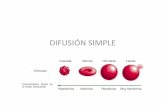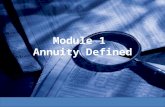La familiaris, un dieu simple
Transcript of La familiaris, un dieu simple
173
MAURIZIO BETTINI
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE
SUR LE LAR FAMILIARIS
En vous présentant ce texte, mon intention est double : d’un côté, réfléchir sur un sujet qui m’a toujours intéressé, le Lar familiaris des Romains ; de l’autre, tirer profit de ce sujet pour développer des réflexions plus spécifiquement méthodologiques, sur l’emploi des outils conceptuels propres à l’anthropologie dans les études sur la culture romaine. Il s’agit donc d’un exercice sur le Lar. Étant donnée l’occasion dans laquelle mon exposé s’inscrit, il est évident que le versant « sujet » des mes réflexions pourra être parfois sacrifié au versant « méthode ».
1. Quelqu’un de la famille
Le volume des recherches consacrées aux Lares de ces cent cinquante dernières années est imposant. Par conséquent, il peut sembler dif-ficile d’ajouter quoi que ce soit à ce dossier1. Cependant, il y a un texte latin duquel peuvent encore venir des suggestions nouvelles. Il s’agit du prologue de l’Aulularia de Plaute, où un Lar familiaris monte directement sur la scène pour nous parler non seulement des membres de sa famille – personnages en vérité plutôt mesquins, à part la jeune fille – et de l’action qui va se dérouler au cours de la comédie, mais aussi de lui-même. Un examen attentif de cette
1 Voir le numéro 73 (2007) de la revue Lares, entièrement consacré à la divinité éponyme, dans lequel une version abrégée de ce travail a déjà paru. Ce numéro de Lares, en particulier avec l’article de G. DE SANCTIS, « Lari », p. 477-527, offre aussi un riche dossier bibliographique sur le Lar.
174
MAURIZIO BETTINI
scène devrait tout de même nous fournir quelques informations de plus sur ce personnage. Commençons par écouter sa voix2 :
Ne vous demandez pas qui je suis, je vais vous le dire en quel-ques mots. Je suis le Lar familiaris de cette maison (ex hac fami-lia), d’où vous m’avez vu sortir. Depuis bien des années, je possède et prends soin (possideo et colo) de cette maison (do-mus), pour le compte du grand-père et du père de celui qui maintenant l’habite. Le grand-père de cet homme, me conju-rant de ne rien dire (obsecrans), à l’insu de tout le monde me confia un trésor en or : il l’ensevelit dans le foyer (in medio foco / defodit) et me supplia (venerans) de le lui garder. Au mo-ment de sa mort – telle était son avarice – il ne voulut pas révéler son secret, pas même à son fils, et préféra le laisser dans la misère, plutôt que de lui montrer où se trouvait le trésor. Il lui légua un bout de terre plutôt petit, avec lequel ce fils ne réussissait à survivre qu’au prix de grandes priva-tions. Après la mort de celui qui m’avait confié l’or, je com-mençai à observer pour voir si par hasard le fils m’honorerait mieux que son père. Mais pas du tout, il prenait de moins en moins soin de moi, et m’honorait de moins en moins. Je lui ai rendu la pareille (item a me contra factum est) ; de fait, il est resté pauvre jusqu’à sa mort. Lui aussi laissait un fils, celui qui habite à présent cette maison, qui a les mêmes habitudes que son père et que son grand-père. Mais il a une fille, et elle, par contre, m’offre tous les jours de l’encens, du vin ou autre chose, et me fait don de couronnes. Alors moi, pour la remer-cier de sa dévotion (eius honoris gratia), j’ai fait en sorte que son père, Euclion, trouve chez lui le trésor. Ainsi, s’il veut la marier, il pourra le faire plus facilement. Et en effet, un jeune homme, d’une famille très importante, a pris la jeune fille par la force. Le jeune homme sait bien qui est celle qu’il a violée, mais elle ne le connaît pas, et son père ne sait rien de ce qui est arrivé. Je ferai donc en sorte que le vieux, qui habite ici tout près (hic senex de proxumo) demande la jeune fille en ma-riage. Je le ferai dans ce but, pour que le jeune homme qui l’a violée puisse l’épouser plus facilement. En effet, le vieux est l’oncle maternel (avunculus) du jeune homme qui a violé la jeune fille lors des fêtes nocturnes de Cérès (Cereris vigiliae).
2 PLAUTE, Aulularia, 1-36 : W. STOCKERT, Plautus. Aulularia, Stuttgart, Teubner, 1983 (avec un commentaire encore extrêmement utile).
175
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
Cette trame contient tous les ingrédients typiques de la nouvelle comédie. Une gentille jeune fille s’est fait violer lors d’une céré-monie nocturne (les Cereris vigiliae cachent vraisemblablement une fête grecque originale, comme les Tesmophores3) : et ces prémisses laissent déjà prévoir une série d’incidents et de malen-tendus, se soldant par une fin apportant à cette affaire une heu-reuse solution. Comme l’exigent les règles de la trame comique antique4. Quant à la persona loquens du prologue, le Lar familiaris, il serait oiseux de se demander qui occupait sa place dans l’original attique : Hestía ? Pístis ? Un héros ? Un theós ephéstios5 ? En fait, Plaute réécrivait la scène pour un public romain, et il y a introduit un Lar familiaris. Puisque, chez eux, les spectateurs honoraient cette divinité et qu’ils en connaissaient bien les caractéristiques et les attributs, nous pouvons supposer que le poète en a fourni une image présentant une certaine conformité avec leur horizon d’attente. En d’autres termes, on a quelque raison de penser que Plaute a mis en scène un dieu « à la romaine ». Essayons de suivre les lignes de ce prologue selon notre point de vue : repérer la nature et le comportement du Lar familiaris.
La présentation que ce dieu fait de lui-même est déjà intéres-sante. En effet, il se qualifie de Lar [...] familiaris ex hac familia. Le lien subsistant entre Lar et familia – entendue comme groupe formé de toutes les personnes, libres et esclaves, soumises à l’autorité d’un pater familias – est hors de discussion dans la société romaine. Il suffit de penser que quiconque abandonne la familia abandonne son Lar ; par contre, si la familia se déplace dans une nouvelle domus, son Lar déménage avec elle, et c’est lui le premier qu’on honore6. On
3 Cf. STOCKERT, Plautus, p. 43, v. 36.4 M. BETTINI, Verso un’antropologia dell’intreccio, Urbino, Quattro Venti, 1991,
p. 11-15.5 STOCKERT, Plautus, p. 37.6 On peut opposer un épisode de PLAUTE, Mercator, 842 (Carinus abandonne
la maison paternelle pour s’en aller loin : Ego mihi persequar [...] alium Larem) et de Trinummus 39-42 (Calliclès ordonne d’offrir des couronnes au Lar après le déménagement). D’autres matériaux en abondance in G. WISSOWA, s.v. « Lares », W. ROSCHER, Ausführliches Lexicon der Griechischen und Römischen Mythologie, II/2, Hildesheim, Olms, 1978 (1886-1890), p. 1868-1898 (en part. 1878). D.G. ORR, « Roman Domestic Religion », in Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, Berlin – New York, Walter De Gruyter, 1978, vol. XVI/2, p. 1563-1569 ; G. DUMÉZIL, La religion Romaine archaïque, Paris, Payot, 1974, p. 347-350 ; pour d’autres définitions de la familia, cf. infra.
176
MAURIZIO BETTINI
pourrait donc dire que le Lar est la familia, qu’il la représente. Mais de quelle façon ? On ne peut s’empêcher de remarquer que Plaute exprime ce lien en usant d’une étrange syntaxe : Lar [...] familia-ris ex hac familia. Qu’on me pardonne la pédanterie linguistique et philologique – on verra plus avant que cette pédanterie peut aussi révéler une inattendue valeur théorique – mais dans un cas de ce genre, on s’attendrait à un génitif, huius familiae, indiquant simplement la sphère de l’action à laquelle le dieu se réfère. Alors pourquoi cet ex ? Sans doute le Lar veut-il se présenter comme un dieu qui « provient » de cette familia ; ou mieux, vu que déjà chez Plaute ex suivi de l’ablatif recouvre l’espace du partitif, le Lar voudrait insister sur son «appartenance» à la familia, au groupe social constituant sa sphère d’action7. Quoi qu’il en soit, au moyen de cette singulière expression – ex hac familia – le Lar ne se présente pas comme une divinité qui se place sans discussion au sommet de la familia, mais plutôt comme quelqu’un qui en fait partie, ou en provient. C’est curieux. On attendrait d’un dieu qu’il affirme sa souveraineté, ou son contrôle, sur la sphère d’action qui lui est propre. Mais non. Le Lar préfère se désigner simplement comme une « partie » de cette familia.
Continuons à suivre le discours du dieu. Immédiatement après avoir déclaré son identité, il ajoute un élément plus intéressant que sa simple « appartenance » à la familia : une limitation temporelle de sa divinité. « Cela fait bien des années désormais », dit-il au vers quatre, « que je suis le Lar de cette maison ([...] iam multos annos est cum [...]) ». Nous avons donc affaire à un dieu dont l’existence et la divinité ont eu un commencement, correspondant vraisemblable-ment au moment où l’avus (celui qui avait caché le trésor) a créé la familia qui encore se perpétue dans cette domus. Voilà probablement pourquoi ce Lar se perçoit comme une « partie » de la familia qu’il protège, déclare qu’il en « vient » : sans cette familia, lui-même n’existerait pas, ils ont commencé ensemble. Ce qui signifie que sa dispersion ou son extinction entraînera la disparition du Lar. De ce point de vue, le Lar ressemble au genius, cette divinité personnelle qui assiste chaque mâle romain de sa naissance à sa mort. Le genius
7 Sur ex cf. J.B. HOFMANN, A. SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, Mün-chen, Beck, 1972, p. 265. STOCKERT (Plautus, p. 38, v. 2) formule l’hypothèse de l’explication de ex – sprachpsychologisch – par l’influence du unde qui suit, mais il n’a pas vraiment l’air d’y croire (vielleicht).
177
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
est un dieu dont l’existence commence avec la venue au monde de la personne dont il est le comes, selon le mot d’Horace, et s’efface à la mort de ce dernier. On serait tenté de penser que le genius est à chacun ce que le Lar est à toute une familia : tous deux sont des dieux dont l’existence, et l’action, sont nécessairement passibles de limites temporelles ; tous deux représentent des « personnes » ou des groupes de personnes spécifiques – nous dirons aujourd’hui : des dieux qui ont un nom et un prénom – et qui comme tels paraissent nécessairement limités, aussi bien dans leur durée que dans le rayon de leur intervention8. Mais continuons à suivre le discours de Plaute.
Le Lar désigne la domus dont il représente la divinité en usant d’une expression qui pourrait tromper le lecteur ou le spectateur moderne : hanc domum [...] possideo. Revendique-t-il la « propriété » de cette domus en affirmant qu’il en est en quelque sorte le seigneur et maître ? Non. Voilà encore de la pédanterie philologique. Chez Plaute, le verbe possideo n’indique pas la propriété privée, mais : eine tatsächliche Gewalt sur un morceau de l’ager publicus ; concordant avec le juriste Gallus Aelius, pour qui le terme possessio signifiait usus quidam agri aut aedificii (« usage déterminé d’un champ ou d’un édifice »)9 : en d’autres termes, possidere et possessio n’indiquent pas la propriété privée d’un champ ou d’un édifice, mais une possession qui se manifeste sous la forme d’un usus. Le bien n’appartient pas à celui qui en jouit. Donc, le Lar, depuis bien des années, « occupe » la domus où il déploie son action : il y exerce sa fonction divine, mais n’en est pas le propriétaire.
8 HORACE, Epistolae, II, 2, 187 ; sur genius G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München, Beck, 1971 (1912), p. 175-181 ; H. KUNCKEL, Der Römische Genius, Heidelberg, Kehrle Verlag, 1974 ; ORR, « Roman Domestic Religion », p. 1569-1575 ; S. MATTERO, « Gluttonous genius », Arctos 26 (1992), p. 85-96. Natu-rellement nous n’affirmons pas, comme cela est arrivé plusieurs fois par le passé, que genius et Lar sont à l’origine une seule divinité (ou une transformation de l’une à l’autre : WISSOWA, ibid.). Comme on pouvait s’y attendre, la représentation de la divinité dans le culte domestique peut s’accompagner de celle du genius paterfamilias (ou de la iuno matrisfamilias) : V. TRAN TAM TINH, s.v. « Lares », Lexicon iconographicum mythologiae classicae, VI/1, Zürich – München, Artemis, 1981-1997, p. 205-212 (en part. 212).
9 M. KASER, Eigentum und Besitz im älterem römischen recht, Köln – Graz, Böhlau, 1956, p. 239 sq. et 314 sq. ; STOCKERT, Plautus, p. 38-39 ; GALLUS AELIUS in FESTUS, De verborum significatu, p. 260, 28 sq. Lindsay (= fr. 15 Funaioli : Grammaticae Romanae fragmenta, collegit recensuit H. Funaioli, Lipsiae, in Aedibus B.G. Teubneri, 1907, vol. I, p. 549).
178
MAURIZIO BETTINI
Observons maintenant le verbe colo, coordonné avec le verbe possideo, et les deux datifs qui suivent : Hanc domum [...] possideo et colo / patri avoque iam huius qui nunc hic habet. Le dieu occupe cette maison depuis de nombreuses années et prend soin d’elle – en quelque sorte il la « cultive » (colo) – pour le compte du père et du grand-père de celui qui l’habite actuellement, c’est-à-dire Euclion. Nous comprenons mieux la position du Lar familiaris dans la familia d’où il « provient » ou dont il « fait partie ». Le Lar est vraiment un dieu singulier : il a simplement l’usus et la possessio de la maison où habite sa familia de référence, et dont il prend soin comme un colonus cultive un morceau de terre qui ne lui appar-tient pas, pour d’autres personnes10. Dans un fragment d’Ennius, il est dit que Lar curat (« prend soin ») de la maison (tectus) dans tous ses aspects (funditus). Avec cette définition, nous continuons à nous trouver dans une dimension où il s’agit de s’occuper de, d’administrer, de cultiver. Le Lar prend soin (curat) de la maison comme on le fait d’habitude pour le repas, les courses, le vin, la vigne, la ruche, et ainsi de suite11.
Pour conclure, le Lar de Plaute se présente comme quelqu’un qui s’occupe de sa familia et de sa maison, plutôt que comme un seigneur ou un maître de maison. Sous nos yeux se dessine un Lar familiaris dont la divinité est assez limitée12. À quelle espèce de divinité avons-nous donc affaire ? Nous n’avons qu’à poursuivre la réflexion.
10 Cf. les observations de STOCKERT, Plautus, p. 39, v. 4. Difficile d’évaluer l’affirmation de DUMÉZIL, Religion romaine, p. 348 : selon lui, l’expression hanc domum [...] possideo et colo du Lar familiaris « résume bien, en deux verbes, la théorie de sa fonction » ( ?).
11 ENNIUS, Annales, fr. 619 Skutsch : Vosque Lares nostrum tectum qui funditus curanti ; sur l’usage de curare cf. Oxford Latin Dictionary s.v. Encore chez PLAUTE, Rudens, 1207, on dit des Lares qu’ils auxerunt « ont garanti le bien-être » de la familia (je me suis occupé du sens de augeo in M. BETTINI, Alle soglie dell’autorità, introduction à B. LINCOLN, L’autorità, Torino, Einaudi, 2000 [1994], p. VII-XXXIV) ; tandis que dans Mercator, 835 on attribue au Lar la fonction de tutari « protéger » la res familiaris.
12 À ce propos, nous pouvons ajouter que Plaute ne semble pas doter son Lar de la vertu de l’omniscience : pour savoir si le fils entend l’honorer plus que son père, il doit « attendre pour voir » comment celui-ci se comporte, il ne sait pas d’avance ce qui va arriver (v. 16) ; il semble en général disposer d’un pouvoir assez modeste. Pour bien évaluer ces caractéristiques attribués par Plaute à son Lar (relevées par l’analyse philologique de K. ABEL, Die Plautusprologe, Thèse de doctorat, Frankfurt, 1955, p. 42 : STOCKERT, Plautus. Aulularia, p. 37), il faudra aussi considérer les nécessités imposées au Lar-personnage par le récit comique.
179
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
2. Succinti Lares
Nous allons envisager le Lar sous un aspect qu’on aurait tort de sous-estimer, son habillement. Nous avons la chance de posséder de nombreuses statuettes et peintures qui représentent cette divi-nité et, par conséquent, d’élargir le contexte culturel de notre Lar à l’aide des images. Il s’agit généralement de jeunes hommes habillés d’une tunica courte, au-dessus du genou, et visiblement serrée à la taille13. La tunica était évidemment quelque chose de bien différent des vêtements plus spécifiques et caractéristiques comme la toga du citoyen, la paenula du voyager, la synthesis de celui qui se rend au banquet, et ainsi de suite. Voyons donc de plus près le réseau des pertinences dans lesquelles la tunica s’inscrit.
Quand la tunica était revêtue par les sénateurs et les chevaliers, elle était marquée par la présence de clavi : des bandes rouges plus étroites dans le cas des chevaliers (angustus clavus) et plus larges dans le cas des sénateurs (latus clavus)14. En général, la tunica pouvait être utilisée soit comme sous-vêtement, par exemple sous la toga, soit comme vêtement principal. Si les classes les plus élevées pouvaient se servir de la tunica dans les deux fonctions, les classes les plus humbles l’utilisaient comme vêtement tout court. Il ne s’agissait pas seulement d’esclaves – selon les prescriptions de Caton, ils devaient revêtir une tunique de trois pieds et demi exactement – c’était aussi le « petit peuple » en général qui se revêtait de la tunica. On le sait, la tunica est l’habit des classes humbles (le tunicatus populus). Ce n’est pas un hasard si les membres de la classe inferieure étaient
13 TRAM TAN TINH, s.v. « Lares », VI/1, p. 205-212 ; les reproductions de nom-breuses images des Lares in VI/2, p. 97-102.
14 Sur l’usage de la tunica cf. J. MARQUARDT, La Vie privée des Romains, tra-duit par V. Henry, Paris, Thorin et fils, 1893, vol. II, p. 192 ; G. BLUM, Tunica, in C. DAREMBERG, E. SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, Graz, 1969, vol. V, col. 534-540 (en part. 538) ; A. T. CROOM, Roman Clothing and Fashion, Gloucestershire, Briscombe, 2002, p. 31-41 ; riche en matériaux le travail de M. PAUSCH, Die römische Tunika. Ein Beitrag zur Peregrinisierung der antiken Kleidung, Augsburg, Wissner Verlag, 2003, p. 49-70 (et passim) ; sur les clavi en particulier MARQUARDT, La Vie privée, p. 184-187 ; PAUSCH, Die römische Tunika, p. 104-127 ; on notera aussi que la présence de clavi sur la tunique des nombreux « bronzetti » (entre les quels aussi des statuettes des Lares : TRAM TAN TINH, s.v. « Lares », no 15, 50, 54 ; PAUSCH, Die römische Tunika, Abbildung no 88, et p. 117-118), ne peut pas être interprétée comme signal du rang partagé par le maître de maison : ainsi Pausch, contre une thèse largement acceptée et soutenue aussi par TRAM TAN TINH, s.v « Lares », VI/1, p. 211.
180
MAURIZIO BETTINI
appelés tunicatus popellus « petit peuple tuniqué », par opposition au groupe des togati, le citoyens romains, que Virgile, dans un vers aussi célèbre qu’emphatique, définissait explicitement comme gens togata15.
Regardons maintenant de plus près cette opposition entre toga et tunica, voire entre tunicatus popellus d’un côté et gens togata de l’autre. Il y avait des occasions dans lesquelles cette distinction s’effaçait. On sait qu’à l’intérieur de la maison, ou dans la paix champêtre de la villa, même les citoyens qui dehors revêtaient la toga, avaient l’habitude de lui préférer simplement la tunica. Cette pratique est extrêmement intéressante pour notre propos. En reve-nant à ce que l’on disait auparavant, nous pourrions affirmer que la tunica se présente comme un vêtement « sans marque » non seulement par ce qu’elle était commune à tous les membres de la communauté – quoique dans des formes différentes – mais aussi parce que, lorsque ce vêtement est porté dans l’espace domestique – c’est à dire dans le territoire du Lar – il convient autant au pauvre qu’au riche, à l’esclave comme au dominus. Revêtu de sa tunique, le Lar familiaris se présente comme un dieu qui s’habille de façon domestique et « sans marque » de la familia dont il fait partie. On pourrait aussi ajouter que, de ce point de vue, le Lar familiaris occupe une position symétrique par rapport à une autre divinité de la maison, le Genius. Si le Lar familiaris est habillé d’une tunique, le Genius est plutôt revêtu d’une toga : le Genius est en effet une divinité togata. Pour définir la position réciproque de ces divinités – qui occupent toutes les deux l’espace domestique – la culture romaine se sert aussi du code vestimentaire. Mais ne quittons pas notre Lar. Après ce qu’on a vu, nous pouvons confirmer le fait que le code vestimentaire fait de la tunica d’intérieur – territoire du Lar – un habit « sans marque », qui efface les distinctions sociales, les neutralise vers le bas. Telles sont les principales caractéristiques de l’habit du Lar dans les images. Qu’en est-il dans les descriptions que nous ont laissées les auteurs antiques ?
15 Pour la tunique des esclaves CATON, De agricultura, LIX : Vestimenta familiae. Tu-nicam p. III S ; sur la tunica comme vêtement des classes pauvres cf. p. es. CICÉRON, De lege agraria, II, 94 (tunicatorum illorum) ; HORACE, Epistolae, I, 7, 64 (tunicato [...] popello) ; TACITE, Dialogus de oratoribus, VII, 4 (tunicatus populus, opposé au togato-rum comitatus di VI, 4, expression utilisée pour indiquer les citoyens), etc. ; VIRGILE, Aeneis, I, 286 (Romanos rerum dominos gentemque togatam).
181
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
Ces descriptions permettent d’observer un trait de l’habille-ment des Lares auquel les Romains semblent accorder une grande importance. Les Lares d’Ovide sont incincti ; ils portent un habit ceinturé à la taille, et donc relevé : nutriat incinctos missa patella Lares (« que la patella nourrisse les Lares à la tunique relevée [ceinturés à la taille] »). Perse, quant à lui, les appelle succinti, dans le même sens : bullaque succinctis Laribus donata pependit (« ma bulle pendit offerte aux Lares à la tunique relevée »)16 . Rappelons que les représentations des Lares déjà citées les montrent aussi portant une tunique serrée à la taille. Ce que nous intéresse, c’est le fait que nos « informateurs » antiques semblent considérer la tunique succinta comme un trait déterminant de l’identité des Lares. Ils évoquent cette caractéristique comme s’il s’agissait d’une épithète – incincti Lares, succincti Lares – capable de synthétiser l’essence même de cette divinité. Comme pour dire qu’un Lar est un Lar quand il porte un habit serré à la taille. Pourquoi mettre l’accent sur ce trait dans la tenue des Lares ? Il faut garder à l’esprit que le fait d’être succincti véhicule à Rome une signification précise. Nous savons en effet que porter sa tunique détachée, être discincti, était consi-déré comme un signe de négligence et de relâchement17 ; tandis que l’action de succingere les habits, pour bouger plus rapidement, dénotait un certain décorum, mais aussi la diligence, la simplicité, la concentration dans le travail. Voici par exemple les mots dont use Ampelisca, une des héroïnes du Rudens de Plaute, pour décrire la prêtresse de Vénus auprès de laquelle il s’est réfugié en compa-gnie de sa s’ur : « je crois n’avoir jamais vu une vieille plus digne (digniorem) [...] avec quelle gentillesse, quelle générosité [...] elle nous a accueillies ! [...] mieux que si nous étions ses filles ! Mais regarde comment elle a serré ses habits [...] (succincta) pour nous réchauffer elle-même l’eau du bain »18 . Si la tunica d’intérieur constitue un habit « sans marque », nous pourrions dire que la bande dont elle est succincta introduit une « marque » spécifique : celle de l’activité, de la simplicité, et du décorum. Les images et
16 OVIDE, Fastorum libri, II, 634 ; PERSE, Satirae, V, 31.17 SÉNÈQUE, Epistolae morales, CXIV, 4 ; PERSE, Satirae, III, 31 ; IV, 22 ; HORACE,
Satirae, I, 2, 25 ; II, 1, 73 ; MARQUARDT, La Vie privée, p. 191-192 ; CROOM, Roman Clothing, p. 33, fournit diverses images de discincti à l’intérieur et à l’extérieur.
18 PLAUTE, Rudens, 406-411. Pour l’usage de succinctus cf. par ex. JUVENAL, Satirae, VI, 445 ; VIRGILE, Aeneis, VII, 187 ; XII, 101.
182
MAURIZIO BETTINI
les descriptions du Lar nous transmettent donc un message dans le langage de l’habillement, mais lequel ?
En substance, celui que Plaute nous avait déjà exprimé sous forme de mots, dans sa syntaxe insolite : le Lar familiaris est un dieu ex hac familia ; il « fait partie » de sa familia. C’est pourquoi l’habit qu’il porte n’est pas marqué, c’est la tunique qui à la maison est portée tant par le maître que par l’esclave ; un vêtement dont la ceinture évoque la simplicité, le décorum et le dévouement au travail. Voyons ensuite d’autres aspects des Lares qui semblent confirmer l’image de la divinité en train de se dessiner. En premier lieu, son rapport privilégié avec les esclaves.
3. Amours ancillaires
Traditionnellement, les esclaves honorent les Lares. On sait qu’au cours des Compitalia, fêtes en l’honneur des Lares compitales, ou Lares « des carrefours », règne un régime de saturnales abolissant l’écart entre esclave et maître. En outre, on offrait aux Lares les chaînes des esclaves qui avaient obtenu la liberté ; les esclaves pouvaient faire partie des collegia cultorum Larum, et ainsi de suite19. Selon Caton, le vilicus n’était pas autorisé à accomplir des sacrifices, sauf dans le compitum, à l’occasion des Compitalia (la fête en l’honneur des Lares, dans ce cas compitales) et dans le focus (le siège du Lar familiaris) : ce qui signifie que, dans les deux cas, il ne pouvait sacrifier qu’aux Lares. Malgré l’interdiction expresse d’accomplir des sacrifices de son propre chef, la vilica, femme du vilicus, sacrifiait elle aussi aux dieux Lares en certaines occasions20. Enfin, l’usage traditionnel à Rome voulait que les esclaves, en compagnie du vilicus, voire de leur maître, prissent leur repas près du foyer, siège du Lar familiaris : ce dernier était lui-même considéré comme un convive, « nourri » au moyen de la patella. Comme le dit Ovide dans un passage que nous venons de lire, nutriat incinctos missa patella Lares (« que la patella nourrisse les Lares ceinturés à la taille »)21 : cette convivia-lité entre hommes libres, esclaves et dieu du foyer nous intéresse
19 Pour la participation des esclaves au culte des Lares compitales, cf. en particulier DENYS D’HALICARNASSE, Antiquiates Romanes, IV, 14, 3-4 ; DE SANCTIS, « Lari ».
20 CATON, De agricultura, V, 3 e CXLIII, 1-2 : cf. W. WARDE FOWLER, « The origin of the Lar familiaris », in Roman Essays and Interpretations, Oxford, 1920, p. 56-64.
21 OVIDE, Fastorum libri, II, 634. Sur les repas en commun près du focus voir
183
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
tout particulièrement. Le Lar nous paraît non seulement un dieu proche des esclaves, mais un dieu qui, en général, ne se soucie pas des différences de condition. Il s’habille de façon « non marquée », prend aussi ses repas avec tous les membres de la famille. Mais que pouvons-nous dire de sa sexualité, ou, si l’on préfère, de ses unions matrimoniales ? Voici pour nous une occasion de faire une brève incursion dans la mythologie romaine.
On racontait que Servius Tullius, comme tant d’autres héros mythologiques, avait été conçu de façon surnaturelle. « Durant le règne de Tarquin l’Ancien », racontait Pline22 , « un organe génital masculin fait de cendres était apparu brusquement dans le foyer (focus) du souverain ; Ocrésia, une esclave (ancilla) de la reine Tana-quille, qui était assise près du feu, se releva enceinte. C’est ainsi que naquit Servius Tullius, qui succéda au règne de Tarquin [...] l’on pensa qu’il était le fils du Lar familiaris. C’est pour cela qu’il aurait institué le premier les Compitalia, jeux donnés en l’honneur des Lares ». Nous n’essayerons pas ici de suivre les ramifications de ce récit mythologique, dans lequel on remplace Servius Tullius par Caeculus, voire par Romulus et Remus23. Bornons-nous à observer que le Lar s’unit à une esclave et donne naissance à un fils qui porte explicitement le nom de Servius « de l’esclave », enfant qui a pour les Lares une dévotion particulière. La prédilection du dieu du foyer pour les amours ancillaires est évidente aussi dans les variantes du récit où une princesse dédaigne de s’unir au miraculeux membre viril apparu dans le foyer : c’est pourquoi elle est remplacée par une esclave24 . Que le Lar familiaris se soit tourné vers une esclave pour mettre au monde un fils – et quel fils : Servius Tullius ! – est important. Non seulement ce dieu se fait honorer par les esclaves, mange avec eux et s’habille de façon à ne pas marquer les différences, mais en plus ses préférences matrimoniales vont aux ancillae25.
en particulier WISSOWA, Lares, p. 1876-1879 (qui recueille les passages) ; pour la patella qui nourrit les Lares, voir infra.
22 PLINE, Naturalis Historia, XXXVI, 204.23 PLINE, Naturalis Historia, XXXVI, 204 ; DENYS D’HALICARNASSE, Antiqui-
tates Romanes, IV, 2 ; PLUTARQUE, De fortuna Romanorum, X, 323 a-c ; ARNOBIUS, Adversus nationes, V, 18.
24 PLUTARQUE, Romulus, II (la naissance de Romulus et Remus selon l’historien grec Promathion).
25 Encore sur le versant mythologique, l’historiola qu’Ovide raconte à propos de la naissance des Lares de Lala / Lara et de Mercurius, nous semble moins inté-ressante : cf. M. BETTINI, « Homéophonies magiques. Le rituel en l’honneur de
184
MAURIZIO BETTINI
Pour comprendre l’origine de cette proximité des Lares avec le monde des esclaves, il n’est pas nécessaire de penser (comme William Warde Fowler) que le culte du Lar familiaris a été introduit dans la domus par les esclaves : ces derniers l’auraient « importé » de celui qu’ils consacraient dans les compita aux Lares compitales, installant ainsi de nouvelles divinités dans le foyer « originaire-ment » occupé par la seule Vesta (quant aux Pénates, ils auraient eu pour demeure originaire le penu)26. Les théories sur l’évolution ont fait leur temps, et nous savons aujourd’hui qu’on n’y voit pas plus clair en distribuant ce qui nous semble contradictoire le long d’une ligne verticale – transformant les incongruités en d’hypothé-tiques phases temporelles. Souvent, cela sert plutôt à masquer des écarts ou des différences précieuses pour la compréhension d’une culture27. Dans ce cas aussi donc, pour rendre raison du fait que les Lares paraissent si proches des esclaves, je crois qu’il suffit de se référer à la constellation de traits que nous avons mis en lumière jusqu’ici : un dieu qui « fait partie » de la familia, dans laquelle les esclaves sont insérés, et qui ne détient aucune propriété sur la domus (dont il est simple possessor ou colonus) ; un dieu à l’habille-ment domestique, sa tunique succincta pouvant aussi bien s’adapter à un homme libre qu’à un esclave, dans la mesure où c’est une personne simple et occupée à travailler. Le Lar n’est pas un dieu « d’importation » des esclaves, mais simplement quelqu’un qui, à l’intérieur de la familia, représente les traits qui unissent, et non ceux qui séparent.
4. Des jouets et des chiens
D’autres intéressantes contiguïtés dans la famille font émerger ce caractère du Lar familiaris. Nous savons par exemple qu’au moment où elles allaient se marier, les jeunes filles de la maison réservaient aux Lares des dons comme une poupée, ou d’autres objets liés à l’enfance. Ces dons indiquent qu’existait aussi un rapport domestique, d’intimité, de familiarité, avec les membres
Tacita dans OVIDE, Fastorum libri, II, 569 sq. », Revue de l’histoire des religions 223/2 (2006), p. 150-172.
26 WARDE FOWLER, The origin.27 Sur ce thème, voir C. VIGLIETTI, « Lares poco familiari », Lares 73 (2007),
p. 553-570.
185
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
les moins importants de la familia28. Observation valable également lorsqu’on quitte la dimension domestique des Lares, pour aller voir un moment dans le domaine public. Dans cette perspective, nous pouvons de nouveau prendre en considération une information qui nous vient d’Ovide et de Plutarque, relative au rapport entre les Lares praestites et le chien.
Aux pieds des antiques statues de ces divinités, les Lares praestites, se trouvait celle d’un chien29. Ces images étaient d’ailleurs parfois enveloppées d’une peau de chien . Ovide et Plutarque nous trans-mettent cette singulière information, en insistant tous deux sur le fait que, comme le chien, le Lar garde et protège la maison. Mais, hormis la garde et la surveillance, nous ne pouvons négliger les autres traits culturels dont les Lares praestites sont investis en vertu de cette contiguïté. Le chien représente l’animal le plus proche de l’homme, au point qu’il fait partie de son groupe – mais, de ce fait, il en constitue le dernier membre, et le plus marginal30. Mis en rapport avec les chiens, voire assimilés à eux à travers une sorte de déguisement, les Lares finissent eux aussi par prendre le rôle marginal de ces animaux au sein du groupe.
Cette surprenante contiguïté canine confirme l’image du Lar ou des Lares que nous nous sommes fait : un dieu qui fait partie du groupe social comprenant non seulement le mâle paterfamilias et les éventuels autres membres « forts » du groupe, mais aussi des esclaves, des jeunes filles, des chiens, etc. De ce point de vue, il faut rappeler que la familia – l’entité sociale à laquelle le Lar se réfère en tant que familiaris – ne comprend pas seulement des personnes humaines, libres ou esclaves, mais s’étend à tout le patrimonium du paterfamilias, y compris les animaux31. Dans un chapitre de son
28 DE SANCTIS, « Lari » ; WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, p. 167-175.29 OVIDE, Fastorum libri, V, 129-142 ; PLUTARQUE, Questiones Romanes, LI ; DE
SANCTIS, « Lari » ; sur l’iconographie des Lares praestites, G. PUCCI, « Lares che gio-cano fuori casa », Lares 73 (2007), p. 529-532 ; voir aussi le denarius de L. Caesius (112 ou 111 av. J.-C.) : deux Lares assis, une lance dans la main gauche, un chien entre les deux ; TRAM TAN TINH, s.v. « Lares », VI/2, p. 89.
30 Cf. C. FRANCO, Senza ritegno. Il cane e la donna nell’immaginario della Grecia antica, Bologna, Il Mulino, 2003.
31 Pour la définition de familia – indiquant non seulement les personnes, libres ou esclaves, soumises à l’autorité du pater familias, mais aussi les biens meubles, immobiliers et animaux qui lui appartiennent – les références les plus intéressantes se trouvent chez TÉRENCE, Heautontimorumenos, 909 (decem dierum mihi vix est familia « j’ai à peine de quoi survivre pour dix jours ») ; Leges XII Tabularum, V, 4 (Fontes
186
MAURIZIO BETTINI
De agricultura, Caton affirme qu’« il est permis de placer les bœufs sous le joug durant les feriae [...] pour les mulets, les chevaux et les ânes il n’y a pas de vacances, sauf celles qui valent pour toute la familia (nisi in familia sunt) ». Ce qui veut dire que « l’appartenance » des animaux à la familia était ressentie non seulement du point de vue du patrimoine, mais aussi du point de vue religieux 32.
5. Entre « émique » et « étique »
Tentons de proposer une définition du Lar familiaris. Ce person-nage divin se présente comme un dieu qu’on dirait volontiers « simple » : puissant mais pas trop, divin mais certainement pas inaccessible. Un dieu « sans façons ». Cette divinité se borne à « faire partie » de sa familia, « jouit » de l’espace qu’elle occupe, en prend soin, sans le posséder ; ce dieu se trouve limité dans sa dimension temporelle ; son habillement semble à ce point « sans marque » qu’il efface toutes distinctions sociales, mais étale, de façon assez emphatique, une « marque » qui évoque le décorum et l’activité ; un dieu proche des esclaves, des petites filles, et même des chiens, qui ne raffine pas dans sa convivialité et s’unit aux ancillae ; un dieu qui, on peut le rappeler à ce point, est souvent représenté sous les aspects d’un jeune et joyeux danseur : un bon copain, si l’on peut dire33 . La définition du Lar que nous venons de suggérer – un dieu simple – pose cependant un problème d’ordre général, que nous allons de suite tenter d’affronter. Voilà le côté plus franchement « méthodologique » de mon exposé.
Pour décrire un segment de la culture antique, il est inévitable que nous usions de mots et de catégories appartenant à notre
Iurisprudentiae, p. 23) ; Rhetorica ad Herennium, I, 23 ; TITE-LIVE, Ab Urbe condita, II, 41, 10 et III, 55, 7 (avec les notes de Ogilvie ad locum : R.M. OGILVIE, A commen-tary on Livy. Books 1-5, Oxford, Clarendon Press, 1965, p. 343-344, 502) ; GAIUS, Institutiones, II, 102 (familiam suam, id est patrimonium suum « sa famille, c’est-à-dire son patrimoine »). Cf. M. FINLEY, L’economia degli antichi e dei moderni, Roma – Bari, Laterza, 1974 (1973), p. 5 ; sur le caractère vraiment « familier » du Lar cf. WISSOWA, Lares, p. 1876 ; DUMÉZIL, Religion romaine, p. 347-348.
32 CATON, De agricultura, CXXXVIII. Si on ne prend pas, comme on l’a fait d’habitude, feriae comme sujet de sunt, mais muli equi asini, la déclaration d’appartenance des animaux à la familia est encore plus explicite : « à moins que (mulets, chevaux, ânes) ne fassent partie de la familia. »
33 Voir TRAM TAN TINH, s.v. « Lares », VI/1, p. 211 ; VI/2, fig. no16-88 ; ORR, « Roman Domestic Religion », p. 1568.
187
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
expérience culturelle. Cela n’empêche pas que, dans le cas du Lar familiaris aussi, mieux vaut, dans la mesure du possible, éviter de résumer ses propriétés et ses caractéristiques en nous servant d’images carrément inhérentes à notre expérience culturelle ; il serait préférable de trouver une description « indigène » ou « locale » de ce dieu, c’est-à-dire venant de la culture romaine. L’anthropologie, du moins celle qu’on pratique depuis une cinquantaine d’années, nous a enseigné la nécessité d’interpréter les cultures en mobili-sant autant que possible des concepts « proches de l’expérience » des populations étudiées, pour citer une formulation de Clifford Geertz. Naturellement, les anthropologues du monde antique ne peuvent espérer fournir des interprétations entièrement construites en utilisant des catégories locales – probablement ne doivent-ils même pas chercher à le faire34. Selon l’avis de Geertz, la tâche du chercheur est la suivante : prendre des concepts proches de l’expé-rience de la population étudiée et « les placer dans une connexion éclairante » avec les concepts que les théoriciens ont façonnés pour « capturer les traits généraux de la vie sociale », ceci afin de « produire une interprétation des façons de vivre propres à une certaine population qui ne soit ni emprisonnée dans l’horizon mental de la même population – une ethnographie de la sorcellerie écrite par une sorcière – ni systématiquement sourde aux tonalités distinctives de son existence – une ethnographie de la sorcellerie écrite par un géomètre. »
Quoi qu’il en soit, dans la pratique de l’anthropologie du monde ancien, il semble également nécessaire de se maintenir le plus près possible de ce niveau d’analyse que – pour adopter une terminologie différente de celle de Geertz, mais qui porte sur des principes méthodologiques semblables – l’on appellerait volontiers « émique », en opposition au niveau dit « étique »: en d’autres termes, de ne jamais perdre de vue un travail d’interprétation qui reste le plus proche possible de la façon dont les antiques concevaient et voyaient leur culture.
Peut-être n’est-il pas nécessaire de rappeler ici l’origine de la catégorie « émique » vs. « étique ». En tous cas, elle s’inspire de l’opposition que les linguistes de la première moitié du XXe siècle
34 Cf. C. GEERTZ, « Dal punto di vista dei nativi », in ID., Antropologia interpre-tativa, Bologna, 1988 (1983), p. 71-90.
188
MAURIZIO BETTINI
avaient créée dans l’analyse des sons du langage : « phon-émique » (les sons selon leur fonction concrète dans un langage donné) vs. « phon-étique » (les sons selon leurs propriétés linguistiques en tant que telles). Pour se limiter à un exemple tiré du latin, imaginons d’analyser la valeur de -n- après voyelle et suivie per -s- (ce qui produit un prolongement de la voyelle et sa contextuelle nasali-sation) par opposition à la valeur de -n- après voyelle et suivie par une consonne dentale : il s’agit d’un travail qui relève décidément d’un approche « phon-èmique » de la langue. Au contraire, une analyse du statut général de -n- en latin – son point d’articulation, son intensité relative, son développement dans les langues romanes, et ainsi de suite – relève plutôt d’un approche « phon-étique » de la langue. De la même façon, la réflexion anthropologique relève d’un approche « émique » chaque fois qu’on utilise des catégories ou des outils conceptuels qui sont tirés de la culture étudiée, tandis qu’elle relève d’un approche « étique » chaque fois qu’on utilise des catégories ou des outils conceptuels tirés plutôt de la culture partagée par l’observateur. Dans le cas de l’anthropologie de Rome, envisager le problème de la religion romaine en termes de divi, religio, ritus, cultus, sacerdos, pontifex et ainsi de suite, relève d’une approche « émique »; tandis qu’utiliser la notion de « polythéisme » relève d’une approche « étique ». De la même façon, le recours à des catégories comme carmen / prosa (oratio), historia (res gestae) / fabula, tragoedia / comoedia, ou parler de fabulae en général, relève d’une approche « émique » ; tandis qu’une définition comme « la littérature latine » relève d’une approche étique35.
Je voudrais aussi souligner le fait que l’origine linguistique – et phonologique en particulier – de la catégorie d’« émique », implique la notion de fonction. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de repérer des éléments « inertes », mais des traits culturels intégrés à l’intérieur d’un système d’oppositions et de corrélations. La di-mension « émique » du carmen, qu’on vient d’évoquer, se définit par opposition à l’oratio, à la narratio, et ainsi de suite, ainsi que par corrélation avec une série des traits stylistiques (comme l’allitération ou la construction isosyllabique dans les formes plus archaïques du carmen), de contextes d’énonciation particuliers, etc.
35 K.L. PIKE, Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour, Glendale, Summer Institute of Linguistics, 1967, en part. p. 8-15.
189
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
D’une manière peut-être inattendue, mon invitation à mettre en valeur le niveau « émique » dans l’analyse de la culture ancienne devrait être donnée pour sûre parmi les classicistes. Il suffirait en effet de remonter aux sources les plus pures de l’historicisme philologique, c’est-à-dire aux principes herméneutiques inaugurés à Göttingen, à la fin du XVIIIe siècle, par Christian Gottlob Heyne (1729-1812). Selon Heyne, le spécialiste qui veut comprendre l’Antiquité doit avant tout quitter la dimension du présent, dont il est entouré, et se faire conduire par le Geist des Alterthums, l’esprit de l’Antiquité, voire le genius des Anciens. Si l’interprète moderne est vraiment intentionné à comprendre Homère, il est nécessaire « qu’il se reporte au temps dans lequel le poète et ses héros ont vécu, de quelque manière en vivant avec eux, en voyant ce qu’ils ont vu, en sentant ce qu’ils ont senti ». Pour Heyne une telle attitude envers l’Antiquité constituait directement « la première règle de l’herméneutique de l’Antiquité ». Cette règle, il l’explicite avec clarté dans son Éloge de Winckelmann : « Chaque œuvre d’art ancienne doit être interprétée et jugée en utilisant les concepts et l’esprit (Geist, Genius) avec lesquels elle avait été réalisée par l’artiste ancien36. » De toute évidence le paradigme épistémologique proposé par Heyne – la nécessité de rentrer en contact avec le Genius (Geist), l’« esprit » des époques anciennes – implique aussi l’exigence de comprendre l’Antiquité de l’intérieur : en substance, il s’agissait déjà de se tenir « proches de l’expérience » de la culture étudiée, selon la formule de Clifford Geertz, voire de partir d’une approche « émique » de la culture ancienne.
Dans tous cas, on ne peut pas se cacher que, dans le domaine de la culture romaine ou ancienne en général, l’opération visant à se tenir le plus près possible du niveau indigène, voire « émique », présente des problèmes spécifiques. Comme c’est évident, l’approche « émique » serait plus facile dans le cas d’une culture vivante, c’est-à-dire capable de produire aussi des informations nouvelles sur elle-même. On a d’ailleurs récemment proposé de segmenter
36 M. HEIDENREICH, Christian Gottlob Heyne und die alte Geschichte, Saur, München, 2006, p. 387-394 ; C.G. HEYNE, Elogio di Winckelmann, 1778, cit. in S. FORNARO, « I Greci barbari di Christian Gottlob Heyne », in C.G. HEYNE, Greci barbari, Argo, 2004, p. 12, 32-33 ; S. FORNARO, « I Greci senza lumi. L’antropologia della Grecia antica in Christian Gottlob Heyne (1729-1812) e nel suo tempo », Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 5 (2004), p. 107-195.
190
MAURIZIO BETTINI
encore la dimension du travail « étique » en deux moments dif-férents : l’interprétation érudite de l’« émique » à travers la pro-duction de données sur le terrain, et la réflexion anthropologique sur l’« émique » une fois que les données sont constituées37. Mais cette dernière condition – la production de données nouvelles sur le terrain – ne se vérifie pas dans le cas de la culture romaine, ou du moins se vérifie très rarement.
Le corpus des informations dont nous disposons est presque entièrement pétrifié : des étagères pleines de textes, littéraires ou épigraphiques, auxquelles s’ajoute la présence de monuments re-censés et interprétés par des spécialistes. La fameuse métaphore de Clifford Geertz, selon laquelle chaque culture coïncide avec « un ensemble de textes [...] que l’anthropologue s’efforce de lire sur le dos de ceux à qui ils appartiennent de droit », peut être référée à la culture romaine d’une façon tout à fait littérale : la culture romaine coïncide réellement avec un « ensemble de textes38 » . Voilà pourquoi, dans ce cas, la recherche d’une définition « indigène » correspond en pratique à une opération herméneutique : on ne peut faire de l’anthropologie « émique » romaine qu’en faisant de la philologie. Il me semble aussi nécessaire de préciser que l’anthropologie du monde antique ne limite pas la tâche de l’herméneutique (entendue surtout comme philologie) à établir un contact entre le « détail local » et la « structure globale » – comme dans l’anthropologie tout court39. L’opération philologique intervient directement dès le moment où se produit un niveau « émique », et pas seulement quand il s’agit d’en faire quelque chose de plus général.
J’ai parlé du caractère fermé du corpus textuel romain, voire de sa cloture. Parmi les conséquences provoquées par cette condition, il y en a une qui présente un intérêt tout à fait particulier : il s’agit de la « valeur émique » entrainée par le lexique romain. En effet, c’est presque exclusivement à travers la langue latine que nos
37 J.-P. OLIVIER DE SARDAN, « Émique », L’Homme 147 (1998), p. 151-156 ; cf. C. CALAME, « L’Histoire comparée des réligions », in M. BURGER, C. CALAME, Comparer les comparatismes. Perspectives sur l’histoire et les sciences des religions, Paris –Milan, 2006, p. 209-235.
38 C. GEERTZ, « Note sul combattimento dei galli a Bali », in Interpretazione di culture, Bologna, 19982 (1973), p. 383-436, en part. p. 436 : les cultures se présentent comme « un ensemble de textes [...] que l’anthropologue s’efforce de lire sur le dos de ceux à qui ils appartiennent de droit ».
39 Cf. GEERTZ, Dal punto di vista dei nativi.
191
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
connaissances de la culture romaine nous ont été aussi transmises que filtrées. Voilà pourquoi il faut toujours regarder avec des yeux bien ouverts le lexique de cette langue pour profiter de toutes les perspectives que les mots latins ouvrent devant nous. Si l’on pra-tique cet exercice d’observation lexicale avec constance, on aura la possibilité de remarquer que maintes fois les Romains exprimaient des notions que nous aussi partageons, mais en suivant des chemins sémantiques différents. Quand les Romains évoquaient la notion du « monstrueux », ils ne le faisaient pas en se référant au caractère de « difformité, laideur monstrueuse » (définition tirée du Trésor de la langue française), mais en se déplaçant plutôt dans l’espace sémantique du « rappeler » ou du « mettre en garde » : monere (mon(e)s-trum). C’est à dire qu’ils définissaient le « monstrueux » en tant que phénomène qui monet, qui mobilise la mémoire ou la mens des hommes en leur rappelant (monere) que la pax deorum a été violé et qu’il faut en découvrir la cause. Voilà un exemple banal de ce que j’entends par regarder le lexique latin les yeux bien ouverts. Le monstrum des Romains n’a pas beaucoup à faire avec notre « monstre ». Derrière le mot latin s’ouvre un espace qui n’est pas esthétique mais religieux, dominé par la volonté des dieux et par les signes qu’ils envoient aux hommes pour les mettre en garde – le monstrum des Romains ne renvoie pas à la laideur, mais à la sémiotique. Mettre en jeu un signifié, le faire danser entre Rome et nous, entre Rome et la Grèce (pourquoi pas ?), entre Rome et les autres : voici une manière de faire de l’anthropologie « émique » avec les Romains. De ce point de vue, on pourra revenir encore une fois à Christian Gottlob Heyne qui, dans son projet séminal – reconquérir le genius / Geist des anciens –, ne négligeait pas la valeur heuristique des mots issus des langues anciennes pour définir et comprendre les formes de la pensée des anciens40.
Ceci dit, on pourra peut-être mieux comprendre pourquoi – comme on s’en rappellera – afin de recueillir des informations sur le Lar familiaris, on a parfois été forcé d’avoir recours à quelque « pédanterie philologique » : en travaillant sur la culture classique, il faut toujours garder les yeux bien ouverts quand il s’agit du lexique,
40 Cf. supra, p. 4 sq. Sur Heyne et l’intérêt pour la terminologie comme source d’information sur le genius des anciens, voir FORNARO, Greci barbari ; HEIDENREICH, Christian Gottlob Heyne, p. 377-394.
192
MAURIZIO BETTINI
de la syntaxe, des formes de la textualité en général. Revenons donc à notre problème initial. Si, pour décrire le Lar familiaris, nous voulons trouver une formulation « émiquement » romaine – ou une formulation « proche de l’expérience » romaine – il faudra fouiller à la fois dans les étagères de la mémoire, et dans celles du séminaire de philologie classique, en espérant tomber sur quelques textes ou passages ou mots qui soient utiles à notre propos. Dans ce cas, nous sommes tentés d’avoir encore recours à Plaute.
6. Un dieu « étiquement » simple et « émiquement » « moins que menu »
Dans la Cistellaria, un jeune amoureux, Alcesimarque, s’abandonne à une sorte de délire invocatoire. Il s’adresse d’abord aux dei inferi et superi – et même aux medioxumi – puis à Iupiter, Iuno, Ops, Saturnus, Ianus, dans un ordre plutôt bizarre (qui a cependant une certaine logique) ; à la fin, il s’exclame : Di me omnes magni minu-tique immo etiam patellarii [...] (« Que tous les dieux, grands, menus et même de la patella [...] »)41. Selon Alcesimarque, l’ensemble des dieux (di [...] omnes) se dispose le long d’une échelle descendante (magni [...] minuti [...] immo etiam patellarii), où les dei patellarii occupent l’échelon le plus bas, même sous les dieux minuti. On pourrait dire que ces dieux sont considérés comme « moins que minuti ». Mais de quoi s’agit-il quand il est question de ces dieux patellarii ? L’objet évoqué par Alcesimarque, la patella, correspond à la petite assiette qu’on utilisait pour offrir les restes de nourriture aux divinités du foyer42. Cette référence nous oriente immédiatement vers l’espace partagé par les Lares : on se souvient qu’Ovide dit explicitement que les Lares étaient nourris avec la patella (nutriat incinctos missa patella Lares, « que la patella nourrisse les Lares à la tunique relevée »)43. Peut-être est-ce ainsi qu’avec l’aide d’Alcesi-marque nous devons nous imaginer « émiquement » le Lar familiaris
41 PLAUTE, Cistellaria, 522 : sur les problèmes posées par ce texte, BETTINI, Verso un’antropologia dell’intreccio, p. 19-20.
42 Sur la patella PERSE, Satirae, III, 26 ; FESTUS, De verborum significatu, p. 293, 13 Lindsay : WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, p. 162.
43 OVIDE, Fastorum libri, II, 634. Conformément à sa thèse (que les Lares se sont insinués dans le foyer dans un second temps seulement : ORR, « Roman Domestic Religion », p. 1563-1564 ; DE SANCTIS, « Lari », p. 479), Wissowa tendait à référer le plus possibles aux Penates les mentions de dons aux dieux du foyer ; et quand
193
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
des Romains. Un dieu « moins que minutus », dans le sens que le latin donne à l’adjectif minutus : « mineur », « moins important »44, car ce qui est minutus se caractérise par son rapport étroit avec la dimension de l’adverbe minus, qui exprime le fait d’être « moindre ».
Les mots d’Alcesimarque constituent donc une suggestion « émique » permettant de poser sur le Lar familiaris un regard romain. Les caractéristiques que nous avions définies dans la caté-gorie « simplicité », un Romain les fixait vraisemblablement sous celle de « minorité » ou de ce qui a une « importance moins que moindre». De toute façon, les étagères du séminaire de philologie classique nous fournissent une autre opportunité de définition « émique » du Lar.
Dans ses Métamorphoses, Ovide décrit la résidence des dieux par une imagerie très romaine (et très politique). Il oppose les « atria de la noblesse divine » (deorum / atria nobilium) à la plebs des divi-nités ; si les « dieux nobles » résident dans une sorte de « Palatin du ciel » (palatia caeli), cette plebs habite de ci de là (diversa locis), dans les lieux qui ont été impartis à chacun sur la terre. Dans ce cas, on n’établit pas une hiérarchie parmi les dieux en recourant à la catégorie grand / petit, ou plus grand / plus petit, mais direc-tement au modèle, très concret, des différences sociales en vigueur à Rome : nobiles / plebs. Mais de quoi se compose le « peuple » des divinités ? Ovide nous l’explique, dans une autre œuvre, en identifiant explicitement la plebs superum (« peuple des dieux ») à une série de dieux mineurs parmi lesquels, en premier lieu, Fauni, Satyri et nos Lares45. Inutile de dire que cette information
les textes disent le contraire, comme dans le cas d’Ovide, il avance l’hypothèse qu’il s’agit de témoignages relatifs à des phases plus tardives de la religion romaine.
44 CICERON, Brutus, CCXXVI (minuti oratores) ; De divinatione, CLXII (minuti philosophi). Ce terme, dei minuti, sera utilisé par Augustin chaque fois qu’il s’opposera aux dieux romains mineurs (comme ceux qui présidaient à chaque action ou à chaque phase de l’existence) ; ARNOBE, Adversus nationes, II, 3, dans un contexte analogue d’opposition au dieu chrétien, les définit dii minores : M. PERFIGLI, Indi-gitamenta. Divinità funzionali e funzionalità divina nella religione romana, Pisa, ETS, 2004, p. 183-197. Dans ce passage de Plaute, la référencé à la patella nous adresse de façon spécifique aux dieux de la maison et du foyer, que, par ailleurs, la persistance de leur culte rendait particulièrement désagréables aux chrétiens. En 392 ap. J.-C., Théodose interdit expressément d’allumer des lampes, de brûler de l’encens et de pendre des couronnes pour honorer Genii, Penates et Lares (Codex Theodosianus, XVI, 10, 12 : TRAN TAM TINH, s.v. « Lares », VI/2, p. 212).
45 OVIDE, Metamorphoses, I, 171-173 : Dextra laevaque deorum / Atria nobilium valvis celebrantur apertis. / Plebs habitat diversa locis [...] ; Ibis, 79-80 : Vos quoque, plebs
194
MAURIZIO BETTINI
présente de remarquables concordances avec les caractéristiques du Lar Familiaris que nous avons rencontrées jusqu’ici. Il suffit de penser à son habillement, la tunica, qui le place dans le populus ou le popellus tunicatus, le petit peuple, dont c’était le vêtement à Rome. Nous pourrions donc conclure que, d’un point de vue « émique », le Lar est un dieu moins que minutus, moins que « mineur », ou plebeius « appartenant au peuple ». Ceci dit, repre-nons la lecture du prologue de Plaute, et acheminons-nous vers la conclusion de notre discours.
7. Réciprocité et mémoire
Quand l’avus a eu besoin du Lar familiaris pour prendre soin de son trésor, il s’est adressé à lui correctement, au moyen de l’acte de l’obsecrari et du venerari46. Pour cacher son or, l’avus s’est très symboliquement servi du lieu consacré au Lar, le foyer (in medio foco / defodit), et le Lar a exaucé sa prière, gardant le trésor qu’on lui avait confié. Mais à l’égard de la génération suivante, le Lar ne s’est pas montré particulièrement bienveillant : vu que le filius du vieux, et pater d’Euclion, n’a adressé au Lar que de rarissimes soins, et de moins en moins, le dieu lui a rendu la pareille (item a me
superum, Fauni Satyrique Laresque / Fluminaque et Nymphae semideumque genus. Sur le sens politique du passage des Metamorphoses, cf. D. MÜLLER, « Ovid, Iuppiter und Augustus », Philologus 131 (1987), p. 270-288, en part. 276-280 ; A. BARCHIESI, Ovidio. Metamorfosi, Milano, Mondadori, 2005 (Fondazione Lorenzo Valla), vol. I, p. 183. Il me semble difficile que l’expression plebs référée à la divinité de l’Ovide des Metamorphoses désigne les famuli, les « serviteurs » dont disposent les dieux les plus importants ; et que donc ces divinités soient les familia des dei nobiles : voir J. SCHEID, « Hiérarchie et structure dans le polythéisme romain. Façons romaines de penser l’action », Archiv für Religiongeschichte 1 (1999), p. 184-203, en part. 197. Le terme plebs ne peut signifier famuli « serviteurs », mais, en général, le peuple de condition modeste opposé aux nobiles. En outre, même sans considérer l’explication explicite de cette formule contenue dans l’Ibis, la suite du texte des Metamorphoses éclaire le fait que les dieux évoqués par Ovide comme plebs correspondent aux divinités mineures. Voir I, 192-193 : Semidei [...] rustica numina Nymphae / Faunique Satyrique et monticolae Silvani ; I, 595 : nec de plebe deo ; ailleurs dans le poème aussi des épithètes semblables sont référés de façon analogue aux divinités mineures : XIII, 586 : Inferior [...] diva (Aurora) ; XV, 545 : De disque minoribus unus (Virbio). La note de F. BÖMER, P. Ovidius Naso. Metamorphosen, Buch I-III, Heidelberg, Carl Winter, 1977, p. 79, fournit de nombreux éclaircissements sur ce thème.
46 Obsecrare est opem a sacris petere : FESTUS, De verborum significatu, p. 207, 7 Lindsay ; sur la valeur de venerari, cf. en particulier R. SCHILLING, La religion Romaine de Venus, Paris, De Boccard, 1954, p. 33-38.
195
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
contra factum est), en le faisant mourir dans la pauvreté. Au contraire, puisque la jeune fille l’honore de vin, d’encens etc., il se montre généreux envers elle, faisant en sorte qu’Euclion trouve le trésor en échange des honneurs qu’il reçoit de sa fille (eius honoris gratia).
On le voit, les rapports entre le dieu et la familia se placent sous le signe de la réciprocité ; entre les deux parties règne un régime d’échange. Le Lar exauce les prières de ceux qui s’adressent à lui de la bonne manière, il rend les « honneurs » (huius honoris gratia) et restitue à chacun la monnaie de sa pièce (contra facere), niant sa bienveillance à qui le néglige. À travers les mots de son Lar, Plaute nous fournit un précieux témoignage de la façon dont les Romains pouvaient ressentir leur rapport concret avec cette divinité. Et en particulier, sur la façon d’imaginer ses réactions aux comportements qu’ils adoptaient à son égard.
Le Lar s’insère dans un circuit de réciprocité dont les modalités sont tout à fait similaires à celles des partenaires humains : si les autres donnent correctement, il donne aussi, sinon, il bloque le flux de l’échange. Dans le circuit du donner et de l’avoir – d’un côté des prières et des honneurs, des bénéfices et une protection de l’autre – le Lar n’agit pas comme un partenaire démesuré, excédant dans un sens ou dans l’autre. Au contraire, il veille à gar-der l’équilibre de la réciprocité. On pourrait dire que l’essence du comportement du dieu se résume dans le mot gratia, dont il se sert pour expliquer pourquoi il s’est décidé à révéler son secret au père de la jeune fille : eius honoris gratia (« pour rendre les hon-neurs [qu’elle me fait] »). Cicéron donne en effet cette définition de gratia, concept clé du langage de la réciprocité : « Ce en quoi réside la mémoire (memoria) de l’amitié et des bienfaits reçus (offi-ciorum) d’un autre, ainsi que la volonté de répondre47. » De la gratia, disposition à répondre, fait strictement partie aussi la memoria de ce que l’on a (ou n’a pas) reçu : le mécanisme de la réciprocité agit en tenant compte, à travers la mémoire, du comportement de nos partenaires. Et le Lar semble avoir une très bonne mémoire.
47 CICÉRON, De inventione, II, 162 : Gratia, in qua amicitiarum et officiorum alte-rius memoria et remunerandi voluntas continetur ; cf. aussi II, 66 : Gratiam, quae in memoria et remuneratione officiorum et honoris et amicitiarum observantiam teneat ; cité par M. LENTANO, Seneca e il giovane Holden. Il De beneficiis, le declamazioni e una possibile interpretazione del trattato, en cours de parution.
196
MAURIZIO BETTINI
8. Mariage, avunculat et vicinitas
Occupons-nous enfin du but que se fixe le Lar de Plaute, les noces de réparation entre la fille d’Euclion et celui qui l’a violée. Qu’un Lar s’occupe de mariage n’a rien d’étrange : le texte de Plaute présente une fois encore une remarquable syntonie avec le contexte anthropologique dans lequel le Lar s’inscrit. Selon le rite nuptial décrit par Varron, les épouses romaines antiques avaient l’habi-tude d’emporter trois asses. Elles en tenaient un en main, qu’elles donnaient à leur mari ; le second, qu’elles avaient sur le pied, elles le posaient sur le foyer des Lares familiares ; le troisième, qu’elles avaient dans leur sac, elles avaient l’habitude de l’offrir au compitum vicinale48. On le voit, les Lares étaient bien présents dans l’horizon matrimonial des Romains, tant sous la forme de divinités du foyer que sous celle de divinités des compita : en apprenant qu’un Lar devait s’occuper de noces, le public de Plaute aura donc simple-ment pensé qu’il faisait son métier. Voyons ensuite la stratégie que le Lar met en œuvre pour arriver à ses fins, à savoir pour favoriser les noces de la jeune fille.
Le dieu, nous le savons, a l’intention de promouvoir la demande en mariage d’un vieillard qui habite à côté (hic senex de proximus), un « voisin ». Il s’agit de l’oncle maternel (avunculus) de celui qui a violé la future épouse. Tel est donc ce futur époux, le vieux Megadore, qui sera sollicité par le Lar au cours de la comédie. Le rôle de « prête-main » de la jeune fille, si je puis dire, qui est ici attribué à l’oncle maternel du jeune homme, dérive vraisembla-blement de la structure de l’original grec de la pièce. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit aussi d’un rôle qui convient parfaitement au type de relations qui liaient, à Rome, l’avunculus et le sororis filius, l’oncle maternel et son neveu utérin. Il s’agissait de relations empreintes de bienveillance, et de familiarité, tout le contraire de ce qui advenait entre le patruus, l’oncle paternel, et le fratris filius, qui présupposait une sévérité devenue proverbiale. Un Lar pouvait bien s’attendre d’un avunculus, personnage indulgen-
48 NONIUS MARCELLUS, De compendiosa doctrina, 852, 8 Lindsay (= VARRON, De vita populi Romani, fr. 304 Salvadore : M. Terenti Varronis fragmenta omnia quae extant, collegit recensuitque Marcello Salvadore, Hildesheim, Olms, 2004, p. 63) ; cf. DE SANCTIS, « Lari », p. 516-517. Sur le mariage par coemptio, cf. P.E. CORBETT, The Roman Law of Marriage, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 78-85.
197
ENTRE « ÉMIQUE » ET « ÉTIQUE ». UNE EXERCISE SUR LE LAR FAMILIARIS
tissimus selon Sénèque, qu’il soit disposé à renoncer à la jeune fille en faveur de son neveu49. Voilà encore un cas dans lequel les catégories de l’anthropologie – cette fois celle de la parenté – nous aident à mieux saisir le sens du texte ancien. Venons-en à l’autre information qu’on nous donne, tout aussi importante du point de vue de l’anthropologie du monde romain : le vieillard, on nous le dit, habitait là tout près (de proxumo), il s’agit d’un « voisin ».
Au sujet de la fête des Lares compitales (ou mieux des héroes pronópioi, selon les termes de l’auteur), Denys d’Halicarnasse met en évidence le fait que ce culte était rendu par les esclaves, mais aussi que, selon les prescriptions de Servius Tullius, « à chaque carrefour on devait ériger des petits temples aux héroes pronópioi pour le compte de voisins (hupó tón geitónon) ; il ordonna ensuite que chaque année soient célébrés des sacrifices en leur honneur et que chaque maison (oikía) contribue avec une fougasse au miel ; il ordonna aussi que ceux qui célébraient les sacrifices aux carrefours pour le compte des voisins (tón geitónon) ne soient pas assistés par des hommes libres mais par des esclaves 50. » On le voit, le culte des Lares compitales est le culte du voisinage. Ce sont les géitones, les « voisins », les oikíai « maisonnées » contiguës que doivent honorer ces divinités. Ceux qui partagent un espace commun, comme celui qui se développe autour d’un compitum, partagent aussi un culte particulier : et ce culte est consacré aux Lares.
Le fait est que, dans la société romaine, les vicini paraissent insérés dans un réseau de rapports réciproques dont la religion ne constitue qu’un aspect. Par exemple, Denys d’Halicarnasse encore nous apprend que, selon une prescription de Romulus, quand les parents d’un enfant infirme ou né difforme avaient l’intention d’exposer cette créature (ce qui était licite), ils devaient avant le montrer à « cinq hommes du voisinage » (pénte andrási tóis éggista oikóusi) pour recueillir leur opinion à ce propos51. Nous connaissons le pouvoir de vie et de mort qu’un paterfamilias pouvait exercer sur sa progéniture : pourtant il était tenu de consulter ses voisins avant d’accomplir un acte qui, bien que cruel, était cependant conforme à ses pouvoirs. Évidemment les voisins formaient un
49 M. BETTINI, Antropologia e cultura Romana, Roma, Carocci, 1998, p. 50-76.50 DENYS D’HALICARNASSE, Antiquitates Romanae, II, 14, 3.51 DENYS D’HALICARNASSE, Antiquitates Romanae, II, 15, 2.
198
MAURIZIO BETTINI
groupe social doté d’une autorité particulière en matière de pro-géniture. Il faut ajouter que, dans la société romaine ancienne, les « voisins » étaient probablement les partenaires les plus fréquents de l’échange matrimonial, comme c’est le cas dans de nombreuses sociétés. En latin, les parents par mariage portent un nom (adfines) qui rappelle à la fois le rapport de parenté, d’affinité, et la « proximité » ou le « voisinage », à savoir la « communauté de la limite » ; dans l’espace agricole : adfines in agris vicini sive consanguineitate coniuncti (« se disent adfines ceux qui sont voisins dans les champs ou unis par consanguinité »)52. Les voisins, les gens qui habitent in proxumo ou proxumae viciniae, comme disaient les Romains, sont insérés dans un réseau d’obligations, d’avantages et en général de rapports réciproques, parmi lesquels le partage d’un culte des Lares. Dans ce sens, le Lar familiaris qui inclut dans ses plans un membre du voisinage, comme celui de l’Aulularia, ne fait que refléter cette invisible, mais traditionnelle, trame de relations.
52 PAULI FESTUS, De verborum significatu, p. 10, 15 Lindsay.