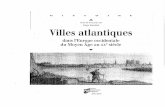Le Réel comme phénomène : étude de l'introduction de L'Etre et le Néant de Sartre.
La bibliothèque comme lieu réel, virtuel et rituel.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La bibliothèque comme lieu réel, virtuel et rituel.
Remerciements
Je remercie très sincèrement mes directeurs de mémoire, Manthos Santorineos et Chu-Yin
Chen, professeurs au département des études et de la recherche aux Beaux-Arts d’Athènes et Paris
8 respectivement, dont je tiens à saluer la disponibilité, la gentillesse et le crédit qu’ils ont accordé à
mes idées. Leurs conseils judicieux et leur apport critique m’ont permis de nourrir le développement
de ma pensée et de vraiment profiter mes études, avec des personnes pionnières comme eux dans
leur art. Cependant, bien que n’ayant pas supervisé mon travail de près, je ne pouvais pas oublier de
remercier Marie-Hélène Tramus où à un moment crucial m'a montrée sa confiance avec une grande
pédagogie.
Au final, je veux remercier la Fondation Nationale de Grèce pour la bourse qu’elle m’a octroyée, ce
qui m'a permis de poursuivre mes études à un niveau supérieur.
J’adresse également mes remerciements à tous les enseignants qui constituent le « Master
conjoint Franco-Hellénique Université Paris 8 & Beaux-Arts d’Athènes », Alain Lioret, Voula Zoi,
Nefeli Dimitriadi, Cédric Plessiet, Jean-François Jégo, personnes belles et intéressantes qui
composent une belle peinture de la connaissance européenne.
Mes remerciements chaleureux vont au professeur de Paris 8 Philippe Nys (philosophe,
docteur, maître de conférences Paris 8) pour sa disponibilité et nos discours philosophiques à
l’INHA. Ensuite, j’aimerais bien remercier David Guzmann et François Ferôle (Bibliothécaire à la
bibliothèque de Paris 8). Spécialement, je remercie Gaétan Darquié qui m’a montré généreusement
sa reconnaissance en mes capacités et grâce à lui cet essai a trouvé sa propre direction.
Au niveau personnel, j’adresse ma gratitude profonde à mes parents Eleni et Takis, et à ma
sœur, Ada. Votre soutien est un allié précieux pour toujours. Je remercie mon ami John Bardakos
pour toutes les discussions importantes qu’on fait (surtout dans le métro) à n’importe quelle heure.
Enfin et surtout, je remercie profondément mon compagnon fidèle Mathieu Lavergne, pour sa
patience à comprendre ma pensée grecque labyrinthique, et qui m’a montré le plus beau visage de la
France par son amitié ; grâce à lui, le processus de ce mémoire écrit en français était un voyage
magique, car nous sommes sortis ensemble de ce labyrinthe.
Si Dieu a détruit la Tour de Babel pour créer une langue belle comme les français, il a bien fait.
Enfin, merci Dieu.
5
Résumé
Nous présentons dans ce mémoire un projet d’architecture virtuel inspiré des «Labyrinthes» de
Borges et plus particulièrement de sa « Bibliothèque de Babel ». Nous y avons décelé une taxonomie
et une symbolique capables de se traduire, de donner corps au domaine émergent de la Réalité
Virtuelle. D’une narration littéraire, en faisant usage des mythes, nous trouvons une relation entre
l’espace lisible et l’espace visible. Nous en sortirons les modèles déterminants d’une architecture.
Notre proposition, en plus de la représentation en 3D de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8,
consiste en la création d’un espace virtuel en son sein. Composé de galeries hexagonales, il est un
lieu de connaissance à la croisée du réel, du virtuel et du rituel.
Abstract
In this essay we introduce a project of virtual architecture inspired from the “Labyrinths” of Borges,
and particularly his “Library of Babel”. We have detected inside taxonomy and symbols which are
able to translate, to give substance to the emerging field of Virtual Reality. From a linear narration
and by making use of myths, we find a relationship between the legible and the visible space. We
will come out the determinants of the architecture models.
Our proposal, in addition to the 3D representation of the University Library of Paris 8, is the creation
of a virtual space within it. Composed of hexagonal galleries, the space of the library is a place of
knowledge at the crossroads of the real, the virtual and the ritual.
7
« L’avenir est aux lecteurs »
Oulipo, 1998
« Ecrire, c’est devenir»
Deleuze
Figure 1_ Exposition au musée d’Art Moderne d’Istanbul sur la ritualité de l’Architecture (2015), photographie Maria Velaora
Introduction: La Bibliothèque comme Lieu
One feels right away that this is the kingdom of books. People working at the library commune with books, with the life
reflected in them, and so become almost reflections of real-life human beings.
—Isaac Babel, “The Public Library”
En lisant une page du livre "Labyrinthes" de Borges, on y sent l’infini. On ne peut lire Borges dans
le sens de la lecture sans raison gardée. Le lecteur s’engouffre dans ses nouvelles comme dans des
labyrinthes d’écriture.
Ce que nous percevons en ouvrant son livre et en y découvrant une géométrie de lettres (« à angle
aigu », « circulaire » et « carré »), est qu’il s’agit d’une lecture motivée par une dialectique entre
l’espace et l’imaginaire/virtuel (entre espace et Logos ou entre Architecture et Lexique).
Le livre Labyrinthes ou Fictions, comme Objet de bibliothèque, devient un moyen d’immersion
dans le monde imaginaire de l’auteur.
A lire une seconde page, on y perçoit progressivement un tout, un nouveau monde, une cosmo-
théorie. Borges, page par page, initie son lecteur à une architecture hypertextuelle. Les mots de ce
texte constituent une référence et chaque référence une image.
Figure 2_ Livre ouvert sur Borges et la mémoire, photographie M.Velaora
Objet de l’étude
Notre travail constitue une étude comparative de l'approche spatiale et artistique de la bibliothèque
dans le virtuel et l'environnement réel. L'essai se concentre sur l'architecture de la bibliothèque, de ce
lieu qui « encapsule » la connaissance. Nous nous concentrons sur la Bibliothèque de Babel
décrite/imaginée par Jorge Louis Borges dans son livre "Labyrinthes".
Nous étudierons dans cet essai les « expériences narratives » qui ont lieu au sein de la "Bibliothèque
de Babel" et dans la Bibliothèque de Paris 8.
Une ville, une bibliothèque, Internet sont des univers qui diffèrent en apparence. Mais à l’instar de
leur propriété à distribuer, cataloguer, classifier, nous leur trouvons des points communs, ou l’Ordre
d’une narration linéaire traduit le Chaos de l’information généralisée, à l’image des bases de
données. Tout coexiste dans un réseau, et le lecteur perd l’idée d’un espace limité. L’espace virtuel
libère l'espace réel dans une sphère immatérielle.
Les axes de recherche
Une application de réalité virtuelle pour une bibliothèque réelle.
Nous allons analyser l'espace de la bibliothèque comme construction conceptuelle et utopique telle
que Borges l’a décrit dans son œuvre, comme une bibliothèque de Babel, où nous trouvons la
description de Dieu, un espace labyrinthique homogénéisé. Nous allons essayer de lire l'architecture
de l'auteur avec des critères spatiaux, artistiques et mythologiques mettant l'accent sur le domaine de
la réalité virtuelle.
Mots-Clés
Bibliothèque, Architecture, architecture de l’articulation , Lieu, systèmes, réseaux, cellules,
hexagone, internet, communication, communauté, réalité virtuelle, art, interactif, Borges, espace,
langage.
10
Qu’est-ce que c’est la Réalité Virtuelle.
Dans cet essai, nous tenterons de découvrir le lien entre la réalité et la virtualité et la ligne ténue qui
les séparent. Avant d’entrer dans l’espace labyrinthe de la perception humaine, nous prendrons cette
ligne fine comme « fil d’Ariane » de notre approche philosophique et spatiale. La limite entre le
« réel » et « virtuel » semble de plus en plus imperceptible à l’époque de la télécommunication, par
l’usage quotidien des « smartphones », du triomphe de la cybernétique et des présages de
l’immersion virtuelle.
La présence physique dans le monde réel et la présence comme trace d’information dans le monde
virtuel interagissent sur plusieurs niveaux de la connaissance et de la communication. Cette
interaction entre le corpus physique/tactile et l’immatériel/numérique, à l’instar de l’émergence
d’environnements virtuels immersifs1, qui susciteront à n’en pas manquer de nouveaux
comportements susceptibles de modifier en profondeur le sentiment de notre présence au monde.
Le titre que nous reprendrons dans cet essai d’un chapitre de Borges, La bibliothèque de Babel,
confère à ce lieu banal une valeur mythique. Pour notre auteur, la Bibliothèque « signifiera pain ou
pyramide, ou toute autre chose » (Borges, The Library of Babel 2006). A sa suite, nous concevrons
la bibliothèque comme une arche de connaissance ou une boîte noire. Cette interprétation correspond
à la notion de Bibliothèque comme unité ou totalité par rapport à sa fonction. Nous emploierons le
concept de bibliothèque à différentes échelles, tantôt pour caractériser un microcosme, tantôt un
monde gigantesque.
Cet écosystème de la connaissance, cet « univers, que d’autres appellent la Bibliothèque » (Borges,
The Library of Babel 2006) est au cœur de notre recherche. La « Bibliothèque de Babel » est un
espace interminable, un labyrinthe de livres cryptés qui s’articule sur deux échelles différentes
(macro et micro, « pain et pyramide »). Borges donne à son lecteur les clés pour la compréhension
profonde de la connexion entre ces mondes différents, une liaison d’unité par les chiffres, par la
description d’un monde homogène composé de galeries hexagonales. Cet étalon élastique2 se trouve
pour Borges dans le monde recyclé et homogénéisé.
1“From presence to consciousness through virtual reality”- Maria V. Sanchez-Vives and Mel Slater, 2005 2 Terme emprunté à Philippe Nys dans son texte « Arpentages et cosmo-plasties ».
11
« On pourrait dire, pour retracer très grossièrement cette histoire de l'espace, qu'il était au Moyen
Age un ensemble hiérarchisé de lieux : lieux sacrés et lieux profanes, lieux protégés et lieux au
contraire ouverts et sans défense, lieux urbains et lieux campagnards (voilà pour la vie réelle des
hommes); pour la théorie cosmologique, il y avait les lieux supra-célestes opposés au lieu céleste; et
le lieu céleste à son tour s'opposait au lieu terrestre; il y avait les lieux où les choses se trouvaient
placées parce qu'elles avaient été déplacées violemment et puis les lieux, au contraire, où les choses
trouvaient leur emplacement et leur repos naturels. C'était toute cette hiérarchie, cette opposition, cet
entrecroisement de lieux qui constituait ce qu'on pourrait appeler très grossièrement l'espace
médiéval: espace de localisation ».
Michel Foucault. Des espaces autres (1984), Hétérotopies.
Dans cet essai, nous ferons le postulat que chaque bibliothèque peut potentiellement être
considérée comme Bibliothèque de Babel, en tant qu’elle est une combinaison spatiale et
spirituelle de l'art, de l'espace et du Logos.
« L’art du lieu » est un art de la totalité dont le but est la création des images du monde. Ces images
traduisent des significations générales en une présentation locale. Toutes les œuvres d’art sont des
totalités, autrement dit des synthèses de différents éléments qualitatifs premiers. Mais l’art du lieu,
autrement dit l’Architecture, qui concerne par principe tout le vécu, est qualifié à juste titre de « mère
des arts 3».
Comment créer un lieu du mémoire avec les trois caractéristiques : virtuelle, réelle, rituelle ?
3(Norberg-Schulz, Le Lieu 1997, 194)
12
Nous répondrons à cette question selon trois axes d’analyse mis en évidence sur le schéma suivant.
Virtuel Réel Rituel
ART ARCHITECTURE LOGOS/ MYTHE
Orientation Mémoire Identification
Regarde / Ecriture Usage / Topologie Présence / Cosmologie
Bibliothèque de Babel de
Borges
Bibliothèque Universitaire de
Paris 8
Bibliothèque Universitaire de
Babel
A la fin de notre analyse, nous chercherons comment ces trois caractéristiques interagissent entre
elles et comment nous pourrions les confondre. Les limites de ces trois axes ne sont pas toujours
clairement distinguables, aussi nous utiliserons des paradigmes précis pour illustrer chaque catégorie.
Ces trois catégories (réelle, virtuelle, rituelle) nous servirons d’angles d’approche pour décrire le
monde et de l’infini (univers). Il s’agit bien sûr là d’une approche personnelle ; mais même si, en
principe, cela semble arbitraire, c’est un arbitraire dont nous devons prendre la responsabilité.
Définition
Biblio-thèque > du grec ancien βιβλιοθήκη : biblio, « livre » - thêkê, « place »
Une bibliothèque est un espace de Logos qui enregistre et classe de l’information. C’est plus
trivialement un lieu où est conservée et lue une collection organisée de livres.
Une bibliothèque est un lieu paradoxal : elle renferme toute la connaissance mais on y trouve que
des livres. L’espace d’une bibliothèque peut être qualifié d’hétérotopique dans la mesure où l’on y
trouve une foule d’éléments contradictoires via des objets homogènes.
Les bibliothèques sont des « centres du monde » en tant qu’axes de la connaissance et du savoir. 13
« La bibliothèque est notre réserve de savoir, comme un trésor disponible. Généralement, dans les
rêves, la bibliothèque fait allusion aux connaissances intellectuelles, au savoir livresque. Cependant,
on y rencontre parfois un vieux grimoire mystérieux, généralement baignant dans la lumière, qui
symbolise la connaissance, au sens plénier du terme, c’est-à-dire l’expérience vécue et
enregistrée ». (Chevalier and Gheerbrant , Dictionnaire des Symboles 1982)
14
CHAPITRE I : La Bibliothèque de Babel comme lieu Virtuel
Labyrinthe, Babel, Jardin : trois mythes
Bibliothèque de Babel est le 6eme chapitre du livre « Labyrinthes » ou « Fictions » de Jorge Louis
Borges. Des 21 nouvelles que comportent son livre - toutes relatives à des univers imaginaires - nous
nous focaliserons sur la description qu’il fait de sa Bibliothèque comme d’un lieu qui existe ad
aeterno4. Nous ferons également référence à l’histoire du « Jardin aux sentiers qui bifurquent », afin
de clarifier l’idée de labyrinthe spatial et chronique.
Dans ce chapitre, nous commencerons par clarifier les éléments constitutifs du labyrinthe, telle la
symétrie ou le chemin qui conduit au centre mystérieux de l’espace.
Des mots comme « Labyrinthe », « Babel », « Jardin » prennent une valeur symbolique dans l’œuvre
de Borges. Nous commencerons par définir ces trois mots-symboles pour raconter trois mythes
différents qui existent en même temps dans son œuvre et qui comportent des réflexions utiles à l’Art
et à l’Architecture.
Figure 3_ La bibliothèque est « pyramide », « sphère » ou « pain », M.Velaora.
4Borges, Jorge Luis. «The Library of Babel.» Dans Labyrinths, de Jorge Luis Borges. London: Modern Classics,
Penguin, 2006.
15
Selon Barthes, le mythe est une parole, un système de signification « qui ne se défini pas par l’objet
de son message mais par la façon dont il le profère ». Tout peut être pour lui un mythe car
« l’univers est infiniment subjectif » (Barthes, Mythologies, p. 181). Aussi dans ce premier chapitre
nous choisirons trois mythes pour mettre en perspective notre vision de la bibliothèque.
Premièrement, nous présenterons la vision de Borges de la bibliothèque comme un labyrinthe des
lettres, en comparaison au Labyrinthe du Minotaure. Ensuite, nous ferons correspondre le titre de sa
nouvelle au mythe de la Tour de Babel. Enfin, nous étudierons la relation réciproque du jardin et de
la bibliothèque, comme jardin de connaissance, en nous appuyant sur le mythe du Jardin des
Hespérides.
Nous pénétrerons dans les symboles et les mythes comme dans un univers parallèle à celui de la
réalité comme totalité vécue. Les mythes sont le plus souvent perçus comme des univers
imaginaires, pour nous ils serviront de « mises en scène » à la production et à la reproduction de la
Réalité Virtuelle.
Labyrinthe
Nous commençons par le Labyrinthe qui peut être défini comme « un entrecroisement de chemins,
dont certains sont sans issue et constituent ainsi des culs-de-sac, à travers lesquels il s’agit de
découvrir la route qui conduit au centre de cette bizarre toile d’araignée. La comparaison avec la
toile d’araignée n’est pas exacte d’ailleurs, car celle-ci est symétrique et régulière, alors que
l’essence même du labyrinthe est de circonscrire dans le plus petit espace possible l’enchevêtrement
le plus complexe de sentiers et de retarder ainsi l’arrivée du voyageur au centre qu’il veut
atteindre ». (Chevalier and Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles 1982)
Le labyrinthe trouve son origine mythique dans le palais crétois de Minos où était enfermé le
Minotaure et d’où Thésée ne pût sortir qu’à l’aide du fil Ariane. On retrouve sur les anciennes pièces
de monnaie de Cnossos5 le dessin gravé du labyrinthe.
Un labyrinthe décrit une route sinueuse sans possibilité d’erreur ou de choix, jusqu’à à son but, soit
qu’il s’agisse du centre ou de la sortie. Le mythe indique que « la sortie ne peut pas se trouver sans un
guide complètement expérimenté » - παντελώς εμπείρου – « qui connait par expérience ». Comme
5 Ville ancienne de Crète où se trouvait le palais du roi Minois et le labyrinthe du Minotaure.
16
Frontisi-Ducroux6 l’explique, le terme « έμπειρος» est le contraire du terme «άπειρος»,
l’inexpérimenté, un terme que signifie aussi « l’infini ». Ce que les images montrent est la solution,
la route qui conduit au but, jusqu’au centre où se trouve, pour Thésée, le monstre qu’il doit tuer, pour
ensuite se retourner et trouver la sortie. Par conséquent, la solution du Labyrinthe, définie par son
architecte/créateur, existe pour celui qui est « bien informé7», qui est un connaissant, comme le
guide expérimenté, qui détient l’esprit dédalique. ( Frontisi - Ducroux 2000, 255-256) Cette
connaissance nécessaire, interprétée comme solution à traverser le labyrinthe, s’exprime dans
l’œuvre de Borges par la recherche constante du livre qui représente le Dieu, le catalogue des
catalogues.
« Comme tous les hommes de la Bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse ; j'ai effectué des
pèlerinages à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues ». (Borges, Library of
Babel 2000, 78-79)
Nous avons parlé de la signification du labyrinthe comme d’un espace mythique qui a vocation
d’épreuve pour l’utilisateur. Dans ce processus la personne peut se perdre ou réussir son initiation
dans l’espace.
6 Frontisi Ducroux, François, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne. Paris : 2000, (Traduction en grecque,
p.351) 7 P.Rosensthiel. Le mots du labyrinthe, Cartes et figures de la Terre, Cendre Pompidou, Paris, 1980, p. 94-103
Figure 4 _ Sol, photographie M. Veloara.
17
Plutôt qu’une construction compliquée, le Labyrinthe est « un problème » qui attend sa solution. Cet
espace exprime la notion d’inconnu, un problème non résolu. Cependant, tant au niveau narratif
qu’au niveau des représentations, le labyrinthe apparait toujours avec sa solution, et non comme un
schéma compliqué impossible à résoudre.
Ce tracé complexe se retrouve gravé sur le sol de certaines cathédrales (Chartres), il est dansé en
diverses régions, de la Grèce à la Chine ; il était déjà connu en Egypte. Le labyrinthe permet
d’accéder au centre par une sorte de voyage initiatique8. Il figure une série d’épreuves initiatiques,
préalables au cheminement vers le centre caché, souvent habité par une figure mythique non
humaine.
Dans le mythe du Minotaure, le labyrinthe préfigure un système de défense (forteresse), il s’agit
d’une défense de la cité, ou de la maison, comme située au centre du monde. D’une certaine manière
chacune de ses épreuves reviennent, en langage morphologique, à pénétrer victorieusement dans un
espace difficilement accessible et bien défendu, dans lequel se trouvait un symbole plus ou moins
transparent de la puissance, de la sacralité et de l’immortalité.
« La Bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque, et dont la
circonférence est inaccessible ». (Borges, Library of Babel 2000)
Blaise Pascal parlait quant à lui de Dieu (ou le monde) comme d’« une sphère infinie dont le centre
est partout, la circonférence nulle part." 9
Les synonymes en français du mot labyrinthe sont légion : embrouillamini, méandre, dédale,
confusion, réseau. Dans notre essai, nous examinerons le labyrinthe comme réseau, une bibliothèque
des possibilités infinies de « devenir ». Pour nous, la Bibliothèque de Babel autant que labyrinthe, est
un réseau, dont le centre varie en fonction de l’observateur/lecteur, comme nous le verrons ensuite.
Plusieurs centres du monde « actifs » peuvent-ils coexister au sein d’un même univers ?
8 Les labyrinthes gravés sur le sol des églises étaient à la fois la signature de confréries initiatiques de constructeurs et les
substituts du pèlerinage en Terre Sainte. C’est pourquoi on trouve parfois au centre soit l’architecte lui-même, soit le
Temple de Jérusalem : l’élu parvenu au Centre du monde, ou symbole de ce Centre. Le croyant qui ne pouvait accomplir
le pèlerinage réel parcourait en imagination le labyrinthe jusqu’à ce qu’il arrive au centre, aux lieux saints : c’était le
pèlerin sur place. 9 Pascal, Blaise. Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets.
18
19
Umberto Eco, écrivain italien, est connu pour sa passion des intrigues labyrinthiques. Dans son
roman Le Nom de la rose, il parle d’une bibliothèque labyrinthique, rhizomatique, rappelant celle de
Borges. Les labyrinthes de son roman ne sont toutefois pas spatiaux mais mentaux. Eco distinguera
trois types de labyrinthes 9F
10 :
- Le labyrinthe de la mythologie grecque est un labyrinthe « unicursal », dont le parcours, de
l'entrée au centre, ne compte pas d'impasse. « Si le labyrinthe classique était déroulé, on
obtiendrait un fil unique : la légende du fil d'Ariane est curieuse, comme s'il fallait un fil pour
s'orienter dans le labyrinthe classique10F
11 ».
10 http://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe 11Umberto Eco, La ligne et le labyrinthe : les structures de la pensée latine, dans Civilisation Latine, Olivier Orban 1986
Figure 5 _ Labyrinthe de Projet, M. Velaora.
- Le labyrinthe « maniériste » déroulé, quant à lui, se présenterait comme un arbre, « un arbre
binaire, du type de celui qu'utilisent les grammairiens et les informaticiens12 ». Il présente un
grand nombre de voies mais toutes, exceptée une, mènent à des culs-de-sac. C'est un
processus d'interrogation, de tentative et d'erreur, mais qui possède une rationalité immanente
qui est la rationalité binaire et qui peut être décrite en termes d'algèbre de Boole.
Une variable booléenne ne peut être que vraie ou fausse. De manière générale lorsqu'il y a N
inconnues binaires, il existe 2N hypothèses complètes possibles.
- Le labyrinthe en « rhizome » ou « labyrinthe hermétique », un réseau entrelacé et infini de
voies dans lequel tout point est connecté à divers autres points mais où rien n'empêche
l'instauration, entre deux nœuds, de nouvelles liaisons, même entre ceux qui n'étaient pas
reliés avant. Chaque route peut être la bonne, pourvu qu'on veuille aller du côté où on va. Le
rhizome est donc le lieu des conjectures, des paris et des hasards, des hypothèses globales qui
doivent être continuellement reposées, car une structure en rhizome change sans cesse de
forme.
Borges devint aveugle à la fin de sa vie, et dû composer avec les nombreux éléments qu’avait retenu
sa mémoire, fertilisant sa créativité en dépit des paraphrases.
12Ibid.
Figure 6_ Eternel retour.
20
Il déclara qu’il concevait sa Bibliothèque comme une sorte de Paradis. Paradoxalement, pendant un
travail de 9 années comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale Miguel Cané, juste avant sa
nomination pour la direction de la bibliothèque National de Buenos Aires, il confirma13 qu’il avait
imaginé cette « histoire kafkaïenne » come version cauchemardesque de cette bibliothèque
municipale dans laquelle il avait passé une grande partie de sa vie.
Borges écrivît ses textes les plus importants dans ces années les plus difficiles de son existence. La
Bibliothèque de Babel est un mélange d’espace cauchemardesque et paradisiaque, dominé par des
émotions extrêmes, ou l’Ordre coexiste avec le Chaos. Cette cohabitation d’antithèses, produit de son
esprit labyrinthique, révèle l’originalité de la pensée borgienne.
A lire Borges, le mythe de Babel apparaît comme le premier labyrinthe mental.
13 [1] Borges, Jorge Luis, "Autobiographical Notes", The New Yorker, 19 September 1970
21
Babel (tour de ; Maison-Dieu)
« La tour de Babel symbolise la confusion. Babel en hébreu signifie « confondre ». L’homme
présomptueux s’élève démesurément, mais il lui est impossible de dépasser sa condition humaine.
Le manque de mesure et d’équilibre entraine la confusion des plans terrestre et divin, et les hommes
ne s’entendent plus : ils ne parlent plus la même langue, c’est-à-dire qu’il n’y a plus entre eux le
moindre consensus, chacun ne pensant qu’a lui-même et se prenant pour un Absolu.
Le récit biblique se situe à la fin des chapitres concernant les origines de l’humanité et précède
l’histoire, plus circonstanciée, moins mythologique et plus chronologique, des patriarches ».
(Chevalier and Gheerbrant , Dictionnaire des Symboles 1982)
Babel forme une sorte de conclusion, au terme de cette première phase de l’histoire de l’humanité,
qui s’est caractérisée par une progressive constitution de grands empires et de grandes cités. Il est
singulier que ce soit un phénomène social et une catastrophe sociale, qui marque la fin de cette
période (Genèse, 11, 1-9).
Le mythe de Babel se focalise surtout sur la construction de Tour, la porte du ciel, comme signe
représentatif et point de repère de la ville. Les historiens ne sont pas toujours d’accord si Babel et
Figure 7_ La Tour de Babel.
Babylone14 désignent le même endroit géographique, mais dans cet essai nous partons du principe
que ces deux termes se réfèrent au même mythe. Cette ville est si magnifique, écrivait Hérodote, et
ses jardins suspendus comptaient parmi les sept merveilles du monde. Par contre, la Tour de Babel
est aussi un symbole d’ambition et de vanité détruit par Dieu, car elle était bâtie sur des valeurs
uniquement temporelles.
La Tour de Babel était une ziggurat15 babylonienne avec une promenade périphérique en spirale au
contour de la construction. On pourrait dire que la Tour est un premier gratte-ciel. Borges laisse son
lecteur libre d’imaginer la bibliothèque de Babel comme il l’entend, en l’avertissant qu’elle était
interminable.
14Babylone est l’antithèse de la Jérusalem céleste et du Paradis. D’après son étymologie, cependant Babylone signifie :
porte du dieu. Mais le dieu sur lequel ouvre cette porte s’il fut un temps recherché dans les cieux, dans le sens de l’esprit,
s’est perverti en homme et dans ce qu’il y a de plus vil en l’homme, l’instinct de domination et l’instinct de luxure, érigés
en absolu. 15Constructions mésopotamiennes, qui ont inspiré la tour de Babel. Dans la tradition biblique, symbole de la démesure
des hommes qui veulent s’égaler aux dieux et qui s’imaginent pouvoir escalader le ciel par les moyens purement
matériels. Elles s’élèvent en terrasses, 3, 5, 7, de plus en plus étroites, reliées par des escaliers très rapides dont les degrés
pouvaient avoir 80cm de hauteur. Certaines de ces tours atteignaient près de 100m de haut. Les 7 étages correspondaient
aux sept cieux planétaires et étaient peints de couleurs différentes, appropriées aux planètes. (Chevalier and Gheerbrant,
Dictionnaire des Symboles 1982, 1038)
Figure 8_Tatlin.
23
« Un nombre n de langages possibles se sert du même vocabulaire ; dans tel ou tel lexique, le
symbole Bibliothèque recevra la définition correcte de système universel et permanent de galeries
hexagonales, mais Bibliothèque signifiera pain ou pyramide, ou toute autre chose, les sept mots de la
définition ayant un autre sens ». (Borges, Library of Babel 2000, 85)
Nous prenons conscience par ce mythe des rapports qu’entretiennent entre eux les langages,
symbolisés par la structure de la Tour. La structure de chaque langue ne se limite pas à ses règles
linguistiques, la langue est un grand paradoxe, un code transcendant.
Nous reconnaissons dans l’œuvre de Borges l’usage simultané de trois types des langues
différentes : la langue littéraire, la langue mathématique et la langue informatique.
Le premier type est le plus évident, autant que Borges était un écrivain, il utilise l’art de l’écriture
pour inspirer et provoquer l’imagination. Cependant dans notre essai, qui regarde tant la théorie que
la pratique, nous rencontrons des jeux de mots ou de quasi-mots que Borges crée par une
combinaison de lettres.
« Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple :
dhcmrlchtdj
que la divine Bibliothèque n’ait déjà prévue, et qui dans quelqu'une de ses langues secrètes ne
renferme une signification terrible ».(Borges, Library of Babel 2000, 84)
Cette logique, comme syntaxe, est plus proche de la pensée mathématique. Plus précisément, Borges
utilise la logique combinatoire, qui est une branche des mathématiques. L’histoire de la Bibliothèque
de Babel commence par l’épigramme : Bythisartyoumaycontemplatethevariationofthe23letters....16
(Borges, Library of Babel 2000, 78) – une phrase qui montre que quelconque rapport entre les lettres
-objets est possible et qui invite à la création d’un code nouveau.
La structure de la langue borgienne procède d’architecture mathématique, édifiée selon deux
axiomes introduits par lui :
1. La Bibliothèque est infinie.
2. Chaque livre est unique et irremplaçable.
16Anatomy of Melancholy, part 2, sect. II, mem.IV
24
« En premier lieu, la Bibliothèque est si énorme que toute mutilation d'origine humaine ne saurait
être qu'infinitésimale. En second lieu, si chaque exemplaire est unique et irremplaçable, il y a
toujours, la Bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de fac-similés presque parfaits
qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou par une virgule ». (Borges, Library of Babel
2000, 83)
En bref, nous pouvons distinguer deux grandes catégories mathématiques dans l’œuvre de Borges,
par rapport au mythe de Babel. Sur ce mythe nous avons distingué des éléments de langage et de la
structure, qui tend à nous faire considérer Borges comme l’architecte-écrivain d’espaces virtuels. La
pensée mathématiques de Borges se révèle dans sa logique algébrique combinatoire (« Variations en
contemplant des 23 lettres 17 »), qui constitue un langage, et dans une géométrie labyrinthique
(« Géométrie et Théorie des Graphes : Ambiguïté et accès 18 »), qui en forme la structure.
La Tour de Babel est un labyrinthe dans lequel l’humanité s’est perdue.
17Bloch, William Goldbloom. The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of Babel. New York: Oxford
University Press, 2008, p.11 18Bloch, William Goldbloom. The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of Babel.New York: Oxford University
Press, 2008, p.93
Figure 9_ 14-hedres ou hexagones en 3D.
25
Ensuite, la langue informatique que nous trouvons dans son texte réside dans sa manière de
cataloguer19 et de repérer un livre dans un univers hexagonal.
« […] pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B qui indiquerait la place de A ;
pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C, et ainsi jusqu’à l'infini... » (Borges,
Library of Babel 2000, 84)
Dans le sous-titre « Livre comme quasi-objet », nous développerons plus avant le langage de Borges
comme mathématique et informatique.
19Théorie de l'information: le catalogage de la collection, Bloch, William Goldbloom. The Unimaginable Mathematics of
Borges' Library of Babel.New York: Oxford University Press, 2008, p.30
Figure 11 _ Bibliothèque de Babel. The Universe was justified.
27
Parler est le rite actualisé nous indiquant que nous partageons le même monde, une réalité qui est
devenue virtuelle après la catastrophe de Babel.
« Derrière la ronde des heures et les points forts du paysage, on trouve en effet des mots et des
langages : mots spécialises de la liturgie, de « l’antique rituel », en contraste avec ceux de l’atelier
« qui chante et qui bavarde » ; mots aussi de tous ceux qui, parlant le même langage, reconnaissent
qu’ils appartiennent au même monde ». (Augé 1992, 99)
Borges participe ainsi à l’actualisation de mythes anciens, qui pour Barthes sont des systèmes de
sémiologie20 (Barthes 1957, 183). Ces mythes, pour nous, restent à ce jour indépassés.
20Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957
Figure 12 _Les lois de la Bibliothèque de Babel.
28
Jardin ou les livres sont des arbres
Figure 13 _ Hortus Conclusus
« J’ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque ».
Jorge Luis Borges
« Dieu écrit droit sur des lignes courbes ». (Proverbe portugais)
Le troisième et dernier mythe de notre analyse est le jardin des Hespérides, que nous rapporterons à
une autre nouvelle de Borges intitulée « Le Jardin des Sentiers qui bifurquent ». Nous essayerons
d’en extraire une conclusion générale sur l'esprit et la stratégie de Borges en rapport avec la
bibliothèque.
Un jardin est une bibliothèque de plantes, une bibliothèque est un jardin de connaissance. Dans le
deuxième chapitre de cette étude, la bibliothèque comme un lieu réel, nous voyons que les
architectes choisissent souvent d'intégrer des jardins intérieurs dans les bâtiments de bibliothèques
qu'ils dessinent. Les jardins intérieurs dans les bibliothèques coexistent avec des livres et imposent le
respect du silence. Vous nous permettrez cette métaphore, les livres sont comme les plantes,
silencieux et vivants.
29
Faisons un détour par le mythe du jardin des Hespérides. Les Hespérides, filles d’Atlas et
d’Hespéris, habitent un jardin de pommes d’or. Les pommes d’or sont les cadeaux de mariage de
Zeus et d’Héra. Depuis que les filles d’ Hespéris tentèrent de voler les pommes, un dragon fût mis à
l’entrée du jardin pour les garder. Le dernier travail d’Héraclès consistait à trouver ces pommes.
Après avoir triomphé du dragon, il s’empara du jardin et de ses richesses.
Ce mythe représente l’existence d’une sorte de Paradis, objet des désirs humains, et d’une possibilité
d’immortalité ; le dragon en désigne les interdits d’approche, les épreuves. Ce mythe est un symbole
de l’effort humain de parvenir à la spiritualité et la connaissance.
Les pommes sont des symboles de la connaissance comme les livres sont symboles de la
connaissance aujourd'hui.
« Des sortes de puits sphériques appelés lampes assurent l'éclairage. Au nombre de deux par
hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante, incessante ».
(Borges, Library of Babel 2000)
Dans la bibliothèque de Borges, les lampes sont des fruits, de lumière et de connaissance.
Contrairement à l'atmosphère cauchemardesque générale que donne Borges à sa bibliothèque, il
Figure 14 _ Image de synthèse : Bibliothèque, Labyrinthe, pomme.
laisse là une fenêtre d'espoir : grâce aux épreuves de l’initiation, l’homme cherche son chemin pour
surmonter les obstacles. La connaissance est inextinguible, à l’image des lampes qui brillent avec
difficulté mais restent en permanence allumées. Les livres sont les fruits de la connaissance, et la
bibliothèque le jardin de ces livres.
Ce voyage vers la connaissance transforme en jeu la narration de l'auteur. En même temps, le voyage
initiatique est une parabole sur la circularité infinie de l'histoire. La nouvelle policière « Le Jardin
des Sentiers qui bifurquent » est la deuxième histoire du livre "Fictions", et fait écho à l'esprit
hypertextuel de Borges, tel un arbre narratif où les scénarios se ramifient en des fins multiples.
L'importance de l'arbre est grande, car elle se rapporte à des itinéraires cognitifs et au caractère
hypertextuel de l'auteur. Le concept de parcours vertical et circulaire à l'intérieur de la bibliothèque
(passage de la bibliothèque dans le livre, du livre à la parole, du mot au symbole et du symbole de
nouveau à la bibliothèque) régit la structure de sa pensée.
Le parcours vertical et circulaire, composition du cercle et de la ligne, forme un mouvement en
spirale. Ce mouvement est le cordon ombilical reliant la bibliothèque de Borges à celle que nous
entrevoyons, et l’axe de ce voyage initiatique en quête d’une esthétique.
Basés sur la grammaire des L-systèmes21 et de certains de ses axiomes, nous avons construit des
images potentielles de la bibliothèque sous forme d'arborescence hexagonale. La spirale exécute les
contraintes de mouvement vertical.
21 « Lindenmayer systems — or L-systems for short — were conceived as a mathematical theory of plant development.
Originally, they did not include enough detail to allow for comprehensive modeling of higher plants. The emphasis was
on plant topology, that is, the neighborhood relations between cells or larger plant modules. Their geometric aspects were
beyond the scope of the theory. Subsequently, several geometric interpretations of L-systems were proposed with a view
to turning them into a versatile tool for plant modeling ». Przemyslaw Prusinkiewicz, Aristid Lindenmayer, James
S. Hanan, F. David Fracchia et Deborah Fowler, The Algorithmic Beauty of Plants, Springer Verlag, 2004
31
L’Arbre
L’arbre est « l’un des thèmes symboliques les plus riches et les plus répandus ; celui également dont
la bibliographie, à elle seule, formait un livre. Mircea Eliade distingue sept interprétations principales
qu’il ne considère d’ailleurs pas comme exhaustives, mais qui s’articulent toutes autour de l’idée du
Cosmos vivant en perpétuelle régénérescence. » (Chevalier and Gheerbrant , Dictionnaire des
Symboles 1982, 62)
Le deuxième élément commun à bibliothèque et au jardin, est le silence. Les plantes parlent un
langage secret qui se cache sous le voile du silence. Les arbres et les plantes sont en un sens un
peuple qui parle toutes les langues, ou autrement dit, continuent de parler un langage commun. Les
pauses montrent souvent une façon de penser, impliquent un commentaire ou un avis qui n’est tout
simplement pas convoqué. Les discours silencieux apparaissent souvent bénéfiques pour les humains
Figure 15_Corail du Dioscoride de Vienne.
quand ils empruntent les voix d’une sagesse naturelle. La bibliothèque comme espace qui incite au
silence, permet l'articulation de cette langue aphone. Le silence22 est le langage de la pensée, même
si en quelques occasions ce silence peut être lourd et assourdissant (quand les pensées ne nous
lâchent plus). Même si pour certains, dans un monde pluraliste et de la communication non-stop,
s’abstenir de parler peut être vu comme faiblesse, le silence dans notre travail est considéré comme
un langage secret, peut-être la seule langue commune qui a survécu à la destruction de Babel.
Pour résumer, le jardin et la bibliothèque sont deux endroits semblables au regard du silence. De
structure organique en manière d’hypertexte, la vertigineuse symétrie de la Bibliothèque de Borges
perd un peu de sa pesanteur.
« Les secrets mouvements de l’entendement sont manifestes par la voix ; de même ne semble-il pas
que les herbes parlent aux curieux médecins par leur signature, lui découvrant par quelque
ressemblance, leurs vertus intérieures cachées sous le voile du silence de la nature ». (Crollius 1976,
10)
« Les hommes que je fus s'estompent au lointain.
Je marche sans arrêt le long d'une muraille Monotone et haïe. Aveugles carrefours, Couloirs que mon regard
déformant interprète Comme une lente circonférence secrète ... »
Le cercle et l'infini travaillent le labyrinthe. Poème – microcosmes, p.22
22 « Plus l’âme a reçu dans le silence, plus elle donne dans l’action » Ernest Hello
Figure 16 _ Réticulum plasmatique et Aulonia hexagona, D’Archy Tompson.
33
THE LIBRARY OF BABEL
BY JORGE LUIS BORGES
LIBRARY OF BABEL PRESS
HEXAGONAL UNIVERSE
Figure 19 _ Couverture du livre de la Bibliothèque de Babel Press.
36
Maison Hexagonale
« L'univers (que d'autres appellent la Bibliothèque) se compose d'un nombre indéfini, et peut-être
infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des
balustrades basses ». (Borges, Library of Babel 2000, 78)
La bibliothèque de Babel est décrite par Borges comme une série d'hexagones imbriqués, chacun
d’eux composés de quatre murs d'étagères et de deux parois d'ouverture aménageant des passages
vers la cellule suivante. Pourquoi des hexagones?
« Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du
moins de notre intuition de l’espace ; ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait
inconcevable ». (Borges, The Library of Babel 2006, 79)
L'hexagone est considéré comme la forme qui fait le plus d'économie d'espace, qui évite les espaces
« morts ».
Borges a lui-même déclaré dans une interview23 qu’en première intention il pensait décrire sa
Bibliothèque par une combinaison de cercles infinis. Mais il abandonna l’idée au prétexte que les
cercles auraient laissé trop d’espaces vacants.
Ses structures hexagonales rappellent les rayons d’une ruche, où une communauté de bibliothécaires
s’affaire à ranger des piles de livres dans chaque cellule. Les abeilles ont représenté, à travers une
vaste histoire de la pensée, une société hautement organisée et hiérarchisée encore dépourvu de
raison.
23 Beatriz Sarlo « Jorge Luis Borges : A Writer on the Edge », p.71
Figure 22 _ Le plan de la gallérie hexagonale.
39
Comme l’ont affirmé d’autres avant nous, la Bibliothèque de Babel ressemble à un nid d'abeilles
sans interstices.
« La distribution des galeries est invariable. Vingt longues étagères, à raison de cinq par côté,
couvrent tous les murs moins deux ; leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse
guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué ». (Borges, Library of Babel 2000, 78)
Selon William Bloch24, les dimensions des galeries hexagonales de la Bibliothèque de Babel sont les
suivantes :
Longueur de la bibliothèque : 3 mètres (grande bibliothèque double face)
Profondeur d’étagère : 0.3 m Hauteur de l’étagère : ∼ 2.21 m
Diamètre escalier en spirale : ∼ 1 m
Chambre miniature pour dormir : ∼ 0.5 m x 0.5 m
Chambre miniature pour le soulagement des besoins physiques : ∼ 0.5 m x 0.5 m
Espace entre escalier et les murs en marchant : ∼ 0.5 m
« Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait? » 25
24 Bloch, William Goldbloom. The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of Babel. New York: Oxford
University Press, 2008, p.95 25 « Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait ? Une méthode rétrograde fut proposée : pour
localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B qui indiquerait la place de A ; pour localiser le livre B, on
consulterait au préalable le livre C, et ainsi jusqu’à l'infini... C'est en de semblables aventures que j'ai moi-même
prodigué mes forces, usé mes ans. Il est certain que dans quelque étagère de l'univers ce livre total doit exister
Figure 23 _ Cellules hexagonales - Rayons.
40
La famille de Borges vivait dans une grande maison avec une bibliothèque anglaise riche de plus de
mille volumes ; Borges plus tard remarqua que « si on me demandait de nommer le principal
événement dans ma vie, je devrais dire la bibliothèque de mon père ». 26
Dans notre recherche, nous prenons au sérieux cette remarque de l'auteur, indiquant son amour
profond pour la bibliothèque de son enfance. L’espace de la bibliothèque semble avoir été pour lui la
pierre angulaire de la vie, à la fois parce qu'il a grandi dans les livres, travaillé dans deux
bibliothèques, et parce qu’il a écrit. C’est comme si Borges était né et mort dans une bibliothèque.
« Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j’écris, je me prépare à mourir
à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis ». (Borges, Library of Babel 2000, 79)
La bibliothèque est un espace entre la maison et le travail, un troisième lieu27. Nous envisagerons les
hexagones comme des demeures potentielles. Ce parti pris est renforcé par la description que Borges
fait des installations sanitaires et espaces pour dormir présents dans chacun de ces hexagones. Dans
cette étude, cette constatation sera un critère clé de notre proposition de projet.
Chaque hexagone est le centre de cette Bibliothèque-univers, comme une maison est le centre du
monde, selon Mircea Eliade (nous le verrons dans le Chapitre III).
[Traduction de Nestor Ibarra] Je le répète : il suffit qu'un livre soit concevable pour qu'il existe. Ce qui est impossible est
seul exclu. Par exemple : aucun livre n'est aussi une échelle, bien que sans doute il y ait des livres qui discutent, qui nient
et qui démontrent cette possibilité, et d’autres dont la structure a quelque rapport avec celle d'une échelle. » (Borges,
Library of Babel 2000) 26 Borges, Jorge Luis, "Autobiographical Notes", The New Yorker, 19 September 1970 27 Servet, Mathilde. “Les Bibliothèques : Troisième Lieu”, Bulletin Des Bibliothèques de France, 2010.
http://droitsculturels.org/paideia4d/wp-content/uploads/sites/3/2014/03/10_Bibliotheques-troisieme-lieu.pdf
Figure 24_ Galléries Hexagonales en série.
41
Le Livre Cyclique: l’Object principal de la Bibliothèque
« L’Univers est un immense livre ». -Mohyddin ibn-Arabî
« Il me dit que son livre s'appelait le livre de sable, parce que ni ce livre ni le sable n'ont de
commencement ni de fin ». -Jorge Luis Borges
Dans ce chapitre nous décrirons l’espace labyrinthique de la bibliothèque comme celui d’un livre,
une tautologie à laquelle nous renvoie l'auteur lui-même.
La bibliothèque de Babel se réfère aux deux niveaux d’initiation dans le labyrinthe, premièrement
par rapport à l’espace homogène hexagonal et ensuite à l’Object de l’espace comme Object de désir.
Les galeries hexagonales formalisent le lieu homogène, architecture caractéristique qui intensifie
l’errance et le sentiment de n’être « nulle-part ». Les livres de la Bibliothèque sont un « pur
labyrinthe de lettres » et la clé de cet espace se trouve dans le catalogue des catalogues ou livre
cyclique, renforçant cette homogénéité.
Borges fait une réalité concrète hors de lui. La "Bibliothèque de Babel" est à l'image de l'univers,
infinie et toujours recommencée. La plupart des livres de cette bibliothèque sont inintelligibles,
lettres jetés ensemble par hasard ou répétées sans relâche, mais parfois, dans ce labyrinthe de lettres,
on peut trouver une ligne ou une phrase raisonnable.
Dans l'histoire de la Bibliothèque de Babel, un lecteur constate que tous les livres ont certains
éléments en commun : l'espace, la période, la virgule, et les 22 lettres de l’alphabet. Borges prétend
que dans cette bibliothèque, il n'y a pas deux livres identiques et chaque exemplaire est unique.
Borges écrit que :
« […] chaque étagère comprend trente-deux livres, tous de même format ; chaque livre a quatre
cent dix pages ; chaque page, quarante lignes, et chaque ligne, environ quatre-vingts caractères
noirs ».
43
De ces lignes, nous concluons que chaque livre se compose par 410 x 40 x 80 = 1.312.000 symboles
orthographiques et d’autant d’espaces vides.
« Il y a cinq cents ans, le chef d'un hexagone supérieur mit la main sur un livre aussi confus que les
autres, mais qui avait deux pages, ou peu s’en faut, de lignes homogènes et vraisemblablement
lisibles. Il montra sa trouvaille à un déchiffreur ambulant, qui lui dit qu'elles étaient rédigées en
portugais ; d'autres prétendirent que c'était du yiddish. Moins d'un siècle plus tard, l'idiome exact
était établi : il s’agissait d'un dialecte lituanien du guarani, avec des inflexions d'arabe classique. Le
contenu fut également déchiffré: c’étaient des notions d'analyse combinatoire, illustrées par des
exemples de variables à répétition constante. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de
découvrir la loi fondamentale de la Bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelque
divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux : l'espace, le point, la virgule, les vingt- deux
lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé : il n’y a pas,
dans la vaste Bibliothèque, deux livres identiques. De ces prémisses incontroversables il déduisit que
la Bibliothèque est totale, et que ses étagères consignent toutes les combinaisons possibles des vingt
et quelques symboles orthographiques (nombre, quoique très vaste, non infini), c'est-à-dire tout ce
qu'il est possible d'exprimer, dans toutes les langues ». (Borges, Fictions n.d.)
De combien de livres distincts est composée la Bibliothèque? Chaque livre a 1.312.000 caractères,
dont chacun peut être rempli par les 25 symboles alphabétiques, ce sont les « variables à répétition
constante» mentionnée par Borges. Encore une fois, en utilisant les idées exposées ci-dessus, il
existe 25 façons de remplir un espace, 25 x 25 = 252 façons de remplir deux espaces, 25 x 25 x 25 =
253 façons de fil les trois espaces, et ainsi de suite, et ainsi de suite pour 1.312.000 espaces. Il suit
immédiatement qu'il y a 251312000 livres distincts dans la bibliothèque. (Bloch 2008, 17)
Mais l'analyse mathématique basée sur le William Bloch ne cesse pas ici, parce que nous n'avons pas
compté les lettres qui sont sur la couverture de chaque livre. Dans notre travail, nous nous appuyons
sur la conclusion directe de ses enquêtes sur les livres disponibles à la bibliothèque. Après ses
calculs basés sur certaines hypothèses formulées plus haut, il conclut que le nombre de livres est:
3,683,681,259,485,362,310,918,865,543,989,208,654,728,931,149,486,911,733,618,072,454,576,141
,229,488,660,718,000
44
ou plus simplement 3,7 × 1084 livres, confirmant ainsi le titre de son livre28.
« L’imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possibles ».
(Bloch 2008, 22)
LE CHIFFRE – Jorge Luis Borges (poème) La proximité de la mer : Une anthologie de 99 poèmes de Jorge Luis Borges
L'amitié silencieuse de la lune
( je cite mal Virgile ) t'accompagne
depuis, cette nuit, aujourd'hui perdue
dans le temps, cette soirée où tes yeux
vagues l'ont déchiffrée pour toujours dans
un jardin, un patio qui sont poussière.
Pour toujours ? Je sais qu'une fois quelqu'un
pourra te dire en toute vérité :
Tu ne verras plus la lune claire.
Tu viens d'épuiser la somme des chances
que t'accorde le destin. Inutile
d'ouvrir toutes les fenêtres du monde.
Il est tard. Tu ne la trouveras plus.
Nous vivons découvrant et oubliant
cette douce coutume de la nuit.
Regarde. C'est peut-être la dernière.
Le livre comme objet est déjà passé de l'époque de papier 29 à l'époque numérique. Sa forme et sa
taille ont évolué des feuilles de papier à des gadgets plus ou moins élégants. Le livre peut aussi être
conçu comme un objet physique (imprimé) et un objet numérique. Le livre numérique se constitue
comme un ensemble immatériel de chiffres et de symboles en permettant une interaction avec le
lecteur. La question qui arrive concerne la relation entre le livre et le Web et la forme qu'il pourrait
28 The Unimaginable Mathematics of Borges’ Library of Babel, p.22. 29 Santorineos, Manthos. 2008. De La Civilisation Du Papier À La Civilisation Du Numérique, À Travers Les Aventures
de L’enregistrement de La Recherche, de La Pensée et de L’art: Proposition D’une Nouvelle Forme de Thèse de
Doctorat Numérique, Collection Ouverture Philosophique, Paris, L’Harmattan.
45
prendre. Nous nous inspirons de Jorge Louis Borges, qui a créé à travers la littérature, une
architecture virtuelle intéressante pour l'ensemble de tous les livres dans la structure imaginaire de la
Bibliothèque de Babel. Dans son essai, il introduit la notion de livre cyclique comme un catalogue
de tous les catalogues ou comme une interprétation de Dieu lui-même, le livre ultime de cette
bibliothèque absolue. « Dans la bibliothèque de Babel qu'est devenu le monde en expansion continue
des livres, bibliothèque dépourvue d'un grand bibliothécaire inspire par le principe du meilleur, tous
les livres possibles semblent pouvoir exister, sans discrimination, et même sans papier 30».
« […] Quant aux mystiques, ils prétendent que l’extase leur révèle une chambre circulaire avec un
grand livre également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs ; mais leur
témoignage est suspect, leurs paroles obscures : ce livre cyclique, c'est Dieu… ».
Pourquoi est-ce que Borges décrit ce livre comme circulaire ; le style d'écriture de Borges inclut la
notion de circularité symbolique. Dans d'autres romans, comme de « livre de sable » ou « Chemins
croisés », davantage dans ses romans policiers, Borges donne une sorte d’épaisseur à son discours
qui suit une propre logique, de manière à provoquer une confusion mystérieuse, perdant le lecteur
dans son texte et le conduisant à en recommencer la lecture. L’univers infini qu’il crée est parfois
spatial et parfois chronique. Dans le texte de la Bibliothèque de Babel, Borges se demande si le
lecteur le comprend, indiquant ainsi qu'une seule lecture ne suffit pas et lui soumettant cette lecture
circulaire à répétition. Borges est friand de ces jeux littéraires de l'esprit.
«Toi, qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue ?» (Borges, Library of Babel 2000)
Ceci est simplement une interprétation de la circularité que nous observons dans son travail et qui est
liée à un dialogue direct entre l’auteur et le lecteur.
Notre pensée peut-elle être symbolisée par le cercle ?
30 Mœglin-Delcroix, Anne, Sur le livre d’artiste, Articles et écrits de circonstance (1981-2005), Du livre comme idée :
Bernard Villers et Jorge Luis Borges, Ed. Formes, Le mot et le reste, p.534
46
Figure 26_ Le miroir. La pensée borgienne.
Figure 27_ Anaglyphe de l’univers de la Bibliothèque, M.Velaora.
Cercle
« Le cercle est d’abord un point étendu : il participe de sa perfection. Aussi le point et le cercle ont-
ils des priorités symboliques communes : perfection, homogénéité, absence de distinction ou de
division… Le cercle peut encore symboliser, non plus les perfections cachées du point primordial,
mais les effets crées ; autrement dit, le monde en tant qu’il se distingue de son principe. Les cercles
concentriques représentent des degrés d’être, les hiérarchies créées. A eux tous, ils constituent la
manifestation universelle de l’Etre unique et non-manifesté. En tout ceci, le cercle est considère
dans sa totalité indivise… Le mouvement circulaire est parfait, immuable, sans commencement ni
fin, ni variations ; ce qui l’habilite à symboliser le temps. Le temps se définit comme une succession
continue et invariable d’instants tous identiques les uns aux autres… Le cercle symbolisera aussi le
ciel, au mouvement circulaire et inaltérable… ». (Chevalier and Gheerbrant , Dictinnaire des
Symboles 1982)
Le cercle en tant que symbole est directement relié à la circularité du temps.
Il est frappant de constater qu’après avoir parlé des 3 lettres qui se répètent en boucle du début à la
fin de son livre, Borges écrive sur le temps des pyramides d'Égypte. Tout au long du texte, il se
réfère indirectement à la Tour de Babel et aux Pyramides directement.
« L'un de ceux-ci, que mon père découvrit dans un hexagone du circuit quinze quatre-vingt-
quatorze, comprenait les seules lettres M C V perversement répétées de la première ligne à la
dernière. Un autre (très consulté dans ma zone) est un pur labyrinthe de lettres, mais à l'avant-
dernière page on trouve cette phrase : O temps tes pyramides ».
Dans cette phrase, le symbolisme se situe sur plusieurs niveaux en même temps, mais nous
discuterons seulement de trois d’entre eux.
Le premier et le plus évident est celui du temps, avec les Pyramides qui sont les plus célèbres
tombes de l'histoire, des temps anciens jusqu'à aujourd'hui, et qui représentent l’éternité et
l’incorruptibilité par le temps, comme c’est le cas chez Borges, de la bibliothèque de Babel.
Dans le deuxième niveau, avec la formation de cette phrase, qui est renforcée par l'interjection
d'admiration, en voyant l'apothéose de l'Ordre dans la bibliothèque, à travers la relation parfaite de
ces lettres enfin, le livre de la bibliothèque donne un sens. Le bibliothécaire en lisant cette phrase ne
peut que ressentir un soulagement. Malgré la forme chaotique de la plupart des livres, nous 48
rencontrons miraculeusement le dernier espoir de l'auteur. Peut-être alors, avec cette seule phrase les
bibliothécaires et les livres de la bibliothèque trouvent une raison d'exister. Les livres avaient perdu
leur matériel parce qu'il avait perdu l'ordre des lettres, ils retrouvent ici leur existence, ici par le
Logos. Encore une fois, la circularité de la succession de l’ordre au chaos se résume dans l'œuvre de
Borges à cette seule phrase.
Le troisième et dernier élément de symbolisme que nous entrevoyons pour les pyramides dans sa
relation avec les livres de cette bibliothèque est formel. Les pyramides sont traditionnellement la
composition géométrique la plus sobre et la plus parfaite, combinant des formes basiques, rappelant
ainsi l’économie hexagonale.
«On sait que le périmètre du carré de base (de pyramide de Gizeh) est sensiblement égal à la
longueur d’une circonférence de rayon égal à la hauteur, ce qui revient à dire que le rapport de la
base carrée et du cercle est exprimé dans l’élévation ». (Chevalier and Gheerbrant , Dictionnaire des
Symboles 1982, 791)
Figure 28_ Compilation de formes géométriques : hexagone, pyramide, cercle, Houdini, M.Velaora.
49
Conclusions Chapitre I _Pourquoi une Bibliothèque de Babel ?
La Bibliothèque de Babel s’intègre aux bibliothèques virtuelles de par sa nature imaginaire. Dans ce
domaine, la Parole et l'art viennent considérablement déterminer comment structurer notre propre
réflexion sur le sujet. La Bibliothèque de Babel de Borges pour notre recherche est le premier
exemple de bibliothèque virtuelle. Chaque utilisateur/lecteur du livre de Borges se fait selon son
propre imaginaire une construction différente à partir des mots de l’artiste/auteur (sphère, pyramide,
pain). La Bibliothèque de Babel fait largement référence aux mathématiques (Cf. Les mathématiques
inimaginables de Borges, Bibliothèque, MIT Press), à la théorie et au paradoxe de Russell, en
essayant de faire du texte une image. Les mathématiques sont la science exacte par excellence en
même temps que science la plus abstraite.
La Bibliothèque de Babel est ensuite la bibliothèque des extrêmes, dans une gamme de l'espace
utopique-dystopique opposé à l’espace hétérotopique, réel de Foucault.
Enfin, tout en combinant les symboles suivants : Babel, Labyrinthe, Pyramides, Arbre, Hexagone, la
Bibliothèque de Babel est néanmoins un espace homogène qui s’identifie à l'univers comme à
Internet.
Chaque galerie hexagonale est un centre de la bibliothèque, un Hyper-Lieu.
Figure 29_ La ville de la Bibliothèque de Babel, M.Velaora.
Pourquoi la Bibliothèque de Babel ?
Mythe de BABEL BIBLIOTHEQUE de Babel
Ville historique - Babylone (limitée) Infinie, interminable, Total, Absolue
Une Langue - Un Dieu (avant la catastrophe) Plusieurs langues – Panthéon des pensées
Tour de Babel Sphère, pyramide ou pain
But absolu : Toucher le Ciel (ou le Dieu) But absolu : trouver le Catalogue des catalogues, le
livre cyclique, Lui
Société babylonienne Société de Bibliothécaires et de lecteurs
Sentiments : ambition, vanité, désir Sentiments : entre joie et désespoir
Catastrophe de la Tour Catastrophe des livres, mais la bibliothèque ne peut
pas être détruite
Figure 30 _ Hexagone entre Hexagone, MV.
CHAPITRE II : La Bibliothèque de Paris 8 comme lieu Réel.
Figure 32 _ Hexagrammes Chinois Yi-King.
Dans ce chapitre, nous nous appuyons dans notre vécu pour tâtonner la manière dont une
bibliothèque réelle fonctionne. L'expérience de Borges précédent était grande. Le chapitre suivant
fait un "atterrissage" à notre lecteur. Une réalité dans des bibliothèques ou probablement Borges est
vécu pendant des années, et l'a transformé en merveilleuses histoires imaginaires telles.
Notre objectif, quand nous avons choisi de nous occuper avec la Bibliothèque de Babel, ne reste pas
dans une analyse linguistique, mais il étend vers une représentation spatiale numérique, en trois
dimensions, avec l'axe principal celui de l’expression artistique. La principale propriété de l'auteur de
cette recherche est celle de l'architecte. L'espace réel, le bâtiment, la ville, la route et la construction
54
sont au centre de nos intérêts. Nous nous concentrons à la compréhension profonde de Borges et
peut-être nous pouvons prouver ou non, l'allégation initiale de notre hypothèse sur le mélange de
l'espace virtuel et réel: la bibliothèque imaginaire de Babel peut être appliquée à quelconque
bibliothèque réelle.
Le lecteur de cette recherche peut-être se demande «Pourquoi la bibliothèque de Paris 8 et pas une
autre?". Plus spécifiquement, en janvier 2015, nous avons reçu la proposition contextuelle par la
bibliothèque de l'Université de Paris 8, pour créer le modèle en trois dimensions de la bibliothèque
sur le déménagement de la salle de magazines et la création de nouvelles salles sur le cadre de
Learning Center Program (expliqué ci-dessous). L'objectif était de construire l'espace en trois
dimensions avec l'usage de la technologie d'Oculus Rift pour permettre à l'utilisateur, qui dans ce cas
était le bibliothécaire lui-même, d’être immergé à naviguer dans l'espace vide de la bibliothèque
virtuelle. Ensuite, sur la base de la refonte de la bibliothèque par un architecte nous pourrions voir
quelle forme elle prendrait l’espace intérieur avant la construction réelle, qui est prévue pour 2018.
Nous avons accepté ce défi, qui a coïncidé avec la recherche et notre intérêt pour les bibliothèques.
Les raisons sont simples et nous les citons :
- L’Architecture et sa liaison avec le Logos, dans un concept qui n'a pas comme occasion la
forme (la « morphocratie » / le formalisme31), mais la forme qui résulte de la signification et
de la narration.
- Pour repousser les limites de l'architecte afin d'enrichir et d’introduire sur son travail la réalité
virtuelle, les nouvelles technologies et la planification informatique.
- La compréhension de l'espace de la bibliothèque et de ses nécessités réels.
- Toute démarche artistique présuppose une expérimentation.
- Le début d’un dialogue qui concerne la création des espaces publics où la Réalité Virtuelle
serait « encapsulée » (à la manière dont les cabines téléphonique ont encapsulé en leur temps
la téléphonie, avant qu’elle ne devienne mobile).
31 Système philosophique qui soutient que l'essence des choses est la prédominance des formes, des caractéristiques
externes, des principes formels et des relations plutôt que sur le contenu.
55
Le département technique de l’université nous a fourni le programme détaillant les besoins de la
bibliothèque et tous les plans de construction en format numérique. Nous avons commencé une
recherche pour le bâtiment et le lieu dans la ville, qui a duré environ trois mois et que nous
développons dans ce chapitre. La recherche concerne la compréhension de la ville se Saint-Denis,
l’architecte Pierre Riboulet, et la communication avec les bibliothécaires.
Figure 33_ Façade de la partie pont de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8.
Histoire
« Nous sommes contemporains d’un univers sans fin. » -Pascal Quiqnard
Le paradigme choisi pour représenter cette première catégorie est la Bibliothèque Universitaire de
Paris 8. Quand nous parlons de l’espace réel, nous entendons n’importe quel espace existant, naturel
ou artificiel. Dans notre cas, il s’agit du bâtiment de la Bibliothèque de Paris 8, alors c’est
évidemment un espace artificiel et comme espace artificiel a été désigné par l’architecte et urbaniste
Pierre Riboulet avec une manière de réaliser une série des fonctions. Le bâtiment de cette
Bibliothèque Universitaire joue un rôle pluridisciplinaire et central dans la vie de l'université,
autrement dit il s’agit du cœur de Paris 8 au niveau de l’espace et au niveau de la connaissance. En
dessous, nous présentons vite quelques données historiques, suffisantes pour notre recherche,
cependant pour plus d'informations sur l’Histoire et l’Urbanisme, il y a des sources précisément
citées disponible à consulter.
Figure 34 _ Panorama de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8, Saint-Denis.
Tissu Urbain et Bâtiment
« Le plagiat est nécessaire. Le progrès l'implique ». -Lautréamont
Dans cette partie nous abreuvons à des sources historiques (Madeleine Jullien, 1998).
En 1980, le déménagement de l’université Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis marque un tournant
dans son histoire. En 1989 on dénonce l’inquiétante misère des bibliothèques universitaires32, et
commence une réflexion sur les constructions universitaires. Dans la même année, Paris 8 organise
un colloque intitulé « quelle université pour demain ? » et précise les grandes thèmes de son
extension : ouverture dans le temps, ouverture sur la ville, développement du rôle social de
l’université. La bibliothèque se trouvait alors représentée par un groupe de travail organisé autour de
l’architecte Guy Naizot, et dont faisait partie Francine Demichel, présidente de l’université de
l’époque. Le schéma directeur approuvé par le conseil d’administration de l’université en janvier
1991 exprimait ces choix : la bibliothèque, située au cœur de l’université « bâtiment-pont » au-dessus
de l’avenue Stalingrad, devenait la vitrine, la « porte » de l’université et par-delà de la ville entière.
32 André Miquel, Les bibliothèques universitaires, Rapport au ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de la
Jeunesse et des Sports. La documentation française, 1989.
Figure 35_ La gare de métro, à la station Saint-Denis Université, ligne 13.
58
L’université devint un lieu de passage, connectant les deux sites de l’université. Par son architecture,
la bibliothèque devient un symbole de liaison organique dans le lieu de connaissance et d’éducation
qu’est l’Université. (Penser, Bâtir la bibliothèque de Paris 8 1998, 5-20)
Deux axes importants,
- L’entrée principale de l'université est logée dans le corps de la bibliothèque, juste en face du
métro.
- Ce pont-suspendu universitaire fait office de point de repère pour l’agglomération de Saint-
Denis. (surface dans œuvre:12510 m2).
Figure 36 _ Les Archives Nationales de France. En face de la bibliothèque de Paris 8.
Les principes, les choix et le programme
L’organisation des collections et leur mise à disposition en modules séparés sur 5 étages ont été
pensées selon plusieurs principes (Madeleine Jullien 1998) :
- mettre en accès libre pour tous un maximum de documents, environ 150 000 ouvrages et 1 000
titres de périodiques, auxquels s’ajoute un fonds spécialisé comptant environ 200 000 livres
anciens en accès indirect ;
- repartir les collections d’ouvrages en 6 pôles thématiques selon un parcours pensé à travers les
disciplines ;
- organiser la séparation des documents par types (périodiques, ouvrages, thèses, documents
audiovisuels) ;
- ne pas répartir les documents par niveau (recherche et étude) tout en réservant un accueil
particulier aux enseignants ;
- prévoir des magasins destinés à compléter l’accès libre pour des ouvrages plus anciens, moins
demandés ou très spécialisés ;
- organiser un magasin en accès libre pour les périodiques, contigu à la salle des périodiques ;
- ne pas constituer un fonds de prêt à part mais associer les documents en communication sur
place et les documents susceptibles d’être empruntés à domicile, en les signalant d’une façon
particulière ;
Figure 37_ L’Entrée de l’Université Paris 8.
- ne pas introduire de cloisonnements dans les espaces afin de garantir la mobilité du public et la
libre circulation des ouvrages ;
- faciliter l’accès aux différents espaces tout en maintenant une certaine autonomie des services,
afin de pouvoir assurer une ouverture partielle à certaines heures ou certaines périodes de
l’année ;
- prévoir des places de lecture diversifiées pour le confort des lecteurs ;
- proposer un prêt reparti afin que même si le service de prêt se trouve centralisé dans le hall
d’accueil, il soit relié aux banques de prêt et d’information des espaces de lecture depuis lesquels
le retour des ouvrages est permis ;
- prévoir un système de transfert automatique des documents des magasins vers les pôles de
communication des ouvrages ;
- prévoir un circuit rationnel des livres.
En ce qui concerne l’informatique :
- prévoir dès le départ des points de consultation du catalogue en ligne et des terminaux de travail
répartis dans toutes les salles de lecture. (Madeleine Jullien 1998)
« La bibliothèque marque cette légère distance du monde, elle est détachée de la praxis,
détachement qui seul permet la connaissance, tout en affirmant clairement son ancrage car il n’est de
connaissance que du réel. C’est un vaisseau qui flotte sur la ville, un lieu abrite, un lieu de privilèges
et de grands bonheurs, dans lequel cependant on entre et que l’on traverse. Ce thème de la traversée
l’anime tout entière ». (Riboulet 1998, 41)
Figure 38 _ Modèle de l’Université a l’entrée de la bibliothèque.
Bibliothèque P8 en temps-réel
Depuis 1989, une génération a passé et nous nous interrogeons toujours sur l’avenir de l’université.
Quelles sont les besoins d’une bibliothèque à l’époque de la floraison de la technologie et de
l’Internet? Comment le rôle de la bibliothèque s’est-il transformé suite à l’arrivée du téléphone
portable et du fait que de nombreuses personnes utilisent leur ordinateur personnel ? Jusqu’à quel
point les appareils intelligents peuvent remplacer l’ancien rôle des bibliothèques ? Serait-il utile pour
les bibliothèques d’instituer des espaces de réalité virtuelle, autrement dit d’intégrer de nouvelles
interfaces de recherche, à partir des bases des données communes entre plusieurs bibliothèques,
accessible pour tous ? Comment on pourrait trouver dans l’Architecture, une nouvelle façon de
mélanger la tradition de la matérialisation de l’espace avec l’innovation immatérielle de la
technologie?
Réaménagement de la Bibliothèque
En 14 janvier 2015, la bibliothèque universitaire de Paris 8 a annoncé une préprogramme33
fonctionnel en vue de la réalisation d’un projet technique et architectural. Le réaménagement s’agit
des espaces publics concernant la création de salles en travail en groupe, de places de lecture très
calme et de place de convivialité. Le contexte se trouve dans le cadre du projet de Learning
center, baptisé « Pépinière »34, souhaité par l'Université, la bibliothèque veut et doit faire évoluer
ses services afin de s’adapter aux nouveaux usages et besoins des utilisateurs, notamment en ce qui
concerne l'offre de places de consultation différenciées.
La bibliothèque dispose aujourd'hui de 1 500 places de consultation organisées autour de grandes
tables collectives (de 4 à 14 places par table, avec une majorité de l'ordre de 10 places regroupées) et
de tables filantes autour des atriums et des rampes de circulation. La possibilité de travailler en petits
33 Service commune de la documentation, Bibliothèque de l’Université Paris 8, 14/01/2015 34 Schéma directeur immobilier (2011), Schéma directeur numérique et système d’information (2012) et Contrat
d’établissement Université Paris 8, jalon 11 (horizon 2017)
64
groupes ou très au calme à des places individualisées propices à la concentration n'avait pas été
retenue lors de l'élaboration du programme de construction à la fin des années 80.
La réflexion menée par les différents groupes de travail constitués au sein de la bibliothèque sur
l’évolution des services publics, l’évolution des métiers et le projet de Learning center, a mis
en évidence trois éléments majeurs : une évolution des besoins, des comportements et des
pratiques d’apprentissage des utilisateurs, l’évolution des méthodes d’enseignement, une nouvelle
articulation nécessaire entre pédagogie, numérique et documentation pour une meilleure réussite des
étudiants. Cela implique la nécessité de créer désormais des salles et espaces de travail en groupe
d'une part, de trouver des zones de calme absolu d'autre part, le tout étant très facilement
repérable par le public à partir de l'entrée dans la bibliothèque.
L’aménagement de l’espace prendra particulièrement en compte le paramètre « sonore », le bruit
généré dans cet espace ainsi que dans l’espace attenant (Salle verte) remontant dans la salle située
au-dessus (Salle rose).
Figure 41_ Lumières en forme de livres volants.
La Bibliothèque et le Son
Ce chapitre sera consacré à l’exposition de la problématique et de ses différents aspects, avec un
certain nombre de questions faisant l’objet d’un remue-méninge collectif. Les bibliothèques sont
traditionnellement conçues et perçues comme des lieux de silence, où les individus sont relativement
isolés.
Nous nous servirons ici du travail Focus group « Gestion du bruit et espaces sonores différenciés »,
dirigé par Isabelle Breuil (conservatrice des bibliothèques, Bibliothèque universitaire de Paris 8).
Par l’origine religieuse de l’étude (les moines), il s’ensuit une forme de sacralisation de la
bibliothèque comme temple du savoir où le silence s’impose. Nous remarquons qu’historiquement,
la lecture n’a pas été toujours silencieuse.
La lecture silencieuse apparaît autour du 12ème siècle avec une transformation de la fonction même
de l’écrit. Le modèle monastique de l’écriture assignait à l’écrit une tâche de conservation et de
mémoire largement dissociée de toute lecture – lecture psalmodiée et liturgique à voix haute, proche
du chant, ou lecture de rumination des textes religieux en vue d’en imprégner son cœur. Lui
succèdera un modèle scolastique de lecture qui fait du livre à la fois l’objet et l’instrument du travail
intellectuel. L’organisation de la page et du texte se complexifiera, et la lecture silencieuse en
permettra d’en approfondir l’analyse.
L’architecture du lieu d’étude des moines qui préfigurent dans une certaine mesure celle des futures
Learning centres.
Avec les changements de pratiques dans la société contemporaine (ex : usage du téléphone portable
à voix haute dans les lieux publics, omniprésence de la musique dans les boutiques), rares sont les
lieux silencieux et exceptés les lieux de culte, on se déshabitue peu à peu du silence.
Les bibliothèques concurrencées par la fourniture documentaire d’ouvrages numérisées et par la
source intarissable que représente internet, cherchent à se singulariser par leur fonction d’espace
commun. La bibliothèque se conçoit alors comme un lieu de vie, où l’échange a toute sa place, mais
où la parole est restreinte.
Le concept de « Troisième lieu », qui se distingue de l’espace privé et de l’espace professionnel,
désignent les lieux de vie où une communauté informelle doit pouvoir s’épanouir librement, tels que
66
67
les cafés qui conjuguent la convivialité de la conversation à celle de la restauration. Ce concept est
souvent évoqué pour décrire le devenir des bibliothèques.
Reste à savoir comment concilier cet espace d’échange informel avec l’injonction au silence.
L’objet de l’Architecture
« Au contraire, d’autres formes de création artistique, le projet d’architecture doit répondre
impérativement à un fonctionnement précis tel qu’il est décrit et condense dans le programme. Le
fonctionnement fonde et détermine le projet, mais dans le même mouvement, le projet, c’est à dire
l’œuvre en gestation, une fois résolue la question fonctionnelle doit la faire oublier ». (Riboulet, Une
bibliothèque dans son espace 1998, 50)
Par principe, la création architecturale est un métier qui laisse peu de place au doute et relève d’une
praxis. Elle diffère en cela de la tâche du critique ou du philosophe. Mais le travail de l’architecte ne
consiste pas dans l’analyse critique d’un phénomène, il est contraint d’arriver à un résultat concret,
de construire une chose dans laquelle, ensuite, les gens habiteront. Comme Le Corbusier l’affirmait à
la fin de sa vie, « faire », c’est « agir dans la modestie, l’exactitude, la précision »34 F
35 (Badiou, et al.
2004, 144). C’est extrêmement lourd, important, parce que, constamment, l’architecte s’interroge
sur son œuvre : « pourquoi cela et pas autre chose ? » Et à un certain moment, nous ne pouvons pas
35 Toujours, les actions de Le Corbusier sont accompagnées et soutenues par un grand sens de moralité. A la fin de sa vie,
il affirme : « […] J’ai 77 ans et ma morale peut se résumer à ceci : dans la vie il faut faire. C’est-à-dire agir dans la
modestie, l’exactitude, la précision […]. »
Figure 42 _ Eléments de l’espace dans l’espace virtuel : échelles, promenade, verticalité. Ou ai-je lu… ?
tricher, parce que nous ne pouvons pas tricher avec la matière que nous allons mettre en œuvre - la
matière réelle, aussi des espaces, des proportions, des conduites sociales. L’œuvre a une matérialité
qui obéit à ses règles propres et dans le même temps, l’architecture est une création, où l’architecte
n’a pas le droit de faillir au niveau de la création artistique. (Riboulet, Écrits et Propos 2003, 38-39)
Néanmoins, la déstabilisation de l’objet de l’Architecture au XXIème siècle est de plus en plus
évidente. L’objet de l’architecture a connu un changement radical depuis que chaque activité relevant
de la création de l’espace, est prise dans une complexité d’activités qui ont évoluées dans l’espace
réel, et se sont simultanément développées dans l’espace numérique de l’Internet, ou via l’Internet
transmises dans un autre espace réel. (Papalexopoulos 2012)
Nous nous intéressons à la définition de l’espace de la bibliothèque comme ensemble d’informations
enregistrées (database). L’architecture d’une bibliothèque réelle ne peut se réduire à la simple
Figure 43_ Une représentation d’Internet.
68
conception d’un bâtiment. La bibliothèque comme pôle d’énergie intellectuelle est un réseau de
connaissance entre le passé, le présent et l’avenir. Nous revendiquons d’envisager notre sujet dans
une variété de lieux transformés et hiérarchisés, autrement dit comme un seul lieu réel où plusieurs
espaces incompatibles se trouvent. Afin de préciser cette idée, citons quelques exemples : un jardin
est une bibliothèque de fleurs, un cimetière est une bibliothèque de tombes, un aquarium est une
bibliothèque de poisons, un zoo une bibliothèque d’animaux, un musée une bibliothèque
d’expositions, une prison ou une clinique psychiatrique est une bibliothèque des gens réprimés et
déprimés, etc. Ces lieux, Michel Foucault les a nommés des hétérotopies36, non que de tels lieux
puissent exister comme les « écrins fonctionnels d’une liberté toute garantie ».
« D'une façon générale, dans une société comme la nôtre, hétérotopie et hétérochronie
s'organisent et s'arrangent d'une façon relativement complexe. Il y a d'abord les hétérotopies du
temps qui s'accumule à l'infini, par exemple les musées, les bibliothèques; musées et bibliothèques
sont des hétérotopies dans lesquelles le temps ne cesse de s'amonceler et de se jucher au sommet
de lui- même, alors qu'au XVIIe, jusqu'à la fin du XVIIe siècle encore, les musées et les
bibliothèques étaient l'expression d'un choix individuel ». (Foucault 1984)
Cependant, nous doutons de l’existence de quelque chose qui serait fonctionnellement - par sa nature -
radicalement libérateur. La liberté est une pratique (Didi-Huberman 2013) que nous essayons
d’appliquer comme «accès libre» aux espaces non commerciaux, comme c’est (encore) le cas dans le
sein des bibliothèques. En réalité, les hétérotopies dont nous parlons se trouvent dans un régime semi-
public, où le citoyen est soumis à décliner son identité en temps qu’étudiant, visiteur, touriste,
professionnel, amateur. Cet accès est médié par la carte ou les horaires d’ouverture. Les hétérotopies
de Foucault, comme les bibliothèques, ont des limites instituées où la liberté ne s’exerce pas
effectivement en vertu de la nature des objets, mais une fois encore, par la pratique de la liberté. « Il
n’y a que des relations réciproques, et des décalages perpétuels entre elles »37.
Les utopies fonctionnent parfaitement, mais de façon irréelle - comme nous le verrons dans le
chapitre suivant - tandis que les hétérotopies fonctionnent de façon bien réelle, même si cela se paye
par un fonctionnement bancal, bricolé, imparfait, jamais complet. Les hétérotopies mettent en œuvre,
36 Foucault, Michel. «Des espaces autres », Empan, vol.54, no.2, 1967: 12-19. 37 Foucault, Michel. « Espace, savoir et pouvoir » [1982], in Dits et écrits, 1954-1988, Paris, Gallimard, 1994 : 275-277.
69
dit Foucault, « une espèce de contestation à la fois mythique et réelle de l’espace où nous vivons »38.
Elles ont « le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements
qui sont en eux-mêmes incompatibles »39, voire plusieurs temporalités hétérogènes (en ce sens que
les archives, les musées ou les bibliothèques sont des hétérotopies cachées sous leur propres lambris
institutionnels). Elles apparaissent comme une « grande réserve d’imagination » dont il ne tient qu’à
nous de faire librement usage40.
Depuis 1997, une nouvelle notion est apparue entre l’architecture et internet avec la définition de
l’ « espace cybrid41 ». Cette idée correspond à la façon dont les activités sont produites. Plus
précisément, une partie de ces activités est produite dans l’espace physique et une autre partie des
mêmes activités se passe sur le Web42. (Anders 1998)
La bibliothèque dans la société de l’information se voit changer de rôle. L’architecte ne conçoit pas
la bibliothèque de l’avenir d’une façon univoque, il offre en même temps un outil pour sa
planification continue. Cependant, il ne refuse pas son rôle principal dans l’application de cet outil.
Au début, il conçoit la bibliothèque comme une machine abstraite, ce qui permet potentiellement
diverses réalisations. C’est une nouvelle architecture de la liquidité, des flux, et la mutabilité repose
sur les avancées technologiques alimentée par le penchant humain fondamental de sonder l'inconnu.
Nous terminerons le deuxième chapitre de l’étude par une phrase de Pierre Riboulet qui illustre le
regard que porte l’architecte sur son œuvre :
« Tout le caractère d’une bibliothèque – monde clos ouvert au monde- que nous cherchons à donner
ce bâtiment se trouve ici réuni : dans cette galerie nous sommes dedans sans être encore entrés.
C’est un endroit d’une merveilleuse ambiguïté, qui aurait séduit des esprits comme Caillois ou
Borges, tous deux comme l’on sait grands amateurs de bibliothèque ». 43
38 Foucault, Michel. Op. cit, 1967: 12-19. 39 Ibid. 40 Didi-Huberman, Georges (Coll.), « Rendre Sensible » in Qu'est-ce qu'un peuple?, Paris, La Fabrique, 2013 : 77-114. 41 Anders, Peter, « Cybrids Integrating Cognitive and Physical Space in Architecture », Convergence : The International
Journal of Research into New Media Technologies, 1998 : 85–105. 42 Dès les premiers concours d'architecture sur l'Internet, en 1997, le concours de l'ACADIE, Libraries in the Information
Age (www.acadia.org). 43Penser, bâtir la bibliothèque de l’université Paris 8, Une bibliothèque dans son espace, Pierre Riboulet, avril 1998
70
De leur côté, les bibliothèques disposent de moins en moins de ressources pour effectuer le travail
nécessaire à l’achèvement de leurs projets documentaires. Elles pourraient donc, au lieu de sous-
traiter une partie de leurs tâches auprès de prestataires ayant recours à de la main d’œuvre dans des
pays à bas coûts, externaliser auprès de la foule des internautes, les tâches qui ne peuvent être
exécutées automatiquement par des programmes et des algorithmes. Cette foule d’internautes
compte des spécialistes dans tous les domaines et des individus susceptibles de s’engager pour des
raisons aussi diverses que le développement personnel, la distraction, le jeu, l’autopromotion ou
l’altruisme. Ces individus pourraient répondre aux appels à participation des bibliothèques qui
bénéficient d’une bonne image, et disposent d’une tradition de bénévolat au service de l’intérêt
général. Ils pourraient ainsi apporter travail, compétences, connaissances, créativité mais aussi
argent et contribuer au développement de projets de numérisation pour la sélection des documents à
numériser, pour la numérisation elle-même, le catalogage, l’indexation et la valorisation éditoriale.
Ils pourraient même remplir des objectifs qu’il aurait été impossible d’imaginer et d’atteindre
auparavant.
Figure 44_ Désigne et télécommunication, a l’espace de la Bibliothèque de l’Ecole Polytechnique d’Athènes, NTUA.
Conclusions Chapitre II
La bibliothèque de Paris 8 est un superbe exemple d'architecture moderne. Un bâtiment moderne
avec tous ces éléments symboliques du passage, autant que voyage dans la connaissance, en
suspension de la terre et pontage. La façade, dans la partie du pont est un point de repère pour toute
l'université. Il possède toutes les infrastructures pour accueillir dans son espace une installation
permanente de la réalité virtuelle. Où les jeunes étudiants peuvent s’informer et les apporter
également au premier contact avec la nouvelle réalité. L'ambition de son architecte était d’être
inspirée par les amateurs de bibliothèques comme Borges. Une vision qui vient de renforcer notre
effort pour unir ces deux mondes, le réel et le virtuel.
La bibliothèque de Paris 8 a toutes les techniques appropriées, les conditions propres à pionner à
l'avenir, en touchant ainsi les normes internationales des bâtiments et des bibliothèques. Nous
concluons que l'argument à partir de laquelle nous avons commencé concernant l’hypothèse que
chaque bibliothèque réelle est potentiellement une bibliothèque de Babel, ne peut pas être répondu à
cette recherche. Mais ce qui peut être répondu est que dans l'exemple que nous avons examiné,
notre assertion est vraie. La bibliothèque de Paris 8 peut être inclut un fragment de la Bibliothèque
de Babel, à assimiler avec elle sur un voyage dans l'infini inconnu à travers l'Internet et de la
technologie.
Dans une époque où le téléphone mobile est considéré comme une bibliothèque de l'expérience et de
stockage de données moderne personnalisée, l'espace est réparti partout. Contraste entre la légèreté et
la facilité d'utilisation de la télécommunication via l’Internet, une bibliothèque virtuelle et
monolithique et calme de la construction proprement dite. La bibliothèque devient un réseau global.
72
Inter médio
Similarités et différences entre la bibliothèque virtuelle et réelle
Comparaison entre la bibliothèque virtuelle et réelle
Bibliothèque de Babel Bibliothèque de Paris 8
AUTEUR Jorge Luis Borges Pierre Riboulet
ART Ecriture / Art de description Architecture/ Art de Lieu
LOGOS Livres sans écrivains Livre des écrivains
ESPACE Homogène / utopique -
dystopique/immatériel
Hétérogène / hétérotopique/
géométrique
SYMBOLES Labyrinthe, Babel, Jardin Pont, Pierre, Passage
OBJET Imaginaire - Virtuel Réel- Pragmatique
TEMPS Ad aeterno Horaire
VILLE Mythique- Babel Saint-Denis
73
Figure 45 _ Superposition de l’espace réel et de l’espace virtuel. La Salle Verte ou salle des périodiques. M.Velaora.
CHAPITRE III : La Bibliothèque comme lieu Rituel.
« Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en
approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des
atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence
nulle part. Enfin c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre
imagination se perde dans cette pensée ». 44
Blaise Pascal
44 Pascal, Blaise. Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets.
76
« The house is not an object, a ‘machine to live in?’. It is the universe that man constructs for himself by
imitating the paradigmatic creation of the gods, the cosmogony. Every construction and every inauguration
of a new dwelling are in some measure equivalent to a new beginning, a new life ».45
Mircea Eliade
Après « la promenade » mentale de notre analyse de la Bibliothèque de Babel et la promenade réelle
dans la Bibliothèque de Paris 8, nous avons jeté les bases de la compréhension des besoins d'une
véritable bibliothèque architecturée intégrant l'art et la réalité virtuelle. Notre intention est de les
associer à une troisième catégorie : la bibliothèque comme un espace rituel. Le réel et le virtuel
entretiennent une relation dynamique, à l’image de situations curieusement complémentaires et
antithétiques simultanément. La sacralisation de l’espace par une cérémonie vise à instituer une
manière d'être dans la salle de la bibliothèque. Pour Mircea Eliade, chaque église et chaque maison
est un centre du monde, en ce qu’il rejoint le Ciel et la Terre. Des espaces quotidiens peuvent être
des espaces transcendants dans le sens de la spiritualité. Cette union entre réel et virtuel n’affirme
son existence véritable qu’en prenant conscience d’un certain type de présence au monde. Une
présence éternelle, mythique et silencieuse peut ainsi se cristalliser à l'intérieur d’une bibliothèque.
Dans ce chapitre, nous essayons de décrire un autre aspect des bibliothèques, un caractère caché dans
les murs et les livres, réels et virtuels, autour de la connaissance qui symbolise l’infini et l’univers
comme contenu. Le rite est une pratique qui met la présence de la personne au centre de l’art du lieu.
Il est des espaces où nous changeons notre comportement quotidien en y entrant, structurés par des
interdits d’approche. Ces endroits indiquent un aspect sacré, comme les églises où nous suivons une
série de pratiques, comme la mosquée où nous devons nous déchausser. Ainsi, les bibliothèques, où
qui respecte le silence en vue de permettre la concentration, sont des Panthéons de « symphonie des
pensées46 ». Nous pourrions dire que d’un certain point de vue anthropologique, la pratique de rituels
représente une Bibliothèque des identités et des communautés.
Le rite, au contraire du réel et du virtuel, est une action ni artificielle ni naturelle. Cela ne signifie
pas forcément que dans le rituel - du côté que nous le regardons – il existe toujours une explication
métaphysique ou fonctionnaliste, cependant nous ne pouvons pas exclure une telle version, mais
nous n’irons pas plus loin dans ce texte. Dans la bibliothèque nous trouvons un espace de « libre-
45 Elliade, Mircea. Sacred Space and Making the World Sacred, page.57 46 Symphony of Thoughts (morceau sonore), Les ailes du désir, Wim Wenders
77
échange spirituel », entre les auteurs et les lecteurs. Notre approche se focalise sur la manière dont
un lieu qui n’été pas construit comme sacré ou religieux, peut accueillir le rituel à travers une
cognition réciproque avec l’espace.
Le rituel, se définit selon le dictionnaire comme « l’ensemble des règles et des rites d’une religion,
d’une association ».
Luc Stéphane clarifie justement la signification et la fonction du rituel. Il explique le mot est
emprunté au latin rituales (libri) « livres traitant des rites ». Le mot actuel rituel est apparu au XVIe
siècle, et utilisé pour la première fois semble-t-il par Rabelais47, pour désigner un livre liturgique
47 François Rabelais (François Rabelais, 1483 ou 1494 - 9 Avril, 1553) était un médecin et écrivain français de la
Renaissance. Rabelais est l'un des plus célèbres humanistes de la Renaissance, en plaidant pour les valeurs de l'antiquité
classique. Son travail a été interdit par l'Église catholique romaine dans l'indice dite Librorum Prohibitorum. Ses plus
célèbres ouvrages, Gargantua et Pentagruel « retracent les aventures de deux géants, père et fils, avec humour et joie de
78
catholique contenant les rites d’administration des sacrements, et particulièrement les fonctions dites
curiales, telles que les exorcismes et les bénédictions. On utilisait habituellement à l’époque le mot
rituaire pour désigner « les livres des rites ». Plus tard, par extension, l’usage du substantif « rituel »
a été étendu à l’ensemble des textes, sur papyrus, parchemin ou papier, ou encore des gravures sur
les murs des temples, indiquant l’ordonnancement des cérémonies.48
Le rite primitif archaïque avait, (selon le sociologue Marcel Mauss), soit un aspect positif, soit un
aspect négatif, comme l’acte magique lui-même. Les sociologues distinguaient également les rites
de la vie quotidienne – qui peuvent devenir des stéréotypes - et les rites commémoratifs faisant
référence, eux, aux symboles, aux mythes, aux modèles mythologiques. Le rite devient alors à cet
égard, une recréation dans le temps des représentations hors du temps, permettant, comme l’a vu
Mircea Eliade, de retrouver « l’éternel, présent mythique », tel que nous l’avons observé dans la
bibliothèque de Babel. (Rite et rituels 2011, 7)
Dans le chapitre « Jardin ou les livres sont des arbres », nous avons déjà parlé du langage silencieux
qu’entoure l’espace de la bibliothèque, les livres, les jardins intérieurs et le dialogue muet qui
s’instaure entre auteurs et lecteurs. Ce dernier discours s’affranchit de la contrainte du temps.
Le rite devient l’instrument d’une prolongation de notre perception spatiale et de notre évolution
spirituelle. Le rituel parfaitement réglé de la vie quotidienne se pose en modèle de vie sociale
communautaire.
L’architecture de la bibliothèque devient une image de l’ascétisme du lecteur. L’architecture à
l’image du rituel prend beaucoup de formes : la « promenade architecturale », la hauteur de l’édifice,
les arches, les escaliers la lumière. L’architecte en tant que plasticien de la lumière conçoit l’espace
de manière à faire circuler la lumière. Dans la Bibliothèque de Paris 8, les rampes, la salle
audiovisuelle cyclique impose une pratique cérémonielle, que nous pouvons ressentir, mais que nous
ne pouvons toujours rationaliser. Le « rituel » repose à la fois sur l’absolue « pureté » de l’espace
(ex : cercle), sur la forme, sur le mouvement du lecteur et du bibliothécaire, sur la proportion de
l’espace vide.
vivre qui respire toutes les créations. éléments de Utopia dans son Rabelais représentés dans le premier des cinq livres, à
propos de Abbaye de Thélème (abbaye de la Volonté). » http://el.wikipedia.org/ 48 « Rite et rituels », Points de Vue Initiatiques, Revue de la Grande Loge de France, 2011, p.31-42.
79
De l’antiquité jusqu’à aujourd’hui, les hommes s’entretiennent avec leur environnement. Au passé,
ils ont fait des libations, des offrandes religieuses en l’honneur des dieux, aujourd’hui des fêtes pour
honorer leur histoire. Pour mieux exprimer l’application de cette pratique de nos jours, nous citons
l’exemple suivant.
Le 28 mars 1995, le Président de la République, François Mitterrand pose la première pierre de
l’édifice. Le symbole de la pierre est vaste, cependant nous nous focalisons sur quelques une de ses
significations. Dans la tradition, la pierre occupe une place de choix. Il existe entre l’âme et la pierre
un rapport étroit. « La pierre, comme élément de la construction, est liée à la sédentarisation des
peuples et à une sorte de cristallisation cyclique. Elle joue un rôle important dans les relations entre
le ciel et la terre : à la fois par les pierres tombées du ciel et par les pierres dressées ou entassées
(mégalithes, bétyles, cairns, monolithes) ». (Chevalier and Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles
1982, 751)
Les pierres tombées du ciel sont d’ailleurs très souvent des pierres parlantes, instrument d’un oracle
ou d’un message. En même temps, les pierres dressées représentent aussi cette fonction de
l’omphalos dont la plus connue est le Beith-el de Jacob, la maison de Dieu. L’omphalos de Delphes,
l’autre de Délos, les pierres sont les symboles de la présence divine, ou tout au moins les supports
d’influences spirituelles.
« L’absolu et l’infini, […] une porte s’y trouve parfois ; on l’ouvre, on est dans d’autre lieux, là où
se trouvent les dieux, là où sont les clefs des grandes systèmes. Ces portes sont celles des
miracles. »49 (Badiou, et al. 2004, 91)
D’une manière générale, un rituel est un acte, une praxis, ou une succession d’actes auxquels que
l’on affecte d’un sens philosophique et spirituel. Nous pouvons donner nombre d’exemples d’actes
rituels dans la vie profane : il suffit de citer par exemple la minute de silence, le garde-à-vous, ou
l’audition d’un hymne debout. On pourrait évoquer également le rituel en vigueur dans les tribunaux,
ou celui des trois coups qui marquent le début d’une représentation théâtrale.
49 Le Modulor, Le Corbusier, p.73
80
Surtout, chacun sait à quel point la vie religieuse en comporte, qu’elle que soit l’obédience ; de
nombreuses attitudes rituelles : joindre les mains, faire le signe de croix ou autre, se mettre à genoux,
se prosterner, se déchausser, se purifier par l’eau, etc. Chez Borges et la Bibliothèque de Babel, nous
trouvons quatre fois le parallélisme entre les actions des bibliothécaires et ceux des pèlerins. Cette
métaphore était si récurrente qu’on ne l’ignorer.
1. « Comme tous les hommes de la Bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse ; j'ai effectué
des pèlerinages à la recherche d'un livre… »
2. « Ces pèlerins se disputaient dans les étroits couloirs, proféraient d'obscures malédictions,
s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs,
périssaient précipités par les hommes des régions reculées. D'autres perdirent la raison... »
3. « Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa recherche, qui un siècle durant battirent vainement
les plus divers horizons ».
4. « Les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en
brigandage, ont décimé la population ».
(Borges, Library of Babel 2000)
Figure 46_ Le rituel comme action théâtrale. Images de la pièce de Tchékhov « La mouette ». Scénographie Numérique. La virtualité comme habillage. L’échelle humaine dans l’espace.
Participation IdefiCreatic, M.Velaora et J.Bardakos.
La pratique d’un rituel renforce considérablement le sens profond des textes, des représentations
symboliques, ou allégoriques qui l’accompagnent. Le rite nous fait entrer dans un mystère,
autrement dit une réalité cachée en Dieu50. Nous pourrions dire que le Rituel participe d’un
psychodrame au sens d’une méthode de formation d’un groupe fondée sur la reconstruction de
situations concrètes, où les participants incarnent des rôles précis. Cela signifie que le Rituel replace
les participants, par sa répétition, son côté théâtral, son vocabulaire, sa gestuelle imposée et ses
expressions propres, dans une autre réalité que celle de leur quotidien, une réalité partagée, hors de
l’« ici et maintenant » de chacun. Paradoxalement, alors qu’il contraint en apparence les attitudes, les
mouvements et les mots, il crée l’espace de la liberté de la pensée, de la réflexion et de la méditation,
comme l’espace d’une bibliothèque le permet.
50 « Comme l’écrit le P. Michel Gitton dans un ouvrage préfacé par le cardinal Joseph Ratzinger avant qu’il ne devint le Pape Benoit XVI, le rituel, qu’exprime la liturgie… »
Figure 47 _ Niveau 1. L’espace vide.
82
L’idée primitive
A ce moment, nous allons étudier la façon dont la réalité se mélange à la virtualité dans le cadre de
notre sujet. Dans la bibliothèque de Paris 8, nous proposons la construction d’un cube (13,2m x
13,2m x 3m), qui sera notre univers. Le cube est la forme la plus simple à comprendre, et symbolise
une logique « carrée ». Ce cube, à l’image d’une pierre tombée du ciel, accueillera des salles
hexagonales et sera le lieu d’une immersion virtuelle. Par métaphore, la bibliothèque de Paris 8
devient un mégalithe de connaissance – un univers concret – qui héberge notre monolithe, un
fragment de la bibliothèque de Babel. Autrement dit, dans notre approche, la virtualité et la réalité
s’enchevêtreront.
Figure 48_ L’idée. Le cube, espace sur l’immersion de la Réalité Virtuelle, ensemble des hexagones.
Dans le cube, nous créons de salles hexagonales, comme celles trouvées chez Borges, créant ainsi un
microcosme labyrinthique. Les hexagones sont traversés par un mouvement spiralique, qui renvoie
au voyage initiatique vers la connaissance de la virtualité. Les salles hexagonales du cube sont des
espaces de lecture conviviale, sur les thèmes de l’Art Numérique et de l’Architecture.
Au centre du cube, nous nous trouvons dans le « centre caché » de notre labyrinthe, c’est la salle à
laquelle on se réfère comme salle de pilotage ou simplement salle-pilote. Il s’agit d’une Cave, ou le
lecteur peut s’immerger seul ou avec d’autres personnes (maximum 4 personnes) dans un univers
virtuel, imaginaire. Là, nous donnons la possibilité à plusieurs lecteurs d’expérimenter le même
univers simultanément, de partager une expérience commune. La salle-pilote est équipée d’un
système de caméras Optitrack qui capturent leurs mouvements, tandis qu’ils deviennent des avatars
du monde virtuel. Nous appelons le centre caché de notre labyrinthe salle-pilote, parce que c’est
l’endroit où le lecteur peut « se décoller » de la réalité. En même temps, le lecteur ou les lecteurs
deviennent les maîtres de leurs propres narrations. Ils prennent la responsabilité de leur propre fin
sur la narration. Une fin fatale ou un nouveau début, c’est au choix de chacun. Autrement dit, la
salle-pilote est une salle qui implique le choix, personnel ou collectif. Cette expérience peut prendre
la forme d’un rituel, et perçue comme tel, incliner à des pratiques nouvelles.
« A mesure que les différentes pratiques artistiques s’émancipent du rituel, les occasions deviennent
plus nombreuses de les exposer ». (Benjamin 2000, 284)
84
Figure 49_ Le mouvement des lecteurs sur le Niveau I. Situation existante.
L’intention
Le premier but de l’installation de ce cube est de faire devenir les lecteurs des auteurs de leur lecture.
En général, l’auteur prédéfinit ou guide les choix et les pensées de son lecteur, contrairement à
Borges, qui laisse libre cours aux interprétations de son œuvre. L’auteur aussi peut devenir aux
travers des autres, le lecteur de sa propre création. Par l’usage de la technologie, nous espérons créer
un dialogue interactif entre l’auteur et le lecteur
Le deuxième but concerne la relation de l’espace à la navigation, où nous donnons la possibilité
d’avoir deux différentes perceptions spatiales, de manière à faire coexister deux méthodes différentes
d’approche :
I. le lecteur-auteur est stable et l'espace se déplace vers lui
II. Le lecteur –auteur est en mouvement. L’espace reste stable. 85
Figure 50_ Le mouvement en spiral des lecteurs sur le Niveau I, comme promenade initiatique. Situation proposée.
Au niveau de la création artistique narrative de salle de pilote, nous nous inspirerons du mythe de
Babel, ville mythique qui fut détruite par la rage de Dieu. Nous cherchons les façons de créer un jeu
incarnant le mythe de cette catastrophe biblique et les leçons que l’on en peut tirer, par des éléments
d’interaction et des choix personnels ou collectives.
- A quelles occasions la bibliothèque virtuelle ou une partie d’elle peut être détruite?
- Pourquoi la mythologie est importante dans l'art numérique?
- Comment la religion et le sacré coexistent invisiblement dans l'Art numérique?
Ces sont des questions, que nous posons aux personnes se verraient intéressés par la réalisation
d’une application ayant pour point de pivot le mythe de Babel.
De l’approche comparative de la bibliothèque réelle et virtuelle a émergé une pléthore de symboles,
que l’on retrouve tant dans la bibliothèque bâti que dans la bibliothèque écrite. Dans l’architecture de
Pierre Riboulet, nous trouvons les symboles du pont, du jardin, de la promenade architecturale, la
forme cyclique comme proportion, la hauteur, la pierre, le couleur blanche et la lumière. Dans celle
de Borges, nous trouvons les pyramides, le mythe de Babel, le labyrinthe, le jardin, les hexagones.
86
Nous nous interrogeons s’il y a des liens communs, des symboles de convergence entre les deux
types de bibliothèque.
Description du Projet
Logiciels utilisés : AutoCad, Unity, Houdini, Lightwave, C#
L'objet de ce travail consiste en une proposition architecturale pour la bibliothèque de Paris 8,
inspirée par l'œuvre de Borges. Le projet est divisé en deux phases:
1. La construction de salles hexagonales.
2. La création d'une application numérique.
Petite remarque : contrairement, à l'œuvre d'un artiste qui peut être individuelle ou collective, la mise
en œuvre du projet d'un architecte n’est pas une entreprise individuelle. Bien qu’il échafaude seule
une idée directrice, il lui faut ensuite coopérer avec les membres d'une équipe technique composée
de menuisiers, de forgerons, de designers, d’informaticiens, etc.
Figure _ 51_ Plan des salles hexagonales.
Partie 1: Voyage initiatique : Proportion en Fonction : Ligne spirale
Pierre Riboulet s’inscrit dans le mouvement d’architecture moderne. Certains de ces principes sont la
création de la promenade architecturale avec des rampes, le plan libre, la libéralisation du sol (avec
l'élévation de la terre), la création de jardins, l'accentuation du mouvement horizontal et vertical.
À l'occasion du programme pour le déménagement des magazines, notre projet s’inscrit dans la
« Salle Verte » de la bibliothèque. Elle est en lien direct avec le hall d’entrée général ou se trouve la
Salle des périodiques. Ce programme stipule de créer des salles de travail en groupe fermées de
175m2.
Notre cube a pour dimensions : 13,2m x 13,2m x 3m. Pour une surface totale de 174,4 m2.
Telles sont les proportions que nous choisissons pour formuler la bibliothèque comme rituel.
Notre objectif est de transformer le mouvement linéaire conçu par l'architecte dans une trajectoire
hélicoïdale. En transformant les mouvements de l’usager de la bibliothèque, nous transformons son
regard et son façon à percevoir l’espace. Nous créons la promenade initiatique pour accompagner le
lecteur dans le monde de la réalité virtuelle.
L’ensemble des salles que nous proposons sont disposées de telle manière à souligner cette tendance.
Nous ne proposons pas un ensemble de salles qui seraient disposées en série, l’une à côté de l’autre,
comme dans un espace commercial ou professionnel. Pour la raison que l’étudiant dans une
bibliothèque ne doit pas être placé dans une vitrine ou un aquarium. Au contraire, notre proposition
repose des critères anthropologiques et multiculturels, partant du principe que les élèves composent
une société, une unité dans l’espace avec des éléments d’épaississement et de dispersion. Influencée
par la Nature, par les cosmologies et manières de concevoir l’espace de différentes cultures, Borges,
et par des modèles organiques, comme le modèle d’une cellule, nous préférons voir le lecteur -
étudiant en tant que membre d’un monde en mouvement, comme celui des abeilles.
En ayant recours à l’hexagone, considéré comme l’arrangement spatial le plus économique, nous
respectons la surface requise par le programme, en évitant la perte d’espace à la périphérie.
88
89
Les murs des salles sont constitués d'un maillage métallique hexagonal et de panneaux de verre et de
bois pressé recyclé (OSB). Il serait bon de respecter la combinaison de ces deux matériaux - verre et
bois, permettant de garder un contact visuel avec la bibliothèque à certains endroits, comme de l’en
isoler complètement à d’autres. Nous pouvons aussi utiliser des matériaux comme le verre et le
plexiglass pour créer un jeu de transparence et de couleurs.
Concernant la fonction des salles:
1. Création d'espaces pour travail en équipe.
2. Création de la Salle Hexagonale comme cockpit, cave.
La dernière salle sera dotée d’un nouveau système de technologie avec des caméras capables de
détecter le mouvement. L'utilisateur, après passage à l'accueil, peut entrer avec une permission
spéciale, pour s'immerger dans un monde parallèle. Basé sur l'analyse que nous avons faite sur la
bibliothèque de Borges, notre objectif est de construire un fragment de la bibliothèque de Babel dans
la bibliothèque réelle. Donc, nous donnerons à ce petit labyrinthe, le mouvement en spirale qui sera
le fil d'Ariane pour se rendre au centre caché, où nous trouvons la salle-pilote.
Figure 52_ Laburinthe, prommenade architectural, voyage initiatique, M.Velaora.
Partie 2: Interface : Narration : Data Base : Immersion
La deuxième partie consiste en la création d'applications interactives numériques présentes dans la
salle-pilote, exclusivement dédiée à la réalité virtuelle. Potentiellement, l’interface peut permettre :
1. une visite de la bibliothèque virtuelle de Paris 8 et de toute autre bibliothèque dans le monde.
2. une recherche des livres en format numérique, les stocker dans un compte personnel, mettre des
bookmarks, faire des comparaisons de textes, etc.
3. une plate-forme commune de coopération avec d'autres bibliothèques de Paris, où les étudiants
entrent avec des avatars et y rencontrent les étudiants d’autres bibliothèques, pour communiquer,
socialiser et échanger des expériences et des informations. Cette plateforme est plutôt envisagée
comme un forum 3d digital. Contrairement à l'espace réel de la bibliothèque, dans l'espace virtuel
des bibliothèques publiques, les étudiants pourront chercher la connaissance non seulement au
travers des livres comme un processus solitaire, mais parler de sujets qui les intéressent. L'espace
numérique devient ainsi un lieu de rencontre, un point fuite de la perception.
4. une narration interactive sur la bibliothèque de Babel.
Pour mettre en œuvre, cette application aurait besoin d'une équipe de personnes expérimentées en ce
qui concerne l'archivage, l'ordonnancement et l'imagerie tridimensionnelle en collaboration avec les
bibliothécaires et les institutions de la bibliothèque. Ne l'oublions pas - cela s'applique plutôt aux
générations futures - l'homme, qui a soif de la connaissance, pourrait perdre le besoin de visiter une
bibliothèque. Par contre, il pourra passer toute sa vie à la recherche de vidéos sur You Tube. Et
commander les livres sur internet sans plus se donner la peine de se déplacer. Les bibliothèques
devraient toujours être présentes et suivre l'époque, être les moyens de cette époque. Sinon, elles
risquent de devenir des institutions désuètes et d’être converties en musées de livres. Les
bibliothécaires doivent être conscients qu’ils sont les tributaires, les dépositaires des clés d'une
tradition profonde.
91
Conclusions Chapitre III
La bibliothèque vue au travers du rite constitue un lieu panthéiste ou pandémonaique, relativement
aux pensées, au langage silencieux des lecteurs. Dans tous les cas, elle reste un lieu de choix. Par
notre analyse, nous avons essayé de découvrir le côté ésotérique des bibliothèques, au niveau de la
réalité et au niveau de la virtualité. L’architecture se doit de prendre en compte, en plus de ces deux
aspects, la ritualité qui opère en ses lieux. Dans le projet architectural que nous proposons, ces
aspects sont les instruments de notre planification. Si nous avons présenté dans le même chapitre les
bibliothèques comme lieux rituels et la description technique de notre projet, c’est parce qu’ils sont
pour nous directement reliés.
En créant, de cellules hexagonales, avec l’aide de la technologie, nous avons tenté de les décrire les
centres d’une communauté.
La sacralisation de l’espace de la bibliothèque correspond à son design, aux proportions de sa
hauteur, la promenade architecturale, la lumière autant qu’à ses interdits d’approche. Le rite compose
un hymne de la connaissance et de la pensée dont pourrait se servir l’art numérique. La narration du
mythe de la Tour de Babel, en tant que catastrophe biblique, peut être l’occasion pour l’imagination
du lecteur d’une catharsis mentale.
Figure 53_ La présence dans le monde virtuel.
Conclusions générales
Figure 56 _ Superposition.
Notre sujet a commencé par l’analyse de la pensée borgienne, en nous appuyant sur la Bibliothèque
de Babel comme parangon virtuel. Les mythes, les formes géométriques et la narration littéraire
constituent un univers codé, labyrinthique, infini et fermé. Il y a beaucoup de représentations et de
symboles au sein de cette bibliothèque imaginaire, de calculs, de mathématiques aussi. Avec
Borges, la Tour de Babel semble un labyrinthe dans lequel l’humanité se serait perdue.
Borges est un architecte-écrivain d’espaces virtuels. Nous cherchons des moyens concrets pour
expliquer des choses immatérielles. Souvent, ces espaces virtuels se réfèrent à une Architecture
possible en forme de réseau, pareil à l’Internet. Les lieux imaginaires de Borges sont construits selon
une architecture hypertextuelle. Inspirés par l’action de l’écriture, nous allons la corréler avec
95
l’action de dessiner, de penser et de bâtir. L’espace lisible est un espace visible, et nous prétendons
que la bibliothèque est espace narratif. L’Objet principal de l’espace impose une certain dialogue
ente l’auteur et les lecteurs. Les livres sont comme les plantes, silencieux et vivants.
Dans la deuxième partie de notre recherche, nous nous sommes intéressés à l’œuvre architecturale de
Pierre Riboulet. Par cet exemple de bibliothèque réelle, son architecture, sa localisation dans la ville
et ses nécessités, nous nous sommes interrogés sur l’avenir des bibliothèques à l’époque du tout
numérique. Culturellement, les bases de données, le catalogage de la raison instrumentale représente
le monde comme une liste d’éléments. Cependant, ce grand catalogue des données numérisées,
refuse de se mettre en ordre. Dans les bibliothèques coexistent la narration et le catalogage qui sont
deux notions antithétiques. L’ordre du catalogage peut être le désordre de la narration, et
inversement. Ils manifestent chacun une certaine vision du monde. Encore une fois, nous retrouvons
le dipôle entre l’ordre et le chaos.
Enfin, nous rappelons la localisation particulière de la Bibliothèque de Paris 8 en face des Archives
nationales de France. La bibliothèque et les Archives Nationales peuvent développer une relation
entre eux puisque toutes les deux sont occupées par les archives et le catalogage. La bonne
organisation des bases de données et la mise en place d'un cadre de coopération entre les deux
identifient précisément leur objectif commun. La meilleure méthode d'apprentissage est le jeu parce
que le jeu convertit la connaissance en expérience. Les Archives et la Bibliothèque de Paris 8 à
l'avenir peuvent devenir un dipôle fort, un partenariat puissant favorable l'Université de Paris 8.
Dans le troisième niveau de notre étude, la bibliothèque est distinguée comme un lieu du choix. Le
silence est le langage de la pensée et un langage universel. Au sein d’une bibliothèque, le silence est
une praxis. Par la structure hexagonale, nous avons essayé d’éviter la création d’espaces « morts ».
L’habitude qu’on a pris, au niveau anthropologique, d’utiliser Internet dans la vie quotidienne fait
émerger des questions sur notre « réalité » qui tend à se confondre avec le monde virtuel. De notre
point de vue, la Réalité Virtuelle peut s’inspirer du Jardin des Hespérides, où la quête de
connaissance est jonchée d’épreuves, qu’illustre le Dragon comme un interdit d’approche. Le
labyrinthe représente un problème en attente de solution vers un centre, un dieu caché, éclaté dans les
96
livres. La problématique de la sacralisation de l’Art Numérique et de la Réalité Virtuelle reste
ouverte. Quels en seront les interdits d’approche et leurs gardiens ?
Dans notre projet, nous avons dépeint la bibliothèque en trois nuances. L’application de l’espace
imaginaire de Borges, amant des bibliothèques, au lieu réel la Bibliothèque de Paris 8 de Pierre
Riboulet, architecte de bibliothèques, est un essai de noces du réel et du virtuel sous l’égide du
rituel.
97
Figure 57_ Tour de Babel, Exposition au musée d’Art Moderne d’Istanbul sur la ritualité de l’Architecture (2015), photographie Maria Velaora
Bibliographie
Frontisi - Ducroux , Françoise. Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce ancienne. Paris: Éditions
La Découverte & Syros, 2000.
Anders, Peter. «Cybrids Integrating Cognitive and Physical Space in Architecture.» Convergence:
The International Journal of Research into New Media Technologies, 1998: 85–105.
Augé, Marc. Non-Lieux. Paris: éditions du Seuil, 1992.
Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Éditions du Seuil, 1957.
Baudoui, Rémi, et al. Le symbolique, le sacré, la spiritualité dans l'œuvre de Le Corbusier. Paris:
Édition de la Vilette, Fondation Le Corbusier, 2004.
Benjamin, Walter. Œuvres III. Paris: Éditions Gallimard, 2000.
Bloch, William Goldbloom. The Unimaginable Mathematics of Borges' Library of Babel. New York:
Oxford University Press, 2008.
Borges, Jorge Luis. «Library of Babel.» Dans Labyrinths, 78-86. London: Penguin Books, 2000.
Chevalier, Jean, et Alain Gheerbrant . Dictionnaire des Symboles. Paris: Editions Robert Laffont,
S.A. et Editions Jupiter, 1982.
Crollius, Oswald. Traicté des Signatures ou Vraye et Vive Anatomie du Grand et Petit Monde.
Milano: Sebastiani, 1976.
Didi-Huberman, Georges. «Rendre Sensible.» Dans Qu'est-ce qu'un peuple?, de Alain Badiou, Pierre
Bourdieu, Judith Butler, Georges Didi-Huberman, Sadri Khiari et Jacques Ranciére, 77-114.
Paris: La Fabrique éditions, 2013.
Foucault, Michel. «Des espaces autres.» Empan vol.54, no.2, 1984: 12-19.
Madeleine Jullien. Penser, Bâtir la bibliothèque de Paris 8. Université Paris 8 Vincennes Saint-
Denis, 1998.
Norberg-Schulz, Christian. L'Art du lieu: Architecture et paysage, permanence et mutations. Paris:
Le Moniteur, 1997. 99
Norberg-Schulz, Christian. «Le Lieu.» Dans L'Art du lieu, 194. Paris: Le Moniteur, 1997.
Riboulet, Pierre. Écrits et Propos. Paris: Éditions du Linteau, 2003.
Riboulet, Pierre. «Une bibliothèque dans son espace.» Dans Penser, Bâtir la bibliothèque Paris 8,
41-54. Université Paris 8, 1998.
«Rite et rituels.» Points de Vue Initiatiques, Revue de la Grande Loge de France, 2011: 7-108.
WEB
Papalexopoulos, Dimitris. rizosarchitects blogspot. 27 Janvier 2012.
http://rizosdimitris.blogspot.fr/2012/01/quasi-objets.html (accès le Avril 20, 2015).
Rollason, Christopher. «Borges’ “Library of Babel” and the Internet.» s.d.
http://www.themodernword.com/borges/borges_papers_rollason2.html (accès le Avril 24,
2015).
L. B. Alberti and G. Leoni, The Architecture of Leon Batista Alberti in Ten Books. E. Owen, 1755.
R. Barthes, “The world of wrestling,” Steel Chair to the Head. Ed, 1972.
R. Barthes, Mythologies, Nachdr. Paris: Éd. du Seuil, 2005.
J. Baudrillard, “The precession of simulacra,” Media and cultural studies, p. 453, 2006.
M. Bello Marcano, “Jorge Luis Borges et la dédalographie. Introduction fictionnelle à un archétype
spatial,” Sociétés, vol. 113, no. 3, p. 73, 2011.
J. Bessière, “Beyond solipsism: The function of literary imagination in Borges’s narratives and
criticism,” SEMIOTICA-LA HAYE THEN BERLIN-, vol. 140, no. 1/4, pp. 33–48, 2002.
P. Borgeaud, “The Open Entrance to the Closed Palace of the King: The Greek Labyrinth in
Context,” History of Religions, pp. 1–27, 1974.
J. L. Borges and A. Hurley, Collected fictions. Viking New York, 1998.
J. L. Borges, Seven nights. New York: New Directions Pub. Corp, 1984. 100
J. L. Borges, “The Library of Babel,” University of South Carolina, 2004.
R. Borgès Da Silva, “Taxonomie et typologie: est-ce vraiment des synonymes?,” Santé publique,
vol. 25, no. 5, pp. 633–637, 2013.
G. Borradori, “Virtuality, philosophy, architecture,” 2000.
P. Bourke, “Constrained diffusion-limited aggregation in 3 dimensions,” Computers & Graphics,
vol. 30, no. 4, pp. 646–649, 2006.
R. Cahtarevic, “Virtuality in architecture: From perspective representation to augmented
reality” Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 6, no. 2, pp. 235–241,
2008.
C. Castoriadis, The imaginary institution of society. Mit Press, 1997.
A.-J. Clisson, “L’art, lieu de réconciliation de conflit identitaire,” 2013.
P. I. Cowling and C. Gmeinwieser, “AI for Herding Sheep.” in AIIDE, 2010.
D. Gauntlett, Creative explorations: new approaches to identities and audiences. London; New
York: Routledge, 2007.
T. Henricks, “Caillois’s Man, Play, and Games,” 2011.
H. Hofer, “Babel,” L’Autre, vol. Volume. 9, no. 2, p. 281, 2008.
M. Léon, “Babel,” Gestalt, no. 1, pp. 57–72, 2009.
L. Manovich, The language of new media, 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass: MIT Press,
2002.
L. Marin, “L’utopie de la carte,” VB, vol. 5, p. 47, 1998.
Momein, “La création d’une bibliothèque universitaire délocalisée par l’intégration de
bibliothèques associées: l’exemple de Bourges (SCD d’Orléans),” 2002.
M. Natanson, “Babel.: L’adolescent : entre fusion et solitude,” Imaginaire & Inconscient, vol. 20,
no. 2, p. 95, 2007.
R. Perron, “La tour de Babel.: Considérations sur le processus analytique,” Revue française de
psychanalyse, vol. 71, no. 4, p. 1111, 2007.
J. Perry, ‘Borges and I’, The Amherst Lecture in Philosophy, vol. 2, no. 2007, pp. 1–16, 2007.
M. Servet, “Les bibliothèques troisième lieu,” Bulletin des bibliothèques de France [en línia], vol. 4,
2010.
D. Vidal, “Maupéou-Abboud Nicole de, Ouverture du ghetto étudiant. La gauche étudiante à la
recherche d’un nouveau mode d’intervention politique (1960-1970),” Revue française de sociologie,
vol. 15, no. 4, pp. 639–641, 1974.
101
PDF sans métadonnées
“Auge Non places.pdf.” .
“Autourderogercaillois.pdf.”.
“Baudrillard_Seduction.pdf.” .
“Burnham_Jack_The_Structure_of_Art_rev_ed.pdf.”
“Caillois.pdf.”.
“Cybrids2.pdf.”
“LE-JARDIN-AUX-SENTIERS-QUI-BIFURQUENT-Dossier-Presse.pdf.”
“Microcosmes.pdf.”
“Roger-caillois-man-play-and-games-1.pdf.”
“Serres_quasi_object1.pdf.”
“The sacred and the profane.pdf.”
Filmographie
Dogville. s.d.
Interstellar. s.d.
L'avenir est aux lecteurs. 1997.
Le Nom de la Rose. s.d.
Les ailes du désir. Réalisé par Wim Wenders. s.d.
Toute le mémoire du monde. s.d.
102
Figure 58_ Livres Volantes, Exposition au musée d’Art Moderne d’Istanbul sur la ritualité de l’Architecture (2015), photographie Maria Velaora.
104
TABLE DES MATIERES
Introduction: La Bibliothèque comme Lieu ........................................................................................... 9
CHAPITRE I : La Bibliothèque de Babel comme lieu Virtuel ........................................................... 15
Labyrinthe, Babel, Jardin : trois mythes ....................................................................................... 15
Maison Hexagonale ...................................................................................................................... 37
Conclusions Chapitre I _Pourquoi une Bibliothèque de Babel ? ................................................. 50
CHAPITRE II : La Bibliothèque de Paris 8 comme lieu Réel. ........................................................... 54
Histoire ......................................................................................................................................... 57
Tissu Urbain et Bâtiment .............................................................................................................. 58
Bibliothèque P8 en temps-réel ...................................................................................................... 64
La Bibliothèque et le Son ............................................................................................................. 66
L’objet de l’Architecture .............................................................................................................. 67
Conclusions Chapitre II ................................................................................................................ 72
Inter médio .................................................................................................................................... 73
CHAPITRE III : La Bibliothèque comme lieu Rituel. ........................................................................ 76
L’idée primitive ............................................................................................................................ 83
L’intention .................................................................................................................................... 85
Description du Projet .................................................................................................................... 87
Partie 1: Voyage initiatique : Proportion en Fonction : Ligne spirale .......................................... 88
Partie 2: Interface : Narration : Data Base : Immersion ............................................................... 90
Conclusions Chapitre III ............................................................................................................... 92
Conclusions générales .......................................................................................................................... 95
Bibliographie........................................................................................................................................ 99
Filmographie ...................................................................................................................................... 102
105