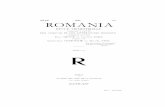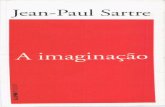Jean Regnier : une vision carcérale de la paix
Transcript of Jean Regnier : une vision carcérale de la paix
Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études médiévales du Québec, 7 (2003), p. 159-173
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix
Tania VAN HEMELRYCK Fonds National de la Recherche Scientifique,
Université catholique de Louvain
L'œuvre poétique de Jean Regnier, bailli d'Auxerre et sujet de Philippe le Bon, nous est parvenue par le biais de l'édition de 1526, qui rassemble diverses pièces sorties de sa plume sous un intitulé générique: Les Fortunes et adversitez 1 •
De ce volume émergent deux parties distinctes. La première renferme un recueil poétique, le Livre de Prison, témoin de la captivité de l'auteur en terre française, de janvier 1432 à mai 1433. Les productions présentes dans cette partie sont assez hétéroclites, car elles expriment à la fois le désespoir personnel du prisonnier, ses appréhensions civiques sur l'état de la France, mais aussi ses élans amoureux dans les pièces envoyées à son épouse, et enfin sa vision personnelle des fins dernières dans un Testament. Quant à la deuxième partie, elle comprend diverses pièces qui furent composées après la captivité. Malgré ces apparentes divergences, Jean Regnier « a conçu avec ses Fortunes et Adversitez un ensemble de grande diversité de tons, dont l'uni té est assurée par le double j eu de l' éq uili bre en tre la fan taisie et la gravité d'une part, et, d'autre part, d'une série de points de repère chronologiques qui lui donne le rythme général d'un réci t » 2.
1. Jean REGNIER, Les Fortunes et Adversitez. Texte publié par E. DROZ, Paris, Champion, 1923 (S.A.T.F.).
2. R. MENAGE, « Deux poètes en prison: Maître Jean Reynier et le prisonnier de Loches », Senefiance, 5 : Exclus et systèmes d'exclusion dans la littérature et la civilisation médiévales, Aix-en-Provence, C.U.E.R.M.A., 1978, pp.241-249.
160 Memini. Travaux et documents
Outre une datation assez large comprise entre 1433 et 1465, ces textes témoignent, à divers niveaux de littérarité, de l'intérêt personnel de Jean Regnier pour l'écriture. En effet, il semble bien que Jean Regnier fut un adepte de la plume, bien avant sa réclusion forcée de Beauvais, et il put peut-être participer aux puys poétiques, fréquents dans les villes du Nord.
Bailli d'Auxerre depuis 1424, Jean Regnier remplit plusieurs missions connexes à sa charge afin de défendre les intérêts du duc de Bourgogne dans le conflit de la guerre de Cent Ans, car Philippe le Bon était devenu maître de l'Auxerrois après la cession de la région par les Anglais. C'est au cours d'une de ses expéditions, le 14 janvier 1432, que Jean Regnier est capturé par les hommes de Charles VII et détenu pendant un an et demi à Beauvais. Il est libéré contre le paiement de mille écus en 1433.
Dans l'espace de ces quelques pages, nous souhaiterions nous arrêter brièvement sur une facette particulière de ce kaléidoscope poétique: la vision pacifique 3 du poète lors de sa captivité.
De fait, un passage du Livre de prison concerne explicitement les motifs de la guerre et de la paix (vers 1457 à 2122)4. Dans la
3. Cette étude constitue la version remaniée d'une partie de notre thèse: T. VAN HEMELRYCK, Les marques pacifiques de la littérature française médiévale: d'Eustache Deschamps à Pierre Gringore, Université catholique de Louvain, Faculté de Philosophie et Lettres, 2000, 2 vol.
4. Bien que tout ce passage ait bénéficié d'une étude par Gérard Gros, nous pensons que certains points pourraient être précisés dans l'optique pacifique; cf. G. GROS,« Croisade contre les Boesmes, ou guerre et paix chez Jean Regnier. (Sur un passage du Livre de la Prison) », Cahiers de Recherches Médiévales, 1 (1996), p. 105-127. Dans son article, René Menage déforce un peu l'unité de ce passage en y associant les vers précédents, depuis le vers 1330 (cf. art. cité, p. 242-243) ; en effet, l'allongement du passage inclut dès lors d'autres rubriques: Balade layee que le prisonnier feit le jour de Pasques (p. 50), Comment ledit prisonnier se complaint du poursuyvant lequel ne retourna pas au jour qu'il avoit promis (p. 52), Comment ledit prisonnier se complaint de son varlet lequel ne retournoit point (p. 52), qui n'encadrent pas aussi explicitement ce passage sur la guerre et la paix, comme le font les deux autres rubriques citées dans le texte.
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 161
premlere édition du texte - parue le 25 juin 1526 5 - deux titres assez explicites encadrent le passage, corroborant cette lecture pacifique:
Comme ledit prisonnier se complaint des pays estranges ou il a esté bien ayse, et ou pays dont il est natif il a grant fortune et se lamente des maulx qu'il voit venir en France6 •
Comment après ce que le prisonnier a parlé des faitz de la guerre il parle d'autres matieres en continuant son œuvre7 •
Il va sans dire que ces titres ne figuraient peut-être pas dans les documents qui sauvegardèrent la mémoire des vers de Jean Regnier jusqu'à leur impression au début du XVIe siècle; malheureusement, aucun témoin manuscrit n'a été retrouvé jusqu'à présent 8 bien qu'il existe cinq exemplaires de l'édition de 1526.
Concernant ce passage centré sur la guerre et la paix, Eugénie Droz notait que
Le bailli abonde en considérations sur les malheurs de la France; ces préoccupations donnent à son livre une certaine dignité et permettent de comparer l'auteur à Alain Chartier. [ ... ] Ces six cents vers sur la paix et la description des
5. Il est à noter que le permis d'imprimer a été obtenu le 10 mai 1524 ; cependant, Jean de la Garde ne l'imprima que deux ans plus tard, après la défaite et la captivité de François 1er , à Pavie, le 24 février 1525. Le roi resta prisonnier de Charles Quint jusqu'au 17 mars, après la signature du traité de Madrid, le 14 janvier 1526; voir: R.J. KNECHT, Un prince de la Renaissance: François 1er et son royaume, Paris, Fayard, 1998, p. 219-247. Sur l'impact de cette bataille en littérature, voir: CI. THIRY, " L'Honneur et l'Empire: à propos des poèmes de langue française sur la bataille de Pavie », Mélanges à la mémoire de Franco Simone, Genève, Slatkine, 1980, t. 1, p. 297-324.
6. E. DROZ, op. cit., p. 55. 7. Ibid., p. 77. 8. Déjà en 1923, Eugénie Droz notait:" L'œuvre de Jean Regnier ne semble
pas s'être conservée en manuscrit. Je n'ai du moins retrouvé sous cette forme qu'une seule chanson, "ballade en trois" (vers 2256-2311) qui figure sans attribution dans le ms. 205 (fol. 375) de la bibliothèque de la ville de Berne. Ce manuscrit, qui date de la seconde moitié du xve siècle, a été écrit à Sens. ». Voir ibid., p. vii.
162 Memini. Travaux et documents
maux de la guerre rappellent étonnamment le Lay de Paix d'Alain Chartier; la similitude de pensée et d'expression est très grande, mais la suite des idées et le rythme des vers sont différents 9 •
Ces 0 n t peu t - ê t r e ces 1 i g n e s qui 0 n t fa i t é cri r e à P. Tuc cil 0
que Jean Regnier avait composé un Lay de Paix; bien qu'il existe effectivement une communauté de ton entre les vers de Regnier et le texte de Chartier, la structure formelle de leur production les distingue clairement. En effet, Alain Chartier a composé un lai dans la pure tradition poétique de l'époque tandis que Jean Regnier a agencé quelque 665 vers sur le mode des malheurs de la France afin de dégager du Livre de Prison un tout thématiquement homogène, traversé par les composantes traditionnelles de la littérature pacifique médiévale et par le recours obligé aux masques du prisonnier pour parler aux puissants. Cependant, bien que certaines pièces épousent les caractéristiques formelles du lai, l'œuvre complète ne satisfait pas aux exigences de cette forme poétique.
La narration pacifique de Jean Regnier débute au vers 1457 par le récit d'une expérience personnelle ll . En effet, l'auteur relate ses nombreux voyages en pays étrangers et en Extrême-Orient, où, malgré le caractère païen de CeS contrées, il vécut des moments de félicité et ne dut jamais subir les maux qui l'accablent alors en France (v. 1457-1506)
Et partout ay fait chiere lye Sans avoir mal ne villenie,
9. Ibid., p. xxvii. 10. Nous n'avons pas pu consulter cet ouvrage; dès lors, nous nous basons
sur les observations de Claude Thiry. Voir Cl. THIRY, « Que mes maistres soient contens. Jean Regnier, prisonnier, au carrefour de Bourgogne et de France », dans Cl. THIRY (éd.), A l'heure encore de mon escrire. Aspects de la littérature de Bourgogne sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire, numéro spécial des Lettres romanes, (1997), p. 183-205. Notons que, dans son article déjà mentionné, Gérard Gros nomme parfois ce passage « lai de paix ».
11. Dans son article, Cl. THIRY s'est penché sur l'attitude de l'auteur dans la partie de son Livre de Prison consacrée à la guerre et à la paix. Cl. THIRY, «L'Honneur et l'Empire ... », art. cité, p. 197-204.
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix.
Peine, tourment ne maladie, Oncques ne feis chere meilleur. Et en France qui a nourrie Ma personne, sera ma vie Fin el en toute douleur Par Fortune que Dieu mauldie. (v. 1475-1482)
163
Dès le vers 1482, l'auteur pointe distinctement Fortune l2
comme la responsable des malheurs du temps présent. Les vers suivants illustrent l'universalité des maux dont elle afflige les hommes sans distinction sociale. Bien qu'il évoque également le sort pénible de la population du royaume, Jean Regnier omet cependant d'expliquer plus longuement comment Fortune s'acharne avec vigueur sur le monde. En effet, il semble craindre des représailles bien réelles de lagent, soit ceux qui le tiennent à merci:
Helas, par ma foy, se je osasse, Je parlasse
Plus avant de ceste matiere, Së autre que Dieu ne doubtasse,
Je comptasse La chose qui est assez clere, Mais la gent est de tel maniere
Si tres fiere Quëilconvientquejem'enpasse. (v. 1507-1515)
Ces précautions oratoires perdurent jusqu'au vers 1540 ; il s'agit pour l'auteur de se mettre à l'abri d'éventuelles réactions négatives, tant de la part de ceux qui le gardent captif que de ceux qui pourraient le faire sortir de sa geôle l3 • Les formules sont
12. A ce sujet, voir M. LACASSAGNE,« Poétique de la fortune dans le Livre de la Prison de Jean Regnier », Nottingham French Studies, 38, 2 (1999), p. 150-158.
13. Comme l'a souligné Claude Thiry, il convient de relativiser quelque peu la vision romantique du pauvre prisonnier mis aux fers dans son cul-debasse-fosse; en effet, Jean Regnier a pu être,« à certains moments de sa captivité, assigné à résidence chez Pierre Du Puis, ou bien il pouvait bénéficier, grâce à ce dernier, d'un régime de faveur, comportant notamment des visites de "no dame" et du "mesnage" ... », cf. Cl. THIRY, art. cité, p. 187.
164 Memini. Travaux et documents
nombreuses et soulignent l'omniprésence de cette rhétorique nécessaire au discours pacifique, surtout au texte rédigé en captivité. Cependant, s'il désigne Fortune comme la responsable des maux actuels (bien voy que seul pas je ne suis / tresmal gouverné par Fortune, v. 1573-1574), elle n'est en somme que la conséquence d'une action préalable commise par une entité réelle et humaine: plurielle au début, ceulx qui conseiller soulloient (v. 1550) ou encore je ne scay a quoy ilz pensoient (v. 1555), mais singularisée dans le déclenchement des hostilités, qui ce fist peu y pourpensa (v. 1561). Dans ces vers, Jean Regnier fait peut-être allusion aux années de troubles et de haines 14 entre Jean sans Peur et Louis d'Orléans, « régents,' implicites du royaume en raison de l'absence mentale du roi Charles VI. Par ailleurs, le vers 1561 indique un acte précis, catalyseur du malheur: peut-être l'assassinat de Louis d'Orléans par Jean sans Peur le 23 novembre 1407, ou la vengeance du parti orléanais à Montereau le 10 septembre 1419. La logique partisane préférerait la seconde option; la conscience de l'homme pourrait dénoncer le premier meurtre ...
Ensuite, après avoir pointé la situation malheureuse du pays, conformément à la tradition des récits pacifiques, Jean Regnier expose les maux corollaires de tout affrontement armé (v. 1593-1628) : destruction des lieux saints, éclatement des structures sociales, perturbation des échanges économiques, arrêt des activités agricoles. Notons qu'à nouveau l'exposé est précédé d'une requête de permissivité d'élocution, adressée à l'auditoire de ses plaintes:
Francë a beaucoup d'ennemys, Guerre si en a la defferre, Telle a partou t mis sa devise Des grans maulx qui y sont commis, Quant g'y pense, le cueur me serre, Voulez vous que vous en devise? (v. 1587-1592)
14. À ce sujet, voir: B. GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, Paris, Gallimard, 1992.
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 165
Comme il se doit, toutes les catégories sociales sont touchées par les malheurs de la guerre: le clergé (mainte eglisë, v. 1593), la noblesse (v. 1597) et, selon la tripartition canonique, le « peuple ». Nonobstant, il convient de distinguer deux couches de la population dans cet ensemble: les bourgeois ou marchans (v. 1609) et les laboureux (v. 1612), ainsi que leurs femmes et enfants, victimes de choix de la guerre (v. 1601-1607). Il coupera court à ses élans rédactionnels, prétextant l'impossibilité de rendre compte en peu de temps de tant d'horreur:
Së au surplus dire vouloye Les maulx que la guerrë envoye Ce seroit admiration. Escripre je ne les scauroye Se d'escripre je ne cessoye D'icy jusques a l'Ascention. (v. 1655-1660)
Par leur universalité, ses plaintes pouvaient courroucer tous les partis de la guerre de Cent Ans et de la querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Chaque faction pouvait trouver insultant d'être désignée comme la responsable de tant d'infortune et de désastre. Ainsi, les geôliers « français» pouvaient décider de supprimer cet hôte aux paroles diffamantes, tandis que Philippe le Bon pouvait choisir de le laisser croupir dans sa prison.
Cependant, force est de remarquer que c'est avant tout la France qui est montrée du doigt dans le texte de Jean Regnier. À la différence d'Alain Chartier et de Christine de Pizan, qui visent l'union des princes de lis - y compris le duc de Bourgogne - contre l'Anglais, le bailli d'Auxerre se contente de sermonner la France sur son état déplorable, conséquence de ses actions. Cependant, l'auteur préfigure une entente à trois; jamais il n'envisage la lutte de deux contre un, c'est-à-dire la France et la Bourgogne contre l'Angleterre. Il parle certes de l'accord des princes, mais l'indétermination permet d'inclure l'Anglais dans l'entreprise pacifique:
Preschez de paix et de concorde Pour tous les princes accorder. (v. 1978-1979)
166 Memini. Travaux et documents
Jean Regnier use de tous les détours stylistiques et rhétoriques mis à sa disposition afin d'exposer les rouages de la situation avec le plus de tact possible. Ainsi, il utilisera les personnifications de Fortune, de Guerre et de Paix pour symboliser l'affrontement bien réel des trois partis aux prises dans la guerre de Cent Ans.
Bien que quelques portions du Livre de Prison soient directement adressées à Guerre ou à Paix, jamais ces personnifications ne s'animent. Ainsi, Dame Paix apparaît dans une longue litanie (v. 1661-1692), où les bienfaits inhérents à sa nature font face aux malheurs causés par son absence; la sonorité des rimes féminines en -ee et -esse crée une atmosphère à la fois délectable et nostalgique, tandis que la suite des vers adressés à Guerre (v.1693-1716) se décline sur des rimes, certes féminines, mais au ton plus cassant et agressif, rendu par la succession des rimes en -euse et -yre.
Déjà évoqué dans la portion dévolue à Paix,
Mais Guerre la larronnesse Si l'a de France esgaree,
Et ostee, Par emblee, Et chassee, etc. (v. 1675-1680),
le motif traditionneJ15 de la paix chassée par Guerre trouve sa pleine expression dans l'invective lancée à Guerre:
Chasseë a Paix l'heureuse. (v. 1705)
15. Déjà dans le Lay dePaixd'Alain Chartier, l'état de discorde était opposé à un âge d'or révolu (v. 113-152), celui durant lequel Paix séjournait encore en France avant d'en être bannie (v. 144). Il est intéressant de remarquer que Paix est victime et n'agit jamais de son plein gré lorsqu'elle quitte une contrée, elle y est contrainte et forcée. L'image se rencontre également dans le Lay de Guerre de Pierre de Nesson:
Nostre Pere, l'Anemy, nous bouta En France, lorsque Paix il en osta. (v. 87-88) [ ... ] Et dès que Paix apparceut regner Vice, Elle s'enfuy et enmenaJustice. (v. 97-98)
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 167
Quant à Dame Paix, elle apparaîtra une dernière fois dans une succession de vingt vers anaphoriques, déclinant les qualités de cette vertu divine (v. 1905-1924). Comme le soulignait Gérard Grosl 6,
ce passage est à rapprocher des productions mariales, ce qui conforte implicitement les parallèles que certains textes pacifiques tissent autour des figures de Paix, de Marie et de la femme l7 .
À côté de ces entités abstraites, l'auteur se réfugie derrière le Dieu tout-puissant lB , seul juge des faits terrestres, pour mettre en cause ceux qui ne s'api to ien t pas sur ces malheurs (v. 1629-1648). L'attaque est détournée, mais claire: tous les puissants ont leur lot de responsabilités. En effet, après avoir évoqué les cas opposés de Paix et Guerre, soit s'être posé au seuil spirituel et allégorique de la compréhension des événements, l'auteur « redescend» au sens littéral et considère brièvement la situation malheureuse de France (v. 1717-1728). Jean Regnier insère à nouveau une réflexion tangible sur l'histoire réelle par le biais d'une question adressée à son « auditoire » :
Scavez vous point a quoy il tient Que France a tant d'aversité ? Certes toute la faulte vient Que on n'ose dire verité. Il ne court foy ne charité, Je m'esbahis que tout devient En chastel, ville ne cité. j'en dis plus qu'il ne m'appartient. (v. 1729-1736)
Dans ces quelques vers, l'auteur vien t donc d'exposer la raison évidente des adversités du temps présent: le mensonge. À la lumière de notre connaissance des événements de l'époque, cet état de mensonge pourrait trouver plusieurs voies d'interprétation.
16. G. GROS, « Croisade contre les Boesmes [ ... ] ", p. 116. 17. Voir T. VAN HEMELRYCK, « La femme et la Paix. Un motif de la littérature
pacifique .. , Revue belge de philologie et d'histoire, (à paraître). 18. Ainsi, il consacre quelques vers aux morts sans confession, ceux que la
guerre a happé trop rapidement, les délaissant du dernier acte de tout bon chrétien: le repentir avant de mourir (v. 1649-1660) ; la vengeance divine se profile déjà à l'horizon, mais seulement pour le lot des victimes, ... les responsables directs suivront.
168 Memini. Travaux et documents
Ainsi, l'émergence des affrontements entre la Bourgogne et la France est explicitement liée aux mensonges et aux dissimulations. Citons le meurtre du duc Louis d'Orléans commandité secrètement par Jean sans Peur le 23 novembre 1407 19 , suivi de la vengeance déguisée du parti « français » et armagnac lors de l'entrevue de Montereau, qui se solda par l'assassinat de Jean sans Peur, le 1 0 septembre 1419.
De plus, les missions diplomatiques de l'auteur l'ont prédisposé à côtoyer ces multiples alliances secrètes et revirements de négociations. Il est vrai que la plupart des tensions subsistantes entre les deux, voire trois, parties s'ancraient dans de torves manœuvres de dissimulation. Notons qu'au moment où Jean Regnier rédige son Livre de Prison, seul le roi Charles VII s'opposait à un rapprochement des trois parties en vue de la paix 20 , bien que les pourparlers de 1430 à Auxerre inclussent Charles VII, Philippe de Bourgogne et Bedford dans la paix.
Cependant, Regnier préfigure la paix d'Arras à trois 21 ,
telle qu'on l'imaginait après Auxerre, soutenant les vues de son maître de Bourgogne:
Pour plus declairer la matiere De ceste paix et qu'on la quiere, Qu'elle soit pure, necte et clere, Et telle que je la demande, La voye seroit la premiere De trouver, par bonne maniere, Par requestë ou par priere, Que de trois pars les gens on mande,
[nous soulignons] A qui la paix on recommande. (v. 2051-2059)
19. Cf. B. GUENÉE, Un meurtre, une société. op. cit., p. 121-281. 20. Le concile de Bâle tenta de rapprocher les trois parties dès 1433, sans
succès; la France restait réticente à un rapprochement avec les Anglais. Voir: J.G. DICKINSON, The Congress of Arras 1435. A Study in Medieval Diplomacy, Oxford, Clarendon Press, 1955.
21. Cependant, la paix signée entre le roi de France et le duc de Bourgogne excluait l'Angleterre des accords; après la signature de la paix, Philippe le Bon était contraint d'abandonner toutes ses alliances anglaises.
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 169
Jean Regnier pointe donc du doigt le nerf de cette guerre, tout en se gardant bien de désigner clairement un coupable ... bien qu'il se trahisse peut-être lorsqu'il rédige les vers 2067 à 2069, certes dictés par des motifs religieux d'expiation guerrière et soutenus par les exigences poétiques de la rime (Angleterre: guerre) ainsi que des syllabes, mais sous-tendus par une représentation « béatifique» du parti bourguignon, non associé à:
Ceulx qui vouldront faire la guerre, Soient de France ou d'Angleterre, Aillent sur les Boesmïens, etc. (v. 2067 -2069)
Il souhaite la paix ou une fin relative des affrontements, qu'un traité de paix ou une croisade pourraient concrétiser. Avant de marteler vigoureusement en faveur de la guerre sainte, le bailli d'Auxerre donnera une dimension eschatologique (v. 1753-1796) à ses réflexions terrestres pacifiques susceptibles d'effrayer les esprits rebelles à la paix, en rappelant les commandements divins, qui apparaîtront ensuite comme la voie à emprunter pour résoudre les querelles intestines entre chrétiens. Il déclare d'ailleurs:
Se telz voulentez avions Paix certes tantost aurions, Et des biens faire pourrions. (v. 1774-1776)
Étant donné qu'il s'avance sur un terrain moins pragmatique, l'image de Dieu devient son recours; l'homme s'abrite derrière le masque du prophète puisqu'il a su déchiffrer les raisons du malheur terrestre. De plus, il semble jouer avec cet artifice prophétique, ajoutant:
Bien croy que, se parler vouloye, Trop plus avant dire pourroye Dont nous vient ceste maladie, Mais de bien peu m'avanceroye, Il n'est homme qui ne le voye, la n'est besoing que plus en dye. (v. 1817 -1822)
170 Memini. Travaux et documents
Quelques vers plus loin, il prendra l'Évangile de Matthieu (XVIII, 7) à témoin pour justifier ses invectives
Or escoutez l'auctorité Que l'Evangille nous enseigne Qui dist qu'il est necessité Aucunes fois qu'esclandre adviengne. Mais cil par qui fault qu'elle viengne Est mauldit de la dei té. Chascun la parolle retiengne Car cë est pure verité. (v. 1849-1856)
Ensuite, une succession de vers (v. 1994-2038), tous à l'indicatif imparfait, évoquent l'ensemble des bonheurs pacifiques types qui Rorissaient en temps de paix. La succession des plaisirs épouse l'échelle canonique des états de la société: les oratores, les bellatores et les laboratores rythment les délices pacifiques de leurs spécificités. Remarquons qu'à nouveau, la dernière catégorie sociale se scinde en deux réseaux d'activités: les marchands et les paysans. En effet, tandis que la paix enveloppait le royaume, le culte et la propagation de la culture étaient assurés par le clergé 22 ; les princes tenaient leurs cours en grand arroi: joutes, chants, danses et chasses occupaient leurs journées 23 ; les marchands vaquaient à leurs occupations mercantiles en toute quiétude 24, tandis que les laboureurs
22. «Quant en France paix aviez, / Clergié, moult aysë estiez, / Car parmy ses beaulx monstiers / Vous alliez, / Et disiez / Voz psaultiers, / Sagement vous conteniez. / Les prestres chantoient / Ou leur volenté faisoient, / Ceulx qui a l'escolle estoient / Apprenoient / Et lysoient / Ou preschoient ; / Les sciences que acqueriez / A grant honneur vous menoient. » (v. 1994-2008).
23. «Princes belle court tenoient / Ou toutes gens recevoient, / Les estranges festioient, / Ilz dansoient / Et chantoient, / Et rioient / Et souventes fois joustoient / Sur palefrois et destriers, / Et dessus ses grans coursiers / Faulcons avoient faulconniers, / Espreviers, / Et lamiers, / Et levriers, / Chiens courans et gros limiers, / Dont souvent deduit avoient / Chevaliers et escuyers. » (v. 2009-2024).
24. «Marchans, bien vous mainteniez, / Quant en paix vous conteniez, / Vous portiez / Voz deniers, / Et alliez / Seurement ou vous vouliez, / Toutes gens a vous venoient. » (v. 2025-2031).
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 171
entretenaient les terres et les bois 2s • Jean Regnier semble avoir préféré l'évocation d'un passé que l'usage de l'indicatif imparfait soulignerait comme tout à fait révolu, au rappel des malheurs de la guerre ressassés par trop de textes. Rappeler ce que l'on a perdu semble plus poignant que de longues tirades dramatiques sur un présent que l'on connaît trop bien ...
L'auteur avancera prudemment la solution qui autorisera, d'une part, d'effacer nos péchés, et, d'autre part, qui permettra d'introduire la paix entre les nations chrétiennes: la croisade contre les Boesmiens. Ainsi, l'appel à la Croisade intervient dans le Livre de Prison comme un juste exutoire aux tensions guerrières entre chrétiens (v. 2067-2086). En effet, la guerre contre les Boesmiens est qualifiée d'honnorable (v. 2079), de prouffitable (v. 2081) et de notable (v. 2084). Cependant, l'entreprise contre les Hussites n'apparaît pas comme une véritable croisade, sinon comme une entreprise punitive, une inquisition contre les hérétiques 26 étant donné qu'au sens strict, une croisade se définit comme l'entreprise de reconquête des lieux saints.
Cet appel final à la « croisade» ajuste le costume du prophète au profil du poète. Jean Regnier se complaît dans ce rôle prophétique incantatoire. Ainsi, le bailli d'Auxerre clôt son texte sur une strophe de seize vers octosyllabiques (v. 2107 -2122) construite autour de l'anaphore du verbe Prions: le prophète du temps présent invite ses semblables à prier Dieu et son Fils pour la rémission des péchés et l'envoi de la paix.
L'extrait du Livre de prison centré sur la paix offre un témoignage exemplaire de l'émergence de la conscience de l'écrivain au XVe siècle. D'ordinaire, les clercs rédigeaient leur
25. "Les laboureux labouroient, / Ilz couppoient / Et rompoient, / Acertoient / Les boys et les arrachoient, / Tant labouroient voulentiers / Certes, pas assez n'avoient. » (v. 2032-2038).
26. Sur ces événements, voir: J. MACEK, Histoire de la Bohême des origines à 1918, Paris, Fayard, 1984 ; plus précisément sur cette hérésie, cf. H. WEBER, Histoire des idées etdes combats d'idées aux XIV' etXV' siècles de Ramon Lull à Thomas More, Paris, Champion, 1997, p. 359-385.
172 Memini. Travaux et documents
pleCe imprécatoire contre la guerre et ses malheurs à l'état d'hommes libres, bien qu'ils se réfugiassent derrière des artifices rhétoriques pour se prémunir d'éventuelles représailles. Or, ici, Jean Regnier se plaint d'une situation guerrière, désastreuse pour lui-même et pour l'ensemble de la population, dans des conditions bien différentes de ses condisciples de plume: il est prisonnier de l'ennemi et il doit donc user de précaution oratoire pour que ses mots - par lesquels il aspire à la liberténe l'enferment pas davantage.
Ainsi, l'écrivain, fidèle serviteur du duc de Bourgogne, homme de guerre, n'est pas dans une situation idéale pour fustiger les malheurs du temps sous les traits des affres de la guerre ... d'autant plus qu'à ses yeux les causes du désarroi actuel trouvent leur origine à l'intérieur du royaume de France, non en Bourgogne. Afin de rendre sa critique moins acerbe et ses observations plus neutres, le prisonnier disserte sur le mode des reproches avec virtuosité, par exemple en alternant les pronoms personnels vous et nous, en se réfugiant derrière les allégories de Fortune, Guerre et Paix, ou encore en privilégiant l'explicitation « peccamineuse » des malheurs du temps. La parole de vérité est empêchée et doit se frayer un chemin dans les poncifs littéraires afin de préserver (réellement ici !) son auteur des incompréhensions et des représailles de son auditoire.
Dans ce texte, Jean Regnier alterne habilement les poncifs de la littérature pacifique, les voies eschatologiques (liées aux changements que l'on escompte, mais que l'on veut subordonner à la volonté divine) et l'interprétation lucide des événements. Cependant, l'Histoire vécue est déguisée sous des élans de croisade ou encadrée d'allégories abstraites, mais qui, par leurs pouvoirs référentiels, permettent d'exprimer le sens caché et la vérité des choses, alors que les voies traditionnelles du discours moral et allégorique tentent de dispenser une parole vraie, du moins protectrice. À nouveau la paix trouve sa voix et ouvre la voie à un avenir meilleur.
Jean Regnier: une vision carcérale de la paix. 173
Ainsi, la lecture attentive du Livre de Prison met en exergue combien Jean Regnier fait la leçon à la France et à ses princes de sang, afin qu'ils agissent avec responsabilité pour le bien commun, c'est-à-dire qu'ils boutent l'orgueil et les vices hors de leur cœur pour y installer la paix. Comme le soulignait Jacqueline Cerquiglini-Toulet, la prison devient, malgré elle, le lieu privilégié de la création littéraire, car « l'auteur se pose en tant qu'écrivain en évoquant la nécessité de la solitude pour créer ou en justifiant le fait qu'il écrit par sa solitude ,,27; l'enfermement du prisonnier « politique» génère l'écrit « citoyen" qui témoigne ainsi de cette prise de conscience de l'homme de lettres au XVe siècle.
27. J. CERQUIGLINI-TOULET, « L'étrangère », Revue des langues romanes, XCII,
2 : Christine de Pizan, (1998), p. 239-251.