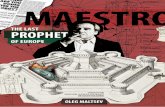Évangiles : de Jean à Marc »
Transcript of Évangiles : de Jean à Marc »
RB 120 (2013), p. 182-219.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC Par Étienne NODET
[email protected] École biblique, POB 19053, Jérusalem – IL
RÉSUMÉ
C’est par leur canonisation et/ou leur usage communautaire que les évangiles se sont stabilisés au IIe siècle, mais leur genèse, mal connue, est débattue depuis l’époque des Lumières, avec de notables implications théologiques. L’hypothèse présentée ici tient en deux points : d’abord, Jn reflète mieux les origines, surtout pour la chronologie, le rang divin de Jésus, et la Passion ; en-suite, pour les synoptiques, le modèle de Griesbach (Mc dépend de Mt et Lc) est le meilleur, car ses difficultés peuvent être levées par une approche liturgique. De plus, les écrits des témoins oculaires ont joué un rôle, car les textes ont eu une histoire complexe.
SUMMARY
The text of the Gospels has taken its final shape through a process of liturgi-cal use and/or canonization. However, this literary process is discussed since the Enlightenment period, with significant theological consequences. A two-fold hypothesis is presented here: first, John is a better witness of the origins, as far as the chronological system, the Passion narrative or the divine rank of Jesus are concerned. Second, for the Synoptics, the Griesbach theory (Mark depends on Matthew and Luke) should prevail, for the objections against it can be removed by a liturgical approach. Incidentally, the pieces written by the eyewitnesses have been instrumental, for the texts have had a rather complex history.
Introduction
La publication d’un volume à la mémoire de M. Hengel (1926-2009) est l’occasion d’une mise au point sur le témoignage des évangiles1. En effet, après les excès d’une critique historique récusant toute possibilité de retrouver le per-sonnage de Jésus, il fut de ceux qui jugèrent – non sans raison – que la théorie dite des « deux sources » n’était pas prouvée, et il réaffirma énergiquement que
1 Michael F. BIRD & Jason MASTON (eds.), Earliest Christian History : History, Litera-ture, and Theology. Essays from the Tyndale Fellowship in Honor of Martin Hengel (WUNT, 2.320), Tübingen, Mohr-Siebeck, 2012.
2 ÉTIENNE NODET
le second évangile reflétait bien l’enseignement de Pierre, combiné avec des souvenirs de témoins oculaires2.
Le problème n’est certainement pas simple. En effet, le mouvement qui s’est développé autour de Jésus était vaste, au point de faire craindre aux autorités juives une répression romaine3 (Jn 11,47), mais il n’était certainement pas très organisé : en dehors des Douze, il est question de soixante-douze (ou soixante-dix, Lc 10,1), sans parler de foules plus ou moins occasionnelles. Par la suite, le mouvement reste notable : quelque cent vingt lors du choix de Matthias (Ac 1,15) ; plus de cinq cents ont vu le ressuscité, y compris Jacques (1 Co 15,7). Il y a cependant des tensions : lors de l’arrivée de Paul à Jérusalem, l’entourage de Jacques lui oppose les « myriades de croyants » zélés pour la Loi, qui tiennent à la circoncision (Ac 21,20). Si l’on rapproche ces passages, on voit que la per-ception du ressuscité n’a pas le même sens pour Jacques et pour Paul. Davan-tage, Jacques représente la famille de Jésus, qui était opposée à sa mission (Mt 12,46-50 ; Mc 3,21). Plus généralement, que la postérité de Jésus ait été mul-tiple est discrètement évoqué par endroits : hors du cercle des disciples, d’autres font des exorcismes au nom de Jésus (Lc 9,49-50) ; Jésus lui-même annonce qu’il y a « d’autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos » (Jn 10,16) ; il rap-pelle qu’il y a « de nombreuses demeures dans la maison du Père » (Jn 14,2). Au plan des institutions, il est remarquable que pour remplacer Judas Pierre cherche quelqu’un qui soit témoin de tout « depuis le baptême de Jean » (Ac 1,22), ce qui suggère que parmi la nuée de disciples certains étaient étrangers à cette tradition. Jésus a commencé sa mission en entrant dans le baptême de Jean, d’où une séparation de sa famille nazoréenne, qui le lui a reproché. Il faut d’ailleurs noter que Jacques, le frère du Seigneur, reste étranger au baptême4 (cf. Ac 15,19-21).
L’étude qui suit se propose de reprendre l’examen des relations entre les évangiles à partir des résultats de travaux précédents.
1. Contrairement à ce suggère une interprétation abusive d’un passage de Jo-sèphe5, la Galilée rurale au temps de Jésus était d’un judaïsme intense, au moins autour du Lac, et non pas une entité indécise, artificiellement judaïsée par le roi Aristobule en -104 et ouverte aux nations ; c’était le haut lieu des pharisiens, avec de fortes attaches babyloniennes. C’est de là qu’après l’arrivée de Pompée (-63) a émergé le mouvement zélote, issu des pharisiens6. C’est là aussi que la tradition rabbinique reconnaît ses origines, avec le Babylonien Hillel sous Hé-
2 Martin HENGEL, « The Lukan Prologue and its Eyewitnesses : The Apostles, Peter, and
the Women », dans : M. F. BIRD & J. MASTON, Earliest Christian History, p. 533-587. 3 Telle est aussi la crainte des autorités juives dans la notice sur le « thaumaturge » de la
version slavone de la Guerre de Josèphe, cf. Henry LEEMING & Kate LEEMING, avec Lyubov V. OSINKINA, Josephus’ Jewish War and Its Slavonic Version. A synoptic Comparison (AGAJU, 46), Leiden-Boston, Brill, 2003, p. 261-262 (G 2:174) ; RB 111 (2004), p. 262-277.
4 Cf. Étienne NODET, « Jacques le Juste et son Épître », RB 116 (2009), p. 415-439 & 572-597.
5 AJ 13:319, cf. SCHÜRER-VERMES 1:141 & 562; 2:8-9. 6 Cf. Étienne NODET, « Jewish Galilee », dans : Tom HOLMÉN & Stanley E. PORTER
(eds.), Handbook for the Study of the Historical Jesus, Leiden, Brill, 2010, p. 627-650.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 3
rode et son ultime disciple Yohanan b. Zakkaï, autour de la guerre de 70. 2. On a longtemps cru que cette tradition, qui établit une séparation nette
entre le ciel et la terre, représentait adéquatement le judaïsme au temps de Jésus. En particulier, le rang divin de Jésus devait nécessairement être un développe-ment secondaire d’origine grecque. C’est très inexact : comme d’autres, Jésus, être exceptionnel, pouvait être crédité d’un rang divin, et les premiers chrétiens ont dû insister sur son humanité pour souligner le réalisme de la Passion7. Paul tient à rappeler qu’il est « né d’une femme » (Ga 4,4), et ce n’est nullement une simple banalité.
3. Pour les récits de la dernière Cène et de la Passion, la version de Jn doit être préférée, pour des raisons de calendrier et de cohérence des détails liés au judaïsme, alors que les synoptiques en ont fait une sorte de Pâque christianisée du soir au soir, commençant par un rite de mémorial et culminant sur la croix8.
4. Dans ses prologues à Théophile, le rédacteur ultime de Lc-Ac commence par établir sa compétence (Lc), alors qu’il se sait éloigné des témoins oculaires ; puis (Ac) il souligne avec précision l’enchaînement de la vie de Jésus et les dé-buts de l’Église, en y raccrochant des épisodes dispersés, voire diverses ten-dances, le tout culminant avec les activités de Paul9. De fait, il y a un écart entre le kérygme selon les Écritures, qui est une affirmation sur Jésus, et l’enseignement de celui-ci : même Pierre n’y fait aucune allusion dans ses dis-cours.
La preuve, ou au moins l’indice que l’ensemble du NT suit la perspective du kérygme, est que si l’on en supprime par la pensée tout ce qui a trait à la Passion et à ce qui y conduit, il ne reste que des fragments de la vie de Jésus (miracles, enseignement) ainsi que l’épître de Jacques ; corrélativement, il n’y a plus d’allusion à une mission universelle. Autrement dit, les évangiles tels qu’ils nous sont parvenus sont marqués d’une perspective chrétienne, au sens de Paul : l’enseignement de Jésus ne vient pas en premier10, et c’est bien ce qu’on re-trouve dans la fameuse notice de Josèphe sur Jésus, qui est la trace d’une con-fession de foi des chrétiens de Rome (AJ 18:63-64) ; le Credo ultérieur a la même perspective. Les évangiles dits apocryphes sont très différents.
L’étude proposée ici reprend des dossiers ouverts depuis longtemps : les té-moignages anciens sur l’existence ou la formation des évangiles synoptiques ; les relations entre Mc et Pierre ; les discussions modernes depuis la recherche d’un « évangile primitif » au XVIIIe siècle. Enfin, c’est par le biais de la liturgie que la singularité de Mc sera appréciée.
7 Cf. Étienne NODET, Le Fils de Dieu, Paris, Éd. du Cerf, 2002, p. 147-230. 8 Cf. Étienne NODET, « Chronologies de la Passion. Leur sens », RB 118 (2011), p. 362-
407. 9 Cf. Étienne NODET, « Théophile », RB 119 (2012), p. 585-595. 10 Contrairement à la conclusion de Adolf von HARNACK, Das Wesen des Christentums,
Berlin, 1902, p. 194, qui jugeait que Paul avait compliqué inutilement le christianisme pur de Jésus. Ce même thème est repris dans plusieurs chapitres (« The Jesus of History and the History of Dogma », « Making difference ») de John S. KLOPPENBORG VERBIN, Excavating Q. The History and Settings of the Sayings Gospel, Edinburgh, T&T Clark, 2000.
4 ÉTIENNE NODET
I – Témoignages anciens sur les évangiles
Les témoignages anciens sur la formation du NT sont peu nombreux, et sou-vent malaisés à réconcilier11. Les plus anciennes listes de livres du NT sont données par le « canon » de Muratori et par Irénée de Lyon (vers 170-180). Pour le premier, l’unique manuscrit connu est fragmentaire : le texte conservé commence par « auquel cependant il assistait, et il l’a mis. Le troisième évan-gile est selon Luc […] Paul l’avait pris auprès de lui […] Le quatrième est de Jean, un des disciples ». La formulation laisse entendre que le second était bien de Marc, supposé témoin au moins partiel, mais non disciple12 ; ce document atteste donc l’ordre canonique actuel. Irénée déclare que Matthieu écrivit en hébreu pendant que Pierre et Paul fondaient l’église de Rome, et qu’après leur « départ » Marc et Luc consignèrent leurs évangiles respectifs par écrit, et enfin Jean composa son évangile à Éphèse (Adv. haer. 3.1) ; apparemment, Irénée désire cautionner l’autorité de Mt grec en lui supposant un original hébreu (ou araméen). Plus loin, face à une multiplicité menaçante13, il explique l’importance du chiffre très symbolique de quatre évangiles : Jean, qui rapporte la filiation divine de Jésus ; Luc, qui lui donne un caractère sacerdotal avec Za-charie ; Matthieu, qui en commençant par sa généalogie en fait un homme ; Marc, qui commence par le don de l’Esprit, et qui s’en tient à une concision de style prophétique (3.11.8).
Vers 150 Justin cite volontiers des « mémoires des apôtres », parfois appelés évangiles, mais il ne les qualifie pas d’Écriture ; il s’intéresse peu à l’enseigne-ment de Jésus, car son principal souci est de montrer l’accomplissement des prophéties. Apparemment, il utilise une harmonie évangélique grecque qui est une sorte de précurseur du Diatessaron de Tatien, fondé sur des états archaïques des évangiles14. Deux détails relatifs à Mc doivent être notés : d’une part, il mentionne le surnom Boanergès des fils de Zébédée, propre à Mc 3,17 et pré-cise que son information provient des « mémoires » de Pierre (Dialogue, § 106). D’autre part (Apologie I:2.39.46), il fait des allusions manifestes à la finale Mc 16,9-20, qui vient après une phrase interrompue (v. 8), mais l’on reconnaît ai-sément qu’elle n’est pas de la même main que le reste de l’évangile : elle est une sorte de brève harmonie des finales de Mt, Lc et Jn, avec même peut-être des allusions à He. Or, elle figure dans le Diatessaron de Tatien et dans
11 James R. EDWARDS, The Hebrew Gospel and the Development of the Synoptic Tradi-tion, Grand Rapids – Cambridge, Eerdmans, 2009, fournit des renseignements plus complets.
12 Cf. Bruce M. METZGER, The Canon of the New Testament : Its Origin, Development and Significance, London, Clarendon, 1987, p. 8-15.
13 À côté des apocryphes (lit. « à cacher »), il s’est développé une catégorie de « livres à lire » (hors liturgie), cf. François BOVON, « Beyond the Canonical and the Apocryphal Books, the Presence of a Third Category: The Books Useful for the Soul », HTR 105 (2012), p. 125-137.
14 M.-Émile BOISMARD, avec la collaboration d’Arnaud LAMOUILLE, Le Diatessaron : de Tatien à Justin, (ÉB, N. S. 15), Paris, Gabalda, 1992, p. 78-82 ; en fait, il s’agit apparemment d’une harmonie légèrement différente.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 5
l’ancienne version latine, et Jérôme l’a conservée dans la Vulgate15. Il y a lieu de conclure qu’une certaine forme de cette finale figurait dans l’harmonie utili-sée par Justin, et qu’ensuite elle a été progressivement intégrée à Mc, d’où les hésitations des manuscrits grecs. Irénée (Adv. haereses 3.10.6) cite le v. 19 comme étant la fin de Mc16. Tout cela indique qu’au IIe siècle il convient d’éviter de mettre une cloison étanche entre critique littéraire et critique pro-prement textuelle ; de plus, les versions anciennes faites dès cette époque ainsi que les témoignages latéraux ne peuvent être sous-estimés17.
Le vaste mouvement issu de Marcion (env. 85-160) a peut-être contribué à la stabilisation du NT, mais il n’est connu qu’indirectement, par des opposants. Comme évangile, on ne lui connaît qu’une forme courte de Lc, critiquée en dé-tail par Tertullien. Celui-ci jugeait que Marcion avait supprimé ce qui ne lui convenait pas, en particulier l’accomplissement des Écritures. Cette vue tradi-tionnelle, maintenue par Épiphane, a été reprise par Harnack18. Cependant, on a observé depuis que cet évangile supposé sectaire n’a ni addition ni remaniement significatif, et il est possible qu’il ne soit que la trace d’un état ancien de l’évangile canonique19.
Avant Marcion, Polycarpe de Smyrne, vers 110, écrivit une Lettre aux Phi-lippiens (LP), où l’on trouve des allusions claires aux paroles de Jésus, mais aucune source n’est indiquée. LP 2.3 cite expressément l’enseignement du Sei-gneur : « Ne jugez pas, pour n’être pas jugés ; pardonnez et vous serez pardon-nés ; soyez miséricordieux et vous recevrez miséricorde ; de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous. » C’est une amplification de Mt 7,1-2, mais différente de la formulation de Lc 6, 37-38. Pourtant, aussitôt après, LP cite encore : « Bienheureux les pauvres et ceux qui sont persécutés pour la jus-tice, car le Royaume des cieux est à eux. » C’est l’addition de la première béati-tude selon la formulation de Lc 6,20 et de la dernière selon Mt 5,10 ; en fait, on peut admettre qu’il s’agit d’un raccourci de l’ensemble Mt 5,3-10, car la men-tion du Royaume figure aux deux bouts. Plus loin, LP 5.2 donne aux diacres (dia&konoi) des recommandations inspirées de 1 Tm 3,8 et il conclut : « …marchant selon la vérité du Seigneur, qui était le “servant” (dia&konoj) de tous. » Le mot « diacre » a appelé une réminiscence d’un thème diffus dans les évangiles, peut être Mt 23,11. LP 7.2 offre une double citation, combinant Mt 6,13 et 26,41b : « Ne nous fais pas entrer en tentation, comme a dit le Seigneur :
15 EUSÈBE, Quaest. ad Marinum, § 1, indique qu’elle est absente de nombreux manuscrits grecs, cf. Theodor ZAHN, Grundriss der Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Leipzig, 21904, II:553-554.
16 Il y eut d’autres variantes et remaniements, cf. éditions critiques du NT. 17 Cf. M.-Émile BOISMARD, « Critique textuelle et citations patristiques », RB 57 (1950),
p. 383-408. 18 Cf. Adolf VON HARNACK, Marcion : Das Evangelium vom fremden Gott (Texte und Un-
tersuchungen, 45), Leipzig, Hinrich, 1921, p. 208*-213*. Il s’est efforcé de restituer un origi-nal marcionite en grec à partir des citations en latin de Tertullien.
19 Cf. Matthias KLINGHARDT, « “Gesetz” bei Markion und Lukas », dans : Dieter SÄNGER & Matthias KONRADT (eds.), Das Gesetz im frühen Judentum und im Neuen Testament. Festschrift für Christoph Burchard (NTOA, 57), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, p. 99-128.
6 ÉTIENNE NODET
L’esprit est ardent, mais la chair est faible. » Le rapprochement est d’ailleurs suggéré par Mt 26,41a « Priez pour ne pas entrer en tentation ». LP 12.3 donne une instruction : « Priez aussi pour les rois, les puissants, les princes, pour ceux qui vous persécutent et vous haïssent, et pour les ennemis de la croix. » Poly-carpe connaît bien les lettres de Paul ; ici, il s’inspire de 1 Tm 2,1 qui recom-mande de prier pour tous, « pour les rois et tous ceux qui sont en charge » ; il développe en incluant au passage un écho de Mt 5,44 : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La doctrine de Polycarpe est centrée sur le kérygme accomplissant les Écritures, surtout d’après Paul, mais comme pas-teur il suit l’enseignement de Jésus tel qu’on le retrouve dans le Sermon sur la montagne de Mt. On peut soupçonner qu’il disposait d’un recueil écrit de « mémoires des apôtres », mais il est difficile de savoir comment il était dispo-sé, car les réminiscences scripturaires lui viennent spontanément à tout propos.
Vers la même époque, Ignace d’Antioche qualifie d’évangile son credo, le-quel inclut la naissance d’une vierge, le baptême de Jésus et se prolonge jusqu’à l’ascension20. Il n’y a pas d’indice clair qu’il utilisait un évangile écrit. Quelques rapprochements avec des paroles de Jésus ont cependant été identi-fiés, mais ils ne permettent pas de conclusion nette : Ad Polyc. 2.2 « sois rusé comme un serpent en tout et toujours candide comme une colombe » est sem-blable à Mt 10,16, mais dans un contexte différent ; Ad Eph. 14.2 « l’arbre (est) révélé (fanero&n) d’après son fruit » rappelle Mt 12,33 ; Ad Smyrn. 6.1 « celui qui peut accepter, qu’il accepte ! », analogue à Mt 19,12, mais dans un contexte très différent ; Ad Smyrn. 3.2 « Prenez (la&bete), touchez-moi et voyez que je ne suis pas un démon sans corps », qui évoque en raccourci Lc 24,39. Seul ce dernier cas a une portée théologique en rapport avec le Credo d’Ignace.
Un peu auparavant, vers 95, Clément de Rome a adressé une lettre d’exhortation aux Corinthiens. Il a connu Paul (cf. Ph 4,3) et le cite expressé-ment (47,1) ; il rappelle aussi des enseignements de Jésus supposés connus, mais sans indication de source21. Voici un exemple (13,2) : « Soyez miséricor-dieux, pour obtenir miséricorde ; pardonnez, pour qu’on vous pardonne ; comme vous faites (à autrui), ainsi on vous fera ; comme vous donnez, ainsi on vous donnera ; comme vous jugez, ainsi vous serez jugés ; soyez serviables (xrhsteu&esqe, cf. 1 Co 13,4), et on sera serviable envers vous ; de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. » C’est une expansion libre du même passage que ci-dessus (LP 2,3).
Il y a donc eu des recueils écrits de l’enseignement de Jésus bien avant la formation des évangiles, ou du moins avant leur attribution à des rédacteurs dé-finis ; les allusions les plus précises se rattachent à Mt. Le prologue de Lc 1,1-4 affirme qu’il existait de tels écrits, proches des témoins oculaires ; le cas d’Apollos d’Alexandrie, qui « enseignait avec exactitude ce qui concerne Jé-sus » (Ac 18,25), montre une diffusion ancienne, mais sans indication d’auteur ou de rédacteur. Dans des circonstances qu’on ignore, mais sans doute à cause
20 Ad Philad. 5.1, 8.2, 9.2 ; Ad Smyrn. 5.1, 7.2. 21 Cf. Bruce M. METZGER, The Canon of the New Testament : Its Origin, Development and
Significance, London, Clarendon Press, 1987, p. 42-43.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 7
d’une multiplicité de livres plus ou moins contradictoires, on s’est posé le pro-blème de l’autorité de ces écrits, c’est-à-dire d’un rattachement clair à la pre-mière génération. Un cas d’école est fourni par l’épître de Jacques. Le premier à la mentionner est Origène (Comm. in Joh. 19.6), au IIIe siècle ; Eusèbe (HE 2.23.24-25) et à sa suite Jérôme (De viris illust. § 2) signalent des doutes tradi-tionnels sur son authenticité, puisqu’elle paraît inconnue avant Origène, mais l’un et l’autre reconnaissaient son autorité, puisqu’elle était lue publiquement dans toutes les Églises22 ; il n’y a jamais eu de discussion ancienne sur son con-tenu. Au contraire, l’épître de Clément, avec tous ses mérites, n’était pas lue dans toutes les Églises (HE 3.16), malgré sa proximité de Paul, et elle n’est pas entrée dans le canon.
Le même Eusèbe a pris soin de rassembler des éléments sur l’origine ou l’authenticité des évangiles, puisque Marc et Luc n’étaient pas des disciples di-rects. Il mentionne Papias, évêque de Hiérapolis ; celui-ci était un « auditeur de Jean » selon Irénée, et il était mort vers 130 ; il avait écrit un commentaire en cinq livres sur les logia de Jésus. L’ouvrage est perdu, mais Eusèbe en cite la préface (HE 3.39.3-4), où l’auteur indique qu’il a recherché le témoignage des « anciens » (ou « prêtres ») sur André, Pierre, Philippe, Thomas, Jacques, Jean, Matthieu, ou « n’importe quel autre disciple du Seigneur » ; il ajoute séparé-ment les noms d’Ariston et de Jean l’Ancien, « disciples du Seigneur ». Il pré-cise, ce qu’Eusèbe lui reproche, que l’écho de telles voix vivantes lui a été plus utile que les livres ; il atteste ainsi l’existence de recueils écrits. Bien entendu, il s’agit non pas de témoignages neutres, au sens juridique, mais de participation engagée23 ; il n’est pas question de Pilate ou des fastes romains. De plus, la no-tion de « disciple » est étendue au-delà des Douze, mais il est notable que l’enquête auprès des anciens n’a porté ni sur Jacques, pourtant une « colonne » (Ga 2,9), ni sur Paul et ses révélations.
Un peu plus loin, Eusèbe cite à nouveau Papias (HE 3.39.15), qui rapporte une tradition de l’Ancien (Jean) : « Marc, ayant été l’interprète (e9rmhneuth&j) de Pierre, mit par écrit tout ce qu’il put se rappeler (des paroles de Pierre) sur ce que le Seigneur avait dit ou fait, quoique dans un ordre incorrect… Il avait suivi Pierre, qui donnait son enseignement en se référant aux besoins, mais sans se préoccuper de mettre en bon ordre les logia du Seigneur. » Cette déclaration implique quelques conséquences : d’abord Pierre, attaché à l’enseignement oral, n’avait nullement envisagé la composition d’un évangile suivi, et l’initiative de Marc est plutôt à situer après sa mort24. Il est possible que ce Marc ne soit autre que celui que Pierre désigne comme « mon fils » (1 P 5,13) ; en tout cas, la
22 Cf. après d’autres Ralph P. MARTIN, James (Word Biblical Commentary, 48), Waco, Word Books, 1988, p. LXIX-LXXVII, avec bibliographie.
23 Cf. Samuel BYRSKOG, Story as History – History as Story. The Gospel Tradition in the Context of Ancient Oral History (WUNT, 123), Tübingen, Mohr-Siebeck, 2000, p. 154-167 ; ID. « Memory and identity in the Gospels : A New Perspective », dans : Bengt HOLMBERG (ed.), Exploring Early Christian Identity, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2008, p. 33-57.
24 Richard BAUCKHAM, Jesus and the Eyewitnesses : The Gospels As Eyewitness Testimo-ny, Grand Rapids, William B. Eerdmans, 2006, p. 205-209, juge après d’autres que Marc était traducteur des dires de Pierre, quand celui-ci voulut écrire.
8 ÉTIENNE NODET
lettre de Pierre n’offre aucun contact avec Mc. Ensuite, Papias indique une tradition « à propos de Matthieu », en soulignant
un contraste sur l’ordre de la matière : celui-ci aurait recueilli et mis en ordre les logia de Jésus en langue hébraïque, mais « chacun » les interpréta comme il le put25 (HE 3.39.16). Cette déclaration énigmatique sur un recueil perdu suggère qu’il fut composé par l’apôtre Matthieu après le travail de Marc, voire qu’il l’aurait supplanté. Eusèbe a déjà indiqué auparavant que Matthieu avait écrit en hébreu par nécessité, pour suppléer à son absence lorsqu’il dut partir évangéli-ser ailleurs (HE 3.24.6). En tout cas, selon ce témoignage, Marc n’aurait pas vu les logia de Mathieu.
Eusèbe rapporte aussi les dires de Clément d’Alexandrie (150-215 env.) sous deux formes : selon HE 2.15.1-2, les auditeurs de Pierre obligèrent Marc à écrire son enseignement ; Pierre l’apprit et en fut satisfait, cautionnant l’usage de cet évangile dans les Églises. Eusèbe juge qu’ainsi Clément confirme Papias, mais plus loin (6.14.5), il cite autrement le même ouvrage de Clément : celui-ci affirme tenir des Anciens que les évangiles avec généalogie (Mt et Lc) furent écrits avant ceux qui n’en ont pas (Mc et Jn), et que Marc écrivit à la demande des disciples de Pierre et diffusa son évangile ; Pierre le sut et ne dit rien26. Quant à Jean, Clément rapporte qu’il fut lui aussi pressé par ses disciples, mais sachant que les principaux faits avaient déjà été rapportés par les trois autres, il composa un évangile spirituel.
Sur ce dernier point, Eusèbe rapporte une tradition divergente (HE 3.24.7-16) : Jean aurait écrit après les trois autres par nécessité, car il les aurait jugés incomplets, ne relatant que les faits postérieurs à la mort de Jean le Baptiste, avec une seule montée à Jérusalem ; il aurait donc dû compléter les deux années manquantes.
En fait, si l’on compare Papias et Clément à propos de Marc, on voit que l’un affirme que l’évangile fut rédigé après la mort de Pierre, alors que pour l’autre ce fut avant. Cependant, l’indifférence de Pierre dans ce dernier cas est suspecte, et l’on peut suggérer que ce n’est qu’une façon d’affirmer l’ancienneté et l’autorité de Mc, que Pierre lui-même aurait vu. Cette conclusion recoupe une indication figurant dans le prologue antimarcionite de la Vieille Latine de Mc, qu’on date vers 160-18027 : « Après la mort de Pierre, (Marc) transcrivit (des-
25 Josef KÜRZINGER, « Papias von Hierapolis : Zu Titel und Art seines Werkes », Biblische Zeitschrift 23 (1979), p. 172-186, a proposé une interprétation particulière : « en langue hé-braïque » peut signifier « à la manière hébraïque », si bien que Marc et Matthieu firent l’un et l’autre aussi bien qu’ils purent.
26 Dans une lettre peut-être apocryphe, Clément indique que Marc, ayant recueilli les notes de Pierre à Rome, aurait finalement composé en Égypte un évangile secret réservé aux initiés, cf. Morton SMITH, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1973 ; Jean-Daniel KAESTLI, « L’Évangile secret de Marc. Une version longue de l’Évangile de Marc réservée aux chrétiens avancés dans l’Église d’Alexan-drie ? », dans : Jean-Daniel KAESTLI et Daniel MARGUERAT, Le Mystère apocryphe, Genève, Labor et Fides, 1995, p. 85-106.
27 Adolf VON HARNACK, « Die älteste Evangelien-Prologue und die Bildung des Neuen Testaments », dans : Kleine Schriften zur alten Kirche, Leipzig, 1930, II:803-822 ; Donatien DE BRUYNE, « Les plus anciens prologues latins des évangiles », Rev. bénédict. 40 (1928), p.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 9
cripsit) cet évangile en divers lieux d’Italie. » Il faut probablement comprendre qu’il fit copier le livre en divers endroits, ce qui se rapproche du témoignage de Clément.
En résumé, Eusèbe est précieux pour avoir accumulé diverses traditions sans chercher à les unifier. Il en ressort que le seul évangile qui soulève des discus-sions plutôt confuses est le second : Matthieu et Jean étaient des disciples, et selon HE 3.4.8, l’évangile de Luc est celui auquel fait allusion Paul quand il dit « mon évangile » (Rm 2,16 ; 2 Tm 2,8). Cette identification était d’ailleurs tra-ditionnelle : Origène (cité en HE 3.6.25) comprend 2 Co 8,18 (« le frère dont toutes les Églises font l’éloge au sujet de l’Évangile ») comme désignant Luc et son évangile.
II – Marc et Pierre
Selon Ga 2,7 Pierre avait été envoyé évangéliser la « circoncision », ce qu’il faut comprendre géographiquement, c’est-à-dire dans les pays de tradition sémi-tique, puisqu’on le retrouve à Antioche (2,11). Pourtant, lors de l’assemblée de Jérusalem, Pierre déclare (Ac 15,7) : « Depuis les jours anciens Dieu m’a choisi pour que de ma bouche les nations entendent la parole de l’évangile. » C’est au moins une allusion à l’épisode Corneille, où Pierre a pris le risque d’entrer chez des incirconcis. Il y tient un discours résumant son témoignage : Jésus en Gali-lée après le baptême de Jean, guérisons multiples, crucifixion et résurrection le troisième jour, envoi en mission auprès d’Israël pour la rémission des péchés, selon la parole des prophètes (Ac 10,37-43). Cela correspond à sa prédication antérieure (2,36 ; 4,10-12 ; 5,31), et lui-même opérait des guérisons (3,6 ; 5,15). Ses dires paraissent peu différents du kérygme paulinien, mais il y a une diffé-rence majeure : Jésus est strictement le Messie d’Israël. Chez Corneille, la sur-prise des circoncis est que les auditeurs de Pierre reçoivent alors l’Esprit Saint ; ils sont alors admis au baptême. Il y a donc une évolution de Pierre, qui n’a fait aucune allusion à un envoi par Jésus auprès des nations.
Face à cela, le deuxième évangile est déroutant, si on le rattache à Pierre. (L’absence de la parole de Jésus sur la primauté de Pierre n’est pas une difficul-té à cet égard.) Dans la finale composite, l’envoi en mission est sobre (Mc 16,15-16) : « Proclamez l’évangile à toute la création ; celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Il n’y a pas d’accomplissement de l’Écriture, ou de ké-rygme proprement dit. Au contraire, selon Mc 1,4 Jean le Baptiste prêche un baptême de conversion pour le pardon des péchés, gouverné par une annonce prophétique ; ensuite, la mission de Jésus commence en Galilée, où il proclame (Mc 1,15) : « Le Royaume de Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez à l’Évangile. » L’urgence est rappelée plus loin (9,1), mais, si l’Évangile est l’enseignement de Jésus en Galilée, on en apprend peu de choses, surtout en comparant avec les autres évangiles : le sabbat, les questions de pureté et le sens des traditions orales sont relativisés au maximum, ce qui d’ailleurs ne peut con- 193-214.
10 ÉTIENNE NODET
cerner que des Juifs ; la prohibition du divorce (Mc 10,1-12) mêle un débat sur le sens de Dt 24,1 (sur le divorce) avec un élément de droit romain. Le double commandement de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain vient directement de la Loi (Mc 12,28-34) et n’innove en rien : les deux sont associés dans la Di-dachè 1.2 et dans la proclamation de Jean le Baptiste selon Josèphe (AJ 18:115).
Cependant, le terme « Évangile » apparaît dans d’autres contextes, quoique sans beaucoup plus de précision : dans son discours eschatologique, Jésus dé-clare que la fin n’arrivera pas avant que « l’Évangile soit proclamé à toutes les nations » (Mc 13,10) ; là et ailleurs (8,35), il est question de persécutions, et l’imminence de la fin n’est plus perceptible. En tout cas, le fait qu’il y ait très peu d’enseignements de Jésus suffirait à expliquer que les écrivains anciens ne l’aient pas cité, sinon dans des listes de livres autorisés ; les seules traces de Mc clairement identifiables figurent dans l’harmonie évangélique utilisée par Justin.
Augustin n’ignorait pas les liens traditionnels Marc-Pierre et Luc-Paul, mais il était confronté à des détracteurs qui critiquaient la véracité des évangiles, à cause de leurs contradictions. Il explique que l’harmonie entre les quatre évan-giles provient, par-delà leurs divergences, de leur symbolique convergente (De consensu evangel. 1.6.9) : Jn, Mt, Lc et Mc, représentés par l’aigle, le lion, le veau et l’homme (cf. Ap 4,7), expriment respectivement la nature du Christ comme divine, royale, sacerdotale et humaine. Quant aux relations entre les évangiles, il fut apparemment le premier à dire que Mc était un résumé de Mt28. C’était en effet sa première impression (1.2.3). En fait, il utilisait un arrange-ment synoptique en « canons », où les sections parallèles des synoptiques sont disposées selon l’ordre de Mt. Avec une telle méthode, qui néglige l’ordre propre de chaque évangile, la conclusion que Mc résume Mt, supposé premier, est presque inévitable. Plus généralement, Augustin affirmait que l’ordre cano-nique reflétait l’ordre chronologique de composition, chaque évangéliste ayant connu ses prédécesseurs. Concernant Mc, ses arguments sont simples : il n’a aucun contact avec Jn contre les deux autres ; il ne dit presque rien en propre, et a peu en commun avec Lc contre les autres, mais il a beaucoup en commun avec Mt. Il faut noter que ce dernier argument est gauchi par rapport aux autres, puisqu’il n’est rien dit des divergences entre Mt et Mc ; cela lui permet de justi-fier brillamment l’ordre traditionnel, sans remettre en cause l’identité des évan-gélistes, puisque ainsi Marc et Luc se trouvent en aval de l’apôtre Matthieu, voire de son évangile hébreu. En finale cependant (4.10.11), Augustin revient sur ce qu’il avait d’abord dit, et se voit plutôt porté à conclure que Marc a unifié Mt et Lc29. S’il en est ainsi, il en résulterait logiquement que Mc soit postérieur aux deux autres, ce qu’Augustin s’abstient de dire, car cela bouleverserait
28 IRÉNÉE, Adv. Haer. 3.11.8, après avoir parlé de Matthieu, l’apôtre évangéliste, a une tournure qui peut avoir influencé Augustin : propter hoc (« à cause de cela ») et compendio-sam et praecurrentem adnuntiationem (Marcus) fecit ; il y a une causalité suggérée, et l’on peut en conclure que Marc, qui n’est pas un apôtre, a résumé Mt.
29 On suit les analyses et les conclusions de David B. PEABODY, « Augustine and the Au-gustinian Hypothesis : A Reexamination of Augustine’s Thought in De consensu evangelis-tarum », dans : William R. FARMER (ed.), New Synoptic Studies : The Cambridge Gospel Conference and Beyond, Macon (GA), Mercer University Press, 1983, p. 37-64.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 11
l’ordre traditionnel30.
III – Le second évangile
Il est maintenant nécessaire d’examiner certaines particularités de Mc actuel. La minceur de l’enseignement de Jésus a déjà été évoquée, mais deux autres points méritent examen : les caractéristiques de son style ; le thème du « secret messianique », très accentué par comparaison avec les autres synoptiques.
Le style de Mc est simple, peut-être à rapprocher du sermo humilis recom-mandé par Augustin, qui disserte longuement de rhétorique chrétienne (Doctr. Christ. 4.18.37). Il comporte de nombreux latinismes, ignorés des parallèles sy-noptiques : une dizaine de substantifs, liés à des réalités romaines, et des locu-tions verbales transposées du latin. Un cas est remarquable : dans le passage sur l’obole de la veuve, ses « deux piécettes » (lepta_ du&o) sont interprétées o# e0stin kodra&nthj « ce qui est un quadrans » (Mc 12,42) ; le terme latin trans-crit signifie « un quart d’as », la plus petite monnaie romaine. Cela suggère une rédaction finale à Rome, ce que laissaient entendre les témoignages anciens.
Cependant, il a aussi des aramaïsmes, en particulier dans des péricopes sans parallèle synoptique, mais il sont toujours suivis d’une traduction : Mc 5,41 (taliqa koum, puis « ce qui se traduit : Jeune fille, je te le dis, lève-toi ») ; 7,34 (effaqa, puis « qui est : Ouvre-toi »). Il y a donc en arrière-plan l’un des récits composés d’après les témoins oculaires mentionnés en Lc 1,1-2, mais plusieurs indices suggèrent que ces traces d’araméen sont résiduelles, résultant d’un abandon progressif31 : contrairement à Jn 1,41 et 4,25, Mc n’emplois pas Mes-
30 Cet ordre, donné par la plupart des mss grecs et par Jérôme, n’est pas celui de la Vetus latina, à laquelle tenait Augustin : mettant les apôtres en tête, elle avait l’ordre Mt, Jn, Lc, Mc, qu’on retrouve aussi dans le codex Bezae (D, grec et latin).
31 Depuis Bultmann, il a été suggéré que le rappel de locutions araméennes de Jésus, sur-tout pour les guérisons, avait une nuance magique ; ce ne peut être le cas, car les mots sont simples, et soigneusement démonétisés par les traductions, alors que la magie suppose des paroles mystérieuses, cf. Hans Josef KLAUCK, Magic and Paganism in Early Christianity. The World of the Acts of the Apostles, Edinburgh, T&T Clark , 2000. L’étude positiviste de Gerd LÜDEMANN, The Resurrection of Jesus, Minneapolis, Fortress Press, 1994 (résumé : What Really Happened to Jesus, London, SCM Press, 1995), ne peut qu’aboutir à un scepti-cisme informe, puisqu’il se concentre sur l’exactitude matérielle du tombeau vide, sans s’interroger sur la culture juive et la puissance du nom. Selon Ac 2,38 le baptême nouveau est donné « au nom de Jésus-Christ », puis ce nom a un pouvoir (Ac 3,6), issu d’une réalité vi-vante ; en 1 Co 1,13-15 Paul demande aux Corinthiens en ébullition au nom de qui ils ont été baptisés. Bien d’autres passages du NT soulignent l’importance du nom de Jésus, qui ne sau-rait être surestimée, puisqu’il se superpose à l’invocation « Seigneur » ; par contraste, après l’exécution de Jean Baptiste, ses disciples se contentent de l’enterrer (Mc 6,29). ORIGÈNE, Adv. Cels., 1:46.67, 7:4, affirme que les chrétiens peuvent guérir divers troubles par le nom de Jésus « et par certaines autres paroles ». Les accusations de magie n’étaient pas rares, cf. Stephen BENKO, « Early Christian Magic Practices », dans : SBL Seminar Papers 1982, Chi-co, Scholars Press, 1982, p. 9-14. Plus généralement, la connaissance du nom propre d’un être céleste est toujours liée à la pratique d’invocations licites, ce qui suppose tout un con-texte culturel, cf. Elias J. BICKERMAN, « Anomymous Gods », dans : Studies in Jewish and
12 ÉTIENNE NODET
si/aj mais toujours Xristo&j. Le verset araméen cité par Jésus en croix (Ps 22,2) a une forme anormale en Mc 15,34 elwi elwi lema sabaxqani, car el-wi est une restitution fautive d’après un hébreu supposé yhaOl)v « mon Dieu » ; l’on ne voit pas comment les assistants auraient pu comprendre « Élie » ( 0Hli/aj), alors que dans le parallèle de Mt 27,46 le lien est clair, car l’invocation yli)' yli)' (identique en hébreu et araméen) est exactement transcrite Hli Hli32. Autrement dit, Mc a perdu de vue l’exactitude de l’original.
Un autre cas montre une décroissance de l’araméen à travers une évolution des textes canoniques. Lors de l’épisode de l’obole de la veuve, Jésus voit ceux qui jetaient de l’argent ei0j to_ gazofula&kion « dans le trésor » (Mc 12,41 ; Lc 21,1), mais Éphiphane cite ce passage (Panarion 66.81) en mettant ei0j to_n korbwna~n, transcription de l’araméen )nbrq, désignant ce qui est consacré (cf. Mt 27,6 ; Lv 1,2 etc.), ce qui trahit une forme plus archaïque du passage, anté-rieure à l’abandon du terme araméen33 ; de même, Mc 7,11 a korba~n, puis ex-plique « ce qui est don », alors que le parallèle Mt 15,5 a simplement « don » (dw~ron). Un autre fait peut se rattacher aux aramaïsmes disparus : la péricope sur le double commandement (Mc 12,29-34) est plus longue que les parallèles de Mt et Lc, et la parole de Jésus sur l’amour de Dieu est précédée de « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur », où l’on reconnaît le début du Shema‘ Israël (Dt 6,1-2), proclamé matin et soir (cf. Josèphe, AJ 4:212) ; ensuite, le scribe qui interrogeait Jésus reprend, en soulignant l’unité et l’unicité de Dieu (v. 32). Le passage est en grec, mais il a une saveur judéenne plus que romaine, ce qui est étonnant dans cet évangile éloigné des réalités juives, et où l’opposition des autorités se manifeste dès le début (Mc 3,6) ; l’araméen vrai-semblable des origines a entièrement disparu. Ces menues remarques de détail n’affectent guère le contenu du livre, mais elles laissent entendre qu’il a eu une histoire rédactionnelle notable, depuis la Judée jusqu’à Rome.
Un autre fait est que Mc s’est éloigné des réalités juives. Voici quelques exemples : dans le récit de la guérison de l’hémorroïsse, Mc 5,27 dit qu’elle toucha le vêtement de Jésus, mais les parallèles (Mt 9,20 ; Lc 8,44) précisent « la frange de son vêtement », avec le terme précis de Nb 15,38 (kra&spedon), qui prescrit ces franges (çiçit) comme rappel des commandements, ce qui a une tout autre portée ; plus loin, il doit expliquer les usages juifs, non sans impréci-sions (7,3-4) ; dans le récit de la Passion, il croit que la « préparation » est la veille du sabbat (Mc 15,42), alors qu’il s’agit de la préparation à la Pâque, fête qui tombait un sabbat cette année-là34.
Christian History III, Leiden, Brill, 1986, p. 270-281. On peut ajouter que selon Josèphe les esséniens s’engageaient non seulement à ne pas blasphémer Dieu ni Moïse, mais aussi à « garder secrets les noms des anges » (G 2:142).
32 Une autre explication est proposée par Bruce M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament : A Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament (Fourth Revised Edition), Stuttgart, Deutsche Bibelgesellshaft, 21994, p. 119-120.
33 Cf. M.-Émile BOISMARD, L’Évangile de Marc. Sa préhistoire (Études Bibliques, N. S. 26), Paris, Gabalda, 1994, p. 27-28.
34 Cf. Étienne NODET, « La “préparation à la Pâque” (Jn 19,14) », RB 119 (2012), p. 421-422.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 13
Les quatre évangiles ne cachent pas que durant la vie publique de Jésus ses
disciples le comprennent mal et ne voient guère l’accomplissement des Écri-tures. C’est particulièrement visible chez Mc. Reprenons à partir du terme Évangile. Lors de l’onction à Béthanie, Jésus déclare (Mc 14,9) : « Partout où sera proclamé l’Évangile dans le monde entier… » Ici, « Évangile » a un certain lien avec la mort de Jésus et une conservation parfumée de son corps ; il a été annoncé auparavant aux disciples un basculement après la résurrection (9,9), mais on n’en sait pas beaucoup plus. Plus généralement, il règne sur l’ensemble de la vie publique de Jésus une ambiance de secret : Jésus interdit aux démons de parler (1,25.34 ; 3,12), et de même aux disciples (8,30), aux bénéficiaires ou aux témoins de miracles (1,45 ; 5,43 ; 7,36 ; 8,26) ; Jésus s’efforce de rester anonyme (7,24 ; 9,30), et son enseignement par paraboles est mystérieux (4,10-13). Les commentateurs, convaincus que Mc était plus proche des faits, ju-geaient que Jésus faisait preuve d’humilité ou de prudence politique, mais en 1901 W. Wrede, observant aussi que les disciples ne comprenaient pas Jésus (8,21) – même quand celui-ci explique (4,34.40) –, montra dans une étude res-tée célèbre qu’il y avait une intention rédactionnelle globale qu’il intitula « se-cret messianique35 ». Il jugeait que cela résultait de la situation de l’Église pri-mitive, dont la christologie n’était pas stabilisée.
La thèse a été critiquée, mais la question du secret messianique est restée vive. Elle a d’ailleurs évolué : le secret sur les miracles n’est pas proprement messianique, de même que l’incompréhension des disciples36. La notion de se-cret peut être élargie en considérant le point de vue du lecteur-auditeur, chez qui la signification se construit peu à peu, rejoignant ou non l’intention de l’auteur37. Le destinataire, qui va lire ou relire, est averti dès le titre (Mc 1,1) : « Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu ». En rigueur de terme, il sait, mais l’entourage de Jésus est présenté comme ne sachant pas, et découvrant peu à peu. Lors du baptême de Jésus, la voix céleste déclare (Mc 1,11) : « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j’ai mis ma faveur. » C’est une défor-mation légère de Is 42,1 cité dans le parallèle Mt 3,17 : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis ma faveur. » Le résultat est que Mc met d’emblée une nuance d’intimité, de révélation privée38 ; celle-ci est partiellement levée lors de la transfiguration, puisque l’identité de Jésus est révélée par la voix céleste à trois disciples, mais ceux-ci ne comprennent pas la consigne de silence « jusqu’à la résurrection du fils de l’homme » (Mc 9,9). Pourtant, Pierre a décla-
35 William WREDE, The Messianic Secret, Cambridge, T&T Clark, 1971 (original : Das
Messiasgeheimnis in den Evangelien : Zugleich ein Beitrag zum Verständnis des Markus-evangeliums, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1901), p. 34-57 ; 231-236.
36 Heikki RÄISÄNEN, The Messianic Secret in Mark, Edinburgh, T&T Clark, 1990, p. 242-243.
37 Kelly R. IVERSON, « “Wherever the Gospel is Preached” : The Paradox of Secrecy in the Gospel of Mark », dans : Kelly R. IVERSON & Christopher W. SKINNER, Mark as Story. Re-trospect and Prospect, Atlanta, SBL, 2011, p. 181-209.
38 Il peut y avoir eu aussi une incidence de Ps 2,7 (« Tu es mon fils, aujourd’hui je t’ai en-gendré ») cité exactement dans le parallèle Lc 3,22.
14 ÉTIENNE NODET
ré peu auparavant à Jésus (8,29) : « Tu es le Christ. » Le contexte montre qu’il ne sait pas ce qu’il dit, alors que le lecteur comprend. En fait, il y a une progres-sion, une sorte de pédagogie sur l’ensemble de l’évangile qui met en relief l’écart entre l’époque de la vie publique de Jésus et la situation du chrétien qui lit ou écoute : Jésus se désigne comme Fils de l’Homme au présent (2,10 ; 8,31) mais aussi au futur, comme celui qui doit venir (8,38 ; 13,26) ; ainsi se croisent la vocation d’Ézéchiel, le prophète incompris (Ez 2,1-7) et les visions eschato-logiques de Daniel (7,13-14). Le dévoilement de l’identité de Jésus comme Christ est progressif : ce titre n’apparaît pas avant la déclaration citée de Pierre, puis il se précise, et même Jésus se l’attribue (Mc 12,35) ; l’évolution est paral-lèle à la progression du sens d’Évangile. Il y a donc une composition délibé-rée39.
Il ressort de ces considérations que Mc n’est pas simplement une collection d’épisodes, mais qu’il a un propos théologique. Le reconnaissant, Wrede revint sur son étude et estima improbable l’antériorité de Mc, mais c’était contraire à la théorie dite des deux sources, qui était supposée acquise40. En fait, elle reste débattue, et il est opportun ici d’en reprendre la genèse. La question sous-jacente est de déterminer le sens de la double caractéristique de Mc : le peu d’enseignement de Jésus, sauf sur son identité, et l’ambiance de secrets ; la brièveté du tout suppose que le lecteur sait déjà quelque chose.
III – « Deux évangiles » ? (Mc issu de Mt et Lc)
La théorie des deux sources a une préhistoire, qu’on peut retracer briève-ment. L’examen critique des évangiles a commencé au XVIIIe siècle, avec une double préoccupation : d’une part, liée au romantisme, la quête des origines ; d’autre part, liée au rationalisme des Lumières, la recherche du véritable Jésus et de son enseignement exact, dépouillé de la foi des théologiens et des tradi-tions des catholiques. La question, loin d’être purement académique, avait une urgence particulière en Prusse luthérienne. Aux noms de Reimarus et Lessing est attaché le lancement entre 1770 et 1780 d’une thèse durable selon laquelle il y aurait eu un évangile primitif enfoui sous les quatre avatars canoniques, peu fiables en matière d’exactitude historique. Cette idée développait les témoi-gnages d’Eusèbe et d’Épiphane sur l’existence d’un Mt araméen ou hébreu, qui aurait été l’évangile des judéo-chrétiens ou des nazoréens, et dont Mt serait un écho en grec. D’autres auraient utilisé librement cette source lointaine disparue, d’où Mc et Lc, Jn restant à part comme « évangile spirituel », sans grande im-portance historique. C’est un assouplissement du modèle d’Augustin, par l’introduction de la notion essentielle de source littéraire perdue, c’est-à-dire
39 Cf. Benoit STANDAERT, Évangile selon Marc. Commentaire, Pendé, Gabalda, 2010, p.
30-41, qui met en relief la composition rhétorique et même dramatique de Mc. 40 William WREDE, « Rückblick auf Markus » (avant 1906), repris dans : Rudolf PESCH
(ed.), Das Markus-Evangelium, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979, p. 13-47.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 15
d’un intermédiaire entre une prédication primitive purement orale et les évan-giles en grec.
Cependant, tous les travaux se fondaient sur un nouvel outil : en 1774 était parue la première « synopse », due à Griesbach, qu’il perfectionna ensuite pen-dant quarante ans. C’était une révolution, car il mettait en regard les textes pa-rallèles de manière à faire ressortir les différences, ce qui est loin d’être aisé lorsqu’on descend au niveau des menus détails. Il confessait même en prologue « l’hérésie » d’affirmer qu’il n’y avait aucun moyen de réconcilier les chrono-logies des évangiles, même des synoptiques, contrairement à ce qu’on avait es-péré avant lui. Il devenait dès lors impossible d’établir une chronologie assurée de la vie de Jésus, et par conséquent d’en établir l’histoire véridique, d’où quelques vives réactions.
En 1783, Griesbach publia sa propre solution du problème synoptique41 : il conserve l’idée traditionnelle que Lc a connu Mt, issu d’un disciple de Jésus, mais il affirme que l’auteur de Mc, qui n’a presque rien en propre, avait devant les yeux Mt et Lc, ce qui se rapproche de la perception finale d’Augustin. Son argumentation tient en trois « observations », qui méritent d’être brièvement rapportées42.
La première observation concerne l’ordre des péricopes, sans considérer les détails littéraires. Mc suit principalement Mt, mais lorsqu’il s’en écarte pour suivre Lc, il le suit fidèlement, puis lorsqu’il revient à Mt on peut voir pourquoi. Voici, légèrement remanié, un extrait du tableau synthétique que donne Gries-bach, avec un aperçu de ses commentaires.
Parallèles de Mt Mc Parallèles de Lc
(1-2) (a) (1-2) 3,1-4,22(b) 1,1-20 1,21-39 4,31-34(c) (5,1-11)(d) 1,40-3,6 5,12-6,11 12,15-16(e) 3,7-12 (12,17-21) 3,13-19 6,12-16(e)
41 Frans NEYRINCK, « The Griesbach Hypothesis : The Phenomenon of Order », ETL 58
(1982), p. 111-122, rappelle que H. OWEN (1764), A. F. BÜSCHING (1766) et d’autres avaient déjà émis l’idée que Mc soit postérieur à Mt-Lc ; c’était avant GRIESBACH, et même pour les premiers avant sa synopse (1776), mais celui-ci ne les mentionne jamais, alors qu’il ne pouvait guère les avoir ignorés.
42 Johann Jakob GRIESBACH, Commentatio qua Marci evangelium totum a Matthaei et Lu-cae commentariis decerptum esse monstratur, Jena, Gabler, 41825. La première édition fut publiée en 1783. Ce bref ouvrage est donné, traduit et commenté dans les actes du « Johann Jakob Griesbach Bicentenary Colloquium 1776-1976 » : Bernard ORCHARD & Thomas R. W. LONGSTAFF (eds.), J. J. Griesbach : Synoptical and Text-Critical Studies 1776-1976, Cambridge University Press, 1978.
16 ÉTIENNE NODET
12,22-23 3,20-21 … 26,1-28,8 14,1-16,8
Tableau 1 – L’ordre de Mc suit alternativement Mt et Lc (extrait). Notes sur le tableau 1 :
(a) Les évangiles de l’enfance sont omis, car Mc ne s’intéresse qu’à la vie publique de Jé-sus. On peut ajouter que Mt et Lc sont impossibles à combiner, du fait de leurs désaccords sur la chronologie et sur Nazareth.
(b) Mc laisse Mt et passe à Lc ; il omet le sermon sur la montagne qui « contient beaucoup de choses qui ne concernaient que ceux qui avaient entendu le Christ parler sur la mon-tagne ». Griesbach conserve l’opinion traditionnelle que Mt grec dépendait de l’araméen ou hébreu écrit par l’apôtre. Plus loin, Mc omet entièrement Lc 8,51-18,14, où l’on trouve sur-tout des discours.
(c) Après l’indication du retour en Galilée de Lc 4,14 (qu’il a déjà mis en 1,14 en suivant Mt 4,12) Mc omet Lc 4,15-30, jugé peu important pour ses lecteurs (succès dans les syna-gogues, difficultés à Nazareth avec allusions bibliques) ; plus loin, alors qu’il suit à nouveau alternativement Mt et Lc, il reprend à sa place dans Mt le passage sur Nazareth, plus bref (Mc 6,1-6 parallèle à Mt 13,53-58).
(d) Mc omet Lc 5,1-11 car il a déjà raconté l’appel des disciples en 1,16-20 d’après Mt 4,18-22.
(e) Mc abandonne Lc au moment de l’équivalent du sermon sur la montagne, et revient à Mt, pour une suite de paraboles qu’il abrège. Mais il faut les introduire, ce qu’il a fait en 3,7-12 en s’inspirant de Mt 12,15-16 (et en développant, cf. ci-après). Cela indique que même en suivant Lc il ne perd pas de vue Mt. Dans la suite, Mc 3,22-13,36 suit alternativement Mt et Lc, avec quelques omissions, mais pour la Passion il suit Mt.
La deuxième observation concerne les passages propres à Mc, en négligeant
les menus détails ajoutés ici et là aux passages pris à ses sources : ce sont seu-lement trois courts récits de miracles et deux paraboles ; le tout tient en vingt-quatre versets, ce qui est infime. Considérant que Marc avait été proche de Pierre, et que sa mère vivait à Jérusalem (Ac 12,12), Griesbach s’étonne que Mc omette tant de faits et gestes de Jésus qu’il devait connaître, d’autant plus qu’il enrichit ses emprunts à Mt et Lc de nombreux détails. Il conclut que le propos de Mc était de ne sélectionner dans Mt et Lc que ce qui était utile à ses lecteurs ; il montre en outre que même ces passages propres dérivent en quelque manière de Mt ou Lc.
Pour la parabole du grain qui pousse tout seul (Mc 4,26-29), il montre qu’elle remplace la parabole de l’ivraie et du bon grain (Mt 13,24-30), car avant (le semeur) et après (grain de sénevé) il suit Mt avec exactitude, ce qui ne l’empêche pas d’avoir introduit l’explication de la parabole du semeur d’après Lc 8,11-15.
La seconde parabole propre à Mc est celle du maître parti en voyage, qui il-lustre l’invitation à veiller (Mc 13,33-37) ; elle remplace, dans un contexte stric-tement parallèle, le bloc Mt 24,37-25,46 qui est un long discours sur le juge-ment dernier, mais qui commence par une invitation très semblable à veiller. De ces deux cas, Griesbach conclut qu’il n’y a pas à chercher une autre source litté-
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 17
raire que Mt : les souvenirs de l’auteur ou sa propre créativité peuvent suffire43. Il applique un traitement analogue à deux des trois récits de miracles. Mc
3,7-12 développe Mt 12,15-16 : Jésus se retire, beaucoup le suivent et sont gué-ris, il leur ordonne de se taire. Mc ajoute deux traits : la mer et la barque de se-cours, qu’on retrouve ensuite (4,1 suivant Mt 13,1) ; les foules venues « de Ju-dée, de Jérusalem, d’Idumée de Transjordane, des régions de Tyr et Sidon », ce qui développe la liste donnée en Mt 4,25 « Décapole, Jérusalem, Judée, Trans-jordane » (cf. 7,31).
La guérison du sourd-muet de Mc 7,32-37, qui se termine par l’admiration de la foule pour les guérisons de Jésus, est une addition dans un contexte parfai-tement parallèle à Mt : il remplace par un cas unique (« hors de la foule ») une formule générale où Jésus guérit tous les infirmes, ce qui impressionne la foule (Mt 15,30-31).
Griesbach concède enfin qu’un cas résiste : la guérison de l’aveugle de Beth-saïde (Mc 8,22-26), insérée dans une trame empruntée à Mt. Il observe cepen-dant qu’un élément commun à ce récit et aux deux précédents est la consigne de silence. Davantage : à d’autres récits empruntés à Mt, Mc ajoute la même con-signe de silence (7,24 ; 9:30) ; c’est donc un trait caractéristique de Mc.
La troisième observation complète la première à l’échelle des petits faits lit-
téraires : lorsque Mc suit Mt (ou Lc) sur un passage, il emprunte de temps à autres un détail à Lc (ou Mt), ce qui indique qu’il avait bien les deux sous les yeux. Par exemple, pour le récit de l’hémorroïsse, Mc 5,25-29 suit Lc 8,43-44, sauf au v. 28 où il est conforme à Mt 9,21. En sens inverse, pour la manifesta-tion du Fils de l’Homme et la parabole du figuier, Mc 13,24-27 est conforme à Mt 24,29-33, sauf au v. 26, où il suit Lc 2,27, plus court. Un cas semblable est visible en Mc 14,12-16, pour la préparation de la pâque.
Enfin, Griesbach consacre un chapitre à répondre aux objections, car il avait
déjà partiellement publié ses vues, et d’autres théories étaient en circulation. Il remarque d’abord que la sélection de Mc est sévère : il omet une bonne partie de Mt et Lc, particulièrement les discours de Jésus. Cependant, lorsqu’il retient un passage, il l’allonge le plus souvent.
La théorie synoptique proposée est incompatible avec la tradition affirmant que Mc a recueilli l’évangile de Pierre ; telle est la première objection, à la-quelle Griesbach répond longuement. La deuxième est que Mc devient inutile, puisqu’il n’apporte à peu près rien de neuf. La troisième, analogue, est qu’on ne voit pas pourquoi Mc a été inclus dans le canon. La quatrième est qu’un évan-
43 On peut noter qu’en fait seul le v. 34 parle d’un « homme » parti en voyage, comme
dans la parabole des talents (Mt 25,14) ; les v. 35-36, sur le retour tardif le jour même du « maître de maison », sont analogues à Lc 12,37-39 ; il est possible que ce soit une sorte de cicatrice de la fusion de deux paraboles de même sens. Un détail est significatif : selon Lc 12,37 la nuit est divisée en trois veilles (système hébreu) mais en Mc 13,35 le maître peut revenir à l’une des quatre veilles, ce qui est le système romain (qu’on retrouve aussi en Mt 14,25 et Mc 6,48). En AJ 5:223 Josèphe transforme les trois veilles nocturnes de Jg 7,18 en quatre, selon la coutume romaine.
18 ÉTIENNE NODET
gile plus court, moins documenté, devrait être plus ancien. La cinquième, plus précise, est que l’hypothèse inverse, que Mt et Lc au-
raient utilisé Mc, rend mieux compte des faits. Citons quelques éléments de la réponse de Griesbach : il est inconcevable que Mt, témoin oculaire, se soit ap-puyé sur Mc, qui ne l’était pas ; Mc est plus clair et souvent plus précis que Mt, ce qui indique qu’il a retravaillé sa source ; l’argument de l’ordre (la première observation) est difficile à retourner, car on ne voit pas, si Mt suivait Mc, pour-quoi il en aurait dispersé les éléments.
La sixième est que les différences entre les synoptiques s’expliqueraient bien si tous trois provenaient d’une unique source sémitique. Griesbach admet que Mt fut d’abord écrit en hébreu, mais les coïncidences en grec de Mt et Mc sont telles qu’il faudrait supposer que Mc, qui a des traces sémitiques propres, ait vu et le grec et l’hébreu de Mt, c’est-à-dire deux recensions distinctes ; il juge donc la conjecture nuisible.
La septième, qui reprend le thème de la priorité de Mc, est que les omissions de Mc, en particulier les discours de Jésus, sont impardonnables s’il avait bien Mt et Lc sous les yeux. Griesbach répète sobrement qu’on ignore quels étaient les destinataires de Mc, puis il justifie en détail une dizaine d’omissions no-tables.
La huitième, dans le même sens, est que Mc contredit assez souvent Mt et Lc, ce qui suggère qu’il ne les suivait pas. Griesbach affirme d’abord que Mc ne pouvait prévoir qu’on l’épie par des synopses minutieuses, puis il examine quelques cas, et conclut que la plupart se résolvent si l’on suit bien Mc lorsqu’il passe de Mt à Lc ou inversement.
La théorie de Griesbach eut un grand succès, car elle expliquait au mieux les
accords et les désaccords entre les évangiles. Les biblistes ne lui reprochaient pas de perdre de vue les traditions patristiques sur l’origine de Mc, mais la diffi-culté persistante restait le problème des omissions, qui ne se posait guère avec la théorie d’Augustin, selon laquelle chacun des évangiles selon l’ordre tradi-tionnel complétait ses prédécesseurs, Mt étant le plus ancien. Si Mc reprenait Mt et Lc, pourquoi omettait-il tant de choses ? Pour répondre, il était tentant de supposer que les évangiles, dans leur forme actuelle, étaient littérairement indé-pendants, mais dérivaient d’un évangile primitif, comme le voulait Reimarus, ou même de plusieurs sources perdues. Pourtant, il restait difficile d’admettre que les synoptiques constituaient trois sources indépendantes, du fait d’évidentes parentés littéraires.
IV – « Deux sources » ? (Mt et Lc issus de Mc et Q)
Les travaux se poursuivirent44. En 1832, Schleiermacher, qui doutait fort que
44 Renseignements empruntés principalement à William R. FARMER, The Synoptic Pro-
blem, New York, Macmillan, 1964 ; Mark GOODACRE, The Synoptic Problem : A Way
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 19
Mt soit l’œuvre d’un témoin oculaire, publia une étude sur Papias45, qu’il com-prenait comme attestant deux sources : un évangile rédigé par Marc (distinct de Mc actuel) et une collection de logia utilisés par Mt (et Lc dépendant de Mt) ; la nouveauté était de considérer que cette collection n’était pas un évangile à pro-prement parler, mais des enseignements de Jésus. Schleiermacher restait fidèle à Griesbach, car il jugeait Mc tardif, mais il fournissait un élément capital pour étoffer la thèse d’un évangile primitif (devenant ainsi un proto-Mc), en introdui-sant une autre source (perdue) pour les discours communs à Mt et Lc, à savoir ces logia.
Un pas de plus fut franchi peu après par Lachmann46, en 1835. Partant de l’idée d’un évangile primitif utilisé indépendamment par les trois synoptiques, il retourna le premier argument de Griesbach sur l’ordre des péricopes : comme Mc suit tour à tour Mt et Lc, il y a toujours au moins deux évangiles qui s’accordent (et parfois les trois, lorsque Mt et Lc concordent) ; ils reflètent donc l’ordre de la source commune. Comme Mc est toujours l’un d’eux, il est donc le meilleur témoin de l’ordre de l’évangile primitif – et probablement aussi de son contenu.
Parallèlement, la même année vit les débuts de ce qui allait devenir pendant trente ans l’« école de Tübingen », avec la publication des ouvrages de Strauss sur Jésus et de Baur sur la gnose chrétienne47. Le point de départ était double : d’une part la théorie de Griesbach, en considérant Mt comme le plus ancien, et d’autre part l’idée admise que ce même Mt était déjà éloigné d’un proto-Mt ori-ginal, œuvre d’un témoin direct. Les récits et légendes des évangiles, ainsi déta-chés de tout élément vérifiable, étaient à interpréter comme mythes. En outre, la pensée dialectique de Hegel était à la mode, et l’on interpréta la succession chronologique Mt-Lc-Mc comme « thèse-antithèse-synthèse », ce qui prolon-geait – sans le dire – la suggestion finale d’Augustin. Baur datait Mt vers 130 et les autres bien après. Ces vues extrêmes – où il manquait encore la distinction entre rédaction et réception ou canonisation –, inquiétèrent les théologiens et les autorités universitaires, et contribuèrent au discrédit de la théorie de Griesbach.
En 1838, une réaction se fit jour à travers un ouvrage de Weisse48, qui s’inspirait de la thèse de Lachmann sur l’ordre des péricopes : il concède d’abord le caractère mythique des évangiles de l’enfance ; puis, constatant qu’il est dangereux de tout faire dépendre de Mt, qui est déjà éloigné des origines, il Through the Maze, Sheffield Academic Press, 2001. D’autres détails sont fournis par Harry T. FLEDDERMANN, Q : a Reconstruction and Commentary, Leuven – Paris, Peeters, 2005, p. 3-40.
45 Friedrich E. D. SCHLEIERMACHER, « Über die Zeugnisse des Papias von unsern beiden ersten Evangelien », dans : Sämtliche Werke I.2, 1836, p. 361-394.
46 Karl LACHMANN, « De ordine narrationum in evangeliis synopticis », dans : Theo-logische Studien und Kritiken, 1835, p. 570-585.
47 Ferdinand Christian BAUR, Ausgewählte Werke in Einzelausgaben, mit einer Einführung von Ernst KÄSEMANN, Stuttgart, Frommann Vlg, 5 vol. 1963-1975. (Le texte le plus caracté-ristique est Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, ihre Verhältnis zu einander, ihren Charakter und Ursprung, Tübingen, 1847.)
48 Christian H. WEISSE, Die evangelische Geschichte, kritisch und philologisch bearbeitet, Leipzig, W. Engelmann, 1838.
20 ÉTIENNE NODET
revient à Schleiermacher, mais cette fois en abandonnant Griesbach : Mt et Lc dépendent de Mc et d’une collection perdue de logia, tous deux remontant à l’époque des témoins oculaires. Tel fut le premier état de la théorie des deux sources. Plus tard, il modifia légèrement ses vues, en reprenant l’idée d’un pro-to-Mc utilisé indépendamment par les trois synoptiques. Cependant, l’ouvrage resta longtemps ignoré, car il n’était que l’une des nombreuses théories qui s’étaient développées à l’époque : les théologiens leur préféraient malgré tout Griesbach, qui évitait de supposer des sources hypothétiques.
En 1862, Holtzmann publia un brillant ouvrage de synthèse49, qui eut une in-fluence considérable en popularisant la théorie des deux sources ; la collection de logia de Papias devenaient Q (Quelle), après avoir été L. Reprenant l’idée des deux sources de Weisse, il s’efforçait de les reconstituer. Son point de dé-part explicite fut d’abord d’extraire de la cacophonie de l’époque des éléments de consensus : d’une part, il y avait un accord général, quoique pour des raisons variées, pour affirmer que Mt n’est pas primitif, c’est-à-dire n’est pas le récit d’un témoin oculaire ; d’autre part, l’idée ancienne due à Lessing d’un évangile primitif (Grundschrift) était admise par tous, en dehors de l’école de Tübingen ; détail essentiel, cela implique que les synoptiques aient été composés indépen-damment. Sa méthode consistait donc, un peu comme Lachmann, à reconstituer un texte primitif à partir des passages où deux au moins des évangiles sont en accord, et en négligeant le reste. En outre, il suivait Schleiermacher en distin-guant les récits et les discours ; pour les premiers, qui correspondent en gros à la triple tradition, il aboutit à un proto-Mc plus long que Mc, et pour les seconds (double tradition), à quelque chose comme les logia de Papias (Q). De cette manière, il put établir une vie de Jésus rattachée à Mc et finalement à Pierre, mais débarrassée d’étranges légendes sur sa naissance et de récits contradic-toires sur sa résurrection. Et ce fut à la fois le fondement et la caution de la théologie libérale, qui put, avec une argumentation historique, combattre aussi bien les dogmes orthodoxes que la critique radicale de l’école de Tübingen. Plus tard, Holtzmann révisa sa théorie50 en identifiant pratiquement le proto-Mc con-jecturé avec Mc actuel51. Il restait cependant au moins une difficulté de mé-thode : plus on se fonde sur Mc tel qu’il est, et non sur une forme antérieure res-tituée, plus il est nécessaire de donner un statut à Q, même perdu ; or cette source, où domine l’enseignement de Jésus, a une couleur beaucoup plus juive que Mc, ce qui, au moins implicitement, pose le problème d’une possible anté-riorité.
49 Heinrich J. HOLTZMANN, Die synoptischen Evangelien, ihr Ursprung und geschichtli-
cher Charakter, Leipzig, W. Engelmann, 1862. 50 Heinrich J. HOLTZMANN, Hand-Commentar zum Neuen Testament. I. Band : Die Synop-
tiker, die Apostelgeschichte, Freiburg, J. C. B. Mohr, 1891. 51 Ces vues furent consacrées par les travaux d’Adolf HARNACK, Geschichte der alt-
christlichen Literatur bis Eusebius, Leipzig, Hinrichs, 1893-1897, où il donne pour les évan-giles des datations qui ont peu varié depuis (II:711-722) : Mc entre 65 et 70, Mt en 70-75, Lc-Ac en 79-93 et Jn en 80-110. Pourtant, John A. T. ROBINSON, Redating the New Testament, London, SCM Press, 1976, p. 16-20, montre que ces conclusions sont peu fondées, sauf peut-être pour Jn.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 21
C’est en Angleterre que se poursuivirent les travaux importants sur le pro-blème synoptique, sous l’impulsion de W. Sanday. Il acceptait la théorie des deux sources, mais avec réserves. Estimant que le dossier n’était pas clos et que la théorie laissait plusieurs problèmes en suspens, il lança et anima de 1894 à 1910 un Oxford Seminar, qui aboutit à d’importantes publications52. Un des problèmes discutés en détail était celui de petits accords de Mt et Lc contre Mc dans les parties narratives. Le jeune B. H. Streeter, qui devait devenir le plus célèbre héritier du séminaire, jugeait alors que ces petits accords étaient si frap-pants qu’il fallait en conclure que Mt et Lc avaient connu, pour la triple tradi-tion, une autre source que Mc : c’était justement Q, que Mc avait lui aussi con-nue et abrégée (ou « mutilée »). Mais Q n’est reconstituée que comme combi-naison de Mt et Lc ; donc, si Mc actuel en dépend, on obtient quelque chose de très proche de l’hypothèse de Griesbach ; la seule différence consiste à supposer que Mt et Lc sont indépendants, ce qu’il fallait encore prouver. F. H. Woods s’aperçut de cette difficulté de méthode53, et prit la peine de réfuter l’idée que Mc dépende de Mt et Lc, en reprenant d’anciens arguments : les omissions de Mc sont inexplicables, tout comme ses principes de sélection supposés ; les pa-rallélismes entre Mt et Lc sont de même inexplicables sans source commune, puisque les deux sont supposés rédigés indépendamment (ce qui généralise l’argument de l’ordre).
D’autres concédèrent que la méthode de Griesbach pouvait avoir certains mérites, mais qu’elle ne tenait pas face à l’hypothèse des deux sources. Par exemple, pour la notice sur les guérisons multiples, V. H. Stanton54 admet que « le soir venu » de Mt 8,16 puisse se combiner avec le parallèle « au coucher du soleil » de Lc 4,40 pour donner « le soir venu, au coucher du soleil » de Mc 1,32. De même, la guérison de l’aveugle de Jéricho est introduite selon Mc 10,46 par une phrase étrange « Ils vont à Jéricho. Alors que (Jésus) marchait hors de Jéricho » ; ce peut être une combinaison de Mt 20,29 « Alors qu’ils sor-taient de Jéricho » et de Lc 18,35 « Il arriva, alors qu’il s’approchait de Jéri-cho ». Il repousse cependant Griesbach car il n’explique pas les parallélismes entre Mt et Lc, toujours supposés rédigés indépendamment ou à peu près ; en fait, il connaît et cite la thèse de Simons55, qui avait montré par l’examen de leurs accords mineurs contre Mc que Lc connaissait Mt, mais il affirme que la dépendance est minimale car ces accords peuvent s’expliquer autrement, et que de toute façon il manque une théorie claire expliquant la méthode de Lc. Fina-lement, il se voit obligé de dédoubler Mc en un proto-Mc source de Mt et Lc et
52 William SANDAY (ed.), Studies in the Synoptic Problem, Oxford, Clarendon Press,
1911 ; John C. HAWKINS, Horae Synopticae. Contributions to the Study of the Synoptic Pro-blem, Oxford University Press, 1911.
53 F. H. WOODS, « The Origin and Mutual Relation of the Synoptic Gospels », dans : Wil-liam SANDAY & al. (eds.), Essays Chiefly in Biblical and Patristic Criticism (Studia Biblica et Ecclesiastica, 3), Oxford, Clarendon Press, 1890, p. 59-104.
54 Vincent H. STANTON, The Gospels as Historical Documents, Cambridge University Press, 3 vol., 1903-1920, cf. 2:35-36.
55 Eduard von SIMONS, Did the Third Evangelist Use the Canonical Matthew ?, Bonn, 1880.
22 ÉTIENNE NODET
Mc actuel, remanié d’après Mt et/ou Lc. Il ajoute que la tâche de Mc, pour combiner Mt et Lc, aurait été difficile, et prend comme exemple d’un phéno-mène fréquent la guérison de la belle-mère de Pierre, où il considère que Mt et Lc reformulent indépendamment Mc :
Mt 8,14-15.16 Mc 1,29-31.32 Lc 4,38-39.40
14 Et Jésus étant allé vers la maison de Pierre
29 Et aussitôt sortis de la synagogue ils allèrent vers la maison de Simon et d’André avec Jacques et Jean.
38 S’étant levé hors de la synagogue il se dirigea vers la maison de Simon.
il vit sa belle-mère étendue et fiévreuse.
30 La belle-mère de Simon était alitée, fiévreuse, et aussitôt ils lui parlent à son sujet.
La belle-mère de Simon avait une grande fièvre, et ils lui demandèrent à son sujet.
15 Il toucha sa main,
31 Et s’étant approché, il la releva, ayant pris la main.
39 S’étant penché sur elle, il menaça la fièvre,
et la fièvre la quitta, et elle fut relevée et elle le servait.
Et la fièvre la quitta, et elle les servait.
et elle la quitta. À l’instant, s’étant levée elle les servait.
16 Le soir venu… 32 Le soir venu, au coucher du soleil…
40 Au coucher du soleil…
Tableau 2 – Guérison de la belle-mère de Pierre. Ce cas est instructif pour deux raisons. La première est que l’argumentation
peut aisément se retourner : Mt et Lc ayant ici deux formes différentes du même récit, il n’est pas plus étrange de supposer que Mc a reproduit les éléments communs aux deux, qui forment une ossature (en italique), et qu’il a rédigé plus librement là où ils diffèrent : aux v. 29 et 30 il a suivi plutôt Lc, et à la fin Mt, en introduisant une forme active du verbe (« il la releva ») qui évoque la résur-rection (cf. Mc 5,41 ; 9,26). En outre, Mc a rajouté (comme en 13,3) les men-tions d’André, Jacques et Jean, qui viennent d’être appelés par Jésus (Mc 1,16-20), alors que cette guérison est racontée chez Lc (5,1-11) avant l’appel des dis-ciples et se trouve insérée chez Mt dans un ensemble de miracles sans disciples, bien après leur appel (Mt 4,18-22). Une telle explication, aboutissant au carac-tère secondaire de Mc, est d’autant plus tentante qu’au v. 32 sur le coucher du soleil, qui suit immédiatement, celui-ci paraît combiner Mt et Lc par simple ad-dition, ce que Stanton admet (cf. ci-dessus).
La seconde raison est que dans ce passage les récits de Mt et Lc peuvent être considérés comme indépendants ; en tout cas, ils n’ont pas d’accords contre Mc, ce qui facilite l’hypothèse de l’antériorité de celui-ci. Mais ailleurs dans les pas-
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 23
sages de la triple tradition, il y a de très nombreux accords de détail de Mt et Lc contre Mc. Une hypothèse simple consiste à introduire un écart entre Mc actuel et un état antérieur utilisé par Mt et Lc, c’est-à-dire de considérer un proto-Mc. On peut aussi tenter de négliger ces accord mineurs, en considérant qu’ils sont modestes en regard de la double tradition remontant à Q, c’est-à-dire des accord massifs de Mt et Lc contre Mc, par péricopes entières. C’est ce que fit Burkitt56 en 1906, qui repoussait l’idée d’un proto-Mc, nécessairement plus long et plus documenté que Mc actuel. Son argument principal était tiré d’une observation : en dehors des évangiles, le NT, et spécialement les attestations les plus an-ciennes (Ac, Paul), ne s’occupent guère de la vie publique de Jésus ; autrement dit, l’intérêt pour le ministère en Galilée est un développement tardif et large-ment légendaire d’origine ecclésiastique. L’observation de Burkitt est judi-cieuse, mais on peut l’interpréter autrement : l’ensemble Lc-Ac, avec les pro-logues à Théophile, représente un effort pour montrer la cohérence entre la vie de Jésus, connue par des sources écrites, et le kérygme paulinien surtout oral.
Cependant, les accord mineurs de Mt et Lc contre Mc dans la triple tradition sont trop nombreux pour être attribués au hasard ; on en trouve entre 250 et 300, selon la manière de les compter. Le problème vient de ce que la théorie des deux sources exige que Mt et Lc représentent deux rédactions indépendantes57. Aussi, après les avoir d’abord négligés puis ensuite étudiés en détail, Abbott concluait-il58 qu’il fallait les voir comme le résultat d’une autre édition de Mc altérant les parallélismes. Pour éviter de conjecturer un proto-Mc de dimension indéterminée, il supposait que Mt et Lc s’étaient fondés sur un deutéro-Mc, qui n’était finalement qu’une recension améliorant la syntaxe et le style. Cela deve-nait presque une question de pure critique textuelle, sans incidence notable sur le contenu.
Il faut citer ici deux ouvrages qui abordèrent autrement la question des ac-cords mineurs, sans l’atomiser en cas particuliers. En 1915, Lummis reprit le dossier59 à partir des travaux précédents, et jugea (avec Simons) que Lc avait connu Mt, et en tira une double conclusion : d’une part, pour la triple tradition, la priorité de Mc cessait d’être démontrée, et d’autre part, pour la double tradi-tion, le recours à une source Q hypothétique ne s’imposait plus ; il invitait donc à revoir les arguments de Griesbach et de l’école de Tübingen. En 1922, Jame-
56 F. Craford BURKITT, The Gospel History and Its Transmission, Edinburgh, T&T Clark, 1906, p. 40-41 et 60-65.
57 Comme le voyait clairement Morton S. ENSLIN, Christian Beginnings, New York, Har-per, 21938, p. 432 ; Ronald PRICE, http://homepage.virgin.net/ron.price/index.htm, néglige ce point de méthode : il suppose que Lc a connu Mt, Mc et Q ; dans ce cas, l’antériorité de Mc et l’existence de Q deviennent de simples suppositions non liées, presque arbitraires, et la démonstration se limite à des considérations stylistiques, toujours réversibles.
58 Edwin A. ABBOTT, Diatessarica Part II. The Corrections of Mark Adopted by Matthew and Luke (Diatessarica II), London, 1901, p. 300-325. Auparavant, dans son article « Gos-pels » de l’Encyclopaedia Britannica, London, 1879, p. 791b, il avait jugé négligeables ces accords mineurs.
59 Edward W. LUMMIS, How Luke Was Written (Consideration affecting the Two-document Theory, with special reference to the Phenomena of Order in the Non-Markan Matter common to Matthew and Luke), Cambridge University Press, 1915.
24 ÉTIENNE NODET
son publia une étude60 fondée sur le problème des accords mineurs, et jugea que les hypothèses proposées (le hasard, le recours à la source Q, la recension per-due de Mc ou les aléas textuels) étaient insuffisantes. Il proposait simplement de revenir au modèle d’Augustin61, Mc ayant utilisé Mt, et Lc ayant utilisé Mt et Mc.
Il n’y avait donc pas de consensus, sinon sur le fait que la question des ac-cords mineurs était fondamentale pour justifier la théorie des deux sources, c’est-à-dire en réalité pour pouvoir conclure fermement que Mt et Lc sont indé-pendants. En 1924, Streeter publia une synthèse62 qui parut définitive. Sa mé-thode fut d’atomiser le problème. Il déclare d’abord que Mt et Lc ont repris Mc en historiens, réécrivant et condensant leurs sources ; un indice est que leur style, moins sémitisant, est meilleur que celui de Mc ; il en résulte qu’une pre-mière catégorie d’accords mineurs, en particulier les omissions, ne sont pas si-gnificatifs, car ils sont dus indépendamment à cette même cause. Une deuxième catégorie provient d’améliorations de style, que n’importe qui aurait faites de la même manière. Une troisième catégorie d’accords (moins) mineurs provient du fait que Q et Mc ont des passages parallèles (narratifs). L’hypothèse que Q in-clut aussi des récits est nécessitée par le fait qu’en cinq péricopes de la triple tradition (Mc 3,23-30 ; 4,30-32 ; 6,8-11 ; 9,42 ; 12,28-34) Mt et Lc sont très semblables, et distincts de Mc63. Streeter juge que Mt combine fréquemment Q et Mc, alors que Lc ne le fait qu’à l’occasion. En fait, c’est une manière de dis-simuler des fragments d’un proto-Mc, dont il ne veut à aucun prix, puisque ce serait encore une source hypothétique. Finalement, la quatrième catégorie est due à des corruptions textuelles, souvent par contamination de passages paral-lèles.
À titre d’exemple, considérons (tableau 3) le premier cas que donne Streeter pour la seconde catégorie (Mc 2,12, à la fin de la guérison du paralytique), mais en considérant aussi le contexte, où l’on rencontre d’autres accords mineurs de première catégorie.
Mt 9,2-7 Mc 2,3-12 Lc 5,18-26
2 Et voici (i0dou&), ils lui apportaient un paralytique
3 Et ils vont portant vers lui un paralytique
18 Et voici des hommes portant un humain qui était paralysé,
60 John G. JAMESON, The Origins of the Synoptic Gospels, Oxford, Blackwell, 1922. 61 Le 19 juin 1911, la Commission Biblique publiait un décret affirmant que Mt (ou son
original araméen), œuvre d’un témoin oculaire, était le plus ancien et avait toujours été un évangile complet (incluant enfance et résurrection), cf. Enchiridion biblicum. Documenta ecclesiastica sacram scripturam spectantia, auctoritate pontificiae commissionis de re bibli-ca edita, Rome-Naples, 21954, § 388, 389, 391, 392 et 399.
62 Burnet Hillman STREETER, The Four Gospels : A Study of Origins, London, Macmillan, 1924.
63 C’est ce qui a été retenu pour la restitution de Q, cf. James M. ROBINSON, Paul HOFFMANN & John S. KLOPPENBORG VERBIN, The Critical Edition of Q. Synopsis Including the Gospels of Matthew and Luke, Mark and Thomas with English, German, and French Translations of Q and Thomas, Leuven, Peeters, 2000.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 25
étendu sur un lit (kli/nhj).
porté par quatre… sur un lit…
Et (kai/) Jésus voyant leur foi dit (ei]pen) au paralytique…
5 Jésus (de/) voyant leur foi dit (le/gei) au paralytique…
20 Et voyant leur foi il dit (ei]pen)…
4 Et Jésus, connaissant leurs sentiments dit (ei]pen)…
8 Et aussitôt, Jésus sa-chant par son esprit qu’ils pensaient ainsi en eux-mêmes, leur dit (le/gei)…
22 Jésus, sachant leurs pensées, répondant dit à eux…
5 Quel est donc le plus facile, de dire : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi et marche ?
9 Quel est le plus facile, de dire au paralytique : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi, prends ton grabat et marche ?
23 Quel est le plus facile, de dire que tes péchés soient remis, ou de dire : Lève-toi et marche ?
6 Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, il dit alors au paralytique : T’étant levé (e0gerqei/j), prends ton lit (kli/nhn) et rends-toi à ta maison (u#page ei0j to_n oi]ko&n sou).
10 Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de remettre les péchés, il dit au paralytique : 11 Je te dis, lève-toi, prends ton grabat (kra&batton) et rends-toi à ta maison.
24 Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, il dit au paralytique : Je te dis, lève-toi (e1geire) et ayant pris ta litière (klini/dion), marche à ta maison (poreu&ou ei0j to_n oi]ko&n sou).
7 Et s’étant levé (e0gerqei/j) il partit à sa maison… (a)ph~lqen ei0j to_n oi]kon au)tou~)
12 Et il se leva, et aussitôt prenant le grabat il sortit devant tous… (e0ch~lqen e1mprosqen pa&ntwn)
25 Et immédiatement, s’étant relevé (a)nasta&j) face à eux, prenant sur quoi il gisait, il partit à sa maison… (a)ph~lqen ei0j to_n oi]kon au)tou~)
Tableau 3 – Guérison du paralytique de Capharnaüm (extraits). Dans le dernier verset, il y a un accord mineur de Mt et Lc contre Mc portant
sur cinq mots. Streeter le neutralise en l’isolant et en affirmant que Mt et Lc ont voulu que le paralytique obéisse exactement à la parole de Jésus ; on peut l’admettre pour Mt, qui la reprend presque mot pour mot, mais c’est inexact pour Lc, qui met un verbe différent (« s’étant relevé »). De plus, il y a dans le contexte bien d’autres accords mineurs, que ce soient des plus de Mc (souli-
26 ÉTIENNE NODET
gnés) ou des contacts positifs Mt-Lc contre Mc (italiques). Le cas le plus vi-sible, dans l’extrait cité, est l’emploi de « grabat » 3 fois par Mc, contre deux fois « lit » par Mt-Lc ; le cas le plus curieux est l’emploi, contraire à sa coutume constante, de la particule de/ par Mc (v. 5) contre « et » de Mt-Lc, ce qui est plus sémitisant. Si l’on prend la théorie de Griesbach, Mc ici se trouve dans une sec-tion de même ordre que Lc (cf. tableau 1) ; quant au texte lui-même, il n’est pas difficile de conjecturer que Mc suit Lc, avec quelques retouches et expansions, mais sans perdre de vue Mt, ce qu’on voit à quelques contacts (par ex. Mc 2,11).
On peut encore ajouter, pour expliquer les omissions communes Mt-Lc, que la thèse selon laquelle ceux-ci résument Mc ne suffit pas : pour l’ensemble du récit, Mt est en effet plus bref que Mc, mais Lc est légèrement plus long, surtout au début et à la fin (qui ne figurent pas dans le tableau 3). Il suffira de dire ici que la conclusion de Streeter ne s’impose pas64 ; d’ailleurs il concède, en fin d’ouvrage, que ceux qui ne sont pas convaincus peuvent considérer que Mt et Lc ont utilisé une recension améliorée de Mc (cf. Abbott ci-dessus) mais non un proto-Mc plus long à la manière de Holtzmann ; pour lui, Mc actuel, avec son style incertain, est primitif, mais il est obligé d’introduire des sources spéciales (M et L) pour les matériaux propres à Mt et à Lc.
Diverses objections se sont manifestées : en 1951, Butler proposait de reve-nir à l’explication d’Augustin65. En 1954, Vaganay s’est efforcé de combiner l’antériorité de Mt avec la théorie des deux sources, en introduisant des phases rédactionnelles plus ou moins rattachées au Mt araméen66. En 1974, Neirynck a repris la défense de la théorie des deux sources en s’efforçant de réduire le pro-blème des accords mineurs de Mt et Lc contre Mc67. À un autre point de vue, Goodacre propose d’oublier Q, tout en maintenant l’antériorité de Mc (Lc dé-pendant de Mc et Mt), ce qui règle apparemment la question des accord mi-
64 Joachim ROHDE, Rediscovering the Teaching of the Evangelists, London, SCM Press,
1968 (original : Die redaktionsgeschichtliche Methode, 1966) montre que la théorie des deux sources est fondée sur des présupposés ; David L. DUNGAN, « Critique of the Main Argu-ments for Mark’s Priority as formuled by B. H. Streeter », publié en 1970 et repris dans : Arthur J. BELLINZONI (ed.), The Two Source Hypothesis. A Critical Appraisal, Mercer Uni-versity Press, 1984, p. 143-161, conclut aussi que Streeter n’a pas démontré l’antériorité de Mc, pour deux raisons principales : d’une part, l’importance des accords mineurs est escamo-tée, et il n’est pas prouvé que Mt et Lc soient indépendants ; d’autre part, l’affirmation que la langue et la théologie de Mc sont plus frustes est gratuite, puisque d’autres ont conclu des mêmes faits qu’il reflétait au contraire une forte influence latine (cf. ci-dessus).
65 B. Christopher BUTLER, The Originality of St. Matthew : A Critique of the Two-Document Hypothesis, 1951 ; il accepterait de revenir à Griesbach, cf. sa synthèse ultérieure « The Synoptic Problem », dans : Reginald FULLER, Leonard JOHNSTON & Conleth KEARNS (eds.), A New Catholic Commentary on Holy Scripture, London, Th. Nelson & Sons, 1969, p. 815-821.
66 Léon VAGANAY, Le Problème synoptique. Une hypothèse de travail, Tournai, Desclée & Cie, 1954, avec bibliographie et présentation des discussions antérieures.
67 Frans NEIRYNCK (ed.), The Minor Agreements of Matthew and Luke against Mark, With a Cumulative List (BETL, 37), Leuven University Press, 1974.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 27
neurs68, mais dans ce cas, la démonstration de l’antériorité de Mc tombe, ou ne repose plus que sur des hypothèses stylistiques69.
Des essais plus complexes ont été tentés, qui pour cumuler les mérites des « deux sources » et des « deux évangiles » combinent l’évolution rédactionnelle de chaque évangile avec leurs influences réciproques, à partir de plusieurs sources réputées indépendantes : Boismard en 1981 et Rolland en 199470. En tout cas, les exemples présentés plus haut permettent de comprendre pourquoi d’aussi nombreuses théories se sont affrontées71. Une tendance plus récente, soucieuse de retrouver le Jésus historique, consiste à revenir sur la véracité du témoignage des synoptiques72, c’est-dire en fait de Mc, puisqu’il est acquis que Mt actuel ne peut représenter directement le Matthieu araméen.
Par ce biais aussi, où réapparaît l’antériorité de Mc, la théorie des deux sources est supposée acquise73. Son mérite est sa remarquable simplicité, digne du rasoir d’Occam ; son défaut est de n’être pas vraiment démontrée, et de né-cessiter sans trop le dire des hypothèses complémentaires ad hoc74. Elle donne
68 Mark S. GOODACRE, The Case Against Q : Studies in Markan Priority and the Synoptic
Problem, Harrisburg, Trinity Press, 2002. 69 Ce que ne manque pas de lui reprocher John S. KLOPPENBORG, « On Dispensing With
Q ? Goodacre on the Relation of Luke to Matthew », NTS 49 (2003), p. 210-236. 70 Pierre BENOIT, M.-Émile BOISMARD, Arnaud LAMOUILLE, Synopse des quatre évan-
giles en français. II – Commentaire des Synoptiques, Paris, Éd. du Cerf, 1981, qui introduit aussi une interaction avec Jn. Philippe ROLLAND, L’Origine et la date des évangiles, Paris, Éd. St-Paul, 1994 : se fondant sur Ac, il rattache Q à Césarée, un proto-Mt à Pierre (Rome) et un proto-Lc à Paul (Antioche).
71 Un symposium rassemblant les chefs de file des principales théories n’a pu aboutir, cf. David L. DUNGAN (ed.), The Interrelations of the Gospels. A Symposium Led by M.-É. Bois-mard, W. R. Farmer & F. Neirynck (BETL, 95), Leuven University Press, 1990 ; la brève conclusion (p. 609-610), qui fait appel à de futurs travaux, enregistre quatre modestes points d’accord et quinze points de désaccords, parmi lesquels figurent la question des « accords mineurs », la manière de concevoir une synopse, la notion de tradition, les implications théo-logiques de chaque théorie, etc.
72 Paul R. EDDY & Gregory A. BOYD, The Jesus Legend. A Case for the Historical Re-liability of the Synoptic Jesus Tradition, Grand Rapids, Baker Academic, 2008, p. 309-442, jugent que les synoptiques sont dignes de crédit en matière historique, sauf preuve du con-traire. C’est une saine méthode, mais justement Jn est plus proche des faits, tant pour la chro-nologie en général que pour la Passion. Robert K. MCIVER, Memory, Jesus, and the Synoptic Gospels (Resources for Biblical Study, 59), Atlanta, Society of Biblical Literature, 2011, p. 183-187, offre une réflexion sur l’incidence de la psychologie du témoin engagé, ce qui pré-cise les conditions d’exactitude des portraits synoptiques de Jésus.
73 À cet égard, typique est la grosse synthèse de James D. G. DUNN, Christianity in the Making. I – Jesus remembered, Grand Rapids – Cambridge, Eerdmans, 2003, p. 143-161, qui se borne à constater que la théorie des deux sources est généralement acceptée, mais qui si-gnale, à côté de cet argument « démocratique », la persistance de problèmes de détails.
74 Par définition, l’hypothétique source Q ne peut rien apprendre directement sur Jésus his-torique, cf. Michael GOULDER, « Jesus without Q », dans : Tom HOLMÉN & Stanley E. PORTER (eds.), Handbook for the Study of the Historical Jesus, Leiden, Brill, 2011, p. 1287-1311 ; cependant, l’introduire qualifie le témoignage des évangiles canoniques, cf. David D. DUNGAN, « Dispensing With the Priority of Mark », dans : IDEM, p. 1312-1342.
28 ÉTIENNE NODET
parfois lieu à des conclusions historiques étonnantes75. Par exemple, Mc 1,14 indique : « Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, annonçant l’Évangile de Dieu. » On peut en déduire d’une part que débarrassé de la tutelle de Jean le Baptiste, Jésus devient libre pour sa mission, et d’autre part que si son baptême est rapporté, alors qu’il ne joue aucun rôle, c’est qu’il est histori-quement vrai76. Une telle conclusion est étrange, car plus tard il faut pour rem-placer Judas un disciple qui soit témoin de tout « depuis le baptême de Jean » (Ac 1,22) ; Jésus lui-même est présenté comme baptiste par Jn 3,22.
V – Que conclure ?
Le problème synoptique ne peut être éludé, surtout dans la perspective de la recherche du Jésus historique : il y a trop de similitudes pour ne pas supposer des dépendances littéraires, mais aussi trop de différences pour qu’aucune ex-plication simple rende compte de l’ensemble des faits. On peut regrouper les théories en trois catégories principales.
– L’hypothèse issue de Griesbach, ou de « deux évangiles », propose que Lc
a connu Mt, puis que Mc a combiné les deux, avec quelques éléments propres. Son avantage est de ne pas conjecturer de source disparue. Sa difficulté est double : d’une part, on ne voit pas bien pourquoi Lc aurait bouleversé l’ordre de Mt ; d’autre part, il faut expliquer pourquoi Mc, qui tend toujours à paraphraser ses emprunts à Mt et Lc, a omis d’importants passages de ses sources, en parti-culier des discours de Jésus. Ce sont là des difficultés globales.
– L’hypothèse des « deux sources », selon laquelle Mc et Q, essentiellement distincts, sont à l’origine de Mt et Lc, supposés rédigés indépendamment. Son avantage est de mettre en tête l’évangile le plus bref. Sa difficulté est double : d’une part, les accords Mt-Lc contre Mc sont difficiles à réduire, et ne sont pas tous mineurs, ce qui a conduit à conjecturer d’autres formes de Mc, antérieures ou postérieures à Mc actuel ; d’autre part, certaines difficultés de la triple tradi-tion ont abouti à supposer que Mc (ou proto-Mc) et Q étaient partiellement pa-rallèles, ce qui rend imprécis le contour des sources supposées77. Ici, les diffi-
75 Cf. le bilan méthodologique de Stanley E. PORTER, The Criteria for Authenticity in His-torical-Jesus Research. Previous Discussions and New Proposals (JSNT, Suppl., 191), Shef-field Academic Press, 2000.
76 Cf. Paul W. HOLLENBACH, « The Conversion of Jesus : From Jesus the Baptizer to Jesus the Healer », ANRW II, 25/1 (1982), p. 209-211 ; d’autres considérations sont proposées par Jerome MURPHY O’CONNOR, « John the Baptist and Jesus : History and Hypotheses », NTS 36 (1990), p. 359-374. Si on néglige Mc et Lc 1-2, il y a toutes raisons de croire que Jean le Baptiste et Jésus n’ont pas été contemporains : Mt 3,1 situe la prédication de Jean sous Ar-chélaüs, c’est-à-dire avant 6 ; Lc 3,21 met le baptême de Jésus après l’arrestation de Jean le Baptiste. Josèphe ne fait aucun lien entre les deux : en AJ 18:116, il situe Jean après Jésus, mais dans les deux substantielles notices de la version slavone de la Guerre (2:110.168), il le met sous Archélaüs, comme Mt.
77 Terence C. MOURNET, Oral Tradition and Literary Dependency. Variability and Stabili-ty in the Synoptic Tradition and Q (WUNT, II/195), Tübingen, Mohr-Siebeck, 2005,
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 29
cultés sont au niveau de la critique littéraire elle-même. – Des théories intermédiaires, qui s’efforcent de combiner les avantages des
deux précédentes, mais elles en ont aussi les défauts, car elles reconstruisent des sources et des phases rédactionnelles que personne n’a vues. Elles sont éclai-rantes sur bien des points, mais elles ne sont pas de véritables hypothèses, car elles multiplient les explications ad hoc, qui par nature ne sont ni vraies ni fausses. En outre, elles ne donnent pas prise à des objections d’ensemble, qui obligeraient à poursuivre.
On peut tenter de reprendre la question à partir d’autres considérations : 1. Dans l’Antiquité, la publication et la protection d’un texte étaient des opé-
rations risquées, à cause des contrefaçons, ou simplement des copies négli-gées78. Le cas de Josèphe est exemplaire : après avoir fait quelques modifica-tions sur les conseils d’amis, il dit avoir présenté les livres de la Guerre à l’empereur Titus, qui a apposé sa signature et en a ordonné la publication (Vie § 360-365). C’était certainement un visa de censure pour un historien faisant des commentarii officiels. Eusèbe rapporte que les ouvrages de Josèphe furent déposés en bibliothèques publiques – la protection la plus sûre79 – et que sa sta-tue fut érigée sur une place à Rome (HE 3.9.2). Or, on a retrouvé en Égypte un papyrus du IIIe siècle avec un fragment de la Guerre (2:576-579 et 582-584), et sur 112 mots il y a 9 variantes inconnues des manuscrits répertoriés80 ; c’était donc une copie déjà éloignée des exemplaires officiels (de Rome). Face à cela, il n’y aucune raison de penser que le NT, même bien défini selon Irénée, ait ja-mais été publié en ce sens, même à Rome ; les divers livres ont circulé de com-munauté en communauté, où ils ont été recopiés ou traduits, non sans altéra-tions. Les migrations de versets d’un évangile à l’autre, constatables en compa-rant les manuscrits, sont un problème de critique textuelle, mais le phénomène est certainement plus ancien ; il relève alors de la critique littéraire, qui est tou-jours fragile. Prenons un exemple tiré du passage de Jésus en Phénicie, et dont l’incidence sur le sens est négligeable. On lit en Mt 15,21 « Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon », puis à la fin (15,29) « Jésus vint près de la mer de Galilée ». Le parallèle Mc 7,24 met « (Jésus) s’en alla vers le territoire de Tyr et de Sidon », puis à la fin (7,31) « quittant le territoire de Tyr, il vint par Sidon vers la mer de Galilée » ; telle est la leçon des meilleurs manuscrits, mais la géographie du récit n’est pas très logique, et l’on soupçonne le plus souvent que et de Sidon de Mc, omis par des témoins secondaires, est une contamination issue de Mt et due à une distraction de scribe. Cependant, le diagnostic s’efforce par un travail statistique de distinguer dans les péricopes celles qui reflètent des traditions orales (avec variation du vocabulaire) de celles qui supposent une dépendance litté-raire (formulation plus stable).
78 Cf. Elias J. BICKERMAN, « The Colophon of the Greek Book of Esther », JBL 63 (1944), p. 339-362.
79 Cf. Saul LIEBERMAN, Hellenism in Jewish Palestine, New York, Jewish Theological Seminary, 1950, p. 82-88.
80 Hans ŒLLACHER, Grieschiche literarische papyri II, Baden b. Wien, Rohrer, 1939, p. 61-63.
30 ÉTIENNE NODET
d’illogisme présuppose un art d’écrire qui est peut-être étranger à Mc81. 2. Vus globalement, les synoptiques sont trois avatars d’un même récit, qui
va du baptême de Jean à la Passion, avec une unique montée de la Galilée à Jé-rusalem ; ils rapportent des épisodes semblables, mais selon des principes de composition différents82. En fait, la Passion est gouvernée par la dernière Cène, où l’institution de l’eucharistie en résume le sens, comme l’exprime Paul (1 Co 11,26) : « Chaque fois que vous mangez ce pain […] vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » La seule fête de pèlerinage mentionnée est la Pâque finale, ce qui suggère que le tout a pris moins d’un an, alors que Jn si-gnale trois Pâques, la première vers 28 (Jn 2,20), et la dernière peut-être en 30, mais plus probablement en 33, pour des raisons de calendrier, ce qui ferait un ministère de Jésus d’au moins quatre ans83.
3. Il en résulte qu’on peut considérer les synoptiques comme trois assem-blages analogues d’éléments dispersés dans le temps, et disposés entre deux bornes bien définies ; il ne s’agit pas de biographies minutieuses. Les matériaux utilisés, épisodes de la vie de Jésus, doivent être rattachés aux compositions nombreuses faites « d’après ce qu’ont transmis les témoins oculaires » (Lc 1,1-2), avec remaniements, fusions, expansions, mais aussi sélections sévères, comme le rappelle Jn 21,25 ; Pierre, comme « fils de Jonas » était plutôt zélote, et il avait une épée. Les observations faites plus haut sur Mc montrent un étire-ment rédactionnel entre un substrat araméen et une arrivée dans le monde latin, et il n’y a pas de raison de refuser à Jean-Marc de Ac 12,12 la paternité d’un premier recueil, organisé ou non.
4. Paul rappelle que l’évangélisation est essentiellement orale (Rm 10,17) : « La foi vient de l’écoute. » Il n’en est pas de même des rites, qui nécessitent des rubriques et des textes écrits, car ils sont par nature prévisibles. Justin, lors-qu’il décrit la célébration chrétienne dominicale, indique une lecture des « mé-moires des apôtres » ou des Prophètes, « aussi longuement que le temps le per-met » ; puis le président donne une instruction doublée d’une exhortation (Apol. 1.67.3). A priori, avec de telles lectures, le sermon doit avoir une double dimen-sion : développement de l’enseignement de Jésus et accomplissement des Écri-tures (kérygme). On ne dispose pas de témoignage antérieur clair, mais si l’on en juge par le récit des disciples d’Emmaüs et la veillée à Troas (Lc 24,30 et Ac 20,7), la « fraction du pain » était précédée d’une prédication. En tout cas, les
81 Voici un autre exemple d’illogisme, encore tiré de Josèphe. Lors du siège de Massada en
73, les sicaires qui s’y étaient réfugiés avaient pour chef Éléazar, « descendant de Judas qui avait persuadé de nombreux Juifs, comme on l’a montré plus haut, d’empêcher le recense-ment quand Quirinius fut envoyé comme censeur en Judée » (G 7:253). Pourtant, dans le récit de la révolte de Judas le Galiléen, Quirinius et son recensement ne sont pas mentionnés (G 2:118), mais il en sera question dans un ouvrage ultérieur (AJ 18:2-5).
82 Gary N. KNOPPERS, « The Synoptic Problem ? An Old Testament Perspective », Bulle-tin for Biblical Research 19 (2009), p. 11-34, attire l’attention sur un phénomène typique de l’AT, où les réécritures d’anciens textes sont hautement créatives ; Sg reprend Ex ; Dt re-prend le bloc Ex-Nb ; 1-2 Ch reprend toute l’histoire d’Israël. Si le NT accomplit l’ancien, il n’y a pas à s’étonner d’y rencontrer des effets semblables.
83 Cf. É. NODET, « Chronologies… » (n. 8), p. 368.
ÉVANGILES : DE JEAN À MARC 31
« mémoires des apôtres » sont écrits ; Papias est apparemment le premier à avoir cherché à identifier des évangélistes, mais son témoignage manque de précision.
5. C’est certainement l’usage liturgique qui a contribué à stabiliser et à diffé-rencier les textes, tout en les maintenant en petites unités largement indépen-dantes, pouvant être utilisées séparément. À cet égard, il n’y a pas lieu de repro-cher à Lc d’avoir dispersé les enseignements du Sermon sur la Montagne : il suffit d’y voir une commodité liturgique, et les arguments sur l’ordre des péri-copes sont peu probants84. Il est remarquable en tout cas que les harmonies évangéliques n’aient pas supplanté les récits canoniques (sauf chez les Sy-riaques, mais au début ils n’étaient pas prêts à accepter Paul).
Selon ces considérations, Mc se détache comme une anomalie à plusieurs
points de vue : éloignement du judaïsme, peu d’enseignements de Jésus, secret messianique et incompréhension des disciples, construction soignée et rythme rapide, où les péricopes sont souvent enchaînées par « aussitôt ». De plus, la composition est soigneuse, en termes de rhétorique ancienne, non sans détails pittoresques ; elle aboutit à la manifestation de l’identité de Jésus. Une hypo-thèse d’ensemble, faite par B. Standaert85, mérite la plus grande attention : Mc serait un livret composé pour une veillée initiatique caractéristique, c’est-à-dire un baptême, peut-être lors d’une Pentecôte, mais on sait peu de chose sur les fêtes chrétiennes au IIe siècle. Dans ces conditions, l’absence d’enseignement de Jésus se comprend bien, puisqu’il s’agit d’une initiation à son identité. Une telle hypothèse permet de revenir au modèle de Griesbach (Mc dépendant de Mt et Lc), puisque la principale objection – à laquelle il n’a d’ailleurs pas répondu – était que la disparition de l’enseignement de Jésus était inadmissible ; il suffit d’assouplir légèrement sa théorie, en admettant que Mc et Lc avaient aussi des sources propres, et que Mt était déjà éloigné de l’original araméen ou hébreu. Au passage, la question des accords, mineurs ou non, de Mt et Lc contre Mc s’évanouit.
Ainsi, Jn est plus proche des origines, avec une théologie haute, des détails plus exacts et un récit de la Passion bien moins reconstruit (sauf pour les dis-cours). Mc est le plus éloigné, avec la dimension humaine de Jésus, comme l’indiquait Augustin. On ne peut affirmer que cet ordre soit aussi celui des ré-dactions finales, mais il est certain que les dates données par Harnack, qui font encore largement autorité, ne peuvent être maintenues.
Quant à l’affirmation d’Augustin que chaque évangéliste, dans l’ordre cano-nique, connaissait les évangiles précédents et les supposait connus, elle n’est guère satisfaisante, sauf peut-être pour Jn. Ils ont certainement puisé dans les récits des témoins oculaires de Lc 1,1-2, mais il n’est pas sûr qu’ils y aient trou-
84 Hypothèse suggéré par Michael D. GOULDER, Luke, A New Paradigm. Part I: The Ar-gument - Part II: Commentary: Luke 1.1-9.50, (JSNTSup, 20), Sheffield, JSOT Press.
85 Cf. Benoît STANDAERT, L’Évangile selon Marc. Composition et genre littéraire, Nijme-gen, Stichting Studentenpers, 1978, repris de manière synthétique dans L’évangile selon Marc. Commentaire, Paris, Éd. du Cerf, 1983, qui est attaché à l’antériorité de Mc, mais sans la discuter (cf. aussi n. 36.)
32 ÉTIENNE NODET
vé des renseignements précis sur les Romains, les rois juifs, les samaritains, les pharisiens et autres sadducéens ; de toute manière, leur propos n’était pas do-cumentaire. Cependant, il y a lieu de croire, pour des raisons qui ne peuvent être développées ici, que les œuvres de Josèphe ont constitué une sorte de manuel de référence ; elles étaient accessibles, car déposées en bibliothèques publiques. En tout cas, ces ouvrages ont été constamment utilisés par la suite – et encore au-jourd’hui – pour éclairer le contexte d’origine des évangiles.
Jérusalem, novembre 2012.