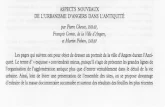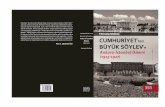Influences francaises dans la formation de l'urbanisme moderne en Grece, 1914-1923
Transcript of Influences francaises dans la formation de l'urbanisme moderne en Grece, 1914-1923
1
INFLUENCES FRANÇAISES DANS LA FORMATION DE L'URBANISME MODERNE EN GRECE 1914-1923
Kiki KAFKOULA - Alexandra YEROLYMPOS Université de Thessalonique
Introduction
Le recours aux modèles européens pour la modernisation des villes était une pratique courante
en Grèce depuis la formation de l'Etat grec moderne en 1828, l'espace urbain étant considéré comme un reflet du développement socioéconomique, plutôt qu'une de ses composantes dynamiques. Cette considération du rôle de l'espace a dû être réorientée à partir les années 1910 pour des raisons structurelles aussi bien que conjoncturelles: la nécessité pressante de moderniser globalement le pays, l'acquisition de nouveaux territoires dont l'intégration posait des problèmes tout à fait singuliers, les immenses dégâts de la guerre, et le besoin d'installer en Grèce 1,2 million de réfugiés.
En même temps la réorientation s'appuyait sur la constitution, sur le plan international, d'une nouvelle forme de savoir, l'urbanisme, en discipline autonome. Les urbanistes français jouaient déjà un rôle de premier plan dans le contexte international. Leur démarche était appuyée en plus, par la présence en France:
- D'une grande tradition d'opérations urbanistiques, avec comme point fort l'opération Haussmann a Paris.
- D'un appareil étatique centralisé et bien organisé à l'échelle nationale avec des services administratifs et techniques.
- D'une école de composition de grande influence, comme l'Ecole des Beaux Arts, ainsi que d'autres institutions qui prônaient la maîtrise du développement urbain, comme le Musée Social.
- Elle était aussi renforcée par le rayonnement culturel de la France dans les pays moins développés d'Europe, d'Orient, d'Afrique et d'Amérique Latine (Taylor 1982:45-46).
L'urbanisme français de 1900 doit son succès au fait qu'il place au centre de ses préoccupations les nouvelles conquêtes technologiques en accord avec les impératifs de production et de paix sociale, et qu'il associe à une solide connaissance des outils méthodologiques (i.e. analyse du mouvement de l' automobile, échelles hiérarchiques, grilles fonctionnelles, législation et règlements) un vocabulaire morphologique qui relève de la tradition classique de Ι' Ecole des Beaux-Arts.
Partout hors de France les urbanistes utilisent les concepts théoriques et les outils les plus
évolués de Ι'époque. l'objectif est une ville-centre, projetant ses extensions contrôlées, avec ses tracés monumentaux et ses parcs romantiques, avec ses réseaux de transport moderne et ses quartiers pittoresques préservés pour le touriste, avec un zonage strict, fonctionnel et social. Une ville hygiénique, propre, réglementée et contrôlable, donc paisible, offrant à ses habitants "l’air, le loisir, la lumière et le droit à l' expression personnelle" (Ε. Hébrard, cité par Wrίght, Rabinow 1982:32).
En Grèce des tentatives pour adopter l'urbanisme moderne avaient été entreprises au début des années 1910. Dans ce contexte favorable, l'apport des techniciens français de l'Armée d'Orient fut considérable. Le moment était en tous points propice, car à la fin des guerres balkaniques de 1912-13, la Grèce avait doublé son territoire et sa population en annexant la Macédoine, Ι'Epire, les îles, un peu plus tard la Thrace, après de longs siècles d'occupation par Ι' Empire ottoman. L'état d'arrièrement qui se manifestait de façon particulière dans les villes, avait attiré l'attention des Libéraux qui gouvernaient la Grèce. Pour y faire face ils ont fondé en 1914 un ministère spécial des Transports, avec comme objet la programmation centrale et le contrôle du réaménagement de l'espace national. Conçu et animé par l'ingénieur civil Dimitris Diamantidis, qui avait fait des études post-diplôme sur les transports en France, ce super-ministère renforçait le caractère déjà fortement centraliste de l'Etat grec avec son
2
ingérence croissante dans les affaires traditionnellement locales. Sa politique était centrée sur les problèmes posés par Ι' adoption de nouveaux moyens de transport et de communications, ainsi que de nouvelles technologies par l'industrie et les constructions (à savoir l'électricité, le béton armé...). Il était aussi chargé d'étudier la perspective de l'emploi massif de l'automobile, et la mise au point d'une législation d'urbanisme et d'expropriations. Les plans d'urbanisme. Le modèle de la ville moderne
Nous savons, quelquefois par des sources non vérifiables, que plusieurs plans d'aménagement
furent établis par des "ingénieurs français" en Grèce du Nord. Ernest Hébrard est supposé être le rédacteur du plan de Jannina, dès 1915. C'est aussi à un français qu'est attribué le plan (introuvable) de Nigrita, ville entièrement détruite par les Bulgares en 1913. Le plan de Florina fut commandé par les autorités locales au service topographique de l'Armée d'Orient, qui occupait la ville depuis septembre 1916 (Ancel, 1921). Le plan original, dont le titre, la légende et toute écriture sont en français, fut complété en 1918, et approuvé par décret royal en 1919.
Fig. 1. Ernest Hébrard (source : Yakoumis H. et al., 2001)
Εn 1919 un Bureau de Reconstruction de la Macédoine Orientale fut créé pour s'occuper des villes et villages des départements de Serres et Kilkish, détruits pendant la guerre entre la Grèce et la Bulgarie (en 1913 et dans la grande guerre). A peu prêt 100.000 d’habitants étaient sans abri. Le Bureau, mis en place par une loi spéciale du Ministre des Transports Alexandre Papanastassiou, fut immédiatement encadré par des ingénieurs grecs et des architectes de l'Armée d'Orient, des Anglais surtout. Pourtant, parmi les plans qui ont été retrouvés, un (le plan de Djoumayia) est signé par Ρiet de Yong, anglais d’origine hollandaise à côté du nom de Ernest Hébrard, qui dirigeait le projet.
Parmi les villes redessinées (peut être 160, on n’a trouvé qu’une trentaine) Djoumayia était la plus grande, d' environ 6000 habitants en 1913. Son plan est très différent des autres, un plan presque idéal typique. Par une symétrie rigoureuse le centre civique est mis en valeur. Il forme une croix dont le centre est occupé par la mairie, quatre hôtels, des équipements de loisirs et un marché-bazar, et les
3
ailes sont formées par des boulevards où on trouve les équipements sportifs et culturels (au nord), les écoles et les services publics (à l'ouest), la cathédrale à l'est et un marché en plein air au sud. Cette ville fut réalisée par les Libéraux, pendant leur dernier gouvernement en 1930 (Kafkoula, 1990).
Il est certain que le plan de Thessalonique après le grand incendie de 1917 est un évènement
tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'urbanisme grec. Εn effet la reconstruction de la ville fut la plus importante matérialisation de l'effort moderniste du premier ministre Eleftherios Venizélos et d'Alexandre Papanastassiou, ministre des Transports (Yerolympos, 1986 et 1988).
Une commission fut immédiatement constituée, sous la direction d'Ernest Hébrard, architecte et urbaniste Grand Prix de Rome 1904, qui se trouvait sur place, mobilisé dans l'Armée d'Orient. Hébrard collabora avec Joseph Pleyber, ingénieur militaire français, chargé du plan d'assainissement de la ville, et avec un groupe de jeunes architectes français de l'Armée (Allègre, Chambet, Gérard, Blaufuss, Chappe, Péronne, Grand).
La réalisation du plan demandait la mise en place d'une législation d'urbanisme prévoyant: l'expropriation générale du sol urbain en faveur d'une association des anciens propriétaires, le réaménagement des îlots au centre historique, le remembrement des parcelles, et la vente par adjudication des nouveaux lots, avec droit de préemption des anciens propriétaires. Il est évident qu'on trouvait là tout le nouveau savoir-faire urbanistique, qui n'apparaissait pas jusqu'alors dans la législation hellénique et qui avait été habilement présenté dans le livre des trois urbanistes Agache,
Fig. 2. Plan de Djoumayia, par de Yong sous la direction d’E. Hébrard (restitué par Athina Vitopoulou).
Fig. 3. Maison de Djoumayia édifiée en 1930.
4
Auburtin et Redont Comment reconstruire nos cités détruites, commandé et publié en 1915 par le Musée Social.
Hébrard a introduit en Grèce les nouveaux concepts et outils sur la forme et la structure de la ville moderne:
- Le schéma directeur prévoyant le développement urbain dans les cinquante années à venir, - Le plan d'occupation des sols, introduisant le zoning fonctionnel et social, - Le plan des extensions futures, - L'aménagement d'un centre civique affirmé, d'un campus universitaire, de faubourgs-jardin, - La mise en valeur des monuments historiques, - La préservation des quartiers pittoresques pour des raisons touristiques, - Les ordonnances architecturales (architecture de programme) aux endroits précisés par le plan d'ensemble, - Les systèmes de construction, - Les modèles pour les îlots et l'habitat collectif dans des immeubles de rapport.
Fig. 4. Plan de Thessalonique, par E. Hébrard (restitué par Athina Vitopoulou).
La décision centrale, qui a marqué l'opération, a été prise cinq jours après l'incendie et n'a
jamais été reconsidérée pendant les sept ans que dura la réalisation, malgré la vive opposition qu'elle a suscitée. D'après des instructions explicites du gouvernement, les urbanistes devaient ignorer résolument la propriété privée, et dessiner la ville comme une "tabula rasa". Les nouvelles parcelles qui seraient créées seraient mises aux enchères et vendues par adjudications.
5
Le deuxième trait principal du plan était lié à cette liberté parfaite d'ignorer toute trace du passé, morphologique ou sociale. La ville a été complètement redessinée comme un ensemble. Toute particularité culturelle a été effacée au profit de la nouvelle religion, le moderne. Les seuls fragments du passé dignes d'être valorisés par le Plan étaient les monuments hellénistiques, romains et byzantins; c'est là précisément que les connaissances et les recherches archéologiques d'Ernest Hébrard ont été utilisées à merveille.
Le cœur du centre a été formé par deux places à programme reliées par une avenue, perpendiculaire au quai, ouvrant sur une perspective majestueuse vers le mont Olympe. La Place Civique, sur l'emplacement du Forum, réunissait l'Hôtel de Ville, le Palais de Justice, et les bâtiments de divers services. La deuxième place, de caractère commercial et touristique, présentait une façade de 100 mètres sur la mer, devenant le "balcon de la ville".
Fig. 5. La "piazzetta" ou le "balcon de la ville", selon l’Hébrard.
6
Fig. 6. Le grand axe avec les deux places.
Hébrard a utilisé les anciens édifices pour donner du caractère au nouveau plan et aussi créer
des espaces libres (Hippodrome, Rotunda, Bezestin, principales églises byzantines et édifices turcs). Εn même temps le plan permettait, par l'aménagement du réseau routier urbain, la circulation
sans entraves de l'automobile et la création des îlots appropriés aux nouvelles fonctions du centre. La commission ne s'est pas limitée à la préparation des plans d'urbanisme. Des plans de
parcellaire réguliers et uniformes ont été dressés ainsi que des plans d'appartements-modèles en vue de faciliter l'utilisation de procédés modernes de construction et imposer de hauts coefficients d'exploitation par l'introduction du béton armé; aussi il s'agissait d' introduire un nouveau mode d'habiter en ville, l'immeuble en copropriété, et ainsi de faire entrer la production des logements dans l'économie du marché.
Par le biais de son nouveau savoir, l'urbanisme a éliminé toutes les traces de l'appropriation traditionnelle du sol urbain par les groupes ethniques et religieux. Les anciens quartiers grecs, juifs et musulmans presque autonomes, et les communautés vivantes qui les animaient, ont disparu devant les nouveaux quartiers ouvriers et de petite et moyenne bourgeoisie. Les nombreux centres de vie sociale ont été substitués par un centre unique, point fort qui organisait la vie civique et économique et exprimait la volonté unificatrice du nouveau pouvoir national.
7
Fig. 7. Immeubles édifiés à Thessalonique, par l’application du plan et des règlements. L'apport de Hébrard ne s'est pas limité au plan de Salonique. Son travail avait été hautement
apprécié par le ministre Papanastassiou; il parait que les deux hommes se sont lies d'amitié et Hébrard a été chargé de plusieurs responsabilités après la fin de la guerre: nommé professeur d'urbanisme à la jeune Ecole d' Architecture, fondée en 1917, il a contribué à la mise au point de l'enseignement des architectes. Aussi il a participé à la Commission du Plan d'Athènes, contribué à la programmation des procédures de planification, ainsi que, plus tard en 1929 à la rédaction du programme des bâtiments scolaires. Finalement il a désigné le plan pour le campus universitaire de Thessalonique en 1929-1930. Alexandros Papanastassiou, élu député de Thessalonique dans les élections de 1928, a visité la ville, rencontré le recteur et recommandé vivement la candidature d’Hébrard, pour l’élaboration du plan du campus universitaire (45 hectares) (Vitopoulou A. Yerolympos A. …).
8
Fig. 8. Le plan du campus universitaire à Thessalonique, par E. Hébrard (restitué par Athina Vitopoulou).
Le débat architectural
Le débat architectural des années 1910 et 1920 a été motivé et animé par des architectes ayant
étudié en France. La mise en place d'une Ecole d'Architecture en 1917, au sein de l'Ecole Polytechnique, n'a pas marqué un changement d'esprit dans les études d'architecture, puisqu'elle fut encadrée par ces mêmes architectes. Alexandre Nicoloudis et Ernest Hébrard, formés à l'Ecole des Beaux-arts en 1905 et 1904, en furent les deux premiers professeurs. En même temps la ruée vers les écoles françaises ne s'était pas interrompue, comme en témoignent les statistiques.
En effet, d'après les registres de la Chambre des Ingénieurs de l'année 1933, les architectes exerçant la profession étaient au nombre de 245. 119 d' entre eux avaient étudie hors de Grèce, parmi lesquels 46 en France. Parmi les 46, 22 étaient partis en France après la fondation de l'Ecole à Athènes, ce qui veut dire que le rayonnement des Beaux-arts persistait toujours. Le premier président du Chambre, Ilias Angelopoulos (1925-1927), avait étudié à l'Ecole des Ponts et Chaussées, aussi que le Premier ministre des Transports (en 1914). Il faut aussi ajouter la présence en Grèce de 28 architectes formés à l'Ecole des Beaux-arts de Constantinople, qui suivait la tradition française.
La prédominance de l'enseignement français a été indiscutable à tel point que les protagonistes des trois principaux courants idéologiques pendant les années 1920 ont eu un rapport direct ou indirect avec la France. L'esprit académique conservateur s'exprimait surtout par Nicoloudis, le mouvement moderne par Vas. Douras, diplômé à l’Ecole Spéciale, et Ν. Mitsakis (qui avait été l'assistant d'Hébrard a l’Ecole d'Architecture); enfin la volonté d'inventer une architecture nationale, axée sur la connaissance des formes traditionnelles et exploitant les moyens de la nouvelle technologie par Dimitri Pikionis, (etudes aux Beaux-Arts en 1912), qui était fortement influencé par les idées de Guadet en faveur du retour a la tradition rurale (Filippidis 1984 et 1988).
9
Nicoloudis et Hébrard étaient alliés au débat de l’emplacement de la Mairie dans la Place
Civique de Théssalonique. Pourtant, ces mêmes personnes se sont affrontées quelques années plus tard au sujet de l’emplacement du nouveau Palais de la Justice à Athènes, confrontation qui connut un vif retentissement dans l'actualité politique de l’époque. Nicoloudis avait gagné le premier prix au concours de 1912, en choisissant un site célèbre, les abords de l’Acropole, pour y construire un bâtiment démesuré! En 1929, quand la construction a été décidée, Hébrard s'est intervenu, par des démarches et des articles très violents, contre la construction «à proximité de l’ Acropole d'un bâtiment aussi volumineux, qui lui porterait dommage, en toute circonstance» (Journal Elefthero Vima, 17 octobre et 6 novembre 1930). Hébrard a réussi à sensibiliser l’opinion publique sur ce "sacrilège", et la construction a été annulée, peut-être aussi à cause du coût estimé trop élevé (Filippidis 1988: 142, -143). Ce conflit est assez révélateur de l’esprit d'Hébrard. Malgré sa préférence pour les modèles centralisants sur le plan idéologique, et académiques-classiques sur le plan esthétique, il était très sensible aux conditions particulières de chaque projet et de chaque site (historique, climatique, géomorphologique et architectural), qu’il essayait de prendre en compte et de mettre en valeur.
Sur le même sujet on doit ajouter ici que les programmes des bâtiments scolaires qu'il a dressés
pour le Ministère d'Education Nationale en 1929 (ou il dirigeait Ι' Office des Bâtiments), expriment aussi ce même souci, rejetant les quatre stéréotypes d'écoles utilisés jusqu'alors, pour introduire de nouveaux impératifs, plus souples, d'après lesquels: les nouvelles écoles devaient être adaptées aux conditions climatiques locales et construites par des matériaux sur place en deux niveaux, avec une ossature de béton armé. Dans les sites exposes au froid et aux vents, les classes devaient être orientées au sud et les couloirs au nord, éclairés par des surfaces en tuiles de verre. Par contre aux climats plus doux, les classes devaient être au nord et les couloirs couverts mais non-fermés au sud, fonctionnant comme brises-soleil pour Ι'étage inférieur. L'emploi de la couleur et des grands pans de verre était vivement recommandé en vue d'enrichir l'expression architecturale (Yiakoumakatos 1987: 52-53).
L’habitat social
Pour revenir aux années 1910, les débats de la période s'enrichissent avec la problématique en
faveur de Ι' habitat social, introduite par Spilios Agapitos. Agapitos avait fait ses études à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris, en 1896. De retour en Grèce ίΙ met au point son programme, qu'il publie en 1918. Par une analyse exhaustive des composantes économiques en Grèce, Agapitos conclut que la solution du problème se situe au-delà de l'initiative privée et propose la mise en place d'institutions non-lucratives. Après avoir exposé les choix et les pratiques suivies dans les pays occidentaux, Agapitos propose trois lignes de conduite: Mise en place des mécanismes de gestion, intervention d'organismes publics ou semi-publics pour la construction, et formulation de normes de qualité très précises et contraignantes.
Elu député avec les Libéraux, président du conseil de plusieurs entreprises jusqu'aux années 1930, Agapitos a milité pour ses idées au sein de nombreuses associations nationales et internationales, comme: l'Association Polytechnique Grecque (dont il fut le président), l’Union Internationale des Villes (siège à Bruxelles), la International Federation for Housing (à Londres), l’Association Française pour l’ Etude de l' Aménagement des Villes et de l' Habitation Populaire (à Paris), et Ι' Association Internationale de Ι' Habitation (à Frankfurt). En 1928 il a représenté la Grèce au congrès international sur l'habitat et l'urbanisme à la Sorbonne, avec une communication sur l'habitat des réfugiés. Il était un des souscripteurs à l’œuvre de la Maison Hellénique parmi les étés 1927-1930, comme en témoignent les archives de la Fondation. Entre-temps il voyageait constamment dans les pays ou la production d' habitat social était plus affirmée et publiait des articles sur les expériences étrangers (v. les journaux
10
1925-1928).
Son programme pour Ι' Habitat Bon-marché (même le nom s'inspire des Français) adopte de
nombreuses clauses de la lοi française (v. les articles 2 et 5 de la loi de12.5.1923 "de la construction des logements Bon-marché", J.O. de Grèce 132/1923). Ce choix n'est pas accidente. Les lois allemandes, aussi bien que celles de l'Italie ou d'Angleterre, supposaient que les initiatives politiques et économiques pour le logement des couches non-favorisées proviendraient en majorité des conseils municipaux, qui disposaient des services techniques et administratifs bien préparés pour assumer une tache pareille, ce qui n'était pas du tout le cas en Grèce. Par contre une structure administrative plus centraliste et hiérarchisée, à la manière de celle existant en France pouvait être adoptée plus facilement en Grèce.
Conformément à cette loi, quarante six coopératives de fonctionnaires d’état ont acquis de terre à construire à Athènes, d'une étendue de cent sept hectares en totale, après expropriation obligatoire (c'est-à-dire à un prix très bas). Cependant, l’application la plus importante/significative de cette loi était la création/construction d’un quartier résidentiel, connu sous le nom de la ‘cité-jardin’ Kypriadis, par une société privée de profit limité, la seule en effet qui a fonctionné de cette manière en Grèce. Selon l'exemple français, son activité était soumise au contrôle du Comité central d’habitations de bon marché. Epaminondas Kypriadis (1888-1958), ingénieur- agronome et fonctionnaire haut placé du ministère de l'agriculture, qui était en tête de la société, avait fait des études en Belgique, ce qui nous permet de supposer qu’il était au courant des pratiques de production d’habitations avec l’aide de l'Etat. Le quartier Kypriadis se distinguait par sa qualité architecturale, dans la mesure qu’il offrait un environnement urbain beaucoup plus favorable que celui des extensions habituelles de la ville; il s’adressait surtout aux couches moyennes, principalement à des employés-fonctionnaires, et non aux ouvriers. Il manquait cependant l'air du luxe qu’on rencontrait à quelques-uns des quartiers résidentiels privés situés dans la banlieue d’Athènes (Kafkoula, 1990).
Fig. 9. Spilios Agapitos
11
Si Hébrard représente le côté technocrate-humaniste de la modernisation et Agapitos ses
programmes sociaux, un troisième technicien, Joseph Pleyber, personnifie la présence française en Grèce, puisqu'il est resté à Salonique après le départ de l'Armée, où il a mourut trente ans plus tard, après avoir fait preuve d'une intense activité et contribué à la formation du nouveau visage de la ville.
Pleyber, né en 1869, était ingénieur militaire de l'Armée d'Orient, et il a participé à la Commission Internationale du Plan, en rédigeant le plan d'assainissement de la ville (v. Ancel, 1930: 330 et L' Opinion 4-10 Avril 1921). Au départ de l'Armée, il s'installe à Salonique, et devient représentant de la Société Franco-hellénique, une grande entreprise formée par des industriels de la ville, qui avait acheté tous les établissements et le matériel laissés sur place et liquidés par l'armée (Ancel, 1921). En 1919, Pleyber négocie avec le gouvernement grec, pour le compte de cette société, la vente des grands hôpitaux militaires, et leur transformation en logements ouvriers. Il parait que cette vente a eu lieu en 1920 (Journal des Balkans 15.5.1919, Saias 1920).
Le problème du logement des réfugiés le préoccupe beaucoup et en 1922-23 il fait des conférences pour leur établissement en soutenant que l'acquitté du problème ne devait pas conduire à des solutions improvisées (Journal Archimidis, 1923). De 1924 a 1927 il construit plusieurs immeubles au centre de Salonique, ainsi que le Collège Français De La Salle, et collabore avec l'architecte Hassid Fernandez. En 1934 il publie un livre sur "Le problème d' habitation de Salonique" et propose de faire une cité-jardin à la montagne de Chortiatis. Α 70 ans, il soutient toujours des idées réformistes (en faveur du logement privé des travailleurs comme une arme contre l'idéologie anarchique) qui
Fig. 10-12. Maisons du quartier Kypriadis.
12
paraissent déjà ternes et vieillies devant la grande tourmente sociale qui s'annonce partout en Europe pendant les années 1930.
Fig. 13. Plan de cité-jardin à Chortiatis, par J. Pleyber.
Fig. 14-16. Immeubles de Thessalonique, par J. Pleyber.
13
L'influence de l'architecture française est assez marquée à Athènes et à Salonique. Il est vrai que sa présence en Grèce s'explique également par son rayonnement international. En même temps, bien que les modèles étrangers soient facilement adoptés en Grèce, dans le silence ou au moins dans l'absence d'un contre-discours consistant, ils se trouvent rapidement obligés de se modifier par une réalité qui puise sur eux et en même temps les transforme. C'est à dire qu'ils ne restent pas autonomes, distingués, juxtaposés à côté d'autres indigènes, pour manifester des relations entre colonie et métropole, mais ils sont assimilés de façon particulière pour servir à divers besoins de conjoncture, et souvent même à des impératifs sociaux non-correspondants.
Entre les deux guerres à Athènes et à Salonique, l'architecture du centre historique exprime les choix esthétiques des classes aisées, et l'école française s'impose par sa présence, puisqu'elle assure le choix des élites. Par contre après la 2e guerre mondiale, l'émergence des couches petites bourgeoises impose un changement à la manière dont se produit l'espace urbain, dû aux besoins pressants de loger les immigrés de l'exode rural. Le nouveau mode de production de l'architecture ne peut plus se permettre la sensibilité et l'imagination des techniciens de l'entre-deux-guerres. Α l'espace d'une génération les belles maisons de rapport des années 1920, se voient substituées par des immeubles sans imagination et de goût médiocre, malgré leur plus grand volume. L'époque' des visions et des idées séduisantes, provenant des capitales occidentales, semble plus ou moins révolue...
Bibliographie
Ancel J. (1921) Les travaux et les jours de l’Armée de l'Orient. Ed. Bossard, Paris Ancel J. (1930) La Macédoine. Son evolution contemporaine. Lib. Delagrave, Paris O Biris Κ. (1957) Ι' histoire de l'Ecole Polytechnique Nationale. Athènes (en grec) Choay F. (1970) "Urbanisme" Encyclopaedeia Universalis Delorme J.-C. (1981) "Des plans d’aménagement et d'extension des villes françaises". Cahiers de la
Recherche Architecturale no 8, Αvril Filippidis D. (1984) Architecture de la Grèce moderne. Ed. Melissa, Athènes (en grec) Filippidis D. (1988) "La modernisation de l'architecture et d'urbanisme d' entre deux-guerres". Actes
du colloque: Ε. Venizelos et modernisation bourgeoise en Grèce. Presses Universitaires de Crète, Iraclio (en grec)
Kafkoula Κ. (1990) La cité-jardin et l'urbanisme grec d'entre-deux-guerres. Thèse de doctorat, Ecole d' Architecture, Université Aristote de Salonique (en grec)
Κitsikis Κ. (1919) Les aspects architecturaux du nouveau plan de Salonique. Athènes (en grec) Marmaras Μ. (1987) "Les immeubles de rapport à Athènes d'entre-deux-guerres". Architectonica
Themata no 18 (en grec) Pleyber J. (1934) Le problème de l' habitation à Salonique et à la campagne. Salonique Saias J. (1920) Salonique en reconstruction. Impr. de l' "Opinion", Athènes Taylor Br. (1982) "Discontinuité planifiée, villes coloniales modernes au Maroc". Cahiers de la
Recherche Architecturale no 9, janvier Vitopoulou A., Yerolympos A. (2002) "Le projet du campus universitaire de Thessalonique.
L’importance d’un dessein de longue haleine", Thessaloniki. Annales scientifiques du Centre d’Histoire de Thessalonique de la Municipalité de Thessalonique, vol. 6, Thessalonique, pp. 273-291 (en grec).
Wright G., Rabinow Ρ. (1982) "Savoir et pouvoir dans l'urbanisme moderne colonial d'Ernest Hébrard". Cahiers de la Recherche Architecturale no 9, janvier
Yakoumis H., Yerolympos A., Pédelahore de Loddis (2001) Ernest Hébrard 1875-1933. Ed. Potamos, Athènes (en grec et français).
14
Υerolympos Α. (1985-86) La reconstruction de Salonique après l'incendie de 1917. Edition de la Ville de Salonique
Yerolympos Α. (1988) "Salonique 1890-1917, les chemins d' occidentalisation". Actes du colloque Ville Régulière. Ed. Picard, Paris (sous presse) Yiakoumakatos Α. (1987) "L'architecture scolaire et le modernisme en Grèce d'entre-deux-guerres".
Architectonica Themata no 18 (en grec)