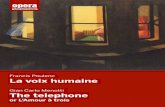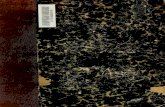Analyse de la locomotion humaine: exploitation des propriétés ...
Indices de fréquentation humaine dans les grottes à ours au Paléolithique moyen final
Transcript of Indices de fréquentation humaine dans les grottes à ours au Paléolithique moyen final
Article original
Indices de frequentation humaine dans les grottes a
ours au Paleolithique moyen final
L’exemple de la Caverna Generosa dans les
Prealpes lombardes, Italie
Bear-caves with indexes of anthropic occurrences
in the final Middle Palaeolithic
The case of Caverna Generosa in the
Lombard Pre-Alps, Italy
Fabio Bona a, Marco Peresani b,*, Andrea Tintori a
a Dipartimento di Scienze della Terra, Universita di Milano I, Via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italieb Dipartimento di Biologia ed Evoluzione, Universita di Ferrara, Corso Ercole I d’Este 32, 44100 Ferrara, Italie
Disponible sur Internet le 20 juin 2007
Resume
Connue comme un gisement paleontologique fortement frequente par l’ours des cavernes, la Caverna
Generosa a livre au cours des recherches recentes des indices discrets de frequentation anthropique
rapportables au Paleolithique moyen final. La caverne s’ouvre a 1450 m d’altitude sur le versant meridional
abrupt du massif du Monte Generoso, entre le Lac de Lugano et le Lac de Come, et se presente comme un
complexe de galeries etroites et de chambres internes. Les donnees sedimentologiques, paleontologiques et
un ensemble de dates radiocarbone situent les frequentations animales et humaines dans la premiere partie
du stade isotopique 3. Elles temoignent du passage d’une phase climatique relativement froide et aride a une
phase plus temperee et humide, avec une transformation progressive des environnements, de faiblement
arbores a arbores riches en arbustes et vegetation de sous-bois avec de rares zones ouvertes. De rares eclats
decouverts disperses et dans certains cas profondement alteres par des phenomenes postdepositionnels
temoignent d’une serie d’incursions de Mousteriens equipes d’objets acheves et de quelques blocs bruts en
radiolarite preleves a faible distance de la cavite. Les objets acheves demontrent une segmentation
http://france.elsevier.com/direct/ANTHRO/
L’anthropologie 111 (2007) 290–320
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (M. Peresani).
0003-5521/$ – see front matter # 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
doi:10.1016/j.anthro.2007.05.003
spatiotemporelle de la chaıne operatoire, alors qu’il n’est pas exclu que les blocs de radiolarite aient ete
travailles a l’entree du site ou a proximite pour obtenir des outils rudimentaires destines a etre utilises
immediatement. Il convient de souligner le desinteret total pour les plaquettes de silex contenues dans le
calcaire de Moltrasio, aux depens duquel est creusee la cavite. La Caverna Generosa se place dans la
categorie des habitats-refuges de duree plus ou moins limitee, conditionnes par des contrastes altitudinaux et
bioclimatiques, qui pourraient s’integrer a une dynamique de deplacements saisonniers au sein des Prealpes
lombardes occidentales.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
Abstract
Already known like a palaeontological site for the study of Ursus spelaeus, Caverna Generosa also
records ephemeral traces of human visits during the late Middle Palaeolithic. The cave opens at an altitude
of 1450 m on the steep southern slope of the Monte Generoso Massif between the Lugano and the Como
lakes and forms a complex group of narrow galleries and inner chambers. Sedimentological and
palaeontological data and radiocarbon dates place both the cave-bear and the human frequentations in
the first part of the isotopic stage 3 with climatic conditions shifting from cool and dry to more temperate and
wet. Environment progressively changed from scarcely arboreal to arboreal-brush with small open spaces.
Few flakes and Levallois flakes have been recovered scattered in the sediment and affected in most cases by
intense postdepositional alteration. These items testify incursions of mousterian groups equipped with end-
products and radiolarite flakes struck from blocks provisioned at lower locations southwards. End-products,
namely Levallois flakes, prove that lithic reduction sequences were spatiotemporally fractionated in the
covered territory. Conversely, it cannot be excluded a priori that sublocal radiolarite has been chipped at the
entrance of the cave or at the very close surroundings for extraction of rudimental tools for immediate use. It
is worth to mention that the small chert slabs in the Moltrasio limestone which crop throughout the cave
walls were totally ignored. Caverna Generosa can be viewed as a refugia-location used in function of more
or less constrained factors strongly influenced by high-altitude and bioclimatic situations. This type of site
might well be integrated within the seasonal movements of humans in the western Lombard Pre-Alps area.
# 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits reserves.
Mots cles : Paleolithique moyen ; Alpes italiennes ; Ensemble lithique ; Frequentation humaine
Keywords: Middle Paleolithic; Italian Alps; Lithic assemblage; Human occurrence
1. Presentation
L’existence de sites specialises, campements temporaires dedies a la production lithique, aux
activites cynegetiques ou a d’autres pratiques habituelles des cycles de subsistance, constituent
l’une des principales sources d’information pour la reconstitution des modalites d’occupation du
territoire au Mousterien. Le cadre general est eventuellement complete par d’autres sites
complementaires, mieux connus comme installations complexes, parfois sujets a une
plurifrequentation, dans tous les cas lieu ideal pour l’accomplissement de pratiques diverses
allant de la consommation a la transformation totale, partielle ou integree des matieres premieres.
Des schematisations excessives appliquees a la realite archeologique ne mettent toutefois pas en
valeur de facon adequate ces contextes marginaux, qu’il convient d’interpreter comme des sites
« etape » a frequentation ephemere, dont la fonction apparaıt parfois evanescente ou, en tout cas,
difficile a inscrire dans une activite organique et compartimentee. Il a ete souligne a differentes
occasions (Foley, 1981 ; Isaac, 1981 ; Roebroecks et al., 1996) que l’analyse des ensembles
d’objets lithiques de faible densite pouvait fournir des elements caracteristiques pour demontrer
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 291
l’existence d’un systeme plus general, ou la presence anthropique s’integre apportant des
segments d’activites nettement disloquees sur un plan spatiotemporel.
Connues egalement comme localite a « indices » de frequentation anthropique, certaines
grottes repaires ou gisements a Ursides pleistocenes se distinguent au sein de cette categorie par
la presence de sols et de niveaux d’occupation animale superposes ou alternes a des traces
furtives de la presence humaine. De tels contextes impliquent une interpretation plus
problematique et pourraient correspondre a un modele d’acquisition comparable. La
frequentation humaine apparaıt extremement discrete et, par consequent, est difficile a montrer
(Brugal et Jaubert, 1991) : dans certains cas elle a ete interpretee comme le resultat d’une etape
integree dans un systeme plus actif d’occupation du territoire, repondant a la mise en pratique de
strategies, structurees par une anticipation des besoins (Peresani et Porraz, 2004; Porraz et
Peresani, 2006).
Si l’on considere la region alpine, les donnees demontrent que l’occupation anthropique s’est
adaptee par le passe aux conditions topographiques et ecologiques particulieres du territoire
montagnard et a la situation d’extreme dispersion critique des ressources. Les systemes
d’occupation peuvent donc avoir structure leur organisation logistique selon une dislocation
verticale des activites economiques, impliquant des relations plus intenses que dans d’autres
contextes. La visibilite des activites economiques apparaıt comme le principal element
d’incertitude dans cette situation, surtout dans les zones altimetriquement plus elevees — limites
materielles d’un territoire economique ou « de subsistance » — ou les facteurs de biais ont
contribue a en reduire et en morceler le contexte. De ce point de vue, l’apport scientifique des
sites d’altitude est encore limite. Explorees depuis longtemps, certaines grottes des Alpes
autrichiennes, suisses et francaises ont livre des preuves encore discutees de la presence
anthropique au Paleolithique moyen (pour une revision critique, voir Jequier, 1975). Utilisees
essentiellement comme sites d’hibernation animale, ces cavites conservent des traces
d’occupation humaine jusqu’a des altitudes elevees et en general se presentent comme des
lieux d’activites diversifiees. Les gisements frequentes par l’ours des cavernes offrent un cas
particulier dans la mesure ou ces mammiferes presentent un comportement specifique, avec une
periode d’hibernation tres longue, cause de mortalite parmi les individus les plus faibles, qui
limiterait les possibilites de frequentation anthropique pour les cavernes homeothermiques a une
certaine periode de l’annee — de la fin du printemps au debut de l’automne — si l’environnement
microclimatique du site le permet. L’ours des cavernes n’est pas connu comme accumulateur
d’ossements, meme si certaines especes d’herbivores lui sont parfois associees dans les memes
gisements. Les preuves de l’action humaine sur ces accumulations sont absentes ou en tout cas se
montrent difficiles a mettre en evidence du fait de la complexite des processus taphonomiques
survenus en surface ou au sein des depots sedimentaires. Nous serions neanmoins enclins a
supposer que les hommes ont exerce une action tres discrete sur ces ensembles ou bien que les
traces de leur passage a ete extremement appauvri. Une etude traceologique peut reveler des
informations sur l’emploi d’outils lithiques, mais ne demontrerait pas necessairement leur
association avec les restes squelettiques (Brugal et Jaubert, 1991). Si l’on fait abstraction de leur
faible visibilite, ces milieux s’integrent a un systeme d’occupations en plein air ou en grotte qui
atteste l’exploitation de certaines entites territoriales telles que les massifs alpins (Bernard-
Guelle, 2002a), ou l’acquisition des matieres premieres lithiques locales figure comme une des
activites specialisees (Bernard-Guelle, 2002a ; Jequier, 1975).
L’etude qui suit tend a souligner l’importance des sites a « indices » d’occupation humaine au
Paleolithique moyen final en presentant la Caverna Generosa, cavite sujette a une importante
frequentation par les Ursides, comme un cas particulier dans le systeme d’implantation des
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320292
Prealpes centrales italiennes. Dans un territoire ou la visibilite de l’implantation est reduite,
l’occurrence anthropique en contexte montagnard se presente comme un evenement accidentel,
interpretable comme une « etape » dans le cadre d’incursions destinees a satisfaire des objectifs
specifiques dans un paysage « difficile », avec des ressources lithiques rares et peu adaptees. Ce
cas de figure est unique pour la region examinee et pour l’ensemble du secteur meridional de l’arc
alpin.
2. Cadre physiographique
La Caverna Generosa se situe dans les Prealpes lombardes, a cheval sur la limite meridionale
du Canton du Tessin, coincee entre deux grands lacs alpins, le Lac de Lugano a l’ouest et au nord-
ouest et le Lac de Come a l’est, au-dela duquel s’elevent les Grigne et le Resegone. Vers le sud-
ouest s’etend la plaine du Po (Fig. 1). La grotte s’ouvre a 1450 m au-dessus du niveau de la mer
sur le versant italien du Monte Generoso, le principal sommet (1701 m) du Massif du Generoso,
dans l’ensemble de monts situes entre Come et Lugano. Quatre vallees principales parcourent ce
massif : la Valle di Salorino, le Val Maira, la Valle della Sovaglia et la Valle di Muggio sur le
versant meridional. Cette derniere est parcourue par le torrent Breggia, affluant du Lario dans
lequel il se jette a Cernobbio (Felber, 1993).
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 293
Fig. 1. Localisation de la Caverna Generosa et des trois autres sites avec industrie mousterienne dans les Prealpes
lombardes. 1. Grottes del Monfenera ; 2. Caverna Generosa ; 3. Bagaggera ; 4. Haut Plateau des Cariadeghe.
Fig. 1. Position of Caverna Generosa and other mousterian sites in the Lombard Alps. 1. Caves in Monfenera Mount;
2. Caverna Generosa; 3. Bagaggera; 4. Cariadeghe High Plateau.
La region comprise entre le Lac de Come et le Lac de Lugano est formee d’une serie de monts
caracterises par des versants abrupts separes par des vallees etroites. Le Monte Generoso, situe au
centre de cette zone, est caracterise morphologiquement par une paroi occidentale verticale, de
direction nord–sud, d’environ 500 m de denivellation et qui represente le premier saut
orographique entre le sommet et le Lac de Lugano. Depuis la base de cette paroi, une serie de
reliefs moindres s’etagent jusqu’aux rives du lac, a environ 280 m d’altitude. A l’est, il est
possible de rejoindre le bassin occupe par le Lac de Come en parcourant d’abord le versant
oriental escarpe du mont (Fig. 2) jusqu’a intercepter le torrent Breggia, pour rencontrer ensuite le
relief escarpe du Monte Crocione (1491 m) auquel fait suite, apres une autre descente rapide le
long du versant oriental, le Val di Erbaggia qui s’introduit dans le Val d’Intelvi pres de Dizzasco
(506 m). De la, en suivant le torrent Telo, on rejoint le lac pres d’Argegno. En partant de l’entree
de la grotte, en se deplacant parallelement a la Valle della Breggia vers le nord-est et en restant sur
la ligne de crete du Monte Generoso, on rejoint facilement l’Alpe d’Orimento par differents
replats structuraux dominants qui offrent un bon point de vue sur toute la region. Lorsqu’on
depasse l’Alpe, a travers la Vallaccia, vallee fermee, mais aisement praticable, on rejoint la Valle
d’Intelvi pres de Peglio d’Intelvi, d’ou, en se dirigeant vers le nord-ouest le long de la Valle
d’Osteno, on peut atteindre sans difficulte le Lac de Lugano. Toujours depuis Peglio d’Intelvi
mais en se dirigeant vers le sud-est le long de la Valle d’Intelvi, on rejoint le Lac de Come. Vers le
sud, en suivant la Valle Breggia, on rejoint facilement la plaine du Po.
Un ensemble d’importants accidents tectoniques (failles, chevauchements) a genere dans cette
region des plissements et de profondes fracturations des formations carbonatees, avec
developpement consecutif des cavites d’effondrement et des cavites karstiques (Bini et Cappa,
1975 ; Felber, 1993). Le karst repandu est particulierement developpe dans les substrats
carbonates du Monte Generoso, avec formation tant de structures karstiques de surface, telles que
les dolines et les lapies (karrenfelder), que souterraines, principalement des cavites horizontales,
plus rarement verticales. Les grottes decouvertes a ce jour sont relativement nombreuses (plus de
36), de meme que les systemes complexes de conduites internes qui forment un vaste reseau de
galeries pour le systeme de drainage a conduites subhorizontales. De nombreuses sources
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320294
Fig. 2. Photo du versant ou s’ouvre la Caverna Generosa.
Fig. 2. The slope where Caverna Generosa opens.
jaillissent au niveau des accidents tectoniques (Linea de Lugano et Linea du Generoso).
Considerant que le Generoso n’a pas ete couvert par les glaciers pleistocenes, on presume que la
morphologie karstique s’est mise en place a partir du Tertiaire (Bini et Cappa, 1975), de facon
analogue a ce que l’on rencontre dans le proche territoire de Come.
2.1. Geologie du bassin du Generoso et ressources lithiques
La region comprise entre les deux lacs est formee presque entierement par des roches
carbonatees sedimentees dans la fosse du Generoso au cours du Lias et reposant au nord sur la
Dolomie a Conchodon et sur les puissants facies de bassin du Norique-Rhetique (Trias
superieur). Le depocentre correspond precisement au Monte Generoso ou sont presents plusieurs
centaines de metres de calcaire de Moltrasio (Lombardische Kieselkalk des auteurs
germanophones) qui constituent la majeure partie du massif qui surplombe les deux lacs
d’environ 1500 m (Fig. 3). Les roches triasiques affleurent par une petite bande sur le versant
suisse le long de la route qui remonte vers Arogno, tandis que les unites plus recentes (Jurassique
superieur — Cretace) sont presentes dans les environs de Bellavista dans la partie inferieure de la
Valle della Breggia, pres de Morbio Inferiore (Bernoulli, 1964 ; Pasquare, 1978).
La sequence du calcaire de Moltrasio se compose de calcaires plus ou moins marneux, gris
sombre, souvent spongolithiques, avec de rares niveaux calcarenitiques et de frequents nodules de
silex noir, d’ou le nom de « silexifere Lombard » donne par le passe a cette unite. La stratification est
bien developpee et les strates ont des epaisseurs qui varient de moins d’un centimetre, mais soudees
en bancs quasiment distincts comme vers le sommet du Generoso et dans la partie au sein de
laquelle est creusee la cavite, jusqu’a un metre. Souvent, surtout dans la partie inferieure de la
formation, des slumping sont visibles, temoignant de l’instabilite du pendage durant le depot. Au-
dessus du calcaire de Moltrasio se trouve la formation de Morbio et donc les marnes rouges
nodulaires identifiees comme Rouge a Ammonites Lombard. Une lacune stratigraphique separe la
serie liasique et mesojurassique initiale de la formation du Jurassique superieur representee ici par
des radiolarites. Ces dernieres sont composees de couches de radiolarite rouge brique qui affleurent
le long de la gorge de la Breggia a 300 m d’altitude et a 9 km de distance de la grotte, autour du
Bellavista entre l’Alpe de Salorino et l’Alpe de Mendrisio sur une surface d’environ 1 km2, entre
900 et 1200 m d’altitude. Aux radiolarites se superpose le Rouge a Aptychus, une formation de
marnes et calcaires marneux rouges ou verdatres, finement stratifies, plus ou moins riches en silex, a
laquelle succedent enfin les calcaires pelagiques bien stratifies de la Maiolica, contenant des
nodules et des plaquettes de silex du blanc jaunatre au gris clair. Cette meme sequence affleure
largement sur les pentes du massif dans les gorges de la Breggia, aux alentours du Morbio.
Les radiolarites du calcaire de Moltrasio sont donc extremement abondantes dans les substrats
du Monte Generoso. Elles constitueraient une eventuelle source d’approvisionnement primaire,
dont les caracteristiques morphologiques et rheologiques maintiennent toutefois subordonne un
eventuel interet economique pour leur emploi lors de la production lithique. Dans la sequence, les
radiolarites sont presentes sous forme de fines plaquettes, avec une teneur en silicates
extremement variable, jusqu’a devenir exclusive. L’epaisseur varie a l’echelle de quelques
centimetres et le reseau dense de stratifications et de fissures en favorisent l’intense
fragmentation, produisant des plaquettes caracteristiques formees d’un niveau a silex encadre par
deux niveaux a composition carbonato-siliceuse. Les radiolarites de Bellavista et de la Breggia
contiennent des lits et de gros nodules rouge brique parcourus par des veines decolorees qui
courent le long d’anciennes lignes de fracture cimentees. Du fait de ce reseau dense, les nodules
tendent a se fracturer en debris anguleux finement tachetes et dans certains cas ils conservent des
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 295
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320296
Fig. 3. Cadre geologique du Monte Generoso et du Lac de Lugano avec position de la grotte. Legende : 1 - depot
quaternaires ; 2 - Eocene ; 3 - Cretace ; 4 - Jurassique superieur ; 5 - Jurassique moyen ; 6 - Jurassique inferieur ; 7 - Triasique ;
8 - porphyrites ; 9 - socle cristallin ; 10 - failles principales ; 11 - chevauchements ; 12 - agglomerations.
Fig. 3. Geologic sketch map of Generoso Mount and Lugano Lake showing the position of the cave. Key: 1 - Quaternary
deposits; 2 - Eocene; 3 - Cretaceous; 4 - Upper Jurassic; 5 - Middle Jurassic; 6 - Lower Jurassic; 7 - Triassic; 8 - Porfirites;
9 - crystalline socle; 10 - main faults; 11 - overthrusts; 12 - urban agglomerations.
portions compactes qui ne s’opposent pas au developpement de la fracture conchoıdale et qui
autorisent la mise en œuvre d’un schema de debitage organise.
3. La Caverna Generosa
La Caverna Generosa est formee d’un ensemble de cavites qui se developpent sur un total de
200 m dont seulement les soixante-dix premiers conservent des depots stratifies (Fig. 4). L’entree
debouche dans une galerie initiale longue d’environ 25 m, qui etait pratiquement entierement
obstruee par les sediments au moment de la decouverte ; seul un petit passage permettait d’acceder a
une premiere salle, dite « Petite Salle », d’une extension d’environ 4 � 3 m pour 5 m de haut. De la
« Petite Salle » on accede par un siphon etroit a une salle plus grande, la « Salle Terminale » d’un
diametre moyen de 8–9 m pour environ 8 m de haut, et ou furent decouverts les premiers restes
d’Ursus spelaeus. Dans cette salle, un role important est joue par une vaste niche qui s’ouvre dans le
secteur sud, et dans laquelle ont ete rencontres des caracteres sedimentologiques differents et d’ou
provient un des vestiges lithiques. A la hauteur de la « Petite Salle » et de la « Salle Terminale » on
peut noter des structures qui temoignent de phases de dissolution karstique survenues
anterieurement a la formation de la portion souterraine interessee par la fouille paleontologique.
Il s’agit de deux conduits a section circulaire, d’environ trois metres de diametre et a developpement
subhorizontal, recoupes par l’hypogee posterieur avec un angle d’environ trente degres. Ces deux
conduits secondaires ne contiennent que des sediments residuels, a l’exception de la branche nord
de la « Salle Terminale », qui se developpe sur plus de 70 m, utilisee comme lieu d’hibernation et de
deces par les ours. La presence de deux cheminees verticales est egalement a souligner : l’une se
trouve dans la partie nord de la « Petite Salle » et l’autre dans la niche sud de la « Salle Terminale ».
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 297
Fig. 4. Planimetrie de la Caverna Generosa avec les secteurs fouilles et la position des vestiges lithiques. 1 - detail de la
zone fouillee dans la « Salle Terminale » ; 2 - detail de la zone fouillee dans la Petite Salle et le siphon.
Fig. 4. Map of Caverna Generosa showing the excavated sectors and the lithic pieces recovered. 1 - detail of the area
explored in the ‘‘Terminal Room’’; 2 - detail of the area explored in the ‘‘Little Room’’ and the Siphon.
Par ces cheminees pourraient arriver des sediments de structure inconnue formes dans des reseaux
karstiques situes a un niveau superieur a celui de la Caverna Generosa. L’apport de materiel paraıt
tres probable, surtout par la deuxieme cheminee.
3.1. Decouverte, fouille et recherches
Le gisement paleontologique fut decouvert au cours de l’ete 1988 par deux speleologues de
l’association speleologique Suisse, section du Tessin, qui recueillirent les premiers vestiges
osseux d’Ursides a la surface du remplissage. Cette recolte, sans distinction et depourvue de tout
enregistrement, rendit toutefois impossible le releve et l’analyse taphonomique de la surface de
frequentation animale originelle. Les premieres etudes consacrees aux restes d’Ursus spelaeus et
d’Ursus arctos ont ete realisees par Fusco a qui revient egalement le merite d’avoir obtenu la
premiere date radiocarbone de 38 200 � 1400 ans BP (UZ2429, ETH 4249) (Fusco et Visconti
Di Modrone, 1989).
En 1991, le departement des sciences de la terre de l’universite des etudes de Milan effectua
quelques essais de fouille pour verifier l’importance des depots, en vue de mettre en place un
programme de recherches paleontologiques a long terme. Compte tenu des resultats positifs de
ces evaluations, au cours des annees qui ont suivi furent conduites quelques campagnes de fouille
qui, du fait des difficultes d’acces a la « Salle Terminale » et de moyens financiers limites,
connurent les premieres annees des rythmes variables d’avancement des travaux. De 1999 a
2004, les recherches se sont poursuivies de facon continue grace a l’importante intervention de
fouille realisee en 1998 dans la partie comprise entre l’entree et le debut de la « Salle Terminale »
(Bona, 2003). Parmi les interventions successives, cinq ont ete realisees dans la « Salle
Terminale » et une dans la portion de la galerie d’acces comprise entre la premiere petite salle et
le siphon sur un total de 9 m, a partir de 25 m de distance depuis l’entree de la cavite.
Les vestiges lithiques decrits dans cette contribution et les nombreux restes squelettiques,
parfois rencontres sous forme de concentrations d’interet taphonomique, ont ete recueillis dans la
galerie d’acces et dans la « Salle Terminale ». Des echantillons ont ete preleves pour les analyses
sedimentologiques et des sediments ont ete recueillis pour recuperer les restes de
micromammiferes (Bona, 2003, 2004a, 2004b) apres tamisage (maille de 1 mm). A l’issue
de la derniere campagne de fouille (2004), le nombre total de vestiges lithiques est de six. Le
systeme de carroyage est de 1 � 1 m dans toute la cavite, sauf dans la « Salle Terminale », ou il
est de 1 � 0,5 m.
S’agissant d’une recherche paleontologique, l’accent a ete mis sur la reconstitution des
processus sedimentaires et taphonomiques ayant conduit a la formation du remplissage, sur la
paleoecologie des macro- et micromammiferes et sur l’etude de la population d’Ursus spelaeus,
espece representee ici par plus de trente mille restes et par environ 450 individus (NMI).
3.2. Stratigraphie du secteur « Petite Salle – Siphon »
Les depots situes dans le secteur compris entre la « Petite Salle » et le siphon ont ete explores
sur une epaisseur totale d’environ 1,50 m ; dans la « Petite Salle », l’espace entre la surface du
remplissage et le plafond est de 3–4 m alors que le siphon etait entierement obstrue au moment de
la decouverte. Les depots sont subdivises en neuf unites, differenciees sur des bases lithologiques
et qui presentent dans certains cas des caracteres taphonomiques prononces lies a la bioturbation
animale : terriers de marmottes effondres avec elements squelettiques en connexion, os semi
verticaux, surtout dans les niveaux 2C, 5aC, 6C et 7C (Bona, 2004b).
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320298
La sequence stratigraphique se compose ainsi (Fig. 5) :
Niveau 0C : epaisseur maximale 40 cm, franc argileux, 10YR4/3, pierres angulaires 2–3 cm,
rares blocs.
Niveau 1C : epaisseur 25–26 cm, argilo-limoneux, 2,5Y6/4, pierres rares subangulaires
7–8 cm, massif, humide, ne reagit pas a HCl 5 %, petites taches (2,5Y6/6),
presence d’os a la base.
Niveau 2C : epaisseur 33–34 cm, limono-argileux, 2,5Y4/4, pierres rares, structure granulaire
peu developpee, non-poreux, humide, ne reagit pas a HCl 5 %, depourvu de
taches.
Niveau 3C : breche incoherente a support clastique avec des elements de 10–15 cm, argilo-
limoneux, agregats grumeleux argileux de 1–2 cm, poreux, humide, ne reagit pas a
HCl 5 %, depourvu de taches, epaisseur d’environ 40 cm.
Niveau 4bC : incline vers l’exterieur de la cavite, argileux, 2,5Y5/6, petites pierres angulaires,
structure polyedrique medio-fine, depourvu de macrospores, humide, ne reagit pas
a HCl 5 %.
Niveau 4C : limono-argileux, 10YR3/4, pierres angulaires 10–12 cm avec diminution de taille
vers la base, agglomeration polyedrique fine, non-poreux, humide, ne reagit pas a
HCl 5 %, taches (10YR 7/4), presence d’ossements.
Niveau 5aC : argilo-limoneux, 2,5Y5/4, pierres angulaires (10–15 cm) plus petites a la base, os
longs.
Niveau 5C : argilo-limoneux, 2,5Y5/4, pierres communes (7–8 cm), agglomeration polye-
drique grumeleuse de fine a moyenne, micropores diffus, humide, ne reagit pas a
HCl 5 %, laminations, patine d’argile diffuse 10YR4/2, nombreux os et gros
fragment de crane en carre 29.
Niveau 6C : epaisseur 7–12 cm, limono-argileux, 10YR4/4, pierres subangulaires (7–8 cm),
agglomeration polyedrique grumeleuse de fine a moyenne, humide, ne reagit pas a
HCl 5 %, pas de taches.
Niveau 7C : breche dissoute a support clastique, matrice argilo-limoneuse, 10YR3/3,
agglomeration polyedrique grumeleuse fine, non-poreux, humide, ne reagit pas
a HCl 5 %, pas de taches, presence d’os, avec accumulations et alterations dans les
secteurs 30–31, matrice bioturbee (terriers) par endroits.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 299
Fig. 5. Coupe stratigraphique des depots de la Petite Salle et du siphon.
Fig. 5. Stratigraphy of the deposits observed in the ‘‘Little Room’’ and the Siphon.
3.3. Stratigraphie de la « Salle Terminale »
La stratigraphie de la « Salle Terminale » est tres complexe et caracterisee par des variations
lithologiques et geometriques des unites sedimentaires qui la composent. L’epaisseur globale
analysee a ce jour est de 2,50 m ; si l’on tient compte du fait que le fond de la salle n’a ete atteint
que dans le secteur nord-est, l’espace entre la surface des depots et le plafond de la cavite est de
5–6 m. La sequence comprend 12 niveaux (Fig. 6) decrits comme suit (Bona, 2004b) :
Niveau 1 : epaisseur de 60 a 10 cm, limoneux, 10YR5/3, pierres angulaires 6–7 cm, parfois de
dimensions plus importantes.
Niveau 2 : epaisseur d’environ 20 cm, argileux, 10YR4/6, pierres arrondies de 5 cm de
diametre, rares vestiges paleontologiques.
Niveau 3 : epaisseur maximale de 25 cm, 10YR5/4, rares pierres alterees de 4–5 cm, presence
de vestiges paleontologiques.
Niveau 4 : epaisseur de 10 a 40 cm, 10YR5/8, pierres de 5 cm, presence de fantomes argileux
gris-bleu de pierres calcaires alterees, presence de vestiges paleontologiques.
Niveau 5 : epaisseur 20–50 cm, 10YR4/3, presence de nombreuses pierres alterees hetero-
metriques surtout pres de la paroi rocheuse, grandes lentilles organiques, tres riche
en os dans des etats de conservation varies.
Niveau 6 : epaisseur 30 cm, 10YR4/4, pierres de 6–7 cm, limite superieure irreguliere, presence
de grandes lentilles organiques, tres riche en os meme en connexion anatomique.
Niveau 8 : epaisseur 12–20 cm, argileux, 10YR4/4–3, pierres de 15 cm au maximum, presence
de restes osseux en mauvais etat de conservation.
Niveau 9 : epaisseur 12–20 cm, argilo-limoneux, 10YR4/4, pierres subordonnees en calcaire
altere de 5–6 cm au maximum, legere orientation vers la paroi sud-ouest, presence
de vestiges paleontologiques.
Niveau 10 : epaisseur 12–18 cm, argileux, brun sombre, 10YR4/4, tres grandes pierres de
20–30 cm au maximum, vestiges paleontologiques varies.
Niveau 11 : epaisseur d’environ 16 cm, argileux, 10YR4/4, pierres predominantes de 10–12 cm
au maximum, agregats de 3–4 mm au maximum, legere orientation vers le sud-
ouest, ou le contenu argileux augmente et prend une couleur plus jaunatre.
Niveau 12 : argileux, 10YR4/4, pierres de 2–3 cm au maximum, decimetriques pour certaines,
agregats moyens a fins.
Dans les secteurs de E a L, les caracteristiques sedimentologiques sont substantiellement
differentes de celles de la zone centrale de la « Salle Terminale ». Pour cette raison, les niveaux y
ont ete decrits avec une nomenclature differente (Fig. 7). Les principales caracteristiques
observees sont presentees ci-dessous :
Niveau A : epaisseur 15 cm au maximum, limono-argileux, vides entre les pierres, agregats de
1 cm au maximum, pierres anguleuses de 30 cm au maximum, restes osseux epars.
Niveau B : epaisseur variable de 30 cm au maximum, limono-argileux, moins limoneux que le
niveau A, pierres de 10 cm au maximum, restes osseux.
Lentille 1 : limoneux, pierres anguleuses alterees de 15 cm au maximum, agregats de 1 cm au
maximum, vides entre les granules, disparaient vers la fin du secteur 10.
Niveau C : fin, limono-argileux, mais avec plus de limon que le niveau B, pierres rares
et alterees de 3–4 cm au maximum, presence de restes d’Ursus spelaeus.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320300
Niveau D : couleur brune, argilo-limoneux, rares pierres de 4–5 cm au maximum, frequentes
taches rouge brique, frequents restes osseux surtout d’Ursus spelaeus.
Si l’on observe la stratigraphie en direction du sud-ouest, toujours dans les memes secteurs
E–L, le niveau A presente differentes variations laterales :
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 301
Fig. 6. Variations le long de la sequence stratigraphique de la « Salle Terminale » de certains parametres sedimento-
logiques. I : rapport entre sables et somme des limons et argiles ; II : rapport entre mineraux opaques et transparents ; III :
indice d’alteration des mineraux lourds.
Fig. 6. Variation of certain sedimentary parameters along the stratigraphic sequence at the ‘‘Terminal Room’’. I: rate
between sand and silt + clay sum; II: opaque/transparents minerals rate; III: weathering index of heavy minerals.
Niveau A cp : (a partir du metre 14) caracterise par l’absence de matrice et la presence de rares
agregats d’un diametre d’environ 1,5–2 cm. Les pierres presentes sont
directement en contact et forment des vides (structure clasto-soutenue). Ces
pierres presentent un diametre moyen d’environ 7–8 cm. Il semble s’agir d’un
niveau appauvri en matrice par lessivage. Vers le sud, la fraction fine augmente
en quantite et forme la matrice entre les pierres.
Niveau A cp1 : (a partir du metre 14) il presente les memes caracteristiques que le niveau A cp,
mais avec une rubefaction de la matrice. Les deux niveaux sont en contact lateral
entre les secteurs H14 et I14 ; en I14 le niveau A cp1 se trouve au-dessus de A cp.
En outre dans les deux secteurs entre H14 et I14 et entre H13 et I13, le niveau
superieur presente par endroits une importante composante argileuse (Niveau A
bis) avec de rares pierres de 2 cm au maximum.
3.4. Analyse des sediments
L’etude des processus de formation des depots du remplissage s’est basee sur l’analyse de la
sequence consideree comme la plus representative de l’ensemble de l’histoire sedimentaire de la
cavite. Les echantillons preleves dans la « Salle Terminale » carre MGB6, ont ete analyses pour
les granulometries selon une methode de routine et les determinations des mineraux lourds dans
la fraction 180–63 m separes par liquide (Bona, 2004b).
Les composants de la fraction grossiere sont essentiellement des graviers anguleux marneux a
surfaces decarbonatees et des graviers siliceux subarrondis et anguleux. D’un point de vue
petrographique, cette fraction est constituee d’elements caracteristiques de la formation du
Moltrasio (Rossi et al., 1991) et enregistre des pourcentages variant entre 6 et 41 %. Le
pourcentage le plus important (41 %) correspond au niveau 1, tandis que les valeurs minimales se
retrouvent dans les niveaux 3, 4 et 5 (respectivement, 6,7 et 7 %). Dans tous les niveaux, le
materiel fin est preponderant avec un pourcentage moyen de 84,1 %.
La texture est resolument limoneuse (de 64 a 80 %) avec un contenu en sable et argile
similaire (11–18 %), sauf pour les niveaux 2 et 3 qui presentent une faible proportion d’argile
(5 %) (Bona, 2004b) (Figs. 6 et 8). Les indices granulometriques indiquent une faible dispersion
bimodale pour les sediments et des differences granulometriques du materiel fin, dues
principalement a differentes phases de colluvionnement : les niveaux 1, 4, 8 et 11 semblent avoir
un contenu en argile plus eleve (respectivement, 18, 20, 20 et 18 %) par rapport aux autres
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320302
Fig. 7. Stratigraphie des secteurs E-L. I : situation correspondante des secteurs F11 et F12 ; II : detail des variations
laterales du niveau A dans le secteur I 14, noter l’emplacement ou a ete decouvert le vestige 3.
Fig. 7. The sedimentary succession explored in sectors E-L. I: situation viewed in sectors F11 and F12; II: detail on the
lateral variations of level A in sector I 14, note the place were lithic artefact n8 3 was recovered.
niveaux, comme le montrent egalement les faibles rapports limon/argile (respectivement, 3,78,
3,67, 3,30, et 3,55) et les faibles indices QD phi (respectivement 2,81, 3,04, 3,11, et 2,96) ; les
niveaux 4, 8 et 11 presentent en outre d’importants Sigma phi (respectivement, 2,7- 2,7- 2,9). Les
niveaux 2 et 3 s’individualisent par un rapport limon/argile eleve (17 et 15,8) avec argile 4/5 % et
sigma phi relativement faible (2,15, 2,05).
Les resultats de l’analyse des mineraux lourds, presentes dans le Tableau 1, mettent en
evidence l’apport de materiaux eoliens dont l’aire d’alimentation est probablement a chercher
dans les depots glaciogenes du Lario (Bini et al., 1996). Ces apports eoliens semblent avoir ete
parfaitement constants durant toute la periode enregistree par le depot, etant donne que le
pourcentage releve ne semble pas varier enormement dans les differents niveaux. En revanche,
le calcaire de Moltrasio presente dans sa fraction terrigene des mineraux sous forme micro et
cryptocristalline alteree, en accord avec ce qui avait ete montre par Rossi et al. (1991) et
deduit des observations microsedimentaires. Les indices d’alteration tels que le zircon,
tourmaline, rutile (ZTR)et de brewer (WI = ZT/(Amph.+Pyrox)), le rapport entre mineraux
opaques et transparents et l’evolution du pourcentage de rutile semblent montrer une alteration
progressive croissante des niveaux superieurs vers les niveaux inferieurs de la coupe, avec
deux tendances progressives d’alteration croissante entre les niveaux 1 et 3 entre les niveaux 4
et 10 (Fig. 6).
La diminution constante des mineraux amphibolitiques vers les niveaux inferieurs est
evidente ; elle est a mettre en relation avec une accumulation de produits d’alteration
pedogenetique en sediments polycycliques. Les plus bas indices d’alteration se trouvent dans le
niveau 4 (ZTR, WI et rutile), tandis que les alterations les plus marquees correspondent au
niveau 6 (opaque/transparent ; rutile ; ZTR). On observe en outre un pourcentage eleve
d’opaques dans le niveau 1. Les mineraux de titane tels que le rutile, la brookite et la titanite et les
agregats titaniferes semblent augmenter vers le bas avec un pourcentage maximum pour le
niveau 10. Les mineraux stables tels que le rutile, le zircon, le grenat, presentent un
arrondissement important des cristaux, signe d’un recyclage des sediments dans lesquels ils se
trouvent.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 303
Fig. 8. Courbes granulometriques cumulees des niveaux mis en evidence dans la sequence de la « Salle Terminale ».
Fig. 8. Textural cumulative diagrams of the sedimentary succession sampled at the ‘‘Terminal Room’’.
F.
Bo
na
eta
l./L’a
nth
rop
olo
gie
11
1(2
00
7)
29
0–
32
03
04
Tableau 1
Resultats de l’analyse des mineraux lourds isoles dans les niveaux mis en evidence dans la sequence de la « Salle Terminale »
Table 1
Heavy minerals composition of the ‘‘Terminal Room’’ sequence
Niveaux\
Min. l.
Epid. Gren. Amph. Pyrox. Min. TiO2 Tourm. Zirc. Staurol.
Spin.
Total
n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %
1 51 32,7 31 19,9 41 26,3 20 12,8 7 4,6 3 1,9 1 0,6 1 0,6 1 0,6 156 100
2 96 49 22 11,2 45 23 20 10,2 9 4,6 2 1 1 0,5 1 0,5 196 100
3 83 40,9 29 14,3 54 26,6 14 6,9 8 3,9 9 4,4 5 2,5 1 0,5 203 100
4 116 48 35 14,5 66 27,2 7 2,9 15 6,2 2 0,8 1 0,4 242 100
5 87 40,6 33 15,5 65 30,4 11 5,1 13 6,1 2 0,9 2 0,9 1 0,45 214 100
6 100 44 54 23,8 42 18,5 6 2,6 16 7 3 1,3 3 1,3 3 1,3 227 100
7 99 48,8 67 33 4 2 5 2,5 14 6,8 3 1,5 2 1 9 4,4 203 100
8 107 44,8 71 29,7 27 11,3 5 2,1 25 10,5 1 0,4 1 0,4 2 0,8 239 100
9 122 54,5 42 18,7 35 15,6 5 2,3 11 4,9 1 0,4 3 1,3 5 2,3 224 100
10 108 51,2 55 26,1 15 7,1 5 2,4 15 7,1 5 2,4 1 0,5 7 3,2 211 100
Total 969 45,8 439 20,7 394 18,6 98 4,6 133 6,3 31 1,5 19 0,95 31 1,5 1 0,05 2115 100
3.5. Conclusions sur la genese du depot
La fraction fine de la sequence sedimentaire de la « Salle Terminale » presente des
caracteristiques particulieres : teneur elevee de sables, courbes cumulatives granulometriques
asymetriquement positives, tri vraiment tres faible a l’exception du niveau 2, peu trie et peut-etre
lie majoritairement a des apports eoliens. Les mineraux lourds indiqueraient un depot de
materiaux eoliens tres proches de ceux qui composent le lœss d’Orimento (Bona, 2004b),
provenant probablement de fronts glaciaires pleistocenes. Les indices mineralogiques, ZTR, WI,
opaques/transparents, et le pourcentage relatif du rutile, indiqueraient une accumulation de
produits d’alteration, avec au moins deux phases distinctes : une phase recente qui comprend les
niveaux 1–3 et une phase ancienne pour les niveaux 4–6 et 8–10. De telles differentiations
pourraient etre liees aux caracteristiques predepositionnelles generees par la pedogenese externe
de materiaux colluvies ensuite dans la cavite. Cela suggererait une cyclicite de la sedimentation
qui impliquerait au moins deux evenements depositionnels separes par une stase, difficilement
quantifiable temporellement, au sein d’une homogeneite des caracteristiques depositionnelles.
4. Faune et interpretation paleoecologique
Les deux series etudiees, celle de la « Galerie » et celle de la « Salle Terminale », ne sont pas
reliees physiquement, mais certains caracteres sedimento-geometriques conduisent a envisager
l’hypothese d’une etroite correlation. Certains caracteres taphonomiques observes suggerent
differentes modalites d’enfouissement pour les restes osseux des deux secteurs.
4.1. Analyse des macro- et micromammiferes
Les restes de micromammiferes, recuperes manuellement au microscope binoculaire en
laboratoire dans les sediments tamises durant la campagne, ont ete determines a l’aide de
collections de comparaison et des publications adaptees (Chaline et al., 1974 ; Niethammer et
Krapp, 1978, 1982, 1990). En ce qui concerne les restes d’Ursus spelaeus, une analyse de
population a ete realisee (Bona, 2004b, 2004c).
4.2. La « Galerie »
Les restes de macrovertebres et quelques rares micromammiferes de la sequence de la
« Galerie » peuvent etre rapportes aux associations fauniques suivantes (Bona, 2003) (Tableaux 2
et 3) :
� Dans les niveaux les plus profonds atteints a ce jour (7C, 6C, 5aC), l’association est formee de
Martes sp. (2,6 %), Ursus spelaeus (tres abondant), Cervus elaphus (5,3 %), Megaloceros
giganteus (1,3 %), Capra ibex (8 %), Rupicapra rupicapra (4 %), Marmota marmota (77,3 %).
Cette association, caracterisee par la presence a la fois du chamois et du bouquetin, de la
marmotte et d’un individu de Chionomys nivalis, reflete un environnement ou predominent les
zones ouvertes et un taux d’humidite faible.
� Dans les niveaux 4C, 3C et 2C, l’association comprend Martes sp. (1,4 %), Vulpes vulpes
(1,4 %), Ursus spelaeus (tres abondant), Ursus arctos (2,8 %), Canis lupus (5,5 %), Alces alces
(1,4 %), Rupicapra rupicapra (5,5 %), Capreolus capreolus (1,4 %), Cervus elaphus (2,8 %),
Megaloceros giganteus (1,4 %), Marmota marmota (69,4 %), Myoxus glis, Terricola gr.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 305
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320306
Tableau 2
Composition des restes de macromammiferes de la sequence de la galerie
Table 2
Macromammal composition in the ‘‘Gallery’’ sequence
Niveaux 1 2 3 4 5a 6 7 TOT
Canis lupus N 3 3
NMI 1 1
% 14,3 0,77
Canis sp. N 1 1 2
NMI 1 1 2
% 0,65 1,7 0,51
Felis silvestris N 7 7
NMI 1 1
% 4,55 1,79
Martes sp. N 4 1 2 1 8
NMI 2 1 1 1 5
% 2,6 4,8 4,8 2,8 2,05
Mustela putorius N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Ursus arctos N 1 1 2
NMI 1 1 2
% 1,7 4,8 0,51
Ursus spelaeus N X X X X X X
NMI
%
Vulpes vulpes N 1 1 2
NMI 1 1 2
% 0,65 7,7 0,26
Alces alces N 1 1
NMI 1 1
% 1,7 0,26
Bos Taurus N 6 6
NMI 1 1
% 3,9 1,53
Capra ibex N 4 3 7
NMI 2 1 3
% 9,6 8,4 1,79
Capra hircus N 14 14
NMI 2 2
% 9,1 3,58
Capra vel Ovis N 36 36
NMI 5 5
% 23,5
Capreolus capreolus N 2 3
NMI 1 2
% 1,3 0,77
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 307
Tableau 2 (Suite)
Niveaux 1 2 3 4 5a 6 7 TOT
Cervus elaphus N 2 2 1 1 6
NMI 1 1 1 1 4
% 3,4 2,4 2,8 1,53
Megaloceros giganteus N 1 1 2
NMI 1 1 2
% 4,8 0,51
Rupicapra rupicapra N 6 3 3 3 15
NMI 1 1 1 1 4
% 3,9 5,1 14,3 8,4 3,84
Sus scrofa N 4 4
NMI 1 1
% 2,6 1,02
Lepus europaeus N 39 39
NMI 5 5
% 25,8 9,97
Lepus sp. N 10 10
NMI 4 4
% 6,5 2,56
Marmota marmota N 12 51 12 32 34 28 169
NMI 2 5 2 3 3 2 17
% 92,3 84,7 57 83,2 77,6 43,2
Tetrao tetrix N 16 1 17
NMI 4 1 5
% 10,4 1,7 4,53
Tetrao urogallus N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Alectoris graeca N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Gallus gallus N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Falco tinnunculus N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Aves N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Amphibie N 1 1
NMI 1 1
% 0,65 0,26
Total N 153 13 60 21 36 41 36 360
NMI 36 3 11 7 6 7 6 76
% 100 100 100 100 100 100 100 100
multiplex-subterraneus, Tetrao tetrix. Il est a noter que sont associes au chamois de nombreux
cervides tels que le cerf elaphe, le chevreuil, le cerf megaceros et l’elan. La presence d’Alces
alces, Capreolus capreolus, Myoxus glis et Terricola gr. multiplex-subterraneus indique
probablement une augmentation du taux d’humidite et du couvert boise.
� L’association la plus recente, niveau 1C et surface, est composee de restes holocenes et actuels.
Sont presents : Capra vel Ovis, Capra hircus, Rupicapra rupicapra, Capreolus capreolus,
Lepus europaeus, Mustela putorius, Martes sp., Vulpes vulpes, Tetrao tetrix, Tetrao urogallus,
Alectoris graeca, Gallus gallus, Falco tinnunculus, animaux qui vivent encore sur les versants
du Monte Generoso. Meme le chamois est actuellement bien represente dans le Massif du
Generoso avec environ 280–300 individus issus de reintroductions au cours des annees
soixante (Maddalena et al., 1998).
4.3. La « Salle Terminale »
Dans cette partie du depot, la quasi totalite des macrorestes est representee par Ursus spelaeus
avec un faible pourcentage de Marmota marmota. Compte tenu de la faible differentiation
specifique des macromammiferes, l’analyse paleoecologique est donc centree sur les restes de
microfaune (Bona, 2004b). Etant donne le faible nombre de microrestes decouverts, afin de
realiser des comparaisons a partir de valeurs significatives, les niveaux stratigraphiques ont ete
reunis en groupes caracterises par des affinites sedimentologiques. De l’analyse effectuee, il
ressort que la sequence est caracterisee par une evolution climatique relativement evidente
(Tableau 3).
� Les niveaux 5, 6, 8, 9 et III sont caracterises par une association de Terricola gr. multiplex-
subterraneus, Chionomys nivalis, Arvicola terrestris et Microtus arvalis. La presence diffuse
d’especes comme Chionomys nivalis et Microtus arvalis, associee a la rarete des especes
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320308
Tableau 3
Micromammiferes de la « Salle Terminale » ; frequence numerique et pourcentage le long de la sequence stratigraphique
Table 3
Numeric and percent frequencies of micromammal composition in the ‘‘Terminal Room’’
Taxa Niveaux 0, 1,
2, 2b, A, B, I
Niveaux 3, 4, II Niveaux 5, 6,
8, 9, III
n % n % n %
Terricola gr. multiplex-subterraneus 36 49,3 5 31,3 2 11,8
Terricola cf. savii 3 4,1
Chionomys nivalis 1 1,4 4 23,5
Clethrionomys glareolus 2 2,7 4 25,1
Arvicola terrestris 12 16,4 1 6,2 5 29,4
Microtus arvalis 8 10,9 1 6,2 6 35,3
Myoxus glis 3 4,1
Muscardinus avellanarius 1 6,2
Apodemus gr. silvaticus/flavicollis 2 2,7 3 18,8
Sorex minutus 1 1,4 0 0
Sorex cf. araneus 1 1,4 1 6,2
Talpa cf. europaea 2 2,8
Talpa cf. caeca 2 2,8
Total 73 100 16 100 17 100
typiques des milieux forestiers, permet d’avancer l’hypothese selon laquelle la region du
Monte Generoso etait caracterisee par la presence de vastes espaces ouverts, de roches
exposees, d’un couvert vegetal bas et d’aires boisees reduites. Le climat devait etre
relativement froid et aride.
� Pour les niveaux 3, 4 et II, le nombre d’individus decouverts est faible. Les deux groupes les
mieux representes sont Terricola gr. multiplex-subterraneus et Clethrionomys glareolus. Un
autre groupe bien represente est celui forme par les Apodemus gr. sylvaticus/flavicollis. Ce
genre est de toute facon considere comme ubiquiste, avec une tres forte capacite d’adaptation a
tous les milieux ; il semble donc n’etre d’aucune aide pour l’analyse paleoenvironnementale et
paleoclimatique. En ce qui concerne les autres especes (Arvicola terrestris, Microtus arvalis,
Sorex araneus), aucune conclusion ne peut etre avancee dans la mesure ou elles ne sont
representees que par un seul exemplaire chacune.
Il est donc possible d’avancer l’hypothese selon laquelle la region environnante etait caracterisee
par des zones boisees assez etendues avec un sous-bois epais (la presence de Muscardinus
avellanarius est significative, meme s’il s’agit d’un seul individu) ; toutefois, le nombre d’individus
par groupe est tellement limite qu’il est impossible de le demontrer avec certitude.
� Pour les niveaux 0, 1, 2, 2b, A, B et I, les donnees disponibles mettent en evidence la presence
aux alentours de la grotte de zones boisees. Preuves en sont les nombreux Terricola gr.
multiplex-subterraneus. La presence discrete de Clethrionomys glareolus et de Myoxus glis
tendrait a confirmer cette hypothese. Ces zones couvertes alternent avec des zones ouvertes,
suggerees par Microtus arvalis et par un Chionomys nivalis. La presence d’Arvicola terrestris
suggere l’existence de zones abritees et humides.
Le tableau climatico-environnemental dresse par ces associations conduit a penser que sur le
Monte Generoso etaient presentes des zones boisees riches en arbustes et en vegetation de sous-
bois, tandis que les zones ouvertes devaient etre plus limitees. Par consequent, on note le long de
la sequence une amelioration climatique progressive qui voit le milieu passer d’une zone peu
couverte a un bois avec de rares zones ouvertes. On peut donc envisager un passage d’un climat
relativement froid et aride a une phase plus temperee et humide.
4.4. Aspects taphonomiques
Les restes osseux mettent en evidence differentes modalites d’accumulation. En premiere
analyse, on peut distinguer les deces naturels dans la grotte de ceux de differentes especes lies a
des activites de predation et de transport dans la cavite.
Au premier groupe appartiennent les carnivores, parmi lesquels se distinguent par leur nombre
de restes Ursus spelaeus, et Marmota marmota, tous deux representes par de nombreux individus
a differentes phases de leur developpement ontogenique. La presence de classes d’age variees
permet de comprendre comment ces deux taxons ont utilise la grotte au cours de longues periodes
de l’annee en y mettant bas et en y elevant leur progeniture. Au deuxieme groupe appartiennent
tous les herbivores et les micromammiferes, representes par un groupe nettement inferieur de
restes. Les animaux introduits comme proies, principalement des Artiodactyles, sont representes
seulement par des portions squelettiques, generalement des parties du squelette appendiculaire.
L’etat de conservation des restes recuperes dans la galerie d’acces et ceux provenant de la
« Salle Terminale » presente des variations substantielles, que ce soit pour le degre de fracturation
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 309
et d’emousse, qui concerne surtout les surfaces articulaires des os longs ou que ce soit au niveau
de la dispersion des portions squelettiques. Parmi les differents mecanismes qui ont pu conduire a
produire une forte dispersion et une alteration des restes de la galerie, l’un des principaux est le
pietinement animal et la mobilisation consecutive a laquelle etaient soumises les portions
squelettiques avant leur enfoncement dans le sediment. A l’inverse, la conservation d’elements
anatomiques en connexion dans la « Salle Terminale » suggere une dispersion moindre et un
pietinement moins important (Bona, 2004b).
Une autre cause importante de fragmentation est l’action animale sur les restes deja deposes.
En temoignent les traces de morsure et de rongement sur les os d’herbivore, d’ours des cavernes
et de marmotte. Differentes traces telles que des punctures compatibles par leurs dimensions avec
les dents d’ours des cavernes ou des traces dites « vertes », c’est-a-dire produites sur un os encore
elastique avec presence probable de chair, montrent que la predation d’Ursus spelaeus par ses
semblables est tres probable. Parmi ces traces, on note le crane d’un jeune individu qui porte les
stigmates evidents d’une predation ayant echoue, comme en temoigne une blessure en partie
cicatrisee (Bona et Cattaneo, 2003). Une autre difference importante entre les deux secteurs
analyses consiste en une representation distincte des taxons de macromammiferes : dans la
« Galerie » 29 taxons ont ete determines tandis que 4 seulement l’ont ete dans la « Salle
Terminale » (Bona, 2004b). Cela implique que la majorite des especes predatrices utilisaient les
premiers trente/trente-cinq metres alors que rares etaient celles qui utilisaient la totalite de la
cavite exploree.
L’identification d’eventuels indicateurs d’activites anthropiques sur les restes squelettiques est
rendue delicate par le mediocre etat de conservation des surfaces. Les observations effectuees sur
les herbivores, les carnivores et les marmottes n’ont donne aucun resultat positif. Meme s’il faut
prendre cette affirmation avec reserve, la contribution anthropique a la formation de
l’accumulation osseuse doit donc etre consideree comme pratiquement nulle.
5. Dates radiocarbone
A la premiere date 14C de 38 200 � 1400 ans BP (UZ2429, ETH 4249) obtenue par Fusco sur
restes osseux, s’est ajoutee recemment une serie de dates AMS obtenues a partir du collagene de
cinq os d’Ursus spelaeus (Tableau 4). Les mesures definissent un intervalle de temps de 18 ka
radiocarbone, dont la limite superieure coıncide avec la date la plus recente du niveau 2 et la
limite inferieure avec la mesure la plus ancienne du niveau 6. A cette derniere est associee la
deuxieme date du niveau 2, UtC-10760, attribuable selon toute probabilite a un echantillon
remanie. Conformement a la sequence stratigraphique, les dates radiocarbone des niveaux 6 et 4
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320310
Tableau 4
Dates radiocarbone obtenues a partir du collagene de cinq os d’Ursus spelaeus
Table 4
Radiocarbon dates made on collagene extracted from five Ursus spelaeus bones
Echantillon Niveaux Fraction
analisee
Masse
[mg]
UtC Nr d13C
[p.mil]
14C Age [BP]
Lombardy-A4MGB6 2 collagene 2,210 UtC-10760 �23,7 51 200 � 4000
Lombardy-B5MGGD 2 collagene 2,140 UtC-10761 �23,5 39 200 � 1000
Lombardy-C1MGAA3 4 collagene 2,160 UtC-10762 �18,8 46 700 � 2400
Lombardy-D2MGAA3 6 collagene 2,250 UtC-10763 �20,1 47 800 � 2600
Lombardy-E3MGAA3 6 collagene 2,270 UtC-10764 �18,3 50 800 � 5000
se superposent compte tenu de l’important sigma des trois mesures et en particulier de
UtC-10764. Dans l’ensemble, la position chronologique des echantillons, et en particulier ceux
du niveau 6, souffre des effets lies a la limite inferieure de resolution des mesures radiometriques
qui conduit les principaux laboratoires modernes a considerer que les limites techniques se
situent autour de 9,5 demi-vies et nombreux sont ceux qui considerent que les resultats ne sont
pas fiables au-dela de 5,0–7,5 demi-vies (Joris et al., 2003). La partie de la sequence qui a ete
datee s’insere principalement dans la premiere partie du stade isotopique 3.
6. Vestiges lithiques
Les traces de frequentation anthropique de la cavite consistent en six vestiges lithiques
decouverts dans le remplissage lors des fouilles systematiques mais aussi durant la recuperation
de sediments remanies par les fouilles precedentes. La localisation originale de trois pieces est
inconnue, celles-ci n’ayant pas ete identifiees des le depart comme des vestiges lithiques lors de
la fouille de 1998 dans la galerie d’entree. Deux d’entre elles proviennent du carre 20 de la
« Galerie » : la piece 2 (Fig. 9(6)), decouverte a 55 cm de profondeur et la piece 6 (Fig. 9(4)),
decouverte en 2004 au sein de deblais de la fouille precedente. Un troisieme vestige (Fig. 9(5)) a
ete decouvert dans les sediments remanies de la galerie. Les vestiges 3, 4 et 5 (Fig. 9(1–3)) sont
issus de trois differents niveaux stratigraphiques lors des fouilles de 2002 et 2004 dans la « Salle
Terminale ». Le premier provient du sommet de l’unite B, correlee au niveau 2 de la « Salle
Terminale » sur la base de caracteres sedimentologiques, le second du sommet du niveau 12
tandis que le troisieme provient du niveau 11. Les vestiges se repartissent donc dans des secteurs
divers, au centre et sur les cotes (n8 3 dans le secteur I13, n8 4 dans le secteur B4 et n8 5 dans le
secteur A2) avec une densite extremement basse (1/27 m3 de sediment).
Tous les vestiges ont ete realises en radiolarite. Deux eclats massifs et corticaux recuperes
dans la galerie ont ete extraits de deux nodules/blocs distincts. Les caracteristiques de la
radiolarite, a savoir la couleur brun-rougeatre fonce (2,5YR3/4 – M.S.C.C.), le contenu
fossilifere, le reseau dense de veinures decolorees qui parcourent le long des fractures cimentees,
sont proches de celles des roches qui affleurent a Bellavista, a 3,5 km de la grotte a vol d’oiseau.
Ces deux eclats presentent des surfaces de fracturation naturelle recouvertes, pour l’une des
pieces, par une patine translucide postdepositionnelle. L’autre eclat presente une plage corticale
fraıche et une surface de fracture naturelle marquee par les decolorations decrites precedemment.
Outre des pseudo-retouches et la patine translucide deja mentionnee, l’un des deux eclats
presente des fractures naturelles parcourues par des pellicules jaune-brunatre (10YR6/8)
probablement en limonite. Les patines et un changement chromatique sensible vers le gris-
violace ou le brun-jaunatre par rapport a la couleur d’origine ne suffisent cependant pas a
masquer le contenu fossilifere de ces pieces.
Les quatre eclats restants sont en radiolarite brun-rougeatre fonce (2,5-5YR3/4) ou rouge
sombre (2,5-5YR3/6) avec des traits decolores correspondant a d’anciennes fissures cimentees.
Outre des pseudo-retouches et une patine translucide, l’un de ces quatre vestiges presente
egalement une patine brune (7,5YR4/6) non-homogene, essentiellement developpee sur la face
dorsale, associee a des colorations jaunatres (10YR7/8) le long des nervures et sur les aretes ou
bien organisee de facon a conferer un aspect marbre a la surface.
Le contenu micropaleontologique et les caracteristiques texturales et chromatiques suggerent
pour ces quatre vestiges une acquisition au sein des radiolarites du bassin du Generoso,
disponibles dans la large bande d’affleurement presente a basse altitude sur le versant sud du
massif (affleurements de Bellavista et de Gola della Breggia).
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 311
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320312
Fig. 9. Caverna Generosa : vestiges lithiques (dessins S. Ferrari).
Fig. 9. Caverna Generosa: lithic artefacts (drawings S. Ferrari).
Au sommet du niveau 12 a ete decouvert un eclat Levallois debordant, recurrent centripete, a
dos cortical partiellement travaille (Fig. 9(1)) ; le bord tranchant oppose au dos est altere par des
pseudo-retouches appuyees et repetees, de morphologie ecaillee, alors que des esquillements
marginaux sont presents sur tous les bords de la piece ; la face superieure est depourvue de cortex.
Dans la partie superieure du niveau 11 a ete decouvert un fragment distal d’eclat Levallois
recurrent (Fig. 9(2)), portant des pseudo-retouches envahissantes sur tous les bords, y compris
celui fracture, qui conferent a la piece une denticulation caracteristique masquant d’eventuelles
retouches.
Le niveau 2, pres de sa limite superieure, a livre un racloir lateral sur eclat Levallois recurrent,
fragmentaire (Fig. 9(3)). Une fracture ancienne sur le cote gauche, portant des pseudo-retouches,
forme un dos qui tend a converger vers le talon. Le bord retouche se trouve sur le cote oppose ; la
retouche est directe, partielle et envahissante ; l’angle n’est pas determinable. Des pseudo-
retouches envahissantes concernent tous les bords et en particulier les plus fins, constituant une
denticulation caracteristique et masquant d’autres retouches eventuelles sur le bord transversal.
Les trois pieces provenant de la galerie sont differentes des precedentes. Deux eclats, l’un en
position remaniee, l’autre decouvert a 55 cm de profondeur, presentent un aspect massif. Le talon
est lisse, tres etendu, et correspond a la surface de l’une des nombreuses fissures planes paralleles
partiellement cimentees qui parcourent la radiolarite. Sur la face superieure, l’un des eclats
presente deux larges negatifs unidirectionnels et convergents (Fig. 9(6)), l’autre une plage
corticale emoussee et une surface de fracture semi-fraıche sur le cote droit (Fig. 9(5)). Les
pseudo-retouches sont marginales a etendues et interessent tous les bords. Un eclat mince,
partiellement cortical et a talon lui aussi cortical, classifiable comme produit predeterminant du
debitage Levallois, provient egalement de la galerie (Fig. 9(4)) ; il presente une pseudo-retouche
denticulee marginale sur la totalite de son pourtour qui ne permet pas d’evaluer l’utilisation du
bord brut. Dans l’ensemble, les vestiges presentent des traces evidentes et a des degres divers
d’alterations postdepositionnelles. Les pseudo-retouches visibles sur les bords et sur les aretes, y
compris celles formees par des intersections avec des surfaces de fracture, peuvent etre mises en
relation soit avec des phenomenes de pietinement repete, avec mobilisation des objets lithiques
sur la surface, soit avec des contacts abrasifs ou des pressions entre le vestige et un corps rigide,
pierre ou os, enfoui dans le sediment. De telles alterations sont communement observees sur les
produits de debitage dans les cavites sujettes a une importante frequentation animale (Pei, 1936;
Bordes, 1961) mais aussi dans les contextes ou les modifications liees au gel/degel ou au
remaniement hydrique s’averent non-negligeables (pour une synthese generale recente sur ce
sujet, voir Thiebaut, 2001).
La plus grande frequence des pseudo-retouches est enregistree sur les vestiges de la « Salle
Terminale », en l’occurrence sur les trois eclats Levallois, alors que sur les trois vestiges
decouverts dans la Galerie, l’alteration des bords varie de legere a profonde. Une telle situation
reflete les diverses conditions taphonomiques auxquelles sont notoirement soumis les depots de
cavites a forte frequentation animale ou mixte. Dans le cas de Preletang, l’industrie recueillie
dans la galerie presente une forte proportion de pseudo-outils que l’on ne retrouve pas dans les
ensembles provenant du secteur externe (Bernard-Guelle, 2002b). De meme, dans de nombreuses
autres cavites telles que la grotte de Fumane par exemple, les niveaux archeologiques montrent
une augmentation progressive des pieces avec pseudo-retouche en avancant vers l’interieur le
long de la galerie principale. D’autres alterations consistent en un lustre et des stries. Le lustre,
qui envahit uniformement les surfaces des trois supports Levallois et l’un des deux eclats massifs
de la galerie (Fig. 9(6)), serait lie a des mecanismes de mobilisation dans des sediments
quartzitiques a matrice fine, responsables du poli des surfaces (Plisson et Mauger, 1988). Les
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 313
stries sont imputables a des contacts avec des particules sableuses au cours du pietinement ou au
remaniement des vestiges. Aucun des eclats ne presente de trace d’alteration thermique.
Les vestiges temoignent de differents objectifs techniques. Pour les radiolarites locales
(Bellavista), l’objectif du debitage etait de produire des supports massifs aux bords robustes
destines a realiser une activite specifique mais faiblement elaboree. Les autres vestiges refletent
une selection de supports Levallois, y compris un eclat debordant pour ses caracteristiques
morphotechniques bien connues qui lui conferent une efficacite fonctionnelle notoire (Beyries et
Boeda, 1983). Les vestiges peuvent etre consideres comme des produits finis, fabriques ailleurs et
importes dans la cavite. Le degre d’alteration des bords interdit d’en identifier la fonction. Des
preuves de la segmentation spatiotemporelle de la sequence operatoire Levallois sont egalement
suggerees par l’eclat predeterminant decouvert dans la galerie. Celui-ci atteste l’exploitation
ponctuelle, survenue probablement a proximite de l’entree de la cavite, d’un nucleus Levallois
precedemment destine a la production en d’autres lieux et integre a l’outillage lithique mobile.
7. Conclusions
La presence sporadique de vestiges lithiques dans les cavites intensement frequentees par les
Ursides est largement documentee dans l’arc alpin, a des altitudes variees et y compris pour des
gisements situes a plus de 1000 m. Ces decouvertes constituent des elements de comparaison
pour la Caverna Generosa, a l’heure actuelle l’un des rares exemples de frequentation
mousterienne en altitude dans les Prealpes lombardes et le seul site des Alpes italiennes montrant
une serie d’occupations anthropiques durant le stade isotopique 3.
Connus dans les Alpes autrichiennes, dans les Alpes sarentines et sur differents plateaux du
Jura, plusieurs sites etroitement lies a la presence massive d’Ursides ont livre des traces plus
ou moins ephemeres du passage de groupes humains au cours du Paleolithique moyen. Objets
de revisions parfois recentes (Tillet, 1997, 2001), de tels gisements ont ete par le passe a la
base d’hypotheses sur l’existence d’une culture mousterienne specifique a la region alpine
(Bachler, 1940), rejetee par de nombreux auteurs a la lumiere de revisions approfondies et de
donnees issues de fouilles (Koby, 1954 ; Sphani, 1953 ; Jequier, 1975 ; Le Tensorer, 1998 ;
Tillet, 2002).
Dans le Massif du Santis (Prealpes d’Appenzell), s’ouvre le Wildkirchli a 1477 m. L’industrie
lithique, objet de remaniements postdepositionnels, a ete attribuee a une unique phase
d’occupation et temoigne d’activites de consommation plutot que de production sur des roches
locales telles que les quartzites a grain fin, les schistes siliceux, les radiolarites, caracterisees par
une reponse mediocre a la taille. La technologie de production est Discoıde et est parfois
precedee par celle Levallois dans la meme sequence de reduction. Les etapes de certaines
sequences de production ne sont pas documentees et sont a rechercher dans les sites qui devaient
consteller l’entite territoriale et desquels provenaient les objets finis et semi-finis importes dans la
cavite (Jequier, 1975).
Dans le meme massif s’ouvre le Wildenmannlisloch a 1628 m, ou a ete decouverte une
modeste serie lithique recueillie en position secondaire dans des depots ossiferes a 50 m de
l’entree. Le faible taux de sedimentation semble etre a l’origine des deplacements horizontaux
des vestiges, qui ont sejourne longtemps en surface et qui ont par consequent ete soumis a une
dispersion et une alteration. La matiere premiere la plus frequente est un quartzite a grain tres fin
disponible dans des depots glaciogenes a 9 km de la grotte, alors que deux eclats sont en chaille
grise et en jaspe rouge a radiolaires. Technologiquement, l’industrie est proche de celle de
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320314
Wildkirchli, meme si elle s’en distingue par l’absence de debris, d’eclats de petites dimensions et
de nucleus, demontrant que les activites de taille se sont deroulees ailleurs (Jequier, 1975).
A des altitudes plus importantes se trouvent les grottes des Totes Gebirge, le Salzofenhole
(2000 m) et la grotte de Ramesch-Knochenhole (1960 m). La premiere a livre une modeste serie
lithique qui comprend une dizaine d’eclat dont quelques racloirs essentiellement sur chaille,
corneenne et jaspe locaux mais de mediocre qualite, tandis que les autres vestiges sont en silex
allochtone. Des niveaux E–C de la grotte de Ramesch-Knochenhole proviennent quelques outils
(Hille et Rabeder, 1986). En Styrie, on note les restes d’un foyer et d’un seul eclat trapu et epais
decouverts a Lieglloch (a 1290 m) dans la vallee de l’Enns (Jequier, 1975).
La grotte de Schnurenloch, a 1230 m dans le Simmental, contenait trois eclats en quartzite tres
alteres par des pseudo-retouches, attribue selon toute probabilite au Paleolithique moyen
(Jequier, 1975). Malgre une date 14C de 24 ka BP qui situe cette serie a une epoque plus recente
(Le Tensorer, 1998) soutient son attribution au Paleolithique moyen et avance l’hypothese d’une
frequentation entre la fin d’un glaciaire et le debut d’une phase interstadiaire. Differents sites en
grotte dans les Alpes francaises et dans le Jura suisse montrent une intense frequentation des
Ursides melee a des traces d’occupation anthropique. Dans la grotte du Bare (Haute-Savoie), on
signale un foyer associe a une dizaine de vestiges. Un seul eclat, profondement altere par des
pseudo-retouches, provient de la grotte de Fournet (Jequier, 1975). Dans la grotte des Plaints,
quelques eclats ont ete decouverts disperses dans la couche paleontologique. Il s’agit de 16
pieces, toutes profondement alterees par le pietinement et les deplacements : 14 sont en chaille
locale, roche de mediocre qualite, alors que les autres sont en silex allochtone indetermine et en
quartzite rougeatre a grain grossier contenu dans les formations erratiques alpines regionales.
L’industrie est a technologie Discoıde, elle compte un seul racloir demi Quina et trouve des
affinites avec Wildkirchli (Jequier, 1975).
Objet de recherches recentes (Bernard-Guelle, 2002a), le Massif du Vercors conserve un
nombre assez important de sites, parmi lesquels quelques cavites intensement frequentees par
l’ours des cavernes. Dans la grotte de Marignat, le remplissage a livre des eclats de technologie
Discoıde et Levallois en silex senonien d’origine indeterminee qui correspondraient a des
occupations de courte duree sans production lithique sur place (Bernard-Guelle, 2000). Il
convient de signaler le contexte mineral particulier de la grotte de La Passagere (1050 m), dont
les parois sont parsemees de nodules de silex senonien. De la couche 4 provient une abondante
faune a Ours, accompagne de la Marmotte, du Cerf, du Sanglier et d’une trentaine de pieces, dont
plus de la moitie realisees en silex local ; les autres sont en silex disponible a proximite de la
grotte ou en silex allochtone, provenant de la partie meridionale du massif. L’industrie,
technologiquement Levallois et numeriquement pauvre malgre la presence de silex senonien,
suggererait l’existence d’une halte de chasse visitee lors de frequentations du Vercors selon une
direction N–S (Bernard-Guelle, 2000).
Objet de recherches entamees dans les annees 1960, la grotte de Preletang dans le Massif des
Coulmes a livre des vestiges mousteriens dans la galerie interne et dans l’entree actuelle. Si
l’industrie lithique du premier secteur paraıt clairement remaniee, celle de l’entree temoigne
d’un depot primaire, probablement multiple, de vestiges et d’ecofacts : aux restes fauniques
d’ongules (cerf, chevreuil, sanglier, bovides), ours des cavernes et marmotte, s’ajoutent des
structures de combustion et une industrie lithique Levallois (Tillet et Bernard-Guelle, 1998). Des
pointes, des instruments a bords convergents et des racloirs sont confectionnes sur des matieres
premieres locales ou sublocales (7 km) et sur des materiaux exterieurs au massif mais dont la
source est distante de moins de 20 km. La segmentation de la chaıne operatoire suggeree par les
produits finis ou semi-finis importes dans le site, integree a une activite de debitage occasionnelle
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 315
a faible investissement technique, definissent pour cette cavite un facies economique typique des
sites de consommation. L’interpretation de Preletang fait reference a un campement de courte
duree, siege d’une activite specialisee liee a la subsistance (Bernard-Guelle, 2002b).
La chronologie 14C de ces sites place la frequentation animale et les occupations
neandertaliennes concomitantes dans le stade isotopique 3 (Pacher, 2003 ; Tillet, 2001, 2003) :
38 470 � 810 BP pour la grotte du Bare (Rouch-Zurcher cite par Tillet, 2001), 46 200 � 1500
BP pour la couche I de Preletang, 34 000 � 3000 et 31 200 � 1100 BP pour Salzofenhole
(Neugebauer-Maresch, 1999 ; Pittioni, 1984), 28 130 � 600 et 33 500 � 240 BP pour le
Lieglloch, 31 300 + 1900/-1800, 34 600 + 2800/-2700, 34 900 + 1800/-1500, 36 100 + 300/-
2800 et 37 200 + 1900/-1600, 38 900 + 2300/-2200, 41 400 + 5300/-4900, 44 500 + 2900/-
2800, 51 300 + 2800/-2700, 52 000 + 4700/-4500 BP pour la grotte de Ramesch-Knochenhole
(Hille et Rabeder, 1986). Les dates sont en grande partie superposables a celles de la Caverna
Generosa.
Les donnees sur le contexte paleoecologique de ces frequentations animales et humaines sont
tout aussi fragmentaires. L’association pollinique de Ramesch-Knochenhole se rapporte a une
periode chaude, dite « Interglaciaire de Ramesch-Knochenhole » (Hille et Rabeder, 1986), qui
aurait connu dans cette region des conditions plus favorables que celles de l’heure actuelle. Dans
les Alpes suisses est attestee une faune alpine en situation interstadiaire, correlable avec
l’interstade de Hengelo (Le Tensorer, 1998), alors que l’attribution paleoclimatique des niveaux
7d et 7c de Schnurenloch paraıt plus discutee. Le plus ancien de ces deux niveaux temoigne d’une
phase a toundra avec Ovibos moschatus, Marmota marmota, Microtus arvalis, Pyrrhocorax
alpinus, a correler avec une periode precedent l’interstade de Hengelo ou bien immediatement
posterieure si l’on considere la date 14C (Le Tensorer, 1998). Le niveau 7c indique en revanche un
interstade, avec apparition d’Eliomys quercinus et Evotomys glareolus sur un fond biologique
glaciaire toutefois tres prononce. A Preletang, la frequentation s’insere dans un cadre varie avec
des milieux forestiers et temperes et des milieux plus frais, largement ouverts, assimilables a une
prairie de montagne (Bernard-Guelle, 2002b).
Au-dela des evidences archeologiques, c’est aussi la particularite du contexte altitudinal et
geographique de Caverna Generosa qui soutient l’hypothese selon laquelle les frequentations
mousteriennes de ce site d’altitude ont presente un caractere sporadique avec un equipement
compose d’outils finis ou semi-finis. Seuls quelques eclats massifs temoignent d’activites
ephemeres de production lithique, qui se deroulaient probablement dans la zone d’entree.
L’aptitude fonctionnelle de ces vestiges, rendu tres basse par la faible qualite des matieres
premieres, suggere une utilisation pour des besoins immediats, que les radiolarites des Alpes de
Mandrisio etaient peut-etre aptes a satisfaire. Comme a la Passagere, il est surprenant a Caverna
Generosa que les plaquettes de silex qui affleurent le long des parois de la cavite et sur les
versants proches n’aient pas ete exploitees. L’aptitude economique et fonctionnelle de ces
supports pour la confection de racloirs est demontree dans d’autres sites mousteriens comme la
Grotta del Cavallo dans le Salento (Palma di Cesnola, 1996), dont l’orientation fonctionnelle
paraıt toutefois complexe et diversifie, et nettement differente de celle de Caverna Generosa. Il
est probable que, compte tenu des limites imposees par les caracteristiques lithologiques et
geometriques de ces supports, la confection et la predetermination fonctionnelle des bords utiles
ne presentaient aucun interet pour les occupants de la grotte.
La Caverna Generosa n’est pas isolee dans les Prealpes lombardes, mais s’integre dans un
ensemble d’implantations qui, meme s’il est peu dense, mal date et fragmentaire, temoigne de
phenomenes de colonisation alpine au Paleolithique moyen. Sur le plateau de Cariadeghe, dans
les Prealpes de Brescia, est signalee la decouverte de quelques eclats Levallois, d’une pointe et
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320316
d’un racloir dans un niveau de lœss pedogenise attribue a un interstade wurmien (Cremaschi,
1981). Des elements tres incertains proviennent en revanche de quelques cavites du Triangle
Lariano, telles que le Buco del Piombo et le Buco del Corno de Vigano. Dans la premiere, non
seulement les vestiges sont en position secondaire, mais leur attribution au Mousterien est elle-
meme discutee (Fedele et Gagliardi, 1988). Pour le Buco del Corno, on ne dispose pas d’un
enregistrement fiable de la position stratigraphique des vestiges (Cremaschi, 1981).
Dans les Prealpes lombardes, des vestiges ont ete signales dans les lœss wurmiens de la
terrasse de Casnigo a 500 m au-dessus du niveau de la mer, dans la Val Seriana (Poggiani Keller,
1992). A 37 km a vol d’oiseau du Monte Generoso, le site de plein air de Bagaggera dans la vallee
du torrent Curone (260 m d’altitude) est autrement important (Cremaschi et al., 1990). L’horizon
IIIB23t date par 14C de plus de 31 ka BP et par TL de 60,5 � 7,5 ka BP, a livre une industrie
lithique sur silex local d’accumulation residuelle pedogenetique avec pieces Levallois associees
a deux structures de combustion. Meme s’il n’a fait l’objet que d’une note preliminaire,
Bagaggera semble documenter une serie d’occupations s’inserant dans une phase temperee du
Wurm ancien.
Vers l’ouest, au debouche de la Valsesia, se trouvent les sites en grotte du Mont Fenera
(899 m) (Fedele, 1972) qui forment un complexe connu explore dans les annees 1960–1970. La
Ciota Ciara est un site classique de deces de faune hibernante avec une association quasiment
monospecifique (95 % d’Ursus spelaeus, associe notamment a Capra ibex), attribuee au Wurm
ancien (Fedele, 1968). Du secteur interne de cette cavite proviennent de rares vestiges lithiques
alors qu’une importante industrie Discoıde en quartzite a ete reperee dans les niveaux remanies
au niveau de l’entree sud-ouest (Fedele, 1968 ; Peresani, 2003). Le Riparo del Belvedere presente
un interet certain par sa sequence stratigraphique (niveaux 13–7) qui couvre l’intervalle
chronologique compris entre la premiere partie du Pleistocene superieur et les phases finales du
Mousterien. Independamment des differences lithotechniques des ensembles lithiques recueillis
dans les differents niveaux, l’ensemble semble montrer des affinites entre les activites realisees
au cours des differentes phases d’occupation de l’abri. Le site est interprete comme un lieu
d’occupation temporaire destine a la predation et au traitement des carcasses d’Ursides et
d’autres mammiferes parmi lesquels le bouquetin et l’aurochs, ce dernier ayant ete chasse en fond
de vallee (Fedele, comm. pers.). L’approvisionnement lithique temoigne d’un interet envers les
ressources locales du fond de vallee — galets de quartzite et de porphyre — et dans une moindre
mesure envers celles disponibles autour de la cavite — spongolithes, calcaires siliciferes divers
— destinees a une production Discoıde d’eclats (Peresani, 2003). Dans un territoire pauvre en
ressources, de vagues indices de mobilite et de l’existence d’un reseau d’approvisionnement
aupres du Monfenera et d’autres localites sont fournis par des silex probablement d’origine
lombarde decouverts au Riparo Belvedere et par des eclats en quartzite des rives du Sesia et en
porphyre de la basse Valsesia recueillis dans les sites de plein air de Trino Vercellese (Fedele,
1976, 1984–1985 ; Fedele et Gagliardi, 1988).
Dans un modele d’occupation du territoire, la Caverna Generosa se situe dans la categorie des
habitats-refuges, de duree plus ou moins limitee conditionnee par les contrastes altitudinaux et
bioclimatiques, qui pourraient s’integrer dans une dynamique de deplacements saisonniers au
sein de la zone montagneuse alpine, de facon analogue a ce qui a ete dit precedemment pour le
complexe du Monfenera. Ils formeraient des habitats extremement secondaires ou des lieux de
passage furtifs, sieges possibles d’activites ephemeres, permettant la satisfaction de besoins
immediats. L’exploitation sur place de matieres premieres locales n’est en effet pas un caractere
discriminant pour ces sites, qui trahissent parfois un desinteret envers les sources disponibles
immediatement. La region se trouve ainsi constellee de stations etapes, d’installations de courte
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 317
duree, de sites aux roles diversifies, dont le choix depend de criteres plus complexe que la simple
presence d’un abri naturel et, en partie seulement, lies a la geo-topographie du lieu (col du Monte
Generoso). L’etat des recherches ne permet pas pour le moment de verifier l’existence autour du
Massif du Generoso d’occupations de plein air semi-permanentes qui pourraient etre liees a des
conditions biogeographiques plus favorables a l’exploitation des ressources, a la production et a
la consommation integrees pour lesquelles ont ete organises les deplacements depuis des habitats
complementaires de fond de vallee ou perialpins.
Remerciements
Les campagnes de fouille a la Caverna Generosa ont ete realisees avec l’autorisation du
Ministero per i Beni Culturali et ont ete financees par le Ministero dell’Istruzione, dell’Universita
e della Ricerca, par le Museo di Lugano, par la Comunita Montana Lario-Intelvese (projet
INTERREG III), par les fonds speciaux du Magnifico Rettore dell’Universita degli Studi de
Milan. La Societe de chemin de fer du Monte Generoso S.A. a fourni un support logistique
essentiel. La premiere date 14C (38 200 � 1400 ans BP) de la Caverna Generosa a ete obtenue
grace a l’interet du Museo di Storia Naturale de Lugano. Ce travail s’inscrit dans le programme
de recherche national MIUR « Origines et evolution du peuplement humain en Italie :
paleobiologie, comportement et strategies de subsistance ». Les auteurs remercient le Prof. F.
Fedele pour les suggestions fournies durant les phases finales de redaction du texte. Traduit de
l’italien par V. Mourre.
References
Bachler, E., 1940. Das alpine Palaolithikum der Schweiz in Wirdkirchli, Drachenloch und Wildenmanlisloch. Mono-
graphien zur Ur- und Frugeschichte der Schweiz 2, Basel.
Bernard-Guelle, S., 2000. Etude de quelques series lithiques mousteriennes (deposees a l’Institut Dolomieu de Grenoble).
In: Tillet, Th. (Ed.), Les Paleoalpins — Hommage a Pierre Bintz. Geologie Alpine, Memoire h.s. 31, pp. 107–115.
Bernard-Guelle, S., 2002a. Modalites d’occupation et d’exploitation du milieu montagnard au Paleolithique moyen :
l’exemple du massif du Vercors (Prealpes du Nord). Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise 99, 685–697.
Bernard-Guelle, S., 2002b. Le Paleolithique moyen du massif du Vercors (Prealpes du Nord). British Archaeological
Reports, International Series, 1033.
Bernoulli, D., 1964. Zur Geologie des Monte Generoso (Lombardische Alpen). Beitrage zur Geologischen Karte der
Schweitz, Lugano.
Beyries, S., Boeda, E., 1983. Etude technologique et traces d’utilisation des « eclats debordants » de Corbehem (Pas-de-
Calais). Bulletin de la Societe Prehistorique Francaise 80, 275–279.
Bini, A., Cappa, G., 1975. Appunti sull’evoluzione e distribuzione del carsismo nel territorio del Monte Generoso (Canton
Ticino) in rapporto al vicino territorio comasco. Actes du 5e Congres Suisse de Speleologie, 61–67.
Bini, A., Felber, M., Pomicino, N., Zuccoli, L., 1996. Maximum extension of the glaciers (MEG) in the area comprised
between Lago di Como, Lago Maggiore and their respective end-moraine system. Geologia Insubrica 1 (1+2), 65–78.
Bona, F., 2003. Associazioni faunistiche a macromammiferi della Caverna Generosa (Lo Co 2694). Geologia Insubrica 6,
1–4.
Bona, F., 2004a. New data on cave bear populations from the Pleistocene deposits of Caverna Generosa (Lombardy,
Northern Italy). Abstract in 10th ICBS congress, Mas d’Azil.
Bona, F., 2004b. I depositi del Pleistocene Superiore della Caverna Generosa (Lo Co 2694). Analisi Paleontologica ed
Interpretazioni Paleoambientali. Tesi di dottorato, Universita degli Studi di Milano.
Bona, F., 2004c. Preliminary analysis on Ursus spelaeus Rosenmuller and Heinroth, 1794 populations from ‘‘Caverna
Generosa’’ (Lombardy – Italy). Cahiers scientifiques, h.s 2, 87–98.
Bona, F., Cattaneo, C., 2003. Inusuali tracce di predazione in Ursus spelaeus. Bollettino Societa Paleontologica Italiana
42, 1-5.Bordes, F., 1961. Typologie du Paleolithique ancien et moyen. Publications de l’Institut de Prehistoire de
l’Universite de Bordeaux, Memoire 1.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320318
Brugal, J.-Ph., Jaubert, J., 1991. Les gisements paleontologiques pleistocenes a indices de frequentation humaine : un
nouveau type de comportement de predation ? Paleo 3, 15–41.
Chaline, J., Baudvin, H., Jammot, D., Saint-Girons, M.C., 1974. Les proies des rapaces : petits mammiferes et leur
environment. Douin, Paris.
Cremaschi, M., 1981. Le attuali conoscenze sul Paleolitico lombardo nel suo contesto paleoambientale. In: Atti I
Convegno Archeologico Regionale. Museo Archeologico Cavriana, pp. 35–53.
Cremaschi, M., Fedoroff, N., Guerreschi, A., Huxtable, J., Colombi, N., Castelletti, L., Maspero, A., 1990. Sedimentary
and pedological processes in the Upper Pleistocene loess in Northern Italy. The Bagaggera sequence. Quaternary
International 5, 23–38.
Fedele, F., 1968. Ricerche sui giacimenti quaternari del Monfenera. Studio sui macromammiferi della caverna Ciota Ciara
(scavi 1966). Rivista di Antropologia 55, 247–269.
Fedele, F., 1972. Apercu des recherches dans les gisements du Monfenera (Valsesia, Alpes Pennines). Bulletin d’Etudes
Prehistoriques Alpines IV, 5–39.
Fedele, F., 1976. Paleolitico medio a Trino. Rapporto sulle ricerche 1976. Gruppo di Studio del Quaternario padano 3,
59–76.
Fedele, F., 1984–1985. Il Paleolitico in Piemonte: le Api Occidentali. Ad Quintum. Archeologia del Nord-Ovest 7, 23–44.
Fedele, F., Gagliardi, G., 1988. Ricerche sul giacimento paleolitico del Buco del Piombo, 1975–1978. Quaderni Erbesi 9,
147–166.
Felber, M., 1993. Storia della Geologia del tardo terziario e del quaternario nel mendrisiotto (Ticino Meridionale,
Svizzera). DISS. ETH n8 10125.
Foley, R., 1981. Off-site archaeology: an alternative approach for the short-sited. In: Hodder, I., Isaac, G.L., Hammond,
N. (Eds.), Patterns of the past: studies in honour of David Clarke. Cambridge University Press, Cambridge,
pp. 157–183.
Fusco, V., Visconti Di Modrone, V., 1989. La grotta dell’orso del Monte Generoso. Associazione Archeologica Ticinese,
24–25.
Hille, P., Rabeder, G., 1986. Die Ramesch-Knochenhohle im Totem Gebirge. Mitteilungen der Kommission fur
Quartarforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 5.
Isaac, G.L., 1981. Stone age visiting cards; approaches to the study of early land use patterns. In: Hodder, I., Isaac,
G.L., Hammond, N. (Eds.), Patterns of the past: studies in honour of David Clarke. Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 131–155.
Koby, F.E., 1954. Les paleolithiques ont-ils chasse les ours des cavernes ? Actes Societe Jurassienne d’emulation 61,
1–48.
Jequier, J.P., 1975. Le Mousterien Alpin. Eburodunum II. Cahier d’Archeologie Romande, 2.
Joris, O., Fernandez, E.A., Weninger, B., 2003. Radiocarbon evidence of the Middle to Upper Palaeolithic transition in
southwestern Europe. Trabajos de Prehistoria 60, 15–38.
Le Tensorer, J.M., 1998. Le Paleolithique en Suisse. Prehistoire d’Europe. Editions Jerome Millon, Grenoble, p. 8.
Maddalena, T., Moretti, M., Del Fante, F., 1998. I mammiferi del Monte Generoso. Ferrovia Monte Generoso SA,
Capolago.(CH).
Neugebauer-Maresch, Ch., 1999. Le Paleolithique en Autriche. Prehistoire d’Europe. Editions Jerome Millon, Grenoble,
p. 8.
Niethammer, J., Krapp, F., 1978. Handbuch der Saugetiere Europas, Bd 1, Rodentia I (Sciuridae, Castoridae, Gliridae,
Muridae). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
Niethammer, J., Krapp, F., 1982. Handbuch der Saugetiere Europas, Bd 2/1, Rodentia II (Cricetidae, Arvicolidae,
Zapodidae, Spalacidae, Hystricidae, Capromidae). Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
Niethammer, J., Krapp, F., 1990. Handbuch der Saugetiere Europas, Bd 3/1, Insectivora, Primates. Akademische
Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
Pacher, M., 2003. Upper Pleistocene assemblages at alpine sites in Austria and adjacent regions. Preistoria Alpina 39,
115–127.
Palma di Cesnola, A., 1996. Le Paleolithique inferieur et moyen en Italie. Prehistoire d’Europe. Editions Jerome Millon,
Grenoble, 1.
Pasquare, G., 1978. F. Giurassico. In: Ardito, D. (Ed.), Geologia dell’Italia. Unione Tipografico Editore Torinese.
Pei, W.C., 1936. Le role des phenomenes naturels dans l’eclatement et le faconnement des roches dures utilisees par
l’Homme prehistorique. These de Doctorat de la Faculte des Sciences de Paris.
Peresani, M., 2003. An initial overview of the middle Palaeolithic discoid industries in Central-Northern Italy. In:
Peresani, M. (Ed.), The Discoid Technology. Advances and Implications. British Archaeological Reports, Interna-
tional Series, 1120, pp. 209–223.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320 319
Peresani, M., Porraz, G., 2004. Re-interpretation et mise en valeur des niveaux mousteriens de la Grotte du Broion (Monti
Berici, Venetie). Etude techno-economique des industries lithiques. Rivista di Scienze Preistoriche LIV, 181–247.
Pittioni, R., 1984. Ein Mousterien-Schaber aus der Salzofenhole im Totem Gebirge (Steiermark). Die Hohle 35, 1–4.
Plisson, H., Mauger, M., 1988. Chemical and mechanical alteration of microwear polishes: an experimental approach.
Helinium XXVIII, 3–16.
Porraz, G., Peresani, M., 2006. Occupations du territoire et exploitation des matieres premieres : presentation et
discussion sur la mobilite des groupes humains au Paleolithique moyen dans le nord-est de l’Italie. In: Bressy, C.,
Burke, A., Chalard, P., Lacombe, S., Martin, H. (Eds.), Notions de territoire et mobilite : exemples de l’Europe et des
premieres nations en Amerique du nord avant le contact europeen, 116. ERAUL, Liege, pp. 11–21.
Poggiani Keller, R., 1992. Carta Archeologica della Lombardia, II. Provincia di Bergamo. Panini editore.
Roebroecks, W., De Loecker, D., Hennekens, P., Ieperen, M., 1996. A veil of stones’’: on the interpretation of an early
Middle Palaeolithic low density scatter at Maastricht-Belvedere (The Netherlands). Analecta Praehistorica Leidensia
25, 1–16.
Rossi, S., Alberti, F., Previati, R., Bini, A., 1991. Geologia e tettonica sulla sponda occidentale del Lago di Como.
Rendiconti Societa Geologica Italiana 14, 135–140.
Sphani, J.C., 1953. Les gisements a Ursus spelaeus de l’Autriche et leurs problemes. Bulletin de la Societe Prehistorique
Francaise 51, 346–367.
Thiebaut, C., 2001. Caracterisation des encoches et des denticules au Paleolithique moyen. Memoire de DEA, Universite
de Provence.
Tillet, Th., 1997. Les grottes a ours et les occupations neandertaliennes dans les Alpes. In: Tillet, Th., Binford, L. (Eds.),
L’Homme et l’Ours, Actes du Colloque International d’Auberives-en-Royans, Isere.
Tillet, Th., 2001. Le paleolithique moyen dans les Alpes et le Jura : exploitation de milieux de contraintes d’altitudes. In:
Conrad, N.J., Binford, L. (Eds.), Settlement Dynamics of the Middle Palaeolithic and Middle Stone Age, Tubigen
publications in Prehistory, introductory volume, Verlag, pp. 421–446.
Tillet, Th., 2002. Les Alpes et le Jura. Quaternaire et Prehistoire ancienne. Editions scientifiques Gordon et Breach, Paris.
Tillet, Th., 2003. Il Paleolitico medio e inferiore delle Alpi e dintorni. Preistoria Alpina 39, 49–58.
Tillet, Th., Bernard-Guelle, S., 1998. Behavior patterns, strategies and seasonality in the Mousterian site of Preletang
(Vercors): the Mousterian in Alps. In: Conard, N.J., Wendorf, F. (Eds.), Middle Palaeolithic and Middle stone age
settlement system. Proceeding XIII UISPP Congress, Workshop 5, Forli, pp. 319–326.
F. Bona et al. / L’anthropologie 111 (2007) 290–320320