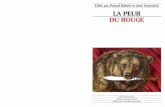Introduction au livre Des neurosciences à la philosophie (Faucher & Poirier)
Qui a peur du déterminisme ? Sur la prétendue incompatibilité entre neurosciences et conception...
Transcript of Qui a peur du déterminisme ? Sur la prétendue incompatibilité entre neurosciences et conception...
Qui a peur du déterminisme ?Sur les résistances ordinaires aux explications
neuroscientifiques du comportement humain
Florian Cova
Responsabilité morale et image manifeste
Pour de nombreux philosophes, l’une des tâches de la philosophie est de réconcilier l’image manifeste (ou naïve) que nous avons du monde et l’image scientifique du monde.
Au coeur de cette image manifeste se trouve la croyance que nous sommes des agents, c’est–à-dire des êtres libres et moralement responsables de nos actes, du fait du contrôle que nous exerçons sur eux.
Pour certains philosophes, cette croyance est tellement fondamentale que l’abandoner aurait des consequences désastreuses (Smilansky, 2000): Ce serait la fin de toute moralité. La possibilité même de certains sentiments (dont la
gratitude et l’amour) disparaîtrait.
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Ces hypothèses pessimistes semblent pourtant corroborées par la recherche en psychologie expérimentale.
Prenons par exemple l’étude de Vohs & Schooler (2008):
Les participants reçoivent un extrait d’un livre du biologiste et Prix Nobel Francis Crick. Une partie des participants recevait un extrait dans lequel Crick affirme que, comme lui, la plupart des gens très cultivés et intelligents reconnaissent que le libre arbitre n’est qu’une illusion sécrétée par notre cerveau. Les autres participants recevaient un autre extrait du même livre, dans lequel il n’était pas question de libre arbitre.
Vohs et Schooler avaient fait l’hypothèse que lire le premier passage, mais pas le second, diminuerait la croyance des participants dans leur propre liberté.
Les participants remplissaient ensuite un questionnaire mesurant le degré de liberté qu’ils s’attribuaient. Les résultats ont montré que la manipulation était un succès : les gens ayant lu le premier texte s’estimaient moins libres que ceux ayant lu le second texte.
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Vohs & Schooler (2008):
Dans un second temps, ces mêmes participants devaient répondre sur un ordinateur à une vingtaine de problèmes mathématiques.
Il leur était dit que le programme avait un défaut et que la réponse s’afficherait automatiquement à l’écran, à moins qu’ils n’appuient sur une touche à l’apparition de chaque problème. Il leur était ainsi possible de tricher en n’appuyant pas sur la touche pour voir la réponse s’afficher avant de répondre.
Ce qu’ont observé Vohs et Schooler, c’est que les personnes ayant reçu le premier texte avaient plus tendance à tricher que celles ayant reçu le second (en moyenne, les premières trichaient dans 14 essais sur 20 tandis que les secondes trichaient dans 10 essais sur 20).
Vohs et Schooler ont trouvé un effet semblable dans une seconde expérience lors de laquelle les participants devaient résoudre certains problèmes logiques et gagnaient 1$ pour chaque problème résolu.
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Vohs & Schooler (2008):
Après avoir rempli les questionnaires, les participants devaient s’auto-évaluer à partir d’une feuille de réponse et se servir eux-même dans une enveloppe contenant des billets de 1$. Les questionnaires étaient ensuite détruits avant que l’expérimentateur ait l’occasion de les consulter. Il était donc possible aux participants de tricher en prenant plus de billets que de problèmes résolus.
Là encore, les participants ayant préalablement lu des phrases niant l’existence de la liberté avaient une plus forte tendance à tricher (ils retiraient en moyenne des sommes plus fortes que les autres participants).
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Diminuer expérimentalement la croyance au libre-arbitre conduit à : Une diminution du contrôle de soi, Une augmentation de l’agressivité et une diminution
des tendances prosociales, Une augmentation des comportements malhonnêtes (entre
autres : tricher).
De plus, il a été observé que la croyance à la liberté corrélait : Positivement avec le succès dans le milieu
professionnel. Négativement avec une tendance au conformisme.
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Pour ce qui est des sentiments, moins de données sont disponibles: Il a été récemment montré que diminuer la croyance au
libre-arbitre diminue la gratitude ressentie (MacKenzie, Vohs & Baumeister, 2014).
Nous avons néanmoins trouvé une corrélation entre croyance au libre-arbitre et amour passionnel.
2.5
5.0
7.5
-3 -2 -1 0 1Free W ill
Love DF$pays
IndiaUS
De la nécessité de croire en sa propre responsabilité
Que les sciences (et en particulier la psychologie) puisse nous apprendre quelque chose sur les effets psychologiques de la croyance en notre propre liberté et notre propre responsabilité morale, cela n’a rien d’étonnant.
Cependant, certains scientifiques se sont révélés plus ambitieux et ont pensé pouvoir résoudre le problème proprement philosophique : celui de savoir si nous sommes effectivement libres et moralement responsables.
L’image scientifique : la liberté comme illusion
La réponse à laquelle ils parviennent le plus souvent est que la liberté est une illusion.
L’image scientifique : la liberté comme illusion
La plupart de ces critiques scientifiques du libre-arbitre sont faites au nom de la science, sur la base de données en psychologie et en neurosciences.
Et en particulier sur les fameuses expériences de Libet (1983) :
L’image scientifique : la liberté comme illusion
Il y a eu depuis des réplications des expériences de Libet.
Par exemple, Soon et al. (2008):
L’image scientifique : la liberté comme illusion
Les expériences de Libet sont censées prouvées que nous ne sommes pas libres pour trois raisons :
1) Elles montreraient que la conscience ne joue aucun rôle dans la production de nos actions.
2) Elles montreraient que nos états mentaux ne sont pas la source ultime de nos actions.
3) Elles montreraient qu’il nous est impossible de faire autre chose que ce que nous faisons.
Or, la liberté, c’est bien : pouvoir faire autrement car nous sommes la source ultime et consciente de nos actions.
L’image scientifique : la liberté comme illusion
“The popular conception of free will seems to rest on two assumptions: (1) that each of us could have behaved differently than we did in the past, and (2) that we are the conscious source of most of our thoughts and actions in the present. As we are about to see, however, both of these assumptions are false.”
Quelles conséquences pour le grand public ?
Selon ces scientifiques (psychologues, neuroscientifiques) et les philosophes qui les suivent, les progrès de la compréhension neuroscientifique des déterminants du comportement humain vont nécessairement conduire à de grandes réformes.
Pourquoi ? Parce que nos concepts de liberté et de responsabilité vont se révéler obsolètes, des illusions mal adaptées à la réalité.
Les conceptions philosophiques de la liberté
Cependant, ces critiques et prédictions présupposent une conception exigeante et incompatibiliste de la liberté et de la responsabilité morale.
Il existe des conceptions moins exigeantes, dites compatibilistes.
Déterminisme Indéterminisme
Compatibilisme Compatibilisme (?)
Incompatibilisme Déterminisme « dur » Libertarisme
Que faut-il entendre par liberté ?
“I see him [Daniel Wegner] as the killjoy scientist who shows that Cupid doesn’t shoot arrows and then insists on entitling his book The Illusion of Romanic Love. [...] free will is not an illusion; all the varieties of free will worth wanting are, or can be, ours
‘‘the ‘free will’ that compatibilists defend is notthe free will that most people feel they have.’’
‘‘c’est là un misérable subterfuge, dont quelques esprits ont encore la faiblesse de se contenter, s’imaginant ainsi qu’ils ont, par ce dérisoire artifice verbal, résolu ce difficile problème’’
Quelle conception ordinaire de la liberté ?
Une réponse possible est, comme Dennett, de refuser l’idée que la conception ordinaire de la liberté doive être notre guide (c’est-à-dire d’adopter une posture révisionniste) : Seriously, [Harris’] main objection to compatibilism,
issued several times, is that what compatibilists mean by “free will” is not what everyday folk mean by “free will.” Everyday folk mean something demonstrably preposterous, but Harris sees the effort by compatibilists to make the folks’ hopeless concept of free will presentable as somehow disingenuous, unmotivated spin-doctoring, not the project of sympathetic reconstruction the compatibilists take themselves to be engaged in. So it all comes down to who gets to decide how to use the term “free will.” Harris is a compatibilist about moral responsibility and the importance of the distinction between voluntary and involuntary actions, but he is not a compatibilist about free will since he thinks “free will” has to be given the incoherent sense that emerges from uncritical reflection by everyday folk.
Une autre solution consiste à considérer que la notion ordinaire de liberté est cohérente et doit servir de référence, mais que celle-ci n’est pas incompatibiliste.
Quelle conception ordinaire de la liberté ?
« On a du mal à croire ce qui est écrit tant cela paraît surprenant, étonnant, stupéfiant. En fait, c'est du grand n'importe quoi, jusqu'au jour où certaines études sérieuses viendront contresigner ce verdict. Nos gènes pourraient alors excuser nos méfaits et nos vices. »
« Dans les sociétés modernes, jusqu'à maintenant, le déterminisme n'est pas admis. Chacun a son libre-arbitre, est responsable de ses actes et doit répondre de ses manquements. »
La philosophie expérimentale : l’exemple des cas Frankfurt
L’idée selon laquelle la conception ordinaire de la liberté requiert le pouvoir de faire autrement est contredite par nos intuitions sur les fameux cas Frankfurt :
Dans ces cas, nous sommes censés avoir l’intuition que Jones est moralement responsable de son acte, quand bien même il ne pouvait pas faire autrement.
Le docteur Black veut tuer la femme de Jones. Pour parvenir à ses fins, il a implanté à son insu dans le cerveau de Jones un dispositif capable de prendre le contrôle de Jones et de le pousser à tuer sa femme. Mais le docteur Black sait que Jones a prévu de se débarrasser de sa femme. Le dispositif dans le cerveau de Jones est ainsi programmé pour ne s’activer que si Jones renonce à tuer sa femme. Jones tue sa femme de son propre chef et le dispositif n'est jamais activé.
Miller, J.S., & Feltz, A. (2011). Frankfurt and the folk: An experimental investigation of Frankfurt-style cases. Consciousness & Cognition, 20, 401-414.
La philosophie expérimentale : l’exemple des cas Frankfurt
M. Green a demandé à M. Jones, le vigile, de voler la voiture de Mme Green le 7 octobre à midi précisément. Cependant, M. Green ne fait pas entièrement confiance à M. Jones, et a pris en conséquence des mesures extraordinaires. M. Green a fait appel à des neuroscientifiques qui ont implanté un mécanisme dans le cerveau de M. Jones, à l’insu de celui-ci. Ce mécanisme est situé près des neurones impliqués dans la prise de décision et est programmé pour envoyer à midi exactement une série de décharges qui pousseront nécessairement M. Jones à voler la voiture. Néanmoins, il se trouve qu’à midi juste, M. Jones décide de lui-même de voler la voiture, ce qu’il fait. Étant donné que M. Jones décide de lui-même de voler la voiture, les décharges du mécanisme n’ont aucun effet, car les neurones en question sont déjà activés par le processus de décision initié par M. Jones lui-même. Cependant, si M. Jones n’avait pas, à ce moment précis, décidé de lui-même de voler la voiture, le mécanisme aurait activé ses neurones de la prise de décision, et M. Jones aurait tout de même fini par voler la voiture.
Miller, J.S., & Feltz, A. (2011). Frankfurt and the folk: An experimental investigation of Frankfurt-style cases. Consciousness & Cognition, 20, 401-414.
La philosophie expérimentale : l’exemple des cas Frankfurt
Était-il possible à M. Jones de faire en sorte de ne pas décider de voler la voiture à midi le 7 octobre ?
À midi le 7 octobre, M. Jones avait-il la possibilité de faire autre chose que voler la voiture ?
Après avoir lu ce texte et répondu à ces deux questions, les participants devaient noter sur une échelle allant de 1 à 7 leur accord avec la phrase suivante (7 étant l’accord maximum) :
« M. Jones est-il moralement responsable du fait d’avoir volé la voiture ? »
Miller, J.S., & Feltz, A. (2011). Frankfurt and the folk: An experimental investigation of Frankfurt-style cases. Consciousness & Cognition, 20, 401-414.
La philosophie expérimentale : l’exemple des cas Frankfurt
Dans l’ensemble, la moyenne des réponses à cette question était de 5,27. Une fois éliminés les participants qui avaient répondu autre chose que non à l’une des deux questions (ou aux deux questions), cette moyenne montait à 5,59.
Autrement dit, la plupart des participants étaient prêts à dire que M. Jones était responsable du fait d’avoir volé la voiture, quand bien même il n’aurait pas pu faire autrement.
Dans une expérience utilisant la même méthode, j’ai aussi pu observer que la plupart des participants jugent que M. Jones a agi librement (of his own free will).
Nahmias, E., Morris, S. G., Nadelhoffer, T., & Turner, J. (2006). Is incompatibilism intuitive?. Philosophy and Phenomenological Research, 73(1), 28-53.
Un sens commun compatibiliste ?
Dans le même esprit, Nahmias et ses collègues ont testé les intuitions des gens au sujet d’agents dont les actions étaient déterminées par leur passé et donc prévisibles. Premier cas : un agent dont les actions sont prédites
par un Superordinateur avant même sa naissance. Deuxième cas : un agent dont les actions sont
complètement expliquées par son bagage génétique et son environnement.
Dans les deux cas, la plupart des participants ont jugé que ces agents étaient libre et moralement responsables de leurs actes.
Autrement, dit les gens semblent avoir une conception compatibiliste de la liberté et de la responsabilité morale.
Nahmias, E., Shepard, J. & Reuter, S. (2014). It’s OK if ‘my brain made me do it’: People’s intuitions about free will and neuroscientific prediction. Cognition, 133, 502-516.
Un sens commun compatibiliste ?
Recent brain scanning studies have shown that specific patterns of brain activity can be used to predict simple decisions several seconds before people are consciously aware of those decisions. Imagine that in the future brain scanning technology becomes much more advanced. Neuroscientists can use brain scanners to detect all the activity in a person’s brain and use that information to predict with 100% accuracy every single decision a person will make before the person is consciously aware of their decision.
[The neuroscientists cannot, however, do anything to change brain activity and hence they cannot directly influence thoughts and actions. / The neuroscientists can even use this technology to alter a person’s decision by altering the person’s brain activity without the person being aware of it.]
Nahmias, E., Shepard, J. & Reuter, S. (2014). It’s OK if ‘my brain made me do it’: People’s intuitions about free will and neuroscientific prediction. Cognition, 133, 502-516.
Un sens commun compatibiliste ?
Suppose that in the future a woman named Jill agrees, as part of a neuroscience experiment, to wear this brain scanner for a month (it is a lightweight cap). The neuroscientists are able to use real-time information about her brain activity to predict everything that Jill will think or decide, even before she is aware of these thoughts or decisions.
[However, they cannot alter her brain activity to change what she thinks and does. / And without her knowing it, they can alter her brain activity to change what she thinks and does.]
On election day, Jill is considering how she will vote for President and for Governor. Before she is aware of making any decisions, the neuroscientists can see, based on her brain activity, that she is about to decide to vote for Smith for President and Green for Governor.
[ Just as the neuroscientists predicted, Jill votes for Smith for President and Green for Governor. / However, before she is aware of making any decisions, the neuroscientists alter Jill’s brain activity so that she votes for Black for Governor, though this has no effect on how she votes for President, and just as the neuroscientists predicted, Jill votes for Smith for President.]
Nahmias, E., Shepard, J. & Reuter, S. (2014). It’s OK if ‘my brain made me do it’: People’s intuitions about free will and neuroscientific prediction. Cognition, 133, 502-516.
Un sens commun compatibiliste ?
As with her decisions to vote for Smith for President [and Green for Governor], the neuroscientists are able to predict every decision Jill ends up making with 100% accuracy while she is wearing the scanner. Occasionally, Jill tries to trick the neuroscientists by changing her mind at the last second or by stopping herself from doing something that she just decided to do, but the neuroscientists predict these events as well. Indeed, these experiments confirm that all human mental activity is entirely based on brain activity such that everything that any human thinks or does could be predicted ahead of time based ontheir earlier brain activity.
Jill voted for President of her own free will. Jill voted for Governor of her own free will. Jill was responsible for how she voted for President. Jill was responsible for how she voted for Governor.
Nahmias, E., Shepard, J. & Reuter, S. (2014). It’s OK if ‘my brain made me do it’: People’s intuitions about free will and neuroscientific prediction. Cognition, 133, 502-516.
Un sens commun compatibiliste ?
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Cependant, Nichols et Knobe se sont interrogés sur le fait de n’utiliser que des cas concrets.
Ils ont utilisé une description du déterminisme contrastant deux univers :
Imaginez un univers (appelons-le l’Univers A) dans lequel tout ce qui se produit est entièrement causé par tout ce qui s’est produit auparavant. Cela est vrai depuis le tout premier commencement de cet univers, de telle sorte que ce qui s’est produit au tout début a causé ce qui s’est produit juste après, et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui. Par exemple : un jour, John décide de manger des frites. Comme tout le reste, cette décision est entièrement causée par ce qui s’est produit auparavant. Ainsi, si tout dans cet univers jusqu’à la décision de John avait été identique, alors il devait forcément arriver que John décide de manger des frites.
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Imaginez maintenant un univers (appelons-le l’Univers B) dans lequel presque tout ce qui se produit est entièrement causé par tout ce qui s’est produit auparavant. La seule exception, ce sont les décisions humaines. Par exemple : un jour Marie décide de manger des frites. Puisque dans cet univers les décisions de chaque personne ne sont pas entièrement causées par ce qui a précédé, alors, même si tout avait été identique jusqu’à la décision de Marie, Marie n’aurait pas été obligée de manger des frites. Elle aurait pu décider de manger quelque chose d’autre.
La différence clé est donc que dans l’Univers A, toute décision est entièrement causée par ce qui a précédé la décision. Étant donné les événements passés, chaque décision devait forcément se produire de la façon dont elle s’est produite. Par contraste, dans l’Univers B, les décisions ne sont pas complètement causées par les événements passés et ne devaient pas forcément se produire de la façon dont elles se sont produites.
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Après avoir donné aux participants la description d’un univers déterministe, ils donnaient au participants soit : Un cas concret : Dans l’Univers A, un homme appelé Bill se sent
attiré par sa secrétaire et décide que la seule façon d’être avec elle est de tuer sa femme et ses trois enfants. Il sait qu’il est impossible de s’échapper de sa maison en cas d’incendie. Avant de partir en voyage d’affaires, il installe dans sa cave un appareil qui met le feu à sa maison et carbonise sa famille. Bill est-il pleinement responsable du meurtre de sa femme et de ses enfants ?
Une question abstraite : Dans l’Univers A, est-il possible pour une personne d’être pleinement responsable de ses actions ?
Les participants donnaient des réponses compatibilistes dans le cas concret, mais des réponses incompatibilistes à la question abstraite.
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Conception Incompatibilist
e
Réponses Incompatibilist
es
Question abstraite
RéponsesCompatibilistes
BiaisEmotionnel
Cas concret
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Pour tester cette hypothèse, Knobe et Nichols ont ensuite contrasté deux cas concrets :
Une situation émotionnellement faible : As he has done many times in the past, Mark arranges to cheat on his taxes. Is it possible that Mark is fully morally responsible for cheating on his taxes?
Une question abstraite : As he has done many times in the past, Bill stalks and rapes a stranger. Is it possible that Bill is fully morally responsible for cheating on his taxes?
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Univers sans
déterminisme
(Univers B)
Univers
déterministe
(Univers A)
Emotionnellem
ent fort95% 64%
Emotionnellem
ent faible89% 23%
Pourcentage de réponses compatibilistes dans
chaque condition
Nichols, S., & Knobe, J. (2007). Moral responsibility and determinism: The cognitive science of folk intuitions. Nous, 41(4), 663-685.
Le compatibilisme comme biais
Conception Incompatibilist
e
Réponses Incompatibilist
es
Question abstraiteTricher sur ses
impôts
RéponsesCompatibilistes
BiaisEmotionnel
Viol
Feltz, A., & Cova, F. (in press) Moral Responsibility and Free Will: A Meta-Analysis. Consciousness and Cognition
Objection, I
Cependant, une méta-analyse sur plus de 30 études révèle que l’impact des émotions sur les jugements de responsabilité dans de tel cas est très faible (taille d’effet : <1%).
Cova, F., Bertoux, M., Bourgeois-Gironde, S., & Dubois, B. (2012). Judgments about moral responsibility and determinism in patients with behavioural variant of frontotemporal dementia: Still compatibilists. Consciousness and cognition,21(2), 851-864.
Objection, II
De plus, les patients souffrant d’une variante comportementale de la démence frontotemporale, dont les réactions émotionnelles sont diminuées, continuent à donner des réponses majoritairement compatibilistes.
Nahmias, E. (2006). Folk fears about freedom and responsibility: Determinism vs. reductionism. Journal of Cognition and Culture, 6(1-2), 215-237.
Déterminisme et Epiphénoménisme
Déterminisme Psychologique – Imaginez que dans un univers semblable à celui dans lequel nous habitons se trouve une planète nommée Erta qui ressemble beaucoup à la nôtre. La géographie et la vie y sont très similaires à celles que l’on peut trouver sur Terre. On y trouve aussi une forme de vie avancée, les Ertains, qui parlent et se comportent comme nous, et nous ressemblent beaucoup. Néanmoins, la science des Ertains est beaucoup plus avancée que la nôtre. Plus précisément, les psychologues de la planète Erta ont découvert la façon précise dont fonctionne l’esprit des Ertains. Ces psychologues ont découvert que toute décision prise ou action accomplie par un Ertain est entièrement causée par les pensées, désirs et projets qui se trouvent dans l’esprit de cet Ertain et que ces pensées, désirs et projets sont entièrement causés par les événements qui ont précédé, y compris le patrimoine génétique et l’éducation de cet Ertain. Ainsi, à chaque fois qu’un Ertain agit, son action est entièrement causée par les pensées, désirs et projets qu’il a à l’esprit à ce moment donné, et ces pensées, désirs et projets sont entièrement causés par une chaîne d’événements antérieurs que l’on peut remonter jusqu’au patrimoine génétique et à l’éducation de cet Ertain.
Nahmias, E. (2006). Folk fears about freedom and responsibility: Determinism vs. reductionism. Journal of Cognition and Culture, 6(1-2), 215-237.
Déterminisme et Epiphénoménisme
Déterminisme Neurologique – Néanmoins, la science des Ertains est beaucoup plus avancée que la nôtre. Plus précisément, les neuroscientifiques de la planète Erta ont découvert la façon précise dont fonctionne le cerveau des Ertains. Ces neuroscientifiques ont découvert que toute décision prise ou action accomplie par un Ertain est entièrement causée par les réactions chimiques et les processus neurologiques qui se déroulent dans le cerveau de cet Ertain et que ces réactions chimiques et processus neurologiques sont entièrement causés par les événements qui ont précédé, y compris le patrimoine génétique et l’environnement physique de cet Ertain. Ainsi, à chaque fois qu’un Ertain agit, son action est entièrement causée par les réactions chimiques et les processus neurologiques qui se produisent dans son cerveau à ce moment donné, et ces réactions chimiques et processus neurologiques sont entièrement causés par une chaîne d’événements antérieurs que l’on peut remonter jusqu’au patrimoine génétique et à l’environnement physique de cet Ertain.
Nahmias, E. (2006). Folk fears about freedom and responsibility: Determinism vs. reductionism. Journal of Cognition and Culture, 6(1-2), 215-237.
Déterminisme et Epiphénoménisme
Chaque participant recevait l’un des deux scénarios puis répondait aux deux questions suivantes :1. Lorsque les Ertains agissent, agissent-ils librement
?2. Les Ertains méritent-ils d’être blâmés et loués pour
leurs actions ?
Alors que leurs réponses étaient hautement compatibilistes pour le cas Déterminisme Psychologique (72% de réponses oui à la première question et 77% à la seconde question), elles étaient franchement incompatibilistes dans le cas Déterminisme Neurologique (18% de réponses oui à la première question et 19% à la seconde question).
Murray, D., & Nahmias, E. (2014). Explaining away incompatibilist intuitions.Philosophy and Phenomenological Research, 88(2), 434-467.
Déterminisme et Epiphénoménisme
Murray et Nahmias distinguent deux thèses : Le déterminisme est la thèse selon laquelle tout ce qui arrive est déterminé, y compris nos actions. Mais cela n’empêche pas nos états mentaux (croyances, désirs, décisions) d’avoir une influence sur nos actions. Leur influence est juste déterminée, et eux-mêmes sont déterminé.
L’épiphénoménisme est la thèse selon laquelle nos états mentaux ne jouent aucun rôle et n’ont aucun pouvoir causal. Ils ne font rien.
Selon Murray et Nahmias, les gens sont compatibilistes, mais ils peuvent donner l’impression d’être incompatibilistes quand ils prennent le déterminisme comme une version de l’épiphénoménisme.
Murray, D., & Nahmias, E. (2014). Explaining away incompatibilist intuitions.Philosophy and Phenomenological Research, 88(2), 434-467.
La théorie de la confusion
Conception Compatibiliste
Réponses Compatibilistes
Cas concrets
RéponsesIncompatibilist
es
Confusion
Questions abstraites
Murray, D., & Nahmias, E. (2014). Explaining away incompatibilist intuitions.Philosophy and Phenomenological Research, 88(2), 434-467.
La théorie de la confusion
Les attitudes réactives
Un célèbre argument se fonde non sur les intuitions, mais sur les attitudes réactives : la colère, la culpabilité, la gratitude – toutes ces émotions qui semblent étroitement liées à l’idée de responsabilité morale.
Selon le philosophe Peter Strawson, notre concept de responsabilité morale (et donc de libre-arbitre) prend son sens dans ces attitudes et les pratiques qui lui sont liées. C’est là ce qui donne sens à ce concept.
Or, les attitudes réactives ne sont pas sensibles à la question du déterminisme. Il n’y a donc pas de raison de penser que le déterminisme menace le libre-arbitre et la responsabilité morale.
Les attitudes réactives
Certains incompatibilistes ne sont pas d’accord avec Strawson et pensent au contraire que les attitudes réactives (comme la colère) sont sensibles au déterminisme.
Voici un exemple donné par le philosophe Robert Kane : Such incompatibilist intuitions about the reactive
attitudes are widespread, and I certainly share them. My own thoughts on this matter were inspired by a local trial of a young man who had raped and murdered a sixteen year old girl. I imagined myself as a relative of the victim attending the trial on a daily basis. My initial thoughts of the young man were filled with anger and resentment. But as I listened daily to the testimony of how he came to have the mean character and perverse motives he did have a sordid story of parental neglect, child abuse, bad role models, and so on some of my resentment toward him decreased and was directed toward other persons who abused and influenced him. Some resentment was indeed left for the young man, but it was due to my continuing belief that he had some residual responsibility for what he became, despite the abuse and bad influences. In such manner, the changes in reactive attitudes, as well as the residual resentments, are related to beliefs about ultimate responsibility.
Les attitudes réactives
Dans cette dernière série d’expériences, je me suis concentré sur le cas de Robert Harris, une histoire vraie, celle d’un homme :
Qui a tué deux adolescents « pour rire » après avoir volé leur voiture et leur avoir promis de les laisser en vie.
A eu une enfance tragique, pleine de violences.
Questions : Est-il vrai que le récit de l’enfance de Harris nous
conduit à réviser nos attitudes réactives envers lui ?
Si oui, est-ce parce que nous le considérons déterminé, ou juste parce que nous avons pitié de lui ?
Les attitudes réactives
Ces études ont été menées en collaboration avec Paul Egré et Aurélien Nioche à l’Institut Jean Nicod.
Dans une première étude, nous avons donné à un groupe de participants la description du meurtre puis celle de l’enfance de Paul Harris (toutes deux tirées d’un article du Los Angeles Times).
A deux reprises, nous avons posés aux participants des questions sur : Leurs attitudes réactives. Le déterminisme. Le libre-arbitre. La responsabilité morale de Harris. Son « intelligence morale ». Sa santé mentale.
Les attitudes réactives
Reactive attitudes
Determinism Moral reponsibility
Free-will Moral ability Sanity0123456789
10BeforeAfter
ns
ns
ns ns ***
***
Les attitudes réactives
A quoi cette diminution dans les attitudes réactives est-elle due ? Deux hypothèses :1) C’est parce que nous le percevons comme
déterminé que nos attitudes réactives baissent.
2) C’est parce que la pitié vient contrebalancer la colère.
Pour tester l’influence de chaque facteur, nous avons manipulé la qualité de l’enfance (triste/heureuse) et le caractère « déterminant » de celle-ci (déterminante/non-déterminante).
En conclusion
Ce que ces données suggèrent, c’est d’abord que les gens ont une conception compatibiliste de la liberté :
Les données neuroscientifiques ne menacent donc pas leur image d’eux-mêmes comme êtres libres.
Et ne requièrent pas une remise en cause profonde de nos institutions.
Et que leur peur apparente du déterminisme est en fait une peur de l’épiphénoménisme :
Il est donc possible, en levant cette confusion, de leur faire accepter ce que la science nous apprend de l’homme.
Et cela passe par une meilleure communication scientifique.
Merci de votre attention !
References Bebin, X. (2006). Pourquoi punir: l'approche utilitaire de la
sanction pénale. l'Harmattan. Greene, J., & Cohen, J. (2004). For the law,
neuroscience changes nothing and everything. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 359(1451), 1775-85.
Harris, S. (2012). Free will. Simon and Schuster. Libet, B., Gleason, C. A., Wright, E. W., & Pearl,
D. K. (1983). Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential) the unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 106(3), 623-642.
Smilansky, S. (2000). Free will and illusion. Oxford University Press.
Wegner, D. M. (2002). The illusion of conscious will. MIT press.