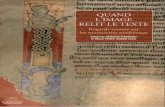Henri Bergson et l'image scientifique de l'homme chez Wilfrid Sellars
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Henri Bergson et l'image scientifique de l'homme chez Wilfrid Sellars
HENRI BERGSON ET L’IMAGE SCIENTIFIQUE DE L’HOMME CHEZ
WILFRID SELLARS
Le texte qui suit étudie certaines notions de Wilfrid Sellars et cherche à determiner en
quoi ces notions affectent la philosophie d’Henri Bergson,en particulier les thèses
defendues dans Matière et mémoire et quelles réponses d’inspirations bergsonienne sont
possibles.Si certains éléments avancés par Sellars permettent d’affiner et même de
corriger certaines notions défendues par Bergson.Nous verrons que non
seulement les notions de Bergson résistent bien aux critiques de Sellars,
mais que celui-ci apporte des reponses convaincantes par rapport à certains
problèmes qui se présentent dans la distinction entre image manifeste et image
scientifique ainsi que par rapport au « réalisme scientifique»défendu par Sellars.
Ce texte est structuré de manière suivante.Une première partie explique les demarches
de Wilfrid Sellars et d’Henri Bergson,leurs positionnements par rapport à Kant,qui
cherchait à constituer une métaphysique comme science.La deuxième partie tente de
créer une jonction entre certaines conceptions de Bergson et Sellars, pour qu’une
comparaison soit possible, par une conception du rapport entre les connaissances et leurs
acquisitions ainsi que du problème de l’innée et de l’acquis,la suite du texte s’appuiera
sur ce qui est exposé dans les deux premières parties ou le tout prendra consistance. La
troisième partie est un aperçu rapide de la manière que Sellars s’y prend pour expliciter le
rapport de l’image scientifique par rapport à l’image manifeste.La quatrième partie étudie
ou examine les perspectives d’inspiration bergsoniennes par rapport à la conception de
l’image manifeste et de l’image scientifique.La cinquième partie étudie rapidement les
problèmes qui pourraient apparaître par rapport au concept de personne chez Sellars ainsi
des solutions que pourrait apporter Bergson par rapport au problème de l’image
scientifique et l’image manifeste en générale.
Cet exposé à été envoyé le 12 janvier 2014,
et le 10 octobre 2014,quelques correctifs mineurs ont été apportés par rapport aux trois
versions,qui ont trait au style de quelques phrases et aux choix de quelques mots,mais
sinon il s’agit du même texte.
-----
«Au début était l’acte »
Faust, Goethe
Nous nous intéressons à la méthode au sens noble du terme, c'est-à-dire comment un
auteur développe une méthode par rapport à un problème donné et ne fait pas
qu’appliquer qu’une formule toute faite. Comment des auteurs constituent un problème et
produisent une méthode appropriée. Donc...
Méthodes, problèmes, situations
Bergson cherche à se poser comme une alternative à Kant.Il cherche à constituer une
métaphysique post-kantienne qu’il distingue, et non qu’il oppose, à la science.
L’opération principale de Bergson dans la constitution d’une nouvelle métaphysique est
de scinder en deux parties la conception kantienne de l’intuition,qui est celle de
l’espace ET du temps.Cela lui permettra de dissiper certaines apories dans le débat entre
les idéalistes et les réalistes que le philosophe allemand a cherché à résoudre, de manière
insatisfaisante selon Bergson, par rapport à la constitution de la subjectivité et de la
réalité. Pour Bergson, l’espace est pensé par l’intelligence et la durée par l’intuition. La
science est un mode privilégié de la connaissance de l’espace par l’intelligence, qui est
une extension qualitative de l’instinct (chez l’humain déterminé comme
«sens commun») 1.La durée pure, c’est-à-dire une conception du temps épurgé de toute
conception de l’espace, est le domaine de la métaphysique, qui appréhende la durée grâce
à la méthode de l’intuition.La fonction de la science est de produire une forme de
compréhension de l’étendue et de notre situation d’«objet » parmi les «objets », ce qui
permettra d’augmenter notre capacité à agir sur l’ensemble des « objets » (en nous
incluant comme « objet »). La fonction de la métaphysique est de dissoudre les faux
problèmes inhérents à l’utilisation de l’intelligence, de notre compréhension de
1 Extension qualitative,qui « émerge de »mais d’on la différence n’est plus simplement de
degré.Par exemple,il y a une différence entre l’instinct chez les animaux et le « sens
commun ».c’est une appréhension de situation sans explication « rationnelle »pour le sens
commun une rationalisation est possible(l’intelligence),les animaux ne peuvent pas
rationalisé leurs instincts chez Bergson,ou alors pas au niveau d’abstraction des
humains.Mais ce sont des dispositions qui sont reliées à l’appréhension d’action possible.
l’espace,et ainsi rendre possible des formes de problématisations qui tiennent compte de
la vie,
de l’aspect qualitatif de l’expérience,de l’émergence de la nouveauté, et du mouvement
se faisant.2 La méthode de problématisation de la philosophie, ou métaphysique, qui est
l'intuition,permet d’appréhender les problèmes dans leurs singularités, en défaisant les
faux mixtes qui forment nos expériences et nos théories de la connaissance et qui peuvent
avoir des effets contradictoires, même mortifères si elles sont mal conçues.La méthode
d'extraction de l'expérience pure consiste à séparer ce qui est de l’ordre de la durée, temps
continu,indivisible ou qui ne peut être divisé sans changer de nature au niveau qualitatif,
qui est de l’ordre de l’intuition, de l'espace, qui est la relation simultanée des « choses »,
ou images (qui se rapporte ultimement d’une manière ou d’une autre à la matière ), qui
est déterminée par l’intelligence, c’est-à-dire ce qui est de l’ordre de l’extension, du
quantitatifs, puisque toujours déterminé par rapport à une qualité homogène, qui peut être
additionné ou divisée sans changer de nature. La métaphysiques bergsoniennes se veut
Donc une méthode de précision et d'affinement des problématiques qui se rapportent à la
composition des éléments recherchés en les décomposant, selon la durée et l’espace,
pour déterminer ce qui est de l’ordre du qualitatif et du quantitatif, pour expliciter
l’interaction des éléments dans leurs devenirs,alors que Kant cherche à distinguer la
croyance de la science pour déterminer ce qui l’ordre de l’entendement et de la
croyance3.Pour Bergson, la préoccupation principale est la «vie » et le vivant,
la biologie est la science privilégiée,autre distinction avec Kant où la physique est la
science privilégiée.4La métaphysique bergsonienne se distingue de la métaphysique
kantienne qui est la tentative de construction d'une métaphysiquenormative,
c'est-à-dire que « les faux problèmes » ou les problèmes insolubles seront
considérés comme valides ou non valides en cela qu'ils respectent certaines normes et
2 La vie chez Bergson est de l’ordre de ce qui n’est pas la reproduction mécanique, est un
aspect qualitatif de l’existence en t’en que corps stabilisé, sa capacité à croitre, proliféré
et assurer les conditions pour assurer l’expansion. 3 Simplement préciser une évidence, ce qui est de l’ordre de la croyance chez Kant est
d’une importance capitale. Si pour Kant l’homme est un animal rationnel, c’est avant tous
en développant et en agissant selon le principe de la rationalité qu’il peut prétendre à la
dignité. La raison est un précepte moral basé sur une métaphysique normative.Mais la
raison pratique,la morale,les principes sont tout aussi importants que l’entendement. 4 Ne pas oublier qu'il se situe à une période où la théorie de l'évolution de Darwin modifie
le paysage scientifique et que cette théorie à des implications ontologiques importantes,
bref il y a une modification qualitative dans la pratique généralement quantitative de la
science qu’on pourrait nommer une révolution scientifique.
le respect de ces normes permettra de fonder une métaphysique comme science.5
C’est-à-dire que la connaissance sera fondée sur des critères scientifiques qui permettront
de construire l'édifice de la connaissance sur des bases qui ne dépasseront pas les
capacités de la raison humaine. Donc, chez Kant, l'homme est la mesure de toute chose,
pour éviter de laisser place aux sophistes,aux septiques...et sauver le «réalisme
scientifique », l’on devra construire un système où existe une réalité extra humaine,
que ce soit Dieu dans l'ordre de la croyance ou de la réalité du cosmos indépendamment
de nous dans l’ordre de l’entendement, dont nous ne pourrons qu’avoir une connaissance
limitée,déterminée par l’entendement, et des lois qui régissent cellui-ci par rapport au
réel,dans l'ordre de la connaissance. Cette méthode sera la méthode critique qui
s’appuiera sur la notion de transcendantal en cherchant à démontrer la possibilité de
produire des jugements synthétiques a priori (des jugements réalistes répondant aux
critères de la logique scientifique et démontrables empiriquement). C'est-à-dire une
méthode qui permettra de déterminer les conditions de possibilité réaliste (au sens
épistémologique, d’un fondement réaliste scientifique) de la morale, de la
connaissance…Sur laquelle la science s’appuiera qui rendra possible la croyance dans le
cadre de la raison.
Wilfrid Sellars est un logicien et se situe dans la tradition du pragmatisme américain. Il
cherche à reproduire la tentative kantienne d'élaborer une métaphysique comme science
(bien que Sellars n'utilisera pas le terme de métaphysique au sens kantien). Il procède en
créant des dispositifs critiques qui rendront possible, selon lui, l'élaboration d'une
conception scientifique réaliste (c'est à dire réaliste et vérifiable empiriquement, au sens
de Kant). Sellars procède en construisant des dispositifs lui permettant de constituer un
champ transcendantal qui rendra possible l'élaboration d’une critique de certaines
conceptions philosophiques qui entravent la constitution de ce qu’il nomme «image
scientifique de l'homme ».Pour ce faire,il s’inspire largement du concept de picturing de
Wittgenstein, qu’il utilise pour mettre en place son dispositif transcendantal, en
5 Nous adoptions ici la conception de Kant comme auteur réaliste au sens métaphysique
comme science, comme il se considérait lui-même, dans la 2e édition de la critique il
ajoute une réfutation de l’idéalisme pour éviter toute ambigüité, ce qu’il précise même dans
sa préface. Aussi voir «Prolégomènes a une métaphysique du future.» Nous croyons que
Sellars se situe dans une variation de cette interprétation de Kant. Bien sûr, plusieurs
autres interprétations existent. Par contre, Si nous considérons Spinoza comme l’auteur
qui pousse la philosophie rationaliste des lumières jusqu’à ces ultimes limites,Kant, pour
que ça critique s’applique au rationalisme des lumières, se doit d’être réaliste(sans quoi la
métaphysique spinoziste peut considéré le criticisme kantisme comme un simple
appendice de Hume.
comparant une image scientifique et une image manifeste de l'homme.6
Ou en constituant un Mythe, le mythe de Jones (encore un tableau) qui lui permettra
d’exposer le problème qu’il nomme «le mythe du donnée ». On pourrait dire avec un brin
de provocation que Sellars fait usage de "la puissance du faux ", terme utilisé par Deleuze
pour déterminer le potentiel transfigurateur des œuvres de fictions dans l’image-
mouvement 7(concept s'appliquant aux mauvais génies de Descartes ou aux expériences
de pensée si populaire dans certaines pratiques philosophiques) et qui est à distinguer du
faussaire, qui induit volontairement les gens en erreur. On pourrait qualifier la méthode
de Sellars comme participant au programme de recherche d'empirisme
transcendantal…par contre, empressons-nous de spécifier que le champ du transcendantal
chez Deleuze, contrairement à Sellars, est aussi constitué par l'art et la philosophie
(en plus de la science).Si chez Bergson il n’y à pas de transcendantal à proprement dit la
mémoire pourrait jouer un rôle analogue.8 Ce qui implique que ce qui est de l’ordre du
transcendantal varie d’un vivant à l’autre.9 C’est-à-dire que chaque vivant a son «champ
de possibilité propre » et que les conditions de possibilité d’un vivant par rapport à un
autre sont plus du rapport des « airs de famille » que d’un principe d’identité.
Pour terminé, comme le mot science a une valeur performative gigantesque dans certains
milieux, précisons que des auteurs comme Russel ou Chomsky sont des entraves à la
constitution de cette image scientifique dans la percepective de Sellars, puisque leurs
conceptions épistémologiques s’appuient sur une image manifeste de l'homme et qu’ils
sont victimes du mythe du donné, Heidegger se situe clairement dans l'image manifeste
même s'il n'est pas victime du mythe du données et bien que cela sera peu étudié dans ce
texte, ce n’est pas un hasard si un auteur comme Richard Rorty apprécie Heidegger et
Sellars.10
L"antihumanisme "de Heidegger se situe dans la même ligné que le mythe du
données même si la notion de personne développée par Sellars cherche probablement à
contrer une critique de type Heideggérienne, non verrons s’il y réussit.
6 Tractatus-logico-philosophicus p.40-41
7 Deleuze,Gilles,«La puissance du faux»,L’image mouvement, p-165-202
8 Par exemple, comme l’indique Quentin Meillasoux dans cette article excellent, mais qui
laisse de coté certains pans importants de la métaphysique deleuzienne, par exemple
Deleuze affirme plusieurs fois constituer un empirisme transcendantal et c’est même fait
accusé de kantisme par Alain Badiou, qui en un certain sens n’avait pas complètement
tord. Voir la bibliographie de Francois Dosse sur Deleuze/Guattari.
10
Rorty, Richard, Philosophy and the mirror of nature,p.167-188
Bergson et Sellars peuvent sembler deux auteurs antinomiques à première vue, ils ont des
problématiques et certaines influences communes, par rapport à James et Spinoza, une
critique de la représentation classique, une métaphysique processuelle (bien qu’elle soit
différente chez l’un et l’autre, pas étudié ici),malgré de grandes divergences, des
ressemblances parfois surprenantes entre Bergson et Peirce (qui a influencé ouvertement
Sellars), une tentative de création d'une forme «d’empirisme supérieur»… L'intégration
d'un discours scientifique dans la description du fait humain chez Bergson qui s’appuie
sur la biologie, et il ne semble pas avoir de dérive sur ce point,qui étaient courante à
l’époque, comme quoi sa distinction entre science et métaphysique est peut-être plus à
propos qu'une lecture superficielle ou sommaire pourrait laisser entrevoir. Bref, elle
réussit à opérer une fonction équivalente à un dispositif critique bien mené (et en éviter
les problèmes, selon lui). Bergson s’appuie, ce qui semble échapper à première vue aux
septiques, sur une conception «scientifique»de l’homme, cela sera
précisé au fur et à mesure que le texte se développera. La métaphysique de Bergson
dissout les métaphysiques fondationalistes classiques et son «réalisme scientifique»
semble avoir une assise solide. N’oublions pas que le projet de Bergson est de constituer
une métaphysique appropriée aux sciences modernes.
Compétence et connaissance I, qu'est-ce que que penser chez Sellars et Bergson
Débutons avec un mythe de notre crue, toute ressemblance avec des événements réels
n’est peut-être pas un hasard. Beaucoup disent que la philosophie débuta quand un
homme, d'on nous tairons le nom pour sa propre sécurité, à dit que tout ce qu'il savait est
qu'il ne savait rien et qu'il chercha à enseigner une méthode dont la maxime est "connait
toi toi même "! Une telle affirmation ou révélation mène à nous poser la question
des compétences (une capacité à exécuter ou à savoir comment). On peut donc affirmer
que la philosophie débute quand est posée la question des compétences et que les
connaissances, c'est-à-dire nos modalités de compréhensions acceptées, nos savoirs, sont
en jeu. On cherche à savoir qu'elles sont les compétences appropriées pour atteindre la
connaissance… « Je t'enseigne la méthode pour obtenir les compétences qui te
permettront d'atteindre la connaissance et une fois que tu auras les connaissances, tu ne
pourras point mal agir », à t’il dit. Cette personne se trouva en position fâcheuse quand
certaines personnes qui affirmaient détenir des connaissances, elles étaient même payées
pour ça, étaient un peu embarrassée de se faire dirent qu’elles ne connaissaient rien.
La philosophie commence quand on se pose la question «comment obtenons-nous les
bonnes compétences et s’arrête quand il ne se trouve qu'être qu’une transmission de
connaissance ». D’où les différentes spécialités qui se sont détachées de la philosophie
(psychologie, sociologie, linguistique,théologie...), Sellars utilise judicieusement
l’exemple de l’historien, dans l’époque moderne.
Le terme compétence est une traduction de l'anglais «knowing how» par rapport a
«knowing that», introduite par Gilbert Ryle dans the Concept of Mind.1112
Une
traduction littérale «Knowing how», savoir comment, ne recoupe pas exactement le
même phénomène en anglais qu’en français où cela recoupe capacité à exécuter,
généralement reliée à un savoir-faire. «Knowing that» est relié à une compréhension
formalisée d’un phénomène. En langage familier cette distinction pourrait être définie
comme «comment faire» et «comment ça marche». Bergson se préoccupe de cette
problématique en faisant usage des termes comprendre et exécuter par rapport à des
habitudes. Cette problématique ouvre la question à savoir quelles sont les connaissances
formelles nécessaires pour exécuter un savoir-faire et quelles savoir-faire ou capacités
d’exécutions nécessaires sont requises pour acquérir une connaissance formelle. Sellars
utilise l’exemple judicieux d’un canard qui se pose sur l’eau qui n’a probablement pas
une connaissance formelle de l’action qu’il vient d’exécuter, pourtant il exécute cette
action avec succès constamment, il précise ensuite que les compétences dont font usage
les humaines nécessitent généralement plusieurs connaissances («konw-how »et
«matter-of-fact»). Cela nous mène à nous poser une autre question; qu’elles sont les
justifications épistémologiques, ontologiques, métaphysiques qui permettent de
déterminer ce qui est inné et ce qui est acquis? 13
Selon Sellars, ce qui distingue la philosophie des autres activités ou spécialités
intellectuelles n’est pas le fait d’avoir des connaissances particulières, mais bien des
compétences particulières. Ces compétences se rapportent à la capacité de réfléchir sur la
configuration général des différents objets du « monde», c'est-à-dire leurs rôles dans les
11
Bien sûr ce débat date depuis au moins la critique d’Aristote de l’intellectualisme
platonicien, par exemple Éthique a Nicomaque. Aristote affirme qu’il y a plusieurs
problèmes avec «strictement avoir une connaissance est la condition nécessaire et
suffisante pour bien agir.» Par exemple le problème de la volonté, du savoir-faire, de la
sagesse pratique. 12
Ryle, Gilbert, Concept of Mind 13
Ce n’est l’objet du texte mais nous avons ce qui ce rapporte à l’instinct et à l’intelligence chez Bergson
compétences des différentes disciplines, le rôle, la configuration et la relation entre les
différents objets du monde, et la capacité de formuler ou d’expliciter pourquoi les
différents objets du monde «tiennent ensemble» (hang together),ce qui fait du
philosophe un spécialiste qui à une capacité de s’orienter de manière générale dans les
problématiques des différentes disciplines, bref,il est un spécialiste du général.14
Le
«know how» du philosophe lui permet de réfléchir sur la configuration des objets du
monde sur lesquelles se fonde les différents «knowing that». Il s’intéresse au
«knowing that» du «knowing how», c'est-à-dire aux éléments qui permettent de fonder ou
produire de la connaissance. Ici, l’influence de William James et de ses essais
d’empirisme radical est manifeste, le présupposé métaphysique de James est que
l’univers est composé de «stuff», 1516
qui est apprehendé de différentes manières par un
organisme déterminé et que l’articulation de cet organisme par rapport au «stuff»du
monde d’ont il est une des composantes est ce que James appelle son expérience pure.17
Pour Sellars entre autres, la majorité des compétences humaines présupposent déjà une
certaine compréhension du«comment ça marche», sur cette compréhension du
« comment ça marche », le philosophe cherche à déterminer ce qui est valide
épistémologiquement. Le philosophe est caractérisé par sa compétence de dresser le
tableau de ce qui est pensable de la situation générale par rapport à la connaissance des
différentes disciplines dans la conception du monde et de leur rapport aux objets (encore,
how things hang together). En rationalisant l’expérience pure jamesienne, en s’appuyant
sur la théorie du «Knowing how/kowing that» de Ryles, et avec un certain usage du
concept d’images logiques du monde chez Wittgenstein, Sellars tente de constituer un
champ transcendantal qui lui permettra de faire sont travail de philosophe.18
Pour Sellars,
14
Sellars,Wilfrid,«The Scientific image of man» in Science,perception and
reality.Ridgeview publishing Company, California,1963 15
Traduction difficile, en français la traduction usuelle est étoffes (par exemple dans
l’évolution créatrice, Bergson utilise «étoffe») mais une traduction plus appropriée pourrait
être matériaux (eh non nécessairement matière), du cela…Est très près du concept
d’image chez Bergson 16
«La conscience existe-t-elle»,«Un monde d’expérience pure» in Essais d’empirisme
radical, 17
Bien sûr cette conception, pour James qui a une formation de psychologue, lui permet
de chercher à expliquer le fonctionnement de l’organisme selon des formes qui ne sont
pas déterminées d’avance et de rendre justice à l’ensemble des phénomènes qui constitue
la vie d’une personne, de chercher à les expliquer en faisant appelle à moins de
présupposé possible et de rendre l’organisme déterminé viable(l’influence de Darwin) 18
Dans sont discours sur l’act de création, Deleuze parle que la conception de la
philosophie qui consiste a «réfléchir sur» est une idée «comique» et affirme que le rôle de
la philosophie est de fabriqué des concepts. Dans Mille Plateaux Deleuze et Guattari
un philosophe est un méta-théoricien qui cherche à déterminer qu’elles sont les points
communs entre les différents discours théoriques des différentes spécialités et de
déterminer ce qui est pensable théoriquement dans l’ordre de la pensée.
Si Sellars conçoit la philosophie comme production d’un champ transcendantal normatif
qui permettra une réflexion sur le fonctionnement des différentes disciplines, dans une
traduction non fondationaliste de la tentative kantienne de fonder une métaphysique
comme science, qui permettras un éclaircissement des problématiques qui peuvent
apparaitre par rapport aux conceptions communes partagées par les différentes
disciplines à un moment historique donné, Bergson conçoit le philosophe comme un
métaphysicien. Le rôle de la métaphysique chez Bergson est la dissolution des faux
problèmes qui peuvent survenir par un usage inadéquat de l’intelligence et la méthode de
la métaphysique est l’intuition. La méthode de l’intuition se fonde sur la conception du
réel en temps que durée. L’intuition est la saisie de ce qui nous affecte dans un acte
simple, de ce qu’il y a de qualitatif dans l’expérience.19
Il s’agit d’avoir comme point de
départ l’expérience la plus pure possible où tout les éléments perçus s’imbriquent les
uns dans les autres dans un continuum de temps indivisible (la durée) et que les objets du
monde forme un tout en mouvement par rapport à l’observateur et sa durée,observateur
qui forme aussi un tout en mouvement. Cela permettra d’appréhender les «images» du
monde «de l’intérieur», dans leurs devenirs et leurs progrès dans une totalité en
mouvement,il serat alors possible de décomposer et de recomposer les éléments de
l’expérience pure pour percevoir la singularité d’une situation en tant que moment
déterminé dans un processus,bref d’extraire l’aspect qualitatif du « cela »qui compose le
monde et de constitué des problématisations appropriées à des situations singulières, qui
permettra de trouver la solution la plus adéquate aux situations qui se présentes.Par
exemple, aujourd’hui,la notion d’intersectionalité,qui semble avoir une certaine faveur
chez plusieurs féministes,est un excellent exemple de l’application de la méthode
bergsonienne, ce n’est aussi surement pas un hasard si un auteur comme Fréderic Worms,
affirment que le philosophe est un «synthétiseur», ce qui peut rapprocher de la conception
de Sellars(sans parler de certaines tournures de phrase de Mille Plateaux). De plus, la
conception métaphysique processuelle et l’épistémologie antifondationaliste de Sellars le
pousse avoir une conception de la philosophie comme construction d’un appareillage
technique qui permettra de déduire la configuration des objets du monde la plus approprié
ou justifiable ou qui lui permettrons de «réfléchir sur» et non de se prononcer sur la
nature des objets du monde et que même à dire que l’homme est un animal rationnel non
par nature, mais par convention ou principe…
spécialiste de Bergson, s’intéresse au care. On a ici une variation (non-fondationaliste) de
la méthode cartésienne ou l’on construit une problématique en cherchant à éliminer tous
les présupposés de «l’intelligence», c'est-à-dire les connaissances empiriques et les
théories constituées, et qu’à partir de cela l’on cherche à constitué une méthode nous
permettant de reconfigurer les problématiques de façons plus précises et concrètes,ce
qui permettra l’émergence de solutions inédites et appropriées à la singularité de la
situation dans un champ de la connaissance ou de la pratique.20
Bien-sûr, dans la
perspective mise de l’avant ici, Descartes, comme Platon, dérives quand ils cherchent à
fonder la connaissance sur un moment privilégié sur lequel ils fondent leurs
intellectualismes et leurs métaphysiques. La méthode bergsonienne cherche à déterminer
une compréhension génétique de la possibilité de l’émergence d’événement inédit dans
l’univers, de découvertes inattendues par un objet, qui est le corps d’une personne et non
de produire une fondation métaphysique statique.
Donc, la métaphysique n’a pas pour fonction chez Bergson d’indiquer le chemin à la
science et à l’intelligence, mais est bien une méthode qui permettra d’expliquer et de
clarifier certains problèmes qui pourraient entraver son évolution ou la rendre mortifère.
Si la méthode bergsonienne et fort utile pour comprendre l’application concrète de
solutions donnée à des situations quotidiennes. La méthode métaphysique bergsonienne
cherche à comprendre comment les découvertes scientifiques émerges et qu’elles
sont les conditions nécessaires pour que ces découvertes puissent avoir lieu, bref
elle permet de penser les situations, les objets, les images dans leurs évolutions.C’est
une préoccupation constante de Bergson non seulement par rapport à la science,mais
aussi par rapport à la liberté, l’expérience, l’évolution, la politique.
Compétence et connaissance II, partie 1, Les imagent chez Bergson, l’intuition
La conception des nombres exposés dans les Essaies sur les données immédiates de la
conscience est des plus éclairantes pour définir la notion bergsonienne d’intuition… Un
nombre est une collection d’unités supposées identiques(le nombre 4 suppose 4 fois la
même chose), qu’il est possible de compter un à un, c'est-à-dire une totalité quelquonc du
même. L’idée du nombre suppose une intuition simple d’une multiplicité de partie unifier
20
Bien-sûr cela implique un «knowing-how»,qui est toujours là à l’arrière plan
ou une unité(1,43,10,sont des unités avec des multiplicités de partie).21
Un nombre (1, 45
ou 36 par exemple) est une qualité pure dans la durée et ne peut qu’être répété, ou se
succéder, par rapport à son apparition première, c’est donc un événement qui n’apparait
qu’une fois dans la durée, comme intensité. Pour être compté, additionné et donner une
somme, un nombre doit être spatialisé, c'est-à-dire, même dans une opération de l’esprit,
exister simultanément à par rapport à un autre nombre similaire.22
(par exemple, 3
présuppose un autre nombre, 43 par exemple,qui a trois occurrences).Un nombre peut
être conçu comme une image. Une image, perçus ou représenté est subjective quand elle
est une unité perçue par un acte de l’esprit et est objective quand elle est décomposée en
plusieurs parties/ images, pour expliciter la composition de l’aspect qualitatif pur, par
exemple.Ce qui est subjectif est ce qui est soit actuel ou immédiat,c’est une totalité
qualitative, une émotion, une intensité, un état. Ce qui est objectif, est l’énumération des
différents éléments qui composent la qualité, les caractéristiques de l’émotion, les sources
de l’intensité, etc. «ce qui est subjectif est ce qui parait entièrement et adéquatement
connu, objectif ce qui est connu de telle manière qu’une multitude toujours croissante
d’impressions nouvelles pourraient être substitué à l’idée que nous en avons
actuellement »23
. Si nous considérons par rapport à l’intuition kantienne, qui est une
forme de saisie passive par les sens des données extérieures + «un sens commun à la
Aristote », qui doit être donné pour que des expériences soient possibles et qu’il y est
unité de l’expérience,.24
l’intuition chez Bergson est un acte de volonté qui consiste à
lier multiplicité et unité dans la durée à partir de notre perception des images(l’univers est
une totalité indéfinie d’images). Ce qui est donné chez Bergson est l’ensemble des
images et nous sommes qu’une image parmi les images. Notre condition n’est pas
d’abord celle d’un sujet parmi les objets, mais d’une image parmi les images. 25
21
Bergson, Henri, Essais sur les données immédiates de la conscience,
Ibid. , P.39 22
Aussi, L’aspect qualitatif du nombre peut être expliqué par une énumération des
composantes qui donnent la qualité particulière au nombre en tant qu’unité encore par
un processus de spatialisation de la duré 23
Ibid P.42 24
Pour une lecture éclairante du concept d’intuition kantienne,«Avoiding the myth of the
Given», John Mcdowell 25
Il faut être prudent en utilisant les termes de sujet et objet ou phénoménologie, comme
le fait quelquefois Frédéric Worms dans ces expositions somme toute excellentes de la
penser de Bergson(voir introduction a matière et mémoire ou Bergson où les deux sens
de la vie). Cela risque un malentendu, un sujet donné d’où émergerais une représentation
et isolé doté d’une intentionnalité. Les images ne sont pas données à une conscience, mais
il y à une conscience parmi les images, c'est-à-dire que c’est« l’extérieur» qui cause la
conscience elle émerge parmi les images.
Compétence et connaissance II, partie 2, Aspect des images, la perception pure
Le point de départ de l’épistémologie bergsonienne est la théorie de la perception pure,
qui est une conception de l’espace épurée d’idées préconçues et de mémoire. Cela évitera
d’attribuer à l’image percevante que nous sommes toutes capacités ou qualités qu’il
serait impossible d’attribuer à d’autres images sans justification empirique. Cela est
possible grâce à la méthode intuitive qui permet de défaire le mixte impure qu’est
l’expérience en isolant l’espace, quantifiable et homogène, de la durée, qualifiable et
hétérogène. La théorie épistémologique de Bergson est une théorie de la connaissance
basée sur l’action,26
donc on pourrait la qualifier de fonctionnaliste, qui ne se base pas
sur la conception d’un sujet connaissant prédonné. Il s’agit donc d’une théorie
épistémologique nonreprésentationaliste27
, c'est-à-dire que se sont avant tout les images
qui sont perçues en elles-mêmes et non nous qui les percevons(elles sont présente et non
représenté), le cerveau est une image parmi les images et ne créer pas de «représentation»
au sens moderne du terme, le rôle de la perception se rapporte aux actions possibles de
l’image-corps sur les autres images.28
Le nonreprésentationalisme bergsonien postule que
l’univers est composé de matière/ d’images et que chaque image se donne
immédiatement et complètement l’une à l’autre,de manière complètement transparente,
ce qui résulte que toute réaction est proportionnel aux actions subies.29
Bref, la matière
n’ajoute rien qui n’était pas déterminé par sa position et sa condition par rapport aux
autres images.30
Dans la théorie épistémologique,la différence entre les images
vivantes, en particulier l’humain,et les autres images,est que les vivants sont des images
dont la réaction n’est pas proportionnelle à l’action subie. 31
Par exemple, si l’on observait
un ensemble d’images au microscope, nous verrions autour des images vivantes un
certain infléchissement dans la chaine de causalité par rapport à l’image vivante.
26
Worms, Introduction à matière et mémoire 27
Antireprésentationalisme indique que la représentation n’est pas le fondement de la
perception nous ne sommes pas un sujet qui se représente le monde face à un monde
représenté.
Bergson, Henri, Matière et mémoire, p.11 28
Ibid., P.12 29
Ibid., p.10 30
Ibid. p.12 31Ibid. P.14
C'est-à-dire que l’univers est composé d’images se répétant constamment et que des
événements modifient de manière déterminée la configuration entre les images les unes
par rapport aux autres et que les vivants sont capables de produire des événements qui
n’étaient pas complètement déterminés dans les images.La science facilitera notre
compréhension en tant qu’image singulière dans la totalité des choses et d’événements
simultanés qu’est l’univers étendu.Elle permettra de produire un écart de plus en plus
grand dans l’étendue entre les actions que nous subissons et notre perception de celles-
ci.Ce qui permettra une anticipation des «événements» et une préparation possible face à
certaines actions des images sur nous(avant que les actions des autres images nous
affectent complètement).
Nous sommes une image parmi les images et nous devons déterminer pourquoi en tant
qu’image nous nous distinguons des autres images. Nous nous distinguons des autres
images en cela que nous percevons les images à l’extérieur que nous nous percevons de
l’intérieur(de notre corps) par les affections.32
La perception de l’image n’est pas une
impression au sens de Hume mais l’extraction-réflexe par notre système perceptif, de
certains éléments des images perçus qui permettent « une mise en distance »de celles-ci
avant qu’elle nous affecte complètement.33
Par exemple, quand une boule de billard en
frappe une autre, il est possible de prévoir de manière précise les directions prises par
celles-ci après leurs contacts. Si une boule de billard avait une perception quelquonc à
la manière d’un être vivant, la réaction observée de l’extérieur ne pourrait pas être
complètement déterminée, c'est-à-dire que la boule de billard aurait des réactions internes
dues à l’affection causée par la perception de l’action virtuelle qu’elle appréhenderait,
observées de l’extérieur par son mouvement ou la modification de la configuration de la
boule de billard.En tant qu’image qui avons une perception des images extérieures, c'est-
à-dire que nous isolons certains éléments des images qui nous entourent dans la
perspective de modifier nos réactions par rapport aux actions qu’elles ont sur nous, et
ainsi infléchir la chaine de causalité d’une partie de l’ensemble des images.34
Cette
tension entre actions virtuelles perçues par notre corps-image et l’actualité de la réaction
de notre système nerveux est la source de notre affection, qui est la transformation des
sollicitations des images perçues en actions naissantes,sélectionnées par le cerveau, qui
reçoit des signaux du système nerveux par rapport aux images perçues,en des
mécanismes d’actions ou d’inhibitions, qui sont mémorisés et/ou réflexe.L’affection est
32
Ibid., p.10 33Ibid. P.32
34
Ibid. p.11
donc la tension entre l’effet appréhendé des images sur notre image-corps et la réaction
virtuelle préparée ou inhibée par celui-ci et non la source de notre perception du monde
extérieur, il y a comme une boucle entre les perceptions «externes» et les affections
internes. Le rôle du cerveau n’est pas de produire des représentations qui dédoubleraient
une réalité,mais bien d’être un centre de coordination par rapport à différentes
sollicitations des images perçut par le système nerveux. L’ensemble des images sont
données, présentes, dans leurs totalités et plus le système nerveux d’un système nerveux
se complexifie, plus il y a indétermination des réactions de l’image vivante, qui est le
corps, par rapport aux actions qu’il subit. La représentation est un ensemble sélectionné
par extraction de certaines images par le système nerveux dans l’ensemble des images qui
constitue une totalité indéterminée. La représentation permettra une action dans
«un milieu», suggéré par Bergson comme un tableau ou un paysage.35
Le corps
sélectionne les images qui l’intéresse dans son milieu, met l’emphase sur certaines
images, dans le but de se positionner différemment par rapport au milieu ou d’en
modifier la configuration.Le corps est un centre sensori-moteur, c’est-à-dire qu’il est un
agencement machinique (une multiplicité d’image) qui produit une inflexion par rapport
au système de causalité proportionnel et déterminé des images non organiques et qui à
aussi la possibilité de réagir de manière non-proportionnelle face à aux actions des autres
vivants.
Voilà pour l’aspect épistémologique de l’empirisme supérieur qui détermine la possibilité
de fonder un «réalisme scientifique», qui doit s’appuyer sur une métaphysique
anti-fondationaliste pour affiner sa précision et tenir compte des aspects de
problématisations se rapportant à la vie.36
L’objectivité se constitue en faisant une coupe
instantanée dans la durée reconfigurée en temps, c'est-à-dire en succession d’instantané, à
partir desquels il sera possible t’étudier certains aspects de l’univers de manière
objective, au sens de « réalisme épistémologique», en constituant un espace qualitatif
homogène (chimique, biologique, physique…) donc quantifiable. Cela nous permettra
d’augmenter nos capacités d’action sur les images en prédisant certains éléments de cause
35
Deleuze parle de manière plus appropriée de paysage (totalité indéterminée) mais nous
allons rester avec tableau. Bergson utilise le terme de tableau pour indiquer que la
représentation consiste à soustraire certains éléments de la totalité pour en faire une
totalité. L’image du tableau risque de laisser comme malentendu que la représentation est
comme un tableau dans la tête ou l’esprit, ce qui n’est pas le cas. 36
les entités externes postulées par la sciencent existent puisqu’elle fonctionne et que le
monde extérieur est donné en t’en que totalité d’images indépendantes d’une conscience,
donc une les données d’une théorie épistémologique de type réaliste sont réunit.
et effets dans un ensemble donné dont nous aurons extrait une qualité homogène
quantifiable, bref de dégager une tendance,la science est un outil
d’extension de nos perception.37
La perception n’a pas pour fonction de spéculer,
mais bien d’augmenter nos capacités d’actions entre ce que nous affectons et ce qui nous
affecte , d’augmenter nos capacités d’anticipation, donc d’augmenter les actions possibles
par rapport aux autres images. La fonction de la science est « d’augmenter » la
perception, qui n’est pas liée à la contemplation, mais bien l’action.38
Par exemple, l’eau dans un verre d’eau ou une flaque d’eau est une image avec une
composition particulière, ici qui occupe un espace donné. L’eau, image totalement
présente aux autres images se transformeras en glace à 0 degré Celsius, due à la
composition de l’eau en tant qu’image par rapport à la composition des images avec
laquelle elle compose un tout.Cette décomposition-recomposition est ce que Bergson
entend quand il parle d’acte dans la nature.La science dira à 0 degré Celsius l’eau se
transforme en glace.Dans la durée on dira l’eau devient glace, c'est-à-dire que l’aspect
qualitatif de l’eau se modifiera, nous saisirons l’eau dans sont intensité qualitative de
devenir glace. Quand Bergson parle d’acte dans la nature, l’exemple de l’eau qui devient
glace, dans la totalité de la modification dans la durée est un excellent exemple, il ne
s’agit pas «d’actes» au sens phénoménologique, mais bien d’une modification qualitative
d’une image dans sa totalité. Comme nous ne sommes pas des images totalement
présentes aux autres images, nous pouvons modifier de façons relatives notre
positionnement face aux compositions-décomposition-recomposition des images perçues.
Donc, nos actions et réactions sont plus indéterminées par rapport à l’ensemble des
images.
Compétence et connaissance II, partie 3, Aspect des images, Mémoire
Une fois, clarifier le fonctionnement de la perception pure. Et il nous sera possible de se
lancer dans l’étude de l’aspect «personnel » de notre expérience, qui est en très large
partie le résultat de notre mémoire. Pour Bergson, la mémoire n’est pas une
37
La conception de la perception de Sellars a certaines ressemblances avec celle de Bergson. Par exemple
cet article. Johana Seibt,«Functions between Reasons and causes:On picturing» In Empiricism,
Perceptual knowledge, normativity and realism
38
Ibid, P.39
impression passée qui à pour caractéristique d’être moins intense qu’une impression
présente, mais la totalité des événements passés vécus par le corps inscrit dans la durée,
donc au niveau virtuel notre passé est toujours là dans sa totalité avec ses dates
et ces heures dans le présent, comme une nappe de fond qui forme le caractère de la
personne,« l’élément qualitatif» par rapport au fondement de notre personnalité qui est
notre corps. La mémoire à deux niveaux, la mémoire pure qui est la totalité des souvenirs
dont nous n’avons qu’un accès partiel(la nappe de fond), puisque pour fonctionner l’on
doit sélectionner certains événements et en inhiber d’autre (dans un mécanisme analogue
à la perception), et la mémoire souvenir,ou contraction, qui est la production de «système
de rappel» qui nous permet de déterminer les actions favorisées par notre cerveau qui
serait complètement indéterminées ou aléatoires dans une perception pure. Quand un
événement inédit se produit dans la perception pure, ou par différentes techniques, ou
qu’un problème surgit dans le système de rappel, des éléments de la mémoire pure
peuvent refaire surface, ce phénomène sera exposé à la fin de la section suivante.
La mémoire ajoute quelque chose en plus à la perception immédiate pure qui existe en
droit (dans sa pureté, instantanée, impersonnelle) mais non en fait, c'est-à-dire que le
mémoire modifie les éléments sélectionnés mise de l’avant par le corps dans la
perception immédiate. En fait, la perception va du passé immédiat au présent par
rapport à la mémoire (contraction) et du présent au futur immédiat par rapport à la
perception,ce qui donne une certaine épaisseur de durée.39
C'est-à-dire que le passé est
imbriqué dans le présent par la mémoire et que le futur immédiat est appréhendé par la
perception pure, ce qui résulte que chaque zone d’indéterminations qui est les corps du
vivant se trouvera avoir des réactions qui varient selon les sollicitations des images
perçues, à cause de cette nappe de fond des expériences emmagasiné et des effets
contraction de celle-ci. La mémoire, qui en elle-même n’a aucun effet de causalité direct
sur le monde des images externes, à un effet dans l’étendue par l’entremise des corps qui
l’actualisent.
Donc,nous sommes une image parmi les autres images qui ont la capacité d’avoir des
réactions qui ne sont pas proportionnelles par rapport aux actions des autres images sur
nous. Notre corps est capable « d’initié » des actions, c’est-à-dire qu’il a la capacité
d’enclencher plusieurs démarches possibles pour affecter la matière,40
d’avoir des
réactions préméditées ou de développer des formes de résistance face aux actions qu’il
39
Ibid , p.20 40
Ibid.p14,
subit. Ces démarches possibles seront déterminées par ce qui est perçu à l’extérieur de
mon corps par la perception réflexe, par une ou des habitudes contractées par mon corps,
la mémoire jouera un rôle dans la sélection des actions par mon cerveau, qui auras reçu
des signaux du reste du système nerveux, pour exécuter ou « inhibé » certaines actions,
dans le but de conservé ou de modifié ma situation parmi les autres images. De même, il
est possible par des techniques de contraction d’habitudes et des techniques de
décontraction d’habitudes d’acquérir de nouvelles habitudes ou de nouvelles méthodes
d’action. La mémoire qui cherche à se rappeler suit la même procédure, non par rapport à
notre capacité d’affecter la matière, mais par la capacité de nous rappeler ce qui est
mémorisé et d’actualiser dans le présent des éléments dans notre mémoire, qui est la
totalité de ce que nous avons vécu(comme si c’était une nappe de fond). Serat mis ici
l’emphase sur la mémoire contraction par rapport à la matière puisque nos considérations
ici sont d’ordre épistémologique, c'est-à-dire des conceptions de l’image de l’homme
chez Sellars sont l’ordre de la mémoire contraction chez Bergson.
Compétence et connaissance III, Know-how---Know-That, interaction avec la
mémoire.
Nous allons faire usage de la notion d’événement pour éclairer la distinction entre
mémoire et perception pure en plus de la théorie du «knowing how» et du
«konwing that»par rapport à Bergson,cela sera ensuite utilisé en arrière-fond,comme
grille de lecture par rapport à Sellars. L’espace en soi,41
jusqu'à matière et mémoire, est
strictement quantitative et extensive, cela implique qu’il n’y a pas d’événements qui ne
sont pas prévisibles en droit,dans un ensemble déterminé, si nous avons une théorie
adéquate, puisque tout changement est un changement quantitatif, dans l’extension, soit
plus ou moins du même en quantité différente. La durée est qualitative, c'est-à-dire
qu’elle à une variation d’intensité dans le temps, un événement dans la durée implique un
changement qualitatif dans l’état des choses puisqu’une division dans la durée est une
division qualitative, il n’y a pas de division dans la durée sans modification qualitative
ou événement.42
L’anti représentationalisme implique que la perception va de la
41
Qui peut etre les choses qu’on perçois avec l’aide de nos organes mais aussi par des
méthode d’abstraction scientifique, des atomes, des composé chimique…Qui sont des
méthodes d’abstraction qui permettent une abstraction de la perception. 42
Deleuze,Gilles,Le Bergsonisme
périphérie au centre, que la perception est «dans les choses», les choses te regardent écrit
Deleuze, elles te sollicitent,43
c'est-à-dire que la tension entre les effets,les choses
appréhendées et leurs actions actuelles sur notre image-corps affect le système nerveux
de l’image-corps, qui enclenche et inhibe des actions possibles. Les images perçues par
le corps sont des « suggestions » des aspects de «l’image totale» qui intéresse le corps et
la mémoire modifie certains aspects de l’image,en temps qu’image(et non de matière),
perçue par le corps. Chez un vivant, un acte est un effort, une résistance en t’en qu’image
parmi les images pour infléchir la causalité proportionnelle et modifier la situation par
rapport à l’ensemble des images selon certains schémas sensori-moteurs. En terme
bergsonien, le «know how» se définit de manière suivante; tout acte, que se sois un
rappel à la mémoire ou un acte corporel est l’enclenchement ou la répétition d’un
mouvement indivisible, qui forme un système clos se refermant sur lui-même et qui
résulte d’une impulsion initiale(que nous avons appelé événement). 44
Il est possible de
décomposé un mouvement pour en modifier certains aspects pour le recomposer, mais
une fois un «knowing how» acquis, l’acte enclenché après l’impulsion initiale se fait
toujours dans la même séquence après que le cerveau ait sélectionné une des actions
possibles.45
Une fois les leçons maitrisées, un savoir-faire est constitué et ce savoirfaire
peut être qualifié d’action habituelle, qui devient de plus en plus impersonnelle une fois
le «knowing how» maitrisé, pensons à la marche par exemple.Chaque pratique ou leçon
menant à l’habitude est un événement distinct qui ne peut se répéter et qui à une date fixe
(un moment non modifiable) « imprimé »dans la mémoire. Une un «kow-how» maitrisé
à l’aide de la mémoire se trouve être un processus sensori-moteur enclenché par une
impulsion initiale,donc un acte, un événement dans l’espace. Ce qu’on appelle un« know
how» est un schème qui s’enclenche par rapport à notre situation parmi les images,
qui peut être enclenché ou inhibé.46
Chaque souvenir de la leçon apprise est un
événement décomposable ou recomposable dans la mémoire, une qualité intensive de la
durée qui est décomposable ou recomposable en quantité extensive de manière virtuelle
dans la mémoire. Par exemple,on peut embrasser un souvenir d’un coup comme dans un
tableau et analyser les différents éléments de celui-ci pour chercher à expliciter les
éléments qui composent le tableau.47
43
Je n’ai pas retrouvé la citation, mais c’est dans ses livres sur le cinéma, envoyer plus
tard si ces exiger 44
Ibid P.47 45
Ibid P.47 46
Ibid P.47-48 47
Ibid. p.21
Nous avons ici l’apparition du «knowing how» par rapport au «kowing that». Un «know
that» se constitue toujours par rapport à un «know how» qui peut devenir de plus en plus
sophistiqué et impliqué de plus en plus d’opérations plus l’indétermination de
l’organisme devient grand.
La théorie de la mémoire contraction chez Bergson se rapporte principalement à un
système de rappel par rapport à la perception pure, un schéma sensori-moteur qui
s’enclenche face à une situation analogue qui a des airs de famille avec une situation
antérieure.Donc, une image existe «en t’en qu’objet en lui-même existe et est,en
lui-même pittoresque comme nous l’apercevons».48
Nous ne somme pas dans un système
de représentation classique ou l’objet serait dédoublé dans une représentation et dont on
devrait déterminer la correspondance, la perception n’a aucun lien avec la spéculation,
mais se rapporte au système sensori-moteur, à l’action et les images sont des sollicitations
par rapport au système nerveux. Donc, une image dans la perception pure détache la
partie qui intéresse notre corps et notre affection est l’anticipation de l’effet de l’image
sur nous, qui cause un ébranlement dans les différentes parties notre système nerveux,
que le cerveau traite pour déclencher ou inhiber des actions possibles.49
Dans la
perception pure tout est causalité quantifiable, donc le vivant réagis et agis de manière
aléatoire (en droit et non en fait bien sûr) ou réflexe. La mémoire, par un rappelle de ce
qui est semblable dans la perception pure favorise certaines actions à exécuter par
rapport à d’autre. Ce qui est de l’ordre de l’agir est l’enclenchement d’une réaction
apprise par rapport à une image appréhendée dans la perception pure, l’actualisation
dans l’espace d’un acte ce qui se trouvait dans la mémoire, c’est en cela le
«knowing how» se détermine.Cela peut être l’action d’un danseur reproduisant le
mouvement appris, d’un garagiste réparant une voiture, d’une réponse à un problème
mathématique dont nous avons l’habitude, de la rédaction d’une dictée, de lire une
partition. Ce qui est de l’ordre de la compréhension, le «knowing that» est l’équivalent du
rappelle de la leçon apprise, c'est-à-dire que c’est la capacité à décomposer et recomposer
les éléments de l’action selon certaines règles, qui sont un «kowing how» pour
déterminer le fonctionnement du «knowing that», par exemple,un historien pourrait
décomposer certaines actions expliquer dans certains documents, de même pour un
professeur de danse par rapport à un mouvement,un prof de français dire pourquoi tel
élément ne fonctionne pas à cause de telle ou telle règle de grammaire...
48
Ibid P.46
Ce qui est de l’ordre du «knowing that» d’une discipline donné pourrait être qualifié
d’habitude inductive, un peu comme la troisièmeté de Peirce, donc un «knowing that»
impliquant la sélection de certaines images données dans une totalité close (l’histoire, le
français…). Donc, plus un «knowing how» est maitrisé, plus l’aspect suggestif des
images est refoulé et plus les actions deviennent impersonnelles, plus les problèmes
« knowing that-knowing-how » sont à l’arrière-plan et ce qui est à la base des
ressemblances ou des «airs de famille» semble pouvoir être déterminé sous un principe
d’identité. Ce qui est de l’ordre de l’agir ou de la reconnaissance est l’enclenchement
d’un acte simple par rapport à une multiplicité d’images, qui s’il n’y a rien de
problématique devient de plus en plus impersonnelle.Ce qui est de l’ordre de la réflexion
est la décomposition d’un acte simple ou d’une perception immédiate en une multiplicité
d’image pour la recomposer dans une nouvelle totalité close. Quand est perçus une image
avec laquelle nous ne sommes pas familiers,une découverte ou un détaille dont nous ne
tenions pas compte, face à des problématiques d’autres disciplines, à des situations
problématiques, des problèmes techniques, des situations sociales inédites, nous
cherchons parmi nos souvenirs une ressemblance avec l’image que nous percevons, il y a
donc une hésitation, un moment de réflexion pendant laquelle nous cherchons à
recomposer le schéma d’habitude pour déterminer les réactions appropriées face à cette
image nouvelle ou cette situation inédite. C’est à ces moments que l’intuition et la durée
apparaissent de manière plus manifeste, quand on cherche par analogie des «d’airs de
famille», et avec nos différents «knowing how»-«knowing that» à reconstituer un
«kowing that» ou à inventer des nouveaux «knowing how».
Une nouvelle image du monde l’image scientifique et l’image manifeste de l’homme.50
«Il y a des mensonges nécessaires à l’existence, par exemple, les jugements synthétiques
a priori »
Friedrich Nietzsche, La généalogie de la morale
«Dieu, c’est les microbes »
Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu
Nous avons affirmé plus haut que Sellars cherchait reconstituer le projet kantien de
fonder une métaphysique comme science en cherchant à éliminer tous les éléments non
justifiés rationnellement, par les sciences naturelles, dans sa théorie épistémologique.
Comme Kant l’avait fait à l’époque ou certains éléments furent démontrés comme
impossibles à justifier à l’aide des sciences naturelles par le scepticisme Humien.
Sellars si prend en cherchant produire des dispositifs critiques qui permettront de
constituer un champ transcendantal, qui rendra possible, selon lui, la production de
théories de la connaissance de type réaliste et qui s’appuieront seulement sur des
présupposés qui sont justifiable selon les méthodologies des sciences de la nature. Tout
cela sans tomber dans un « fondationalisme» attaqué de toute part à la fin du 19e siècle
et au début du vingtième siècle.Ces outils sont la logique formelle et une conception de
l’usage du langage wittgensteinienne comme pratique rigoureuse qui serait en mesure
d’éviter les faux problèmes engendrés par une équivocité du sens des mots.Cela remplira
le rôle de l’analytique transcendantal chez Kant. Y sera ajoutée la notion de picturing,
qui a une importance primordiale pour la validité de son épistémologie réaliste et non
fondationaliste. Elle a une fonction équivalente aux jugements synthétiques a priori chez
Kant,c'est-à-dire que leurs fonctions est de déterminer la validité du champ transcendantal
par rapport à l’expérimentation empirique, sa validité est donc indispensable pour
l’aspect «réalisme scientifique» de sa conception de l’image scientifique de l’homme.La
50
Bien sûr Sellars parle de l’humain et utilise «Man»,Nous utiliserons Homme simplement
pour mettre en évidence la dimension «image» comme un concept normatif, comme image
au sens de Sellars. Non pour laisser entendre que Sellars considère les humains féminins
comme moins humains simplement qu’humain fait automatiquement pensé à une entité
biologique et homme ont une construction historique.
notion de «picturing»(action de faire un tableau), inspiré de la conception de
l’image logique du monde chez Wittgenstein est fort relié à la définition que Sellars à du
philosophe. Il s’agit de déterminer qu’elles sont les configurations des objets et leurs
catégorisations, et non des faits comme chez Wittgenstein, dans l’image logique du
monde, bref elle explicite les présupposés épistémiques implicites qui permettent de
déterminer la validité épistémologique des énoncés. Sellars ne cherche pas à constituer
une épistémologue correspondantiste, où la relation d’identité entre la représentation
d’objet perçu ou étudié équivaudrait à l’objet dans le monde extérieur, mais une théorie
coherentiste-verificationiste ou la validité objective des objets perçus est déterminé par
sa cohérence par rapport à l’image logique du monde. C'est-à-dire que validité de
l’énoncé est déterminée par les règles suivit pour le justifié par rapport à une conception
du monde encadré par un système logique.
Pour Sellars, nous voyons apparaitre une nouvelle image de l’homme, c’est-à-dire que la
totalité du fonctionnement de l’homme devient explicable par les sciences naturelles et
que l’homme étant entendu comme sujet connaissant ou objet privilégié dans la nature est
de moins en moins valide comme fondement épistémologique sur lequel produire des
connaissances répondant au critère de validation des sciences contemporaines. En terme
ontologique, cela indique que la conception de la représentation classique est de moins
en moins tenable si l’on veut tenir un discours rationnel par rapport aux développements
des sciences naturelles ou les entités non observables immédiatement permettent
d’expliquer et de prévoir de manière de plus en plus précise les phénomènes observables.
En termes épistémologiques il en résulte que l’homme ne peut être entendu comme point
de départ ou objet d’exception d’une théorie de la connaissance, car il est déterminé dans
un ensemble dont il est une partie, un objet parmi une multitude d’objets et non plus, au
niveau épistémologique, un sujet face à un monde d’objet. Certains ont dénommé cette
condition historique comme la mort de l’homme. Les auteurs que Sellars identifie comme
représentant l’émergence de l’image scientifique de l’homme sont Baruch Spinoza et
William James. Les membres les plus éminents de l’image manifeste sont Platon,
Descartes,l’empirisme britannique classique(Sellars fait souvent référence à Russel sur ce
point), ces auteurs pourraient être qualifié de représentationaliste dualiste, ou alors
sensualiste, défendant une position corelationniste (ou l’Homme et sa conscience est le
fondement de la connaissance), bref, la modernité, si l’on pense dans un schéma
d’inspiration hégélienne est la rationalisation de l’image manifeste du monde comme
image logique de notre être au monde. 51
Un autre aspect de l’image manifeste est aussi la
philosophie pérenne comme interprétation des textes canoniques qui nous aideraient à
penser l’homme et sont être au monde par l’étude des textes ou de la vie des grands
auteurs.52
Les variations de l’image de la pensée à travers l’histoire.
Quand il parle d’image, rappelons que Sellars est avant tout un épistémologue, son
intérêt principal et la condition de validations des énoncées de connaissance, mais il est
inspiré par Kant où épistémologie et ontologie sont intrinsèquement liées.Comme Sellars
n’est pas un auteur existentialiste, il cherche à déterminer ce qui est pensable au niveau
épistémologique dans une image logique du monde donnée qu’il peint comme des
tableaux (picturing).53
Nous allons reconstruire son argument de manière à comprendre
mieux ce qui se joue ici. L’image scientifique émerge de l’image manifeste de l’homme.
L’image manifeste a émergé de l’image pre-manifeste de l’homme. L’image
pre-manifeste se caractérise dans une image logique du monde où tout les objets
peuvent être catégorisés comme des «personnes », c'est-à-dire que le monde et les objets
qui le composent sont conçus comme étant dotés d’intentionnalité et de volonté. Donc,
les événements dans la « nature » sont des actes (ne pas confondre avec actes chez
Bergson),qui ont pour finalité des effets dans le monde, les événements naturels ont une
intentionnalité. Par exemple, «la rafale veut faire tomber le bâtiment»,
« Cette inondation est une punition des forces célestes.»,sont des énoncés
épistémologiquement valides. Il y a donc probablement une distinction faible entre
l’intériorité et l’extériorité puisqu’il semble avoir une différence de degré et non de
nature entre l’homme et les objets du monde, on pourrait qualifier cette phase d’animiste.
L’image manifeste apparait quand l’homme «découvre» qu’il est un être privilégié dans
le cosmos et de plus en plus, il se considérera comme un centre privilégié, il se
rencontrera lui-même et se questionneras sur son « être au monde», l’image manifeste
commença à prendre une forme déterminée avec le questionnement socratique et chez
Platon ou l’on trouve une forme d’animisme rationalisé,54
il suffit de bien connaitre pour
52
Cette critique n’est pas nouvelle et un peu naïve selon nous, par exemple, Hume,
Essais esthétique. 53
Sur l’image logique du monde,Wittgenstein Tractatus-logico-philosuphicus. P.40-41
bien faire ou par exemple dans l’affirmation d’Aristote «l’homme est un animal
politique» où il y a une forme de rationalisation du cosmos, et le début d’une prise en
compte de l’homme comme sujet connaissant, et une rationalisation de l’animisme dans
la nature. L’image manifeste de l’homme prendra une ampleur sans précédant avec le
christianisme, pensons à la genèse, ou les éléments animistes prennent une forme de plus
en plus anthropomorphique (encore plus que chez Platon ), l’homme n’est plus une
émanation de la volonté de la nature, mais une émanation de la volonté de Dieu qui l’a
fait à son image et qui transcende la nature. L’homme dispose d’un royaume à l’intérieur,
son âme,et la nature est un royaume externe qu’il transcende en tant que
créature de Dieu, il dispose même d’une volonté qui lui permet de désobéir à Dieu. De
là apparut l’humanisme… Bien sûr Descartes représente la rationalisation de cette
tendance par une conception animiste de l’âme humaine, qui nous est donnée par Dieu et
une conception mécaniste de la nature, qui est un mécanisme fabriqué par Dieu. Cela
implique que dans l’image manifeste, les sciences de la nature ou la validité de la
connaissance est basée sur l’observation d’un observateur détenant une méthode 55
(et de
moins en moins sur l’adéquation de l’observation avec les textes d’Aristote),L’homme
s’interprétera comme un observateur de la nature. C'est-à-dire que l’homme à des
caractéristiques particulières qui font de lui un être en dehors de la nature, ou alors
nous devons d’abord étudier les caractéristiques de l’homme qui font de lui un être doté
d’une nature et qu’il nous faut étudier cette nature selon les principes des sciences
naturelles, dont les fondements ne sont que conventionnel et se rapportant à l’homme, et
qu’il importera avant tout d’étudier cette nature humaine pour ensuite en dégager des
connaissances qu’il est possible de déterminer,le représentant le plus célèbre de cette
tendance est Hume chez qui l’on trouve les premiers balbutiements de l’image
scientifique selon Sellars. Ce que Sellars nomme image manifeste n’est pas une image
qui est nécessairement anti-scientifique, mais par rapport à l’évolution des sciences, elle
à tout simplement atteint ses limites selon lui.56
Le précurseur de l’image scientifique
selon Sellars est Spinoza avec sa métaphysique réaliste et mécaniste, qui détermine que le
monde est une substance ayant une infinité d’attributs qui s’actualisent dans une infinité
de modes, où Dieu égal la nature (premier moteur aristotélicien +newton) qui est nature
naturée (faite)et nature naturante (se fessant). La relation entre la métaphysique (qui est la
science des sciences) et le social chez Spinoza se rapporte à la connaissance adéquate de
54
Scientifique image of Man,p.16 55
Idib, 56
Idid,. P.19
Dieu et la conception inadéquate de Dieu.57 C'est-à-dire qu’en recherchant les
conceptions les plus adéquates possible de la nature des choses en tant
qu’ensemble d’objets mécaniques s’affectant les uns les autres selon les lois de
la physique newtonienne, il nous est possible de favoriser les conditions
sociales nécessaires permettant la recherche de la vérité philosophique et
scientifique dans la cité. De plus en tant qu’objet mécanique faisant partie
d’ensemble mécanique plus grand nous sommes des entités individuelles, mais
incomplètes, donc étant victimes des passions et ne pouvant avoir de
conception complètement adéquate du monde, il nous faut chercher le meilleur
système politique possible pour assurer la concorde et permettre aux individus qui
composent la cité d’exercer leurs raisons et de vivre selon leurs natures (qu’il ne peuvent
que déterminer en exerçant leurs raisons, donc eux même selon Spinoza). Notons ensuite
que
Sellars critique le principe de causalité de l’image manifeste, contra-Spinoza, car le
principe de causalité se fait toujours par rapport à des ensembles, il n’y a pas de causalité
en soi, mais des prédictions par rapport à des contextes. 58
Venons-en à l’émergence de
l’image scientifique de l’homme.Comme l’image manifeste n’élimine pas complètement
l’image pre manifeste, mais la subsume, l’image scientifique subsume l’image manifeste
de l’homme et aussi longtemps que nous n’aurons pas une image scientifique complète
de l’homme les différents dispositifs de l’image manifeste seront nécessaires pour
accompagner l’émergence de l’image scientifique. D’où l’importance des notions
d’intersubjectivité et de personnes chez Sellars traité dans le dernier chapitre.
L’image scientifique de l’homme (ou image postulationaliste)
L’image manifeste place l’homme au centre de la théorie de la connaissance, c'est-à-dire
comme un empire dans un empire, que ce soit en tant qu’observateur privilégié soit en
t’en que continuateur d’une tradition pérenne, qui s’incarne au niveau épistémologique
dans les textes d’Aristote qui étaient commentés et qui était utilisé comme système de
validation « scientifique» des phénomènes observés. Donc la configuration des objets
57
Sellars est victime de son Hégélianisme en disant que chez Spinoza l’image manifeste
est une fausse image de l’homme. Chez Spinoza elle est simplement une connaissance
mutilée et non une erreur (1er genre de connaissance ),.
58
Contre la «fondationalisme» Spinoziste
dans l’image logique du monde avait pour centre de détermination l’homme, comme
communauté et comme individus. C’est-à-dire que l’image manifeste de l’homme, les
théories épistémologiques scientifiques sont ce que l’on pourrait appelé dans certains
milieux philosophiques corelationniste.
L’image scientifique est caractérisée par la production d’entités théoriques permettant de
valider les données de l’observation. Ces entités théoriques se doivent d’être testées et
validées selon des critères répondant à certaines exigences pour déterminer leurs validités
empiriques et sont révisables, corrigibles et perfectibles par des critiques suivant certains
critères qui permettent une prévision de plus en plus grande et de plus en plus précise des
entités observées. Au niveau de l’explication épistémologique, les systèmes de validation
qui permettent de corroborer des faits sont aussi importants que les « faits » pour
déterminer ce qui est de l’ordre de la connaissance scientifique, c'est-à-dire que les
entités des théories scientifiques déterminent la réalité des objets ou phénomènes
observés ce ne sont pas les faits en eux-mêmes qui déterminent la réalité d’une théorie.
Les entités des théories scientifiques sont la réalité des entités qui apparaissent dans
l’image manifeste, donc l’ensemble des considérations épistémologiques de l’image
manifeste peuvent être expliqué par les théories épistémologiques, c’est-à-dire que
l’homme dans l’image scientifique est un objet parmi les autres objets à la Spinoza. Par
exemple, on peut expliquer le comportement d’une personne par rapport à une théorie
déterminée, ce que Sellars appel le «Iffy effect»,la proposition scientifique
comportementaliste se déclame comme suis, selon la théorie y, si l’événement x se
produit, y réagiras de telles manières.59
.La validité de la théorie scientifique qui
permettra d'expliquer la réalité est déterminée par un processus intersubjectif par une
communauté de chercheur candide et de bonnes fois pratiquant une discipline commune60
,dans l’image logique du monde.Les entités des théories scientifiques sont réelles selon
Sellars, elles déterminent la réalité de ce qui est.
La conception de l’image scientifique de Sellars pourrait laisser penser qu’il s’oppose au
système de représentation classique (moderne) tout en le reproduisant, puisqu’elle
redoublerait le monde où l’on devrait chercher à faire concorder la réalité du monde
59
Sellars,Wilfrid, Science, Perception and Reality.24-25 60
Charles Sanders Peirce,comment se fixe la croyance.Certains éléments peuvent être
problématiques ici,par exemple par rapport aux différentes modalités de production du
savoir et aux relations de« pouvoir »entre les différents chercheurs et les éléments
extérieurs.
extérieur avec la représentation que nous en avons (donc, Kant représente une des
ultimes tentatives). Cette critique est selon nous injustifiée même si le philosophe
américain laisse place a équivoque quand il parle des différentes conceptions de l’image
comme des conceptions «idéales», il “dessine» littéralement un tableau, mais il se
distingue bien de Kant sur ce point. Sellars fait le tableau de l’image manifeste
(et pre-manifeste) par rapport à l’image scientifique. C'est-à-dire que l’observateur de
l’image manifeste est un objet parmi un système de relation d’objet tous comme Wilfrid
Sellars est un objet déterminé par des lois scientifiques qui cherchent à déterminer le
fonctionnement de la connaissance et qui observe une entité ayant une conception
manifeste de l’homme, qui croie que la connaissance se rapporte à lui, Russel par
exemple, qui est un objet parmi les objets que Sellars observe par exemple, et qui
cherche à s’orienter parmi un système de relation d’objet dont il à une image particulière
(mais il est bien un objet). Ce qui laisse place à équivociter chez Sellars est son postulat
que le monde est composé «d’objets» non de «stuff» ou d’images, il doit alors expliquer
pourquoi il est possible que des choses qui n’ont pas de représentation puissent produire
des théories, sauf à affirmer ce sont des choses produites par un « esprit absolu»et que
dans une conception hégélienne, par un mouvement dialectique, il est possible de
découvrir ce qu’il y a derrière l’image manifeste, c'est-à-dire que l’image manifeste
masque une réalité qui est plus réelle que le monde des apparences, et que nous serions à
une fin de l’histoire ou la raison a prise conscience d’elle-même, dans l’image
scientifique, est selon nous un peu naïve et pas très nouvelle61
. Les stade pre manifeste et
manifeste et le stade scientifique ne nous fait t’il pas penser au conception de l’enfance,
de l’adolescence et de l’adulte chez Auguste Compte. Ou de l’enfant, du lion et du
chameau chez Nietzsche dans une perspective antihégélienne.
Bergson et l’image scientifique de l’homme
La théorie de la connaissance chez Bergson est une théorie qui cherche à déterminer
61
Par exemple, Hume, Essais esthétique. Ou Spinoza qui affirme que Platon et Aristote ne
lui ont absolument rien apprit. Ce que reproche Sellars à Russel ou Mill pourrait se
rapprocher de ce que les défenseurs des universaux reprochent au nominaliste.
comment nous saisissons le monde par l’intelligence strictement en tant que corps-image
dans l’espace et en faisant abstraction de la mémoire,c’est une théorie de la
«perception pure». Le but des théories de la connaissance est d’augmenter notre
compréhension des relations de cause à effets et les relations/interactions des différentes
images. Ce qui permettra de prédire le positionnement des différentes images à travers le
temps (qui est une forme de spatialisation de la durée)et augmentera nos possibilités de
réaction face aux actions des autres images sur nous, puisque l’écart entre l’effet prévu
et l’effet actuel augmentera au fur et à mesure que nos conceptions «objectives» des
images, c'est-à-dire les positions des images et leurs tendances,se perfectionneront. Nous
avons un fondement ontologique réaliste antireprésentationaliste qui rendra possible un
«knowing how» pour atteindre un «knowing that» réaliste en droit. Pour Bergson dire que
le monde est composé «d’objets» serait contradictoire avec son
antireprésentationalisme, car cela serait retombé dans le postulat commun qui a mené aux
impasses du réalisme et de l’idéalisme qu’a tenté de résoudre Kant sans succès,selon
Bergson.Pour Bergson le monde est composé d’images qui sont de la matière certes, mais
non de la matière qui peut être perçus dans sa totalité par nous en t’en qu’image.
Bergson fait de la métaphysique, mais pose-t-il la causalité comme premières ou une
causalité première?Bien sûr que non. Si nous comparons Bergson à Spinoza par rapport
au problème de la causalité; chez Spinoza «Dieu en tant que nature» est la cause
première, le «premier moteur», donc chez Spinoza tout est «causé» ultimement, en droit
par une cause première qui ressemble à un moteur immobile à la Aristote. Dans la
métaphysique bergsonienne ce qui est premier est la durée,donc il n’y a pas de
«cause première» ou premier moteur, mais un événement est causé par une multiplicité
de cause qu’il est possible de saisir d’une certaine manière comme unité par un acte
d’intuition simple, qui demande un «effort et est une «méthode», dans la durée.62
Donc,
la théorie du « iffy effect» , exposé chez Sellars, répond exactement à la procédure qui est
suivie par la science ou le sens commun, donc l’intelligence, dans le premier chapitre de
matière et mémoire. Bergson est anti représentationaliste, nous ne répéterons pas ce qui a
été écrit plus hauts, mais le corps est une image, un schème sensori-moteur, la mémoire
contraction peut être considéré comme des habitudes inductives chez Peirce. La
différence est qu’il est possible chez Bergson pour un corps de produire des « actes
libres», qui sont des événements exceptionnels, non des «miracles»,Bergson explique
tout à fait pourquoi c’est possible. Le cerveau peut être connu en soi et il est même
62
Dans l’évolution créatrice Bergson semble cherche à démontrer que l’univers en
évolution est cause comme dans un phénomène de détraction, mais il s’agit d’une
détraction par rapport un événement, comme la théorie du big bang.
possible de prévoir certaines actions du corps favorisé par le cerveau.Même s’il y a une
certaines indétermination de la volonté et l’aspect de la mémoire , il est possible de
déterminer la tendance entre différentes réactions anticipées par le système nerveux et le
cerveau qui n’ajoute rien à la matière et la prend comme elle est.63
Bref, Bergson répond
aux critères de l’image scientifique de l’homme chez Sellars même si les principes de sa
philosophie pourraient laisser entendre qu’il se trouve ouvert,ou complètement ouvert,
aux critiques que Sellars fait aux philosophes associés à l’image manifeste. L’image
scientifique équivaut à la notion d’espace chez Bergson(dans le premier chapitre de
matière et mémoire) et détermine les conditions pour une conception postulationiste de la
science. Le «dualisme» bergsonien s’appuie sur une conception scientifique de l’homme
tel que défini par Sellars. 64
Maintenant Sellars produit deux tableaux par un acte d’intuition, donc construit une
image de deux totalités idéales qu’il oppose,il les décompose selon une définition à
l’aide de savoirs faires qu’il possède, une connaissance de l’histoire de la philosophie, en
particulier de certains philosophes (on peut repérer clairement Kant, Hegel, Wittgenstein,
James et Peirce, certaines compétences en logique formelle. Voyons ce qui en est des
tableaux que Sellars a constitués (en les intuitionnants dans une perspective
bergsonienne). Même si Sellars insiste pour dire que ce sont des conceptions idéales,
certains présupposés par rapport à l’image manifeste sont problématiques,par exemple
par rapport au rôle de la communauté. Comme si dans l’image manifeste l’on partait d’un
individu qui réalisait qu’il était membre d’une communauté et que Hegel aurait
découvert que l’homme ne peut se réaliser sans la médiation d’une communauté, nous
avons volontairement ajouté «l’homme est un animal politique» et l’interprétation des
textes d’Aristote,qui pourrait être considérés comme un noyau heuristique fort solide,
dans notre exposition de l’image manifeste. Pour Aristote l’homme est un animal
communautaire, il ne se réalise et acquière des connaissances que dans la communauté et
grandit dans une famille, l’homme n’est pas un dieu ou une bête.65
Ce n’est pas Freud qui
à découvert le rôle du milieu familial dans la formation de la personnalité,par exemple,
Saint-Augustin,Spinoza, Aristote (sans parler que des groupes sociaux viables se sont
constitué en ayant des systèmes de structure familiale «non-nucléaire»,par exemple
Platon dans la republique à pensé à quelque chose du genre)… La tension entre individu
63
Matiere et Mémoire p.37 64
Nous ne défendons pas une conception dualiste,le « problème »du dualisme
bergsonienne peut être résolue ou apprehendé de plusieurs manières,pas traité ici. 65
Bien sûr, Aristote est réaliste, le monde existe indépendamment de nous et du langage
et communauté est un problème récurant dans l’histoire de la philosophie, de même que
celui de «l’apparence et la réalité». Et L’Homme se concevait «animal politique»
probablement même dans «l’image animiste.».D’ailleurs ne se considérait-il pas comme
membre d’une communauté qui englobait la communauté de la nature, et peut-être même
il y avait tension entre certains individus et leurs groupes dans l’image animiste.Un des
éléments méthodologiques dont fait usage Sellars est de constituer des règles abstraites
permettant d’expliciter des phénomènes, des dispositifs dirait certains, mais comment se
constitue ces règles, par un processus intersubjectif, par un processus entre sujets, mais
comment est constitué le sujet, un sujet se constitue par sa capacité a suivre des règles
comme on suivrait des jeux de langage? Il semble avoir un point aveugle dans l’aspect
réalisme scientifique et à certains présupposés ontologiques par rapport au lien entre
image manifeste et image scientifique du type,dans l’image manifeste nous disposons
d’un libre arbitre(On peut suivre des règles)par rapport à une image scientifique qui est la
vrai(ou il n’y a pas de libre arbitre).
Le réalisme bergsonien postule que le monde est composé d’images et non de choses qui
sont appréhendées selon des habitudes inductives sous une image particulière et que la
perception pure est première et impersonnel (en droit tout de moins) car nous ne
percevons avant toute chose que des images qui sont matière. L’ ensemble des images
sont données comme totalité, mais ne sont pas données à une conscience a priori, elles
affectent une image particulière qui est notre corps. Nous ne pouvons pas trouver une
“réalité” derrière les apparences, car nous serions totalement présents aux autres images,
donc des objets opérant dans une causalité stricte. Il y a plutôt des apparences et des
apparences fausses dans nos rapports avec les images, tout ce que nous pouvons faire est
construire des appareils techniques, des machines, des théories, des nouvelles images…
qui augmenteront notre perception dans le but d’augmenter nos capacités d’action.Ici
nous utilisons les termes d’apparence et de fausse apparence,mais Bergson affirmerait
plutôt définis ou indéfinis ou alors définitions plus ou moins adéquates.
L’univers est une totalité indéfinie que nous définissons d’une certaine manière. Et encore
nous n’utilisons pas vrai ou fausse apparence par rapport à une conscience. Nous
réagirions différemment si nous étions composés de manières différentes, si la
composition des images qui est notre image-corps n’était pas la même.Par exemple, si
nous avions une modification génétique, et que plus sensible à la chaleur,il nous serait
possible de nous orienter par rapport à celle-ci, nos théories scientifiques,par l’intérêt de
nos recherches, différeraient complètement.Ou alors,si nous étions dans un espace clos et
qu’un gaz toxique inodore, incolore, que nous ne percevions pas, se propagerait dans la
pièce, nous serions complètement présents à celui-ci, ce gaz ne serait pas la réalité
absolue derrière une apparence, mais simplement une composition des images dont une
partie nous affecterait et auxquelles nous serions totalement présents, elle nous affecterait
directement sans que l’on puisse réagir. Faire d’une image un «objet» c’est l’isoler et
l’immobiliser dans le but d’en décomposer les parties pour en déterminer le
fonctionnement, et prédire ses actions et réactions possibles. Dans la théorie
épistémologique de Bergson, si nous suivons une méthode scientifique appropriée, elle
n’en serait pas moins réelle. Le réel est connaissable à condition d’avoir la bonne
conception de la métaphysique et de la science, mais l’image n’est pas connaissable en
soi, c’est une unité qualitative, puisqu’une image apparait toujours à une autre image qui
est dans une situation particulière, à un composé d’image qui forme une image qui est le
corps qui la perçoit d’une certaine manière, due à sa composition interne et à l’ensemble
des images qu’il a perçues dans le passé, qui forme sa mémoire.
Mythe de Jones et l’image d’Alexander Ovechkin, une personne est t’elle un
simulacre ou une entité ontologiquement valide.
«La thèse de tous les idéalistes véritable, depuis l’école éléate jusqu'à l’évêque Berkeley
est contenue dans cette formule « Toute connaissance obtenue par les sens et
l’expérience est simplement apparence, et il n’est de vérité que dans les idées de
l’entendement et de la raison pure
Le principe qui régit et détermine de part en part mon idéalisme est au contraire le
suivant «Toute connaissance des choses qui proviennent uniquement de l ‘entendement
ou de la raison pure est simple apparence et il n’est de vérité que dans l’expérience»
Emanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique du future (en réponse à une critique,
Kant regrette d’avoir dénommé un aspect de sa philosophie idéalisme et précise avec
l’énergie du désespoir que son projet philosophique à pour but d’être des plus réalistes
qui soit, et même est antiidéaliste.
Comme noté plus haut,Sellars cherche à démontrer que les postulats de ce qu’il nomme
l’image manifeste de l’homme sont subsumés lentement mais surement par l’émergence
de l’image scientifique. C’est à dire que ce qui pouvait être déterminé comme le
fondement épistémologique de la connaissance, une entité particulière, l’Homme
comme entité privilégié, devient une entité observante dans une théorie épistémologique
scientifique quelquonc.66
Selon Sellars, la science qui cherche à constituer l’image
scientifique de l’homme, sur laquelle on doit se fier pour constituer une épistémologie est
le behaviorisme, qui postule que seulement les comportements observables selon les
66
Sellars,Wilfrid,Science,perception and reality P.191
critères de validation des sciences naturelles sont légitimes pour expliquer le
comportement d’un spécimen humain avec une rigueur scientifique. On reproche
généralement au behaviorisme d’avoir une conception incomplète de l’homme, car on
ne tient pas conte des «états internes» mais seulement des comportements observables,
c'est-à-dire que le behaviorisme ne cherche pas expliquer pourquoi une personne
«prévoit» faire quelque chose avant d’exécuter l’acte ou affirme que cela n’est pas
(«prévoit») une entité scientifique valide pour expliquer un comportement,il n’y a qu’un
corps-objet qui a des stimulis et des réponses par rapport aux autres objets qui agissent
sur lui.Les états internes seraient le dernier rempart des tenants de l’image manifeste.
Sellars cherche à expliquer le phénomène de l’intériorité en terme behavioriste en
construisant un mythe, le mythe de Jones. Sellars débute son mythe en cherchant à parer
des critiques qui pourraient affirmer qu’en créant un mythe pour expliquer l’existence
d’états internes dans l’image scientifique,il pourrait faire faire et dire n’importe quoi à
ces protagonistes, mais il affirme, tel un hypnotiseur, que peut de personne ou philosophe
affirmeront cela.67
Voilà le mythe; imaginons une tribut,les Ryléens, dont les membres maitrisent toutes les
opérations caractéristiques du langage, déterminées par des opérateurs logiques simples
et aussi des discours «indéterminés»,de logique «floue»... Leurs langages est
complètement public,parlé (an overt speech) et respecte les relations de cause à effet,
donc il est possible de traduire les énoncés puisqu’ils ont une validité observationnel.68
La tribut à des théories de base pour expliquer les observations,bref ce sont des
behavioristes des plus stricts, ils n’ont pas la possibilité d’expliquer les états internes. Un
jour arrive Jones,qui s’y prend en introduisant un troisième terme, le «modèle», pour
expliquer l’existence des «états interne».Il s’y prend de la manière suivante;d’abord,une
67
Ibid., P.179 Sellars semble souvent faire appelle à des arguments d’autorité injustifiés,quand un tel
argument est avancé par un bon philosophe(ce que Wilfrid Sellars est), c’est qu’il sait qu’il y a des
objections qui lui donnent du fils à retorde ou des éléments d’ont il ne veut pas tenir compte, mais qui sont
pertinent… «on sait qu’une théorie des images est vouée à l’échec», pourquoi? «L’image manifeste est très
dualiste» d’accord que le dualisme est un problème ontologique,semble être un jugement de valeur,
Heidegger n’a pas de problèmes de dualisme, sans parler de Bergson qui prône une forme de dualisme et
qui répond au critère postulationel de l’image scientifique.«Oui la créativité est un facteur essentiel de
l’évolution des sciences». Ce n’est pas son problème, on comprend, mais on peut dire qu’il n’y a pas de
science sans créativité,ou qu’il est possible de comprendre la science sans tenir compte de l’aspect de
creativité.
68Ibid P.180
théorie est un système de postulation(behaviorisme par exemple) qui permet l’explication
des éléments observés.Une théorie,pour être valide,doit pouvoir reproduire le même
phénomène selon les principes qui constituent la théorie de manière systématique ou
répétée. Bref, une théorie permet d’expliquer une observation et d’en déterminer les
causes. Un modèle est la définition de l’observation expliquée par la théorie (OET).Plus
simplement, pour constituer un modèle, on extrait les éléments de l’OET en les
définissant dans un ensemble selon certaines règles, disons à l’aide d’un «know how» qui
permet de sélectionner les éléments pertinents pour la production du modèle,
un «know how» permettant un «know that».Une fois le modèle constitué, il peut servir
d’hypothèse de base pour chercher à expliquer un phénomène observé. Un OET pourrait
se déclamer comme suis, «l’observation x se produit parce que les éléments y sont
réunis» un modèle se déclame comme cela« p postule (ou je pense que) l’observation x se
produit parce que quand les éléments y sont réunis dans une situation semblable, x se
produit». Maintenant Jones explique sa théorie du modèle à ses compatriotes, qui
maîtrisent le langage behavioriste, qui en écoutant les membres de leurs tributs exprimer
dans les termes du «je pense que» lui attribut des états internes selon les principes du
modèle, ce qui a été appris devient une habitude et à partir de cela,il est possible
d’attribuer des intentions et des états internes par observation sur le principe du
modèle.Bref,l’usage du modèle indique que le langage utilisé par un interlocuteur est reçu
comme une hypothèse,et non une affirmation littérale, par les autres interlocuteurs.De
même les «impressions» et «l’expérience immédiate» où «l’intentionnalité»sont des
entités théoriques, elles sont le résultat d’un processus intersubjectif et donc ne peuvent
pas être à la base d’une théorie de la connaissance «réaliste» dans l’image scientifique de
l’homme.C'est-à-dire que fonder une théorie de la connaissance sur les «impressions»,
«l’expérience immédiate»,«le cogito» est le résultat d’un processus intersubjectif.Donc
pour Sellars, dans un projet réaliste scientifique, ces fondations comme base de la
connaissance sont injustifiées.
Sellars affirme dans le texte qu’il fait de la bonne méthodologie et pas de la
métaphysique pure et que dans son mythe les Rylien n’ont pas de conception des images
(mais ils ont accès au langage!),de plus, il affirme que dans la conception scientifique de
l’homme nous ne pouvons pas déterminer avec assurance le rôle du système nerveux et
du cerveau, il parle dans SIM d’être prisonnier dans un schéma de « Matter and
consciousness».69
On peut donc présupposer qu’il sait qui est Bergson et qu’il croit que
69
Plus tard dans Fondation for a metaphysics of pure process,il cite Bergson.
son mythe du donné s’applique à sa philosophie. Pour ce qui est de la métaphysique, le
modèle prés des entités maitrisant le langage qui n’ont pas de conception des
images.Comment pourrait-on prouver, par une méthodologie des sciences naturelles, qui
ne se fonde pas sur la Genèse, que nous maitrisons le langage avant de percevoir des
images au sens bergsonien, un bébé naissant perçoit des images, probablement dans une
totalitévague ou les images ne sont pas vraiment définies et il n’a peut être pas de notion
d’intérieur et d’extérieur, mais il perçoit, il réagit à des sons, au touché, à des sources de
lumière, de manière indéterminée, mais il réagit. Nous réalisons peu à peu qu’une image
est toujours là, semblable, face à des images changeantes et c’est par les affections qui
s’affinent peu à peu à cause de l’appréhension des effets des images sur nous,
que se constitue peu à peu le sentiment d’un intérieur et d’un extérieur.70
Bref, nous
sommes dans un processus d’individuation (un devenir dans la durée), nous avons des
caractéristiques en tant qu’image qui font que nous nous individuons de telle ou telle
manière par rapport aux autres images et c’est notre appartenance à différents régimes
d’individuations, dont des éléments équivalents à intersubjectivité font partie, qui sont la
possibilité de l’existence d’«états internes».«États internes», qui chez Bergson sont lié à
la mémoire du passé en tension avec l’appréhension du future ou,strictement dans un
niveau physicaliste,ce qui vient de nous affecter et l’anticipation par la perception de ce
nous anticipons nous affecter. L’individuation excède l’intersubjectivité et l’individuation
est la source première des «états internes». Sellars à un étrange argument qui consiste à
dire que dans l’image scientifique on n’a pas déterminé le rôle du système nerveux, qui
chez Bergson est un système d’action réaction plus ou moins clos par rapport à un
«extérieur», (en terme deleuzien on dirait un agencement machinique, on pourrait dire un
composé d’images qui garde pas mal toujours les mêmes caractéristiques(un corps) qui
change de position par rapport à un composé d’images qui change par rapport à ce
composé d’images qui est notre corps)71
,en plus, Bergson affirme qu’il est pensable
en théorie qu’il y ait des perceptions sans organe de perception, tout de moins dans les
perceptions pures sans système nerveux, donc Bergson a surement prévu ce type
d’objection,72
de plus Bergson précise que pour avoir une conception adéquate, objective
de la perception pure, l’on doit laisser de coté les affections et les impressions, qui sont
des dérivés de la perception et non sont fondement.73
Bergson émet une hypothèse
70
Matiere et Memoire P.34 71
Ibid P.27 72
Ibid P.25Ultimement, les images dans l’espace sont un système d’action réaction 73
C’est un procédé, pour avoir la possibilité de déterminer un discours scientifique on doit
avoir une ascèse. C'est-à-dire reproduire l’espace dans la mémoire et déterminer certains
(créé un modèle) c'est-à-dire qu’il base sa théorie épistémologique et utilise les sciences
expérimentales de son époque pour déterminé la validité de son modèle. La théorie des
images de Bergson est un métamodèle qui explique comment un modèle peut surgir, sans
la théorie des images de Bergson aucun modèle ne serait possible. Pour Bergson le
langage surgit de notre relation avec les images et est une convention adoptée pour agir et
s’orienter en commun parmi les images, on nous apprend à désigner des images par des
sons ou des symboles (mots en alphabet arabe,latin, signe japonais…).Pour être
provocateur, dire que le langage précède les images ou dire que le langage est premier
dans l’ordre de l’être et même seulement de l’expérience intérieure, c’est être
créationniste! Le langage est fort utile et est un outil de relation avec les images des plus
mobile et efficace,mais les mots et les sons sont des images que l’on perçoit et qui
sollicitent notre système nerveux, notre capacité de s’approprier le langage impersonnel
qu’on nous apprend avec des formules toutes faites pour en faire notre langage résulte de
notre particularité de vivant de ne pas avoir des réactions proportionnelles aux actions
subit. C’est la tension entre les effets actuels et les effets anticipés que les autres images
ont sur nous qui rend le langage possible et non le langage qui rend les états internes
possibles.Nous ne sommes pas les fils de dieux qui créeraient l’univers en le nommant,
mais l’univers est une machine à faire des dieux.
http://www.youtube.com/watch?v=vzbmI6-YSnQ 74
Faire un modèle c’est construire une image, et face à une nouvelle image on est comme
un enfant qui apprend à s’orienter parmi les images et qui expérimente. Maintenant le
«modèle» on en fait usage, on à avec lui une relation subjective, on le prend comme une
totalité, ou une relation objective, on le décompose pour déterminer sont fonctionnement
ou expliquer ce qui se produit. Constituer un modèle résulte d’un effort intellectuel, c’est
un acte d’intuition, on extrait les éléments objectifs, décompose une image en multiplicité
d’images, d’un état subjectif, une image «totale» pour les recomposé en une autre totalité
aspects de l’entendu en ne tenant compte, que de manières secondaires, des affections,
qui sont simplement des zones de tension «d’indétermination».Si il n’y a pas d’affection,
nous ne sommes qu’un objet inerte, mais l’affection n’est pas un fondement
épistémologique pour constituer une théorie de la connaissance. Pour avoir une
perception «objective» sans sensation signifie étudier quelque chose comme sur une
photo par exemple, c'est-à-dire prendre un moment instantané et l’étudier comme un
objet. Ibid,. P.33 74
Un video youtube qui de plus mets en scène une partie de hockey n’est pas du gouts de
tous,mais il est justement un exelent exemple du rapport image-language-durée.
(état subjectif, nouvelle image «total»). Ca prend un corps qui perçoit des images, une
mémoire pure avec des contractions à l’aide de laquelle on s’oriente parmi
les images (qu’elles soient perçues ou rappelées),dans le langage de Sellars une OET ou
une habitude inductive qui devient de plus en plus impersonnelle plus elle est maitrisée.
À noter que cela s’applique à l’enclenchement «d’actions machiniques» dans l’espace ou
de «rappel» de schéma intellectuel dans la pensée. Une OET, que ce soit une
théorie validée (une image de la mémoire contraction) ou un acte fonctionnant de
manière optimale (un acte en enclenché par la perception) est un système de répétition
déterminé, un circuit fermé qui fonctionne.75
Un acte d’intuition, un effort intellectuel,
implique une déshabituassions relative ou une totalité qui devient de plus en plus vague
ou de moins en moins déterminé, comme si l’on redevenait un enfant, à partir de laquelle
l’on recompose une totalité ou un repositionnement.Chez l’humain, créature vivante ou
l’indétermination est la plus grande, donc dont les «knowing how» sont les plus variés,
cela peut être des actions spectaculaires, comme le but d’un joueur de Hockey, la
production d’une théorie scientifique, la création d’une œuvre d’art,mais aussi un geste
quotidien, comme une infirmière qui fait un petit geste imprévu, qui facilite la vie de sont
patient, que personne n’a vue et que peut-être même son patient ne s’est pas aperçu.
Pour Bergson, nous n’avons le choix de construire une théorie de la connaissance qu’à
partir de moment instantané figé(ou de séquences closes reproductibles).Il est possible
d’avoir des prédictions qu’en comparant deux moments instantanés figés ou plusieurs
séquences close l’une par rapport à l’autre, et d’en dégager la tendance. Voir des images,
qui sont de la matière en tant «qu’objet» est le résultat d’habitudes inductives qui sont
déterminées par notre composition en t’en qu’image.Si nous pouvons construire une
image scientifique de l’homme, ce n’est qu’une image figée dans le temps dans le
processus de l’évolution, l’image scientifique de l’homme n’est qu’un outil permettant
une plus grande action de l’homme sur l’homme76
. Ce qui caractérise l’homme est une
forme d’indétermination parmi les individus et même en tant qu’espèce, il y a toujours
quelque chose qui excède, qui peut être prédit en partit seulement,des événements ou des
«découvertes» imprévus ou inconcevables peuvent survenir et faire voler en éclat des
éléments conçus comme des plus solides. La science est une activité pratiquée par des
organismes vivants qui sont par définition indéterminés.La science,activité de
75
Matière et Mémoire p.62-63 76
Nous ne disons pas qu’une image scientifique n’est qu’un outil de domination de
l’homme par l’homme,bien que cela serait possible, mais est un outil qui augmente les
capacités d’actions(de puissance)des hommes.
l’intelligence, a pour fonction ultime une compréhension de l’espace qui nous permettra
d’élargir notre champ d’action. La science n’est plus un outil de description de la
«réalité»,l’a t’elle déjà été?mais estun outil avec lesquelles on créé jusqu’à des entités
vivantes.La science même comme système de postulation est un outil d’abstraction
qui permet une extension de la perception,qui est relié à l’action et non à la
contemplation,selon Bergson.La réflexion est la recherche de solutions alternatives ou
tentatives d’explications quand des éléments ou événements inédits,détail non pris en
compte,des méthodes alternatives rendent problématiques certains éléments
du système de postulation.Nous cherchons alors à reconfigurer le système de postulation
ou le système d’image par des actes d’intuitions,par rapport à nos habitudes inductives,
ou littéralement par nos actions.
Pour Sellars la pensée est reliée au langage et même s’il existe de la pensée sans
langage77
,le langage est premier dans la hiérarchie de l’être.Dans The Scientific Image,
Sellars affirme que l’étude des systèmes informatiques nous donne la clef pour
comprendre la pensée dans l’image scientifique de l’homme . La pensée(toute la
«pensée» est à l’intérieur du cerveau) est selon lui des patterns de relations qui sont
analogues au fonctionnement d’un système informatique, par la manière que les énoncés
sont reliés entre eux et de la manière qu’ils sont utilisés.78
Il utilise le modèle d’un jeu
d’échec,dont les règles ne changent pas, mais dont la forme des pièces et la forme du
tableau pourrait varier. Le fonctionnement du cerveau équivaudrait à l’opération d’un
télégraphe, comme un télégraphe dans un pays étranger qui enverrait des signaux, la
fonction du cerveau équivaudrait à la capacité du système informatique à traiter les
informations et à les reproduire.Encore,noter que pour parler des «états internes» ou à
l’activité de «pensées »,Sellars doit faire appel à des images (puisqu’il essaie de
constituer ou se fit sur un modèle),le système informatique, un jeu d’échec,un télégraphe.
Maintenant, prendre un objet technique créé par l’homme et déterminer que cet objet
nous donnera une image réelle,réaliste,par un processus d’abstraction ou un modèle est
un peu problématique ou naïf selon nous… par exemple, le feu, la roue, le train…où
n’est-ce pas l’affirmation que l’on ne peut se passer des images pour faire évoluer la
pensée, qu’elles sont nécessaire, même le fondement pour produire des abstractions et
faire évoluer la pensée conceptuel.79
L’usage du modèle, ou de l’image utilisée comme
modèle,chez Bergson,avec la photographie particulièrement, qui à l’époque devait être
77
Wilfrid Sellars, Mental events 78
Ibid P.34On reconnait bien sûr les jeux de langages wittgensteinien, 79
Par exemple, Lorraine Daston,Peter Galison, voir Objectivity,
aussi impressionnante que l’informatique aujourd’hui, c’est un usage qui nous permet
d’avoir une meilleure compréhension de la perception, elle ne dit pas la réalité de la
perception,c’est l’erreur commune des réalistes et des idéalistes par exemple,qui
prennent la photo pour l’image réelle du monde et ensuite essaient de penser les
phénomènes à partir de la photo comme si elle était la réalité.C’est une image qui nous
permet de comprendre mieux d’autres images, par exemple on peut avoir une meilleure
description des éléments d’une situation si nous prenons une photo et l’étudions, c’est
simplement une image rappelée de la mémoire qui nous permet de comprendre mieux le
fonctionnement de la penser, une analogie qui nous permet de mieux saisir comment
fonctionne la perception,mais n’est pas la clef pour comprendre la totalité de la réalité.
Bref,Bergson n’utilise pas le fonctionnement du système photo comme quelque chose qui
nous dévoile le réel derrière l’apparence,mais une image qui nous permet de mieux
comprendre notre perception en ce qu’elle nous permet de créer des abstractions par mise
à distance.Bergson est conscient que la photo est une image que l’on utilise comme
dispositifs technique paradigmatique,un modèle,pour comprendre les éléments dans le
monde, comme certain l’on déjà fait avec le train, le feu, la roue, et même le tonnerre,
dire que le modèle nous permettra d’aller derrière les apparences et atteindre la réalité qui
serait derrière c’est produire une fausse réalité, qui nous masque la réalité qui est toujours
en mouvement, c’est encore une fois tomber dans le problème des réalistes et des
idéalistes.Pour Bergson,c’est un outil de l’intelligence,qui nous permet d’augmenter
notre perception de l’espace et nous aide à comprendre le fonctionnement de notre
intelligence. Notre réussite par un acte,de constituer une machine qui fait des calculs ou
une machine qui reproduit des images que nous avons vue tel que nous les avons vues (la
photographie par rapport à la peinture par exemple) nous permets d’avoir une certaine
compréhension du fonctionnement de la perception,mais n’atteint pas la réalité de la
chose avec laquelle on la met en analogie.Cela serait tombé dans le mythe de la genèse
(encore plus de dire que le système informatique pourrait nous permettre de découvrir les
clefs de la pensée, comme si le vivant était une production conçue par une entité ayant
une volonté suivant un plan et une logique,c’est retombé dans l’habitude inductive de
dire que quelque chose nous à fabriqué de manière intentionnelle).
Le traitement de l’information par rapport au jeu d’échec n’est pas des plus judicieux
pour comprendre la conscience ou plus précisément l’existence des états internes.80
Le
jeu d’échec est l’exemple parfait pour montrer le problème de la spatialisation du temps
chez Bergson, un jeu d’échec est une succession de moments figés et affirmer que l’on
peut reproduire les états internes ou reconstruire une image du monde (et même des
états de conscience internes en utilisant les jeux d’échec est superficiels puisqu’il laisse
de coter le facteur d’indétermination et l’émergence d’éléments qualitatifs (intensifs) qui
sont le fondement des états internes selon Bergson. Le temps réel,ou la durée,n’est pas
une succession de moment figé, mais une chose qui s’écoule sans arrêt.C’est la durée qui
est interne aux choses qui est l’aspect qualitatif de l’expérience et l’intériorité se
constitue dans notre rapport avec les images par la perception pure et la mémoire.
Dans un jeu d’échec,toutes les images sont totalement présentes les unes aux autres et le
virtuel est réduit au possible(il y a une limite d’actions possibles et de parties possibles)
et rien de nouveau ou d’inédit qui était impensable ne peut apparaitre, à moins de
changer les règles du jeu qui sont adoptées par convention entre des personnes.Par contre,
nous ne serions plus dans un jeu d’échec si la règle du jeu changeait, l’aspect qualitatif
de notre expérience se modifierait. Reproduire des règles n’est pas la preuve que nous
avons des états internes, la possibilité de programmer un ordinateur pour qu’il fasse des
opérations complexes ne prouve aucunement son intériorité. Pour revenir à la partie de
hockey, un ordinateur dans un pays étranger nous rapporterait; Goal;Ovechkin;unasisted ,
Washington 6-Pheonix 1
Une personne devient-elle une personne parce qu’elle est reconnue comme telle ou
parce qu’elle possède des caractéristiques intrinsèques81
La notion de personne chez Sellars est reliée à la reconnaissance qu’une chose qui est
dénommée humaine à une intériorité. C'est-à-dire qu’une chose humaine peut être étudiée
dans l’image scientifique comme un objet qui agit et réagit en tant qu’objet aux autres
objets, mais la condition humaine est de vivre dans l’image manifeste où cette chose
humaine est en relation avec d’autres personnes. C'est-à-dire que l’on peut lui attribuer
des intentions, la capacité à suivre des règles et à leur désobéir.82
La différence entre une
personne et une chose est au niveau de la description dans une communauté,
81
Se type de questionnement se trouve dans la philosophie anglo-saxonnne,par exemple
une personne moral est tel une personne ayant la faculté de faire usage de la raison(dans
la tradition kantienne,Rawls par exemple),ou une personne morale est tel une entité ayant
la capacité de faire un effort et donc d’avoir des affection(les personnes qui défendent les
droits animaux, ,par exemple la critique de Nussbaum de Rawls) 82
Ibid P38
c'est-à-dire qu’une personne est définie par ce qu’elle devrait (outgh) faire selon les
intentions d’une communauté à laquelle elle appartient, une communauté est toute forme
de groupe, c'est-à-dire une communauté avec laquelle elle peut discourir, donc une
personne peut appartenir à différents groupes, s’insérer dans différents jeux de langages
et développer sont individualité.L’image scientifique dérive de l’image manifeste et nous
n’avons trouver aucune justification absolument convaincante,dans
les textes de Sellars, pourquoi l’image scientifique décrirait la réalité de l’image
manifeste au sens de réalisme scientifique dans le sens qu’il détermine. On est dans le
problème de Nietzsche, dire que la science est la réalité de toute chose est une affirmation
qui est problématique, pour Nietzsche, il en résulte qu’il n’y a pas différence qualitative
entre un discours religieux (morale) et la science, ce n’est qu’un mode d’évaluation (ce
qui est problématique pour un défenseur du réalisme scientifique).Ici Nietzsche défend
une forme de rationalisme problématique, la raison critique la raison et la raison n’a pas
justification rationnelle pour se justifié,il est très problématique de sortir de l’image
manifeste de la manière qu’articule Sellars dans cette perspective.Si l’on se met dans une
perceptive plus foucaldienne l’image scientifique s’approche du biopouvoir, c'est-à-dire
que le pouvoir à la capacité de faire vivre et de laissé mourir, donc le sujet ne se forme
pas nécessairement en suivant des règles adoptées (ou des lois)(ou les règles sont moins
visibles dans l’immédiat) par une communauté et est jugé selon le fait qu’il respect les
règles, mais le but de la communauté, et de ses institutions, est de faires proliférer,
d’augmenter la puissance d’agir pourrait dire Spinoza, des différents éléments qui
constituent et la compose. Biopouvoir, juridico-discursifs ou autres, c’est le pouvoir qui
forme d’une certaine manière le sujet, ou la personne dans le contexte ici, il est non
subjectifs, non intentionnel et il résulte d’un rapport différentiel entre les corps, c'est-à-
dire que se sont des pratiques, des habitudes inductives, qui souvent se reproduisent de
manière non consciente.«L’intersubjectivité» est toujours par rapport à un arrière-plan
qui est les différents dispositifs de pouvoir(pratique, institution),qui forme le sujet et qui
entre dans un processus dit intersubjectif.83
Encore une fois Sellars, semble victime du
mythe du jardin d’Éden ou du départ idéal, .L’intersubjectivité telle que déterminée par
Sellars présuppose des sujets qui maitrisent le langage, l’application consciente de
certaines règles et la capacité de les appliquer consciemment,une forme
d’intentionnalité constituée par le langage partager par le groupe. Dans la conception
83
Nous sommes conscients que les termes de personne/sujet. d’habitude
inductive/pratique ne sont pas des synonymes,leurs ressemblances plus que leurs
identités ne sont pas problématiques dans la perspective donnée ici(elle pourrait le
devenir)On parlerait ici d’un Foucault Bergsonien.
Sellarsienne de la personne et de l’intersubjectivité, plusieurs présupposés de l’image
manifeste que Sellars critique sont latents et sont utilisés comme fondement, ils ne sont
pas le résultat d’un processus intersubjectif.Si on ajoute que l’image scientifique est
considérée comme la réalité de ce qui est,84
alors l’image manifeste n’est qu’un jeu de
simulacre, on se trouve comme dans la Naissance de la tragédie grecque chez Nietzsche
ou l’univers n’est que volonté de puissance et que les personnes ne sont que des masques,
une simulation de cette volonté de puissance, le concept de personne ne deviens qu’une
simulation et il nous faudrait faire appel à Heidegger avec ces concepts d’authenticité, de
souci et ces deux conceptions de la vérité. Si l’on se positionne dans une perspective
d’une forme de libéralisme au sens très large, d’une manière ou d’une autre dans la
tradition des lumières, donc croire qu’une société idéale est une société ou chaque
individu a la possibilité de se déterminer selon ce qui lui convient et que la fonction des
institutions publique et de la science,qui sont des éléments importants pour
l’émancipation de l’humanité et sont des outils essentiels dans cette quête, il y a un
malaise non par rapport à l’intention, mais à la conception de la science et ses
justifications, puisque la science devient une forme de pouvoir à la Foucault ou une
forme de pouvoir ou la justification rationnelle est problématique,Popper y
verrait un problème aussi.85
Pour Bergson, ce qui détermine qu’il y a des états internes n’est pas à proprement parlé la
capacité à répéter des règles, mais la capacité qu’on certaines images à ne pas
avoir constamment des réactions proportionnelles aux actions subites,qui en font des
zones d’indéterminations (partiel,pas total,qui font que des événements inédits pourrons
84
«Science is the measure of all things»Sellars, Science perception and reality, p.173 85
On pense à la formule de Bakounine« ne donnez pas le pouvoir au scientifique! Ils vont
faire avec nous ce qu’il font avec les lapins!», l’aspect superficiel de la révolte
bakouninienne comme moteur de l’évolution n’est pas a démontrer ici. La révolte au sens
de Bakounine résulte en une insatisfaction face une situation donnée et avec l’incapacité à
trouver des solutions appropriées au problème. La révolte peut porter à la recherche de
constitution solution inédite,souvent pas,ça peut être un facteur, mais pas la base de la
créativité. Si Deleuze parle de simulacre dans Différence et répétition il abandonnera
complètement cette notion plus tard, les liens entre Foucault, Deleuze, Sellars et autre
n’étaient pas le but de ce travail. Le but principal ici était de démontrer que Bergson ne
sombrait pas dans les problématiques indiquées dans le mythe du donné ou qu’il pouvait
répondre de manière pertinente au niveau épistémologique. L’aspect «politique» est une
ouverture vers d’autres problématiques même si des questions épistémologiques peuvent
devenir politiques parce que l’on parle de justification d’énoncé, donc d’autorité, de
priorité, de distribution des rôles…Si Sellars parle du concept de personne, il met les
pieds dans la politique au moins au niveau théorique.
survenir de ces zones d’indéterminations).La preuve que nous avons des états internes
n’est pas que l’on peut reproduire ou réécrire exactement ce que nous avons appris ou vu,
ce qui est impossible (ou possible simplement en parti)car en t’en qu’image nous
sommes toujours parmi des images dont notre corps et notre mémoire sélectionnent
certain aspect,mais qu’il nous est possible d’en faire quelque chose d’autre ou quelque
chose de différent,de s’approprier les règles,de pouvoir les reproduire de manières
appropriées selon la situation donnée ou même de ne pas réagir selon les règles que nous
avons apprises,ou comme prévu,pour modifier notre positionnement par rapport aux
images. L’intelligence qui est notre rapport à l’espace et reliée à notre perception nous
permet d’appliquer des règles pour nous adapter de manière appropriée parmi les images
selon des schémas déjà faits. L’intuition qui est notre rapport au temps et à l’intériorité
nous permet d’appréhender la situation dans son devenir et de déterminer des situations
appliquées ou inédites par rapport à chaque situation singulière... L’intuition consiste en
un effort intellectuel permettant au corps de produire des événements inédits dans
l’espace en reconstruisant la configuration de son positionnement dans l’espace ou alors
de modifier la perception des images par rapport à la mémoire en produisant des
«modèles», nouvelle méthode réflexive, production d’images (par l’écriture, la sculpture,
la musique…).
Une personne est définie comme étant une image indéterminée ayant une liberté relative.
Un acte complètement libre est un événement inédit dans la durée ou un corps-objet
infléchi la chaine de causalité stricte de l’univers d’une façon ce qui ne semblait pas
possible ou même pensable devient un élément de l’univers.86
Il n’y a que des actes
libres, qui sont des événements datés dans le temps, et non une liberté conçue comme
libres arbitres (c'est-à-dire une intériorité et une conscience morale innée formalisable, un
je pense qui accompagne toute nos expériences (bref, il y a des éléments inconscients
dans une «expérience»), car même si nous ne savons pas ce que peut un corps, l’humain
et le vivant en général n’est pas un empire dans un empire. La liberté est relative et non
un fondement. Et cette liberté relative est le fondement de notre humanité.
86
La terre tourne autour du soleil, Nous nous réunissons dans des oiseaux en métal pour
voler… La photographie BOUGE et elle émet des SONS… Vous allez voir des images
bouger dans la radio…
Bibliographie
Bergson,Henri,
-Essais sur les données immediates de la conscience,
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/essai_conscience_immediate/essai_co
nscience.pdf, consulté,9-1-13
-Matiere et Mémoire
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/evolution_creatrice/evolution_creatric
e.html
consulté,9-1-13
-Evolution creatrice
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/evolution_creatrice/evolution_creatric
e.pdf
consulté,9-1-13
-La Pensées et le Mouvant
http://classiques.uqac.ca/classiques/bergson_henri/pensee_mouvant/pensee_mouvant.htm
l , consulté,9-1-13
Worms,Frederic
-Introduction à Matiere et Mémoire,PUF,Paris,,336p., 1997
-Henri Bergson ou les Deux Sens de la vie, PUF, Paris,372p., 2013
Riquier, Camille, L’archéologie de Bergson, PUF,Paris,488p
Deleuze, Gilles
-L’image-temps, Les Éditions de Minuit,365p.Paris,1985
-Le Bergsonisme,PUF,119p.Paris,2004
-Différence et Répétition,PUF,416p,Paris,2005
-Mille-Plateaux(avec Felix Guattari) , Les Éditions de Minuit,465p.’Paris,1980
-Ques-ce que la philosophie(avec Felix Guattari) , Les Éditions de
Minuit,,219p,Paris,2005
-Deux regimes de fous, Les Éditions de Minuit ,384p,Paris,2003
Sellars,Wilfrid
-Science,Perception and reality, Ridgeview publishing Company,376p. California,1963
-Science and Metaphysics,Routledge,London,346p.1968 ,
-Fondations for a metaphysic of pure process,
http://www.ditext.com/sellars/carus.html
Johana Seibt, «Functions between Reasons and causes:On picturing» In
Empiricism,Perceptual knowledge, normativity and realism, Oxford university
press,Oxford,2009
Mcdowell,John, «avoiding the Myth of the given»
http://cas.uchicago.edu/workshops/germanphilosophy/files/2011/09/mcdowell-Avoiding-
the-Myth-of-the-Given1.pdf
Ryle,Gilbert,The concept of Mind,University of Chicago Press,334p.,Chicago,2002
Wittgenstein,Ludwig
-Tractatus-logico-philosophicus,, Gallimard,128p,Paris,2001
-Investigation philosophique,Gallimard,380p.,Paris,2005
Rorty,Richard,Philosophy and the mirror of nature,,Princeton University
Press,439p.,2009
Donald Davidson, «A coherence theory of truth and Knowledge»,consulté le 9-01-14
James, Williams,
-Essais d’empirismes radical,Flammarion,236p,Paris,2007,
-La volonté de croire,,Empecheurs de penser en rond, 219p,Paris,2005
Peirce,Charles Sanders, «Comment se fixe la croyance»
http://personnel.usainteanne.ca/jcrombie/pdf/logsci07.pdf consulté le 9-01-14
Heidegger,Martin, Être et Temps
http://www.oocities.org/nythamar/etretemps.pdf consulté le 9-01-14
Nietzsche, Friedrich
-«Généalogie de la morale»,in Œuvres, Flammarion, 1339p.2000
Spinoza,Baruch
-Traité politique, Flammarion,379p.Paris,1966
-Tractatus-teologico-politicus, Flammarion,380p.,Paris,1997
-L’éthique, Flammarion,378p.Paris,1993
Kant,Immanuel
-Critique de la raison pure, Flammarion,749p,Paris,2006
-Prolégomènes a toute métaphysique du future, 184p. Vrin, 2000
Hume, Davis, Essais Esthétique, Flammarion, 220p, Paris,2000
Bakounine,Michel, Dieu et l’état, Éditions Mille-et-une-nuit,119p. 2000
Nussbaum.Martha,Capabilités,Flammarion,300p,Paris,2012
Foucault, Michel, Histoire de la sexualité 1,La volonté de savoir, Gallimard,
248p.1994
MeillassouxQuentin, Soustraction et contraction,
https://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=389737487829790&eid=ASvS9pJ9z
t8djzeI1_JZNgpvcie_7_lC1M1JhpL84Rwn8I1Y3p6HWDyU6n18yxPiFSY&inline=1&e
xt=1389490513&hash=ASsq0lm9HS2E3kkD consulté,9-1-13
Document video a noter,
Brassier,Ray
-Lived expeirence and the myth of the given, disponible en plusieur partie sur Youtube
-Myth of the given, nominalism, realism, materialism
http://www.youtube.com/watch?v=dI5MZ2kBK9M
consulté,9-1-13
Williams,Michael, Inferentalism and ontology
http://www.canal-
u.tv/video/college_de_france/college_de_france_wilfrid_sellars_science_et_metaphysiqu
e_michael_williams.4910
Yvan Ayotte