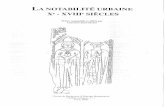L'image des juges chez les épistoliers byzantins du Xe-XIe siècles
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of L'image des juges chez les épistoliers byzantins du Xe-XIe siècles
ROMAIN GOUDJIL JUIN 2014
L’IMAGE DES JUGES CHEZ LES ÉPISTOLIERS BYZANTINS DU XE-XIE SIÈCLE SOUS LA DIRECTION DU PROFESSEUR JEAN-CLAUDE CHEYNET
MÉMOIRE DE RECHERCHE UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE
UFR D’HISTOIRE MASTER 2, MONDE MÉDITERRANÉEN MÉDIÉVAL : ISLAM, BYZANCE, OCCIDENT LATIN
2
Avant toute chose, il me faut remercier M. Jean Claude Cheynet pour m’avoir
guidé à travers les méandres du système judiciaire byzantin et ce malgré mon
expatriation volontaire à l’Institut de byzantinologie de Vienne.
Je remercie également Mme Béatrice Caseau pour l’attention qu’elle a portée à mon
travail.
Je souhaite également exprimer ma gratitude envers les professeurs Claudia Rapp,
Kerstin Susan Jobst et Ewald Kislinger ainsi qu’a toutes les personnes rencontrées à
Vienne qui m’ont ouvert de nouvelles perspectives tant sur le plan académique que
personnel.
Merci aussi à Isabelle Goudjil pour ses relectures, à mes camarades byzantinistes pour
leur soutien toujours plein d’humour, ainsi qu’à tout mon entourage.
Enfin ces remerciements ne seraient pas complets, si je ne mentionnais pas les Herrn
Ober du Braünerhof qui ont accompagné, toujours avec amabilité et élégance, mes
studieux dimanche après-midi viennois.
4
Abréviations BZ : Byzantinische Zeitschrift DARROUZÈS : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle, Paris 1960 DARROUZÈS – ALEXANDRE DE NICÉE : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle,
Paris 1960, p.67-98 DARROUZÈS – DIVERS : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle, Paris 1960,
p.343-381 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle,
Paris 1960, p. 217-248 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle,
Paris 1960, p.249-259 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle,
Paris 1960, p.99-163 DARROUZÈS - THEODORE DE NICÉE : DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle,
Paris 1960, p.261-316 DE VRIES – VAN DER VELDEN – GENDRE : DE VRIES – VAN DER VELDEN, E. « Psellos et son gendre », Byzantinische Forschungen, 23, 1999, p.109-149 DUYÉ : DUYÉ, N., « Un haut fonctionnaire byzantin du XIe siècle : Basile Malésès », REB 30, 1972, p.167-178 GAUTIER, LETTRES : GAUTIER, P., « Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées », REB 44, p. 111-197 JEAN MAUROPOUS : JEAN MAUROPOUS, KARPOZELOS, A. (éd.), The Letters of Ioannes
Mauropous, Metropolitan of Euchaita, Thessalonique, 1990 JÖB : Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik KURTZ-DREXL : MICHEL PSELLOS, KURTZ E., DREXL F. (eds.) Michaelis Pselli scripta
minora : magnam partem adhuc inedita. Volumen alterum, Epistulae, Milan, 1941 LÉON DE SYNADA : LÉON DE SYNADA, VINSON M.P. (éd.), The Correspondence of Leo,
Metroplitan of Synada and Syncellus, Washington, 1985 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT : LIMOUSIN, E., Etude du fonctionnement d’un
groupe aristocratique à Byzance au XIe siècle, Thèse de doctorat inédite, sous la direction de ARRIGNON J.-P., Poitiers, 1995
5
NICOLAS IER MYSTIKOS: NICOLAS I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE, JENKINS R.J.H.,
WESTERNINK, L.G. (éds.), Letters, Washington, 1973 PBW : JEFFREYS, M., Prosopography of the Byzantine World, Londres, 2011
Disponible à l’adresse : http://pbw.kcl.ac.uk PG : Patrologia Graeca PMBZ : LILE, R.J., LUDWIG, C., PRATSCH T., ROWHOW, I., WINKELMANNS F., et alii,
Prosopographie der mittlebyzantinischen Zeit, Berlin, 1998- […] PROFESSEUR ANONYME : ANONYMI PROFESSORIS, MARKOPOULOS A. (ed.), Anonymi
Professoris Epistulae, Berlin, 2000 REB : Revue des Etudes Byzantines SATHAS : MICHEL PSELLOS, SATHAS K. N. (éd.), Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, Μιχαήλ Ψελλού ιστορικοί λόγοι επιστολαί και άλλα ανέκδοτα,, Venise, 1876
THÉODORE DAPHNOPATÈS, : THÉODORE DAPHNOPATÈS, DARROUZÈS, J. et WESTERINK
L.G. (éds.), Correspondance, Paris, 1978 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE : WEISS, G. , Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos, Munich, 1973, p.59 ZACHARIÄ : ZACHARIÄ VON LINGENTHAL, D. K. E., Geschichte des griechisch-römischen Rechts , Berlin, 1892
8
Introduction générale
« Pour ses amis, M. de Villefort était un protecteur puissant ; pour ses
ennemis, c’était un adversaire sourd et acharné ; pour les indifférents, c’était la statue
de la loi faite homme […] . »1 Telle est l’image de la figure du procureur du roi,
Gérard de Villefort, à l’apogée de sa carrière construite sur la forfanterie et la trahison
des principes de la Justice dans le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas.
L’auteur construit ici le portrait d’un individu, d’un juge à la fois homme prêt à
défendre ses intérêts et ceux de sa clientèle à travers un cercle d’influence, un réseau
puissant, tout en restant aux yeux du monde l’incarnation même de la probité. Il est
évident que la comparaison entre un procureur du roi louis-philippard et un juge
byzantin ne peut réellement tenir de par la distance chronologique et la place des
magistrats en tant que telle dans la société byzantine. L’image que nous donne Dumas
n’est pour autant pas tout à fait étrangère à ce qui se vit et se fait dans l’administration
byzantine plus de huit siècles auparavant.
Si l’historiographie du champ juridique byzantin n’est pas en manque de publications,
ce n’est pas le cas pour ce qui concerne spécifiquement la fonction de juge à Byzance.
La littérature scientifique n’a que très peu abordé la question des juges. Un certain
nombre d’études envisagent des points très particuliers. K.E. Zachariä von Lingenthal
abordait déjà à la fin du XIXe siècle la question du système judiciaire mais
uniquement par le prisme de l’histoire du droit2. Le travail de A. Gkoutzioukostas
étudie, lui, la justice à Constantinople mais d’un point de vue administratif
uniquement3. Enfin, la thèse d’E. Limousin4 sur les lettrés byzantins au XIe siècle à
travers la documentation épistolaire aborde la question des juges mais uniquement
1 DUMAS, A., « Feuilleton du journal des Débats, Le Comte de Montecristo (1) - Troisième
partie », Journal des débats politiques et littéraires, 11 Juillet 1845, p.2 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k446981b/f2.image.langFR, [Consulté le 2 juin 2014] 2 ZACHARIÄ VON LINGENTHAL,D. K. E., Geschichte des griechisch-römischen Rechts,
Berlin, 1892 3 GKOUTZIOUKOSTAS A., Administration of justice in Byzantium (9th-12th centuries) :
judicial officers and secular tribunals of Constantinople, Thessalonique, 2004 – En grec. 4 LIMOUSIN, E., Etude du fonctionnement d’un groupe aristocratique à Byzance au XIe
siècle, Thèse de doctorat inédite, sous la direction de ARRIGNON J.-P., Poitiers, 1995
9
comme membre de ce groupe ne cherchant pas à étudier la fonction et les hommes qui
l’exercent en tant que tel.
Seul le travail de G. Weiss qui étudie les fonctionnaires entre autres par le biais des
écrits de Psellos effleure réellement le sujet qui nous intéresse5. Sur un plan général,
l’historiographie concernant le juge byzantin reste très fragmentée et n’aborde la
question plus par capillarité que par réel intérêt. Cette question d’importance semble
régulièrement être abordé quoique toujours mise sur un plan inférieur.
C’est sur ce quasi-no man’s land historiographique que je porte mon étude sur cette
catégorie de fonctionnaires byzantins. Cependant dans le but, je l’espère, d’obtenir
une meilleure efficience de ce travail, il m’est nécessaire de borner mon étude à la
fois chronologiquement et matériellement. Les Xe-XIe siècles sur lesquels se
concentre ce travail, forment une période d’apothéose pour la judicature byzantine.
Longtemps cantonnés à des rôles secondaires et subordonnés au pouvoir militaire des
stratèges, les juges profitent d’une période, plus stable, paisible et prospère, et d’une
politique impériale de démilitarisation des thèmes, pour installer leur autorité sur les
provinces. Ce renversement donne nécessairement à la fonction une bien meilleure
visibilité dans les sources, ce qui n’est pas pour rien dans le choix de cette période. De
même, l’étude de la figure du juge, au moment, où elle est la plus présente permet de
mieux en comprendre sa spécificité par rapport aux autres autorités composant
l’appareil d’Etat et la société byzantine. Dans le même temps, il est nécessaire
d’introduire une limitation dans le matériel utilisé. Je ne m’attacherai donc qu’a
l’étude de la correspondance épistolaire de cette période, les juges y tenant une place
relativement importante. Bien plus qu’une limitation sur le nombre de sources et de
documents à analyser, cette restriction matérielle induit un grand nombre de limites
dues à la spécificité du type de source.
Il n’est pas ici question de retracer l’histoire de l’épistolographie mais
quelques références sont indispensables pour mieux comprendre la spécificité du
matériel épistolaire6. La lettre byzantine fut souvent considérée comme un objet
5 WEISS, G. , Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos, Munich,
1973 6 Voir HUNGER, H., Die Hochsprachliche profane Litteratur der Byzantiner, Munich,
1978. ; HATLIE, P. , « Reddeming Byzantine Epistolograpy », Byzantine and Modern Greek Studies, 20, 1996, p. 213-248
10
littéraire obscure à l’utilité historique limitée7. J. Sykutris8 a bien montré que la
majorité des lettres, que nous connaissons, sont bien des œuvres littéraires plus que
des témoignages du quotidien. Pour autant, la lettre reste pour lui un témoignage
essentiel sur son milieu de production, sur la mentalité qui y domine et surtout sur les
personnalités en jeu, rédacteurs et destinataires. Pour J. Sykutris, l’obtention
d’informations historiques par les lettres passe nécessairement par une étude des
conventions spécifiques du genre afin de pouvoir séparer le formel du réel. C’est ce
qu’entreprend G. Karlsonn dans son étude sur le cérémonial dans l’épistolographie
byzantine9. Dans le prolongement de la réflexion de Sykutris, I. Sevčenko10 et
surtout A. R. Littlewood11 accentuent l’idée que les lettres que nous possédons, les
plus littéraires et les plus travaillées, sont à l’inverse de l’opinion classique sur
l’épistolographie, écrites dans le but de rendre compte le plus parfaitement de la
personnalité du rédacteur et de la nature du lien qui l’unit au destinataire. En cela, la
lettre est une source indispensable pour l’étude des hommes, de leur système de
pensée et de leurs réseaux.
Ce court panorama historiographique laisse transparaitre quelques limites notamment
le style et la rhétorique des auteurs dont il faut savoir délier le formel du juste. Il faut
ajouter les limites intrinsèques à toute collection de lettres, soit le caractère parcellaire
sinon allusif des évènements et des individus qui y sont abordés, accentuées par le fait
que nous n’avons qu’une moitié de cette correspondance, celle du rédacteur. E. De
Vries-Van der Velden propose, aux historiens travaillant sur ce type de source, mais
cela peut également concerner les autres, la pratique d’une constante humilité et
lucidité. « Que sait réellement l’historien ? Peut être devrait-il se satisfaire lorsqu’il
lui est permis d’écrire une bonne histoire. »12
7 MARKOPOULOS A., « Problème relatifs à l’épistolographie », L’épistolographie et la
poésie épigrammatique, Actes de la 16e table ronde du XXe Congrès International des Etudes byzantines, Paris, 2003, p.55-61 8 SYKUTRIS, J. « Probleme der byzantinischen Epistolographie », Actes du IIIe Congrès
international d’études byzantines, Athènes, 1932, p.295-310 9 KARLSONN G., Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine, Uppsala, 1962 10 SEVČENKO, I. « Levels of Style in Byzantine Prose », JÖB, 31/1, 1981, p.289-312 11 LITTLEWOOD, A. R., « An Ikon of the Soul : the Byzantine Letter », Visible Language,
10,1976, p.197-226 12 « So what does the historian really know ? Perhaps he may be content when he is able to
write a good story », DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « The Letters of Michael Psellos,
11
Notre corpus de 255 lettres n’échappe évidemment pas à ces limites bien qu’il
soit relativement fourni. Nous ne pouvons pas effectuer une étude biographique pour
l’ensemble de nos épistoliers. Nous pouvons cependant mettre en exergue ce qui unit
nos auteurs et fait d’eux un groupe relativement homogène. L’ensemble de nos
épistoliers peut se diviser en deux groupes, les auteurs issus de la hiérarchie
ecclésiastique et ceux issus de la hiérarchie administrative et civile.
Le premier groupe se compose principalement de métropolites. Alexandre de Nicée13
ne l’est plus vraiment lorsqu’il écrit ses lettres. Il fait face à une procédure de
destitution expéditive suite à une affaire judiciaire jugée sinon complètement montée
par des ennemis au sein du Synode au milieu du Xe siècle, signe de son appartenance
à l’élite de la hiérarchie ecclésiastique. Léon de Synada14, métropolite mais également
diplomate, était lui en activité à la fin du Xe siècle. Il est très proche du pouvoir
impérial, des hauts fonctionnaires et évidemment du patriarcat, ce qui le place
également en haut de la pyramide de la société byzantine et de l’Eglise. Théodore de
Nicée15 sur qui nous n’avons que peu d’informations tant chronologiques que
biographiques semble être issu du même milieu. À leurs cotés se tiennent deux
personnages plus connus. Jean Mauropous16, métropolite d’Euchaïte qui vécut tout au
long du XIe siècle. Professeur à Constantinople puis moine, il fut assez proche de
l’empereur Constantin IX pour espérer l’influencer. Sa disgrâce vers 1050 le conduit
dans sa métropole pour le reste de ses jours s’adonnant dans ses œuvres, plutôt
religieuses à l’exercice de la rhétorique et au déploiement de sa culture byzantine
ayant fait son succès durant sa carrière. Notre deuxième homme, Nicolas Ier
Mystikos17, patriarche de Constantinople vécut entre le IXe et le Xe siècle. Il est le
fruit des milieux politico-religieux et des conflits qui s’y sont tenus autour de
personnalités brillantes comme le patriarche Photios, dont il était proche. Ces deux
Historical Knowledge and the Writing History », L’épistolographie et la poèsie épigrammatique., Paris, 2003, p. 132 13 DARROUZÈS, J., Epistoliers byzantins du Xe siècle, Paris, 1960, p. 27-32 ; 67-98 14 LÉON DE SYNADA, VINSON M.P. (éd.), The Correspondence of Leo, Metroplitan of
Synada and Syncellus, Washington, 1985. Voir notamment l’introduction 15 DARROUZÈS, J., Epistoliers byzantins du Xe siècle, Paris, 1960, p. 49-57 ; 261-316 16 JEAN MAUROPOUS, KARPOZELOS, A. (éd.), The Letters of Ioannes Mauropous,
Metropolitan of Euchaita, Thessalonique, 1990, p. 9-27 17 NICOLAS I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE, JENKINS R.J.H., WESTERNINK, L.G. (éds.),
Letters, Washington, 1973, p. XV-XVII
12
hommes sont donc eux aussi une partie de l’élite politique, ecclésiastique et
intellectuelle byzantine, ils en sont même des exemples brillants.
Le deuxième groupe ne se distingue pas tant par le niveau social de ses membres mais
par les fonctions qu’ils exercent. Au bas de l’échelle se situe Philetos Synadenos18,
membre de l’élite constantinopolitaine, fonctionnaire, juge de Tarse à la fin du Xe et
au début du XIe siècle. Un de ses correspondants, Nicéphore Ouranos19 est, lui,
général, diplomate et gouverneur d’Antioche à la fin du Xe siècle. Il est à la fois un
brillant militaire, un très haut fonctionnaire et un proche de l’empereur qui lui confiât
la protection du monastère de Lavra à la mort du fondateur, Athanase l’Athonite.
Théodore Daphnopatès20 et Syméon Magistros21 sont eux des hauts fonctionnaires
constantinopolitains de la première moitié du Xe siècle. Ils jouent un rôle important
dans l’administration, le second étant logothète du drome quand le premier était
prôtoasékrètis et éparque. Proche du pouvoir impérial, ils démontrent leurs capacités
rhétoriques et intellectuelles dans leurs œuvres religieuses pour le premier et
historiques pour le second.
Enfin, il nous reste notre dernier auteur, le plus marquant et le plus important, Michel
Psellos22. Sa carrière s’étend tout au long du XIe siècle comme Jean Mauropous dont
il fut le disciple et l’ami. Il fit une brillante carrière civile, débutant comme juge de
18 DARROUZÈS, J., Epistoliers byzantins du Xe siècle, Paris, 1960, p. 48-49 ; 249-250 19 ibid., p., 44-48 ; 217-249 20 THÉODORE DAPHNOPATÈS, DARROUZÈS, J. et WESTERINK L.G. (éds.), Correspondance,
Paris, 1978, p. 1-11 21 DARROUZÈS, J., Epistoliers byzantins du Xe siècle, Paris, 1960, p.33-38 ; 99-163 22 Concernant l’auteur voir : LJUBARSKIJ, J., Michail Psell : Ličnost' i tvorčestvo. K istorii
vizantijskogo predgumanizma, Moscou, 1978 ; RIEDINGER, J.-C., « Quatre étapes de la vie de Michel Psellos », REB, 68, 2005, p.5-60 ; WEISS, G. , Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos, Munich, 1973
Concernant les lettres voir pour ce qui nous concerne : PAPAIOANOU, S., « Das Briefcorpus des Michael Psellos. Vorarbeiten zu einer kritischen
Neuedition. Mit einem Anhang : Edition eines unbekannten Briefes », JÖB, 48, 1998, p.67-117 ; GAUTIER, P., « Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées », REB, 44, 1986, p.111-197 ; MICHEL PSELLOS, KURTZ E., DREXL F. (eds.) Michaelis Pselli scripta minora : magnam partem adhuc inedita. Volumen alterum, Epistulae, Milan, 1941 ; MICHEL PSELLOS, SATHAS K. N. (éd.), Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, Μιχαήλ Ψελλού ιστορικοί λόγοι επιστολαί και άλλα ανέκδοτα,, Venise, 1876
13
thème puis obtenant une place au palais le menant peut être au poste de
prôtoasékrètis. Il exerça de hautes fonctions dans l’administration mais avait
également une autorité certaine dans le domaine intellectuel par le biais de son cercle
d’étude et de son titre de gloire, celui de consul des philosophes. Il aimait à se dire
proche du pouvoir impérial et conseiller de l’empereur, les chroniqueurs ne lui ayant
reconnu qu’un rôle mineur. Moine pour une courte durée, il n’abandonne jamais le
monde terrestre et semble dominer le paysage byzantin de ce XIe siècle.
Ce deuxième groupe tout autant que le premier, est composé à la fois de courtisans de
l’empereur, ses conseillers et ses bras armés au sein de l’administration byzantine.
Cultivés, éduqués, ils sont aussi le reflet du meilleur que peut donner la mentalité, la
culture, la civilisation byzantine de cette période.
Si l’on reprend alors les idées formulées par J. Sykutris et A.R. Littlewood sur
l’épistolographie, nous pouvons les appliquer à l’ensemble de nos auteurs, en tant que
groupe, cercle restreint d’une élite politique, religieuse et intellectuelle proche du
pouvoir impérial. Il est alors envisageable de penser que ces lettres sont le reflet de la
réflexion de chacun des membres de cette élite mais surtout le reflet d’une pensée de
groupe voire de classe sur les thèmes communs qu’elles abordent ainsi que sur le
rapport aux autres. À ce titre, il est clair que ce corpus donne une représentation du
juge issus de cette pensée de classe, de la pensée de l’élite byzantine fortement
constantinopolitaine, un regard plongeant sur les entrailles du système judiciaire
byzantin. Rendre compte de la place du juge et de sa représentation dans cette pensée
est bien le but, humble et lucide, de ce travail.
Ce portrait du juge byzantin au Xe-XIe siècle, nous le dessinerons par le biais de trois
axes principaux. Avec le premier, nous tracerons une première esquisse avec la
volonté de définir ce qui constitue la fonction de juge à Byzance, ce qu’est le juge
dans notre corpus, et ceux qui exerce la judicature. Le deuxième axe est formé de
l’étude des rapports entre les juges que nous avons définis et les épistoliers dans ce
qu’ils ont de plus prosaïques et matériels, les objectifs de cette relation, les moyens
mis en œuvre et leurs conséquences pour le juge. Enfin avec notre troisième axe, il
nous faut aborder ce qui transparait des volontés, des ambitions, des espérances de ces
fonctionnaires du système judiciaire byzantin ; ce qui émerge sur les hommes
derrières la fonction, le byzantin derrière le juge.
16
Première Partie : Le juge byzantin : quelques précisions sur la nature de la fonction et la place de ceux qui l’exercent.
Définir l’image des juges byzantins du Xe-XIe siècle doit nécessairement
passer par l’étape fondamentale de la définition de ce qu’est le juge byzantin sur cette
période. Cette volonté de préciser la nature de la judicature byzantine ne peut se
passer de l’établissement du contexte et de l’architecture théorique et institutionnelle
du système judiciaire byzantin. De cette architecture ressortent les figures multiples
pouvant incarner ce qu’est le juge. C’est de l’étude statistique de notre corpus
épistolaire que nous pourrons définir plus clairement les fonctions et surtout les
hommes dont nous aurons la possibilité réelle et concrète d’étudier l’image. Une fois
définit le contexte intellectuel, administratif et documentaire, il nous faut nous
intéresser de plus près aux hommes qui incarnent la fonction de juge afin de
déterminer leur place dans les interactions avec les composantes diverses de cette
société du Xe-XIe siècle et plus généralement leur position dans le monde byzantin.
17
Chapitre 1 - Le juge byzantin, définition et milieu d’évolution
La construction d’une définition de ce qu’est le juge byzantin doit
nécessairement passer par deux étapes importantes. En premier lieu, il faut essayer de
déterminer le contexte mental et les concepts sur lesquels se fonde la justice
byzantine. De ces concepts découlent la réalité des choses, c’est à dire à la fois les
textes juridiques mais surtout, pour ce qui nous concerne, une administration
judiciaire qu’il nous faut étudier.
Définir le juge
Afin d’étudier les juges et leur milieu de vie et de travail, il nous faut en
premier lieu regarder ce que signifie cette fonction dans les mots, dans le droit et dans
le contexte du système judiciaire byzantin.
L’étude du mot « juge » peut déjà nous apporter des indications sur l’idée de
laquelle découle la fonction. En ce qui concerne notre terme français « juge », il vient
du latin iudicem, accusatif du nom iudex. Le terme signifie littéralement « dire le
droit ». En ce sens, la fonction de juge est assez précise. Il s’agit d’une personne qui
prononce des décisions fondées sur le droit afin de régler les affaires qui s’offrent à
lui. C’est un sens assez strict et restrictif. On retrouve en grec le même terme précis,
celui qui administre la justice, ὁ δικαστής23. Cependant il existe aussi un autre terme,
utilisé de manière égale, celui de κριτής. Le mot vient du verbe grec κρινεῖν dont la
définition peut être beaucoup plus large et donne à la fois le sens de juge dans un
conflit mais aussi celui d’arbitre dans un concours et enfin tout simplement celui qui
choisi, qui prend une décision, qui tranche. Il est intéressant de noter, qu’il n’est fait
ici que peu référence au droit. Ce dernier mot, le plus utilisé dans l’administration,
donne une image d’une fonction de juge plus subjective dont le rôle serait plus de
régler les conflits plutôt que de trancher des affaires avec la loi pour fondement.
Loin de moi cependant l’idée que la justice byzantine ait fonctionné
uniquement sur des sensibilités et des personnalités. La justice de l’empire s’est
fondée évidemment sur tout un corpus de lois hérité de l’empire romain et remanié au
23 Donne notamment le terme ὁ δικαστηρίον, le tribunal.
18
fil des siècles, des empereurs et des changements sociétaux24. L’effort des empereurs
pour redynamiser, actualiser les lois et le système judiciaire particulièrement visible
sous Justinien puis chez les divers empereurs macédoniens, ne peut passer inaperçu.
Ce rôle impérial dans le domaine législatif et judiciaire est fondamental. La figure de
l’empereur est la source de la loi, les corpus de loi du Xe siècle, est d’ailleurs appelé
« les impériales », c’est-à-dire, les lois impériales, τὰ Βασιλικά. Il est ici au sens strict
celui qui dit la loi, le iudex, plus que cela, il la crée. Il est à ce titre à la fois législateur
et juge suprême de l’empire25. Ce statut le place évidemment au sommet du système
judiciaire mais aussi comme la plus haute autorité administrative. Ce n’est pas
seulement une place théorique. L’empereur tient une cour de justice qui est la cour
d’appel de l’empire. Évidement cette cour d’appel est théoriquement accessible à tous
mais il est vraisemblable que seuls ceux qui bénéficiaient alors de soutiens et
d’influence pouvaient y présenter des cas. Pour les autres, il existe différentes
possibilités tel que le dépôt de pétition auprès de l’ ἐπὶ τῶν δεήσεων. Celui-ci juge le
contenu et met en forme les pétitions pour les présenter à l’empereur26. Rappelons
cependant que si l’empereur juge, ses décisions ne sont pas pour autant
inattaquables27. Une décision de justice impériale a certes du poids mais n’est en rien
définitive aux yeux d’autres cours de justice. Le rôle de l’empereur ne se limite pas
seulement au règlement de quelques affaires mais il règle lui même le fonctionnement
de la justice constantinopolitaine. En effet, il organise lui même les jours d’ouverture
des cours de justice de la capitale28.
L’empereur tient donc une place prépondérante dans le système judicaire et
administratif byzantin et joue un rôle réel dans son fonctionnement ; il a tous les
attributs du juge.
24 Si le droit byzantin se fonde clairement sur le corpus juridique romain, il prend sa forme
propre sous Justinien avec son Corpus Iuris Civilis qui résume la jurisprudence romaine et conforte la christianisation des affaires civiles. Les différents corpus qui suivront seront tous fondés sur le droit justinien, si l’on excepte peut être l’Ecloga de Léon VI. Les Basiliques, sous les Macédoniens, et son introduction générale au droit qu’est l’Epanagoge, en sont un bon exemple. Chaque nouvelle tentative de synthétisation du droit apporte nécessairement son lot de suppression de règles à présent archaïques et l’ajout de nouveaux cas à envisager, sur le plan civil et pénal, dans une société en constante évolution. 25 ZACHARIÄ, p.355 26 ZACHARIÄ, p.356 27 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p.59 28 ZACHARIÄ, p.356
19
Un autre principe important est à noter pour bien comprendre le
fonctionnement de la justice à Byzance. Ce principe découle de la position même de
l’empereur dans le système, c’est à dire comme autorité administrative suprême.
L’administration étant gérée par de hauts fonctionnaires auxquels l’empereur délègue
une partie de son autorité et de son pouvoir, il est logique qu’ils aient également une
délégation du pouvoir judiciaire impérial. Ce pouvoir est cependant réduit aux
champs d’action de chaque fonctionnaire29. Autrement dit chaque haut fonctionnaire
est juge en son domaine. Cela n’a rien de particulièrement surprenant puisqu’au court
de notre période, l’accès au fonctionnariat a de plus en plus dépendu de l’éducation
des candidats notamment en rhétorique mais surtout en droit30. Il leur est donc tout à
fait possible de juger des affaires qui se présentent à eux dans le cadre de leurs
fonctions, d’autant plus qu’elle ne concerne que leur champ d’action spécialisé. On
peut notamment donner le cas très fréquent du Genikôn, bureau central des finances,
qui possède sa propre cour de justice afin de trancher les nombreux cas de litige,
qu’ils concernent des délimitations de terrains entre propriétaires ou des litiges
concernant l’évaluation des impôts à payer au fisc. Il n’est pas le seul dans ce cas, les
stratèges aussi en tant que chefs militaires ont le pouvoir de juger toute les affaires
pouvant apparaître au sein des troupes qu’ils commandent mais aussi à l’intérieur du
territoire dont il a la charge.
De ce point de vue, il serait alors logique de considérer tout haut fonctionnaire comme
un juge potentiel dans le cadre de ses prérogatives administratives ou géographiques
puisqu’ils sont parfaitement formés à cela et qu’ils en ont le pouvoir par délégation.
Cette conception est d’autant plus vraie qu’elle s’appuie sur les fondements même de
l’État byzantin que représentent ces fonctionnaires.
De fait, on ne pourrait arriver à une définition du juge sans prendre en compte
les bases sur lesquelles se fonde l’empire. En effet, l’Etat byzantin est soutenu, entre
29 Il s’agit d’une continuité de la conception romaine de la justice qui ne connaît pas
l’existence de juge professionnel mais celle de magistrat jugeant selon le champ de leurs compétences. Voir JONES, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602, A social economic and administrative survey, Oxford, 1964, n.97 et SARADI, H., « The byzantine Tribunals : Problem in the application of Justice State Policy », REB, 53, 1995, p.166-7 ; Cette conception est toujours valable pour notre période et SARADI, H., ibid., p.170 et n.17 et 18 30 WOLSKA-CONUS W., « Les écoles de Psellos et Xiphilin sous Constantin IX
Monomaque », Travaux et Mémoires., VI, Paris 1976, p.225-6
20
autres, par deux piliers principaux que sont la loi et la fiscalité31. L’existence même
de l’Etat dépend de ces réalisations palpables. La loi est rendue tangible par son
application dans les tribunaux. La fiscalité est quant à elle déjà très réelle pour le
byzantin moyen par le biais de l’imposition. Les deux aspects ainsi concrétisés
ancrent l’Etat byzantin dans la réalité. Cette fiscalité est d’ailleurs le fondement du
contrôle du territoire et des populations. Le cadastrage des terrains ainsi que le listage
des feux et des foyers sont les signes visibles du contrôle de l’État sur une région
donnée, à l’inverse le listage des contribuables crée un lien d’appartenance et
d’interdépendance entre les populations et l’État. Ce lien sujet-Etat ne peut pas exister
sans la justice, à la fois dans le sens d’une fiscalité juste, donc pas trop opprimante et
autoritaire pour le contribuable mais aussi une fiscalité qui laisse des possibilités de
recours en justice pour limiter ses propres abus. Michel Psellos met d’ailleurs en
avant ces mêmes principes pour une bonne direction de l’Etat, à savoir un
gouvernement des affaires et un soin dans une bonne redistribution32. En cela, la
fiscalité est partiellement sinon totalement liée à la justice. Il existe de surcroit
d’autres raisons plus juridiques à ce lien. Le fisc est régulièrement le bénéficiaire de
décisions de justice, qu’il s’agisse de la confiscation de bien d’un criminel ou plus
simplement par l’établissement d’acte notarié. Il est acteur de la société byzantine et
pas seulement celui qui prélève l’impôt. A ce titre, le fisc comme propriétaire d’Etat
peut être lui même appelé à participer à une affaire judiciaire comme accusé ou
plaignant. Enfin de par sa méthode de travail, l’administration fiscale est aussi le
service le plus documenté sur les contribuables et les terres de l’Empire, donc une
aide précieuse pour l’établissement de fait dans le cadre d’une investigation judiciaire
effectuée par les hauts fonctionnaires33. La fiscalité possède une grande place dans le
champ judiciaire et en cela joue un rôle important dans le métier de juge.
Récapitulons ce qui semble être le fondement de la définition du juge à
Byzance. Son pouvoir est fondé sur des corpus de lois fixés par les empereurs qui en
sont à la fois l’incarnation et les premiers exécutants en tant que juge suprême de
31 « The abstract concept of politeia or res publica , implied the existence of public law and
public taxation », JACOBY, D., dans ANGOLD, M., « The Byzantine State on the Eve of the Battle of Mantzikert », Byzantinische Forschungen, 16, 1991, p.9 32 ANGOLD, M., ibid, p.11 33 MAGDALINO, P., « Justice and Finance in the Byzantine State, ninth to twelfth centuries »,
LAIOU, A. AND SIMON, D. (eds.), Law and Society in Byzantium, Washington, 1994, p. 96
21
l’Empire. Il est donc le premier magistrat et administrateur byzantin. Du pouvoir
impérial procèdent toutes les prérogatives des différentes administrations et de même
il en résulte que les hauts fonctionnaires de chaque administration sont des magistrats
ayant la possibilité et le devoir de rendre la justice dans leur domaine. La fiscalité
quant à elle est toujours présente que cela soit de fait ou en filigrane dans ce qui est le
métier et la carrière de juge.
Il nous est donc particulièrement difficile d’obtenir une définition plus précise
de ce qu’est un juge à Byzance en étudiant seulement les principes qui fondent le
pouvoir judiciaire. Le juge semble être un haut fonctionnaire, tenant son pouvoir par
délégation impériale, capable d’arbitrer des conflits dans son domaine. C’est une
définition déjà plus réduite que le sens étymologique du mot juge que cela soit en
latin ou en grec puisque cela limite la fonction à des hommes pétris de droit et
connaissances fiscales. Il n’existait alors pas de métier juridique à part entière si l’on
exclut les juristes qui ne sont que des assistants pour les magistrats. Il existait
cependant tout un système de hauts magistrats qui avaient pour prérogative
particulière l’administration du système judiciaire. C’est sur cette partie de
l’administration byzantine qu’il nous faut nous concentrer afin de mieux cerner ce
qu’est le juge.
Le système judiciaire à Constantinople.
Si l’empereur est bien le juge suprême et plus haut magistrat, il existe sous son
autorité de nombreux échelons qui composent le système judiciaire byzantin. Il nous
faut tout d’abord distinguer le système en vigueur à Constantinople et celui des
provinces qui sont relativement distinct.
La capitale, centre de l’empire et cœur de l’administration étatique possède une
accumulation de fonctions judiciaires importantes.
Au début de notre période, la justice constantinopolitaine est régie par un haut
fonctionnaire, l’éparque de la ville, héritier de la fonction de préfet de la ville de
Rome. Il est ce type de fonctionnaire, que nous avons décrit auparavant, cumulant
fonctions pratiques et la fonction judiciaire. En ce qui concerne la ville, il est comme
en témoigne le livre de l’éparque, chargé du contrôle des guildes et des marchands, de
surveiller le bon déroulement des transactions sur les marchés ou lors des changes de
22
monnaies34. Le maintien de l’ordre fait aussi partie de ses prérogatives ce qui le
conduit à diriger une force de police et à régler des affaires judiciaires. Il semble
d’ailleurs que l’éparque ne prenait pas en charge toutes ces missions et qu’il déléguait
une partie de son autorité. Ainsi tout ce qui concernait les affaires judiciaires de
Constantinople était vraisemblablement régi par le logothète du prétoire, chef de la
justice de la capitale et de la prison de la ville35 . À ses côtés, le préteur de
Constantinople institué par Nicéphore II Phocas avait lui aussi des prérogatives
judiciaires et devait présider une cour de justice dépendant de celle de l’éparque
probablement liée aux affaires provinciales36. Si l’éparque délègue une partie de ses
prérogatives judiciaires, il reste le plus haut juge de la capitale après l’empereur et
préside une cour d’appel37. Il nous est difficile de déterminer s’il jugeait seulement
des affaires non résolues constantinopolitaine ou alors celle de tout l’empire38. Étant
juge et président de la cour de justice impériale, il serait cependant tout à fait logique
qu’il se saisisse d’affaires provinciales qui lui serait présentées soit par qui en aurait
les moyens, l’influence et le réseau soit par le préteur.
Au coté de l’éparque siège également le questeur. Il a pour mission principale la
surveillance et le contrôle des étrangers et des provinciaux voyageant à
Constantinople et la gestion des mendiants. Pour ce qui concerne directement le
domaine judiciaire, il est le juge responsable du traitement des affaires de falsification
et prend aussi en charge les conflits opposant provinciaux et grands propriétaires
terriens résidants à Constantinople. Il est aussi intéressant de noter que ce magistrat
est habilité à punir les officiers de justice s’étant comportés de manières injustes ou
inappropriées dans le cadre de leurs fonctions39.
L’influence, le pouvoir de l’éparque et d’une partie de son administration
tendent cependant à diminuer à la fin du Xe siècle et au cours du XIe siècle. En effet,
dans la première moitié de ce XIe siècle, les attributions de l’éparque sont de plus en
plus réduite, se cantonnant à des fonctions purement municipales et économiques40.
34 ZACHARIÄ, p.365 35 BURY, J.B., The Imperial Administrative System in the Ninth Century, Londres, 1911,
p.70 36 AHRWEILER, H., « Recherche sur l’administration de l’empire Byzantin aux IXe-XIe
siècles. », Bulletin de correspondance hellénique, 84, 1960, p.44 37 ZACHARIÄ, p.365 38 BURY, J.B., op.cit., p.69 39 ZACHARIÄ, p.365 40 ZACHARIÄ, p.369
23
Le questeur quant à lui ne réapparait plus après la seconde moitié du XIe siècle41.
L’éparque comme juge le plus important de Constantinople est remplacé par le
Drongaire de la Veille, ὁ δρουγγάριος τῆς βίγλας, qui apparaît vers 103042. Il est
renommé dans les sources à partir du règne de Michel Doukas sous le vocable de
Grand Drongaire. Il reprend alors toutes les prérogatives judiciaires de l’éparque. Et
devient donc juge et président de la cour de justice impériale et juge d’appel. N.
Oikonomidès le décrit même comme une sorte de ministre de la justice institué par
Constantin IX Monomaque43. Avec le drongaire de la veille émergent de nouveaux
tribunaux et de nouveaux juges sans qu’il soit possible de déterminer qu’elles étaient
les attributions précises. Dès la fin du Xe siècle apparaissent de nouveaux collèges de
juges, celui du vélum et celui de l’hippodrome, nommés à partir du lieu où ils se
réunissaient. Ce sont des juges institués par l’empereur et formant la plus haute cour
de justice de l’Empire. À leur côté, d’autres juges plus spécialisés font leur
apparition. On peut par exemple citer le protospathaire du Phiale qui s’occupe des
affaires concernant la marine byzantine44 . On note aussi l’apparition de juges
subalternes, les dikaiophylakai, ainsi que d’autres juges situés entre ces derniers et les
grands juges du vélum et de l’hippodrome créant ainsi toute une hiérarchie dans la
juridiction de Constantinople placée sous le contrôle du grand drongaire45. Cela
indique une réelle volonté impériale de centralisation de la justice à Constantinople,
de contrôle et de supervision, peut être même d’unification et d’harmonisation du
rendu de la justice dans la capitale.
Une autre fonction concrétise cet effort de centralisation de la justice. Il s’agit
de la fonction d’épi tôn kriséôn. Créé sous Constantin IX Monomaque, elle avait pour
but de contrôler la justice thématique notamment par une vérification des décisions
41 BURY, J.B., op.cit., p.73 ; ZACHARIÄ, p.366-70 42 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantine
au XIe siècle », Travaux et Mémoires, VI, 1976, p.134. Il s’agit d’une évolution civile d’une fonction militaire préexistante. OIKONOMIDÈS, N., Les listes de préséance byzantines du IXe et Xe siècle, Paris, 1972, p.268-9, l.29 43 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantine
au XIe siècle », op.cit. 44 CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE, De Administrando Imperio, MORAVCSIK G.,
JENKINS, R.J.H., (eds.) Washington, 1967, §51, p.246, l.3 entres autres ; VOGT., A., « Le protospathaire du Phiale et la marine byzantine », Échos d’Orient, 39, 1903, p.328-32 45 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantine
au XIe siècle », op.cit., p. 134
24
prises.46 . En plus de cette mission de contrôle, ce fonctionnaire avait aussi la
possibilité de juger des cas litigieux que les juges de provinces ne pouvaient
trancher47. Il assume peut être les missions que prenaient en charge auparavant le
préteur qui était lié à la justice provinciale. Quoiqu’il en soit, l’épi tôn kriséôn, qui
n’est pas un juge d’appel, était bien le chef d’un organe de centralisation de la justice
provinciale à Constantinople.
Dans la même perspective de créer un lien réel entre les provinces et la capitale, entre
la population et l’administration, l’épi tôn déèséôn est responsable des pétitions
envoyées à l’empereur. Il doit les sélectionner selon leur intérêt et les mettre en
forme. Il n’est pas vraiment un juge mais décide des pétitions qui seront présentées à
l’empereur. Il est cependant le déclencheur d’un processus administratif voire
judiciaire concernant les affaires traitées dans la pétition. Il est un intermédiaire
important entre la population et l’administration et la justice.
Cette description du paysage judiciaire de Constantinople n’est évidemment
que tout à fait partielle. Seul les grandes structures ont été décrites ici et il est certain
qu’il existait beaucoup de juges spécialisés dont nous n’avons qu’une connaissance
parcellaire. De plus, placée sous l’autorité des différents grands juges ou collèges, se
développe toute une hiérarchie de juges subalternes et d’administratifs comprenant les
juristes, les greffiers et agents détachés du fisc. Quoiqu’il en soit, ce tableau assez
foisonnant de la justice byzantine dans la capitale contraste avec celui de la justice
provinciale.
Le juge dans les provinces.
La justice byzantine dans les provinces de l’empire paraît beaucoup moins
dense et multiple que celle de la capitale. La concentration des sources et des
informations autour du cas de Constantinople y est évidemment pour beaucoup.
Cependant, il semble que le pouvoir de juger ait été depuis la période romaine dans
les mains d’un seul homme. Ce n’est absolument pas surprenant puisque le système
proto-byzantin est une continuation du système d’administration romain. Les
46 AHRWEILER, H., « Recherche sur l’administration de l’empire Byzantin aux IXe-XIe
siècles. », Bulletin de correspondance hellénique, 84, 1960, p.70-1 47 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantine
au XIe siècle », Travaux et Mémoires VI, 1976, p. 134
25
gouverneurs, qu’ils soient légat ou chevalier, concentraient en leurs mains les
pouvoirs militaire, politique et judiciaire48. Le système se perpétue dans la réforme
dioclétienne, à ceci près que Dioclétien limite l’usage de l’appel à l’empereur avec la
création du système tétrarchie et contraint chaque gouverneur à prendre ses
responsabilités judiciaires. Ce pouvoir judiciaire reste dans les mains des préfets et
des éparques ayant pour rôle d’administrer les territoires impériaux qu’étaient les
préfectures et leurs subdivisions, les éparchies. Entre le IVe et le VIe siècle, les
gouverneurs de provinces perdirent peu à peu leurs prérogatives militaires, leur
fonction devenant purement civile et se concentrant sur la fiscalité et la justice49.
À partir du VIe siècle, la réforme de l’administration par Justinien et la mise
en place du système des thèmes change pour un temps la place de la justice dans
l’administration provinciale. Le thème en tant que circonscription militaire était en
effet sous l’autorité d’un militaire. Le stratège est responsable de l’administration
mais était avant tout le chef de l’armée thématique. La gouvernance de chaque thème
était orientée dans le but de fournir les effectifs et les vivres suffisants à cette armée
de défense. Il était donc assez logique que le stratège cumulât aussi des fonctions
civiles notamment en matière de fiscalité mais aussi dans le domaine judiciaire. Ces
prérogatives civiles n’étaient cependant pas mise en œuvre par le stratège lui même
mais par des fonctionnaires civils issus des sekreta de Constantinople50. Ainsi la
justice thématique était exercée par un praitor, qui peut être aussi nommé kritès. Cet
officier de justice semble dépendre de deux autorités à la fois. Il est placé sous
l’autorité du stratège à qui il doit obéissance51. Le stratège pouvait intervenir dans les
dossiers du praitor et prendre des décisions lui même dans des affaires judiciaires52.
Le praitor n’était que l’officier de justice du thème auquel le stratège délègue son 48 JONES, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602, A social economic and
administrative survey, Oxford, 1964, p. 479 Comme le dit Jones, cette concentration ne donnait pour autant pas une vraie responsabilité judiciaire aux gouverneurs, ces derniers ayant tendance à toujours en appeler à une justice plus haute, celle de l’empereur. 49 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p.15 50 AHRWEILER, H., « Recherche sur l’administration de l’empire Byzantin aux IXe-XIe
siècles. », Bulletin de correspondance hellénique, 84, 1960, p.43 ; 67-78 51 AHRWEILER, H., ibid, p.68 52 Un acte athonite montre les stratèges dans de telles situations sans que cela soit
nécessairement des exceptions. LEFORT J., OIKONOMIDÈS N., PAPACHRYSSANTHOU D., KRAVARI V., METREVELI H., Actes d'Iviron T.1. Paris, 1985, n°4, p.126, l.30 « ἐπί τε τῶν ἐπιτοπίον δικαστῶν καὶ στρατηγῶν καὶ θεοφυλάκτου πόλεως δικαστῶν. » Il s’agit d’une énumération des autorités vers lesquelles se tournent moines et autochtones pour régler leurs différends judiciaires. Le stratège y figure en bonne place au milieu des juges « locaux » et des juges de la capitale.
26
pouvoir. Le praitor-kritès dépendait aussi des services judiciaires de la capitale. Il
devait dépendre de l’éparque de Constantinople ou du préteur de Constantinople53.
Le praitor-kritès n’était pourtant pas un simple fonctionnaire subalterne sans
indépendance vis à vis de sa hiérarchie.
Le Taktikon Uspenkij révèle que le praitor de thème n’était pas le dernier des
officiers civils54. Ils sont placés, il est vrai, après les stratèges de thèmes mais se
tiennent à une place plus élevée que le protoasekrètis, chef de la chancellerie et des
sekreta, ainsi que devant tous les autres officiers civils des thèmes y compris les
tourmarques et les agents du fisc. Cela indique que le praitor-kritès était déjà au
milieu du IXe siècle le deuxième personnage du thème et avait probablement sous son
contrôle toute l’administration civile thématique. Les taktika du Xe siècle ne donnent
pourtant pas d’indication ni sur les préteurs ni sur les kritai des thèmes. Cela est assez
étrange étant donnée l’augmentation de l’étendue des pouvoirs du juge que l’on
connaît. Le développement des pouvoirs de ces juges de thème se perçoit dans le
traité militaire de Nicéphore Phocas, le De Velitatione. Il y critique notamment
l’ascendant toujours plus grand des juges sur les militaires, prouvant ainsi le recul du
pouvoir du stratège55. V. Vlyssidou met en avant que le juge avant d’être subordonné
au stratège était d’abord un officier de liaison entre les provinces et l’empereur, un
informateur. Léon VI dans ses taktika, insiste sur cette mission d’information56. Il
s’agit d’une manœuvre politique visant à la surveillance des militaires et des puissants
des provinces. Les lois de Romain Ier Lécapène sur la grande propriété et la
protection des faibles ont aussi donné au juge, responsable de l’application des lois,
un plus grand pouvoir et un plus grand contrôle sur le terrain, du moins de manière
théorique. Le juge est alors l’égal du stratège, son pendant civil. De nombreux actes
53 AHRWEILER, H., op.cit., p.43-4 54 OIKONOMIDÈS, N., Les listes de préséance byzantines du IXe et Xe siècles, Paris, 1972, p.
52-3, l.3 55 VLYSSIDOU, V. N., « Quelques remarques sur l’apparition des juges (Première moitié du
Xe s.). », Byzantine Asia Minor (6th-12th cent.), Athènes, 1998 p. 59 et Traité sur la Guérilla, DAGRON, G., MIHĂESCU H. (eds.), Paris, 1986, p. 111, c. XIX, §7 sur les juges de thème se permettant de fouetter et de mettre en prison les braves soldats byzantins. 56 VLYSSIDOU, V. N, ibid, p.60 ; LÉON VI, Tactica, PG 107, IV, 33, « Ces fonctionnaires,
même s’ils doivent être soumis à certains égards à l’autorité du stratège, nous estimons plus sûr qu’ils rendent compte de leur gestion en s’adressant à notre royauté, de sorte que nous soyons instruits par eux de la situation et de l’administration des affaires civiles et militaires. » Traduction issue du Traité sur la Guérilla, DAGRON, G., MIHĂESCU H. (eds.), Paris, 1986, p. 270
27
athonites montrent d’ailleurs que les affaires judiciaires étaient soumises à la fois au
stratège et au juge sans qu’il y ait une distinction hiérarchique entre eux57.
La fin du système des armées thématiques, remplacées par une armée
professionnelle d’intervention, les tagmata, porte le coup de grâce au stratège de plus
en plus relégué à des missions purement militaires. Le juge reprend la place du
stratège. Il est le nouveau gouverneur du thème et l’étendu de ses fonctions ne se
cantonne plus à la justice. Il remplace également le stratège dans la hiérarchie des
fonctions. Les juges de thème sont alors parmi les fonctionnaires les plus importants
car ils sont à la tête des administrations thématiques et dirigent de nombreux autres
fonctionnaires notamment des agents fiscaux détachés par les services centraux dans
les thèmes ou envoyés pour des affaires précises. L’administration thématique devait
aussi comprendre un service judiciaire spécifique. Sous le commandement du juge
était aussi placée une force de police car il était garant de l’ordre dans sa
circonscription. Il avait aussi à sa charge tout ce qui concerne les infrastructures du
thème notamment les routes ou les ponts. Il est bien plus qu’un simple juge comme
pourrait le laisser penser son nom, c’est un véritable gouverneur, maillon
indispensable du contrôle administratif réel du territoire byzantin. Nous revenons ici à
une situation semblable à celle du IVe-VIe siècle. Il semble cependant que le juge
continuait de présider le tribunal de son thème et de prendre des décisions voire même
d’enquêter sur le terrain, sans aucune délégation de son pouvoir judiciaire à des
officiers civils subalterne58. Le juge de thème reste donc un juge à part entière.
La situation se fige tout le long du XIe siècle, jusqu'à ce qu’un rival du juge, le
duc apparaisse et prenne sa place comme le juge avait, en son temps, évincé le
stratège. On note effectivement que ces ducs commencent par avaliser des décisions
de justice rendues par le juge de thème59. Puis ils prirent la place des juges en rendant
eux même des décisions de justice signant ainsi l’acte de disparition du juge de thème
qu’ils remplacent en tant que gouverneur. Cette disparition relativement rapide
57 Voir n.33 mais aussi LEFORT J., OIKONOMIDÈS N., PAPACHRYSSANTHOU D., KRAVARI
V., METREVELI H., Actes d'Iviron T.1. Paris, 1985, n°9, p.161, l.25 par exemple. 58 ibid., n°9, l.28 Le juge de Thessalonique Nicolas enquête directement sur le terrain pour
délimiter une propriété. ; n°27, Le juge de Thessalonique Jean se déplace à Hièrissos et y reste pendant plus de cinq jours pour trancher une affaire entre le monastère de Lavra et d’Iviron 59 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p.17 ; AHRWEILER, H., op.cit., p.61 ; Actes d'Iviron
T.1., op.cit., n°8 Il s’agit du cas du Duc Jean Chaldos prenant une décision relevant des prérogatives d’un juge.
28
s’explique par le moment de crise que traverse l’empire au cours de ce XIe siècle. Les
régions frontalières en danger doivent être reprises en main par l’armée afin d’en
assurer la défense le mieux possible. On observe donc une nouvelle concentration des
pouvoirs civils et militaires dans les mains d’un seul homme, le duc, comme au temps
des stratèges. Seule l’Hellade conserve son juge de thème qui doit composer avec une
autorité militaire60. La région n’étant pas un endroit militairement sensible, il est
probable que le besoin d’unification des pouvoirs civil et militaire ne se soit pas fait
sentir. Quoiqu’il en soit, la disparition du juge de thème ne conduit pourtant pas à la
disparition du gouverneur-juge puisque le duc prend la direction du tribunal
thématique. Cela a pour conséquence de placer des hommes n’ayant pas
nécessairement de formation juridique à la tête de tribunaux. Les ducs qui possédaient
une formation militaire, n’avaient pas nécessairement cette connaissance des lois et
du droit byzantin, même si l’origine sociale et familiale de ces hauts fonctionnaires
laisse penser qu’ils avaient tout de même une excellente formation. H. Saradi montre
bien que les magistrats nommés dans les tribunaux n’était effectivement pas tous des
spécialistes. Ils devaiennt alors se faire assister par des juges de Constantinople61.
Le système judiciaire byzantin des provinces garde donc l’héritage romain du
gouverneur-juge. Les praitor-kritai, sont les fonctionnaires provinciaux les plus
importants du dispositif judiciaire. Ils deviennent à partir du Xe siècle, les juges de
thème qui sont à la fois des juristes et des chefs d’administrations civiles d’abord sous
la direction du stratège puis de manière tout à fait indépendante. Si les stratèges et les
ducs avaient des prérogatives judiciaires, ils n’étaient pas nécessairement des
spécialistes du droit. Ils n’étaient donc pas des juges à part entière mais des militaires
byzantins ayant la possibilité de juger des affaires dans le cadre de leurs prérogatives,
ici un espace géographique, le thème.
60 AHRWEILER, H., op.cit., p.77 61 SARADI H. « The Byzantine Tribunals : Problems in the application of Justice and State
Policy (9th-12th c.) », op.cit, p. 171 et 185. Elle cite notamment Théodore Balsamôn qui établit une hiérarchie entre les juges. Il vécut au XIIe siècle mais la situation du système judiciaire n’a pas alors radicalement changé de celle du XIe siècle. Il y a les kritai qui prononcent les jugements, les archontes qui composent la cour de justice mais n’ont pas nécessairement de compétences judiciaires et les synedroi qui sont eux des juristes. Voir RHALLES, G., POTLES M., Συνταγµα τῶν θείον καὶ ἱερῶν κανόνων, 3, Athènes, 1853, p.339.
La situation n’est d’ailleurs pas très étonnante. C’est la simple continuité du bas-empire romain. Voir JONES, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602, A social economic and administrative survey, Oxford, 1964, p. 500-1
29
Conclusion
Le juge byzantin, au delà de la capacité de juger et de trancher des conflits est
celui qui possède un pouvoir judiciaire, délégué par l’empereur au travers son
administration. Ce qui différencie n’importe quel fonctionnaire byzantin du juge, c’est
évidemment la formation mais également la place du rendu de la justice dans ses
prérogatives. Tous les fonctionnaires étant à la tête de services judiciaires, à
proprement parler, donc de cour de justice ou d’appel sont donc des juges qu’ils
soient à Constantinople ou en province. Les autres fonctionnaires qui exercent
d’autres fonctions mais possédant une délégation du pouvoir judiciaire pour leur
domaine de spécialité ne sont en ce sens pas considérés comme des juges.
30
Chapitre 2 - Etudes statistiques
Après avoir étudié, à la fois les concepts et les différentes fonctions qui
régissent le droit et le rendu de la justice à Byzance, il est nécessaire de définir plus
précisément ceux que nous pouvons étudier à travers notre corpus épistolaire.
L’utilisation des statistiques est de ce point de vue assez utile pour déterminer les
proportions de différents types de fonctionnaires, leur lieu d’exercice et leur rapport
avec les différents épistoliers au cours du Xe-XIe siècle.
Les officiers de justices dans les lettres : statistiques
L’étude de l’image des juges dans les relations épistolaires byzantines ne peut
s’envisager sans que soit déterminé le type de juges et de fonctionnaires judiciaires
qui y apparaissent. Afin de répondre à cette question, est entrepris ici une courte étude
statistique des fonctions et dignités présentes dans les lettres selon les périodes et les
épistoliers62.
Commençons en premier lieu par lister les fonctions qui apparaissent.
Sur un total de 255 lettres du corpus, dans lesquelles il est possible de déterminer avec
plus ou moins de précision des fonctions judiciaires, une fonction prédomine. Il s’agit
de la fonction de juge de thème, mentionnée sous la forme « Τῷ κριτῇ τῶν/τοῦ [Nom
du thème]», et apparaissant dans 93 lettres soit neuf fonctions sur dix citées dans ces
lettres. La grande majorité de ces juges sont désignés directement dans l’intitulé de la
lettre donné dans les manuscrits des différentes collections. Certains autres sont
déduits du contenu de la lettre elle même63. Sur les lettres restantes, 13 évoquent des
fonctions judiciaires clairement constantinopolitaines. Dans les dernières lettres, seule
62 Se reporter aux statistiques générales en annexe 63 Par exemple SATHAS, 18, p.17, qui peut être attribuée au juge de l’Opsikion par la
référence à l’évêque de Noumerika ; Le cas de lettre SATHAS, 180, p.459-61 est exemplaire. Attribuée à un juge de Philadelphie par C. Sathas, elle fait toujours débat. Les uns comme J.-Cl. Riedinger y voit la référence à un village de Lydie donc attribue la lettre à un juge des Bucellaires quand d’autres voient en Philadelphie la capitale du thème des Thracésiens et attribue la lettre en conséquence. L’hypothèse de J.-Cl. Riedinger me semble, au demeurant plus vraisemblable puisqu’il est effectivement fait mention d’un village reculée et non d’une ville. Voir RIEDINGER, J.-C., « Quatre étapes de la vie de Michel Psellos », REB 68, 2005, p.25.
31
la fonction de juge, apparaissant sous la forme « Κριτῇ τινι », est mentionnée. Cela ne
permet pas de déterminer plus précisément son lieu d’affectation ou le type de
prérogatives qui lui incombent.
Pour ce qui est des fonctions de l’administration judiciaire de Constantinople,
sont présents neuf éparques et huit drongaires de la veille. Il faut cependant se méfier
de cette dernière fonction puisqu’elle apparaît à la fois dans des lettres de Michel
Psellos au XIe siècle et dans celle du Patriarche Nicolas Ier Mystikos au début du Xe
siècle. Il est donc bien important de distinguer le drongaire de la veille chez Mystikos
qui n’est en aucun cas un juge mais bien le commandant du tagma de la veille, chargé
de la protection de l’empereur au Palais et en campagne64, et celui se trouvant chez
Psellos qui est le drongaire, juge et « ministre de la justice ».
En plus de l’Éparque et du Drongaire de la veille, sont mentionnés à quatre reprises
l’épi tôn kriséôn et à deux reprises l’épi tôn déèséôn. Enfin, il existe une unique
mention du logothète du prétoire ainsi que de deux juges non provinciaux,
probablement des juges de la capitale65.
A propos des dignités des différents officiers de justice que l’on peut rencontrer, leur
nombre est assez réduit et trop peu significatif pour en tirer des conclusions générales.
En effet, sur 104 officiers de justice dont nous connaissons avec précisions les
fonctions, seuls seize sont assortis de leur dignité ce qui ne fait qu’un peu plus d’un
dixième d’entre eux. Il est possible cependant de percevoir deux éléments qui
confirment l’évolution administrative ayant été tracée à grand trait auparavant.
En ce qui concerne le lien entre les dignités et la fonction de juge de thème, il est
intéressant de noter qu’au début du Xe siècle, le Patriarche Nicolas Ier Mystikos, nous
renseigne sur un juge de thème de Paphlagonie possédant la dignité de
protospathaire66. Le thème de Paphlagonie n’est pas classé parmi les dix premiers par
le taktikon Beneševič67. Si les fonctionnaires y officiant sont d’un bon niveau tant du
point de vue de leur capacité que de celui de leur dignité, ils ne sont pas
nécessairement les plus brillants. La dignité de protospathaire est une dignité
64 NICOLAS IER MYSTIKOS, 170, p.496, l.5 ; GUILLAND, R., « Contribution à l’histoire
administrative de l’Empire byzantin. Le drongaire et le grand drongaire de la Veille », BZ, 43, 1950, p.340-65 65 DARROUZÈS – ALEXANDRE DE NICÉE, 10, p.85 « Πέτρος ὁ Ἀνδροσυλίτης » en intitulé et
14, p.91, l.26 66 NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p.422-23 67 OIKONOMIDÈS, N., Les listes de préséance byzantine des IXe et Xe siècle, Paris, 1973,
p.247, l.7
32
impériale importante car elle permet l’accès au Sénat mais elle est distribuée en assez
grand nombre ce qui prouve que le juge de thème de Paphlagonie n’avait pas une
place particulièrement importante dans la hiérarchie des juges. En revanche au XIe
siècle, parmi les juges de thème évoqués par Michel Psellos, trois sont cités comme
magistre 68 et deux comme vestarque 69 . Ce sont deux dignités assez proches
hiérarchiquement et assez élevées, bien au dessus de celle de protospathaire au Xe
siècle. Cela indique clairement une prise d’importance et une ascension hiérarchique
de la fonction de juge thème. La présence d’un sébastophore en tant que juge des
Katôtika n’est en revanche pas liée à cette évolution mais plutôt au personnage
particulier qui porte cette dignité, Nicéphoritzès70.
De même sur neuf éparques, on note au cours du Xe siècle une dévaluation de la
fonction qui se ressent dans les dignités qui lui sont attribuées, d’abord celle de
patrice pour sept d’entre eux puis celle de protospathaire71. Cela semble indiquer un
déclin de la fonction dans l’administration constantinopolitaine.
Le problème de ce corpus, encore une fois, est la grande différence qui existe
entre le nombre important de lettres pselliennes du XIe siècle et la faiblesse
numérique de celle du Xe siècle. Cependant, en regardant la place des juges en
proportion pour chacun des deux siècles, il est peut être possible d’établir quelques
faits.
Au Xe siècle, sur un total de 47 lettres, sont présents de 5 juges de thème, 5 officiers
de justice de Constantinople. Les autres destinataires n’ont que des attributions plutôt
vagues mais une partie peut vraisemblablement être classée parmi les juges de
thèmes. Nous avons donc un nombre important de mentions de fonctionnaires de la
justice qui concerne des juges de thème et tout comme pour l’administration judiciaire
de Constantinople. Il y a une sorte de parité entre l’importance des officiers de justice
de province et de la capitale. Il ne faut pas pour autant faire de surinterprétation étant
donné l’étroitesse du corpus.
Pour le XIe siècle, la situation est assez différente. Sur les 208 lettres que nous
possédons, 117 évoquent ou sont envoyées à des juges de thèmes quand seulement 13
68 KURTZ-DREXL, 70, p.103, l.23 ; 220, p.261-62 ; SATHAS, 146, p.394-5 69 SATHAS,, 25, p.260, l.3. Il s’agit dans ce cas d’Anastase Lizix ; 38 - 39, p.272 ; 172,
p.439-40 ; 189, p.480-3. Ces quatre lettres sont toutes destinées à un certain Chasanès, juge de Macédoine. KURTZ-DREXL, 90, p.118, l.25 70 KURTZ-DREXL, 8, p.9 71 Voir Annexe n°1, p.170
33
concernent des agents de l’administration judiciaire de Constantinople. Ainsi près de
neuf dixième du corpus pour le XIe siècle est consacré aux juges de thème. Faut il en
conclure que l’administration de la justice provinciale avait alors plus d’importance
que celle de Constantinople ? Certainement pas. Cette dichotomie entre le Xe et le XIe
siècle réside notamment dans le fait que les lettres que nous avons pour le XIe siècle
sont quasiment exclusivement issues d’un seul auteur Michel Psellos alors que les
lettres du Xe sont dispersées entre une dizaine d’auteurs différents. Seules huit lettres
du XIe siècle ne sont pas de Psellos mais de Jean Mauropous. L’importance de la
justice provinciale au XIe siècle dans notre corpus est donc assez relative puisqu’elle
ne résulte que de la vision et des intérêts de Michel Psellos.
Quoiqu’il en soit ce qui est certain, c’est que le corpus de lettres malgré ses
imperfections multiples fait la part belle à la fonction de juge de thème ce qui est
finalement assez logique, ces deux siècles étant ceux de son ascension parmi les
fonctions d’importance de l’empire. C’est la seule fonction que nous pouvons
vraiment étudier.
Toujours de manière statistique, il nous est possible de donner plus
d’indications sur cette fonction.
En premier lieu, on ne peut pas vraiment dire que l’importance croissante du juge de
thème ait fait de l’ombre à une autre fonction d’importance au début du Xe siècle. En
effet, les lettres de Nicolas Ier Mystikos révèlent que la place du stratège n’est que
minime72. De plus le nombre faible d’évocation de fonctionnaire de la justice de
Constantinople n’évolue absolument pas73. Évidemment la proportion change mais la
comparaison des deux corpus n’est pas vraiment envisageable étant donné leurs
différences.
Pour en revenir aux juges de thèmes, il est possible d’étudier les lieux d’exercice et
surtout la répartition géographique des juges de nos lettres. Sur les 117 juges de
thèmes identifiés avec précision, 35 lettres concernent des juges de thèmes
occidentaux quand 82 d’entres elles concernent les thèmes orientaux de l’empire.
Parmi les thèmes les plus présent, on trouve notamment celui de l’Opsikion puis
vient celui des Katôtika, comprenant à la fois l’Hellade et le Péloponèse, et enfin
viennent en troisième et quatrième position le thème de l’Egée et celui des
72 Sur 190 lettres, seules 16, donc moins d’un dixième sont destinées ou font références à un
stratège. 73 Il y a 14 occurrences pour les lettres du Xe siècle et 13 pour celles du XIe siècle.
34
Thracésiens.74 Si on étudie le rapport entre le nombre de provinces occidentales et
orientales, on obtient une parité à 12 thèmes orientaux pour 6 occidentaux. Pour ce
qui est d’une analyse en fonction des périodes, la disparité des sources est trop
grande pour l’envisager.
Il est clair qu’il y a une prédominance des thèmes orientaux qui ne peut s’expliquer
par un commentaire géographique de l’évolution des frontières de l’Empire. En effet,
au Xe siècle et encore plus au XIe l’empire est assez développé pour qu’il n’y ait pas
une prédominance territoriale de l’Est sur l’Ouest75. Cette différence s’explique donc
par d’autres phénomènes. L’un est la hiérarchisation des provinces. Si l’on étudie la
liste des stratèges donnée dans le taktikon de l’Escurial, on note une correspondance
entre les deuxième et troisième thèmes les plus important, l’Opsikion et les
Thracésiens et les premiers et quatrièmes thèmes les plus cités dans les lettres. Les
épistoliers étant des hommes d’Etat ou d’Eglise très haut placés, il est logique qu’ils
conversent avec les fonctionnaires les plus haut placés dans la hiérarchie thématique.
Cependant, les différents auteurs n’entretiennent pas de relations épistolaires avec des
thèmes hiérarchisés mais avec des personnalités importantes. Cela pose donc la
question de la relation entre épistolier et juge de thème.
Le rapport entre épistoliers et correspondance avec les juges
Il est indispensable de replacer d’une part les lettres de chaque auteur dans
leur corpus respectif et d’autre part de replacer chaque auteur dans son contexte de
vie. Il n’est pas question de faire ici une étude biographique de chaque épistolier mais
de définir pour chacun d’entre eux leur statut et leur place dans la société byzantine
afin de mieux comprendre les rapports qu’ils entretiennent avec les officiers de
justice.
Il est possible de diviser les épistoliers utilisés dans ce travail en deux groupes.
Dans un premier groupe se tiennent les membres de l’administration civile et militaire
tandis que dans un deuxième se trouvent les membres de la hiérarchie ecclésiastique.
Dans le premier groupe se rangent Michel Psellos Syméon Magistros, Nicéphore
Ouranos, Philetos Synadénos et Théodore Daphnopates. Du coté ecclésiastique
prennent place Nicolas Ier Mystikos, Jean Mauropous, Alexandre de Nicée, 74 Voir annexe n°2, p.172 75 Voir Annexe n°4, p.178
35
Théodore, métropolite de Nicée et Léon, métropolite de Synada. Dans chaque groupe,
l’ensemble des membres possède une proportion similaire de lettres destinées aux
officiers du système judiciaire byzantin. Parmi les ecclésiastiques, qui sont
majoritairement issus du Xe siècle, la proportion est toujours située en dessous de
10% de l’ensemble de leurs lettres76 ; juges de province et de la capitale confondus.
De même parmi le premier groupe la proportion moyenne est situé entre 20 et 37 %77.
Théodore Daphnopatès, au milieu du Xe siècle, ne consacre que 20% de ses lettres à
des fonctionnaires de la justice tandis que Nicéphore Ouranos et Michel Psellos,
respectivement à la fin du Xe et au milieu du XIe siècle se rapprochent de la
proportion la plus forte.
Ces proportions nous indiquent tout d’abord que les membres de l’administration
civile et militaire entretiennent plus de lien avec le système judiciaire et les officier de
justice que les ecclésiastiques sans que les différences de proportions soient pour
autant écrasantes. Ce n’est pas extrêmement novateur. Il est assez compréhensible
que des membres de l’administration entretiennent des relations avec d’autres
officiers civils puisqu’ils travaillent ensemble et se côtoient régulièrement. Il est
aussi logique que des généraux ou des administrateurs de la capitale, comme Psellos,
entretiennent une correspondance avec des juges qui sont leurs subalternes,
représentants du pouvoir en province.
Pour ce qui est des membres du clergé, ils ont d’autres référents et d’autres
subalternes. L’Eglise a en effet, sa propre hiérarchie, ses propres lois et surtout son
propre système judiciaire. Il ne leur est donc que peu utile de travailler avec les juges
civils. D’ailleurs leurs relations sont avant tout à mettre sur un plan personnel.
Lorsque les ecclésiastiques, pour ce qui nous concerne une majorité de métropolites,
doivent régler une affaire avec des officiers de justice, ils semblent ne jamais
s’adresser à eux directement mais toujours par l’intermédiaire d’un tiers souvent
membre de l’administration civile78. Les relations qui se tissent directement entre des
76 Nicolas Ier Mystikos, 2,6% ; Jean Mauropous, 9% ; Théodore de Nicée, 4,3% ; Léon de
Synada, 5% 77 Syméon Magistros, 6,8% ; Nicéphore Ouranos, 24% ; Théodore Daphnopatès, 20% ;
Michel Psellos 37%. Syméon Magistros est ici une anomalie que je n’explique pas. 78 KURTZ-DREXL, 82, p.111-2 : Le métropolite d’Amôrion par l’intermédiaire de Michel
Psellos cherche à régler un problème fiscal. ; ou encore SATHAS, 18, p.257 : Psellos intervient pour un problème fiscal de l’évêque de Noumerika.
36
juges et le clergé sont quant à elles quasiment exclusivement personnelles et
amicales79.
La situation pour les membres de l’administration civile et militaire est un peu
différente. Si l’on utilise l’exemple de Philetos Synadenos, juge envoyé à Tarse
comme il est définit dans les collections de lettres. Il est intéressant de noter qu’il
n’envoie aucune lettre à d’autre juge, mais correspond avec des personnes de rang
égal ou supérieur comme Nicéphore Ouranos80 ou le patriarche d’Antioche81. À
l’inverse, chez Michel Psellos, la quasi-totalité des lettres concernant la justice sont
destinées à des juges de thème, comme pour Nicéphore Ouranos, quand pour
Théodore Daphnopatès toutes ses lettres sont adressées à des officiers de justice de
Constantinople.
Cette différence est due aux statuts et aux carrières de chacun des épistoliers.
Théodore Daphnopatès semble avoir fait une très large partie sinon la totalité de sa
carrière à Constantinople dans les sekreta jusqu'à en devenir le chef puis éparque de la
ville sous le règne de Romain II (957-963)82. Il est normal que son réseau à la fois
amical et professionnel se compose essentiellement de membres de l’administration
constantinopolitaine. La carrière de Nicéphore Ouranos et celle de Michel Psellos,
dans une moindre mesure, les ont tous deux conduit dans les provinces de l’Empire.
Nicéphore Ouranos a servit dans l’administration civile en tant qu’épi tou kanikleiou
mais aussi dans l’armée en Occident contre Samuel de Bulgarie, en Arménie jusqu’à
son accession au gouvernorat d’Antioche vers 99983. Sa longue carrière et ses
multiples campagnes militaires lui ont forgé un réseau important en province autant
amical que professionnel. Cependant sa collection de lettres met plus volontiers
l’accent sur les relations personnelles que sur les relations de travail.
Si Michel Psellos, quant à lui, est retourné assez rapidement à Constantinople après
une période passé en tant que juge de thème en Asie Mineure. Il est un homme
influent au palais impérial notamment parce qu’il s’appuie sur un réseau de
connaissances qui quadrille une partie de l’empire. Il doit l’entretenir ce qui crée
nécessairement une inflation du nombre de lettres pselliennes d’autant plus que son
79 NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p.422-3. Le patriarche remercie Léon, juge de Paphlagonie
pour un cadeau. ; JEAN MAUROPOUS, 46, p.140-1, une lettre amicale à un juge de province 80 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS, 8-13, p.254-9 81 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS, 5-7, p.253-4 82 THÉODORE DAPHNOPATÈS, p. 2-3 83 DARROUZÈS, p. 45-7
37
réseau est en grande partie situé en province alors que lui même se trouve
principalement à Constantinople. Ce fait explique peut être aussi la faible nombre de
lettres à des fonctionnaires constantinopolitains. Résidant à Constantinople, il lui est
peut être moins nécessaire de leur écrire. Il est important de noter que la
correspondance de Psellos ne se limite en aucun cas aux juges de thèmes même s’ils y
tiennent une place notable. Elle est composée de destinataires de toutes les catégories
de la haute société byzantine qui pourrait le soutenir ou avoir besoin d’être soutenu
par lui. C’est une situation logique puisque Psellos jouit, selon lui, d’une place
particulière auprès de l’empereur à qui il peut s’adresser directement. La partialité de
cette correspondance, dont il nous manque les réponses des destinataires, nous
empêche de savoir qui de Psellos ou des destinataires qu’ils soient juge ou non, est le
premier à correspondre et établir un lien. Savoir si Psellos se crée un réseau pour
devenir influent ou si le réseau qu’il possède de fait lui donne une influence reste
assez difficile.
Pour en revenir aux juges de thème et à leur localisation largement majoritaire dans
les thèmes orientaux de l’Empire, une étude du cas de Psellos et de sa carrière nous
indique un certain nombre d’éléments. Sur les 182 lettres envoyées à des
fonctionnaires de l’administration civile, nous en avons 142 pour l’Orient et 40 pour
l’Occident84. J.-Cl. Cheynet démontre bien le fort lien de Michel Psellos avec l’Asie
Mineure si l’on en exclut ses marges 85 . Pour rappel, dans la correspondance
psellienne à des officiers de justice la proportion est similaire86. Parmi les thèmes
orientaux, les trois thèmes arrivant en tête sont l’Opsikion avec 31 lettres, puis l’Egée
avec 15 lettres et enfin celui des Thracésiens avec 13 lettres. Il est possible
d’expliquer ce trio de tête tout simplement en utilisant la vie et la carrière de Psellos.
Pour ce qui est du thème des Thracésiens, il est clair que l’attachement de Michel
Psellos vient du fait qu’il en fut le juge et que ses administrés gardent, semble-t-il un
bon souvenir de lui87. Il fut également juge des Bucellaires, qui arrive en quatrième
position avec sept lettres. Il est intéressant de noter que l’auteur qui exerça lui même
84 CHEYNET, J.-C., « L’Asie Mineure d’après la correspondance de Psellos »,
Byzantinischen Forschungen 25, 1999, p. 235 85 ibid, p.236 86 Pour 96 lettres à des juges de thème d’Orient, nous avons 33 lettres pour des juges de
thème d’Occident. 87 CHEYNET, J.-CL., op.cit., p.233-4
38
les fonctions de juge de thème, a gardé des contacts dans ces régions et continue de
s’intéresser à la fois à leurs habitants et à ceux qui les gouvernent, ses successeurs.
Les deux autres thèmes que sont l’Egée et l’Opsikion sont liés à Psellos pour des
raisons plus personnelles qui le pousse à s’entretenir avec les juges de ces deux
thèmes. Psellos possède de nombreuses propriétés et des monastères en charisticariat
dans le thème de l’Opsikion.88 Il entretient des rapports avec le juge de thème afin de
protéger ses intérêts voire de les faire fructifier mais aussi afin de protéger ses obligés
travaillant pour lui dans le thème à l’expansion de son bien. Les liens avec le juge de
l’Egée, Nicolas Sklèros ne sont pas ou peu construits sur une arrière-pensée
spéculative et financière. Il s’agit d’une relation fondée sur l’amitié. C’est l’une des
raisons qui explique la multiplicité des lettres à ce juge. Psellos et Nicolas Sklèros
entretiennent une amitié et une relation intellectuelle importante89. Cela ne l’empêche
pas pour autant d’utiliser cette amitié afin d’atteindre des buts parallèles plus
prosaïque concernant ses biens.
Ce que l’on peut conclure en tout cas des liens existant entre les épistoliers et
leurs correspondants officiers de justice, c’est la relation finalement plus amicale ou
personnelle que professionnelle qui les unit. Le cas des ecclésiastiques est assez
flagrant mais ne se dément pas lorsqu’il s’agit d’épistoliers issus de l’administration
civile comme Nicéphore Ouranos. Seul Psellos entretient avec des juges une relation
dans le but parfois unique de régler des affaires administratives et judiciaires. Il est
aussi clair que par le nombre de juges présents dans ses lettres, l’étude de Psellos et de
ses rapports avec nos juges constituent la plus grande partie de notre travail.
Conclusion
Cette étude statistique de notre corpus rend compte de la prédominance de la
fonction de juge de thème. C’est tout à fait logique puisqu’il s’agit de la période qui
voit leur apothéose. La monopolisation du corpus par les lettres de Michel Psellos
accentue nécessairement cette impression. Le point de vue psellien conditionne le
88 ibid, p. 336 ; AHRWEILER, H., « Charisticariat et autres formes d’attribution de fondation
pieuses aux Xe-XIe siècles », Zbornik Radova Vizantološkog Instituta, 10, 1967, p.24-7 89 Psellos, Nicolas Sklèros et son neveu Anastase Lizix entretiennent des relations amicales
et intellectuelles. La disparition d’Anastase Lizix est d’ailleurs l’occasion de démontrer l’amitié qui lie Psellos et Sklèros par des lettres partageant entre eux une souffrance commune. Voir notamment SATHAS, 25, p.260-1
39
reste de notre étude et ne nous informe qu’à travers les intérêts et les volontés
pselliennes comme le montre l’étude de la géographie des juges. Les relations entre
juges et épistoliers semblent principalement cantonnées à des questions
professionnelles concernant les intérêts des épistoliers même si quelques relations
amicales peuvent se tisser.
40
Chapitre 3 - Onomastique et statut social
Ayant compris l’importance des juges de thèmes dans notre corpus de lettres,
il nous faut maintenant nous pencher sur la question de l’identité de ceux qui exercent
les fonctions de juges. Cette étude se fait à partir des quelques informations que nous
avons dans ces lettres principalement onomastiques. Nous envisagerons ensuite de
placer ces juges dans leur contexte social et culturel pour définir leur place dans la
société byzantine.
Le milieu social des juges
Après avoir essayé de définir le juge dans le contexte administratif byzantin
puis déterminé les différents juges présents chez les épistoliers du Xe-XIe siècle, il est
important de préciser encore notre étude par un travail sur les hommes incarnant ces
fonctions judiciaires, et en particulier leur statut social.
Sur l’ensemble des lettres, rares sont cependant les informations permettant
d’identifier les correspondants des différents épistoliers. En effet, lorsque le nom n’est
pas spécifié en en-tête de la lettre dans les éditions et collections, il est rarement
possible de le déduire par le fond même de la lettre. Il n’y a évidemment rien
d’étonnant à cela, puisque les correspondants se connaissent et n’ont pas
perpétuellement besoin de préciser à qui ils s’adressent et encore moins de spécifier
tout leur état civil. Il est aussi envisageable que certaines lettres soient seulement
adressées à des juges que l’épistolier ne connaît pas nécessairement pour traiter des
affaires liées à son thème. Auquel cas, il n’écrit pas à une personne en tant que tel
mais au détenteur d’une fonction ce qui expliquerait pour certains cas l’absence de
nom. De plus parmi les juges nommés certains ne le sont que par leur nom voire
uniquement par leur le prénom ce qui complique l’identification ou la rend
impossible. Quoiqu’il en soit, sur l’ensemble des lettres sont mentionnées 30
personnalités nommées plus ou moins explicitement et exerçant une fonction
judiciaire90.
Prenons en premier lieu les juges nommés de manière trop peu explicite pour
en faire de longues analyses. Si l’on étudie ces noms, on note la présence quasi- 90 Voir Annexe n°1, p. 170 ; 12 pour le Xe siècle. 18 pour le XIe siècle.
41
exclusive de noms grecs tel que Paul91, Gabriel92 ou Constantin93. D’autre le sont un
peu moins tel que Sisinnios94 ou Malakeinos95 mais cela ne préjuge en rien de
l’origine de leur porteur. Il s’agit probablement de personnes issues de familles non
byzantines mais totalement intégrées à la société de l’empire d’après leurs fonctions
et dignités. Il n’y a donc pas vraiment d’étrangers travaillant dans l’administration
civile byzantine, du moins au niveau judiciaire. La justice demande de toute façon
des compétences très spécifiques que cela soit celle en droit byzantin mais aussi en
rhétorique.
En regardant les différentes personnalités en fonctions du type de juge, il est
envisageable de tirer quelques conclusions sur ces fonctions spécifiques.
Concernant les personnalités exerçant la fonction d’éparque de Constantinople, nous
avons quatre personnes différentes. Tout d’abord un certain Sisinnios, destinataire
d’une lettre de Théodore Daphnopatès en tant que protospathaire et éparque de la ville
sous Romain II (959-963) 96. Il semble que cet homme ait effectué toute sa carrière à
Constantinople dans les services fiscaux. Il fut apo sakelliou puis après un premier
passage comme éparque, devint logothète du Génikon puis redevint éparque avec la
dignité supérieure de magistre97.
Théodore Belonas fut lui aussi éparque et apparaît probablement comme tel chez
Daphnopatès98 mais aussi dans une voire deux lettres de Théodore de Nicée99. Il fut
nommé à cette fonction au plus tard en 958 et nous ne connaissons rien d’autre sur sa
famille ou sur lui même 100 . Enfin nous connaissons deux Constantin 101 .
L’identification à une et même personne est interdite, dû notamment au fossé de 20
années séparant le premier éparque du deuxième. Il n’est pas vraisemblable qu’un
91 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 29, p.230-1 ; 30, p.231 ; 33, p.233 ; 35, p.234 ; 44,
p.239-40 92 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS, 7, p.103, l.10 93 DARROUZÈS - THEODORE DE NICÉE, 38, p.303-4 94 THEODORE DAPHNOPATÈS, 33, p. 195-7 95 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 31, p.232 et 34, p.233-4 ; LÉON DE SYNADA, 23-24,
p.38-41 96 THEODORE DAPHNOPATÈS, 33, p.195-7 97 PMBZ #27115 98 THEODORE DAPHNOPATÈS, 39, p.227, l.12 : « Τοιαῦτα τῆς ὀφρύος ἀπέλαυσεν ὁ Βελονᾶς
». La lettre évoque un sérieux différend entre les deux hommes autour d’une affaire judiciaire concernant des moines. 99 DARROUZÈS - THEODORE DE NICÉE, 12, p.280, et n.24 ; et probablement 21, p.289-90 100 PMBZ # 27706 101 DARROUZÈS - THEODORE DE NICÉE, 38, p.303-5 ; THEODORE DAPHNOPATÈS, 32, p.192-
3
42
éparque ait été 20 ans en fonction ni même qu’il l’eut été deux fois à 20 ans
d’intervalle. C’est en effet une fonction que l’on atteint généralement en fin de
carrière donc en fin de vie. Le premier est le destinataire d’une lettre de Daphnopatès
et n’est pas connu par ailleurs102. Le second, bien plus intéressant, est mentionné par
une lettre de Théodore de Nicée alors qu’il est patrice et éparque103. La Continuation
de Théophane nous donne sur lui quelques informations. La chronique nous apprend
qu’avant d’être éparque, il fut mystikos, c’est à dire le secrétaire particulier de
l’empereur possédant des prérogatives judiciaires et la direction des services centraux.
Il devint ensuite enseignant en philosophie à l’université impériale104 . Si l’on
compare ce parcours à celui de Sisinios et celui d’un de nos épistoliers qui fut
également éparque, Théodore Daphnopatès, on note de nombreuses convergences.
Tout d’abord ce sont des parcours exclusivement constantinopolitain même si les
trajectoires ne sont pas les mêmes. De plus le parcours de Constantin et de
Daphnopatès sont quasiment identiques avec un passage comme mystikos, sous
Romain Ier Lecapène probablement. Les éparques en plus d’être fortement ancrés à
Constantinople sont aussi issu de groupes sociaux aisés et très bien éduqués à la
philosophie comme en témoigne le poste d’enseignant de ce Constantin mais
également les œuvres écrites par Théodore Daphnopatès105. Il s’agit évidemment que
d’échantillons de quatre éparques et il n’est pas possible d’étendre la réflexion mais
une étude des différents éparques connue dans d’autres sources permettrait d’infirmer
ou de renforcer cette hypothèse. En plus de ces quelques éparques nous connaissons
également d’autre fonctionnaires de Constantinople. Ils présentent d’ailleurs les
mêmes caractéristiques sociales si nous nous fions à leur nom. Nous avons
notamment le neveu du Patriarche Michel Cérulaire, Constantin qui fut notamment
Grand Drongaire et épi tôn kriséôn106. Encore une fois un enfant de bonne famille qui
a nécessairement bénéficié du soutien de son oncle. Nous avons également un certain
Léon, qui était semble-t-il, neveu de l’archevêque de Patras, un homme très bien
102 PMBZ #23920 103 PMBZ #23916 104 Theophanes Continuatus, BEKKER, E. (ed.), Bonn, 1838, p. 446, .9-11 105 Principalement des écrits hagiographiques ou des homélies, voir THEODORE
DAPHNOPATÈS, p.4-6 106 PBW : Konstantin 120, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107553 [Consulté
le 4 juin 2014]
43
éduqué qui fut épi tôn déèséôn107. Ces deux hommes sont issus de famille formant
l’élite ecclésiastique byzantine et bénéficie de leur soutien qu’il soit simplement
académique pour leur formation ou politique pour leur carrière.
Pour ce qui est des autres fonctions, les personnalités mentionnées ne sont
pour la plupart pas assez connues pour les étudier dans de long développement.
Ceux mentionnés uniquement par leur prénom ne permettent pas d’aller beaucoup
plus loin que la mention de leur fonction et dignité notamment Léon, protospathaire et
juge des Anatoliques 108 , son homonyme Léon protospathaire et juge de
Paphlagonie109 ou encore Michel, juge des Cibyrrhéotes110. Ceux mentionnés par leur
nom permettent de plus amples analyses puisque les familles sont souvent assez
connues. La présence notamment de Serge Hexamilitès, juge des Thracésiens ou
encore d’un Xeros, juge des Thracésiens est intéressante. En effet, les Hexamilitai
étaient une grande famille de juges et fonctionnaires civils. De même, le juge Xeros
dont nous ne connaissons pas le prénom est issu d’une famille de fonctionnaires civils
d’origine inconnue et étant apparu au début du XIe siècle. La plupart des Xeroi
servaient durant cette période à un poste de juge. Nous connaissons un autre juge de
thème bien que sa famille soit moins bien connue. Il s’agit du juge Malakenos. Il est
destinataire d’une lettre de Nicéphore Ouranos et Léon de Synada 111 . Il est
protospathaire et juge au moment de réception des lettres soit vers 999. Nous ne
connaissons pas vraiment sa famille cependant il est envisageable qu’il apparaisse
dans deux autres sources. Il est possible qu’il ait eu un lien voire qu’il ait été la
même personne que Jean Malakenos qui apparaît dans la vie de Nikôn le Metanoeite
comme notable et soutien du Saint112. Malakenos apparaît peut être également chez
Jean Skylitzès. Il mentionne un protospathaire qui fut exilé à Constantinople pour
sympathie pro-bulgare alors qu’il dirigeait une armée en Sicile113. Les assimilations
107 PBW : Leon 2104 : http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/158159 [consulté le
4 juin 2014 ] ; CHEYNET, J-CL., « Mantzikert, un desastre militaire ? », Byzantion, 50, 1980, p.437 108 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 2, p.217-8 ; PMBZ #24584 109 NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p.422-3 ; PMBZ #24405 110 SATHAS, 66, p.297-8 111 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 31, p.232 et 34, p.233-4 ; LÉON DE SYNADA, 23-
24, p.38-41; PMBZ #24841 112 PMBZ #23106, Vita Niconis , BHG 1366-7, 43-45, p.148-56 et Testamentum Niconis,
BHG 1368, p. 253, l.72 113 JEAN SKYLITZÈS, Empereurs de Constantinople, CHEYNET, J.-CL., FLUSIN, B., (trad., ed.
et com.), Paris, 2003, p.286 et n.10
44
sont à mon sens difficile. Elles sont envisageables étant donné la concordance de la
datation mais la différence de statut entre le Malakenos, notable thessalonicien de la
vie de Nikôn et le Malakenos, général en Sicile chez Skylitzès oblige, à mon sens à un
choix entre les deux. Quoiqu’il en soit, que cela soit l’un ou l’autre ce personnage
reste issus de la partie haute de la société byzantine sur le plan économique pour l’un,
sur le plan politique et militaire pour l’autre.
Quant aux juges non définit de Constantinople, ils sont assez peu étudiables.
Nous en avons deux, Paul et un certain Pierre Androsulitès. Paul est un juge
constantinopolitain puisqu’il est appelé à trancher une affaire liée à un monastère de
Constantinople114. Il est un ami de Nicéphore Ouranos et un correspondant important
de celui –ci mais nous n’en savons pas beaucoup plus sur ce qui les lie et sur les
fonctions de Paul.
Pierre Androsulitès quant à lui est mentionné par Alexandre de Nicée115 alors qu’il
évoque les commissions successives chargées de déterminer sa culpabilité dans le
procès suivant sa destitution de la charge de métropolite. Il s’agit d’un dignitaire dont
la fonction précise n’est pas connue mais il est d’un rang très important puisqu’il
siège aux côtés de très hauts juges et métropolite116. Il est fort probable qu’il y ait un
lien entre notre Androsulitès et la famille des Androsalitai. Les membres de cette
famille ont servi l’empire sous le règne de Basile Ier. En effet, le premier Androsalitès
connu est Nicolas Androsalitès, higoumène du monastère de Saint Diomède qui aide
le jeune Basile lors de son arrivée à Constantinople117. Cette aide a rejailli sur toute la
famille et Basile devenu empereur nomma tous les frères de Nicolas à de hautes
fonctions. Paul devint Sacellaire 118 , Jean devint Drongaire de la veille 119 et
Constantin, Logothète du Genikon120. Pierre Androsulitès est peut être le descendant
de cette famille ayant ainsi été introduit dans les offices de l’Empire et devenue par ce
biais un grand dignitaire et juge de cette commission.
114 PMBZ #26373 ; DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 30, p.231. Nicéphore Ouranos y
évoque le monastère de Saint Taraise à Constantinople, l.3 et n.11bis ; JANIN, R., La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, Paris, 1953, p.497 115 DARROUZÈS – ALEXANDRE DE NICÉE, 10, p.85-6 ; 14, p.91, l.26 116 PMBZ #26471 117 PMBZ #25886 ; Notamment Theophanes Continuatus, op.cit., p.223-5 et 316-7 ; JEAN
SKYLITZÈS, Empereurs de Constantinople, op.cit., p.105 et n.19 118 PMBZ #26320 119 PMBZ #22840 120 PMBZ #23785
45
Ce que montre à la fois l’étude préliminaire des juges de thème et de
Constantinople, c’est que les fonctions semblent pour la plupart être attribuées à
quelques familles plaçant leurs membres dans l’administration. Il faut cependant
réaffirmer que la méconnaissance d’un plus grand nombre de nom empêche une
confirmation plus certaine. De plus l’absence de connaissance sur une famille ou un
nom peu tout simplement indiquer que le juge s’est hissé sans le soutien familial aux
fonctions qu’il occupe. Il ne faut pas en effet oublier l’existence d’hommes nouveaux
parmi lesquels se trouvent Michel Psellos lui même.
Quelques juges remarquables
Malgré le nombre important de juges anonyme, quelques uns mentionnés dans
ces lettres sont des figures assez connues. Nous pouvons donc envisager de faire
quelques développements sur leur vie ou carrière.
Certains, et de manière plus certaine que pour le juge Androsulitès, sont liés à des
familles renommées. On peut notamment citer le juge Mytilenaios121. Le nom lui
même signifie « celui de Mytilène ». Ce juge est fortement lié, semble-t-il, à
Christophe Mytilenaios, poète et juge de la première moitié du XIe siècle. La lettre de
Léon de Synada qui s’adresse au juge Mytilenaios est datée de l’année 998. Le dit
juge peut donc difficilement être assimilé à Christophe de Mytilène tout simplement
du fait de sa date de naissance, vers 1000. Il probable qu’il s’agisse soit de son frère,
Jean qui fut protospathaire et juge de Paphlagonie puis des Optimates122, soit de son
père qui n’est pas très bien connu123. Le fait que ladite lettre ait été destinée à un
membre de la famille de Christophe de Mytilène ne fait pas grand doute cependant.
Sur la famille dans son ensemble, nous n’avons pas beaucoup d’information sinon
qu’elle venait de Mytilène à Lesbos et qu’elle s’est installée à Constantinople. Le
contenu de la lettre purement amical ne préjuge en rien de la localisation du thème
d’exercice du juge mais il est probable qu’il s’agisse d’un thème d’Asie Mineure. Les
membres de la famille Mytilenaios exerçant, en effet, à plusieurs reprises la fonction
de juge notamment en Paphlagonie124. À noter enfin que le juge Mytilenaios est l’un
121 LÉON DE SYNADA, 25, p.40-1 122 PMBZ #23297 123 PMBZ #28511a 124 Christophe ainsi que son frère Jean y ont officié
46
des rares juges sur lesquels on peut obtenir autant d’informations pour le Xe siècle
avec un minimum de certitude.
Le cas est plus fréquent pour le XIe siècle. En examinant le cas d’un juge des
Katôtika, on en tire un des plus importants exemples. Ce juge est le fameux
Nicephoritzès125. Bien qu’il n’apparaisse qu’à deux reprises, nous sommes tout à fait
capable de le relier à l’eunuque Nicéphoritzès. Sous le règne de Romain IV, il est
envoyé comme juge de l’Hellade, partie des Katôtika. Sa dignité de sebastophore ne
laisse aucun doute sur l’identité de celui qui fut l’un des hommes forts du régime de
Michel VII126. Il semble que sa nomination au poste de juge des Katôtika était une
manière de l’éloigner de la cour impériale de Constantinople où il n’était apprécié que
par intermittence. Son cas étant assez particulier, il ne nous est pas possible de tirer
des conclusions générales sur la fonction de juge sinon qu’elle peut servir de mesure
d’exil en quelque sorte.
La plupart des autres juges que nous connaissons son connus grâce aux liens qu’ils
entretiennent avec Michel Psellos.
L’un des juges nommé le plus grand nombre de fois est le juge Nicolas
Sklèros127. Il apparaît à plus de 14 reprises en tant que destinataire sous la fonction de
juge de l’Egée. Sans refaire toute l’histoire des Sklèroi, il s’agit d’une famille très
influente dans le jeu politique entre le IXe et le XIe siècle. Arrivée depuis la petite
Arménie en tant que militaire, les Sklèroi gravissent les échelons jusqu'à ce que
Bardas Sklèros tente d’usurper le trône impérial. Le XIe siècle, voit un certain déclin
de la famille mais surtout une intégration d’une partie d’entre elle à l’aristocratie
civile constantinopolitaine. C’est le cas de Nicolas Sklèros, ici nommé juge, qui fut
également épi tôn déèséôn et grand skeuophylax des Blachernes 128 , soit
l’administrateur de ses propriétés. Il cumule également les dignités de vestès, proèdre
puis protoproèdre et enfin magistre. Il s’agit donc d’un homme issu de la plus haute
aristocratie de l’empire. D’un point de vue social, on note que Psellos entretient une
amitié et une correspondance suivie avec un homme ayant un statut social égal ou
125 KURTZ-DREXL, 8, p.9 126 GUILLAND, R., « Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin : le
sébastophore », REB, 21, 1963, p. 199-207 127 SATHAS, 25, p.260-1 ; 65, p.297 ; 95, p.337-8 ; 135, p.378-9 ; KURTZ-DREXL, 37, p.60-
2 ; 44, p.73-5 ; 56, p.88-9 ; 60, p.92-3 ; 63, p.96-7 ; 123, p.147-8 ; 124 – 128 p.148-152 128 PBW, Nikolaos 2104 : http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/158208 [22 mai
2014]
47
supérieur à lui ; tout dépend si l’on prend en compte uniquement l’héritage familial ou
la fonction exercée.
Il est aussi intéressant de noter que Psellos est lié avec d’autres membres de la famille
Sklèros. Il évoque à plusieurs reprises un certain Lizix129. Il s’agit d’Anastase Lizix,
qui n’est autre que le neveu de Nicolas Sklèros130. Les lettres de Psellos à son sujet
sont assez évasives mais l’éloge funèbre qu’il rédige pour lui nous indique qui il était
et la place qu’il tenait dans le réseau amical de Psellos. Il fut un de ses élèves et était
d’après lui d’une culture à nulle autre pareille131. De formation juridique, il se lance
dans une carrière civile avec le soutien de son maître mais aussi d’autres grandes
personnalités notamment issues de la famille des Dalassenoi132. Il fut juge de thème
mais entra également aux services centraux du palais avant d’être une nouvelle fois
envoyé en province, à Athènes où il trouve sa dernière demeure terrassé par une
maladie à la fois paralysante et foudroyante133. Ce que nous indique ces informations
sur Anastase Lizix, c’est encore un fois l’origine sociale élevée de ceux qui se lancent
dans des carrières civiles, mais également le fait de la nécessité d’obtenir des soutiens
extérieurs de poids, ici Psellos et les Dalassenoi. Les lettres nous montrent le lien
amical très fort qui lie à la fois Nicolas Sklèros, Psellos et Anastase Lizix, montrant
qu’il ne s’agit pas ici simplement d’une histoire de soutien pour une carrière mais
bien d’amitié.
Il manque encore deux autres juges pour compléter ce tableau. Il s’agit de
deux personnalités, liées au consul des philosophes non pas par l’amitié mais par les
liens du sang. Le premier est Pothos, régulièrement nommé « le fils du
Drongaire »134. Il est vraisemblablement le cousin de Psellos135. Il fut juge de
Macédoine136, de Thrace et de Macédoine137, ainsi que de l’Opsikion138. Il était
également magistre puis vestarque. Encore une fois, il s’agit de la haute société
129 KURTZ-DREXL, 127, p.151, l.9 ; et vraisemblablement SATHAS, 25, p.260, l.3 130 KURTZ-DREXL, 127, p.151, l.11 ; GAUTIER, P., « Monodies inédites de Michel Psellos »,
REB, 36, 1978, p. 87 et n. 20 131 GAUTIER, P., « Monodies inédites de Michel Psellos », REB, 36, 1978 p. 108 132 ibid., p.87 133 ibid., p.109-10 134 KURTZ-DREXL, 35, p.56-9 ; 53, p.83-5 ; 220, p.261-2 ; 250, p.299 135 PBW, Pothos 102: http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/109102 [Consulté le
4 juin 2014] 136 KURTZ-DREXL, 220, p.261-2 137 KURTZ-DREXL, 250, p. 299 138 KURTZ-DREXL, 35, p.56-9
48
byzantine. Cependant, il n’est pas certain que Psellos entretenait des relations
particulièrement personnelles avec son cousin, le sujet des lettres étant souvent très
administratif et judiciaire. Ce qui est intéressant, c’est que ce Pothos, cousin de
Psellos venait probablement du même milieu social que lui, c’est à dire d’un milieu
relativement modeste, bien qu’il soit le fils du drongaire. Il aurait donc gravit un peu
comme Psellos, les échelons administratifs jusqu'à devenir juge de thème par le
simple fait de sa culture, son éducation et ses connaissances juridiques ce qui tranche
un peu avec la trajectoire de Nicolas Sklèros ou Anastase Lizix.
De même, notre dernier juge est aussi issus d’un milieu modeste, il s’agit de
Basile Malésès139 . Il est juge des Katôtika140 , puis des Arméniaques141 . Il a
probablement suivit les formations de philosophie, rhétorique et droit à
Constantinople chez Psellos ou Xiphilin142. Il travailla d’abord dans les bureaux du
fisc dans la capitale avant de devenir juge de thème. La promotion entre le thème des
Katôtika et celui des Arméniaques est assez importante, ce qui signifie qu’il
satisfaisait à la fois les exigences dues à son travail mais il pouvait compter sur le
soutien de Psellos qui d’ailleurs le couvre d’éloges. Selon Eva de Vries – van der
Velden143, le soutien sans faille de Psellos à Basile Malésès viendrait du fait qu’il ait
été l’époux de sa fille adoptive, donc son gendre. Les lettres de recommandation
multiples qu’il envoi aux métropolites du thème des Arméniaques, montrent qu’il 139 En réalité, seul « τῷ Μαλέσῃ » apparaît dans les lettres. N. Duyé fait le lien entre ce
Malesès et Basile Malesès, logothète de l’eau chez Michel Attaliatès. Voir DUYÉ, N., « Un haut fonctionnaire byzantin du XIe siècle : Basile Malésès », REB 30, 1972, p.167-178 ; L’idée est réaffirmée dans CHEYNET, J-CL., « Mantzikert, un desastre militaire ? », Byzantion, 50, 1980, p.437 et complétée dans DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « Psellos et son gendre », Byzantinische Forschungen, 23, 1996, p. 109-149
La correspondance parait assez logique bien que A. Kazhdan et J. Ljubarskij ne soient pas convaincus. Cependant, ils n’apportent tous deux aucuns éléments permettant d’infirmer sérieusement l’hypothèse. Ils ne font que réaffirmer un doute inhérent à ce genre d’identification et admettent même l’existence d’argument, même faible, pouvant corroborer l’hypothèse de Duyé. Voir KAZHDAN, A., LJUBARSKIJ, J, «Basile Malésès encore une fois», Byzantinoslavica, 34, p.219-29 140 KURTZ-DREXL, 76, p.107-108. En particulier p.108, l.10 141 KURTZ-DREXL, 132, p.154-5. Voire en particulier, p. 155, l.4-8 Malésès était
vraisemblablement juge des Arméniaques lorsqu’il reçoit cette lettre. Psellos évoque une affaire qui avait été présentée à un certain Splénarios, vestarque et juge des Arméniaques. Le requérant ayant fait appel à l’empereur pour obtenir une meilleure solution, l’affaire se présente donc de nouveau devant le juge du thème, Malesès. Cela prouve qu’il était alors le successeur de Splénarios à la tête du thème. 142 DUYÉ, p.167-9 143 DE VRIES – VAN DER VELDEN, E. « Psellos et son gendre », Byzantinische Forschungen,
23, 1996, p.109-49
49
souhaite à la fois augmenter le nombre de soutiens de Malésès dans son thème de
fonction mais également qu’il souhaite aussi le surveiller. Le thème des Arméniaques
est important et assez troublé par l’avancée turque en Asie Mineure, il ne faudrait pas
qu’un faux pas Malésès, compromette Psellos auprès de la cour impérial et de
l’empereur, plaçant ainsi sa fille et sa descendance dans une situation délicate qui
menacerait la pérennité du statut de Psellos et de sa famille qu’il a construit durant
toute sa vie.
Quoiqu’il en soit ce Basile Malésès, d’origine modeste ayant acquis une culture et
une éducation d’excellent niveau cumulées au soutien de Psellos, son beau-père
éventuel, réussit à devenir le juge d’un des thèmes les plus important de l’empire.
Sans ce soutien, peut être n’aurait il pas eu une carrière aussi longue.
L’étude de l’ensemble de ces juges montre que ces hommes se sont élevés au
dessus des autres par deux trajectoires possibles. Soit par le soutien familial tel que les
Xèroi, Sklèroi, Hexamilitai. Ceux là ont joui d’une éducation solide et d’un réseau
familial prestigieux au service de leur carrière. Il ne sont pas sans mérite mais ont
bénéficié d’un certain nombre d’avantages. D’autre issus de milieux plus modestes se
sont hissés dans les hautes sphères de l’empire par des études brillantes, l’acquisition
d’un socle de connaissance solide mais bénéficiant nécessairement de soutiens
extérieurs trouvés lors de leurs études comme pour Malésès. De même, les
trajectoires de carrières semblent toutes commencer à Constantinople que cela soit
pour les juges de thème ou les futurs éparques. La question serait de savoir si les
carrières sont faites à partir de choix volontaires ou d’arbitraires administratifs.
Comme certitude, nous savons cependant que toute carrière commence
nécessairement par une formation solide dans la capitale.
La question de la formation et de l’éducation des futurs juges
Il faut bien avouer que les allusions explicites concernant la formation ou du
moins l’éducation des juges ne sont pas légion dans notre corpus. Nous n’avons au Xe
siècle strictement aucune référence. Peut être que le juge et protospathaire
Théodore144, correspondant à une reprise du professeur anonyme, fut un de ses élèves
mais rien n’indique que nous puissions vraiment affirmer cela. De la même manière
144 PROFESSEUR ANONYME, 121, p.99
50
chez Michel Psellos, malgré un nombre important de correspondant, nous ne
connaissons que quelques références explicites à l’enseignement.
Dans une première lettre adressée à un ancien camarade de classe vraisemblablement
devenu juge145, Psellos insiste sur l’amour et la fraternité spirituelle qui les lient
après avoir passé tant de temps à suivre les mêmes enseignements146. Cela ne nous
donne pas beaucoup d’éléments sur l’éducation mais cela a le mérite de nous montrer
les liens que peuvent unir d’anciens camarades dans leur vie professionnelle à venir,
s’il en était besoin. Une autre lettre nous permet de noter un autre type de relation. Il
s’agit d’une lettre que Psellos adresse à un juge de l’Opsikion147. Le sujet n’a
strictement rien à voir avec l’éducation et la formation des juges puisque Psellos lui
demande d’accueillir un ancien officier de justice de Constantinople venant trouver du
travail dans ce thème d’Asie Mineure. Comparant la relation que devrait entretenir le
juge et ce nouvel arrivant avec celui qu’Alexandre le Grand entretenait avec ses
soldats et lieutenants notamment Cleitos et Parménion, il conclut en précisant
cependant que le juge n’avait pas comme enseignant Aristote mais bien Psellos148.
Deux autres juges sont qualifiés d’élèves par l’épistolier. Anastase Lizix est l’un
d’eux. Il était juge et neveu de Nicolas Sklèros dont Psellos déplore la mort
prématurée dans une lettre à ce dernier149. L’éloge que Psellos lui écrit décrit
notamment cette époque ou Lizix suivait les enseignements de Psellos. Il loue à la
fois son intelligence et sa culture comme il en est la règle dans ce genre d’écrit et met
donc en avant le fait qu’il fut son ancien élève. Les précisions apportées par Psellos
indiquent cependant qu’Anastase Lizix était bien plus qu’un simple étudiant du consul
des philosophes mais quasiment son égal sur un plan intellectuel. En effet, Psellos
qui aime décidément à se comparer aux philosophes antiques précise que Lizix « le
nouvel Aristote, faisait [de Psellos] un Platon »150. Au delà de l’ego psellien, ce
passage ainsi que le précédent insistent bien sur le rapport particulier qui peut se créer
entre un professeur et son élève qui perdure bien après la fin des études de ces
derniers sous la forme d’une amitié dans ce cas, d’un lien de clientèle plus
145 KURTZ-DREXL, 11, p.12, « Συµµαθητῇ τινι » 146 KURTZ-DREXL, 11, p.12, l.13-18 147 KURTZ-DREXL, 100, p.128-9 148 ibid., p.129, l.2 149 SATHAS, 25, p.260-1 ; KURTZ-DREXL, 127, p.150-1 150 GAUTIER, P., « Monodies inédites de Michel Psellos », REB, 36, 1978, p.108, l.40-41,
« χαρίτιον ἐµῶν καὶ Πλατιονά µε ὁ νέος Ἀριστοτέλης ποεῖς »
51
fréquemment. Nous avons encore une autre référence concernant le juge Serge
Hexamilitès. Dans une lettre qui lui est adressée au sujet d’un moine vagabond Hèlias,
Psellos lui demande de bien l’accueillir terminant en précisant « voici l’ordre du
maitre à son élève. »151 Dans une oraison qui lui est dédiée, Psellos note également en
titre que ce dernier fut son élève152.
Toutes ces indications montrent bien que Psellos gardait un contact avec un cercle
d’anciens élèves. Ayant formé la plupart des juges avec qui il correspond, le lien qui
les unit sert à la fois pour surveiller leur carrière et les protéger si besoin153.
Quoiqu’il en soit les indications sur l’éducation, à l’exclusion de quelques
indices sur les rapports entre épistoliers et anciens élèves, sont bien maigres. Il nous
est possible cependant de déduire l’éducation, si ce n’est la formation, qu’ont reçu nos
officiers de justice en mettant en jeu leur statut social. En regardant les noms de
Sklèros, Xèros, Hexamilitès, Synadenos ou même Malesès, nous savons que ces
hommes, ces juges, même s’ils ne sont pas forcément représentatifs, appartiennent à
l’élite de l’empire, un groupe à la fois aisé et cultivé. Leur éducation est donc un
point majeur si ce n’est une marque d’appartenance à cette élite. Si l’on se replace au
Xe siècle, on connaît un renouveau ou du moins une réforme du système scolaire
notamment avec un renforcement du l’enseignement supérieur à Constantinople sous
Michel III puis Constantin VII154. Tout membre de l’élite byzantine se doit alors de
maitriser la paideia, c’est à dire un enseignement, principalement littéraire, fondé sur
« la grammaire, la poésie et la rhétorique et l’acquisition d’un langage de forme et de
qualité d’expression dont les modèles et les garants se trouvent dans le lointain passé
de l’hellénisme. »155 Cet apprentissage se faisait soit par le biais de tuteurs privés,
pour les familles les plus grandes et les plus fortunées, soit dans des écoles. Nous n’en
connaissons aucune en province et seulement quelques unes à Constantinople.
L’enseignement au delà de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la
mathématique de base devait donc se concentrer dans la capitale limitant l’accès à la
paideia à un nombre restreint de famille. Le nombre d’élèves en lui même à ce
151 GAUTIER, P., « Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées », REB, 44, 1986,
p.181, l.22-23 , « δεῖ γάρ διδάσκαλον ἔντελλεσθαι µαθητῇ» 152 MICHEL PSELLOS, Michaelis Pselli Oratoria Minora, LITTLEWOOD, A.R., (ed.), Leipzig,
1985, p.94 153 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p.13 154 BROUSSELLE, I., Recherche sur les élites dirigeantes de l’Empire byzantin IXe-950,
Paris, 1986, p.133 ; LEMERLE, P., Le premier humanisme byzantin, 1971, Paris, p.253-66 155 LEMERLE, P., Le premier humanisme byzantin, 1971, Paris, p.252
52
niveau d’étude, qualifié de « moyen » par P. Lemerle, était assez faible. Probablement
situé entre 20 et 30 élèves par école et par an soit environ 200 à 300 élèves à l’échelle
de l’ensemble du territoire byzantin156. Cet enseignement de la culture grecque est
donc réservé à une toute petite frange de la population, les enfants de l’élite ou des
protégés de hauts dignitaires. La restauration d’un enseignement universitaire par
Constantin VII a permit à cette élite de renforcer son emprise sur l’appareil d’Etat par
une formation supplémentaire en droit notamment. En effet, pour ceux qui nous
concernent, les juges, il était obligatoire d’avoir suivit de surcroit une formation
juridique afin de pouvoir postuler à un poste dans l’administration civile. Cette
formation ne devait être qu’essentiellement théorique157.
Le système d’enseignement ne semble pas avoir beaucoup évolué au XIe
siècle. L’enseignement moyen reste semble –t-il le même fondement de la culture de
base du byzantin éduqué. Seul un épisode de courte durée, mais fondamental en ce
qui nous concerne, bouleverse un peu le champ de la formation des juges. Il s’agit de
l’établissement par Constantin IX de l’école de Xiphilin et Psellos158. Il semble
d’après l’éloge de Psellos à Xiphilin que le Droit et la Rhétorique n’étaient que peu
enseignés. Les deux hommes possédaient autour d’eux un cercle d’élèves avides de
ces questions et animés de la volonté de faire carrière dans l’administration civile.
Xiphilin donnait des cours de droit et de rhétorique tandis que Psellos se réservait la
philosophie et enseignait également la rhétorique. Les titres de proèdre et de consul
des philosophes octroyé à Psellos sous entendent qu’il présidait l’école la plus
importante et prestigieuse de la capitale. Xiphilin quant à lui, portait le titre de
Nomophylax et était vraisemblablement responsable des examens de droit et de la
sélection des futurs fonctionnaires et juges. Cette réforme témoigne de la hausse du
niveau d’exigence de culture demandé à un administratif puisque l’école formait à la
fois au droit, à la rhétorique mais également à la philosophie. Les juges n’étaient
donc pas seulement des experts du droit, loin de là mais bien une partie de l’élite
intellectuelle de l’empire, des lettrés byzantins par excellence pour les meilleurs
d’entre eux. Pour ce qui est de l’enseignement juridique, il s’agit encore une fois d’un
enseignement théorique qui passe par l’apprentissage des notions juridiques, des
156 ibid., p.257 157 ibid., p.261 158 WOLSKA-CONUS, W., « Les écoles de Psellos et Xiphilin sous Constantin IX
Monomaque », Travaux et Mémoires, VI, Paris 1976, p.223-43
53
corpus de lois byzantines, fondé sur des traités juridiques ainsi que des interprétations
des lois rédigées par des juristes avertis159. Encore une fois, la notion d’apprentissage
pratique du métier d’administrateur semble être exclue de la formation comme le
sous-entend Psellos dans une lettre à Basile Malèses, juge des Arméniaques160. Ce
dernier s’étant plaint des difficultés de son métier face à la population locale reçoit de
Psellos une réponse: « Tout les débuts sont difficiles. Il faut quelques temps pour
montrer ce que vous valez et vous n’arriverez que beaucoup plus tard au maximum de
vos capacités. »161 Le caractère théorique de cet enseignement est certain. Il ne me
semble pas que l’enseignement supérieur byzantin permettait de préparer les étudiants
à la réalité par des cas pratiques. Cet enseignement est destiné à l’élite byzantine,
l’élite intellectuelle. Cette élite forme le cœur de l’administration162 et l’on peut
même dire qu’elle est aux affaires de l’empire byzantin du XIe siècle. La culture et la
connaissance y deviennent bien plus importante que le prestige familial ou la fortune
car elles peuvent apporter les deux. B. Laourdas donne d’ailleurs une sorte de portrait
type de l’intellectuel byzantin entrant dans le fonctionnariat163. Il s’agit généralement
d’un membre d’une famille riche, ayant toute les connaissance de langue nécessaire
pour apprécier et débattre sur les auteurs antiques qu’ils soient philosophes, historiens
ou poètes. Il connaît aussi assez bien les textes chrétiens afin de pouvoir participer
activement à la liturgie. L’apprentissage se poursuit en droit et philosophie. L’étudiant
est introduit au palais où il rencontre dignitaires, intellectuels et hauts fonctionnaires,
se créant ainsi un début de réseau. L’empereur était d’ailleurs le protecteur des
étudiants et les accueillait à ses banquets164. A noter également que le cercle d’étude
dans lequel il évolue constitue le cœur du réseau primitif de chaque aspirant-
fonctionnaire comprenant à la fois les maîtres et les camarades165. P. Agapitos met
notamment en avant le lien de communauté quasi-spirituelle entre l’élève et le
159 WOLSKA-CONUS, W., « les écoles de Droit et l’enseignement du droit à Byzance au XIe
s.: Xiphilin et Psellos », Travaux et Mémoires, VII, Paris, 1979, p. 2-103 160 KURTZ-DREXL, 96 dans DE VRIES – VAN DER VELDEN – GENDRE, p. 126-28 161 KURTZ-DREXL, 96, p.125, l.6-9 162 LAOURDAS, B. « Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine Society»,
Kléronomia 2, 1970, p.283-4 163 ibid., p.282-3 164 BROUSSELLE, I., Recherche sur les élites dirigeantes de l’Empire byzantin IXe-950,
Paris, 1986, p.133 165 AGAPITOS, P. A., « Teachers, pupils and imperial power in eleventh-century
Byzantium », TOO., Y. L., LIVINGSTONE, N. (eds.), Pedagogy and Power, Rhetorics of classical learning, Cambridge, 1998, p.179-80
54
professeur en utilisant des cas extrêmes comme celui de Mauropous et Psellos mais
cela semble également valable pour la relation que peut tisser Psellos avec ses propres
élèves même s’ils sont moins connus.
En plus de ce statut d’intellectuel, de lettré qui semble s’assimiler à la fonction
administrative qu’est celle de juge, on note également le caractère extrêmement
constantinopolitain de ces hommes. Comme le prouve H. Ahrweiler, le prisme
constantinopolitain n’est pas uniquement une maladie de byzantiniste mais également
la maladie qui frappe sans relâche l’élite byzantine du XIe siècle166. Les carrières, les
fortunes et les gloires se glanent à Constantinople. De même les institutions
éducatives et d’enseignement supérieur étaient concentrées dans la capitale
byzantine. Ainsi ce cercle d’étude constantinopolitain est en effet le lieu de naissance
du réseau de chacun et l’université le lieu où « se forgent les solidarités »167. Par leur
culture identique, leur architecture mentale similaire dues à leur éducation commune,
ces hommes, l’élite intellectuelle byzantine, nos juges, semblent former sur ce point
un groupe assez cohérent et homogène.
Conclusion
Malgré le peu d’information que nous avons extrait de ce corpus de lettres,
une première image de ce qu’est le juge byzantin dans son contexte social s’est
dessinée. Grec ou ethnikos intégré de longue date, il a suivit le cursus éducatif
byzantin de l’apprentissage de l’écriture à celui du droit et de la philosophie.
Généralement issu de grandes familles aristocratiques, il peut également faire
ascension depuis des milieux plus modestes par la démonstration de ses capacités
intellectuelles et la recherche de soutien de poids. Par le biais de ces études, il s’est
construit un réseau comprenant camarades, professeurs et soutiens extérieurs. Formé
théoriquement à la fonction de juge, il est renvoyé dans les thèmes où il rêve d’un
poste dans la capitale. Constantinopolitain de cœur, si ce n’est d’origine, il fait partie
de l’élite intellectuelle byzantine dont le centre névralgique se trouve à la cour
impériale, où se décide la marche du monde
166 AHRWEILER H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : nouvelles
hiérarchies et nouvelles solidarités », Travaux et Mémoire VI, 1976 p. 102 167 ibid., p.108
55
Conclusion de la première partie.
La justice byzantine, concrétisation de la loi impériale est un des piliers de
l’empire. Le système judiciaire qui assure cette mission n’est pas aux mains des juges
mais dirigé par l’administration et la chancellerie. De ce point de vue, la figure du
juge est assez difficile à trouver. L’étude du système judiciaire constantinopolitain
puis thématique donne deux visions différentes. L’une montre un système foisonnant
composé de dizaines de juges ou collèges de juges plus ou moins spécialisés sous la
direction d’un juge suprême, l’éparque puis le drongaire de la Veille, eux même en
référent directement à l’empereur. L’autre montre un système beaucoup plus
centralisé fondé sur le pouvoir d’un gouverneur-juge. Cette figure est d’autant plus
intéressante pour notre période puisque le gouverneur est alors un juge de formation.
Théoriquement donc, la judicature byzantine est une fonction à visages multiples et
aux concrétisations diverses.
Pour autant la réalité des sources et de nos correspondances nous impose l’étude d’un
juge unique, le juge de thème, le juge-gouverneur. Ses rapports avec nos épistoliers
semblent être de nature principalement professionnelle et administratif même si
quelques relations amicales transparaissent notamment avec des ecclésiastiques.
Quant aux hommes exerçant cette fonction, d’après notre étude principalement
onomastique, ils sont pour la majeur partie issus d’une élite intellectuelle
constantinopolitaine. Certains appartiennent à de grandes familles de fonctionnaires
civils comme Nicolas Sklèros, Serge Hexamilitès ou encore un Xèros quand d’autres
semblent être les premiers de leur famille à paraître dans l’histoire byzantine tel que
Psellos ou Lizix. Les moins connus laissent tout de même transparaitre une niveau
social très élevé par les fonctions et les dignités leurs ayant été attribuées.
Ce qui unit ces hommes, ces juges, au delà de la fonction et du niveau social, c’est
l’éducation et le cercle intellectuel dans lequel ils évoluent. Leur socle commun, la
culture grecque, la philosophie, la rhétorique, appris à Constantinople dans les cercles
d’études supérieurs, est ce qui fonde leur réseau. Ils l’entretiennent entre eux et avec
nos épistoliers dont certains sont leurs professeurs. Plus encore, ce socle commun est
ce qui détermine leur manière d’envisager le monde et l’autre. Cette vision et cette
56
mentalité spécifique de l’élite intellectuelle byzantine transparaissent surtout dans leur
manière d’aborder leur fonction de juge, donc dans la relation à nos épistoliers.
58
Deuxième partie : Le juge sous tutelle : Affaires, Recommandations, Pressions
Les rapports entre juges et épistoliers sont, en effet, au cœur de notre sujet. Ils
sont de plusieurs types. Professionnel d’abord, les épistoliers fournissant aux juges
une partie des affaires qu’ils ont à traiter dans le cadre de leurs prérogatives de juge-
gouverneur. Ils sont aussi sociaux dans les nombreuses recommandations et
recommandés que les épistoliers envoient aux juges de thème. Enfin ces rapports
semblent être de type assez hiérarchique plaçant les juges plus dans un rôle de
subordonné que d’égal, pion plutôt que joueur d’échec. Encore une fois, il nous faut
nous intéresser à la manière dont les juges abordent ces affaires, dont ils les traitent.
Le statut et le rôle des acteurs et des requérants, dans ces affaires, est aussi important
pour déterminer la place du juge par rapport aux épistoliers et à la société thématique
qui les entoure.
59
Chapitre 1 - L’épistolier, un pourvoyeur d’affaire
Parmi les premières missions du juge de thème, il y a évidemment la
résolution d’affaires judiciaires. Il nous faut donc déterminer les types d’affaires qui
lui sont donnés de traiter, la manière dont il les traite et la nature du lien existant entre
plaignant et magistrat. Le juge de thème, en tant que gouverneur doit également
veiller aux nombreuses actions entreprises dans le domaine fiscal et il nous faut alors
ici apprécier le statut des acteurs de ce genre de cas et la nature des demandes. Enfin,
force est de constater que le juge n’est jamais réellement seul dans le traitement de ces
affaires. Sur eux veillent continuellement leurs anciens professeurs.
Le cœur de la judicature : les affaires judiciaires
Bien que les juges soient membres à part entière de l’élite intellectuelle
byzantine, féru d’hellénisme, de poésie et de philosophie, leurs attributions les
conduisent à redescendre parmi leurs administrés afin de trouver des solutions à leurs
problèmes quotidiens et trancher les affaires judiciaires qui les opposent. Sur ce
champ d’étude, il est clair que la lettre limite nécessairement nos possibilités de
compréhension des tenants et aboutissants des cas présentés aux juges. À propos de
ces affaires, nous n’avons que ce que l’auteur veut bien nous en dire. De fait, il arrive
que l’épistolier précise que le porteur de la lettre s’exprimera en personne sur
l’affaire168. Pour certaines lettres, les affaires sont donc assez floues voire impossible
à classer tellement la quantité d’informations est limitée. De même, il nous est assez
difficile de savoir ce qu’il se passe après réception de la lettre. Nous ne savons
absolument pas ce que fait le juge, s’il lance une procédure d’enquête, s’il est
contraint de prendre en charge les affaires qui lui sont données ou bien s’il choisit
uniquement les plus importantes. Nous savons cependant qu’il n’y a aucune lettre
connue d’un épistolier critiquant ou disputant un juge pour le fait qu’il n’aurait pas
donné suite à une affaire qu’il lui aurait présenté. C’est d’autant plus marquant que les
épistoliers, et en particulier Michel Psellos, n’hésitent pas à réprimander les
168 SATHAS, 116, p.362-3
60
agissements des juges lorsque ceux ci ne sont pas à leur convenance169. Il semblerait
alors que les juges suivaient toutes les affaires qui leur étaient présentées. Il est
important de noter également qu’il n’y a vraisemblablement pas de différence entre la
manière de communiquer des affaires aux juges de thème ou aux juges de la capitale,
si ce n’est un peu plus de déférence pour certain d’entre eux notamment les
éparques170. Nous ne faisons donc aucune différence entre les affaires traitées à
Constantinople et celle traitées en province.
Il nous faut en premier lieu étudier les différents types d’affaires qui se
présentent aux juges afin de mieux comprendre à la fois le métier de juge mais
également la relation qui se tisse entre épistoliers et officiers de justice sur ce genre de
sujet. Nous ne manquons pas d’exemples pour illustrer ces affaires mais ils ne sont
pas tellement diversifiés. Pour ce qui est des délits classiques ou des crimes de sang
nous n’avons que quelques cas. Il est probable que pour ce genre de crime, les
épistoliers n’avaient pas besoin d’informer le juge de ce qu’il se passait dans sa
circonscription, ce dernier possédant une force de police sur le terrain capable de
l’informer de ce genre de trouble. De plus, il est à mon avis fort rare que les
épistoliers ou leur entourage soient concernés directement par ce genre d’affaires
sinon dans des cas extrêmes ou des situations troublées d’instabilité politique.
Théodore, métropolite de Nicée est le seul à nous fournir une lettre concernant une
affaire de meurtre ou du moins avec un cadavre171. Cette affaire met en jeu un parent
du métropolite, son fils adoptif Anastase172 qui s’est retrouvé dans les geôles de
l’éparque, au prétoire probablement, accusé avec un ivrogne173 de la mort d’un
individu à Constantinople174. Théodore de Nicée prend donc la plume pour écrire à
l’éparque et patrice Constantin. La défense pour son fils adoptif est fondée sur le fait
qu’Anastase aurait été trop faible pour porter secours au mort et ne pouvait rien faire
contre l’ivrogne, qui est vraisemblablement le responsable du cadavre. Il s’agit rien de
moins que d’une affaire sordide de sortie de taverne, un soir dans les ruelles de
Constantinople, au cours duquel un homme imprégné par l’alcool a tué un autre
169 SATHAS, 47, p.279-80 Lettre à un Xèros juge des Thracésiens, il se fait réprimander pour
avoir disgracié un notarios, protégé de Psellos. 170 THÉODORE DAPHNOPATÈS, 32, p.193, l.2 : « Τιµιώτατε καὶ ἅγιέ µου κῦρι […]» 171 DARROUZÈS – THÉODORE DE NICÉE, 38, p.303-5 172 ibid., p.304, l.1-3 173 ibid., l.16 « […] οἴνῳ µεθύοντί τινι[…]» 174 ibid., l.14« […] τῷ τετελευτηκότι[…]»
61
homme. Anastase présent sur place aurait été arrêté en même temps. Théodore de
Nicée se demande si son fils est passé aux aveux, ce qui indique qu’il subit en prison
un interrogatoire dont nous ne connaissons malheureusement pas la nature175. La
lettre se termine par une demande de miséricorde et de pardon ce qui montre la
position difficile du jeune Anastase, qui semble n’avoir droit à aucune visite si l’on en
juge par l’ignorance de Théodore sur le déroulement de la procédure. Quoiqu’il en
soit cette affaire nous mène dans les bas fond de Constantinople tant du pont de vue
de l’ivrognerie que du système judiciaire. Elle nous dessine en négatif une procédure
judiciaire avec arrestation sur les lieux du crime et interrogatoire en prison. Cela n’est
pas forcément surprenant mais plutôt rare. Le rôle de l’éparque dans cette affaire est
assez décisif puisqu’il a le sort d’Anastase entre ses mains, sa liberté comme sa mise
en accusation et semble diriger personnellement toute la mécanique judiciaire mise en
place. L’absence de mention du logothète du prétoire pourtant chargé de ce genre
d’affaire prouve bien qu’il n’est qu’un subordonné de l’éparque qui garde la haute
main sur la justice constantinopolitaine.
Deux autres affaires se déroulant en provinces concernent des violences mais dans le
cadre d’une opposition entre des propriétaires. L’une concerne une agression d’un
grand propriétaire par des villageois voisins176. Ils ont vraisemblablement tenté de le
lapider. Psellos demande à ce que le juge fasse justice177. La deuxième affaire est
sensiblement identique. Elle concerne la propriété du fils de Michel
Choirosphaktès 178 . Celui-ci s’est fait attaqué par un fermier voisin dans
l’escarmouche, un vieille homme, dépendant du propriétaire, est décédé. Le juge doit
donc en tirer les conséquences qui s’imposent179. Ces affaires provinciales nous
montrent une manière d’agir différente. Il est étonnant de constater que malgré la
gravité des fait, c’est Psellos qui informe le juge des affaires qui naissent dans son
thème. Le juge n’ouvre une procédure ici qu’en cas de demande. Cette dernière
n’étant pas formulée directement par les plaignants.
Les affaires suivantes nous conduisent dans des types de délits plus crapuleux
puisqu’il s’agit de deux vols. L’une d’entre elle se déroule à Constantinople. La lettre
est rédigée par un correspondant inconnu à destination du logothète du prétoire. Elle 175 ibid., l.23-26 176 KURTZ-DREXL 171, p. 194-5 177 ibid., p.195, l.8-12 178 KURTZ-DREXL 243, p. 293-4 179 ibid., p.294, l.15-19
62
est assez courte. L’homme s’insurge du fait que les murs de sa demeure aient été
percés et sa maison dévalisée pendant la nuit180. Le logothète du prétoire, adjoint de
l’éparque et responsable du maintien de l’ordre était vraisemblablement chargé en
premier lieu de ce type d’affaire. Si le mot n’est pas utilisé ici, il est clair que
l’homme demande la mise en place d’une procédure d’enquête puisqu’il demande à
ce que les coupables soient retrouvés sans émettre aucun soupçon précis. Il est
également remarquable qu’il s’agisse ici de la victime elle même qui porte plainte et
cela par écrit. Cela confirme la nécessité d’effectuer une demande précise aux hautes
autorités pour espérer obtenir réparation.
Notre deuxième cas nous montre un processus de dépôt de plainte plus complexe
encore. Un riche propriétaire du thème de l’Opsikion s’est fait voler des plants de
mûrier par un voisin181. L’accusation est grave, le mûrier ayant une valeur très
importante puisqu’il rentre dans le processus de fabrication de la soie étant le lieu
d’habitation et la nourriture du fameux bombyx mori. Afin de trouver le coupable,
l’homme ne fait semble –t-il pas appel au juge du thème pourtant responsable de ce
genre de cas mais il rédige deux lettres, l’une à Michel Psellos182 et l’autre à
l’empereur183 afin de récupérer son bien et d’obtenir réparation. Psellos rédige alors la
présente lettre afin d’entretenir le juge de l’Opsikion de ladite affaire. Il en est
officiellement chargé au nom de l’empereur qui souhaite être tenu informé184. Au delà
de l’affaire elle même, on note la manière assez intéressante qu’a le plaignant de faire
connaître son affaire. Il passe par son réseau constantinopolitain et Psellos afin de
lancer une procédure dans le thème de l’Opsikion. Peut être est-il résidant de
Constantinople mais cela n’explique pas pourquoi il ne s’adresse pas directement au
juge de thème. Cette pratique est cependant assez fréquente.
D’autres affaires de ce genre sont également présentées, tel qu’un cas de
contrebande soumit par Jean Mauropous185, mais une large partie d’entre elles
concernent des questions foncières et cadastrales. Il n’est à mon avis pas utile de
décrire les affaires dans leurs moindres détails mais il faut s’attacher à la manière dont
180 DARROUZÈS – DIVERS, 49, p.378 181 KURTZ-DREXL, 107, p.136, l.19-20 : « ἀφαιρεῖται γὰρ τὰς συκαµίνους αὐτοῦ καί τῶν προσηκόντων τοπίων ἀλλοτριοῖ. »
182ibid., l.22-23 183ibid., l.21 184 ibid., p.137, l.4-7 185 JEAN MAUROPOUS, 11, p.64-7, voir p.65, l.1-2 « […]κλεπτοτελωνήµασι καὶ ταῖς περὶ αὐτα κακουργίαις […] »
63
les juges les reçoivent et les traitent. De manière générale, pour toutes ces affaires, les
victimes ou personnes concernées au premier chef font appel à une personne
importante et influente, nos épistoliers, afin d’intercéder en leur faveur pour faire
avancer leur cas. Ensuite une lettre est directement envoyée au juge par la personne
influente parfois portée par le plaignant lui même. C’est le cas dans une lettre de
Théodore Daphnopatès adressée à l’éparque et concernant un certain Jean qui du fait
de ses enfants qui ont dilapidé la fortune familiale, s’est retrouvé endetté et incapable
de fournir l’argent nécessaire pour une œuvre impériale dont il était redevable186. La
lettre est ici un plaidoyer en faveur de la victime qui supporte seule le poids de sa
dette. Elle fait appel à la miséricorde du juge, défendant, au même instant son cas en
personne devant l’éparque187.
Une autre affaire nous montre encore une autre combinaison d’actions menant le juge
à ouvrir une enquête. Il s’agit d’une lettre de Michel Psellos à un juge des
Optimates188. Il évoque un ami de Constantinople189 qui lui aurait appris qu’un
homme était régulièrement embêté par des villageois du thème des Optimates. Psellos
demande donc au juge d’enquêter sur la question et de prendre des décisions contre
ces mauvaises gens. Ici nous avons donc un homme des Optimates qui a des
connaissances à Constantinople. Il a avertit un de ses amis de la capitale de son
problème. Ce dernier lié d’une manière ou d’une autre à Psellos l’en a avertit et ce
dernier s’est donc retourné vers le juge des Optimates. Il possible de considérer que le
premier homme était un dépendant du second, peut être même le superviseur d’une de
ses propriétés mais ce ne sont que des conjectures. L’ami constantinopolitain semble
ne pas être assez influent pour interpeller lui même le juge du thème. Quoiqu’il soit, il
est remarquable que les habitants des thèmes ne souhaite pas ou n’ont pas la
possibilité de s’adresser aux juges de thème directement. Ils semblent constamment
chercher le soutien de personnes influentes comme Psellos pour s’adresser à leur
place aux autorités. Cette manière de faire est également valable lorsque les affaires
ont déjà été traité par un tribunal. Il ne s’agit pas ici de tentative pour modifier un
jugement mais bien une procédure de réexamen. Nous en avons un cas issu du corpus
186 THÉODORE DAPHNOPATÈS, 32, p.192-5 187 ibid., p.193, l.3, « […] ὁ διατρέχων Ἰωάννης […]» 188 KURTZ-DREXL, 52, p.83-4 189 KURTZ-DREXL, 52, p.83, l.22
64
psellien. Dans une lettre au juge des Thracésiens190, Michel Psellos évoque le cas
d’un homme, anciennement notable, qui avait été tranché par un juge. Son affaire
avait pris une nouvelle tournure lorsque l’autre partie obtint un jugement de nature
tout à fait opposé et défavorable pour notre homme. L’affaire a été portée, peut être
par Psellos lui même auprès de l’empereur qui a désigné le juge des Thracésiens pour
réexaminer le cas191. Le juge, conseille Psellos, doit se rappeler de l’ancien statut de
notable de l’homme, comprendre le protéger.
Dans toutes ces affaires quelque soit leur type, ceux qui s’adressent aux juges
sont rarement les plaignants eux même. Seul un cas constantinopolitain nous le
montre et il s’agit peut être d’un notable capable de défendre son propre cas seul. La
majorité du temps, la victime ou le plaignant cherche d’abord un appui auprès d’un
ami ou une connaissance influente qui se charge alors de faire valoir ses droits. Les
difficultés intrinsèques de toute action judiciaire causée par la méconnaissance du
droit et du système ainsi qu’une sorte d’inaccessibilité du juge de thème au commun
des mortels ont, peut être, conduit à ce genre de comportement.
Le juge-gouverneur : Les Affaires fiscales
Les juges et particulièrement les juges de thème devaient traiter d’autres
affaires que celle concernant exclusivement la justice. En tant que gouverneurs de
thème, ils étaient aussi les garants de l’entrée des taxes et impôts dans les caisses de
l’État à la fois pour son fonctionnement central mais aussi pour la gestion locale. Il
n’est pas nécessaire de rappeler ici le lien qui unit justice et fiscalité dans l’Etat
byzantin192. La vision que nous avons de cette prérogative du juge de thème est
encore une fois assez partielle et faite de cas particuliers. Différents types de
problèmes concernant le fisc se présentent à nous. Il est intéressant de noter de prime
abord que la quasi-totalité des lettres concernant ce sujet date du XIe siècle.
L’importance du corpus du XIe siècle donne forcément une place plus importante en
quantité à ce type de cas mais il n’est pas exclure qu’il faille y voir une hausse de la
190 KURTZ-DREXL, 66, p.99-100 191 ibid., p.100, l.2-5 192 MAGDALINO, P. « Justice and Finance in the Byzantine State, ninth to twelfth
centuries », LAIOU, A. AND SIMON, D. (eds.), Law and Society in Byzantium, Washington, 1994, p.93-115
65
fréquence de ces affaires fiscales témoignant d’une plus grande flexibilité du fisc face
aux contribuables au XIe siècle.
Une large majorité de ces problèmes concernent des contribuables qui, pour
une raison qui reste inconnue, sont dans l’incapacité de payer l’impôt. Ils ne sont pour
la plupart pas nommés et sont vraisemblablement des protégés de Psellos de basse
extraction. Michel Psellos dans une lettre à un juge non identifié193 demande à ce
qu’il aide un homme. Cet individu est alors en règle avec le fisc mais il semble ruiné.
En effet, l’homme devait être une sorte de fermier-général pour le compte du fisc
mais il semble que ses co-contribuables aient refusés de payer l’impôt194. Nous
sommes ici à la limite entre l’affaire judiciaire et le problème fiscal. Du point de vue
fiscal, pour le juge il n’y aucun problème puisque les taxes ont été collectées mais
d’un point de vue judiciaire Psellos lui demande d’aider l’homme a recouvrer auprès
de ses voisins l’argent qu’il a du débourser jusqu'à la ruine. Il s’agit donc de faire
valoir les droits de cet homme qui a été en quelque sorte escroqué. Dans le même
temps, le règlement de ce genre de cas par le juge peut constituer une sorte d’exemple
pour la population de son thème afin de montrer que personne ne peut échapper à son
devoir fiscal.
Une autre affaire de ce type met en jeu une femme pieuse ayant fait construire un
couvent pour des moniales195 . Elle s’était trouvé un protecteur et mécène qui
envisageait de subventionner ladite institution en payant les taxes qui lui incombait.
Le moment venu, l’homme a refusé de réaliser sa promesse. Psellos enjoint donc le
juge de faire changer d’avis l’homme et de récupérer l’argent des taxes auprès de lui
sinon de le traduire devant sa cour de justice, a priori pour le chef d’accusation de
parjure, qui est un crime punit sévèrement196. Encore une fois, il s’agit d’un cas entre
fiscalité et affaire de justice, entre refus de payer l’impôt et escroquerie. Un troisième
cas, assez similaire, met en scène un usurier se retrouvant en difficulté financière du
fait que ses débiteurs refusent de payer leur dette. Psellos demande au juge de lancer
une procédure judiciaire dans l’optique de renflouer l’usurier et punir les mauvais
193 KURTZ-DREXE, 247, p. 297 194 ibid., l.12-15 195 SATHAS, 130, p.376 196 En toute logique, c’est une ablation de la langue qui est demandée en cas de parjure.
PATLAGEAN, E., « Byzance et le blason pénal du corps », Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982), Rome, 1984, p.409-10
66
payeurs197. Ce qui est intéressant dans ces trois cas, c’est le caractère anonyme des
trois individus et protégés de Psellos. Sans faire de surinterprétation, ces trois
personnes sont des autochtones, des habitants du thème. Le fait qu’ils soient
contraints de passer par un intermédiaire pour faire part de leurs problèmes financier
au juge du thème montre que l’accès au tribunaux ou aux services fiscaux du thème
n’est pas aisé même pour des personnes relativement fortunées198. Je ne dis pas qu’ils
ne sont passés que par l’intermédiaire de Psellos mais ils ont peut être fait part de
leurs problèmes aux services administratifs n’ayant pas donnés suite. Dans un
deuxième temps, utilisant leurs réseaux, ils ont obtenu que Psellos intervienne en leur
faveur. Ces trois affaires posent aussi la question des actions entreprises par le juge
pour régler ces cas. Il n’est pas fait explicitement mention d’action judiciaire mais de
règlement d’affaire. Le juge doit par son autorité faire plier les parties adverses sans
pour autant lancer d’action judiciaire officielle. Psellos joue ce rôle d’intermédiaire
dans le but de trouver des solutions sans lancer de lourdes procédures. En réalité, il lui
arrive de ne s’interroger que très succinctement sur le fond. Au juge des Katotika199,
il écrit qu’une femme de Mantinée a des problèmes fiscaux et qu’elle expliquera bien
mieux son problème que lui200. Psellos précise d’ailleurs qu’il aime à écrire à propos
des évènements et des gens simples201. Doutons cependant de la simplicité de la
jeune femme qui est capable d’obtenir l’intercession d’un proche conseiller de
l’empereur pour régler ses problèmes d’imposition.
Les épistoliers ne jouent pas, bien entendu, les intermédiaires uniquement
pour « les gens simples ». Ils sont très actifs afin de faciliter les affaires fiscales de
hauts dignitaires. Théodore de Nicée en est même à défendre son propre cas devant
l’éparque de Constantinople202. Il s’agit d’une affaire de bien immobilier ; une église
sur laquelle il doit payer un impôt avec d’autre contribuable un peu rétif. L’un d’entre
eux voulait s’attribuer les propriétés de l’église203 . Au delà de l’affaire c’est
l’intervention du métropolite de Nicée pour défendre son cas qui est intéressante. 197 KURTZ-DREXL, 120, p.145-6 198 L’un est, en effet, capable de payer l’impôt d’une communauté entière, la seconde a les
capacités financière pour fonder un couvent tandis que le dernier est un usurier donc un homme possédant une certaine richesse. 199 SATHAS, 116, p.362-3 200 ibid., l.20-24. Il est question plus précisément du monoprosôpon, c’est-à-dire à l’origine
une taxe concernant la paiement d’une monture pour l’armée thématique. 201 ibid., l.4-5 202 DARROUZÈS - THEODORE DE NICÉE, 12, p.280 203 ibid., l.8-11
67
Seul un autre cas, celui de Nicéphore Ouranos est un peu identique. Dans une lettre au
juge des Thracésiens, il se plaint délibérément de « la corde du mitatôn » qui
l’étrangle204. Comme le précise J. Darrouzès, il est assez « piquant » qu’un militaire
de si haut niveau se plaigne des réquisitions faites par l’armée205. Le mitatôn est, en
effet, l’obligation d’héberger des militaires de passage sur sa propriété. Il est très
probable qu’il ne s’agisse ici que de la forme monétisée de cet impôt dont ce plaint
Ouranos. Il demande donc au juge une exemption. Il n’y a rien de bien exceptionnel
mais cela démontre, s’il fallait encore le faire, le pouvoir important du juge en matière
de fiscalité puisqu’il a le droit d’accorder des exemptions, donc de priver l’Etat de
rentrées fiscales. Chez Psellos, on trouve de nombreuses lettres envoyées à des juges
afin d’arranger la fiscalité de certains métropolites. Dans la plupart des cas, il s’agit
d’un homme en vue souhaitant ne plus payer l’impôt dans le thème mais à
Constantinople. C’est le cas du métropolite d’Amoriôn. Psellos écrit au juge des
Anatoliques afin que celui-ci laisse le métropolite payer ses taxes là où il le
souhaite206. Encore une fois, le juge reçoit ce dossier par un intermédiaire mais
surtout Psellos semble vouloir rassurer le juge. Il lui précise qu’il ne s’agit pas d’une
volonté de payer moins de taxes, en particulier pour la taxe mentionnée, le
monoprôsopôn, une taxe pour la fourniture d’un cheval à l’administration207. Le
métropolite paiera autant en qualité comme en quantité208. Cela indique peut être
qu’auparavant le métropolite avait fait part lui même de sa volonté de payer ses
impôts à Constantinople mais en avait été empêché par le juge par crainte d’une fuite
de rentrées fiscales potentielles. Cela dit, il est assez normal pour un contribuable
possédant des propriétés à des endroits multiples de vouloir rassembler le paiement
des impôts en un seul endroit. C’est un cas qui se voit également chez les paysans
propriétaire de plusieurs terrains dans des villages différents209. La crainte d’évasion
fiscale qu’exprime Psellos, répétant peut être celle du juge, révèle de manière
probablement une réalité.
Il arrive également que les juges règlent les problèmes fiscaux, non plus des
dignitaires mais de leurs protégés. Dans une lettre adressée à un juge non identifié,
204 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 42, p.241-2 205 ibid., p.241, n.18 206 KURTZ-DREXL, 82, p. 112, l.1-2 207 OIKONOMIDÈS, N., Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe.), Paris, 1996, p. 104 208 KURTZ-DREXL, 82, p.111 l.25 ; p.112, l.6 209 KAPLAN, M., Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle, Paris, 1992, p.206-7
68
Psellos évoque le cas d’un certain Basile Melissenos210. Celui-ci a subit selon Psellos
un contrôle fiscal qui lui a imposé des impôts insupportables211. Il n’est pas dit si ce
contrôle était tout à fait juste ou non, là n’est d’ailleurs pas la question pour Psellos.
Quoiqu’il en soit, il fait arranger cela pour Basile. Le terme d’arrangement fiscal est
ici particulièrement approprié étant donné qu’il ne s’agit vraisemblablement pas d’un
problème ou d’une faute de l’administration. Le juge doit seulement modifier ce qui a
été décidé, par des principes objectifs de calculs fiscaux, sur la base d’arguments plus
que subjectifs. La présence du nom de Mélissenos est peut être censé produire un
effet sur le juge. D’autant qu’avec l’allégement du fardeau fiscal, Psellos précise que
Basile Mélissenos aura alors trouvé un maitre capable de défaire le destin. Le juge
peut donc y voir une forme de profit. Il obtiendrait alors un nouveau client dans son
réseau et peut être même un lien avec cette puissante famille.
L’arrangement fiscal n’est pas non plus une question réservée à une petite élite
mais concerne également des communautés entières, notamment villageoise. Dans
une lettre que Psellos rédige à l’intention d’un juge des Bucellaires après un passage
dans le village de Philadelphie212 . Il dit avoir évoqué avec les habitants le
comportement du juge. Ceux-ci lui demandent à ce qu’il agisse avec plus de
sympathie. Psellos ajoute qu’il faut parfois placer la gentillesse devant la seule
application stricte des lois213. Il n’est pas ici question de l’application de la loi en
son sens strict mais en réalité de fiscalité. Les habitants veulent probablement une
exemption fiscale. Quoiqu’il en soit s’il s’agit bien d’une affaire de dégrèvement,
cela montre bien les prérogatives fiscales du juge.
D’ailleurs dans une autre lettre Psellos insiste sur cette prérogative en remerciant un
juge pour l’aide qu’il a fournit à un fonctionnaire du fisc214. Il a dû donner les moyens
de son administration et son autorité sur les populations locales pour permettre une
collecte efficace d’une taxe particulière ou bien dans la résolution d’un problème
fiscal ponctuel.
Le juge ne se préoccupe cependant pas exclusivement de fiscalité pure mais
également de problèmes cadastraux ou de propriété. Les exemples sont très nombreux
mais deux cas sont particulièrement remarquables. Le premier voit Psellos intervenir 210 SATHAS, 75, p. 309-10 211 ibid., p.310, l.3-4 ; 6-7 212 SATHAS, 180, p.459-61 213 ibid., p.460, §3. 214 KURTZ-DREXL, 253, p.301
69
auprès d’un juge des Bucellaire pour une affaire cadastrale215. Le magistre Grégoire
veut une délimitation claire de ses terres d’avec celles du fisc. Si le juge s’occupe de
ce cas, il semble qu’il ne peut pas trancher lui même la question. Il doit en effet s’en
remettre à une décision ultérieure des services fiscaux centraux216. Psellos lui dit de
rappeler au magistre d’attendre la décision et une délimitation officielle patiemment.
Cela signifie donc bien que sur ces questions, le juge, chef de l’administration
thématique, ne peut trancher ce genre de question et reste dépendant de la chancellerie
de Constantinople sur ces affaires locales.
Dans notre deuxième cas, le juge subit des pressions de Psellos afin d’éviter la vente
de terres clasmatiques217 . Michel Psellos veut éviter cela car le monastère de
Morocharzanès, dont il protège le fondateur le vestès Michel, avait accaparé une
partie de ces terres pour subvenir à ses besoins218. Sans ces terres, il semble que le
monastère n’aurait pu continuer à fonctionner faute de moyen. Pour ce qui est des
terres non plus le juge semble ne pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Si l’on
se réfère au cas des ventes de terres clasmatiques de Chalcidique par l’épopte
Thomas dans la deuxième moitié du Xe siècle, il est clair qu’elles avaient été autorisé,
si ce n’est ordonné par les bureaux du fisc de Constantinople219. L’épopte n’était que
le gestionnaire de l’affaire pas le détenteur de l’autorité décisionnelle. Le juge devant
s’occuper de la vente des terres clasmatiques, occupées par le monastère de
Morocharzanès, suit vraisemblablement un ordre de la chancellerie impériale. La
lettre psellienne met donc en lumière un cas de pression d’un puissant, Psellos,
exercée sur un fonctionnaire de l’Etat byzantin afin qu’il ne suive pas les ordres de
missions lui ayant signifiés.
Si la majorité des affaires qui lui sont soumises par voie de poste sont bien
fiscales, c’est aussi dans ce type d’affaires que le juge a le moins d’autorité face à sa
hiérarchie et la chancellerie de Constantinople à qui il doit se soumettre. Cette liberté
limitée est encore réduite par des puissants qui tentent d’infléchir ses décisions. Si les
demandes sont bien plus précises et directes, la volonté qu’ont les épistoliers
d’arranger fiscalement leurs protégés ou les puissants qu’ils recommandent montre les
215 KURTZ-DREXL, 84, p.113 216 ibid., l.26-27 217 SATHAS, 99, p.342-3 218 ibid., p.342, l.6-13 219 LEMERLE P., GUILLOU A., SVORONOS N., PAPACHRYSSANTHOU D., Actes de Lavra.
Première partie, Des origines à 1204, Paris, 1970, n°2 et 3 p.91-7
70
difficultés voire les faiblesses du juge sur ces questions. Le nombre important de cas
signifie nécessairement que le juge concédait un certains nombres des avantages
fiscaux qui lui étaient demandés. Cette faiblesse au sujet de la fiscalité réside peut
être dans le fait qu’ils n’en étaient pas experts, étant spécialiste de droit mais il me
semble qu’il s’agit plutôt d’une faiblesse générale liée au rapport hiérarchique existant
entre les grands propriétaires et l’autorité, entre l’épistolier et le juge, pour ne pas dire
entre Psellos et ses anciens élèves.
Le juge, un ancien disciple sous tutelle
Ces affaires que traitent les juges de thème, c’est à dire à la fois de sérieux
problèmes judiciaires ou bien des arrangements fiscaux, semblent bien éloignées de
l’enseignement, fait de rhétorique, de philosophie et de droit, qu’ils ont reçu.
L’enseignement pratique des choses n’est que rarement au programme bien que le
droit ait été conçu jusqu’au Xe siècle comme une discipline manuelle, une matière
enseignée à l’intérieur des guildes qui l’utilisaient, comme les notaires. Le droit était
quelque chose d’un peu artisanal220. L’arrivée d’un jeune juge dans une première
affectation dans les thèmes est donc particulièrement ardue puisque celui-ci n’a que
peu d’expérience pratique de la direction des affaires. Le lien qui a pu se tisser avec le
professeur, le formateur, se révèle ici plutôt utile. L’ancien professeur des choses
théoriques devient alors le guide dans l’action pratique. Psellos, puisqu’il s’agit
essentiellement de lui, n’est pas avare en conseil sur les différents aspects du métier
de juge. Comme le montre la liste des différents élèves et correspondants du
professeur anonyme221, il semble tout à fait classique qu’un enseignant garde des
relations suivies avec ses élèves, en particulier les plus brillants, ceux qui ont atteint
de hautes fonctions. Le professeur anonyme cherche auprès d’eux quelques soutiens.
Psellos en tant que proèdre et consul des philosophes n’a pas vraiment besoin de
soutien de la part de ses anciens élèves, il est leur soutien. Cela s’explique par sa
position au palais et à Constantinople mais sa volonté de conseiller ses anciens élèves
vient de deux autres notions. Tout d’abord celle de l’enseignant car loin d’abandonner
220 WOLSKA-CONUS W., « Les écoles de Psellos et Xiphilin sous Constantin IX
Monomaque », Travaux et Mémoires, VI, Paris 1976, p.237 et 243 221 BROWNING, R., « The correspondence of a byzantine Scholar », Byzantion, 24, 1954,
p.438
71
ses charges de cours, Psellos est un enseignant à part entière. Il ne lui est pas connu
d’assistants ou d’exécutants222. Il a donc établit une réelle relation avec les futurs
juges et la conçoit à travers le prisme de l’enseignement. Il a de surcroit une
conception toute personnelle de sa tâche. Il considère, à l’inverse de la conception
artisanale du droit, que ce dernier fait partie de la philosophie car cette dernière est
sans limite. Le gouvernement des thèmes dans ses affaires les plus prosaïques en fait
également partie223. De ce point de vue, il est tout à fait logique que le consul des
philosophes puisse donner des conseils de « philosophie » à des juges en devenir.
Nous avions déjà évoqué cette position des juges quelques fois remis à leur
place d’élève par le maitre Psellos que ce soit par des allusions historiques ou bien
directement par des ordres plus directs. C’est le cas notamment dans une lettre dans
laquelle Psellos écrit clairement : « voici un ordre du maitre à son élève. »224 Dans le
même style assez autoritaire, Psellos réprimande à plusieurs reprises les juges comme
un enseignant le ferait avec de mauvais élèves. Dans une lettre à un juge des
Katôtika225, il critique le comportement général de son interlocuteur. Il se moque de
sa manière d’incarner la fonction de juge trop sur la défensive226. Il continue en lui
dictant la manière de faire son travail, c’est-à-dire en maintenant sa réputation tout en
faisant fortune227 . Pendant ce temps, Psellos travaille pour lui au Palais. Cette
critique, si elle est fondée, montre un juge qui a du mal à prendre son indépendance et
tend à attendre les conseils de son ancien maitre pour agir.
Dans le même temps, Psellos est tout à fait capable de critiquer des prises de
décisions d’un juge quand elles sont contraires à ses volontés. Dans ces lettres, il met
en avant un manque d’obéissance flagrant du juge. La lettre que Psellos rédige à
l’intention du juge des Thracésiens Xèros en est un exemple228. À la suite du refus du
juge d’accueillir un notarios présenté par Psellos, le consul des philosophes s’irrite du
comportement du juge trop rigide et sans gentillesse229. Il vise peut être le manque de
piété envers son ancien professeur. Peut être que Xèros par son appartenance familiale
222 WOLSKA-CONUS W., op.cit., p.233 223 ibid., p.327 224 GAUTIER, LETTRES, p.181, l.22-23 225 KURTZ-DREXL, 55, p.87-8 226 ibid., p.87, l.15-18 227 ibid., p.88, l.2-5 228 SATHAS, 47, p.279-80 229 ibid., p.279, l.3-7
72
pouvait également s’affranchir du soutien psellien et de fait se permettre de remettre
en question sa volonté.
Dans une optique plus juridique, il arrive que Psellos rappelle à l’ordre
certains juges afin de les inciter à mieux faire respecter les décisions prises. Il ne
s’agit plus d’investissement personnel de Psellos, seulement de respect du droit. Dans
une lettre au juge des Cibyrrhéotes, il évoque un conflit opposant l’évêque d’Aléa et
les villageois de Lysokraneia230 . Les villageois refusent d’accepter la décision
impériale qui a été prise à leur sujet parce qu’elle favorise les intérêts de l’évêché
d’Aléa231. Psellos rappelle au juge ses responsabilités et le pousse à montrer son
autorité en imposant les décisions prises. Il doit imposer la décision impériale aux
villageois malgré leur opposition 232 . Cette lettre évoque une des nombreuses
difficultés des juges de thème, celles connues face aux populations autochtones.
Psellos lui même avait fait face à des embarras identiques lorsqu’il était jeune et juge.
Dans une lettre qu’il adressait à un protoasékrètis, il se plaint de moniales d’un
monastère de Sakélinè qui le harcelaient afin d’obtenir une exemption fiscale sur un
terre agricole233. Il précise qu’elles hurlaient comme « les Perses, quand ils sont
victorieux, poussent des hurlement aigus comme des femmes »234. Psellos connaît
donc très bien le pouvoir de nuisance pour un juge des populations locales.
Un grand nombre de conseils de Psellos sont d’ailleurs consacrés à ce sujet des
rapports entre populations et autorité du juge. Dans la lettre que Michel Psellos rédige
à un ancien camarade, il le met explicitement en garde contre les agissements des
populations locales qui peuvent être assez nuisibles235. De même dans une autre
lettre, il place en fin de son développement un avertissement236. Il vise explicitement
une communauté placée sous l’autorité du juge, celle des habitants de Rodinos237. Ils
sont décrits comme totalement aveugles et dénués de raisons. Le juge ne peut donc
faire aucun compromis avec de tels gens.
230 SATHAS, 76, p.310-311 231 ibid., p.312, l. 5-6 232 ibid., l. 10-12 233 KURTZ-DREXL, 201, p.229-230 dans RIEDINGER, J.-C., « Quatre étapes de la vie de
Michel Psellos », REB 68, 2005, p.7 234 RIEDINGER, J.-C., ibid., p.7 235 KURTZ-DREXL, 11, p. 12-3 236 SATHAS, 189, p.480-3 237 SATHAS, 189, p.483
73
Si Psellos met en garde les différents juges de son réseau contre les
populations locales qui peuvent, semble-t-il, transformer une nomination à la tête d’un
thème en un vrai calvaire, il donne également des conseils aux juges sur la manière
dont ils doivent se comporter avec leurs administrés les moins récalcitrants. Psellos
dit en effet à un juge de l’Opsikion, devant mener des négociations avec les habitants
du village d’Atzikomè, que pour être un bon juge il y a une procédure à suivre238. Le
juge doit d’abord protéger ses administrés, c’est le fondement de son travail, sa tâche
première. Il doit également être un bon ami239. Le juge est le protecteur et ami des
justes, leur défenseur contre les pratiques injustes. Nous pouvons constater une
sérieuse différence entre la manière dont il faut se comporter avec la population
d’Atzikomè et avec celle de Rodinos. Psellos considère peut être qu’il y a des régions
et des localités connues pour être habitées par des populations difficiles et hostiles.
Ce genre de préjugé n’est pas inenvisageable quand on sait que les Paphlagoniens
était considérés comme les habitants les plus rustres de l’Empire240 et que certaines
régions sont connues pour leur agitation régulière contre la fiscalité comme
l’Hellade241. La manière dont Psellos définit les deux missions du bon juge est assez
intéressante. Il n’est fait mention ni de la justice, ni de la fiscalité qui sont les
prérogatives théorique du juge. Celle ci se résume pour Psellos à trois actions,
protéger, aimer et être aimé. Là est là différence entre le juge et le bon juge. Il doit
être une sorte de bon père de famille protecteur, ce que l’empereur est dans la
conception de l’Etat byzantin. A. Kazhdan242 démontre, en effet, la projection
mentale byzantine du noyau familial au niveau étatique et la place tout à fait
particulière de l’empereur qui est le Seigneur et Père des Byzantins243. Ainsi le juge,
qui est le représentant de l’empereur en province et qui possède une partie infime de
son pouvoir, reproduit peut être tout à fait inconsciemment cette figure paternelle dans
la communauté de ces administrés. C’est peut être dans ce sens qu’il faut interpréter le
conseil psellien.
238 KURTZ-DREXL, 99, p.127-8 239 ibid., p.127 l.26-p.128, fin. 240 JEAN MAUROPOUS, 11, p. 64-7 241 Par exemple, SATHAS, 33, p.268 242 KAZHDAN, A., « Small social groupings (microstructures) in byzantine society », JÖB
32/2, p.1-13 243 ibid., p. 9 et n.19
74
Dans une lettre adressée à un juge de l’Opsikion à propos d’un justiciable que Psellos
veut aider, il utilise une nouvelle fois cette notion de protection244. Il écrit que si son
protégé est en mauvaise posture dans le procès qu’il subit, il ne faut surtout pas que le
juge le laisse sans protection. Il ne faut surtout pas qu’il soit accablé à cause de sa
culpabilité. C’est le rôle du juge de faire en sorte que l’accusé « survive », de ne pas
le réduire à la pauvreté et l’abjection totale245. Lorsqu’il s’agit d’une affaire judiciaire
le juge doit toujours garder cette notion de protection dans ses pensées, au delà des
crimes et châtiments prononcés. Au dessus de l’application de la loi réside la volonté
de l’Etat et donc du juge de protéger ces concitoyens. Cela laisse aussi une idée de ce
qu’était la réalité de la justice byzantine pour les coupables ; À savoir des sentences
particulièrement sévères et ravageuses pour les vies de ces hommes, du moins
lorsqu’ils n’avaient pas d’influence ou de protection.
En plus de ses conseils comportementaux, Psellos donne également son avis
sur la gestion de l’administration thématique. Trois lettres sont particulièrement
intéressantes sur cette tendance. Dans la première lettre, à propos d’un notarios,
protégé par la magistrissa Dalassène, Psellos donne des conseils pour bien le
diriger246. Il utilise la métaphore du cheval et particulièrement celle de la course
hippique. Le juge est le conducteur sur son char tandis que le notarios est le
cheval247. Il n’est pas utile de préciser avec cette métaphore que la relation notarios-
juge ne peut être que très hiérarchisée. Cette lettre nous démontre également qu’en
plus de ses prérogatives judiciaires et fiscales, le juge doit être un meneur d’homme,
un chef d’administration. Ces qualités ne sont pas innées et contrastent avec la
formation très intellectuelle qu’ils ont reçue.
Les critiques peuvent également concerner le comportement des juges vis à vis d’un
fonctionnaire subalterne. Dans une lettre à un juge de l’Opsikion, Psellos s’insurge du
traitement qu’a eut à subir un notarios248 . Il critique les punitions infligées à
l’homme, d’autant qu’elles étaient, selon lui, sans fondement249. Ce genre d’actes
remet en cause à la fois les principes même de justice mais également le lien qui unit
244 KURTZ-DREXL, 258, p.305 245 ibid., l.20-23 246 SATHAS, 136, p.388-9 247 ibid., §2 248 KURTZ-DREXL, 142, p.169 249 ibid., l.15-17
75
le juge à Psellos250. Dans une autre lettre à Chasanès, juge de Macédoine, Psellos
donne également son avis sur les congés que doit donner le juge à des fonctionnaires
de son administration251. Il prend le partie d’un notarios dont l’épouse est gravement
malade252. Il décrit alors l’amour qui lie les deux individus comme s’il connaissait
particulièrement bien le couple et indique précisément le nombre de jours dont aurait
besoin ledit notarios253. Il est intéressant de constater à la fois l’impact que la gestion
de l’administration thématique par le juge peut avoir dans la relation avec l’épistolier
mais également la distance qui existe entre le juge et ses fonctionnaires subalternes
obligés de demander des congés par l’intermédiaire de Psellos.
Psellos se permet également dans une dernière lettre de donner clairement des
conseils pratiques à un juge254. Il lui recommande en effet la mise en place d’un
système de cheval de poste efficace pour améliorer les communications dans son
thème255. Est ce un conseil personnel du consul des philosophes, ou une nécessité
d’Etat que Psellos ne fait que transmettre ? Nous ne le savons pas mais cela nous
informe encore une fois sur la partie purement administrative et gestionnaire du
travail du juge. Psellos considère probablement qu’il est tout autant compétent dans ce
domaine, puisqu’il s’agit de philosophie.
Il est clair que le juge est toujours considéré par son ancien maitre comme un
élève ayant besoin de guide, de consignes et de conseils pour être un bon juge. Cette
volonté psellienne perpétuelle de donner son avis montre finalement une volonté de
garder sur les juges un certain contrôle si ce n’est administratif, au moins intellectuel ;
peut être afin de mieux pouvoir les utiliser si le besoin s’en fait sentir. Il ne faut
pourtant pas oublier qu’il est très probable qu’une large partie de ces conseils ont été
donnés à la suite de demande des juges eux mêmes peu préparé à la réalité du terrain.
Conclusion
Les juges de thème vis à vis des affaires qu’ils ont à traiter semblent très
dépendants des épistoliers et plus généralement de l’administration centrale. Les cas 250 ibid., l.17-19 ; l.25-26 251 SATHAS, 39, p.272 252ibid., l.2-4 253 ibid., l.10-13 254 SATHAS, 122, p.370 255 ibid., l.4-6 : « στήσουσι κόντουρα εἱς τὰς ἀλλαγάς τὰς πλησιαζούσας τῷ ἡµετέρῳ καὶ σῷ θέµατι.»
76
qu’ils doivent trancher leurs sont apportés sur un plateau par les épistoliers soit par le
biais de lettres seules soit par le biais d’hommes portant des lettres. Les juges
semblent quelques peu distants vis à vis de ce qui se passe dans leur thème que cela
soit sur un plan purement judiciaire ou sur un plan fiscal. Cette distance se renforce à
mon avis lorsque l’on regarde le statut des différents requérants qui appartiennent à la
partie supérieure de la société byzantine. De plus, il semble que sur le plan fiscal, il
n’est que peu de liberté, les décisions leur étant imposées par le fisc de
Constantinople. Enfin cette dépendance est réaffirmée dans la relation étudiant-
professeur que les juges continuent d’entretenir avec les épistoliers, du fait qu’ils
n’étaient pas vraiment préparés à affronter la réalité des choses dans leurs études
supérieures.
77
Chapitre 2 - L’impératif de l’édification d’un réseau : les Recommandations
La deuxième activité importante de nos juges de thème, qui transparait avec
force dans notre corpus, est de veiller sur un important réseau. Les épistoliers
abreuvent les juges de nombreuses recommandations. Celles-ci sont en premier lieu
professionnelles mais peuvent aussi être tout à fait informelles voire amicales.
L’importance du nombre de ces recommandations pose à la fois la question de
l’importance de la notion de réseau pour les juges et de l’efficacité de ces demandes.
Le juge, gestionnaire administratif : les recommandations professionnelles
Nos différents épistoliers fournissent aux juges une partie de leur travail en les
informant de certaines affaires mais ils leurs soumettent également de nombreuses
lettres de recommandation, notamment à propos de personnes susceptibles d’être
engagées dans l’administration thématique. Ce genre de recommandation
professionnelle n’est présent que dans le corpus psellien. Psellos est le seul épistolier
de notre corpus à avoir un ascendant hiérarchique professionnel aussi grand sur les
juges pour leur soumettre ce genre de recommandation.
Tout d’abord, il est nécessaire d’étudier les recommandés afin de mieux
comprendre ce que ces lettres peuvent nous apprendre sur la fonction de juge. Le
corpus comprend près de 34 lettres de recommandation professionnelle dont une
vingtaine concerne exclusivement les νοτάριος. Il n’est pas nécessaire de tous les
évoquer ici, les éléments biographiques donnés par les lettres sont quasiment
inexistants et nous interdisent toute interprétation. Leur nombre cependant nous
indique le poids de ce genre de fonction dans l’administration thématique. Une lettre
rédigée à l’intention d’un juge des Thracésiens nous éclaire sur la manière de
procéder de Psellos256. Il recommande un νοτάριος, un homme intelligent, plein de
ressources et capable de faire n’importe quel travail avec rapidité. Il est également un
employé loyal et de confiance257. Psellos précise que si le juge n’est pas du même
avis, ce dernier doit tout de même lui faire confiance et s’en remettre au jugement
psellien puisqu’ils entretiennent tout deux une relation amicale et de ce fait possèdent
256 KURTZ-DREXL, 153, p.76 257 ibid., p.76, l.13-18
78
en théorie donc la même vision des choses258. Dans une autre lettre au juge des
Katotika259, Psellos recommande un homme du thème au juge dans la même optique.
Il loue alors non pas ses qualités de travailleurs mais sa culture et son intérêt pour les
études classiques, ce qui pour un Athénien du XIe siècle est assez rare selon
Psellos260. Le consul des philosophes recommande donc des autochtones pour entrer
dans l’administration thématique. C’est également le cas pour un certain
Thrakèsios261. E. Limousin voit en cet homme le futur Jean Skylitzès qui portait
également ce nom262. W. Seibt a bien établit le lien entre Jean Skylitzès et Jean
Thrakèsios, drongaire de la Veille 263 mais l’identification entre notre notarios
Thrakèsios et le chroniqueur n’est à mon sens pas certaine, sans être toutefois à
exclure, puisqu’elle se fonde exclusivement sur une homonymie264. Quoiqu’il en soit
cet homme réside dans le thème des Thracésiens et cherche un travail pour subvenir à
ses besoins alors qu’il est sans protecteur265. Psellos ne précise pas vraiment la nature
de ses qualités ou de ses atouts sinon qu’il porte le même nom que celui du thème266.
La référence à cette homonymie est reprise dans une deuxième lettre267. Celui-ci a
refusé de suivre le précédent juge qui a été nommé à un autre poste et Psellos
demande au nouvel arrivant de le garder dans son administration268. En vérité, il est
précisé que le juge avait essayé d’emmener Thrakèsios, devenu son ami, avec lui mais
258 ibid., l.24-26 259 SATHAS, 20, p.258 260 ibid., l.1-4 261 KURTZ-DREXL, 248, p.298 262 LIMOUSIN, E., « L’entrée dans la carrière à Byzance au XIe siècle : Michel Psellos et Jean
Skylitzès », CASSARD, J.C., COATIVY, Y., GALLICÉ, A., LE PAGE, D., Le prince, l’argent, les hommes au Moyen-Âge, Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, 2008, p.73-75 et n. 35.
263 SEIBT, W., « Ioannes Skylitzes, Zur Person des Chronisten », JÖB, 25, 1976, p.81-5 264 Pour la défense de cette hypothèse, on note que les différents Thrakèsios présents dans la
Prosopography of the Byzantine World sont des paysans travaillant pour le compte de métoques d’Iviron ou alors un prêtre de Constantinople.
PBW, Georgios 170, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107174, [Consulté le 10 juin 2014] ; Ioannes 232, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/107403, [Consulté le 10 juin 2014] ; Nikolaos 123, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/108047, [Consulté le 10 juin 2014]
Il y a donc peu de Thrakèsios faisant une carrière civile à cette époque. L’identification avec un autre fonctionnaire nommé Thrakèsios n’est pas possible étant donné l’état de nos connaissances. Celle entre notre notarios et le chroniqueur n’est donc pas inenvisageable. 265 ibid., l.7-9 266 ibid., p.297, l.21-23, 267 KURTZ-DREXL, 254, p.301-2 notamment, p.302, l.2 268 ibid., p.302, l.9-10
79
avait échoué269. Ces lettres montrent bien le juge dans sa posture d’employeur se
chargeant de l’embauche des notarios dans l’administration du thème dans lequel il
est en fonction. Il les choisit en partie en fonction de leurs affinités intellectuelles. Il
les choisit surtout en fonction de leurs qualités professionnelle d’autant que les
capacités financières de l’administration thématique n’étaient pas illimitées et se
devait d’être efficace, comme le précise une lettre évoquant des restrictions
budgétaires décidées par l’empereur.270. Ces notarioi sont engagés non pour le servir
lui personnellement mais dans l’administration thématique. Lorsque le juge doit
quitter le thème, les composantes de l’administration thématique ne le suivent
évidement pas pour garder probablement une continuité administrative. Thrakèsios
est donc attacher au thème dans lequel il était engagé, ici plus pour des raisons
familiales qu’administratives vraisemblablement 271 . On peut donc percevoir un
empire byzantin divisé en administrations provinciales multiples entre lesquelles les
mutations et les transferts de fonctionnaires s’effectuent au gré des désirs des chefs
d’administration, quoique limités par les impératifs personnels de chacun. C’est donc
une administration thématique assez flexible et arrangeante semble-t-il.
L’importance du nombre de notarioi dans cette correspondance doit également nous
interroger sur la place de ce fonctionnaire dans l’administration thématique et ses
rapports avec le juge. À l’inverse de ce que semble avancer E. Limousin272 qui ne
voit pas bien quelles sont les prérogatives et missions de ce fonctionnaire, H. Saradi
indique précisément qu’il ne faut surtout pas confondre notarios et notaire273. Il
s’apparente plutôt à la fonction antique de ταχυγράφος, c’est à dire de secrétaire.
Dans un contexte administratif, ces fonctionnaires étaient chargés de la rédaction des
actes diplomatiques et des documents administratifs ou privés du juge. Ils sont la
cheville ouvrière de l’administration thématique d’où probablement le grand nombre
de recommandations les concernant. Le caractère très manuel de la tâche ne demande
pas nécessairement une éducation très importante mais il ne faut pas négliger le
caractère intellectuel de la rédaction des actes. Connaître le niveau d’éducation de ces
fonctionnaires subalternes est cependant assez difficile. Quoiqu’il en soit, ils restent
269 ibid., p.302, l.5 ; 7-8 270 KURTZ-DREXL, 109, p.138, l.10-14 271 KURTZ-DREXL, 254, p.302, l.7-8. Il est en réalité précisé qu’il aimait sa terre mais cela
induit très probablement un lien familial fort. 272 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p. 79 273 SARADI, H., Le notariat byzantin du IXe au XVe siècle, Athènes, 1991, p.70-4
80
tout à fait dépendants du juge sous lequel ils exercent. Il s’agit d’une dépendance
professionnelle mais également sociale. Dans une lettre Psellos annonce à un juge
qu’il vient de recevoir une lettre d’un notarios qui vient d’entrer à son service274.
Celui-ci remercie Psellos pour l’avoir introduit auprès du fonctionnaire et lui précise
qu’il a trouvé en lui un maitre qui a su être généreux et l’aider275. La notion de maitre
est à entendre tant au niveau professionnel que social et indique bien la création d’un
lien de clientèle entre le notarios et son juge.
Les notarioi semblent être les seuls à être directement sous la direction des juges de
thèmes. C’est probablement pour cette raison qu’ils sont les plus présents.
Les protonotarioi quant à eux ne dépendent pas vraiment du juge. Ils sont peu
nombreux. Le protonotarios est un fonctionnaire du fisc byzantin. Il est le
responsable de la fiscalité dans les thèmes et dépend directement du fisc de la
chancellerie constantinopolitaine276. Ils ne sont pas recommandés par Psellos pour
être embauché par les juges mais envoyé par le fisc dans les provinces. Une lettre de
Psellos au juge des Katôtika277 fait mention d’un protonotarios ayant eu le choix de
son thème d’affectation. Il se décida pour le thème de l’Hellade car le juge était un
ami de Psellos278. L’institution constantinopolitaine gérant les affectations de ces
fonctionnaires semble donc leur laisser le choix. Le recrutement de ces agents
administratifs ne dépend donc pas d’un recrutement local mais bien d’une
organisation centralisée par la chancellerie de Constantinople. La faiblesse du nombre
de protonotarios dans les lettres confirme un peu cette position ; les épistoliers
n’ayant pas besoin de les soutenir pour obtenir des postes en province. Les juges
reçoivent également de Psellos un certain nombre de recommandations pour les
agents du fisc subalternes. Cependant, comme pour le cas précédent, il ne s’agit pas
ici de lettre de recommandation dans le but d’obtenir une place dans l’administration
mais plutôt pour introduire les agents du fisc auprès des autorités thématiques et
obtenir une aide dans les tâches qui leurs sont assignées. Des fonctionnaires des
bureaux du fisc envoyés depuis Constantinople sont en effet évoqués279. Psellos ne
274 KURTZ-DREXL, 173, p.196 275 ibid., l.15 : « […]ὅτι τοιούτου δι’ ἐµοῦ δεσπότου ἠξίωται […]» ; l. 17-20 276 AHRWEILER, H., « Recherche sur l’administration de l’empire Byzantin aux IXe-XIe
siècles. », Bulletin de correspondance hellénique, 84, 1960, p.43 277 SATHAS, 34, p. 268-9 278 ibid., l.5-9 279 KURTZ-DREXL, 83, p.112 ; 252, p.300-1
81
cherche en aucun cas à convaincre le juge du bien fondé de la venue de ces agents
dans le thème. Cela démontre que le juge n’a finalement pas son accord à donner sur
cette question.
Une partie des fonctionnaires introduits auprès des juges sont des débutants et il est
censé les aider dans leurs premiers pas pour récolter les taxes. Le juge par sa
connaissance des autochtones et du terrain peut en théorie les aider et joue peut être
un rôle de tuteur280. Cela est d’autant plus vrai qu’il existe des lettres de remerciement
de Psellos aux juges à ce sujet.
Une lettre remercie un juge d’avoir aidé un agent du fisc à rassembler les impôts qu’il
était venu chercher281. Dans une autre lettre, il demande à un juge d’aider une
nouvelle fois un agent du fisc à collecter les taxes, le remerciant de ce qu’il avait déjà
fait282. Il semble donc assez logique que le juge n’ait qu’un droit de regard assez
limité sur la fiscalité dans son thème. Il doit aider les fonctionnaires et faire en sorte
qu’ils effectuent efficacement leur tâche mais il n’est pas fait mention d’un
quelconque recrutement ni d’un lien hiérarchique entre le juge et ces agents. Les
fonctionnaires du fisc apparaissant le plus souvent dans les lettres sont d’ailleurs
souvent des agents détachés des services centraux, les dioiketès, et les chrysotélès, de
simples collecteurs de taxes détachés dans les thèmes.
Certains individus sont quant à eux dénués de fonction préétablie et sont
recommandés par Psellos. Il s’agit pour la plupart de proches de l’épistolier. Dans
deux lettres à l’intention du juge du Drougoubitôn, Psellos cherche à introduire deux
hommes dans l’administration du thème. Dans la première283, il recommande un
proche parent. Celui ci doit d’abord passer chercher sa roga à Constantinople puis ira
rejoindre les services du juge pour être sous ses ordres et obtenir ses faveurs284. Il
n’est fait mention ici d’aucun type de fonction précise, Psellos évoquant seulement
la volonté d’obéir et de servir le juge. Dans la seconde lettre285, Psellos recommande
un autre homme qui n’est pas son parent mais qui ferait un excellent subordonné
selon lui286, sans pour autant nous indiquer dans quelle branche de l’administration
280 KURTZ-DREXL, 74, p.106 ; SATHAS, 38, p.272 ; 100, p.343 281 KURTZ-DREXL, 253, p.301 282 SATHAS, 21, p.258-9 283 KURTZ-DREXL, 90, p.119 284 ibid., l.4-9 285 KURTZ-DREXL, 91, p.119 286 ibid., l.17-23
82
thématique son excellence se démontrerait le mieux. Ces deux lettres nous montrent
qu’à la manière des candidatures spontanées actuelles, Psellos propose aux juges
d’éventuels subordonnés sans attribution précise. Pour le premier cas, il est possible
d’imaginer que pressé par un parent désireux d’avoir une charge, Psellos a cherché à
le placer auprès d’un juge ami. Peut être s’agit il également d’une volonté de Psellos
de faire entrer ces hommes non pas dans l’administration thématique mais au service
direct du juge. Peut être souhaite –t-il les introduire dans la suite du juge qui le
suivrait dans ces mutations futures.
Pour ce qui est de l’image des juges, ces lettres de recommandations
professionnelles nous éclairent sur la partie purement gestionnaire du chef de
l’administration thématique. Il doit se charger du recrutement du personnel
administratif de secrétariat. Il doit également aider les agents du fisc qui sont détachés
dans son thème, former les débutants, et leur assurer un cadre de travail productif. À
ce titre, il répond assez bien à la définition du Directeur des Ressources Humaines de
nos entreprises actuelles. Celui-ci doit comme le juge s’occuper du recrutement de
nouveaux personnels, les gérer durant leur travail, surveiller leurs compétences, leurs
faire suivre des formations si besoin et enfin les renvoyer éventuellement.
Les deux derniers exemples ajoutent à cette image, celle du meneur d’hommes avec
sa suite et ses fidèles subordonnés. Le juge n’est pas isolé dans son thème, assaillit par
des villageois rustres et agressifs. Il est à la tête de l’administration thématique et
semble bien plus occupé par son propre personnel que par les autochtones eux même.
De cela, découle peut être la distance existant entre habitants du thème et
administration thématique.
Le juge tourné vers son thème : les recommandations informelles
Michel Psellos, comme les autres épistoliers de notre corpus, recommande
également aux juges des personnes dans un but non-professionnel. C’est le cas le plus
fréquent dans ces lettres dites de recommandation. Les recommandés se divisent en
plusieurs groupes qu’il nous faut respectivement analyser afin de mieux connaître la
clientèle de nos épistoliers et les protégés-futurs de nos juges.
Un premier groupe se détache aisément, celui des faibles. Il ne forme pas
nécessairement un groupe homogène, la faiblesse ou la pauvreté pouvant se traduire
de manière trop diverse. Il peut s’agir par exemple de pauvreté économique. Psellos
83
décrit dans une lettre à un juge de l’Opsikion287 la situation d’un soldat de noble
naissance qui s’est retrouvé sans le sou après des blessures handicapantes288. Devant
trouver un moyen de subsister, il devient fermier et s’établit dans le thème289. Psellos
demande au juge de l’aider dans sa reconversion difficile290. La manière d’aider cet
homme n’est pas précisée mais il s’agit probablement d’une aide fiscale sinon
financière, à moins que le juge ne mette à disposition du fermier des hommes pour
lancer les premières semailles de son domaine. Quoiqu’il en soit, le juge doit le faire
prospérer, lui le soldat riche devenu pauvre291.
Une autre lettre nous montre le cas, identique, d’un individu dans une situation
précaire dont le juge devrait se charger292. Psellos lui précise que face à la pauvreté, il
doit être tel Herakles devant l’hydre de Lerne et cautériser la mauvaise fortune pour
éviter son retour293. Un dernier exemple de ce genre d’aide nous indique qu’il y avait
bien plus qu’une simple demande de protection mais bien une aide financière
sonnante et trébuchante. Il s’agit d’une lettre à Pothos, fils du drongaire et juge294.
Un homme déjà pauvre a été attaqué dans ses propriétés. Celles-ci ont été détruites295.
Psellos demande au juge de soutenir le pauvre homme par des cadeaux et en
rebâtissant la propriété296. Il précise que l’homme n’a pas besoin de luxe et que les
dettes se feront en petite monnaie et non en livres297. Il est donc assez clair dans cette
lettre que le juge doit prêter de l’argent, le sien ou celui de son administration pour
aider un homme dans le besoin. Il s’agit d’un soutien actif et non d’une simple
protection. Il serait logique que dans nos deux autres cas le soutien ait été tout aussi
actif. Ainsi le juge doit selon Psellos s’engager personnellement dans l’action
philanthropique. A noter qu’il ne lui a pas demandé dans la dernière lettre de lancer
une procédure judiciaire contre les pillards mais seulement de sortir l’homme de cette
situation. Jean Mauropous fait le même type de recommandation298. Il envoi un
287 KURTZ-DREXL, 119, P.145 288 ibid., l.13-14 289 ibid., l.15-17 290 ibid., l.17-21 291 ibid. l.19-20 : « ἐλέει ὡς εὐπορήσαντα µέν, πτωχεύσαντα δέ » 292 SATHAS, 201, p.494-5 293 ibid., p.495, l.3-7 294 KURTZ-DREXL, 257, p.304 295 ibid., l.17-20 296 ibid., l.21-22 297 ibid., l.23-25 : « αλλ᾽οὺ µνᾶς ουδὲ ταλάντα » 298 JEAN MAUROPOUS, 55, p. 158-9
84
homme à un juge. Cet homme enchaîne les échecs notamment sur le plan
économique. Mauropous demande au juge de lui donner refuge, afin de le protéger
contre d’éventuels créanciers peut être, et de faire œuvre de miséricorde, de le
remettre sur pied. L’argumentation n’est pas très développée et la recommandation
s’apparente plus ou moins à une obligation pour le juge. Psellos dit en effet qu’ayant
été lui même charitable avec un homme, le juge se doit de faire de même. Ici, il n’est
même plus question de dette mais de charité299.
A côté de ces individus se trouvant dans des situations financières délicates
mais possédant le soutien psellien comme issue de secours, se tiennent des personnes
issues de l’élite. L’aide, qui leur est accordée, est de nature assez différente. Dans une
lettre au juge de l’Opsikion300, Psellos charge le juge d’accueillir un de ses collègues,
juge de l’hippodrome301, qui suite à quelques échecs professionnels, s’installe dans
son thème. Il n’est pas ici question d’argent mais d’un accueil, le juge
constantinopolitain ne devant pas avoir de problème financier majeur. Le juge de
l’Opsikion doit faire en sorte que l’installation de l’individu se déroule sans
encombre, administrative ou peut être dû au voisinage. Il est possible qu’il doive
également l’introduire dans la haute société du thème pour qu’il se tisse un premier
réseau local. Dans une seconde lettre du même type, Psellos demande à un juge
d’accueillir un ami et client302. Elle n’aurait rien de particulier si le consul des
philosophes n’y demandait pas explicitement en plus à ce que la juge fasse en sorte
que les devoirs de cet individu avant qu’il ne quitte la capitale pour son thème aient
été accomplis303. Là encore, il est probable que le juge utilise les moyens de son
administration afin de faciliter la vie d’un individu unique sous prétexte qu’il est un
protégé de Psellos. Le juge doit organiser son départ, peut être même s’occupe –t-il
du transfert des biens de l’homme ou même de la logistique du voyage. Ce n’est peut
être qu’exagération mais la lettre suivante nous montre le contraire.
Cette lettre concerne les moines du monastère Ta Narsou. Au juge Nicolas Sklèros,
Psellos demande, en effet, explicitement à ce qu’il organise le voyage du bateau du
monastère afin que celui-ci évite les vents mauvais lors de la traversée de
299 ibid., l. 2-6, en particulier l.4-6 : « διὰ ταῦτα νῦν πάρεστί σοι, ναυαγὸς ἄλθιος ἐξ ἀτυχους ἐµπορίας καὶ δυσδαίµονος πλοῦ προσαποβαλὼν και το πλοὶον.» 300 KURTZ-DREXL, 100, p.128-9 301 ibid., p.128, l.10 302KURTZ-DREXL, 175, p.197-8 303 ibid., p.198, l.4-6
85
« l’Atlantique », donc de l’Egée304. Cela montre bien les diverses missions de
protection du moins d’organisation qui sont attribuées aux juges par l’épistolier. Ces
hommes et ces moines sont des protégés de Psellos. Les épistoliers utilisent donc leur
réseau auprès des juges de thème afin de prolonger leur rôle de protecteur dans les
provinces par le biais des juges.
S’occuper des moines n’est qu’une partie du travail du juge concernant le personnel
ecclésiastique, les épistoliers recommandent également des évêques.
Nous avons en effet plusieurs lettres s’adressant à des juges concernant une
aide qu’ils devaient mettre en œuvre pour servir les évêques. Nicolas Ier Mystikos
dans plusieurs lettres demande au juge des Thracésisens de seconder le métropolite de
Sardes qui rejoint son éparchie305. Il n’est rien demandé d’autre que de l’aider dans
tout ce qu’il entreprend dans l’intérêt de sa métropole306. Le juge doit donc travailler
en bonne intelligence avec lui. Le patriarche veut établir des relations de travail entre
le juge et le métropolite. Un exemple plus précis de ce que peut faire un juge pour un
métropolite peut se trouver dans une lettre de Psellos à un juge de l’Egée307. La
métropole de Cyzique vient de subir, en 1063, un tremblement de terre dévastateur308.
Psellos demande donc au juge d’utiliser des fonds publics à la fois pour restaurer la
métropole mais également pour effectuer de généreuses donations 309 voire
d’organiser la continuité de l’aumône pour les pauvres.
On remarque que ce genre de recommandation se fait également dans l’autre sens.
Psellos s’adresse notamment aux métropolites du thème des Arméniaques pour leur
demander de protéger et d’aider un juge, vraisemblablement Basile Malésès310. Ils
doivent le surveiller mais surtout l’aider dans l’entreprise ardue qui est la sienne à
l’instar du juge des Thracésiens devant aider le métropolite de Sardes.
Dans d’autres cas, Psellos, en particulier, cherche à établir des liens plus amicaux.
Dans une lettre au frère de Jean Mauropous, Juge des Cybbhiréotes, il introduit
l’évêque de Larissa311. Le juge n’a semble-t-il qu’une assez mauvaise opinion de cet
évêque et Psellos tente de le convaincre de faire confiance à ses mots et à son
304 SATHAS, 135, p.378-9 305 NICOLAS IER MYSTIKOS, 181, p. 510-3 306 ibid., p.510, l.2-4 307 SATHAS, 79, p.312-3 308 ibid., p.312 l.15-17 309 ibid., p.313, l. 6-8 310 DE VRIES – VAN DER VELDEN – GENDRE, p.111-4 311 KURTZ-DREXL, 47, p.78-80
86
jugements. Il lui dit en effet de « l’habiller » avec les mots de Psellos tel Achille en
son armure et de l’admirer312. Au delà de la comparaison tout à fait égocentrique du
consul des philosophes, on ne note aucune allusion à une quelconque mission ou
tâche attribuées au juge. Il s’agit seulement d’essayer d’entretenir de bonnes relations
entre ce juge de thème et l’évêque de Larissa. Cela était peut être nécessaire pour le
bon fonctionnement et la bonne harmonie de l’administration de la province, au sens
large.
D’autres lettres à propos d’amis ou de connaissances ont simplement pour but
de faire entrer en contact les gens et de leur faire passer d’agréables moments. Nous
avons par exemple le cas d’un musicien 313 ou d’un conteur 314 que Psellos
recommande à des juges en leur promettant qu’ils passeront des moments divin en
leur compagnie car les deux artistes sont particulièrement doués315.
Un moine est particulièrement représentatif de ce genre de recommandation amicale.
Psellos le recommande à plusieurs juges de thème dont le moine traverse les
circonscriptions316. Il s’agit d’un moine particulièrement bien éduqué et un très bon
ami de Psellos317 nommé Hèlias Krystalas. C’est une sorte de gyrovague errant entre
la Syrie, l’Asie Mineure, la Grèce et le Péloponnèse sans oublier Constantinople. Il se
fait payer par les juges en les divertissant avec de la musique, de la comédie, de la
poésie, et surtout avec des imitations318. J.N. Ljubaskij le compare aux moines
rabelaisiens319 quand Psellos précise qu’étant certes moine, il n’en restait pas moins
attaché au monde terrestre par ses entorses aux vertus monastique notamment celle de
la chasteté320.
Ces trois exemples nous font rentrer dans l’intimité des juges. Si les lettres concernant
Hèlias font la part belle à la description de ses frasques, elle nous invite également
dans les villas des juges lors de leurs soirées d’hiver. Durant celles-ci pour se divertir,
312 ibid., p.79, l.24-25 313 KURTZ-DREXL, 180, p.200-1 314 KURTZ-DREXL, 9, p.10-1 315 KURTZ-DREXL, 180, p.201, l.1-2 316 DENNIS G.T., « Elias the Monk, Friend of Psellos », Nesbitt J.W. (éd.), Byzantine
Authors, Literary Activities and Preoccupations, Leyden, 2003, p.44 317 ibid., p.44-45 318 ibid., p.45 319 LJUBARSKIJ, J., Michail Psell : Ličnost' i tvorčestvo. K istorii vizantijskogo
predgumanizma, Moscou, 1978, p.79 cité dans DENNIS G.T., « Elias the Monk, Friend of Psellos », op.cit., p.45 320ibid., Lettre 6 à un juge de thème, p.53
87
loin de Constantinople les juges, entourés de leur suite, accueillent artistes, musiciens,
comédiens recomposant dans leur thème une sorte de petite cour impériale à leur
niveau, en déboursant quelques livres d’or321.
Ce que nous révèle ce deuxième groupe de lettres sur un plan plus général,
c’est le rôle important du juge dans la société du thème qu’il gouverne au delà de son
rôle administratif. Il est, au côté de l’Église, un acteur de la philanthropie et de la
miséricorde vis à vis des pauvres ou des faibles. Il facilite les relations et les
installations de notables avec qui il fait société. Il est en relation avec les évêques et
métropolite dans son thème dans un but professionnel mais également amical. Le
juge est l’un des pivots de la société thématique.
La question de l’efficience de la recommandations
Il apparaît que les juges étaient constamment sous les feux des demandes de
nos épistoliers, que ce soit des recommandations amicales ou professionnelles.
L’étude du cas des notarioi pour obtenir une protection ou une place dans
l’administration montre une fréquence assez élevée de ce type de recommandations.
Nous ne connaissons que trop peu les datations de ces lettres de Psellos mais elles ont
été nécessairement produites durant la période d’activité du consul des philosophes,
donc plus ou moins entre 1040 et 1070. Sur trente années d’activités et d’influence
importante, nous avons une vingtaine de notarios recommandés, soit un peu moins
d’une recommandation par an en moyenne. Cela semble peu, mais Psellos concentre
ses recommandations sur quelques juges notamment ceux du thème des
Thracésiens322 mais plus généralement sur les juges d’Asie Mineure323. Le cas des
notarioi n’est qu’un exemple parmi d’autres, et si l’on ajoute les recommandations
plus personnelles ou les demandes de protection, alors il est clair que Psellos, en
particulier, inonde littéralement les juges de demandes, plusieurs fois par an324.
Psellos lui même reconnaît à plusieurs reprises que le nombre de faveurs et de
recommandations demandés est très important, assez pour que les juges ne puissent
321 ibid., Lettre 1 à un juge, p.47-48 notamment le dernier paragraphe 322 7 recommandations 323 13 recommandations 324 62 lettre de recommandations et 26 demandes de protection : 88 lettres
88
toutes les accepter325. La submersion des juges au moyen des demandes peut être, à
mon sens, aussi considérée comme une forme de pression en soit ; afin que les juges
n’oublient pas d’où ils viennent. Pour Psellos en tout cas, la raison de cette
considérable correspondance est la nécessité pour lui d’avoir un réseau de personnes
sur lesquelles s’appuyer pour augmenter sa propre influence à la cour ou auprès de
l’empereur. C’est probablement aussi pour permettre à ses anciens élèves de se
constituer eux même un réseau avec ces multiples personnes présentées par lui, être
donc plus influents eux même et espérer des évolutions de carrière favorables. Cette
notion de création de réseau est présente à de nombreuses reprises. Psellos
recommande par exemple un dioikétès et précise que lui et le juge auront une
collaboration très efficace et créeront ainsi un cercle vertueux qui ne fera que
s’agrandir326. Psellos considère d’ailleurs qu’un homme sans réseau est quasiment un
homme faible, sinon un homme mort. C’est probablement dans cette optique qu’il
écrit autant de lettres. Il le fait pour ses propres besoins mais aussi pour ses anciens
élèves, car le réseau est la clé de son succès donc du leurs327.
Il ne faut pas oublier cependant que les juges reçoivent aussi des demandes de leurs
nombreux autres correspondants. Jean Mauropous se plie aussi à cette pratique même
si elle cible dans son cas moins des juges que des ecclésiastiques328.
De ce fait, il est donc logique de se poser la question de l’efficacité de ces
lettres et de leurs mises en application par le juge.
Une des lettres de l’évêque d’Euchaïtes nous indique de prime abord que la
recommandation n’a aucun caractère injonctif. Cette lettre adressée à un juge
fraichement nommé, évoque un protégé du juge précédent329. Mauropous encourage
le juge à renouveler cette protection comme gage de continuité ou du moins comme
cadeau330. Cela démontre deux choses à la fois. En premier lieu, le caractère versatile
325 SATHAS, 133, p.379, l.1-3 ; KURTZ-DREXL, 137, p. 163, l.14-17 Les deux phrases assez
similaires mettent à la fois en avant l’ennui de Psellos lui même devant tant de requérants mais également la nécessité pour le juge de tous les accepter au nom de la φίλια. 326 KURTZ-DREXL, 167, p.192 327 AHRWEILER H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : nouvelles
hiérarchies et nouvelles solidarités », Travaux et Mémoire VI, 1976, p. 109 ; ANGOLD, M., « The Byzantine State on the Eve of the Battle of Mantzikert », Byzantinische Forschungen, 16, 1991, p. 29 328 JEAN MAUROPOUS, 32, p.120-1 ; 39, p.132-3 ; 55, p. 158-9 329 JEAN MAUROPOUS, 39, p. 132-3 330 ibid., p.133, l.7-8
89
sinon éphémère de ces recommandations mais aussi dans un second temps que les
juges subissent des pressions fondées sur les comportements de leurs prédécesseurs.
De même Psellos, dans une lettre au juge des Thracésiens, Xèros, nous donne un
exemple de la marge de manœuvre des juges331. Psellos est furieux après le juge car
celui-ci a disgracié un notarios protégé332. C’est en réalité bien plus qu’une disgrâce
puisqu’il fut arrêté pour détournement d’argent. Le juge s’est apparemment comporté
de manière brutale avec la famille de l’accusé. Psellos ne critique pas la
condamnation du notarios mais le comportement rude du juge puisqu’il dit que la
décision de Xèros était juste333. Cette lettre nous montre bien la limite de la protection
psellienne qui semble s’arrêter là où commence la loi. Seule la punition et les affres
des perquisitions sont critiquées par Psellos. Le juge conserve donc toute sa liberté vis
à vis de ce personnel même s’il s’expose à quelques réprimandes en cas de justice
trop expéditive. Avoir Psellos contre soi peut cependant s’avérer mauvais puisque le
juge ne bénéficierait plus de son influence. D’un point de vue théorique, le juge peut
disgracier et donc nécessairement refuser des recommandés. D’un point de vue
pratique, le juge doit faire des compromis entre son intransigeance dans sa manière de
rendre la justice concernant ces hommes protégés et sa volonté de conserver le soutien
psellien. Psellos, lui même soutient, en théorie, cette liberté des juges. Dans une lettre
à un juge, il lui demande d’observer un recommandé pour déceler chez lui la réalité
des choses334. Il doit en étudiant son visage savoir s’il s’agit d’un homme vertueux ou
d’un homme se prétendant vertueux mais ne l’étant pas335. En théorie, Psellos laisse
donc le choix au juge, la liberté de se déterminer à propos d’un potentiel subalterne.
Cependant Psellos est un homme, semble-t-il, de paradoxe puisque dans une lettre à
Nicolas Sklèros, juge de l’Egée, il met en balance son amitié avec le juge afin que ce
dernier, qui vient de refuser deux de ses recommandés, plie devant ses demandes336.
Si Psellos peut mettre en balance son amitié ou témoigner de sa colère envers un juge
c’est probablement à cause des cadeaux, sinon des pots-de-vin envoyé avec les lettres
aux juges. E. Limousin explique qu’il était fort probable que les juges recevaient en
guise de cadeau quelques rétributions afin de mieux faire accepter la
331 SATHAS, 47, p.279-80 332 ibid., p.279, l.1-3 333 ibid., l.10-13 334KURTZ-DREXL, 10, p.12 335ibid., l.9-11 336 KURTZ-DREXL, 128, p.151-2
90
recommandation337. Il est fait mention dans les lettres à plusieurs reprises de salaires
mais celui-ci n’est toujours que divin et jamais concret338. E. Limousin persiste en
suggérant que les cadeaux, loin d’être explicités dans les lettres, étaient seulement
apportés par les recommandés eux même339. Il est probable que cela se déroulait ainsi
mais cela ne présageait que peu de l’efficacité.
Nombre de juges témoignent de leurs agacements vis à vis de ces
recommandations intempestives. Ils se plaignent vraisemblablement de ces envois
réguliers de protégés pselliens. Psellos évoque ce type de critiques dans une réponse
qu’il fait à un juge des Bucellaires340. Ledit juge se plaint de devoir protéger un
homme sur qui des soupçons judiciaires se portent avec insistance341. L’épistolier
rétorque que le juge n’y perd rien au change puisque son nom n’est pas mentionné,
mais que le bénéficiaire y gagne beaucoup. Le juge devrait donc arrêter de se
plaindre, être plus miséricordieux et accepter en échange l’amitié de Psellos342. Cette
lettre montre bien que si le juge a bien le droit de se plaindre, il gagne aussi le droit à
se faire remettre en place par Psellos par l’argument de la miséricorde dû à tout ceux
qui sont « tombés dans les abysses »343.Le consul des philosophes contre même les
argumentation purement gestionnaires et économiques des juges. Il précise en effet,
qu’ils doivent accueillir de nouveaux protégés et les aider malgré les restrictions
économiques imposées par l’empereur344. Le juge est donc encore une fois un peu
bloqué entre sa mission de juge et les recommandations pressantes de Psellos qui
finissent souvent par s’imposer. De ce point de vu, les demandes et recommandations
ne peuvent donc qu’avoir une concrétisation.
Une lettre du même type nous montre, une nouvelle fois, l’impasse dans laquelle se
trouvent les juges. Psellos recommande un fonctionnaire du fisc de Constantinople à
un juge345. Encore une fois, le juge est hostile à recevoir l’agent du fisc car il sait que
celui-ci commet un certain nombre de fautes professionnelles. Il ne s’agit plus ici
d’un argument considérant le nombre de demande mais bien d’une argumentation de 337 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p.153 338 ibid. ; JEAN MAUROPOUS, 39, p.133, l ;12-14 ; KURTZ-DREXL, 119, p.145, l.20-21 :
« ύπὲρ οὗ καὶ παρ ᾽ ἡµῶν ἀποκείσεταί σοι χάρις καὶ παρα θεῷ µισθαποδοσία » 339 LIMOUSIN, E, op.cit. 340 KURTZ-DREXL, 92, p.120 341 ibid., l.19-21 342 ibid., l.27-29 343 ibid., l.22-23 : « έγώ δέ παραινέσαιµι άν σοι χεΐρα τώ έµπεπτωκοτι εις βόθρον ορέξαι » 344 KURTZ-DREXL, 109, p.138, l.11-14 345 KURTZ-DREXL, 252, p.300-1
91
fond sur les qualités professionnelles du personnage. La réponse de Psellos est assez
éloquente puisque l’épistolier incite, pour ne pas dire oblige, le juge à faire l’aveugle
devant des erreurs, que Psellos juge, mineure. Le juge qui a une argumentation
construite contre l’agent que Psellos lui envoie, se voit opposer une fin de non-
recevoir, voire une demande de silence face à des agissements troubles d’un agent du
fisc. Il ne semble avoir dans ce cas qu’une liberté très limitée. Autant la
recommandation est ici forcément concrétisée, autant la plainte du juge, elle, n’est
jamais prise en compte.
Dans un dernier cas, Psellos envoi un homme avec une lettre de recommandation. La
lettre est lapidaire. Elle peut se résumer ainsi : Si tu ignore cet homme, alors Psellos te
rayera sans procès de sa liste d’interlocuteurs346. Il s’agit ici d’une menace claire et à
peine voilée envers un juge et surtout envers sa carrière. Peut être Psellos sous entend-
il même qu’il fera en sorte de lui nuire mais ce n’est qu’une supputation. Le juge est
donc contraint d’accepter ce genre de recommandation quelque soit le recommandé,
sous peine de perdre le soutien de Psellos voire de l’avoir contre lui, ce qui est assez
problématique pour son avenir.
Plus généralement, on note que la pratique de la recommandation, et son
acceptation, est un phénomène laissé à l’appréciation et liberté du juge en théorie. En
tant que chef de son thème, il a une position tout à fait suffisante pour décider qui il
veut auprès de lui et dans son administration. Il s’agit bien de théorie. La thèse d’Eric
Limousin sur l’existence d’une corruption répétée auprès des juges n’est pas vaine,
cependant il me semble que dans ces quelques lettres de Psellos à ces juges un peu
plaintif, le trait le plus marquant c’est leur manque de liberté générale dans les choix
qui s’offrent théoriquement à eux. La liberté du juge est sans doute très minime pour
le cas des recommandations puisque Psellos rédige plusieurs lettres qui sont en fait
des fins de non-recevoir opposées malgré des arguments construits et acceptables. Ce
rejet psellien des refus des juges s’accompagne régulièrement de menace directe pour
les carrières de ces fonctionnaires. Le juge ne semble jamais en position de négocier
avec l’épistolier.
346 KURTZ-DREXL, 183, p.203, l.2-4 : « εἰ δὲ παρόψη καὶ ἀποπέµψη, εἴσοµαι µέν, ὡς µέχρι γλώττης τὰ υπεσχηµένα ἦν, οὐκέτι δὲ τοῦ λοιποῦ ἐνοχλήσω, ἀπό τῆς πρώτης πείρας ἠθετηµένος εὐθύς »
92
Conclusion
Ces recommandations, et le réseau qu’elles forment, lient d’autant plus les
juges de thèmes aux épistoliers. Ils leurs fournissent en effet une partie du personnel
de leur administration comme les notarioi et semblent faciliter leurs rapports avec les
fonctionnaires du fisc ne dépendant pas du juge. Sur un plan informel, les épistoliers
cimentent la relation entre le juge et son thème par la demande d’actions
philanthropiques mais aussi par la création de lien avec le système ecclésiastique
parallèle. La dépendance des juges vis à vis des épistoliers est forte. Ils protègent les
clients de ces derniers. Quant à l’efficacité de ces recommandations, elle semble être
élevée sinon totale. Les juges, n’ont semble-t-il, aucune marge de manœuvre s’ils ne
veulent pas risquer de perdre le soutien de l’épistolier leur protecteur. Il est un maillon
de leur réseau, un pion sur leur échiquier.
93
Chapitre 3 - Le juge, pion sur l’échiquier des « épistoliers »
Si le juge est utilisé comme relais de l’influence de l’élite constantinopolitaine
dans les provinces, comme prolongement de son réseau, il est surtout utilisé à des fins
purement personnelles, économiques, fiscales si ce n’est politiques. La question de la
liberté des juges dans leur champ d’action privilégié, le thème mais aussi et surtout le
domaine judiciaire, nécessite d’être posée pour déterminer le statut réel des juges dans
la société byzantine et expliquer leurs comportements.
Le juge, protecteur des intérêts de son maître
Les juges et en particulier les juges de thème sont abreuvés de demandes et
d’informations diverses. Jusque là, en tant que premières autorités de leurs provinces,
il n’y a rien de plus normal qu’ils aient été le carrefour de toutes les demandes et
informations concernant leur thème. Il ne faut cependant pas voir les épistoliers
comme des êtres totalement désintéressés ne tirant aucun profit des recommandations
qu’ils font. Ils sont des intermédiaires et des constructeurs de réseaux mais ils utilisent
directement les canaux de communication qu’ils ont auprès des juges pour régler leurs
propres affaires. Le cas de Psellos est exemplaire en la matière. Profitant de son
ascendant à la fois professionnel et intellectuel, il utilise le juge à son profit. Les
lettres qu’il rédige à l’intention des juges sont d’ailleurs les rares sources nous
permettant d’étudier sa fortune et ses biens immobiliers. Il n’est pas question ici de
tracer l’évolution de la fortune et des biens de Psellos mais il est nécessaire de
rappeler que sa fortune est relativement importante notamment en Asie Mineure347.
J.-Cl. Cheynet démontre que le gros de la fortune psellienne était constitué de
donations viagères et de rentes. Une partie de ses rentes proviennent de monastères
dont il est le charisticaire ou l’éphore, ce qui semble en revenir au même348. Il tire des
bénéfices de ses monastères. Pour les augmenter, il cherche donc à ce que ces
établissements jouissent de la situation la plus favorable qui soit dans leur thème
347 CHEYNET, J.-C., « L’Asie Mineure d’après la correspondance de Psellos »,
Byzantinischen Forschungen 25, 1999, p.236 348 AHRWEILER H., « Charisticariat et autres formes d'attribution de fondations pieuses aux
Xe-XIe siècles », Zbornik radova Vizantološkog Instituta 10, 1967, p. 3
94
d’implantation. C’est dans ce cadre qu’il communique avec les juges sur ses intérêts
personnels.
Certaines lettres ne sont que des annonces de prises de possession d’un bien. Lorsque
Psellos reçoit le monastère de Megala Kellia sur le Mont Olympe de Bythinie, il
rédige une lettre au juge du thème, celui de l’Opsikion, pour lui signifier qu’il en
prend possession349. Il lui est donné en charisticariat après être passé entre plusieurs
autres mains350. Ce type de lettre n’est pas du tout exceptionnel mais bien une
pratique courante. Il est probable que chaque propriétaire ait fait de même comme s’il
s’agissait d’une formalité administrative. Lorsque Psellos cède le charisticariat de
Médikon à Anastase Lizix, il en avertit l’empereur qui le lui avait concédé351. Lizix se
chargeait alors de prévenir ensuite le juge de thème de sa prise de possession.
Une fois les annonces de prises de possessions faites, Psellos se fait un peu plus
pressant auprès des juges pour obtenir d’eux quelques avantages. Une lettre à Pothos,
juge de l’Opsikion est tout à fait révélatrice. Psellos se réjouit de la nouvel affectation
de Pothos qui une fois devenu juge de l’Opsikion pourra s’occuper personnellement
de son régime fiscal352. À de multiples reprises, il demande aux juges de protéger son
patrimoine contre des problèmes éventuels notamment des voisins un peu trop
expansionnistes. Le juge Nicolas Sklèros de l’Egée reçoit un grand nombre de
demandes pselliennes, une large part du patrimoine de Psellos se trouvant dans son
thème. Plusieurs lettres concernent le monastère Ta Narsou, que le consul des
philosophes tient en éphorie, c’est à dire en gestion économique353, et qui se situe à
Constantinople 354 . Dans une de ces lettres, Psellos précise que les terres du
monastère, situées a priori dans son thème, sont nombreuses mais pauvres. De plus,
elles subissent des attaques répétées355.Psellos demande donc au juge Sklèros de
donner une aide effective à ce monastère356. Psellos ne précise pas vraiment ce que
doit être cette aide effective. Peut être s’agit-il d’accroitre la sécurité des terres, à
349 KURTZ-DREXL, 273, p.318 350 Ahrweiler H., op.cit., p. 25 351 ibid. ; KURTZ-DREXL, 202, p.230-1 352 KURTZ-DREXL, 38, p.62, l.23-26 353 AHRWEILER H., op.cit., p. 25 ; Pour plus de précisions voir GAUTIER, P., “Précisions
historiques sur le monastère de Ta Narsou”, REB, 34, 1976, p.101–10. 354 JANIN, R., La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, Paris, 1953, p.373 355 KURTZ-DREXL, 127, p.150-1 356 KURTZ-DREXL, 126, p.150
95
moins qu’il ne s’agisse d’une aide financière. En tout cas, le juge doit fournir une aide
qui n’est pas nécessairement prévue dans ses prérogatives.
Dans une lettre concernant un autre de ses charisticariat, l’Acheiropoietos, Psellos
renouvelle cet appel à l’aide357. Dans celle ci, Psellos utilise une argumentation
imparable qui met en avant l’aide que fournit Nicolas Sklèros non pas à Psellos lui
même qui n’est que son ami, mais bien à la Théotokos et aux martyrs honorés par le
monastère358. Par cette aide le juge, selon Psellos, s’assure de leur soutien359. Ce
besoin d’utiliser l’intercession de la mère de Dieu et des martyrs pour appuyer sa
demande indique peut être que celle-ci n’est en elle même pas très régulière.
D’ailleurs, il ne s’agit là de rien de particulièrement extravagant si l’on compare cette
demande à une troisième qu’il fait au même juge. Il s’agit cette fois-ci d’une demande
de prise en charge d’un voyage en bateau pour des moines360 . Il s’agit plus
précisément que le juge fasse en sorte que la traversée dudit bateau se déroule sans
encombre, notamment d’un point de vu météorologique. Peut être s’agit il d’une
métaphore représentant les ennuis fiscaux qui accompagnent tout voyage de
marchandises par la mer. Que cela soit dans un sens métaphorique ou littéral, ce n’est
absolument pas dans les attributions du juge du s’occuper du commerce ou de
l’approvisionnement d’un monastère de Constantinople.
De même dans un autre cas, Psellos utilise un juge comme protecteur des terres des
enfants de Théodore Alopôs, dont il est lui même censé être le protecteur361. Le juge
doit protéger les protégés. Psellos se décharge un peu de son fardeau au profit du juge
qui doit veiller à la fois sur les enfants à Rhodes362, mais également sur les propriétés
en les faisant prospérer363. Le juge devient à la fois administrateur de biens et tuteur
d’enfants protégés pour le compte de Psellos mais avec les ressources du thème.
Il ne faut cependant pas sur-interpréter. Il semble que bien des fois, Psellos utilise son
accès aux juges pour régler de vrais problèmes notamment ceux avec ses voisins,
comme n’importe quel autre propriétaire. C’est le cas pour une terre du monastère de
357 KURTZ-DREXL, 124, p. 148-9 358 ibid., p. 148, l. 8-10 359 ibid., l.18-20 360 SATHAS, 135, p.379 361 KURTZ-DREXL, 50, p.82-3 362 ibid., p.82, l.15 363 ibid., p.82, l.21-fin
96
l’Acheiropoiètos de Constantinople que Psellos détient en charisticariat364. Il semble
que le cours d’eau qui passait par les terres dudit monastère, en Thrace, a été détourné
par des villageois. Le manque sinon l’absence d’eau lèse évidemment les terres mais
également les trois moulins du monastères qui, de fait, ne fonctionnent plus. Psellos
demande, tout à fait légitimement, à Pothos, juge de Thrace et Macédoine de s’en
occuper. Il s’agit là d’une demande tout à fait logique et Psellos aurait eu tort de se
priver de l’aide de son ancien élève.
En dehors de la protection des intérêts matériels de Psellos, le juge doit
également jouer un rôle dans la concrétisation de ses volontés politiques voire
personnelles.
D’un point de vu politique, certaines lettres montrent des juges utilisés pour interférer
dans une désignation d’évêque. Dans une lettre à un juge des Thracésiens, Psellos
évoque un clerc impérial qui voyage en direction du thème avec la ferme intention
d’obtenir le poste d’évêque de Paiona365. Celui-ci veut obtenir l’approbation du juge
et Psellos lui demande de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire balancer le
choix du nouvel évêque en la faveur de son poulain366. Psellos fait également la
communication politique de l’aspirant-évêque et dénigre les autres candidats. Il
demande au juge de ne pas y faire attention même si la rumeur les annonce comme
plus compétents367 . Le juge doit donc selon la demande de Psellos participer
activement à une campagne politique ayant pour but de placer un protégé du consul
des philosophes à la tête d’un évêché. L’utilisation d’une argumentation plaçant
l’amitié comme ce qui doit être le moteur de l’action du juge ne cache pas les vraies
motivations de l’épistolier qui entre, lui même, dans l’arène politique368. Il n’y a
aucun étonnement à avoir cependant. Il est normal que Psellos cherche à placer ses
protégés à des postes importants comme celui d’évêque. Celui-ci une fois élu lui sera
totalement redevable et se pliera à toutes ses demandes. Ce qui est également
intéressant, c’est la place que le juge a dans ce choix. Son soutien semble compter
pour le choix d’un évêque.
364 KURTZ-DREXL, 251, p.299-300 ; AHRWEILER H., op.cit., p.24 365 KURTZ-DREXL, 130, p.153 366 ibid., l.8-11 367 ibid., l.13-15 368 Une deuxième lettre est assez similaire et concerne un évêque de Larissa, ami proche de
Psellos, souhaitant récupérer son siège avec l’aide du juge des Katôtika ; KURTZ-DREXL, 69, p.103
97
Sur un plan personnel, Psellos utilise également les juges pour concrétiser ses
volontés. Parfois, il s’agit de favoriser un certain Moïse, higoumène d’un monastère
dont Psellos est l’éphore, l’un de ses plus proches amis369. L’exemple de la protection
des enfants de Théodore Alopôs est aussi remarquable de ce point de vue puisque le
père avait confié la protection de sa fortune à Psellos et ce dernier s’en décharge
finalement totalement sur le juge. Cela va dans le sens d’un autre cas mais dans un
sens encore plus personnel. Il demande au juge de l’Egée, Nicolas Sklèros d’accorder
des avantages aux administrateurs d’une propriété à Homonoia appartenant à Anne
Radénè370. Celle-ci était une connaissance constantinopolitaine de Psellos. L’accord
de ces faveurs par le juge permettra à Psellos de se rapprocher d’elle. Il tient à
préciser qu’il n’y a aucun caractère amoureux dans cette démarche371 ; justification
qui trahit peut être une tentative de séduction de Psellos, sinon pourquoi le justifier.
Quoiqu’il en soit, qu’il s’agisse d’un rapprochement amical ou amoureux Psellos
utilise clairement le juge pour tirer des profits relationnels auprès d’une amie. Le cas
est unique mais montre bien la position du juge comme marionnette de Psellos.
Nous ne sommes plus ici dans l’existence d’un simple réseau dans lequel les
juges s’insèreraient mais bien sur un échiquier. Psellos est l’un des joueurs et les
juges sont les pions destinés à être déplacés, utilisés, voire sacrifiés pour assouvir les
désirs économiques, politiques ou personnels du consul des philosophes. La liberté
du juge semble ici toute relative.
La liberté du juge continuellement remise en doute
Le juge comme pion de Psellos, est une facette de la fonction qui se réaffirme
lorsque l’on étudie les critiques et rappels à l’ordre parfois secs que les épistoliers font
à leur encontre. Les rappels à l’ordre concernent tout aussi bien des affaires
personnelles des épistoliers comme les affaires concernant des tiers. Psellos cependant
s’énerve un peu plus souvent pour des affaires qui le concernent.
Ainsi dans plusieurs lettres, il met en garde des juges à propos de ce qui leur est
interdit de faire. Dans une lettre à l’intention d’un juge de l’Opsikion à propos du
monastère de Megala Kellia, Psellos rappelle que son institution bénéficie d’une
369 KURTZ-DREXL, 227, p.270-1 370 KURTZ-DREXL, 60, p.92-93 371 ibid., p.93, l.24-25 « οὐχ ἵνα ἐρωτικός ταύτῃ ὀφθείην, ἀλλά φιλότιµος ἄνευ ἔρωτος »
98
exemption totale372. Le juge n’a donc rien à faire sur ses terres. C’est une mise en
garde. Il sous entend au juge qu’il doit rester éloigné de ses propriétés. Il n’est
cependant fait mention d’aucun acte impérial ou d’acte du bureau du fisc justifiant de
cette exemption. Le juge doit donc croire Psellos sur parole alors que ce dernier
l’enjoint de cesser tout trouble au monastère 373 . Il précise d’ailleurs que son
prédécesseur en tant que charisticaire n’avait lui jamais été embêté par les collecteurs
de taxe374. Dans une seconde lettre au juge du même thème, Psellos rappelle toutes
ses propriétés375. En fin de lettre, il demande au juge de bien protéger ses propriétés
mais surtout de ne pas leur imposer de taxe376. La protection est elle envisagée contre
les propres agents du fisc sous le contrôle du juge ? La mention de l’amitié avec
l’empereur est elle une manière pour Psellos d’éviter d’être taxé à moindre cout ?
C’est assez probable. Le juge doit accorder toute sa confiance aux déclarations de
Psellos qui ne justifie en rien de toutes ses assertions.
À coté de ces demandes plutôt courtoises, il y a des sollicitations un peu plus
directes. Un certain nombre de lettres concernent directement l’action de membres de
l’administration du juge, notamment des dioiketai et des taxeotai. Les deux fonctions
sont chargées de la collecte de l’impôt, les premiers semblent être des réels agents du
fisc tandis que les seconds font aussi office de force de l’ordre377. C’est le cas
notamment dans des lettres rédigées pour le juge de l’Opsikion378. Psellos y prit
Zoma, juge de l’Opsikion d’éloigner les collecteur de taxe de son domaine. Le ton est
assez plaintif et suppose donc des exactions ou des troubles possible379. Il est clair
que les agents du fisc travaillaient avec ardeur et parfois avec un peu trop de zèle,
cependant, il n’est pas fait ici référence par Psellos d’actions particulièrement
présomptueuses, ce n’est semble-t-il qu’un avis général. Le juge ne doit même pas
esquisser l’idée d’obtenir quelque impôt que ce soit sur les terres de Psellos.
Dans d’autre cas, Psellos, d’ailleurs rappelle aux juges qu’ils n’ont rien à faire sur ses
propriétés. Une lettre adressée à un juge de l’Opsikion rappelle que les propriétés
372 KURTZ-DREXL, 108, p.137 373 ibid., l. 9-13 374 ibid., l.19-21 375 KURTZ-DREXL, 200, p.227-229, en particulier, p.229, l.5-8 376 ibid., l. 12-13 377 OIKONOMIDÈS, N., Fiscalité et exemptions fiscales à Byzance (IXe-XIe siècles), Paris,
1996, p.88 et 113 378 SATHAS, 29, p.263-5 379 ibid., p.264
99
pselliennes sur le Mont Olympe sont exemptées par décision impériale et que le juge
n’a en aucun cas le droit d’envoyer quelques agents que ce soit sur le terrain380.
Psellos a tout à fait le droit de rappeler les exemptions qu’il a obtenues, en revanche il
n’a pas réellement le droit d’interdire à un juge l’accès d’une partie du territoire de
son thème. Psellos veut que ses propriétés bénéficient d’une sorte de statut
d’extraterritorialités mais ce statut n’a pas de fondement. Si Psellos était si confiant de
ses exemptions, il n’aurait alors pas de problèmes à ce que des agents du fisc viennent
sur ses terres pour vérifier les actes impériaux. Une lettre à Pothos indique bien que
Psellos peut agir sans document administratif à faire valoir381. Un conflit a opposé le
consul des philosophes au juge à propos de l’exemption fiscale d’un de ses
monastères. Le juge semblait demander un justificatif que Psellos n’était pas capable
de fournir jusqu'à l’arrivée de la présente lettre382. Cela montre bien que Psellos
souhaitait s’affranchir des règles et s’octroyer des exemptions fiscales inventées,
pensant certainement pouvoir forcer les juges à les reconnaître. Cela n’est
évidemment que suppositions. Ce qu’indiquent en tout cas ces lettres, c’est les
pressions que le juge semble devoir exercer sur les agents du fisc détaché dans son
thème pour éviter qu’ils ne fassent leur travail, alors qu’ils ne sont administrativement
pas clairement placés sous son autorité. De manière plus générale, le juge en tant que
délégué de l’empereur en province est garant du respect ses décisions. Il est donc
logique que Psellos lui demande de surveiller la bonne application des exemptions
qu’il a reçues, même a posteriori et donc de surveiller des agents du fisc,
éventuellement trop zélés.
Psellos manie assez bien le bâton lorsqu’il s’agit de ses propriétés mais ne perd pas
non plus la main pour défendre les intérêts des autres. Cependant, il le fait moins dans
un soucis du respect de la loi que dans l’envie d’accroitre son influence sur ses
protégés. Dans une lettre à un juge383, il évoque le cas du patrice Hikanatos qui
possède une propriété mais est assez faible384. Le juge pour une raison que nous ne
connaissons pas a fait évacuer les parèques des terres du monastère qu’il possédait.
Quoiqu’il en soit, Psellos insiste pour que le juge arrête immédiatement et cesse
380 SATHAS, 101, p.343-4 381 KURTZ-DREXL, 53, p.84-5 382 ibid., p.84, l.17-20 383 SATHAS, 138, p.381 384 ibid., l. 7-9
100
d’importuner Hikanatos385. Psellos intervient ici dans une affaire qui ne le concerne
en rien pour indiquer au juge ce qu’il doit et ne doit pas faire. Évidement, il ne
fournit aucune explication autre que la pauvreté de l’homme et le juge devrait se
borner à exécuter les ordres pselliens. Il y a certes une différence entre le cas de
Psellos qui possède quelques exemptions officielles et celui d’Hikanatos qui
vraisemblablement n’a rien pour lui. Il est intéressant de constater que Psellos joue
sur les deux tableaux, le légalisme strict et la flexibilité comme moyen de
gouvernement en fonction des situations et des profits qu’il peut tirer.
Il n’est pas le seul épistolier à agir ainsi, les autres le font également dans une
moindre mesure. Ils se placent de manière générale moins sur le plan fiscal que le
plan judiciaire. Ils ne s’opposent pas vraiment à l’action du juge mais veulent des
reformulations, des réinterprétations ou des infléchissements de ces décisions.
Jean Mauropous écrit une lettre exactement de ce type386. Il dit clairement que le juge
a pris une décision que toutes les parties ont acceptée. À partir de là, l’affaire devrait
être close et Mauropous continue et ajoute qu’il ne veut en aucun cas faire changer le
juge de position387. Cependant, il précise qu’il faut une nouvelle interprétation, plus
claire ; une qui soit plus humaine et sympathique388. Cette demande est décrite non
comme un dû mais bien comme une faveur. Nous ne connaissons pas le cœur de
l’affaire ni même la décision prise mais il s’agit clairement d’une tentative d’infléchir
la décision de justice rendue par le juge. Jean Mauropous fait pression sur le juge afin
qu’il change partiellement sinon totalement d’avis. Peut être devrions nous lire
« changer de jugement » à la place de « clarifier l’interprétation ». Si les deux parties
étaient d’accord sur la décision, c’est qu’elle était claire. Il n’y a donc aucun besoin de
clarifier si ce n’est pour changer la décision. Mauropous soutient une des parties.
Celle-ci n’était en réalité pas d’accord avec le jugement et Mauropous est envoyé en
sous mains pour faire évoluer la situation. C’est une explication possible.
De même dans une autre lettre389, il met en avant la probité et la justesse du juge
avant de préciser qu’il devrait pourtant adapter sa justice en fonction de celui qui est
385 ibid., l.10-11 386 JEAN MAUROPOUS, 31, p.118-21 387 ibid., p.119, l.5 388 ibid., p.119-120, l. 23-27, en particulier l.23 : « εἰ δὲ τὰ παρ᾽ ἄλλοις ἀµφίβολα τἐµνει φιλανθρωπία […]» 389 JEAN MAUROPOUS, 11, p. 64-7
101
en face de lui390. Les accusés sont des Paphlagoniens, donc des ignorants. Il précise
en effet, que selon l’opinion commune, les habitants de ce thème sont connus pour ne
pas connaître leur droite de leur gauche391. À ce titre, s’ils sont coupables ce n’est pas
de leur fait. Ils ont transgressés la loi sans aucune malice, en toute innocence392. Au
delà du nouveau concept juridique de l’innocente culpabilité qui m’échappe,
Mauropous signifie au juge qu’il a raison de les juger ainsi en principe mais qu’il faut
une justice adaptable. Il lui demande donc de réviser son jugement. Encore une fois
le juge subit une pression et ne peut exercer sa fonction en toute liberté de jugement
et en adéquation avec la loi. De plus Mauropous met en avant un système plus ou
moins inégalitaire et géographiquement discriminatoire, qui favoriserait en jugement
les bêtes et les ignorants, l’inverse de la justice même.
Il n’est pas le seul à tenter de s’opposer au cours de la justice, Syméon Magistros
également se place en travers de son chemin. Dans une lettre à un supérieur, a priori
un juge, il demande le pardon pour les coupables393. L’argumentation est fondée sur
l’évangile qui veut que les juges soient cléments avec les coupables repentants.
Syméon Magistros ne voit aucun obstacle au pardon de ces coupables du moment
qu’ils ont confessé leurs fautes. Il fait notamment référence à la parabole du fils
prodigue pour plaider sa cause394. Il y a ici une tentative d’alléger une sentence en
prétextant que les accusés ont plaidé coupable. Rien de bien choquant mais cela reste
une tentative de pression sur le juge.
Nicéphore Ouranos lorsqu’il écrit à son ami Paul, juge, fait également pression sur
lui. Il vient de condamner un homme de rang social élevé et fortuné395. Ouranos met
en avant la foi chrétienne qui appelle à plus de miséricorde pour demander plus de
clémence au juge396. Il ne conteste donc pas au départ la décision judiciaire seulement
la proportionnalité de la sentence, comme Syméon Magistros. Il ajoute pourtant que
si les lois disent qu’il faut avoir plus de pitié pour les pauvres, elles ne disent pas que
390 ibid., p.65, l.3-5 391 ibid., p.67, l.14-15 « οἱ ἁπλοϊκοὶ Παφλαγόνες, οἵ οὐκ ἔγνωσαν, καθάτερ ἀκούεις, δεξιὰν ἣ ἀριστεράν.» 392 ibid., l. 13-14. Rappelons que les dits accusés sont convaincus de contrebande, si ce n’est
de vol ou de pillage. 393 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS, 21, p. 113-14 394 ibid., p.113-14, l.14-20. 395 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 35, p. 234-35 396 ibid., p.235, l.38-41
102
celui-ci est poussé facilement à la dénonciation397. Nicéphore Ouranos prend ici une
position finalement un peu plus litigieuse. Il ne conteste même plus le jugement mais
bien l’accusation. Ce n’est plus une contestation, c’est une contre-attaque judiciaire
contre la décision même du juge d’accorder du crédit aux accusations d’un individu.
L’argumentation est fondée sur un seul critère, l’origine sociale du plaignant. Le juge
Paul subit une mise en accusation de sa propre faculté de réflexion et de jugement des
affaires, par une argumentation basse de Nicéphore Ouranos qui d’ailleurs n’hésite
pas à mettre son amitié en balance pour faire pencher Paul dans son sens. Encore une
fois, le juge subit des pressions dans le cœur même de son métier.
De manière plus générale, il faut bien voir que les juges sont constamment
surveillés, épiés quand il s’agit de prendre une décision ayant des répercussions. Sur
la fiscalité, le système est organisé de sorte que nos épistoliers se soient prémunis de
tout acte des juges par des exemptions, des documents impériaux, du moins en parole.
Les juges n’ont donc aucune marge de manœuvre et subissent donc de grandes
pressions pour maintenir sur « la bonne voie » les agents du fisc oeuvrant dans son
thème.
Il est encore plus intéressant de noter la volonté des épistoliers de constamment
s’affranchir des limites du droit lorsque celui-ci ne leur convient pas. Ainsi, ils
n’hésitent pas à utiliser des arguments à la limite du droit et de la cohérence, à faire
peser sur les décisions judiciaires justifiées tout leur poids. Le juge, utilisé tel un pion
sur un échiquier n’a aucune liberté en ce qui concerne le cœur même de son travail,
de sa fonction, la concrétisation de la loi, le rendu de la justice.
Le juge produit de la mentalité de l’élite : Les comportements peu vertueux.
Il faut cependant introduire un peu de nuance dans les propos précédents.
Certes, le juge est un pion utilisé par les plus puissants et sa marge de manœuvre dans
son travail et dans sa charge reste parfois assez limitée. En revanche, le juge est lui
même un puissant dans son thème et semble agir comme tel. Il n’est donc pas à
considérer comme une simple marionnette des épistoliers. Il peut être aussi le
tourmenteur des populations locales. Les épistoliers peuvent aussi être considérés
non pas comme des poids mais bien comme des autorités surveillants les juges quant
397 ibid., l.35-37
103
à leurs possibles exactions. Ce n’est d’ailleurs pas un cas unique puisque déjà au
début du Xe siècle les officiers de l’armée thématique devaient parfois leur rendre des
comptes. Nos correspondant, élite constantinopolitaine, perpétuent cette pratique de
surveillance au cours de notre période d’autant plus que ces hommes qu’ils soient
juges ou officiers de l’armée restent dans la même position par rapport aux épistoliers,
celle de dépendants. Dans une lettre rédigée par Nicolas Ier Mystikos et adressée à un
« officiel », peut être un représentant de l’armée thématique, le patriarche le
réprimande pour les menaces qu’il a osé proférer à l’encontre des moines du
monastère d’Anthes398. À cause de ces menaces, ils ont fui leur monastère399. Nous
ne connaissons pas les causes précises de ces menaces mais il est clair qu’elles
devaient être assez terribles. Nicolas Ier insiste d’ailleurs sur la cruauté de l’homme400.
Il semble que les moines avaient un problème judiciaire et qu’aucun compromis
n’avait pu être trouvé. Les menaces de l’officiel avaient été faites dans le but de forcer
les moines à accepter le compromis. De ce point de vu, les représentants de l’armée
thématique avaient donc des prérogatives judiciaires mais les exerçaient avec quelque
peu de brutalité. Dans une autre lettre rédigée entre 914 et 918401, le patriarche
fustige un officier pour des actes de torture effectués à l’encontre de coupable. Pour
punir les coupables dans une affaire qu’il avait tranchée, il leur fait subir quelques
supplices tel que des lacérations, des écorchements ou encore des arrachages de
cheveux402. Au delà de ces actes, le patriarche critique surtout l’accaparement des
terres appartenant à Sainte Sophie dans la région d’exercice de l’officier403. Afin de
rendre sa réprimande plus efficace, il y associe celle de l’empereur qui n’apprécie pas
ce genre d’actions404. Dans une troisième lettre attribuée au même patriarche, il
s’insurge contre un juge qui a porté la main sur des prêtres405, probablement lors
d’un conflit concernant une terre appartenant à leur église. L’accusation est assez
grave et Nicolas Ier utilise une parabole vétérotestamentaire assez remarquable pour
remettre le juge à sa place. Il compare son comportement à celui d’Achaab406. Ce
398 NICOLAS IER MYSTIKOS, 171, p.498-99 399 ibid., p.498, l. 2-5 400 ibid., l. 13-14 401 NICOLAS IER MYSTIKOS, 165, p.490-3 402 ibid., p.490, l. 6-9 403 ibid., l. 9-12 404 ibid., l. 18 405 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS, 53, p.131-2 406 ibid., p.132, l. 3
104
dernier fut roi de Samarie au IXe siècle av. J.-C.. Il est dans l’Ancien Testament
considéré comme un roi particulièrement impie, adorant Baal depuis ses noces avec
Jézabel. Le jugement inique407 auquel fait référence Nicolas Mystikos correspond à
un épisode au cours duquel le roi, voulant s’attribuer les vignes de son voisin, fit
organiser par son épouse un faux procès avec de faux témoins et se terminant par la
lapidation du pauvre propriétaire408. Le sort d’Achaab est alors prédit par le prophète
Elie qui évoque notamment sa vision du corps du souverain dévoré par les chiens409.
L’image est assez éloquente pour montrer la gravité des actes du juge aux yeux du
patriarche.
Ces trois lettres adressées à trois types de personnes dans une période assez similaire
montre bien que les juges sont tout autant capables d’exactions que les officiers de
l’armée thématique. Il ne faut évidemment pas généraliser mais il est clair que les
comportements qu’avaient alors les stratèges puis les juges devaient être assez
similaires. De même le rôle de l’épistolier est assez répétitif puisque Nicolas Ier
Mystikos menace et réprimande de manière identique.
Si ces comportements sont similaires alors une lettre du patriarche peut encore
nous éclairer sur les comportements des juges vis à vis de l’argent. Il s’agit d’une
lettre adressée à un ancien stratège devenu moine, Dermocaitès410. Nicolas Ier lui
demande de rédiger un rapport pour la chancellerie impériale au sujet de la fortune
que celui ci a engrangé lorsqu’il était en fonction411. Comme Dermocaitès était un
moine parfait, le patriarche suppose qu’il avait été également un excellent stratège. Il
souhaite donc en faire un modèle à la fois moral et financier412. Il souhaite lui faire
établir une sorte de revenue type pour les stratèges en fonction qui ne sont que trop
mus par l’amour de l’argent413. J.-Cl. Cheynet utilise d’ailleurs cet exemple en plus
de celui de Léon Phocas, trafiquant du blé d’Etat pour faire des profits mirifiques,
pour montrer que l’administration byzantine était menée par des personnes assez
corrompues et vénales414. Comme le remarque N. Oikonomidès, le gouvernorat des
407 ibid., l. 1 408 1. ROIS, 21 : 1-15 409 1. ROIS, 21 : 19 ; 1. ROIS, 22 : 38 410 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS, 86, p.147-8 411 ibid., p.148, l.3 412 ibid., l. 4-5 413 ibid., l. 6-7 414 CHEYNET, J.C., « Point de vue sur l’efficacité administrative entre le Xe-XIe siècle »,
Byzantinische Forschungen, 19, 1993, p.12
105
provinces, donc le poste de stratège et de juge, en ce qui nous concerne, était une
fonction particulièrement lucrative415. Elle attirait nécessairement tout aristocrate
souhaitant voir sa fortune fructifier rapidement. Les comportements de ces derniers,
étant plus déterminés par ce désir de profit à tout prix qu’orientés vers
l’accomplissement des tâches et prérogatives des juges, causaient donc du tort à
l’image de la fonction.
Comme le Verrès, gouverneur de Sicile dépeint par Cicéron416, une partie des juges
étaient donc à la recherche de profits rapides par des exactions notamment fiscales.
Certaines lettres de Michel Psellos montrent très bien cet aspect de la fonction. Dans
une lettre de remerciement à un juge pour les services qu’il a rendu à un agent du
fisc417, Psellos précise que cette aide le fait entrer dans un cercle vertueux qui ne peut
lui apporter que des bénéfices 418 . Ainsi aider un agent du fisc à rassembler
efficacement l’impôt permet au juge d’obtenir des bénéfices personnels ? Psellos sous
entend de prime abord que le juge doit faire des bénéfices personnels dans le cadre de
son travail et de surcroit dans des opérations de récolte de l’impôt. Cela signifie-t-il
que le juge prenait sa part sur les impôts payés par les contribuables de son thème ?
Cela n’est pas à exclure. La lecture du réquisitoire de Cicéron contre Verrès et en
particulier des chapitres concernant son gouvernorat en Sicile peut, à mon sens, nous
éclairer grandement sur les moyens mis en œuvres par les juges pour assouvir leurs
passions cupides. Il est clair cependant qu’il s’agit là d’un cas extrême qui ne peut
servir de calque. Pour autant, une transposition de certains actes de Verrès,
notamment ceux concernant le détournement de la justice à ses propres fins, dans un
environnement plus byzantin ne serait, me semble-t-il, ni choquante ni anachronique.
Deux autres lettres sont particulièrement exemplaires de cette vision. Dans la
première adressée au juge des Katotika419, Psellos conseille au juge de ne pas trop
415 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire byzantine
au XIe siècle », Travaux et Mémoires, VI, 1976, p.148 416 Voir le livre II de la seconde action contre Verrès qui concerne sa préture en Sicile, soit
les différents moyens mis en œuvre pour accomplir un enrichissement personnel colossal. CICÉRON, Discours, T.III, Seconde action contre Verrès, Livre II : la préture de Sicile, Paris, 2002, notamment c. X, 26, p.59-60 qui concerne notamment la corruption de Verrès se faisant payer pour juger dans un sens ou dans un autre. Voir également CICÉRON, Discours, T.III, Seconde action contre Verrès, Livre II : la préture de Sicile, Paris, 2002, p.3-43 pour une analyse globale de ce réquisitoire. 417 KURTZ-DREXL, 253, p.301 418 ibid., l.5-20 419 KURTZ-DREXL 55, p.87-8
106
s’occuper de ce qui se passe à Constantinople. Il lui ordonne de faire son travail
efficacement, de se montrer plus fort et si possible d‘avoir la bourse pleine de
pièces420. Il est intéressant de noter la définition de la manière dont le juge doit faire
son métier, être fort, efficace et s’enrichir. Cela l’est d’autant plus qu’il place
l’enrichissement et l’efficacité sur le même plan. Dans une dernière lettre à Pothos,
fils du drongaire et alors juge de l’Opsikion, Psellos le félicite pour l’excellent
accomplissement de sa judicature qui combine à la fois l’administration de la justice
et la poursuite de ses propres intérêts421. L’enrichissement personnel constitue pour
le consul des philosophes une des missions fondamentale du juge de thème.
Cette volonté d’enrichissement au détriment de la loi et des principes de la justice,
c’est exactement ce que reprochait Cicéron à Verrès et à nombre d’autres gouverneurs
dans son acte d’accusation 422 et Nicolas Ier Mystikos aux stratèges. C’est un
comportement qui semble avoir eu une certaine constance entre la Rome républicaine
et notre période. Faut-il voir chez Psellos une évolution au cours du XIe siècle ou du
moins une approche plus assumée de la fonction par le prisme de l’enrichissement ?
Quoiqu’il en soit, il ne s’agit absolument pas d’un sujet concernant uniquement les
juges mais bien toute l’élite byzantine. H. Ahrweiler insiste sur ce « manque
d’exemplarité des élites piégées par le vice de l’enrichissement […] et de
l’opportunisme visant les charges et les services. »423 et sur la corruption générale
des élites424. Le comportement des juges de ce point de vue ne fait que s’ancrer dans
celui du groupe dans lequel ils évoluent. Il n’est réprimandé pour des actions de ce
type que dans le seul cas où elles nuisent aux intérêts des épistoliers. Les interventions
du patriarche Nicolas Ier en sont l’exemple. De même Jean Mauropous se voit
contraint de se défendre contre le juge de son thème car celui-ci se comporte en
« puissant »425.
Il ne faut pas pour autant considérer que les juges ne font que calquer le
comportement d’une partie de l’élite byzantine. Ils ne sont pas simplement des
420 ibid ., p.88, l. 4-5 : « εἰ µέν οὖν µετὰ τῆς κρειττονός φήµης καὶ τὸ βαλάντιον στατήρων πληρᾶς» 421 KURTZ-DREXL, 35, p.56 422 CICÉRON, Discours, T.III, Seconde action contre Verrès, Livre II : la préture de Sicile,
Paris, 2002, p.27 et n.6 423 AHRWEILER H., « Erosion sociale et comportement excentriques à Byzance au XIe-XIIe
siècles », Actes du XVIe Congrès International des Etudes Byzantines, Athènes, 1979, p.29 424 ibid., p.33 425 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p.63
107
imitateurs, ils y sont pleinement encouragés. Les lettres de Psellos sur
l’enrichissement constituent une face de la médaille de la corruption des juges. Les
demandes d’infléchissement de jugement constituent le revers de cette même médaille
récompensant l’absence d’exemplarité de l’élite. Par ces demandes multiples du
rendre la justice non pas selon la loi ou les faits mais selon d’autres principes
directeurs tel que l’amitié426, les pressions exercées427 ou même la vénalité428, les
épistoliers mènent les juges sur des chemins non balisés. Cette pression constante
pour obtenir des faveurs fiscales ou l’annulation de jugements ne fait que diriger les
juges hors du champ de l’application des lois. Constamment sous une pression
hiérarchique, le juge reproduit nécessairement cette pression sur ses administrés pour
obtenir un enrichissement personnel rapide. De plus les différentes faveurs et
exemptions fiscales accordées aux puissants et amis des épistoliers ne jouent pas en
faveur du juge dans son relationnel avec les populations locales. L’exemption fiscale
signifie pour le reste de la population une augmentation de la charge fiscale ou du
moins une détérioration des services qu’elle finançait. Les autochtones sont d’ailleurs
incapables d’obtenir de telles faveurs. Les juges sont en effet moins enclins à donner
ce genre de réduction d’impôt à des communautés rurales ou à des « vrais » pauvres
comme le montre un certain nombre de lettres429. Ainsi subissant des pressions de sa
hiérarchie professionnelle ou sociale, le juge accorde des exemptions à une élite sans
pour autant en accorder aussi facilement pour les habitants réels de son thème, plus
modestes. La population le voit comme un mauvais gouverneur qui privilégie son
enrichissement et celui des puissants. Nombreux sont les exemples de populations se
refusant alors à payer les taxes430. Dans ce cas, le juge se défait des impôts de
puissants et est incapable de faire renter les impôts de la masse de la population. Cela
conduit nécessairement le juge dans une impasse, à la baisse des rentrées fiscales et à
une défiance des populations locales vis à vis de l’autorité thématique et centrale.
426 SARADI H. « The Byzantine Tribunals : Problems in the application of Justice and State
Policy (9th-12th c.) », REB 53, 1995, p. 185 427 ibid., p.176 428 ibid., p.192 429 Par exemple, KURTZ-DREXL, 99, p.127-8. Psellos demande au juge d’avoir plus de φιλία
pour ses administrés afin que ceux-ci se conduisent mieux. Il est vraisemblable que Psellos évoque ici un allégement d’impôt que le juge se refuse à accorder aux villageois. E. Limousin montre bien que les « vrais » pauvres sont absent des lettres et n’ont donc vraisemblablement aucune aide de la part du juge. LIMOUSIN - ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p.86-7 430 SATHAS, 33, p. 268
108
Le juge est donc ici un agent de l’État byzantin un peu schizophrène, pris entre
les devoirs dus à sa fonction, sa servitude envers ceux qui l’ont formé et le protègent
et ses propres désirs et nécessités. Il doit à la fois exécuter sa mission avec brio pour
espérer une promotion, tout en facilitant les désirs parfois illégaux de ses maitres et
réussir à concrétiser son nécessaire enrichissement personnel sans pour autant se
mettre à dos la population locale ce qui clouerait au sol toute ambition. Le juge est
dans une position plus qu’instable.
Conclusion
Les épistoliers et notamment Psellos considèrent les juges de thèmes comme
des marionnettes à qui ils pourraient demander n’importe quoi. C’est effectivement le
cas dans leurs affaires personnelles, on note très bien que Psellos demande bien des
choses aux juges dépassant largement le cadre des missions qui leurs sont attribuées
allant parfois même jusqu’aux limites de la légalité. Pour autant sur un plan judiciaire,
s’ils tentent constamment d’infléchir, d’annuler voire d’attaquer les décisions de
justice de nos magistrats, il est clair que l’efficacité n’est pas nécessairement au
rendez-vous. Cela fait transparaitre cependant l’image d’un juge finalement assez
faible face à l’élite intellectuelle et politique. Cela n’empêche pas nos juges de se
comporter eux même de cette manière dans leur thème, c’est-à-dire en puissant. En ce
sens le juge est bien un maillon d’une chaîne hiérarchique de puissance qui rend les
individus toujours faibles et flexibles vis à vis de leur supérieur ; sévères et cupides
envers leurs inférieurs.
109
Conclusion de la deuxième partie.
Les prérogatives du juges de thèmes l’amènent à étudier des affaires aussi
diverses que des agressions, des vols et des meurtres accidentels mais ce qui constitue
la plus grande part de son travail, ce sont ses prérogatives fiscale. Cela réaffirme bien
la place de gouverneur de ces juges. Il est aussi un homme de réseau, sur le plan
professionnel d’abord. Il gère l’administration thématique, les embauches et les
licenciements, les formations et les congés. Ce sont là les prérogatives logiques du
gouverneur-juge. C’est peut être aussi finalement ce qui transparait le moins. En effet,
ce que montre le corpus de lettre c’est la dépendance constante du juge vis à vis de
nos épistoliers. Elle se caractérise dès le départ par une relation fortement hiérarchisée
entre anciens disciples et enseignant. Dans le cadre de cette relation, les juges
demandent conseil sur le comportement à avoir dans diverses circonstances et se
voient aussi imposer certaines règles et manière d’agir. Cette dépendance est aussi
claire sur le plan social. Ce sont les épistoliers qui fournissent aux juges leur réseau,
qui les introduisent auprès de la hiérarchie épiscopale ou dans les cercles des
puissants de son thème. Ce sont encore eux qui leurs créent une clientèle, étape
nécessaire à la création d’un cercle d’influence. Il ne faut pas croire que ce sont des
actes philanthropiques, les juges n’ont que peu de choix dans leurs relations aux
épistoliers. Cela se perçoit notamment dans les demandes plus personnelles que
formulent nos correspondants. Ces demandes concernent soit des avantages fiscaux à
obtenir soit des modifications de jugements. Les juges semblent donc prisonniers de
cette relation, obligés d’assouvir les désirs des épistoliers souvent sous peine de
perdre tout soutien de leur part. Issus tout de même de l’élite intellectuelle byzantine,
les juges mis au pas quant à leurs relations avec leurs supérieurs, n’en restent pas
moins des puissants vis à vis de ceux qui leurs sont inférieurs. De ce point de vue, les
juges reproduisent ce qu’ils vivent eux même sur la population des thèmes en
s’enrichissant et en prospérant parfois par des méthodes douteuses voire brutales.
Encore une fois, cependant, ils ne le font pas de leur propre chef mais y sont incités
par les épistoliers. Cette dépendance des juges, membres de l’élite intellectuelle de
l’empire, vis à vis des épistoliers, et notamment de ceux qui appartiennent à une élite
constantinopolitaine plus politique, questionnent nécessairement les causes et les
raisons qui fondent la relation entre les deux acteurs de notre étude.
112
Troisième partie Le byzantin derrière le juge : moteur de son action et conséquence sur son existence
Ayant définit le juge de thème comme archétype du gouverneur-juge, et étudié
son action dans le cadre de ses fonctions, il transparait que moins guidé par les
prérogatives qui lui ont été attribués et par un sens du devoir et de l’intérêt général, le
juge est bridé sinon contrôlé dans la conduite des affaires publiques et privées par les
épistoliers. Il faut donc nécessairement interroger les causes de l’entrée des juges dans
ce type de relation, dans cette dynamique de soumission. Doit on y chercher une
relation particulière et forte entre les juges de thème et nos épistoliers ? Ou doit on y
voir des intérêts et des objectifs personnels des juges qu’ils ne pourraient atteindre
que par ce biais ? C’est probablement dans cet axe qu’il nous faut avancer ce qui n’est
pas sans faire émerger de nouvelles questions et notamment celle de l’efficacité de
telles stratégies.
113
Chapitre 1 - L’amitié, moteur de l’action des juges ?
L’amitié est une notion extrêmement présente dans les lettres de manière
générale et dans celles adressées à nos juges en particulier. Il nous est donc nécessaire
de nous interroger sur les formes qu’elle peut prendre, sur les personnes qu’elles
concernent et sur ses conséquences générales sur la relation entre les juges de thème
et les épistoliers. La question est de savoir si la relation de dépendance institutionnelle
sinon sociale entre les juges de thème et l’élite politique byzantine est fondée sur une
forme d’amitié.
Des relations amicales entre juges et épistoliers
La correspondance épistolaire byzantine, loin d’être uniquement et
majoritairement utilitaire comme pourrait le laisser penser cette étude, comprend
également des épitres dénotant de relations purement amicales. En premier lieu, il est
nécessaire de réfléchir à ceux qui sont susceptibles de partager l’amitié des épistoliers
parmi les juges. M. Mullett définit une liste de critères permettant tout d’abord de
déceler l’existence d’une relation. Il y a relation dès le moment où une lettre existe. À
partir de là, si l’on exclut la famille, les supérieurs et inférieurs hiérarchiques d’un
point de vue professionnel, on peut se faire une idée de ceux qui ont lié une amitié
avec les épistoliers431. Cela tendrait à penser qu’à l’exception des épistoliers exerçant
une fonction de juge ou faisant partie de la hiérarchie ecclésiastique, aucune autre
personne ne pourrait entretenir de relation amicale avec un juge. Ces derniers seraient
en effet continuellement des agents subalternes. À l’inverse, les lettres d’amitié que
nous possédons montrent qu’il est clairement possible qu’il existât des relations
amicales asymétriques. La similarité des positions sociales ou professionnelles n’étant
pas une règle432.
De fait, des lettres amicales sont échangées entre un juge de Paphlagonie et le
patriarche Nicolas Ier Mystikos433, entre Nicéphore Ouranos, Maitre de l’Orient et
431 MULLETT, M., « From Byzantium, with love », JAMES, L. (ed.) Desire and Denial in
Byzantium, 1999, Aldershot, p. 17-8 432 ibid., p.18 433 NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p. 422-3
114
gouverneur d’Antioche et de nombreux juges434. D’autres mettent en jeu des relations
moins asymétriques comme celles entre le métropolite d’Euchaïte, Jean Mauropous et
des juges de provinces 435 ou encore entre Théodore Daphnopatès et quelques
membres bien placés de la chancellerie impériale436.
La question de la définition de ce qu’est une lettre amicale dans la masse du
corpus reste cependant posée. M. Mullett avance que les liens d’amitiés
transparaissent dans les lettres possédant le moins de marques et de stéréotypes
rhétoriques dénotant l’affection ou le respect 437 . Ce serait ainsi que cela se
présenterait dans le corpus de Théophylacte d’Ohrid. Cette affirmation se concrétise
en effet dans nos lettres, les juges étant le plus rarement désignés avec de nombreux
adjectifs et superlatifs sont ceux avec qui les épistoliers semblent entretenir le plus de
liens. Cet argumentaire est à retenir mais il faut le nuancer. Les lettres que Michel
Psellos écrit au César Jean Doukas438 sont à la fois très déférentes et rhétoriques tout
en étant vraisemblablement très amicales. J’ajouterai que les lettres d’amitié les plus
claires sont celles qui n’ont strictement aucun but précis, ou utilitaire. J’exclus donc
les lettres concernant trop directement des affaires judiciaires ou des
recommandations professionnelles.
Ces lettres d’amitié ne sont pour autant pas vides de fond et elles comprennent bien
des topoï qui les identifient comme telles. Parmi ceux-ci, l’un d’entre eux est assez
récurent. Il s’agit du motif de l’absence de nouvelle. Ce topos est présent chez la
plupart des épistoliers avec quelques variations. Il peut s’agir de simples questions
comme chez Jean Mauropous439. Cette critique amicale se retrouve également chez
Philetos Synadenos qui se plaint, sans aucune considération hiérarchique, au
patriarche d’Antioche que ce dernier ne lui écrit pas assez440. Nicéphore Ouranos est
l’un de ceux qui semble utiliser le plus fréquemment cet argumentaire, peut être aussi
parce que la proportion de lettres amicales chez cet épistolier est un peu plus grande.
À l’un de ses amis, Paul, juge, il écrit une lettre de mise en accusation assez piquante
434 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 13, p.223 ; 24, p.228 ; 29, p.230-1 ; 33, p.233 ; 44,
p.243 435 JEAN MAUROPOUS, 39, p.132-3 ; 46, p.140-1 436 THEODORE DAPHNOPATÈS, 28, p.188-90 et 31, p.192-3 par exemple. 437 MULLETT, M., op.cit., p.18 438 Voir entre autres GAUTIER, LETTRES, 1-10, p.126-150 439 JEAN MAUROPOUS, 39, p.133, l.14-5 :«ἀλλα τί µὴ γράφεις ἡµιν ποτε καὶ αὐτός τι βραχύ;
» 440 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS, 5, p. 253,
115
dans laquelle il l’accuse du crime d’agraphie441. Nicéphore Ouranos semble prendre
assez mal ce manque de nouvelles et considère cela comme un désertion du juge442. Il
est assez amusant de constater le mélange du vocabulaire à la fois judicaire et
militaire pour évoquer l’amitié. Cependant cette mise en accusation ne semble pas très
efficace puisque dans une seconde lettre, Nicéphore Ouranos utilise un ton plus
plaintif, priant Paul de lui écrire même s’il s’agit d’une lettre de reproches443. Il utilise
ce même ton envers un certain Anthyme, protospathaire et juge444. Il lui demande
pourquoi il ne lui écrit plus et semble ne pas comprendre la distance qu’il met entre
eux. Il est prêt cependant à prouver ses sentiments amicaux pour lui et lui demande de
faire de même. Cette lettre ne diffère que très peu de notre conception actuelle de
l’amitié, dont les méandres psychologiques sont tout aussi tortueux.
Un autre élément est récurent dans les lettres d’amitié, offrir des cadeaux. A.
Karpozelos dans une étude sur les realia dans l’épistolographie, montre cependant
que les cadeaux n’ont pas toujours un caractère amical445. Cela dit, dans certains cas,
ce caractère amical est tout à fait certain Dans une lettre à un juge de Paphlagonie,
Nicolas Mystikos le remercie pour les moutons que celui-ci lui a envoyés. Il fait
également une remarque assez amusante accusant le juge d’avoir volé les ressources
de son thème pour les offrir446. Si cette remarque peut être considérée comme une
plaisanterie, elle reflète peut être aussi la réalité de la corruption et de l’accaparement
des richesses par les juges. Il ne faut pas sur-interpréter, d’autant que la plupart des
cadeaux offerts sont des aliments447. Le patriarche reçoit également du beurre qu’il
réutilise pour confectionner des biscuits qu’il offre à son tour448. Cette réciprocité
dénote, à mon avis, bien d’une relation amicale. Le partage de la nourriture est un lien
fort et indique une relation qui ne se construit que pour elle même, ou du moins pour
les biscuits.
Theodore Daphnopatès nous offre, lui aussi, de nombreuses indications au sujets des
cadeaux alimentaires. L’un de ses correspondants, malheureusement anonyme, était
441 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 33, p. 233, l. 1 : «[…]γραφὴν ἀγραφίου[…]» 442 ibid.,l.9-10 : «[…]λειποταξίου γράφοµαι[…]» 443 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 44, p. 243 444 ibid., 13, p. 223 445 KARPOZELOS, A., “Realia in Byzantine Epistolography, X–XII c.,”, BZ, 77/1, 1984, p. 2 446 NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p. 422, l. 5-7 447 KARPOZELOS, A, op.cit 448 DARROUZÈS – SYMÉON MAGISTROS, 72, p. 141, l. 4 : « […] κλιβανίτας[…]»
116
en effet de l’aveu même de Daphnopatès, un vrai glouton449. Il lui envoi ainsi du
raisin, des poissons divers et de nombreux mets450 que le correspondant ne fait
qu’engloutir. Il est vraisemblable qu’il s’agissait d’échanges de nourriture comme
pour le cas de Nicolas Ier Mystikos. D’ailleurs Daphnopatès lui aussi des présents
alimentaires notamment du lièvre de la part d’un correspondant inconnu, peut être un
client. Il décide alors de le partager avec un de ses amis Eustathe, protospathaire et épi
tou kanikleiou451.
Si la nourriture semble avoir une place importante, d’autres types d’échanges
existaient. Une lettre de Nicéphore Ouranos témoigne de l’existence d’échanges un
peu plus intellectuels. Il écrit à Pierre, juge et protospathaire. Celui-ci possède une
bibliothèque contenant un ouvrage intéressant le gouverneur d’Antioche, l’Atticistès
de Denys d’Halicarnasse452. Il lui demande de le lui envoyer. Il s’agit ici comme
l’écrit A. Karpozelos nécessairement d’un prêt, le livre étant d’une valeur trop
importante453.
Ces quelques éléments constituent une base, certes fragile, pour définir la
lettre amicale même si elle peut prendre des formes multiples. La lettre d’amitié est
donc une lettre sans trop de formes cérémonielles mais avec quelques topoï
spécifiques et récurrents, n’évoquant que la personne ou le lien qui unit des deux
correspondant. Seul ce type de lettre peut désigner à mon sens une relation purement
amicale entre deux individus dans notre corpus.
Philetos Synadenos et Nicéphore Ouranos sont souvent définit comme étant des
amis.454. Il peut être intéressant de constater que leurs lettres ne correspondent pas
aux critères définis, si ce n’est peut être celui de n’avoir pas de but utilitaire. Les
lettres de Philetos Synadenos à Nicéphore Ouranos ne cachent pas l’amitié sinon
l’affection, que celui ci entretient, du moins à l’écrit, avec le général. Il répète que sa
seule consolation, après avoir été envoyé à Tarse, est la présence proche de son ami à
449 THEODORE DAPHNOPATÈS, 23, p. 180-183 Il ne s’agit que d’un exemple parmi tant
d’autres mais il est particulièrement exemplaire. l.5-11 notamment. 450 ibid., 22, p.180-1; 25, p.184-7 par exemple 451 ibid., 28, p. 188-9 452 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 22, p.228, l.7 : « […] ὁ τοῦ ῾Αλικαρνασσέως Διονυσίου Ἀττικιστής […]» 453 KARPOZELOS, A, op.cit., p.12-13 454 DARROUZÈS, p.49 ; HANNICK, C., SCHMALZBAUER, G., « Die Synadenoi », JÖB, 25,
1976, p.127
117
Antioche, le miracle de Byzance455. Cependant les lettres ne sont finalement qu’un
long flot de discours totalement admiratifs pour Nicéphore Ouranos, le général
victorieux des Arabes, le philosophe de haut niveau, le rhéteur au style sublime.
Philetos Synadenos ne ménage en rien ses effets rhétoriques pour plaire au maitre de
l’Orient. Il forge des expressions utilisant le jeu de mot entre le mot Ciel et Ouranos
pour glorifier son correspondant456, annonce que Byzance s‘est transporté à Antioche
avec Nicéphore457, sous entendant que le général était le constantinopolitain parfait et
éduqué. Il compare même les victoire de Nicéphore à des actes honorant à la fois
l’empire et l’empereur lui même458. Ces lettres ne sont cependant pas dénuées
d’actions affectives concrètes. Lorsqu’il apprend une victoire du général, Philetos
veut se jeter à cheval sur les routes pour rallier Antioche avant que Nicéphore ne lui
rappelle sa mission de juge459. Ce dernier épisode indique très clairement que
Philetos était placé sous l’autorité de Nicéphore Ouranos, qui lui ordonne de
s’occuper des réfugiés. De même toute la rhétorique mise en œuvre par Philetos
Synadenos paraît très déférente sinon servile. Il est intéressant également de noter
que la collection de lettres de Nicéphore Ouranos ne comprend aucune lettre à
Philetos Synadenos sur les 50 qui nous sont parvenues, malgré le style sublime
qu’aurait employé le général pour celles-ci. Il est possible qu’il ait lui même organisé
sa collection de lettres et l’absence de Philetos Synadenos tendrait à montrer qu’il
s’agit d’une amitié à sens unique. L’historiographie a voulu voir une amitié forte et
réelle, là où il n’y peut être que l’affection d’un juge pour le détenteur de l’autorité
dont il dépend. Je ne remets pas en cause l’affection de Philetos Synadenos,
seulement la réciprocité des choses.
Quoiqu’il en soit, s’il reste que juges et épistoliers entretenaient entre eux des
relations amicales, si ce n’est des relations d’amitié. L’échange de nouvelles, de
cadeaux et peut être parfois le discours élogieux, constituent le fondement de ces
lettres. Cependant cela ne concerne que peu de cas. De plus ce type d’amitié ne
constitue en aucun une relation qui engage les deux parties l’une envers l’autre ou très
peu. Michel Psellos, quant à lui, considère l’amitié sous un tout autre angle, avec ses
propres critères assez restrictif. 455 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS, 11, p. 257, l. 3 456 ibid., 13, p. 258, l. 1-5 457 ibid., 12, p. 258, l. 12-13 458 ibid., 13, p. 258, l. 11-15 459 ibid., 10, p. 256, l. 14-15
118
L’amitié philosophiques psellienne
Les lettres amicales que nous venons d’étudier n’ont pas grand rapport avec
les lettres d’amitiés rédigées par Psellos. Les lettres pselliennes présentent une autre
forme d’amitié plus intellectuelle. Comme le montre A.R. Littlewood, les lettres de ce
type doivent répondre à un certain nombre de critères rhétoriques, plus précis que
ceux de M. Mullett. Ces lettres, d’après la tradition épistolographique ancienne,
doivent être personnelles et donner un aperçu réel de la personne qui écrit ; ne doivent
être ni trop longues ni trop courtes ; ne doivent aborder aucun sujet trop prosaïque ou
éphémère et enfin utiliser une langue à la fois simple et gracieuse460. Les lettres ainsi
faites seraient alors le reflet de la personnalité de l’épistolier, une icône de l’âme. Je
ne m’avancerais pas à classer les bonnes et les mauvaises lettres de Psellos selon ces
critères mais il est clair que le fond des lettres et la manière dont il est abordé dépend
clairement de la finalité de la lettre, rhétorique ou utilitaire. I. Sevcenko précise
également qu’il existe plusieurs niveaux de style de langue et de rhétorique
permettant d’adapter son discours à l’interlocuteur en fonction de son niveau de
culture notamment461. Schématiquement, il y a trois niveaux de style. Un style de
faible niveau avec un vocabulaire et des formes proches de la langue parlée et ne
possédant en guise de référence que des allusions au Nouveau Testament ou aux
Psaumes. Un style de niveau médian avec une syntaxe fondée sur de longues
périodes, un vocabulaire proche de celui des pères de l’Eglise et des références aux
Saintes Écritures dans une acception plus large. Enfin, il existe un style de haut
niveau avec notamment un vocabulaire très recherché et un nombre important
d’hapax, une langue attique dans laquelle les références aux Écritures sont faibles et
celle à l’Antiquité foisonnantes. Il n’est encore une fois pas question d’étudier le style
de Psellos qui doit être finalement assez élevé contrairement à ce que peut dire le juge
Xèros462. Cependant l’étude des références et des images utilisées dans les lettres peut
nous indiquer quelques éléments sur le niveau de culture de certains juges et la
possibilité pour eux de partager avec Psellos une amitié, sinon une relation
460 LITTLEWOOD, A.R., « An « Ikon of the soul » : the Byzantine Letter », Visible Language
10, 1976, p.208 461 ŠEVČENKO, I.,« Levels of style in byzantine Prose », JÖB, 31/1, p.289-312 462 SATHAS, 51, p. 282, l.2-3
119
intellectuelle. Les références notamment à l’Antiquité ne sont pas si courantes dans
les lettres adressées à des juges et peuvent donc démontrer un lien particulier entre les
juges et l’épistolier. Si l’on prend par exemple une lettre de Psellos à un juge de
l’Opsikion, on note la présence d’une longue métaphore filée sur le thème
d’Alexandre le Grand 463 . Dans une autre lettre, il évoque les personnage de
Rhadamanthe et Alcmène464 . Psellos évoque aussi dans un courrier à un juge,
Kronos, et Oenée roi de Calydon dont l’histoire est racontée dans l’Iliade. Les
références mythologiques sont relativement présentent dans les lettres adressées aux
juges et démontrent une nouvelle fois le haut niveau de culture de ces fonctionnaires
byzantins. Elles sont aussi un signe des liens particuliers qui unissent certains juges à
Psellos.
Le cas de Nicolas Sklèros est particulièrement intéressant de ce point de vue. Dans
deux lettres qui lui sont adressées, on note un luxe de références antiques à la fois
philosophiques et mythologiques465. Psellos y fait référence à Héra, Aphrodite, à
Thrakos et Orphée466. Dans une deuxième lettre, Psellos évoque à la fois les grands
courants philosophiques avec Platon, Protagoras et Épicure mais également
l’Académie 467 . La lettre, assez longue, lui permet de citer abondamment des
personnages de l’Iliade tel que Achille, Nestor et Télamon mais également Heraklès
qui les côtoie dans l’imaginaire psellien468. Il s’agit là de quelques cas précis, loin
d’être une liste exhaustive de référence469. Ces lettres nous montrent que certains
juges étaient vus par Psellos comme capables de lire et d’écrire des lettres en style de
haut niveau quand d’autre devaient se contenter de lettres en style de niveau médian,
les références étant plus bibliques470. Certains juges semblent avoir aux yeux de
Psellos une plus grande valeur intellectuelle que d’autre. Il est notoire par exemple
que Nicolas Sklèros et Michel Psellos entretenaient des relations excellentes sur le
plan intellectuel et amical. Cette idée de partage d’une même culture est extrêmement
463 KURTZ-DREXL, 100, p. 128, l. 22-23 464 KURTZ-DREXL, 244, p.294, l.25 et 26 465 KURTZ-DREXL, 37, p.60-2, et 44, p.73-5 466 KURTZ-DREXL, 37, p.60, l.2-3 467 KURTZ-DREXL, 44, p. 74, l. 3-5 468 ibid., l. 18-20 469 Les lettres aux fils du drongaire en sont des exemples notamment KURTZ-DREXL 35,
p.56-8 ou 38, p.62-3. 470 Entre autre KURTZ-DREXL, 76, p.108, l.15, référence à Abraham et Lazare ; 97, p.126,
l.9, référence à Jonas ou encore 214, p.255 référence à Adam (l.4), Jacob (l.16) et Joseph (l.17)
120
importante dans la conception de l’amitié idéale envisagée par Psellos. F. Tinnefeld
qui a étudié spécifiquement la conception psellienne de l’amitié, précise en effet, que
pour le consul des philosophes, l’intérêt de l’amitié est celui de partager les mêmes
inclinations scientifiques et académiques471. Dans plusieurs lettres de Psellos mais
aussi chez Daphnopatès, on note un fort intérêt à la discussion philosophique. Chez
Théodore Daphnopatès par exemple, on trouve une discussion avec son ami Pierre,
spatharocandidat, sur la nature du lieu qui unit le corps et l’âme et le rapport entre
choses terrestres et célestes472. Il s’agit bien d’un échange de lettres et non d’un
simple cours donné par Daphnopatès à un correspondant473. Psellos discute lui aussi
de sujets hautement philosophiques avec des juges, notamment Constantin Xiphilin,
drongaire de la Veille474. Les deux hommes discutent de la possibilité de faire une
version « métaphrastique » plus abordable d’un texte d’Aristote. Dans cette lettre,
Psellos use de multiples références et métaphore pour définir la difficulté de la tâche.
Toute discussion intellectuelle n’induit pas, pour autant, une relation amicale forte.
Pothos, le fils du drongaire qui semble jouir d’une culture suffisante pour recevoir des
lettres pselliennes de haut niveau, se voit imposer par Psellos une leçon tel un élève
auquel le maitre donnerait quelques cours supplémentaire. Il lui explique en effet
comment ont été faite les découvertes scientifiques majeures chez les Égyptiens et les
Phéniciens. Il conclut en demandant à Pothos d’observer le monde sur le terrain. On
pourrait penser qu’il s’agit ici d’une discussion philosophique comme chez
Daphnopatès mais en réalité, Psellos a un but plus prosaïque. Il s’agit d’apprendre à
Pothos à mesurer précisément des terres que l’empereur veut voir cadastrer. Il aura
donc besoin d’observer attentivement le terrain avant de faire ses mesures. Psellos
n’entretient pas, à mon avis, de relations très poussées avec son cousin qu’il ne
semble pas considérer comme son égal à l’inverse de Nicolas Sklèros.
F. Tinnefeld ajoute qu’a l’intérêt académique commun, Psellos considère également
le temps passé ensemble et une bonne disposition de caractère pour forger une vraie
amitié475. Nous sommes assez dépassé sur cette question, ces deux éléments étant
difficilement évaluables avec la documentation dont nous disposons. Il est possible
471 TINNEFELD F., « « Freundschaft » in den Briefen des Michael Psellos », », JÖB, 22,
1973, p.152 ; 155 472 THEODORE DAPHNOPATÈS, 19-20, p.172-9 473 THEODORE DAPHNOPATÈS, 19, p.173, l.1-2 474 SATHAS, 205, p.499-502 475 TINNEFELD F, op.cit., p.155
121
cependant de retrouver cette amitié, qualifiée de philosophique par Tinnefeld, dans le
partage des soucis et de la souffrance de l’autre, considéré comme une vertu de
l’amitié476. Ce souci de sympathie est flagrant dans la lettre rédigée par Psellos à
l’intention de son ami Nicolas Sklèros lors de la mort de son neveu Anastase Lizix477.
Psellos dit certes qu’il n’y a que peu de temps pour la peine et le deuil mais la retenue
psellienne indique peut être ici un vrai chagrin plus clair dans la monodie qu’il écrit
pour Anastase478. Ce cas d’amitié réelle, philosophique est l’un des rare cas que nous
connaissons entre un juge et un épistolier.
Un autre élément peut nous indiquer, selon la conception de Psellos, des
amitiés réelles. Il s’agit d’observer le comportement de Psellos lors de la réception de
cadeaux qui lui sont offerts. F. Bernard a étudié cette question et semble développer
l’idée que chez Psellos le cadeau et surtout la manière dont il est reçu donne une
indication sur la relation que les deux interlocuteurs entretiennent479. Psellos aurait
tendance à refuser les cadeaux de ceux qu’il estime et avec qui il entretient une amitié
réelle et philosophique480. C’est le cas du César Jean Doukas par exemple, dont
Psellos refuse les truffes481 ou encore celui du Patriarche d’Antioche dont il refuse les
parfums482. L’argument est toujours le même. Psellos préfère les lettres à n’importe
quel autre cadeau. Le discours est supérieur à la matérialité des choses483. Il s’agit ici
pour Psellos d’essayer de créer une amitié idéale, ascétique totalement intellectuelle.
Le refus écrit des cadeaux est donc une sorte de célébration de l’amitié intellectuelle.
Ainsi peut on essayer, par cette étude des réceptions de cadeaux, de déceler les
amitiés réelles de Psellos avec les juges. Il n’y a malheureusement aucun cas de refus
de cadeau sinon une lettre rédigée à l’intention du juge de Macédoine, Chasanès484.
Celui ci lui a offert de l’or ou du moins un objet en or. Psellos semble l’accepter en le
remerciant de lui offrir de l’or véritable mais lui précise que l’or n’est rien face au
476 ibid., p.159 477 KURTZ-DREXL, 127, p. 150-1 478 GAUTIER P., « Monodies inédites de Michel Psellos », REB 36, p.83-151 479 BERNARD, F., « Gifts and intellectual friendship in eleventh century Byzantium »,
GRÜNBART, M. (ed.), Geschenke erhalten die Freudnschaft, Gabentausch und Netzwerkpflege im Europäischen Mittelalter, Akten des Internationalen Kolloquiums Münster, 19.-20. November 2009, Berlin, 2011, p. 1-13 480 ibid., p.2 et 5 481 ibid., p.4 et KURTZ-DREXL,40, p.66 l.26-30 482 BERNARD, F., op.cit., p.1 et KURTZ-DREXL, 88, p.117, l.15-17 483 BERNARD, F., op.cit., p.8 484 SATHAS, 172, p. 439-40
122
Logos485. Veut-il dire que l’or n’est rien par rapport à la lettre que Psellos lui envoi?
Ou bien veut il simplement dire qu’une lettre de Chasanès suffisait ? Nous ne
pouvons pas vraiment trancher. Ce cas reste pour autant l’unique exemple de refus
plus ou moins clair de Psellos. L’argumentaire de Psellos indique également le haut
niveau de culture de Chasanès ce qui tendrait à penser que les deux hommes pourrait
entretenir une relation amicale réelle.
Si Psellos a une conception de l’amitié réelle très réduite et idéalisée mais tout
à fait forte, il ne la concrétisait que peu vis à vis des juges. Seuls quelques noms
ressortent vraiment. Ceux de Nicolas Sklèros et de son neveu Anastase Lizix,
probablement Constantin Xiphilin mais également, dans une moindre mesure celui de
Pothos et de Chasanès. Pour autant il ne faut pas croire que le thème de l’amitié était
absent de la majorité des lettres pselliennes aux juges.
La notion de φιλία : prétexte à l’établissement de relations de soumission
Psellos laisse cependant planer certains doutes dans sa correspondance sur sa
conception de l’amitié. En effet, il déploie toute une rhétorique amicale envers des
juges ce qui laisserait penser à première vue qu’il entretient avec eux des relations
amicales. Ce serait faire une grave erreur d’interprétation que de penser cela.
Regardons tout d’abord cette rhétorique.
E. Limousin met en évidence l’importance de l’utilisation de deux termes un peu
trompeurs comme adelphos ou anepsios486. Psellos utilise généralement le terme
d’adelphos pour ceux avec qui il entretient un minimum de relations intellectuelles et
amicales, ceux issus des meilleurs milieux sociaux aussi487. Et il semble que ceux que
Psellos nomme fils, uios, étaient pour la plupart des juges ayant été ses anciens
élèves488. Ils ne sont donc pas nécessairement ses amis. Il ne faut pas se laisser leurrer
par les termes affectifs qui les désignent. Il est même vraisemblable que ces « fils »
soient en réalité des dépendants de Psellos. Chaque expression semble donc désigner
un groupe de personnes et ne doit ni être prise au premier degré comme fils, frère,
neveu ni dans un sens métaphorique affectif à l’exception peut être pour les « frères ». 485 ibid., p. 439, l.24-27 486 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p.136 487 ibid., p.144 488 MULLETT, M., « From Byzantium, with love », James, L. (ed.) Desire and Denial in
Byzantium, 1999, Aldershot, p. 17-8
123
Il s’agit plutôt d’une manière de marquer la hiérarchie dans la relation tout en gardant
un ton plus amical. Les « frères » sont les égaux de Psellos sur le plan social et
intellectuel. Les fils sont dans une position inférieure à Psellos par le fait qu’ils lui
doivent leur carrière. Psellos fait aussi en sorte de rester constamment dans la position
du maitre d’école, parmi ses élèves. La place de neveu devrait être situé entre les
deux, peut être des hommes ayant déjà fait une partie substantielle de leur carrière,
restant débiteur de Psellos tout en s’étant affranchi de sa tutelle directe. Ceux qui ne
sont pas désignés par ces termes mais désignés par d’autres formes489, sont situés
alors au dernier rang derrière les fils et n’avaient probablement pas de relation
particulière avec Psellos. Les formules sont d’ailleurs plutôt longues et stéréotypées
ce qui prouve en un sens qu’elles n’ont pas nécessairement grande signification.
M. Mullett montre bien que chez Théophylacte d’Ohrid, les lettres ayant des formules
stéréotypées sont des lettres envoyées aux personnes les moins proches avec les
épistoliers490. Il en est probablement en partie de même chez Michel Psellos.
En étudiant les discours faisant références à l’amitié, on s’aperçoit que dans la
plupart des cas, il ne s’agit encore une fois que de références qui diffèrent
fondamentalement avec ce qu’est l’amitié réelle. À l’exception des lettres à caractère
philosophique entre Psellos et ses vrais amis se proposant de faire des mises en abîme
de l’amitié afin de la rendre plus pur et éclatante491, il fait référence à l’amitié dans
des situations et dans des optiques bien différentes.
Parmi les exemples multiples, il est possible de citer celui de l’équation amicale.
Dans une lettre courte à un juge, Psellos écrit à peu près en ces termes : Un ami a été
maltraité. Tu es un ami à la fois bon et juste. Règle la situation492. Le lien entre les
amis de Psellos semble effectif selon l’adage quasi arithmétique que les amis d’un
ami sont des amis. Ainsi en tant qu’amis ils se doivent aide mutuelle. Une autre lettre
avance cette argumentation sobre et efficace. À un juge de Cappadoce, il écrit que les
moines de Cappadoce sont ses amis493, lui est compté également parmi ces amis494.
489« φίλος µοι » : KURTZ-DREXL, 52, p.83, l.1 ; « κυρ µου » : KURTZ-DREXL, 51, p.83, l.1,
65, p.97, 4 et 253, p.301, l.6 ; « λογιώτατε » : KURTZ-DREXL, 35, p.56 l.1; 116, p.143, l.1; ou encore « λογιώτατε πάντων ανδρών καί έµοί φίλτατε » : KURTZ-DREXL, 91, p.119, l.14-15 490 MULLETT, M, op.cit., p.18 491 TINNEFELD FRANZ, « « Freundschaft » in den Briefen des Michael Psellos », », JÖB, 22,
1973, p.175 492 KURTZ-DREXL, 163, p.190 493 SATHAS, 158, p.412, l.1 494 ibid., l.3-4
124
En ce sens l’équation ne fait alors aucune difficulté pour être résolue495. La seule
chose qu’il doit faire est d’apporter son aide aux moines en question. Il est assez
intéressant que Psellos utilise le terme de συνλογισµός pour désigner ce lien qui doit
s’établir entre les moines et le juge. Il ne s’agit pas d’une question en débat. L’amitié
entre le juge et le consul des philosophes commande au juge d’aider les moines sans
discussion. D’ailleurs Psellos utilise cette même idée dans une lettre de
recommandation d’un certain Procope496. Il termine sa lettre après avoir fait état des
qualités de l’homme, en précisant que quelque soient les qualités susmentionnées, le
juge devrait l’accepter puisque l’amitié devrait commander en tout et à tous497.
Psellos dévoile ici sa deuxième conception de l’amitié, celle que l’on devrait appeler
en réalité sphère influence, réseau. Cette idée réside déjà dans une expression qu’il
utilise pour pousser un juge à soutenir une famille pauvre. Il dit en effet, qu’aider les
gens est une tendance naturelle498. Il ne précise pas si c’est une tendance naturelle
chez lui ou chez les hommes de manière générale. La seconde solution me semble
plus crédible. Ainsi si l’aide est une tendance naturelle, l’amitié mise en avant par
Psellos dans les lettres précédentes n’est évidemment pas un argumentaire fiable mais
bien un artifice rhétorique. En effet, s’il existe une tendance naturelle à l’altruisme,
alors l’argumentaire de l’amitié devrait être tout à fait inutile.
L’utilisation que fait Psellos de ce concept d’amitié indique bien qu’il n’a que peu de
sens pour lui. Dans plusieurs lettres dans lesquelles il requiert des juges qu’ils
changent leurs jugements, Psellos oppose la justice et l’amitié. C’est le cas dans une
lettre rédigée à propos d’un homme ayant subit des maltraitances499. La fin de la lettre
est à ce titre exemplaire puisque Psellos appelle le juge à appliquer strictement la loi
et le droit mais à ne pas oublier l’amitié dans ce jugement500. Un autre cas met en
avant l’amitié dans un contexte qui prouve qu’elle n’existe pas pour Psellos dans ce
cas. Il s’agit d’une lettre dans laquelle Psellos menace un juge de le déchoir de son
amitié si celui-ci n’accueille pas un homme501. Cette menace montre bien que pour
Psellos, il ne s’agit pas d’amitié. En effet, si le juge n’accueille pas l’homme
495 ibid., l.6 496 SATHAS, 147, p.395-6 497 ibid., p.396, l.11 498 SATHAS, 193, p.488, l.2-3 499 KURTZ-DREXL, 166, p. 191-2 500 ibid., p.192, l.15-17 501 KURTZ-DREXL, 183, p.202-3
125
recommandé par Psellos alors il devient un pion tout à fait inutile. Il est donc logique
qu’il le sorte du jeu. Cette réflexion est à l’opposée de ce qu’est l’amitié, d’autant plus
de la conception psellienne de la vraie amitié mais elle est liée avec l’idée d’influence
et de réseau dans laquelle Psellos évolue avec aisance. L’amitié, dans le cas de
relations peu personnelles, se nomme influence502. Elle se définit chez Psellos par la
possibilité de manipuler les hommes pour les faire avancer dans le sens de ses propres
intérêts. H. Ahrweiler semble plus mesurée, mettant en avant l’idée de φιλόφιλος de
Psellos, c’est à dire la nécessité de répondre à toute les demandes des amis et de leur
entourage afin de pouvoir soit même demander en retour503. Il s’agit donc bien d’un
lien de service qui existe entre la majorité des juges et Psellos. L’amitié réelle n’est
quasi pas existante.
Afin de consolider cette idée, on peut étudier une nouvelle fois le cas de la réception
des cadeaux par Psellos. Ce dernier remercie à quelque reprise des juges pour les
cadeaux qu’ils ont envoyé. Il s’agit soit de cas dans lesquels Psellos ayant fait
quelque chose pour le juge reçoit un présent en remerciement ou dans des cas où le
juge afin de plaider sa cause accompagne sa missive d’un cadeau. Sur l’ensemble des
lettres cela ne concerne que peu de d’occurrences. Un cas est cependant intéressant
pour ce qui concerne les liens d’amitié. Psellos évoque un mulet que lui avait offert
un juge des Cibyrrhéotes504. Le cadeau est d’importance ici, il ne s’agit pas ici de
simples légumes ou de beurre. Le comportement de Psellos est tout aussi intéressant.
Celui-ci ne remercie que très vaguement le juge et après avoir commenté la couleur
de l’animal505, il précise que la bête est bien trop petite pour lui506. Ainsi, à l’avenir le
juge lorsqu’il décidera d’offrir une nouvelle fois un mulet à Psellos devra en choisir
un plus adapté. On est loin de l’idéal de l’amitié antimatérialiste et ascétique. Psellos
critique le juge tel un enfant mal élevé. Le cadeau n’est ici absolument pas un gage
d’amitié mais bien un signe de subordination sinon un moyen de domination pour
Psellos.
502 LIMOUSIN E., « Les Lettrés en société : « φιλος βιος » ou « πολιτικος βιος » »,
Byzantion, 69, 1999, p. 356 503 AHRWEILER H. , « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : nouvelles
hiérarchies et nouvelles solidarités », Travaux et Mémoire VI, 1976, p. 109 504 SATHAS, 66, 67, p.297-99 505 SATHAS, 66, p. 298, dernier §. 506 SATHAS, 67, p. 299, dernier §
126
Ce que montre en tout cas ce court panorama de la rhétorique amicale
psellienne, c’est qu’elle ne désigne jamais ou très peu l’amitié désintéressée. Elle
symbolise soit les liens d’influence, donc de subordination entre les hommes et
Psellos ; soit les hiérarchies sociales ou intellectuelles qui traversent la société
byzantine. Cette autre amitié a pour nom, plus juste, celui de clientèle. La plupart des
juges sont des clients des épistoliers et en particulier de Psellos. À ce titre, ils n’ont
que peu d’indépendance vis à vis de lui et de ses désirs. Psellos a donc beau jeu de
parler d’amitié lorsqu’il s’agit en réalité d’obligation déguisée.
Conclusion
Les relations amicales entre juges et épistoliers sont de natures très diverses et
existent réellement, les échanges de nouvelles, de cadeaux et les plaintes dû à la
séparation ne sont pas de vains topoi et prouvent l’existence de telles relations.
Cependant, il est clair qu’une large partie de la rhétorique amicale utilisée dans les
lettres n’est pas une preuve de l’existence amicale mais bien une manière déguisée
pour les épistoliers, pour ne pas dire Michel Psellos, d’habiller une relation de
dépendance sinon de soumission. Seules quelques relations très particulières, dites
d’amitié philosophique, entre Psellos et certains juges trahissent des rapports plus
égalitaires, du moins en dehors d’une hiérarchie sociale. Ces relations rare se tissent
généralement entre les membres d’un milieu identique l’aristocratie civile et
intellectuelle constantinopolitaine excluant ainsi une large partie du bataillon des
juges. La rareté de l’amitié réelle et engageante, entre juges et épistoliers, laisse
penser que ce genre de relation n’est pas le moteur de la soumission plus ou moins
volontaire des juges de thèmes aux épistoliers, elle n’est qu’un moyen d’habiller ce
rapport de soumission.
127
Chapitre 2 - L’ambition des juges et leurs perspectives de carrière
L’amitié n’étant ni une cause ni un moteur de cette relation, il est nécessaire
de trouver pour les juges un objectif, un profit qu’ils pourraient éventuellement retirer
de ce rapport de force qui les soumet et leur impose une manière d’agir jusque dans
leur prérogative la plus centrale, le rendu de la justice. La survie professionnelle du
juge, souvent menacée par les épistoliers eux même en est probablement la cause. Il
nous faut donc tenter d’étudier l’impact des épistoliers sur les carrières de nos juges.
Prosopographie de quelques juges remarquables : les carrières les plus brillantes
L’amitié n’est en rien le moteur de la servitude répétée des juges envers nos
épistoliers. La dynamique responsable des mouvements des juges est à trouver dans
leurs ambitions et leurs désirs, tout à fait humains, de faire carrière. Psellos en tant
que proche de l’empereur, du moins membre de la cour, avait une légère influence sur
les décisions administratives, donc les mutations et les promotions des fonctionnaires.
Il serait intéressant d’étudier quelques carrières afin de tenter de déceler les influences
et les actes déterminants leurs évolutions.
Il est assez difficile d’étudier les carrières uniquement à partir de la correspondance.
Seuls quelques juges sont nommés explicitement et reviennent à plusieurs reprises
pour que nous ayons une possibilité de tracer quelques une des évolutions de leur
carrière. Seul le corpus psellien nous permet un tel travail et pour le nombre réduit de
trois juges. La question de la datation des lettres est aussi complexe sinon insoluble.
Je m’appuis principalement sur celle proposée parfois par E. Limousin507. Cette
limitation du nombre de carrières étudiables conduit à ne percevoir qu’une partie
infime de la réalité, la plus brillante. Les trois cas que nous étudions en premier lieu
sont celui de Nicolas Sklèros, de Pothos, le fils du drongaire et Basile Malesès.
Nicolas Sklèros est le juge et ami de Psellos ayant reçu le plus de lettres. Les
indications s’y trouvant nous permettent de retracer son parcours à partir de son
premier poste de juge. La fonction la plus présente est celle de juge de l’Egée508. Il est
possible que certaines lettres nous aient échappé mais il reste difficile d’attribuer un
507 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p. 255-75 508 Sur un ensemble de quinze lettres, treize sont adressées au juge de l’Egée
128
destinataire à une lettre sans plus d’information. Les datations mises en avant par E.
Limousin nous donne une période d’exercice de cette fonction située entre 1054 et
1071. C’est une période très large mais quatre lettres sont cependant daté plus
précisément entre 1068 et 1071509. Il a donc au minimum exercé la fonction de juge
de l’Égée durant trois ans. On peut cependant penser au vu de la large datation qu’il
l’a exercé un peu plus longtemps. Les autres lettres concernant Nicolas Sklèros ne lui
donne aucune autre fonction. Cependant le matériel sigillographique peut nous aider à
restituer le reste de sa carrière. Un sceau nous permet de connaître la fonction qui
exerçait avant son arrivée dans le thème de l’Egée. Ce sceau de Nicolas Sklèros le
nomme comme juge des Bucellaires510. Il s’agit d’un sceau frappé à la fois de la
Vierge Hodegètria ainsi que de Saint Nicolas et Saint Théodore. Il mentionne la
fonction de juge des Bucellaires et la dignité de vestès. W. Seibt le date de la seconde
moitié du XIe siècle. Il considère ce sceau comme assez ancien pour appartenir aux
débuts des années 1060. Cette indication est importante. Nicolas Sklèros aurait été
juge des Bucellaires avant d’être juge de l’Egée. L’importance du nombre de lettres
adressées à Nicolas en tant que juge de l’Egée laisse penser qu’il fut plus longtemps le
détenteur de cette dernière fonction. Peut être est-ce un indice démontrant l’absence de
durée fixe d’exercice à une fonction de juge. Un autre sceau nous indique la suite de la
carrière de Nicolas que nous ne connaissons pas par les lettres. Il s’agit d’un sceau
indiquant Nicolas Sklèros comme épi tôn déèséôn511. Il est daté entre 1060 et 1080.
De plus un chrysobulle des années 1060 fait référence à un Nicolas, épi tôn déèséôn.
Il semblerait donc qu’avant d’avoir exercé en Égée, Nicolas fut nommé auprès de
l’empereur à Constantinople. Ayant déplut à l’empereur d’une quelconque manière,
probablement pour avoir participé de près ou de loin à un complot, il fut disgracié et
ses terres confisquées512. Il est vraisemblablement envoyé à ce moment là ou peu
après en Égée, à la fin des années 1060. Ne voyant pas d’évolution de carrière
possible, Nicolas Sklèros tenta alors d’obtenir le droit de se retirer de la vie publique.
En effet plusieurs lettres évoquent la volonté de Nicolas de se retirer sur ses terres
après son expérience en Égée, ce que l’empereur lui accorde513. En réalité, cette
retraite semble n’avoir été que de courte durée puisqu’on le retrouve sous Alexis 509 KURTZ-DREXL, 44, p.73-75 ; SATHAS, 25, p.260-1 ; 65, p.297 et 95, p.328-9 510 SEIBT, W., Die Skleroi, Vienne, 1976, p.93 511 ibid., p.95, n°339 512 KURTZ-DREXL, 56, p.88-9 notamment p.89, l.4 513 KURTZ-DREXL, 37, p.60-2 ; 44, p.73-5 ; 63, p.96-7
129
Comnène, dans une lysis impériale de 1084 ou 1099, au poste de Grand Drongaire514.
Si l’on reconstruit plus synthétiquement la carrière de Sklèros. Il fut d’abord juge des
Bucellaires au le début des années 1060 puis nommé avant 1065 épi tôn déèséôn. Il est
ensuite renvoyé en province comme juge de l’Egée autour des années 1068 et 1071. Il
obtint alors de l’empereur de se retirer sur ces terres mais est rappelé des années plus
tard, probablement avant 1084 et reprend son ascension jusqu’au poste de Grand
Drongaire. Il n’y a donc pas vraiment d’évolution linéaire dans cette carrière. Il est
appelé à Constantinople, renvoyé en province. Ce n’est pas une ascension continuelle
vers les plus hauts postes de l’empire mais plutôt une succession d’aller-retour, de
grâce et de disgrâce.
Notre deuxième cas est celui de Pothos. Une partie des lettres qui le concerne
sont adressées uniquement au fils du Drongaire515. Cela semblerait signifier que
Pothos devait une partie de son influence, de son pouvoir, de sa carrière à son père
uniquement. Il aurait donc comme Nicolas Sklèros, manifestement, réussi ses débuts
professionnels grâce au soutien familial, d’autant qu’il est le cousin de Psellos. Nous
connaissons trois de ses postes de juge. Il fut juge de Macédoine516, juge de Thrace et
Macédoine517 et enfin juge de l’Opsikion518. Nous n’avons aucune datation précise
qui nous permettrait réellement d’organiser la carrière de Pothos chronologiquement.
Cependant, il est fort probable qu’il fut d’abord juge de Macédoine avant qu’on ne lui
adjoigne également le thème de Thrace. L’accumulation des deux directions de thème
constituerait une promotion réelle. On peut ajouter également que le thème de
l’Opsikion est un des thèmes les plus important d’Asie Mineure. Il est donc possible
qu’après avoir exercé en Occident dans un double thème, il reçut une nouvelle
promotion en étant nommé en Opsikion. Tout cela n’est évidemment que supposition
et comme nous l’avons remarqué, une carrière n’est pas nécessairement linéaire.
Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin, nous ne connaissons pas son nom de
famille et bien qu’il existe des sceaux de quelques Pothos, juge, il serait trop incertain
de les relier au notre519. Ce que nous savons de la carrière de Pothos reste très partiel,
514 SEIBT, W., Die Skleroi, Vienne, p. 96 515 KURTZ-DREXL, 38-39, p. 60-5; 41-42, p. 67-70 516 ibid., 220, p. 261-2 517 ibid., 250-251, p. 299-300 518 ibid., 35, p. 56-8 519 Il y a notamment un Pothos, vestès, juge du vélum et de Paphlagonie, PBW, Pothos
20110, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155484 [Consulté le 28 mai 2014 ] ; MCGEER, E., NESBITT J., OIKONOMIDES, N., Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton
130
on ne sait pas s’il commence sa carrière de juge en Macédoine ni ce qu’il aurait fait
après son poste éventuel en Opsikion. A-t-il obtenu un poste à Constantinople ou a-t-
il obtenu d’autres postes dans les thèmes ? Nous ne pouvons le savoir mais si notre
tentative de restitution est plausible alors il vraisemblable qu’il ait obtenu soit un
poste dans un thème plus important, les Arméniaques par exemple, soit un poste de
juge à Constantinople à moins qu’il n’ait subit quelques mauvais coup du sort.
Nous connaissons mieux la carrière de notre troisième cas, Basile Malésès, qui
selon E. de Vries-Van der Velden était le gendre de Psellos520. La carrière de Basile
Malesès commence vraisemblablement à Constantinople dans les bureaux du fisc de
Constantinople521. Sa carrière de juge de thème n’est pas très développée mais elle se
fait avec le soutien sans faille sinon total de Psellos522. Ce dernier dit, en effet, qu’il
ne comprendrait pas que Malesès l’oublie après tout ce qu’il a fait pour lui. Basile
Malesès obtient un premier poste dans le thème des Katôtika523. Il semble y avoir une
réussite importante notamment dans la récupération de l’impôt dans une région
notoirement connue pour son manque de coopération fiscale. La majorité des lettres
qui lui sont adressées le sont lors de son mandat dans les Katôtika. Il reçoit par la
suite grâce à la médiation de Psellos, le poste de juge des Arméniaques524. Ce
soutien se note surtout à travers les lettres que le consul des philosophes a envoyé aux
métropolites du thème afin que ceux-ci aident et soutiennent le jeune juge pour qui
cette promotion était loin d’être évidente525. Le thème est dans une situation difficile
et le jeune juge a quelques difficultés. La suite de la carrière de Malesès n’est pas
connue par les lettres. N. Duyé avance que la période d’exercice de la fonction de
juge pour Malesès se situait entre 1060 et 1066, divisé en deux fois trois ans. Il aurait
été entre 1060 et 1063, juge des Katôtika puis entre 1063 et 1066 juge des
Arméniaques. Je n’en suis pas persuadé étant donné la différence du nombre de lettres Oaks and in the Fogg Museum of Art 4: The East, Washington D.C. 2001, p.31, n°11.14 ; Et il y a aussi un Pothos, vestès, juge du vélum et grand chartulaire du Génikon, PBW, Pothos 20108, http://db.pbw.kcl.ac.uk/pbw2011/entity/person/155482 [Consulté le 28 mai 2014] ; LAURENT, V., “Sceaux byzantins inédits”, BZ, 33, p. 347-48. ; LAURENT, V., Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin, T.2 : l’administration centrale, Paris, 1981, n°341, p.164 520 DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « Psellos et son gendre », Byzantinische Forschungen,
23, 1996, p.109-49 521 DUYÉ, p.170 522ibid., p.169 et KURTZ-DREXL, 55, p. 87-8 523KURTZ-DREXL, 55, p. 87-8 ; 69-70, p. 103-4 ; 74, p.106-7 ; 76, p. 107-8; 86, p. 114-5;
SATHAS, 26, p. 261-2 ; 32- 34, p. 267-9 ; DUYÉ, p.171 524 KURTZ-DREXL, 132, p. 154-5 525 DE VRIES – VAN DER VELDEN – GENDRE, p. 114-8
131
existant pour la première période et celui pour la seconde 526 . L’arrêt de la
correspondance avec Psellos serait lié à des divergences dans le conflit politique
opposant Romain IV Diogène aux Doukai après la fin du mandat de Malesès dans les
Arméniaques. Le faible nombre de lettres s’explique donc seulement pas une durée
d’exercice du mandat de juge, plus courte. Après ce passage dans les thèmes,
Malesès rejoint Constantinople en tant qu’épi tou kanikleiou, ce qui constitue une
grande avancée car ce poste rapproche très fortement Malesès de la personne même
de l’empereur527. Il réapparait plus tard en tant que logothète des eaux au cours de la
défaite de Mantzikert en 1071 décrit par Michel Attaliatès528. Ce qui est certain c’est
que soutenu par Psellos, Malesès, issus d’un modeste milieu, obtint de hauts postes
d’abord en tant que juge puis à la cours avant de se défaire totalement de la tutelle
psellienne, finalement à son propre détriment.
Enfin si l’on étudie la carrière de Psellos, du moins son début, on note de
grandes similarités. Arrivé jeune à Constantinople, Psellos entre au service d’un
Kataphloros dont il est le secrétaire. Il voyage avec lui jusqu’en Mésopotamie. Après
cette expérience et soutenu par son ancien maitre, il obtint un poste de juge de thème.
Ce qui est certain c’est qu’il fut juge dans les Bucellaires à la fin du règne de
Constantin Monomaque. On ne sait pas s’il y reste ou s’il obtient également un poste
dans les Optimates. Après cela, il fut promut et rentre directement au service de la
cour surtout pour ses capacités intellectuelle et sa culture. Il est possible qu’il ait été
nommé au poste de prôtoasekrétis. Il réussit donc son début de carrière grâce à sa
formation et son intelligence personnelle mais assurément aussi grâce au soutien de
puissant comme Kataphloros. Le reste de sa carrière ne dépend cependant que de lui
et de ses choix.
Il est intéressant de noter que tous ces juges commencent d’abord par de petits
postes administratifs à Constantinople, où ils ont suivit leur formation, ou bien auprès
de puissants de la capitale. Ils sont ensuite nommés en province comme juge de
thème relativement jeune. Les déroulements de début carrière semblent assez
similaires. Ces hommes restent juges de thème un certain temps dans plusieurs thèmes
différents. Les meilleurs d’entre eux ou les plus soutenus retournent à Constantinople 526 Il y a 18 lettres adressées au juge des Katôtika et seulement trois au juge des
Arméniaques. 527 DUYÉ., p.173 528 MICHEL ATTALEIATÈS, The History, KALDELLIS A., KRALLIS, D., (trad.), Cambridge,
2012, p.302-30, 20.29
132
dans l’administration centrale. Il faut noter l’importance des soutiens dans l’évolution
de ces carrières. Les trois carrières que nous avons pu étudier sont celle des membres
les plus proches du cercle psellien, un cousin, un potentiel gendre et un ami très
proche. Le rôle du consul des philosophes dans leur carrière est en ce sens tout à fait
évident. Le soutien sans faille de Michel Psellos pour ses proches, même lorsqu’ils
sont en disgrâce comme Nicolas Sklèros, leur permet d’atteindre les plus hauts postes
de l’empire. Par extension le statut et l’autorité de nos épistoliers à Constantinople et
au Palais constituent donc une réelle force d’attraction pour nos juges, mus par leur
ambition.
Hypothèse et recherche de ligne directrice à partir du modèle des grandes carrières de juge.
Ces quelques carrière ne peuvent cependant être le reflet de ce qu’est une
carrière classique de juge. La proportion de lettres adressées à ces trois juges que nous
avons étudiés n’atteint qu’un peu plus d’un dixième du total de notre corpus. Il est
donc clair que ces trois personnalités n’ont que très peu de représentativité de la
masse des carrières. Il s’agit là de carrières brillantes et préparées dès l’enfance de ces
individus. Ce sont des familles, les Sklèroi comme les Xeroi, qui sont déjà intégrés à
l’aristocratie civile et dans le milieu de la chancellerie impériale. Ils n’ont strictement
aucun mal à s’intégrer à la société et à faire carrière, grâce au soutien familial. Ce
sont des archétypes de l’élite qui dès le IXe siècle monopolisait les postes. I.
Brousselle dans sa thèse démontre très bien les qualités nécessaires à tout porteur de
dignité donc à toute personne ayant une charge. Cela se réduit à quatre mots,
« puissance, richesse, naissance et culture »529. Si l’on examine par ces quatre
critères nos trois juges, Nicolas Sklèros correspond tout à fait à ce schéma. Il est donc
le produit de la reproduction des élites tout à fait logique et classique. Le seul critère
qui permet à un plus large spectre de personnes d’espérer se hisser au niveau de cette
élite traditionnelle est la culture. C’est le seul moyen de s’élever socialement530, seul
moyen d’obtenir une charge, donc un poste de juge. Cette assertion qui est valable
pour le IXe et le début du Xe siècle l’est encore plus pour la fin du Xe et le XIe siècle. 529 BROUSSELLE I., Recherches sur les élites dirigeantes de la société byzantine, (IXe siècle
– première moitié du Xe siècle, sous la direction de AHRWEILER H., 1986 (non éditée), p.45-57 530 ibid., p.56
133
N. Oikonomidès montre que les hauts postes sont de plus en plus convoités par des
hommes n’ayant pas les formations requises pour les incarner pleinement531. Ce que
démontre cette critique c’est la nécessité d’être formé pour entrer dans
l’administration. Seuls quelques hommes bien en vus issus de grandes familles
peuvent espérer être nommés à une charge sans avoir les capacités pour l’exercer.
D’un point de vue un peu plus général, le XIe siècle fut une période d’ouverture des
postes, des charges et de l’élite à un plus grand nombre d’individus issus de groupes
sociaux moins en vue. La prise d’importance de l’administration civile dans l’empire
a permis le développement d’un groupe de personnes n’ayant pour eux que leur
formation et leur culture et réussissant à arriver à de hauts postes532. Kekaumenos
insiste d’ailleurs sur la possibilité pour tout un chacun d’accéder à tous les postes de
la pyramide administrative533. La plupart de ces hommes sont donc des hommes
nouveaux qui se sont hissés à ce niveau par leurs connaissances et le réseau qu’ils ont
su créer durant leurs années de formation. C’est le cas de Michel Psellos lui même
mais aussi semble-t-il de Basile Malesès534. Il est donc assez vraisemblable qu’une
part non négligeable des juges présents dans nos lettres soient eux aussi des hommes
nouveaux. Ils se sont hissés jusque dans les écoles de Constantinople et se sont
attachés le soutien psellien, pour ceux qui nous concernent. Une partie des « fils » de
Psellos, dont M. Mullet, G. Weiss et H. Ahrweiler ont démontré qu’il s’agissait
d’anciens élèves, sont nécessairement membres de ce nouveau groupe. Ils sont les
dépendant de leur ancien professeur sans qui ils n’auraient probablement jamais fait
carrière à l’inverse d’un Sklèros ou d’un Xèros qui pouvaient toujours compter sur le
soutien familial. Au moins une partie de nos juges sont de cette catégorie. Si nous en
restons là pour ce qui est de leur origine sociale qu’on ne peut définir plus
précisément par manque d’information, il est possible d’avancer quelques hypothèses
quant à leur carrière. Psellos et Malesès ont tous les deux commencé leur carrière
531 OIKONOMIDÈS, N. « L’évolution de l’Organisation administrative de l’Empire au XIe
siècle (1025-1118) », Travaux et Mémoires, 6, p.148 ; Cela est réaffirmé par H. Saradi qui ajoute que cela conduit à avoir des juges incapable de juger, SARADI H. « The Byzantine Tribunals : Problems in the application of Justice and State Policy (9th-12th c.) », REB 53, 1995, p. 171 532 AHRWEILER, H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : Nouvelle
hiérarchies et nouvelles Solidarités », Travaux et Mémoires, VI, p.108 533 ibid., p.109 et n.39 534 RIEDINGER, J.-C., « Quatre étapes de la vie de Michel Psellos », REB 68, 2005, p. 24 ;
DUYÉ, p.168
134
administrative dans les bureaux de la Chancellerie pour le second, au service direct
d’un puissant pour le premier. Leurs connaissances et leur formation leur permettaient
vraisemblablement d’avoir des postes à responsabilités. Psellos était secrétaire
personnel de Kataphloros ce qui lui a appris à la fois à apprivoiser les puissants mais
également à définir une certaine idée de l’autorité afin de mettre en pratique les
volontés de son maitre. Malesès, s’il a probablement commencé sa carrière à des
postes subalternes a certainement connu assez rapidement des postes de direction
minime dans la chancellerie de Constantinople. Nous n’avons pas de preuve de cela
mais étant donné qu’après avoir rapidement débuté leur carrière, ils furent
directement envoyés dans les thèmes en tant que juge donc gouverneur, il est probable
et nécessaire pour eux qu’ils aient eu une expérience même petite de la direction des
affaires et des hommes. Pour en revenir à nos homines novi byzantins, on peut
légitimement penser qu’ils commençaient leur carrière après une formation solide à
Constantinople dans l’administration à la tête de petites sections dans un sekretôn.
L’âge auquel commence cette carrière reste difficile à déterminer. On sait que Psellos
et Malesès devinrent juges à un très jeune âge. Psellos était secretaire de Kataphloros
à 18 ans, on peut donc envisager qu’il fut juge vers 20 ans535. On ne connaît pas l’âge
précis de Malesès au début de sa carrière mais il devait aussi tourner autour de 20 ans.
Si l’on considère qu’ils peuvent être des exemples pour des carrières brillantes alors
peut être que les juges moyens issus de milieux modestes obtenaient leur premier
poste au cours de leur vingtaine. Il ne faut pas totalement calquer la carrière de ces
deux individus avec celle de nos hommes nouveaux d’autant qu’il n’est pas donné à
tout le monde d’atteindre les hautes sphères proches de l’empereur comme ils l’ont
fait.
Ce qui est certain c’est que la carrière commence quelque peu avant 20 ans
juste après la fin des études. Les postes obtenus avant d’être juge sont, semble –t-il,
des postes administratifs mineurs. La question est de savoir si tous les aspirants juges
commencent à Constantinople. Nous avons vu que le système éducatif byzantin et en
particulier l’enseignement supérieur était concentré dans la capitale. Il est donc
logique qu’ayant été formé à Constantinople, les juges en formation obtiennent un
premier poste dans la chancellerie. Il n’est pas cependant invraisemblable de voir
quelques futurs juges entrer directement dans l’administration thématique à la tête de
535 RIEDINGER, J.-C., op.cit., p. 23-4
135
quelques services sous l’autorité d’un juge de thème. Ce ne sont là que des
hypothèses dont la vérification est difficile mais si l’on se rappelle le chiffre
qu’avançait P. Lemerle concernant le nombre d’élèves par an en formation, environ
300 pour tout l’empire536, on note que ce dernier est trop élevé pour que chacun
trouve un poste dans la capitale. Certes ces 300 élèves n’entreront pas tous dans
l’administration civile, certains d’entre eux iront dans l’armée et d’autre dans la
hiérarchie ecclésiastique mais le nombre me semble toujours élevé. Il serait logique
qu’une partie de ces jeunes administrateurs soient envoyés dans les services des
provinces. Le Nomophylax qui a pour tâche de déterminer les élèves aptes à rentrer en
fonction537, établissait peut être une sorte de classement, les meilleurs étant affectés à
Constantinople, les moins bons en province. Dans cette hypothèse, les mieux lotis,
ceux nommés à Constantinople obtiendraient par la suite de meilleurs poste en tant
que juges de thème tandis que les autres auraient à terme des postes de juges dans des
thème plus petits. En commençant sa carrière à Constantinople, il y aurait donc plus
de chances de faire une grande carrière et de revenir à terme par la grande porte dans
la chancellerie à Constantinople à la tête d’un sekreta ou mieux encore à la cour. Les
autres auraient alors des carrières plus lentes, moins fulgurantes et plus provinciales.
Je rappelle que nous sommes ici dans le domaine de l’hypothèse. Cependant si le
modèle peut se tenir nous n’avons que peu de preuves pour l’appuyer, si ce n’est un
frêle fondement appuyé par une comparaison avec les carrières les plus brillantes.
Un autre point de vue peut éventuellement ajouter quelques éléments à la
réflexion sur les carrières moyennes des juges. Psellos et les autres épistoliers
recommandent de nombreux hommes pour qu’ils entrent dans l’administration
thématique, souvent au poste de notarios. On ne connaît pas leur âge. Il n’est pas
possible de le connaître, et nous ne savons pas non plus s’il s’agit de leur premier
poste mais il est clair qu’il s’agit la plupart du temps de leur début de carrière en
province ou du moins dans le thème où ils sont recommandés. Les fonctionnaires de
ce niveau devaient la plupart du temps faire carrière dans le thème de leur première
affectation à moins que protégés par un juge, ils ne le suivent dans ses différentes
536 LEMERLE, P., Le premier humanisme byzantin, 1971, Paris, p.252 537 WOLSKA-CONUS, W., « Les écoles de Psellos et de Xiphilin sous Constantin IX
Monomaque », Travaux et Mémoires VI, 1976, p.233-6
136
affectations538. Il est probable que le notarios, s’il entrait jeune en fonction, ne restait
pas toute sa vie à ce poste subalterne et qu’il gravissait les différents échelons de
l’administration thématique. D’autant qu’ils n’étaient pas dénués d’éducation bien au
contraire. Ils étaient capables de rédiger des actes de chancellerie nécessitant un
minimum de connaissances rhétoriques et juridiques. Si, en toute logique, la plupart
n’ont pas eu de carrière particulièrement brillante, peut être que certains d’entre eux
plus doués et soutenus par les puissants locaux, sinon par les juges successifs,
réussirent à atteindre de hauts postes dans l’administration thématique. Parmi ces
derniers peut être a –t-il existé quelques notarios ayant atteint la fonction de juge de
thème en fin de carrière. Cela constituerait pour eux une sorte d’apothéose
professionnelle contrairement à nos élèves de l’enseignement supérieur de
Constantinople. Un exemple peut éventuellement nous aider à éclaircir cette question.
Il s’agit du cas du notarios Thrakèsios évoqué deux fois par Michel Psellos539. Si
l’identification que fait E. Limousin entre notre fonctionnaire et le chroniqueur Jean
Skylitizès est bonne alors nous avons une preuve de l’existence de ce genre de
carrière. En effet, le parcours professionnel de Jean Skylitzès se termine aux plus
hauts postes du système judiciaire byzantin, Éparque et Drongaire de la Veille. Cela
signifierait qu’un simple notarios, qualifié de pauvre par Psellos540, a pu, grâce au
soutien de ses supérieurs et de Psellos lui même, obtenir de nombreuses promotions
qui l’ont mené à Constantinople. L’absence de connaissance sur le début de carrière
du chroniqueur permet de penser qu’il a pu exercer des fonctions peu élevées, comme
celle de notarios, dans sa jeunesse541. Encore une fois, tout ce développement réside
sur la véracité ou non d’une identification. Si elle s’avère juste, ce cas serait
l’exemple parfait démontrant à la fois l’ascension d’homines novi byzantins aux plus
hautes fonctions de l’empire et la possibilité pour eux d’obtenir d’excellentes
promotions en commençant en bas de la pyramide des charges, en ayant les soutiens
adéquats. L’absence de plus d’informations nous empêche de développer cette
hypothèse mais cela expliquerait aussi en partie un certain nombre de cas de juges
tout à fait inconnu. Si un notarios peut devenir grand drongaire, il peut devenir juge
de thème. Ayant alors fait une carrière uniquement thématique, n’ayant eu aucune
538 Comme l’aurait voulu le juge dans le cas du notarios Thrakèsios. Voir KURTZ-DREXL,
248 p.297-298 ; 254, p.301-2 539 KURTZ-DREXL, 248, p.297-8 ; 254, p.301-2 540 KURTZ-DREXL, 248, p.297, l.3 541 SEIBT, W., « Ioannes Skylitzes, Zur Person des Chronisten », JÖB, 25, 1976, p.85
137
fonction étatique d’importance auparavant, ce type d’homme n’apparaitrait
logiquement dans aucune autre source.
Tout ce développement est, je le répète, une longue hypothèse sur les carrières
de ceux sur lesquelles nous n’avons que peu d’éléments mais qui constituent le plus
grand nombre. Tout le monde ne devenait pas consul des philosophes ou ne se faisait
pas capturer par les Turcs sur le champs de batailles. La plupart des juges que nous
côtoyons ici ont eu une carrière moyenne, en province sans jamais obtenir de poste à
Constantinople, joyaux inaccessibles pour bon nombre de fonctionnaires byzantins.
La centralité de Constantinople : chaîne liant les juges aux épistoliers.
Les juges suivent donc différentes évolutions de carrières les menant plus ou
moins loin de Constantinople, plus ou moins haut dans la hiérarchie, plus ou moins
proche de l’empereur. Force est de constater que malgré cette multitude de parcours,
tous les juges sont obnubilés par Psellos et ce qu’il représente, c’est à dire, pour la
plupart, le seul lien direct les reliant à la capitale. Nous possédons, en effet, des
lettres de réponses faites par Psellos à des demandes multiples des juges. Psellos est
l’intermédiaire à qui les juges confient leurs soucis, leurs problèmes mais également
leurs désirs professionnels. Psellos leur rappelle constamment qu’il est bien leur
intermédiaire à Constantinople. E. Limousin récapitule toutes les allusions qui sont
faites à propos du lien entre Psellos et l’empereur542. Il liste ces expressions montrant
que Psellos a accès à l’empereur pour lui parler, sous entendu, des problèmes des
juges. Il dit ainsi « avoir l’oreille de l’empereur », « être près de l’empereur » ou plus
directement « pouvoir parler à l’empereur » 543 . Si ces expressions sont très
rhétoriques, elles ne manquent pas de mise en pratique. Ainsi dans une lettre rédigée à
un juge des Thracésiens vers 1060, Psellos se fait le porte-parole de la volonté
impériale auprès du juge544. Il lui présente un homme, qui a été condamné dans un
procès suite à des pressions et que le juge doit protéger. L’empereur considérant que
justice n’avait pas été faite, demande à ce que le juge revoie cette affaire545. Psellos
précise qu’il doit à la fois accomplir les volontés impériales et agir en ami vis à vis de
542 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p.115-21 543 ibid., p.119 544 KURTZ-DREXL, 66, p.99-100 545 ibid., p.100, l.3-5
138
lui. La tournure de la lettre indique bien que le juge doit trancher en faveur de
l’homme puisque l’empereur a décidé de rejuger l’affaire. C’est une forme de
pression sinon de menace contre toutes velléités d’indépendance du juge dans le
traitement des recommandations. Cet homme fait vraisemblablement partie de la cour
et bénéficie du soutien impérial. Le juge doit donc entériner une décision sans
possibilité de réfléchir sur le cas. La seule référence à un homme soutenu par
l’empereur, semble d’après cette lettre, ordonner au juge de le favoriser, peut être
dans l’espoir d’en tirer quelques profits ultérieurs. C’est assez typique du XIe siècle
qui voit une augmentation de l’influence de l’entourage direct de l’empereur. Cet
entourage que Psellos nomme « le Palais »546 est le carrefour de tous les pouvoirs et
de toutes les décisions. Le sort des juges y est décidé comme celui de toute l’élite de
l’empire. Cette cour est composée de l’élite administrative et ecclésiastique
constantinopolitaine et des fidèles de l’empereur. H. Ahrweiler avance que les
byzantins y voyaient comme une sorte de gouvernement de l’empire mais aussi
comme un lieu de vie mondaine où il fallait absolument paraître pour exister547. À ce
titre la position des juges de thème est particulièrement compliquée. Envoyés dans
les provinces pour diriger les thèmes, ils sont éloignés du lieu où se tranchent les
affaires et les carrières. À Constantinople, à l’inverse, Michel Psellos mais également
une partie de nos épistoliers, sont eux très proches du pouvoir et membres de ce
gouvernement informel. M. Angold considère même Psellos comme un arbitre dans
les affaires d’Etat et un homme qui utilise son réseau pour se garantir un vrai pouvoir
d’influence auprès de la personne impériale et de son administration548.
Nous touchons là à la clé du problème, au moteur de la relation entre les
épistoliers et nos juges. Psellos est en contact permanent avec les juges et avec la
cour impériale. Il est le seul qui puisse faire valoir les droits de la plupart des juges et
de discuter pour leur obtenir des faveurs et des promotions. Ils sont totalement
dépendants de ce lien. Certaines lettres laissent d’ailleurs transparaitre l’inquiétude
réelle des juges quant à ce qui se décide pour eux à Constantinople. Plusieurs lettres
envoyées à Psellos par des juges témoignent de leurs inquiétudes quant à la santé de
leur protecteur. Les réponses de Psellos tentent de les rassurer. Dans une lettre, en 546 AHRWEILER, H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : Nouvelle
hiérarchies et nouvelles Solidarités », Travaux et Mémoires, VI, p.104-6 et n.16 547 ibid., p.106 548 ANGOLD, M., « The Byzantine State on the Eve of the Battle of Mantzikert »,
Byzantinische Forschungen, 16, 1991, p.29
139
réponse à un juge de Paphlagonie549, il lui précise que malgré des problèmes de santé,
il ne doit pas s’inquiéter et continuer à avoir foi en « son véritable ami Psellos »550 qui
travaille pour lui auprès de l’empereur. Le juge de Paphlagonie questionnait
probablement Psellos sur sa capacité à plaider sa cause auprès de l’empereur. Cette
inquiétude est tout à fait légitime puisque dans d’autres lettres, Psellos répond que ses
maladies l’ont empêché d’aller au Palais551. Dans un cas, il précise même clairement
au juge qu’il n’est plus en mesure de s’occuper de son affaire et le renvoi vers un
autre proche de l’empereur, ici Constantin Leichoudès552. L’inquiétude des juges est
donc tout à fait fondée et démontre l’importance de Psellos pour eux puisqu’il est leur
seul lien avec la cour. Il est également le seul à pouvoir informer les juges de ce qui se
passe précisément sur le plan politique et administratif à la cour. De fait les juges sont
clairement dépendants de Psellos, ce qui explique, leur promptitude à assouvir tous
ses desiderata et à recevoir toutes ses demandes et recommandations. Les juges
semblent également s’inquiéter de ce qui se dit sur eux, en particulier si cela peut
nuire à leur carrière. Dans une lettre à un juge de Macédoine, Psellos répond qu’il
ferait mieux de faire son travail et d’ignorer les ragots et les rumeurs553. Il est là sur
place pour réduire tous ces mensonges à néant554. Psellos joue ici clairement son rôle
de protecteur des intérêts et de la réputation des juges. Il est probable qu’il se
chargeait également de régler les problèmes plus matériels qui concernaient les juges
comme des problèmes de propriété ou autres. Cela nous ne le voyons pas, Psellos
usant toujours de périphrases sans sens précis. Ce que nous pouvons remarquer, c’est
qu’il n’y a aucune lettre de Psellos où il se refuse à régler une affaire pour les juges.
On peut arguer qu’il aurait très bien pu les retirer de sa collection de lettre pour ne pas
ternir son image puisqu’il l’a, semble-t-il, composée lui même555. Cependant, sans
parler d’interdépendance entre les juges et les épistoliers, il était nécessaire à Psellos
d’au moins promettre en mots qu’il s’occuperait des affaires des juges afin de les
garder sous son joug. Psellos dit s’occuper des problèmes constantinopolitains des
549 SATHAS, 49, p.280-1 550 ibid., p.281, l. 3 : «[…] ἐπὶ τῷ σῷ ἀληθῶς φίλῳ Μιχαήλ » 551 SATHAS, 73, p. 308, l.6-7 552 ibid., p.309, l.1-3 et 5-7 553 KURTZ-DREXL, 7, p.8-9 554 ibid., p.9, l.4-6 555 DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « The Letters of Michael Psellos, Historical Knowledge
and the Writing History », L’épistolographie et la poèsie épigrammatique., Paris, 2003, p. 130
140
juges quand eux accomplissent sans grande liberté les volontés pselliennes. Les lettres
nous montrent en quelques cas un Psellos très actif notamment pour aider son cousin
Pothos. Dans une de ses lettres Psellos lui précise que son courrier pour l’empereur
est arrivé trop tard pour être lu par l’empereur dans la journée mais par l’intermédiaire
de son oncle et le secrétaire de l’empereur que Psellos connaît bien, elle fut lue hors
séance556. Cette lettre avait notamment pour sujet, les attaques que devait subir
Pothos à la cour557.
L’activité psellienne se discerne surtout dans le domaine des carrières.
Plusieurs lettres confirment à la fois le rôle important de Psellos mais également
l’importance fondamentale que prend la parole impériale dans ce champ de décision.
Les carrières sont décidées par l’empereur et la cour et non par un quelconque organe
administratif qui régirait les fonctionnaires provinciaux. On aurait pu penser que l’épi
tôn kriséôn en tant que juge surveillant le travail des juges de thème pouvait être
responsable de leur gestion. Ce n’est pas le cas même s’il est probable qu’il avait son
avis à donner sinon peut être des rapports à rédiger. Dans une lettre envoyée à un juge
inconnu, Psellos annonce la réaction de l’empereur à sa demande de mutation faite
auparavant558. L’empereur est prêt à lui donner une promotion. Le juge exerce alors
dans un petit thème. L’empereur lui propose donc un thème de taille moyenne, les
grands thèmes étant tous déjà occupés. Cela nous confirme le rôle fondamental de
l’empereur dans le jeu des mutations et des promotions. Il semble selon cette lettre
qu’il faille déposer une demande personnelle auprès de l’empereur pour qu’il tranche.
L’impossibilité pour le juge d’être nommé dans un grand thème indique bien que
l’empereur ne peut pas faire tout ce qu’il souhaite et doit respecter une certaine
cohérence administrative. Les juges ne sont, pour le coup, pas des pions aisément
déplaçables sur la carte des thèmes.
Deux autres cas font référence à la volonté de deux de nos juges, Zôma et Nicolas
Sklèros, de mettre fin à leur carrière. La lettre adressée à Zoma, juge de l’Opsikion,
lui annonce le refus de l’empereur de le laisser partir au monastère même si ce désir
est motivé par des problèmes de santé559. L’empereur, ayant eu vent de la réputation
d’excellent administrateur du juge ne peut se décider à le laisser quitter ses
556 KURTZ-DREXL, 41, p.67-9 557 ibid., p.68, l.14-18 558 KURTZ-DREXL, 255, p.302-3 559 SATHAS, 190, p.483-5
141
fonctions 560 . Cela démontre deux choses. Premièrement, les excellents
administrateurs ne devaient pas être si nombreux puisqu’en laisser partir un semble
poser problème. Deuxièmement, il est probable que cette volonté de Zôma de se
retirer au monastère arrive à un âge assez précoce. Psellos lui précise qu’il a le choix
entre insister auprès de l’empereur si c’est une question vitale ou attendre, ce qui
corrobore cette hypothèse.
Il en est de même pour le cas de Nicolas Sklèros qui souhaitait se retirer sur ses terres
de Mitza Kathara561. Plusieurs lettres de Psellos concernent cette affaire, les différents
progrès qu’il fait jusqu'à ce que l’empereur semble lui accorder sa retraite et le relève
de ses fonctions de juge de l’Egée alors qu’il n’est pas au plus haut dans l’estime
impériale562.
On constate donc assez aisément que pour tout ce qui se décide à
Constantinople, l’avenir, les fortunes et les gloires, les juges sont prisonniers de leur
relation avec Michel Psellos. Même si Nicolas Sklèros qui semble avoir commencé sa
carrière et poursuivi celle ci avec un peu d’indépendance vis à vis du consul des
philosophes, il se voit contraint de le laisser négocier son départ en retraite. Les juges
sont donc en ce qui concerne leur destin professionnel tout à fait dépendant de
Psellos. Cela explique en grande partie le manque de liberté qu’ils ont vis à vis des
demandes de Psellos. Un juge souhaitant avoir une carrière longue ne peut se passer
du soutien à la cour incarné par Psellos. Il ne peut donc se permettre de le contrarier.
Conclusion
Les juges doivent nécessairement trouver dans leur relation de dépendance avec
épistolier un avantage, un profit. Ce profit, il faut le trouver dans l’ambition des juges
qui voient dans ces relations hiérarchisées un moyen d’atteindre par procuration
Constantinople, le milieu du Palais si ce n’est la personne impériale. En effet, les
décisions concernant des carrières et des promotions reviennent moins aux épistoliers
qu’a l’empereur. De ce point de vue tout semble se dérouler à Constantinople. Il est
donc nécessaire au juge d’y avoir un relais. Chaque juge regarde également vers la
capitale non comme simple organe de décision mais comme ambition. Seul les
meilleurs semblent destinés à y revenir, nommés à une fonction de l’administration
560 ibid., p.483, l.8-14 561 KURTZ-DREXL, 63, p.96, l.27 562 KURTZ-DREXL, 37, p.60-2 ; 44, p.73-5 ; 56, p.88-9
142
centrale. Encore une fois sans l’aide et le soutien de puissants tels que nos épistoliers
l’obtention de telles fonctions n’est pas envisageable. Dans cette ambition repose une
part de cette dynamique de soumission volontaire des juges vis à vis des épistoliers.
143
Chapitre 3 - La vie des juges : Sur les routes de la déception et de l’isolement.
Si le moteur de cette relation de sujétion entre les juges de thèmes et nos
épistoliers est bien l’ambition et la volonté tout à fait naturelle de faire carrière, il est
nécessaire de questionner l’efficacité de cette démarche. Cette interrogation doit se
faire à la fois sur le plan strictement professionnel sur l’efficience des demandes de
promotion et de mutation mais également sur un plan plus personnel. Il faut se
demander si cette relation apporte autant de bénéfice au juge qu’elle les oblige à se
compromettre.
Le juge-planète face à l’arbitraire impérial
Le besoin constant des juges de se tenir au courant des évènements
constantinopolitains par le biais de leurs protecteurs se comprend dans le sens d’une
inquiétude concernant leur carrière. Si les épistoliers sont en mesure de faire part à
l’empereur des désirs de changement de certains juges, ils ne sont pas réellement
capables de garantir une quelconque concrétisation. Nous en avons déjà vu un
exemple ; Celui d’un juge devant se contenter d’un thème de moyenne envergure en
guise de promotion alors qu’il aurait pu prétendre à un thème de premier plan563.
Dans ce cas, la déception est toute relative puisqu’il s’agit toujours d’une promotion.
Plusieurs autres lettres semblent démontrer le peu de prise que les épistoliers, donc de
fait les juges, avaient sur les évolutions de carrières. Philetos Synadenos en est un
exemple. Dans son cas, il ne nous est pas possible de savoir s’il avait fait une
demande de promotion ou de transfert. On sait cependant qu’il est envoyé depuis
Constantinople564 pour prendre le contrôle administratif de Tarse en Cilicie reprise
aux Hamdanides depuis 965. Les lettres sont datées de la période 1000-106 durant
laquelle Nicéphore Ouranos à qui il écrit était gouverneur d’Antioche. Lorsqu’il
évoque l’ordre impérial qui le contraint à aller en Cilicie, il évoque « un ordre plus
brûlant que le feu de l’Etna »565. Il ne faut pas ici sur-interpréter ce qui est une
formule poétique mais l’image, en elle même, indique à la fois le caractère tout à fait
563 KURTZ-DREXL 255, p. 392-3 564 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADÉNOS, 11, p. 257, l. 1-2 565 ibid., 12, p. 257-8, l. 3-4
144
arbitraire de l’injonction et l’impossibilité pour Philetos Synadénos de s’y opposer.
Peut être a –t-il essayé et expérimenté la nature de ce feu volcanique. Cela dit, il ne
semble pas trop déçu puisque cette nomination le rapproche de son « ami » Nicéphore
Ouranos.
D’autres en revanche sont clairement désespérés par leur nouvelle affectation.
Deux lettres de Jean Mauropous, rédigées entre 1028 et 1046 à l’intention d’un jeune
juge, peut être Psellos, sont des épitres de consolation. Le juge des Paphlagoniens a
été transféré dans le thème des Bucellaires566. On ne connaît pas l’objet de cette
déception puisque, comme le dit Mauropous, le juge augmente son territoire et par ce
biais son pouvoir567 . Le thème des Bucellaires est plus grand que celui des
Paphlagoniens. Il est donc plus important, mieux placé dans la hiérarchie et constitue
nécessairement une plus grande source de revenus à la fois pour l’Etat et pour le juge.
Pour justifier sa déception, le juge avance qu’il troque sa richesse chez les
Paphlagoniens contre une pauvreté 568 . Il est bien difficile de comprendre cet
argument, peut être évoque –t-il la richesse dans ses relations sociales. Il semble en
tout cas qu’il n’était pas dans les plans du juge d’être nommé dans ce nouveau thème.
Peut être souhaitait il obtenir un poste à Constantinople. On note dans tous les cas
qu’une nouvelle fois, les juges ne sont absolument pas maitres de leur position
administrative mais également géographique. Plus tard, Psellos a écrit également ce
genre de lettre afin de consoler des juges tout autant déçus qu’il l’avait été lui même.
C’est le cas par exemple pour une lettre qu’il écrit à un juge des Thracésiens
vraisemblablement déçu de sa promotion569. Il tente alors par une blague sur le nom
Moschos, d’un de ses notarios, de le faire sourire570.
La déception concernant une promotion ou une évolution de carrière non
souhaitée, ou moins brillante, n’est pas quelque chose de spécifiquement byzantin
mais elle s’accompagne dans notre cas d’un sentiment d’incertitude et d’instabilité
permanent. Cette instabilité due à l’arbitraire impérial se perçoit assez aisément. Les
promotions ou mutations dépendent grandement de la conjoncture administrative
comme le montre la justification de Psellos pour consoler un juge571. Il précise que les
566 JEAN MAUROPOUS, 6, p. 55, l. 18-19 567 ibid., 9, p.63, l.10-12 568 ibid., 6, p. 55, l. 21-23 569 KURTZ-DREXL 61, p. 93-4 570 ibid., §1 571 ibid., 255, p. 303, l.4-7
145
juges de grands thèmes viennent d’être nommés ou ne peuvent être changés pour le
moment572. Ce juge fait donc sa demande à un moment peu opportun pour espérer
une promotion dans ces thèmes là. En réalité, il semble que cela ne dépende
uniquement du bon vouloir de la personne impériale. Dans une lettre que Psellos
rédige pour un juge, proche parent, il précise que pour ce qui est des promotions, il
sait que l’empereur souhaite faire des changements généraux concernant les juges de
thème mais qu’il diffère sans cesse l’affaire573. Cette courte phrase nous indique que
l’empereur est bien le seul à pouvoir prendre des décisions sur ce sujet, même s’il est
vrai qu’il peut se faire influencer, là est la brèche par laquelle se faufilent nos
épistoliers. Les mutations et promotions de juges ne sont en tout cas pas une affaire
traitée de manière programmée et régulière. Le fait que Psellos précise, ici que
l’empereur envisage un changement général, indique peut être que ce n’est pas la
règle. Les promotions et transferts étaient probablement des affaires gérées au cas par
cas. L’image des juges chez les épistoliers est sur ce sujet celle de fonctionnaires
n’ayant pas vraiment de maitrise sur leur propre vie et sur leurs mouvements. Jean
Mauropous dans une lettre de 1048-1049 à un juge utilise une formule assez
éloquente574. « Vous, les juges, tel des planètes, vous êtes habitués à aller de
province en province. »575 Cette image montre bien que le juge de thème est conçu
comme un homme perpétuellement en mouvement. Je ne peux pas développer ici les
conceptions astronomiques byzantines mais Mauropous précise que le juge qui était
à l’Est arrivera tôt ou tard à l’Ouest pour les illuminer576. Peut être Constantinople
est elle vue comme la terre autour de laquelle tourne les juges en province sans
jamais s’arrêter ni d’ailleurs entrer en collision avec elle. Il s’agit peut être d’une
indication montrant bien que pour la plupart des juges, un poste à Constantinople
n’est qu’un doux rêve qui reste abstrait.
Quoiqu’il en soit, on peut noter cette idée de déplacement continuel des juges
dans d’autres lettres. Il s’agit généralement de lettres envoyées à des juges dont nos
épistoliers avaient perdu la trace. Une lettre amicale de Nicéphore Ouranos au juge de
572 ibid., l.10-13 573 DE VRIES – VAN DER VELDEN – GENDRE, p.122 ; SATHAS, 146, p. 395, l. 21-23 574 JEAN MAUROPOUS, 46, p. 140-1 575 ibid., p. 141, l. 10 : « καὶ γὰρ δὴ καὶ πλάνητες ὐµεῖς οἱ κριταὶ ἐν ἄλλοτε ἄλλῃ τῶν επαρχιῶν διατρίβοντες προαιρετικὴν ὡσανεὶ καὶ οἰκείαν τὴν φορὰν ἀπαιτοῦµεν.» 576 ibid., l. 13-14
146
Colonée en est un exemple577. Il semble que le juge se soit plaint de ne recevoir
aucune nouvelle du général. Ouranos lui répond qu’il ne l’avait pas oublié mais ne
pouvait lui faire parvenir des lettres, ne connaissant pas l’endroit où les adresser.
Cette lettre montre peut être ici un juge qui fut transféré depuis peu dans le thème de
Colonée. Le fait que son ami Nicéphore Ouranos ne soit pas au courant indique que
ce changement a été fait de manière rapide et que le juge n’a alors pas eu le temps de
régler ses affaires. L’administration gère ses effectifs avec quelque peu de brusquerie
et d’arbitraire. Une autre lettre de Psellos témoigne des souffrances accompagnant
l’éloignement des juges de Constantinople578. Psellos se plaint du départ d’un de ses
amis envoyé comme juge de thème en province ; Il se plaint de la séparation et
souhaite son retour579. Cette volonté affirmée n’est que théorique. Psellos précise
qu’il dit ne pas supporter la douleur et préférer la rencontre des corps, à la
communion de l’âme comme le voudraient Platon ou Aristote580. Psellos n’a pas pu
empêcher le départ de son ami. Peut être cette lettre n’est elle que tout à fait
rhétorique, peut être aussi que Psellos était tout à fait impuissant dans cette affaire. La
destinée des juges n’est pas dans l’inertie et la sédentarité mais bien dans le
mouvement.
La durée de ces mouvements est aussi en question. Nos lettres ne nous donne
que peu d’indication à ce sujet. E. Limousin avance que la durée d’un mandat de juge
de thème était de trois ans581. Cela est également affirmé par N. Duyé582. Cette idée
se fonde sur un passage des Recommandations et Conseils de Kekaumenos. Il y décrit
le comportement d’un empereur qui aurait envoyé un juge de Constantinople en
province pour mieux pouvoir séduire son épouse583. Il précise que l’homme revient à
Constantinople après trois ans584. Cependant rien n’indique que ces trois ans étaient
déterminés par une sorte de durée légale d’un mandat. G. Weiss précise bien que les
durées de ces affectations semblent en réalité beaucoup plus variables585. On peut
577 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 24, p. 228 578 KURTZ-DREXL, 160, p . 187-8 579 ibid., p.187, l.16-18 et plus généralement §2 580 ibid., l. 10-13 581 LIMOUSIN – ETUDE DU FONCTIONNEMENT, p.111 582 DUYÉ, p.171 583 KEKAUMENOS, SPADARO, M.D. (ed., trad.), Raccomandazioni e consigli di un
galantuomo, Alessandria, 1998, Chap. 102, p.150-3, voir en particulier l. 17-20 584 ibid., p.150, l.24 : « µετὰ δὲ τρεῖς ἐνιαυτοῦς ἐλθὼν ἀπὸ τοῦ θέµατος ὁ ἀνὴρ […]» et
n.28 585 WEISS – OSTRÖMISCHE BEAMTE, p. 38-41
147
penser tout au plus que les juges restaient durant toute leur période d’exercice dans le
thème dans lequel ils ont été affectés. Il me semble donc que cette hypothèse de
mandat de trois ans n’est pas fondée, d’autant qu’un certain nombre de lettres évoque
indirectement l’absence durée d’exercice du mandat de juge de thème. Jean
Mauropous dans sa fameuse lettre évoquant les juges-planètes demande à son
interlocuteur le moment où il repassera Constantinople586. Mauropous ne sait pas
donc pas quand son ami termine son mandat, cela démontre bien qu’il n’y avait pas de
durée fixe. Il en est de même chez Léon de Synada écrivant à un certain
Malakeinos587. Son cas est un peu différent puisqu’il est possible qu’il ait été exilé un
temps pour sympathie pro-bulgare588. Cela n’est qu’une hypothèse cependant fondée
sur une onomastique similaire. S’il ne s’agit pas du même Malakeinos alors Léon de
Synada s’interroge également sur le moment qui les verra se réunir de nouveau. De ce
point de vue, on peut pas clairement dire que les épistoliers connaissent une
quelconque idée de mandat ou de durée fixe pour la période d’exercice des juges. De
même Psellos ne semble pas bien savoir quand il retrouvera son ami envoyé loin de la
Ville. Tant d’ignorance contredit, à mon avis, l’hypothèse avançant que le mandat des
juges avait une durée fixe de trois ans.
Ces quelques lettres témoignent en tous cas de la difficulté pour les juges
ayant réussi à faire une carrière, à mener la vie que l’administration sinon l’empereur
leur impose. Ils sont nommés et déplacés au gré des changements et des
conjonctures, souvent sans leur accord et pour des destinations parfois peu enviable.
La durée de service quand à elle n’étant pas fixe, les juges n’étaient pas vraiment
maitre de leur carrière et encore moins de leur vie.
Le juge en terre hostile : la constantinopolisation des esprits
La carrière de juge est fractionnée entre les diverses affectations et les
quelques retours rapides à Constantinople, elle se déroule principalement loin des
fastes et du dynamisme de la Ville. Cet éloignement est une vraie douleur pour les
juges qui en tant que membre de l’élite intellectuelle de l’empire ne supportent que
peu l’inculture présumée des populations provinciales. S’il y a peu de déclarations
586 JEAN MAUROPOUS, 46, p.140-1 l.11-14 587 LÉON DE SYNADA, 23, p. 38-9 588ibid., p. 111-2
148
d’amour explicites à Constantinople, les lettres sont beaucoup plus claires quant il
s’agit de commenter le comportement des autochtones.
Jean Mauropous dans une lettre visant à faire innocenter des protégés utilise une
argumentation fondée sur le fait qu’ils étaient Paphlagoniens donc ignorants et
irréfléchis par nature589 Il réitère ce même genre d’affirmation dans la lettre qu’il
rédige à l’intention d’un juge, probablement Michel Psellos, alors promus au thème
des Bucellaires590. Psellos a émis une critique contre les habitants de Claudiopolis,
siège épiscopal dans son thème. Mauropous nuance son propos, que nous ne
connaissons pas, et dit : « Ne reproche pas aux habitants de Claudiopolis d’être à
moitié secs et à moitié morts car ils ont un berger à moitié aveugle. »591 L’attaque est
ici double, Psellos a reproché aux Claudiopolitains d’être mous et sans dynamisme
sinon totalement amorphes quand Mauropous s’attaque directement à l’un de ses
confrères. Ce genre de critique n’est pas unique chez Psellos. Dans une lettre qu’il
rédige à Chasanès, juge de Macédoine, il décrit les coutumes et les comportements
des habitants de Rodinos comme étant de pur barbarismes592. Cette comparaison
entre les thèmes et des terres barbares, Psellos la reprend pour parler de lieux autrefois
centre culturels et intellectuels importants. C’est le cas à propos de la Grèce et en
particulier d’Athènes. Dans deux lettres au juge des Katôtika, il met en garde le juge
contre l’inculture des habitants de l’Hellade593. Dans la première, Psellos argumente
sur l’idée qu’il faut se lier d’amitié avec les Athéniens 594 . Cette volonté
argumentative dénote peut être d’une forme de rejet qu’aurait eu le juge lors de son
arrivée dans le thème. Psellos avance que les Athéniens sont les descendants de
Périclès et d’autres et à ce titre, ils méritent cette amitié même s’ils leurs sont bien
inférieurs595. En soit ce n’est déjà pas une très bonne opinion de ces population mais
Psellos en rajoute dans sa deuxième lettre. Il répète ce que le dioiketès d’Athènes a
pensé lors de son arrivée dans la ville596. Selon lui, le thème d’Hellade est semblable
589 JEAN MAUROPOUS, 11, p. 64-7 590 JEAN MAUROPOUS, 6, p. 54-7 591 ibid., p.57, l.37-38 « Τῇ δὲ Κλαυδίου µὴ πάνυ τὰ τῆς ἀπορίας ὀνείδιζε, ἡµιξήρῳ πως οὔσῃ καὶ ἡµιθνήτῳ διὰ τὸ τοῦ ποιµένος ἡµιτυφλον, […] » 592 SATHAS, 189, p. 483, l.1-3 593 SATHAS, 20, p. 258 et 33 594 ibid., 20, p.258, l.6-8 595 ibid., l.5-6 596 ibid., 33, p. 268
149
au pays des Scythes597. Il ne s’agit ici pas d’une comparaison avec les Scythes en eux
même mais bien avec l’archétype littéraire antique du Scythe, l’image même du
barbare inculte, désordonné et rustre. Ce mépris permanent à l’endroit des
populations provinciales n’est pas une spécificité développée par l’aristocratie et
l’élite intellectuelle de la seconde moitié du XIe siècle puisque Philetos Synadénos
développe également le même type d’argument. Envoyé à Tarse pour y servir comme
juge, il n’hésite pas à insulter les populations autochtones. Dans une lettre au
Patriarche d’Antioche, il demande qu’il lui écrive une lettre dans son style sublime598.
Cette lettre lui permettrait de s’échapper intellectuellement du milieu dans lequel il se
trouve, c’est-à-dire entouré de « stupides Ciliciens qui barbarisent son esprit ».599
Philetos Synadenos est cependant plus dans le rejet de son affectation que dans le
mépris général de la population. Dans deux lettres à Nicéphore Ouranos, il dit son
désamour de cette région de Tarse. Il dit ne pas aimer ni Tarse ni Antioche alors qu’il
quitte Constantinople600 . Cette opposition entre Tarse et Antioche d’un côté et
Constantinople de l’autre montre bien l’attachement de l’homme à la capitale et son
peu d’inclination pour la Cilicie, région reconquise, située aux marches de l’empire.
Il précise d’ailleurs que cette région est hostile par essence à cause de son climat.
« J’ai posé le tarse de mon pied à Tarse, lorsque ceux qui tiennent à la vie lèvent le
pied de là. »601 Son aversion pour la région et la province de manière est générale est
totale. Concernant les populations locales, il est clair qu’elles étaient moins éduquées
que celle de Constantinople, du moins que le cercle réduit que fréquentent les juges.
Pour autant, l’accusation de barbarie est une complète exagération. C’est une manière
purement élitiste de se comporter, typique de ce cercle formé par l’élite intellectuelle
constantinopolitaine. Encore au XIIe siècle, Eustathe de Thessalonique employait des
arguments identiques contre la population de sa métropole, deuxième cité de l’empire
en importance économique et culturelle602. Il critiquait la rudesse des Thessaloniciens
comme leur impiété et ne cessait de se plaindre de sa situation, loin de
597 ibid., l. 3 « […] ὡς τὴν Σκυθῶν θεασάµενος[…]» 598 DARROUZÈS – PHILETOS SYNADENOS, 7, p. 254 599 ibid., l.8 : «[…] ὁ τοῖς ἀνοήτοις Κίλιξι συµβαρβαρωθείς […] » 600 ibid., 11, p257, l.1 601 ibid., 12, p. 257, l.1-2 602 ANGOLD, M., Church and Society under the Comneni, 1081-1261, Cambridge, 1995,
p.179-196 et spécifiquement p.179-80
150
Constantinople. Ses ouailles le lui rendaient bien603. C’était une vision tout à fait
partiale de Thessalonique qui n’était certes pas Constantinople mais n’avait rien à voir
avec un petit village des montagnes paphlagoniennes sorti de l’esprit de Jean
Mauropous. Cela montre bien l’ineffectivité de la réalité de ces informations. Il s’agit
bien d’une posture d’Eustathe de Thessalonique et de manière générale, de nos juges
et nos épistoliers. Depuis le milieu du Xe siècle la haute société byzantine s’est
constantinopolisée, du fait notamment de la concentration de l’enseignement
supérieur dans la Ville et évidemment la présence de la cour impériale seul espace de
tous les possibles concernant les carrières, les dignités, les gloires et les fortunes604.
Une lettre de Nicéphore Ouranos témoigne assez bien de cette constantinopolisation
de l’élite. Il rédige une lettre à un juge des Thracésiens pour une demande
d’exemption fiscale605. Cette exemption lui enlèverait les difficultés inhérentes à un
individu dans sa situation, c’est à dire un homme, « citadin par nature, paysans par
nécessité. »606 Comme le montre, E. Limousin, Nicéphore Ouranos oppose ici la
πολιτικόν βίον et la γεωργικόν βίον, la vie qu’il souhaiterait avoir et celle qu’il vit du
fait de sa fonction, envoyé au quatre coins de l’empire loin de la Ville607. E. Limousin
lie cette vie citadine à l’idée que la citoyenneté byzantine pour Psellos est fondée sur
l’action de philosopher. Être citoyen c’est avoir une culture et une formation obtenue
à Constantinople, et mettre en pratique la philosophie dans sa vie608. Être citoyen
c’est donc être un citadin nécessairement cultivé, un Constantinopolitain. Cette vision
à la fois de la citoyenneté et de la vie citadine, qu’il faut entendre au sens d’habitant
de la capitale, isole un peu plus les juges des populations qu’ils dirigent et avec
lesquelles ils vivent.
L’isolement n’est cependant pas qu’intellectuel ou lié à l’absence d’harmonie
du niveau culturel entre les populations locales et les juges de thème. Elle est aussi
tout à fait physique et géographique, notamment pour les thèmes d’Asie Mineure.
Certaines lettres de Psellos montrent que le voyage jusqu'à certaines provinces 603 ODORICO, P., Thessalonique, Chronique d’une ville prise, Toulouse, 2005, p.26-7 ; EUSTATHE DE THESSALONIQUE, Relation sur la dernière – plaise à Dieu- prise de
Thessalonique, ODORICO, P. (trad., com.), op.cit., p.251-4 604 AHRWEILER, H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : Nouvelle
hiérarchies et nouvelles Solidarités », Travaux et Mémoires VI, p.99-124 605 DARROUZÈS – NICÉPHORE OURANOS, 42, p. 241-2 606 ibid., p.241, l.5 : «[…]φύσει µὲν πολιτικόν, ἀνάγκῃ δὲ γεωργόν,[…] » 607 LIMOUSIN E., « Les Lettrés en société : « φιλος βιος » ou « πολιτικος βιος » »,
Byzantion, 69, 1999 p.348 608 ibid., p.349
151
reculées, au départ de Constantinople, constitue un obstacle important qui sépare
durablement le juge de la capitale. Dans une lettre au juge des Thracésiens à propos
d’un clerc impérial souhaitant devenir évêque de Paiona, Psellos met en avant le long
voyage effectué par lui depuis la capitale et l’incertitude de son arrivée dans les
temps609. Si le clerc arrive trop tard, le juge a pour devoir de prendre soin de lui.
Psellos met donc bien l’accent sur l’aspect lointain de la province et les difficultés
inhérentes à un voyage à travers l’Anatolie. Dans une seconde lettre à un juge de
Paphlagonie, Psellos prévient de l’arrivée d’un notarios610. Il est parti sans l’accord
psellien de Constantinople pour rallier la position du juge. Psellos s’inquiète pour le
voyageur qui a commencé son périple jusqu’en Paphlagonie en plein hiver611 et doit
traverser des « montagnes de glaces » pour arriver dans la capitale du thème612. Le
climat et la géographie du terrain joue nécessairement sur la difficulté du voyage mais
à l’inverse constituent également un obstacle entre le juge et la cour impériale, entre
sa ville d’affectation et la Constantinople tant désirée. Cette idée de séparation
géographique dû aux vicissitudes et aux dangers des routes est souvent mentionnée
par Psellos613. Les juges semblent donc fixés à leur thème, cloitrés dans leur province,
dans un territoire qu’ils jugent hostile, sinon peu avenant.
Ce qui ressort de ces différents avis de nos juges sur leur environnement de
vie, c’est bien une sorte d’isolement. L’isolement vis à vis des populations locales,
qui ne sont pas jugés par eux comme des dignes interlocuteurs notamment par leur
manque de culture et leur ignorance, mais aussi un isolement géographique dû aux
contraintes climatiques et géomorphologiques du territoire byzantin. Cet isolement
accentue d’autant plus le désir des juges pour Constantinople, sa société et ses cercles
d’intellectuels. Ce sentiment d’isolement révèle bien, ce que H. Ahrweiler considérait
comme une maladie614, une sorte de « constantinopolite. »
609 KURTZ-DREXL, 130, p. 153 l. 5-8 610 KURTZ-DREXL, 109, p. 137-8 611 ibid., p.138, l.1 612 ibid., l.7-9 613 Entres autres KURTZ-DREXL, 131, p.154, l.7-8 ; 54, p.86, l.24-28 ; SATHAS, 54, p. 285,
§2 614 AHRWEILER, H., op.cit., p. 102
152
Le juge isolé socialement dans son thème et dans son milieu professionnel
Le juge de thème est isolé intellectuellement et géographiquement. Cet
isolement est accentué à la fois par le comportement de ses administrés mais
également par celui des membres de son groupe social. Nous avions déjà noté la
distance qui semble exister entre le juge et les habitants des thèmes qu’ils dirigent.
Les lettres nous laissent penser que dans de nombreux cas, il n’est pas possible pour
la population locale d’avoir aisément accès au juge et à ses services pour leurs
soumettre ses problèmes. Il lui est toujours nécessaire d’avoir le soutien d’un
puissant, constantinopolitain pour espérer obtenir un règlement ou une solution. Que
le juge ne soit pas accessible à tout un chacun, cela paraît logique puisqu’il ne peut
logiquement pas recevoir n’importe qui pour écouter ses doléances. L’accès à
l’administration thématique semble cependant lui aussi tout à fait difficile. Cela crée
nécessairement une distance entre la population et les représentants de l’autorité, peut
être même un sentiment de défiance. Ce ressentiment vis à vis de l’autorité se trouve à
de nombreuses reprises dans les lettres.
Si l’on utilisait uniquement les réponses de Psellos aux juges pour décrire le
comportement des populations locales, nous aurions alors un tableau extrêmement
sombre et surtout faussé de la situation. Pour le consul des philosophes, l’agressivité
des populations locales est un fait qui n’est plus à démontrer. Une lettre qu’il écrit au
juge des Optimates est en ce sens assez représentative. Il évoque un propriétaire
terrien ayant un petit domaine fort peu productif dans son thème615. Rappelant le
comportement des habitants du village voisin à l’égard dudit propriétaire, Psellos
utilise l’expression simple et claire « d’agression ordinaire »616. Pour Michel Psellos,
il n’y a rien de plus normal que l’agressivité des populations autochtones à l’égard
des propriétaires et de l’autorité. Il y a dans ses lettres de nombreuses occurrences à
des « attaques » menées par les populations des thèmes 617 . Il s’agit
vraisemblablement d’attaques physiques plutôt que d’attaque judiciaire étant donné la
nature du vocabulaire utilisé mentionnant à la fois des blessures et des dangers.
Psellos décrit clairement une attaque d’un propriétaire par ses voisins618. Il mentionne
615 KURTZ-DREXL, 51, p. 83 616 ibid., l. 14-15 « άλλ’ οἵ γε χωρῖται τα εἰωθότα καὶ ἐπί τούτῳ τολµῶσιν .» 617 Par exemple, SATHAS, 65, p. 297, l. 13; 134, p.378, l. 1-4; 195, p. 489 618 KURTZ-DREXL 171, p. 194-5
153
des menaces de morts mais également des jets de pierres et des coups de couteaux619.
S’il y a donc bien une part de réalité dans ces faits, il ne faut pas exclure des
probables exagérations de la part de nos épistoliers. Il est vrai cependant que les
populations provinciales semblent avoir quelques ressentiments à l’égard des
puissants et des représentants de l’autorité. La répétition de ce motif de la population
hostile dans ces lettres adressées à des juges dénote aussi de l’état d’esprit de cette
élite qui se sent nécessairement étrangère à cette population, qui ne la comprend pas,
sinon refuse de la comprendre. D’autant que les mentions d’attaques ne sont que très
rarement accompagnées d’explications claires sur les motifs de ces attaques. Cela
montre peut être que les juges et les épistoliers considéraient les comportements de
ces populations comme un peu irraisonnées. Dans d’autre cas, les comportements sont
pour autant tout à fait prémédités. Dans une lettre psellienne rédigée au juge de
Thrace est évoqué une affaire entre le juge et des moines du monastère de la
Théotokos, tenu par Psellos en charisticariat620. Pour une raison que nous ne
connaissons pas explicitement, les moines ont attaqué le juge en justice de manière
assez brutale621. Ces moines ont peut être eu peur d’être taxés davantage ou de
perdre une partie de leurs biens. Ce qui est certain c’est que Psellos se voit contraint
de présenter ses excuses aux juges pour le mauvais comportement des moines622. Ils
ont osé en effet remettre en question l’impartialité du juge à tort. Cela illustre bien la
défiance et le manque de confiance de la population vis à vis des autorités. Il s’agit
cependant d’un cas particulier puisque les moines ont leurs intérêts propres et des
rapports à l’Etat byzantin spécifique. D’autres cas sont assez similaires, notamment
celui qui voit Psellos repoussé dans ces derniers retranchements face à des moniales
hurlantes623. Si ces deux cas sont particuliers et répondent à des intérêts et des
motivations purement fiscales et cupides de la part de groupes puissants, il semble
que sur un plan général, la situation pour la population locale ne soit pas très
satisfaisante. H. Ahrweiler démontre bien le scepticisme et l’élan critique des
habitants des thèmes vis à vis de cette autorité venue de Constantinople. Le juge,
619 ibid., p.194, l.28 : « […]λίθων προσεγένοντο […] » , p.195, l.1-2 : «[…]διά σιδήρων καὶ περὶ τὰ καιριώτατα µέρη τοῦ σώµατος […] » 620 KURTZ-DREXL, 77, p.108-9; AHRWEILER H., « Charisticariat et autres formes
d'attribution de fondations pieuses aux Xe-XIe siècles », Zbornik radova Vizantološkog Instituta 10, 1967, p. 25 621 KURTZ-DREXL, 77, p.108, l.21-23 622 ibid., l.23-24 623 KURTZ-DREXL, 201, p.229-30,
154
représentant du pouvoir impérial, applique les directives de la chancellerie, sans
connaître très bien le terrain et ses administrés624. Seuls quelques uns réussissent à
se faire connaître de lui, soutenus et protégés par des puissants, dans le but d’obtenir
une situation plus avantageuse, sur le plan fiscal principalement. C’est le cas de la
majorité de nos recommandés. Ils obtiennent par l’intermédiaire des épistoliers des
solutions personnalisées et avantageuses à leurs problèmes. La majorité de la
population, elle, n’a pas cette possibilité. Elle ne peut donc qu’être hostile à une
autorité injuste sinon inégalitaire qui incarne le pouvoir d’une capitale lointaine.
D’autant plus que les juges semblent généralement les mépriser. Il y a donc une
méfiance voire une défiance mutuelle entre juges et autochtones ce qui renforce
probablement l’idée d’isolement des juges de thème, ilots constantinopolitains en
terre hostile.
Isolé intellectuellement, isolé géographiquement, isolé au milieu de la
population de son thème, isolé, le juge l’est aussi dans son propre milieu
professionnel. Ce milieu dans lequel le juge évolue, et plus généralement celui de la
cour impériale, est en toute logique ce que l’on pourrait qualifier de nid de vipères. Le
fonctionnement de la cour et de l’administration étant plus ou moins régulé par le fait
de plaire ou non à la personne impériale et à son entourage, crée nécessairement un
environnement hostile et malsain où règnent l’hypocrisie et la rumeur. Un certain
nombre de lettres font état de ce type d’atmosphère. Elles sont rédigées par Psellos à
des juges afin de les rassurer sur l’état de leur réputation à Constantinople625. Dans
l’une d’entre elle, Psellos fait référence aux rumeurs distillées à la cour à propos du
juge et contre lesquelles Psellos se bat avec acharnement626. Il est clair qu’à la cour
pour obtenir une charge, une dignité ou tout simplement une faveur, les manœuvres
ne semblent pas toujours très honnêtes. Lancer une rumeur sur un adversaire potentiel
n’a rien de très original et cela semble assez courant à la cour. L’isolement du juge
dans ce cas est total. Ils ne sont au courant des rumeurs répandues contre eux que par
le biais des épistoliers, leurs protecteurs. Un juge qui n’aurai pas de tels soutiens se
verrait assez vite éliminé. Il ne serait au courant des rumeurs qui courent à son propos
qu’au moment où tomberait sur lui le couperet décisif de son éviction. En ce sens cet
624 AHRWEILER, H., « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : Nouvelle
hiérarchies et nouvelles Solidarités », Travaux et Mémoires VI, p.116 625 SATHAS, 107, p. 351 ; KURTZ-DREXL, 7, p. 8-9 626 KURTZ-DREXL, 7, p. 9, l. 4-5
155
isolement vis à vis des informations constantinopolitaines le pousse toujours plus dans
une dépendance vis à vis des épistoliers. Dans une seconde lettre, Psellos n’évoque
plus seulement les rumeurs mais bien les scorpions à la cour qui n’ont de cesse de
vouloir piquer le juge627. Psellos précise qu’il a rendu silencieux certains d’entre eux,
en a tuer d’autres et persuader le reste ne pas piquer628. Le juge est dans une situation
particulièrement mauvaise. Il n’est pas mentionné s’il avait fait quelques mauvaises
actions sur un plan professionnel mais il est clair qu’il a tenté de prendre son
indépendance vis à vis de Psellos629 . L’épistolier critique nécessairement cette
volonté d’indépendance. Il précise que le juge a brisé toutes les règles, abandonné la
philosophie630. S’il ne veut pas avoir de plus gros ennuis, il doit s’excuser et admettre
sa culpabilité devant Psellos631. L’isolement du juge est ici flagrant. Ayant voulu être
plus autonome, il se retrouve totalement piégé car les rumeurs et accusations contre
lui, elles, n’ont pas disparus. Psellos s’est débrouillé jusque là pour les contenir et
attend le retour de cette brebis égarée pour les éteindre complètement. Dans le cas
contraire, Psellos ne serait plus là pour protéger le juge et il sera emporté par les
scorpions, seul face aux conséquences de son acte632. En plus de démontrer l’hostilité
que les juges doivent subir dans leur milieu professionnel très concurrentiel, cette
lettre montre bien que le juge ne peut que s’en remettre corps et âme à son protecteur
pour espérer pour continuer d’exister professionnellement. Isolé, loin de la capitale,
incapable de se défendre, les juges ne peuvent que s’enchaîner pour leur propre salut à
des plus puissants.
Cette situation n’est pas caractéristique du milieu des fonctionnaires de justice et
Psellos lui même a subi quelques attaques du même type à la cour. Dans une lettre
qu’il écrit au drongaire de la Veille, Machétarès, Psellos le réprimande pour les
attaques qu’il a portées contre lui au sujet de la dignité de proèdre qu’il vient
d’obtenir633. Nous ne connaissons pas vraiment la raison de la plainte de Machétarès,
peut être souhait il également se la voir décernée. Psellos n’évoque pas non plus les
manœuvres du juge. Quoiqu’il en soit, nous avons là une nouvelle preuve que le
627 SATHAS, 107, p. 351, l. 3 628 ibid., §1 629 ibid., p.351, l.8-12 630 ibid., l. 13-14 et plus généralement §2 631 ibid., l. 22-25 632 Cette argumentation est reprise plusieurs fois par Psellos. Par exemple KURTZ-DREXL,
154, p.177 notamment l.14-17. 633 SATHAS, 108, p. 352-3
156
milieu de la cour est hostile et que tout un chacun se doit de descendre son adversaire
pour mieux s’élever même lorsque l’on a atteint la position plus qu’honorable de
drongaire de la Veille.
L’hostilité des juges entre eux n’est pas uniquement une affaire de rumeur.
Elle transparait également sur un plan plus professionnel. Les juges ne s’attaquent
pas mutuellement mais utilisent des affaires pour imposer leur manière de faire, leur
vision, et leur personne même. Un cas unique est présent dans les lettres de Psellos.
Dans une lettre au juge des Bucellaires, il évoque une affaire que lui même avait jugé
en faveur d’une des parties634. Le successeur de Psellos, un certain Morocharzanès a
décidé cependant de reprendre le cas635, peut être poussé par la partie adverse. Il
trancha dans le sens opposé de Psellos. Le juge des Bucellaires destinataire de la lettre
est lui le successeur de Morocharzanès. Psellos qui a été approché par l’une des
parties demande au juge de revoir une nouvelle fois le cas. Il précise cependant être
surpris que Morocharzanès, un homme qui connaît ses limites, l’ait contredit636. Que
faut il comprendre à propos des « limites » de Morocharzanès, sinon une attaque
psellienne déguisée. Le juge doit enquêter et en se fondant sur les faits, et non pas sur
les juges et jugements antérieurs, puis trancher637. Le conseil que donne ici Psellos a
toute son importance car il s’agit peut être d’une critique sur la manière de faire de
Morocharzanès. Si l’on prend se conseil à l’inverse, Psellos suppose que son
successeur a jugé l’affaire en se fondant sur le verdict de Psellos et s’y est opposé par
principe sans se fonder sur les faits, sans enquêter. Psellos semble utiliser sont
destinataire, le juge des Bucellaires pour démontrer la faiblesse de son successeur.
Faut il y voir un règlement de compte entre Psellos et Morocharzanès par jugement
interposé, cela n’est pas à exclure mais difficile à prouver puisque nous ne
connaissons pas Morocharzanès par ailleurs. De manière similaire une lettre de
Theodore Daphnopatès témoigne d’une opposition radicale entre deux éparques638. Il
s’agit dans ce cas d’un conflit avec Théodore Belonas qui d’après la lettre en plus de
créér un climat délétère par l’insulte639 se complaisait dans des démarches judiciaires
634 KURTZ-DREXL, 65, p. 99 635 ibid., l. 7-8 636 ibid., l.18-19 : « ἄλλο τι διέγνωκε περὶ αὐτῆς, ἄνθρωπος τὸ οίkεῖον µέτρον εἰδώς » 637 ibid., l. 21-24 638 THÉODORE DAPHNOPATÈS, 39, p.224-227 639 ibid., p.225, l.2-3
157
douteuses640. Cette lettre n’est pas à prendre au premier degré puisqu’il s’agit d’une
lettre du vainqueur du conflit ayant pu obtenir gain de cause auprès de l’empereur en
démontrant l’iniquité des jugements de Belonas641. Cependant, elle démontre le
climat d’hostilité qui règne à la cour et parmi les membres du système judiciaire
byzantin et les conséquences que cette atmosphère avait sur les décisions de justice
ramené à des affaires de second plan derrière les conflits personnels. D’autres lettres
nous revèlent le même type d’atmosphère de concurrence et d’hostilité permanente
même à un niveau hiérarchique plus bas.642
Ce qu’indique cette lettre c’est qu’au delà même de la cour impériale, où il
faut obtenir des faveurs par tous les moyens, sur le plan professionnel et surtout
judiciaire, les juges utilisent des affaires réelles avec des plaignants vivants pour se
faire une réputation au dépend d’un prédécesseur et au détriment des principes de
justice les plus élémentaires donc des populations locales. En ce sens les juges créent
eux même le contexte favorable à leur propre isolement général.
Conclusion
La question de l’efficience du rôle des épistoliers, et ainsi de la justification de
cette soumission des juges, ne peut être tranchée sur un plan général. D’un point de
vue exclusivement professionnel, il n’est pas vraiment possible de dire que les
épistoliers assurent les carrières des juges. Ils ne sont que des porte-paroles plus ou
moins influents. La décision revient toujours à l’empereur et elle ne satisfait pas
toujours les juges. D’un autre côté les épistoliers sont là pour assurer la défense de
leur poulain à la cour contre les ambitieux, les opportunistes et les complots de cour.
On peut donc dire que les épistoliers, pour ne pas dire Michel Psellos, ont un rôle de
stabilisation de la position des juges de thème mais ne peuvent concourir à son
amélioration. On pourrait également ajouter que le rôle des épistoliers à un effet
pernicieux pour la position du juge, un effet d’isolement. Les juges constamment
tournés vers Constantinople, ville convoitée et tant chérie, en viennent à s’isoler. Ils le
640 ibid., p.225-7, l. 8-9 641 ibid., p.227, l.11 642 C’est la cas notamment de l’ensemble de lettres concernant la défense du basilikos de
Madytos. KURTZ-DREXL, 1, p. 1; 64, p. 97-9 ; SATHAS, 148, p. 396-7 ;165, p.423-4. Psellos enjoint un juge, et des métropolites de faire respecter les droits et les prérogatives du basilikos qui ont tendance a être accaparé par d’autres autorités.
158
sont sur le plan géographique mais renforce cet isolement par un mépris pour les
populations locales. Les juges semblent être des petits morceaux de la banquise
constantinopolitaine ayant dérivé loin jusque dans les thèmes, et ne souhaitant que
s’unir de nouveau avec la capitale. Ils tentent donc d’ignorer l’environnement, de fait
hostile vis à vis d’élément exogène, qui les entourent.
159
Conclusion de la troisième partie.
Il est certain que l’amitié est un thème très récurent dans notre corpus et plus
généralement dans l’épistolographie byzantine, les auteurs y voyant souvent un
moyen de magnifier une relation amicale en la rendant purement immatérielle et
intellectuelle. Force nous est de reconnaître qu’elle n’a pour notre étude qu’un impact
tout à fait limité. Les relations amicales entre des juges et certains de nos épistoliers
existent. Nicéphore Ouranos n’est pas appelé « l’ami des juges » pour rien mais elles
ne semblent, de mon point de vue, ni assez nombreuses ni assez fortes pour justifier
les actions et les compromis mis en place par les juges dans le cadre de leur fonction.
Seul Psellos entretient ce genre d’amitié qui engage les hommes les uns pour les
autres mais encore une fois elle ne concerne qu’un nombre réduit de juge. Le moteur
des agissements des juges n’est pas l’amitié, d’autant qu’elle est souvent utilisée
comme prétexte par les épistoliers pour renforcer leur ascendant sur eux. Les juges de
thème ne sont pas des êtres naïfs et leur motivation est à placer au niveau de leur
ambition. Dans cette optique, le rôle des épistoliers est indispensable pour les juges.
Ces derniers, éloignés de Constantinople ne peuvent faire valoir leur mérite et leurs
désirs auprès de l’empereur, seul organe décisionnel en la matière. La position des
épistoliers est donc pour eux le seul moyen d’espérer à la fois d’être entendu mais
surtout écouté et par ce biais obtenir des promotions qui les ramènerait petit à petit
vers des fonctions plus importantes donc constantinopolitaines. Un juge sans soutiens
est un juge sans réseau donc un homme mort d’après l’analyse de la société byzantine
que nous donne Psellos. C’est donc une nécessité pour le juge, sinon un impératif, de
soigner son réseau et au premier chef, ceux qui en constituent la clef de voûte, nos
épistoliers.
Cependant, il nous est nécessaire de rappeler que l’efficacité d’une telle dynamique,
d’un tel mécanisme n’est absolument pas assurée. Nombreux sont les juges à la fois
déçus et désespérés par des promotions qui n’en sont pas, par l’absence d’intérêt de
l’administration à leur égard, et par l’hostilité de leurs collègues. Le juge semble
finalement assez isolé, sans ressources et soutiens vraiment efficaces leur permettant
d’espérer des jours meilleurs. Cette solitude des juges est renforcée par le système de
pensée dans lequel ils évoluent, élitiste et constantinopolitain et par les actions qu’ils
160
entreprennent au nom de ce système, émanation de la construction sociale byzantine.
Isolé du monde auquel il souhaite appartenir, le juge œuvre dans son thème dans
l’unique but de le rejoindre, s’isolant ainsi du monde qui l’environne.
162
Conclusion générale
Le but de cette étude était de faire apparaître concrètement ce que représente
le juge dans le système de pensée de l’élite byzantine aux Xe-XIe siècles. Force est de
constater cependant que ce travail apporte bien plus de questionnements que de
réponses tranchées.
En dehors de cette représentation du juge vu par l’élite constantinopolitaine, un
certain nombre de points ont été abordés dans cette étude sans que nous n’ayons pu
réellement apporter d’éléments concluants. Il s’agit principalement de questions
techniques. La question du recrutement des officiers de justice après leur formation
est abordée puisque les premières affectations sont parfois mentionnées pour certains
juges mais nous ne connaissons pas les mécaniques qui les ont porté jusqu’à ces
postes. De même on peut citer la question de la rémunération des juges qui n’est que
peu abordée en tant que telle. Seules les notions d’enrichissement ou de salaires
« divins » sont évoquées et nous sommes en droit de nous questionner sur les moyens
de subsistance des juges et sur leur fortune. Corréler au problème du recrutement des
juges le thème du recrutement de subordonnés est fréquemment posé par les
épistoliers mais uniquement du point de vue de la recommandation et du lien de
clientèle. On peut donc s’interroger sur l’existence de normes, de règles ou de
procédures concernant le sujet. Cela pose également la question de la vie des juges en
province, dans la capitale de leur thème, l’existence d’un entourage, d’une cour ou
plutôt une vie solitaire centrée sur l’accomplissement au mieux de la tâche qui leur
incombe dans le but de regagner au plus vite la capitale.
Sur un plan plus professionnel, les mécaniques judiciaires mises en jeux par les juges
ne sont, elles aussi, que peu représentées dans nos lettres. Une meilleure connaissance
de celles-ci et de la manière de concevoir le droit et la loi dans la judicature byzantine
permettrait d’évaluer avec plus de précision et de véracité la liberté des juges dans le
champ de leurs prérogatives. Davantage de compréhension de leurs carrières et
surtout des carrières les plus communes permettrait une meilleure approche de la
place du juge dans la société byzantine, dans la hiérarchie administrative et par ce
biais des rapports de force qui pouvait exister avec d’autres autorités. Cela nous
renseignerait aussi sur les mécaniques qui régissaient l’avancement de nos juges.
163
Nous pourrions alors avoir une meilleure idée de l’efficience des stratégies de
carrières construites par les juges eux même. Il reste en ce sens beaucoup de questions
et de thèmes concernant la judicature, mais aussi le juge en tant qu’homme, son
milieu, sa carrière et sa vie.
L’utilisation de toutes les autres sources, narratives, sigillographiques, normatives
apporterait nécessairement de nouveaux éléments sur ces questions sinon des
confirmations ou des infirmations sur les hypothèses soulevées dans cette étude.
L’ensemble de ces sources permettrait vraisemblablement d’obtenir une image plus
complexe et profonde du juge sur cette période. Il serait possible de dresser à la fois
un portrait théorique du juge grâce aux lois et novelles édictées à leur propos. Il serait
possible aussi d’étudier les différents profils de carrières grâce aux sources
sigillographiques principalement. Les actes administratifs et les recueils de
jurisprudence tel que la Peira donneraient, quant à eux, également la possibilité
d’étudier la réalité de l’exercice de l’autorité du juge et des mécaniques judiciaires.
Enfin l’utilisation de sources ecclésiastiques nous donnerait également une vision en
parallèle du domaine de la justice patriarcale, de ses acteurs, de ses mécaniques et de
sa position par rapport à la justice civile.
Bien évidemment l’élargissement de la chronologie sur les siècles précédents et ainsi
que sur la période postérieure à la quatrième croisade permettrait de s’intéresser aux
évolutions de la fonction de juge, du statut de ceux qui l’exercent et plus
généralement de la place du juge dans la société byzantine sur le temps long.
Malgré cet important contingent d’interrogations non résolues, la
documentation épistolaire a permis de mettre au jour une représentation assez claire
du juge au regard des conceptions de l’élite byzantine.
Il nous faut préciser en premier lieu que si cette image résulte grandement de la
pensée même de Michel Psellos qui monopolise l’espace documentaire de cette
période, il n’est pas nécessaire de penser qu’il s’agisse d’une représentation originale
sinon marginale. On le voit, les autres épistoliers semblent envisager leurs relations
avec les juges encadrées par les même principes et conceptions. L’absence d’évidence
claire est due à l’absence d’un corpus assez développé concernant ces auteurs.
Psellos, qui semble être passé par toutes les étapes de la hiérarchie administrative et
sociale byzantine, en est le produit le plus pur. En plus d’être un intellectuel brillant, il
connaît les mécanismes sociaux qui sous-tendent l’administration et cette société, il
en connaît les arcanes. Michel Psellos, consul des philosophes avait certainement l’un
164
des points de vue les plus réalistes et objectifs sur l’État byzantin et sur l’élite qui le
fait fonctionner.
Quoiqu’il en soit, notre première tâche dans ce travail a été de tenter de définir ce
qu’est le juge à la fois dans la société byzantine et dans nos sources.
Le travail de définition de ce qu’est le juge dans la société byzantine à partir des
principes qui fondent la loi et le système juridique byzantin a bien montré que cette
définition n’avait que peu de raison d’être. Le juge en tant que tel n’existe pas
vraiment ou plutôt n’existe que trop à travers chaque fonctionnaire de l’empire. En
revanche, à travers cette source particulière qu’est l’épistolographie, force nous est de
constater que cette image des juges ne concerne pas la judicature byzantine dans un
sens général mais uniquement un seul et unique type de juge, le juge de thème. C’est
lui qui domine notre corpus. De ce point de vue, c’est tout autant le juge comme
magistrat que le juge comme gouverneur qu’il nous a fallut étudier. La tentative de
détermination du statut social de ces juges et en particulier des juges de thème par le
biais de l’onomastique à quant à elle permis de bien montrer l’appartenance de ces
fonctionnaires à une élite administrative civile constantinopolitaine de très haut
niveau. La présence des Xeroi et des Sklèroi notamment montre bien à la fois
l’importance de la fonction dans la hiérarchie administrative, son attractivité pour les
membres de l’aristocratie et laisse transparaitre la nature du milieu des juges. C’est un
milieu constitué d’individus éduqués à Constantinople par un enseignement supérieur
de pointe en philosophie, rhétorique et en droit, en particulier au XIe siècle. Cette
formation n’est en soit pas spécialement tournée vers l’exercice futur d’une
quelconque fonction mais plutôt orientée dans le but de former la futur élite
intellectuelle de l’empire. Cela est extrêmement important puisqu’en tant que futur
élite intellectuelle, ces apprentis juges ont tendance à déjà se considérer comme
appartenant à ce groupe social ancré à Constantinople, séparé du reste de la
population. C’est dans ce groupe qu’ils forment le réseau primitif qui servira leur
carrière, notamment avec leurs camarades mais surtout avec leurs enseignants, le cas
de Michel Psellos étant ici assez exemplaire.
Il est, au demeurant, le correspondant nous en apprenant le plus sur le cœur du travail
de juge de thème. Ses nombreuses lettres font émerger deux prérogatives principales
utiles aux épistoliers, soit le traitement d’affaires et le traitement des
recommandations. Concernant les affaires, une petite minorité est purement judiciaire
et nous permet d’aborder la figure du juge comme magistrat, mais la plupart d’entre
165
elles sont des affaires fiscales ou cadastrales. Ce genre de cas ancre bien le juge de
thème dans la posture du gouverneur de province, lien entre le fisc de Constantinople
et les contribuables provinciaux. C’est également le cas lorsque nos épistoliers font
référence à l’aspect gestionnaire de la fonction de juge que cela soit dans
l’organisation territoriale du thème ou concernant la gestion de l’administration elle
même. Les recommandations faites par les épistoliers nous montrent un juge devant
régir toute une troupe de fonctionnaires subalternes, être capable de les orienter dans
leurs tâches si ce n’est de les former et enfin de leur apporter la prospérité qu’ils
recherchent. Là est le lien avec une mission plus informelle du juge, celle de
protecteur. C’est une prérogative qui revient régulièrement et qui concerne toute
personne placée sous son autorité du simple client à la population du thème en passant
par le subordonné. Le juge est ici une vraie figure paternelle protectrice dans son
thème en parallèle avec la figure protectrice de l’empereur concernant tout l’empire.
Sur ce point spécifique, il s’agit surtout pour les juges de répondre aux atteintes des
épistoliers et à leur vision particulière de ce qu’induit la fonction de juge de thème. Ce
sont les épistoliers qui fournissent aux juges leurs affaires mais aussi leur clientèle
ainsi qu’un certain nombre de leurs subordonnés. Les juges se doivent alors de
correspondre à l’image que se font les épistoliers de leur fonction en protégeant les
intérêts de leurs maîtres ainsi que leurs protégés. À ce titre, il est certain que les
épistoliers se sentent en droit de surveiller le travail, le comportement et les
agissements des juges. D’autant plus qu’ils semblent rester pour eux de simples
disciples. Ce droit de regard est en réalité bien plus pressant qu’une simple
surveillance et a tendance à se métamorphoser en une forme de soumission
notamment lorsque l’on observe le comportement des épistoliers vis-à-vis des prises
de positions des juges concernant les recommandations. Le manque de liberté est
assez évident et bien qu’il se fonde sur une conception particulière du réseau d’amitié,
il constitue en réalité une réelle soumission. Cette inféodation des juges envers nos
auteurs, en particulier Michel Psellos, transparait également à travers les décisions
judiciaires des juges. La volonté constante de Psellos, Mauropous et les autres, de les
infléchir, de les changer sinon tout simplement de les briser est bien la preuve de
l’existence d’un rapport de force continuel semblant toujours être en défaveur du
fonctionnaire provincial.
Ce rapport de force, duquel le juge de thème sort rarement vainqueur, n’est pas un
conflit entre deux autorités mais bien un rapport informel de soumission hiérarchique
166
dans lequel le juge se place plus ou moins volontairement ou du moins sans réel
choix. La question des mécaniques qui pousse le juge dans cette direction est donc
importante à trancher. Le premier rouage de cette dynamique réside dans le lien entre
l’ancien étudiant et le professeur appartenant au même réseau primitif. Ce lien reste
très présent mais l’épistolier tâche de le placer sur un tout autre plan celui de l’amitié.
Etait-ce une amitié réelle ? Sur ce point, la réponse est claire et elle est négative dans
la grande majorité des cas. L’amitié est ici un prétexte pour instrumentaliser les juges
un peu plus et faire pression sur eux pour qu’ils correspondent mieux à l’image que
les épistoliers ont conçue. L’amitié n’est pas un rouage de la mécanique de
soumission volontaire des juges mais plutôt la façade derrière laquelle se place tout
cet ensemble. Le deuxième rouage de l’inféodation des juges est constitué par la
volonté de ces derniers de faire carrière. L’analyse des quelques parcours pouvant être
reconstruits avec notre matériel épistolaire consacre la place fondamentale de
Constantinople dans la formation, les débuts de carrière mais aussi et surtout comme
objectif suprême dans l’ascension sociale. Constantinople tient lieu également de
centre de décision unique pour les affaires administratives par la présence de la
chancellerie et de la personne impériale, rien de plus logique pour une capitale. La
place et le statut des épistoliers, pour ne pas dire de Psellos, sont donc de premières
importances dans la stratégie des juges pour espérer des évolutions de carrières
favorable. L’épistolier est le lien entre le juge et l’organe de décision institutionnel,
celui qui peut faire et défaire une carrière, changer une vie, faire envoyer aux marches
de l’empire tout comme faire appeler au plus près du basileus. La soumission des
juges est en quelque sorte une stratégie ayant pour but de faire des épistoliers leurs
meilleurs ambassadeurs auprès de l’administration centrale de Constantinople. Il est
intéressant de constater que pour le peu que nous pouvons entrevoir, cet objectif est
loin d’être atteint. Le nombre de juges déçus, désespérés de leurs nouvelles
affectations, ou de l’absence de promotion est important. Cette désillusion est
accentuée par l’environnement hostile qui entoure nos magistrats. Les juges semblent
isolés dans leur thème face à des populations qu’ils ne comprennent pas ou du moins
qu’ils refusent de comprendre comme s’ils attendaient à chaque instant un coursier
leur apportant la nouvelle d’une affectation immédiate à Constantinople. Isolé
géographiquement et socialement, le juge est également seul dans son propre milieu, à
l’intérieur même de l’élite, du fait des querelles nombreuses et incessantes entre les
dignitaires n’ayant pour seul moteur que l’ambition, la cupidité et l’opportunisme. La
167
stratégie de soumission du juge aux épistoliers dans le but de servir ses propres
intérêts est semble-t-il inopérante et place les juges de thème dans une situation
instable.
D’un point de vue plus global, il est remarquable de constater que la place du juge
dans cette étude n’est pas si centrale que cela. Il constitue le cœur de notre recherche
mais le rôle qui lui est attribué en réalité n’est que celui d’instrument des épistoliers,
auquel il se soumet en toute docilité pour espérer assouvir des désirs de gloire
hypothétique. Le juge n’est pas l’ami protecteur ou l’adversaire acharné, il est encore
moins pour la société, l’incarnation de la justice, il n’est qu’un simple objet des
épistoliers. Seuls eux, et en particulier Michel Psellos, concordent avec l’image
dumasienne d’hommes de réseaux s’appuyant constamment sur les principes,
abâtardit par leurs pratiques, de justice et d’amitié pour réaliser leurs propres intérêts
et projets. Eux seuls peuvent être les protecteurs ou les adversaires des juges. Entre
ces deux extrêmes, leurs comportements dépendent alors du degré d’inféodation de
nos magistrats byzantins.
170
ANNEXE N°1 - RÉCAPITULATIF DES JUGES NOMMÉS
NOMS DIGNITÉS FONCTIONS DATATION SOURCES Pierre Androsulitès Membre d’une commission
judiciaire Vers 944 ALEXANDRE DE NICÉE,
10 ; 14 Basile Juge des Arméniaques 1063-1064 KURTZ-DREXL, 96
Basile Juge de Cappadoce 2nd XIe s. SATHAS, 110 Théodore Belonas Patrice Éparque 955-960 THÉODORE DAPNOPATÈS,
39 THÉODORE DE NICÉE, 12 ; 21
Chasanès Vestarque Juge de Macédoine 2nd XIe s. SATHAS, 38, 39 ET 172 Constantin Éparque Vers 950 THÉODORE DE NICÉE, 38 Constantin Protospathaire Éparque 948-957 THÉODORE
DAPHNOPATÈS, 32 Constantin Magistre, Proèdre,
prôtoproèdre, Sébaste Drongaire, Grand Drongaire, épi tôn Kriséôn, Sacellaire
1070-1078 SATHAS, 1 ; 31 ; 45 ; 83 ; 157 ; 214
Gabriel Juge Debut Xe s. SYMÉON MAGISTROS, 7 Serge Hexamilitès Juge des Thracésiens 2nd XIe s. GAUTHIER, LETTRES, 27 Léon Protospathaire Juge des Anatoliques Fin Xe s. NICÉPHORE OURANOS, 2 Léon Protospathaire Juge de Paphlagonie 914-919 NICOLAS IER MYSTIKOS,
127 Léon ὁ τοῦ Πατρῶν épi tôn déèséôn 1052 SATHAS, 89 Anastase Lizix Patrice ; Vestarque Juge 1060-1070 SATHAS, 25 ; 78 ; KURTZ-
DREXL, 127 ; 202 Machetarès Drongaire de la Veille 1057-1059 SATHAS, 108 Malakeinos Juge Fin Xe –
début XIe s. NICÉPHORE OURANOS, 31 ; 34 LÉON DE SYNADA, 23-24
Basile Malesès Juge des Arméniaques Juge des Katôtika
1060-1065 KURTZ-DREXL, 76 ; 96 ; 132
Michel Juge des Cibyrrhéotes 2nd XIe s. SATHAS, 66 Mitylènaiôs Juge Fin Xe s. LÉON DE SYNADA, 25 Morocharzanès Juge des Bucellaires Milieu XIe s. KURTZ-DREXL, 65 Paul Juge Fin Xe s. NICÉPHORE OURANOS,
29 ; 30 ; 33 ; 35 ; 44 Nicéphoritzès Sebastophore,
Hypersebaste Logothète Praitor du Péloponèse et d’Hellade
1068-1071 SATHAS, 103 ;134 KURTZ-DREXL, 8
Pothos Magistre, Vestarque Juge de Macédoine Juge de l’Opsikion Juge de Thrace et Macédoine
1070-1080 KURTZ-DREXL, 35 ; 220 ; 250 ; SATHAS, 204
Sisinios Éparque 959-960 THÉODORE DAPHNOPATÈS, 33
Nicolas Sklèros Proèdre Juge de l’Egée 1060-1065 KURTZ-DREXL 37 ; 44 ; 56 ; 63 ; 124 ; 126-8
Basile Splénarios Vestarque Juge des Arméniaques 2nd XIe s. KURTZ-DREXL, 132 Théodore Protospathaire Juge Début Xe s. PROFESSEUR ANONYME,
121 Xèros Praitôr des Thracésiens
Juge des Thracésiens 2nd XIe s. SATHAS, 47 ; 51
Constantin Xiphilin Drongaire de la Veille 2nd XIe s. SATHAS, 205 Zoma Juge de l’Opsikion 2nd XIe s. SATHAS, 24 ;29 : KURTZ-
DREXL, 142
171
ANNEXE N°2 - STATISTIQUES GÉNÉRALES
1. Les lettres évoquant les juges par rapport à leur ensemble AUTEURS LETTRES SUR LES JUGES ENSEMBLE DES LETTRES POURCENTAGE
ALEXANDRE DE NICÉE 2 20 10%
THÉODORE DAPHNOPATÈS
8 40 20%
LÉON DE SYNADA 3 54 5% JEAN MAUROPOUS 7 77 9% NICOLAS IER MYSTIKOS 5 190 2,6% NICÉPHORE OURANOS 12 50 24% MICHEL PSELLOS 201 545 37% SYMÉON MAGISTROS 5 73 6,8% PHILETOS SYNADENOS643
13 13 100%
THÉODORE DE NICÉE 2 46 4,3% PROFESSEUR ANONYME644
1 126 - de 1%
AUTEURS DU XE S. 47 567 8,2% AUTEURS DU XIE S. 208 622 33 % 2. Les fonctions précisément identifiées645 FONCTIONS XE SIÈCLE XIE SIÈCLE TOTAUX EPARQUE 4 4 DRONGAIRE DE LA VEILLE
3 3
ÉPI TÔN KRISÉÔN 1 1 ÉPI TÔN DÉÈSÉÔN 2 2 LOGOTHÈTE DU PRÉTOIRE
1 1
JUGE DE THÈME 5 88 93646 TOTAUX 10 94 104
643 Pour ce qui concerne PHILETOS SYNADENOS, il ne peut pas vraiment être compté dans
les statistiques puisqu’en théorie chacune de ses lettres a une importance quelque soit son sujet puisqu’elle reste rédigée par l’auteur, un juge. 644 De même, le cas du PROFESSEUR ANONYME n’est à mon sens absolument pas
significatif, puisqu’un grand nombre de ses interlocuteurs n’ont pas de fonctions précises mentionnées. Il est possible qu’il y est donc des juges que nous ne pouvons identifier. 645 Ici, seules les fonctions précises sont utilisées, les mentions de kritès seules ne peuvent
entrer en compte ici puisqu’elles peuvent tout aussi bien recouper la fonction de juge de thème comme celle de juge de l’hippodrome ou du vélum ou toute autre fonction constantinopolitaine. 646 Ce nombre indique le nombre maximum de juges de thèmes différents croisés dans la
correspondance. Les juges bien identifiés par leurs noms comme Pothos ou Nicolas Sklèros n’ont ainsi été compté qu’une seule fois.
172
3. Répartition géographique de la correspondance en fonction du thème647. THÈMES XE SIÈCLE XIE SIÈCLE TOTAUX PROPORTION GÉN. ANATOLIQUES 1 2 3 2,6% ARMÉNIAQUES 2 2 1,7% BOLÉRON 1 1 - de 1% BUCELLAIRES 5 5 4,3% CAPPADOCE 2 2 1,7% CHARSIANÔN 2 2 1,7% COLONÉE 1 1 - de 1% CIBYRRHÉOTES 5 5 4,3% DROUGOUBITÔN 2 2 1,7% EGÉE 9 9 7,7% KATÔTIKA648 17 17 14,5% MACÉDOINE 8 8 6,8% OPSIKION 26 26 22 % OPTIMATES 5 5 4,3% PAPHLAGONIE 1 5 6 5,1% THRACE 2 2 1,7% THRACE ET MACÉDOINE 4 4 3,4% THRACÉSIENS 2 16 18 15,4% TOTAUX 5 112 117 100
647 Il ne s’agit pas ici d’une étude concernant les individus mais bien le nombre contacts
avec l’autorité d’un thème donnée. Nous n’avons utilisé que les attributions les plus certaines. 648 Y sont compris notamment un praitôr du Péloponèse et de l’Hellade et un juge
d’Hellade.
173
ANNEXE N°3 - RÉPERTOIRE DES LETTRES UTILISÉES DANS CETTE ÉTUDE XE SIÈCLE ALEXANDRE DE NICÉE, 10, p.85, Lettre envoyée depuis Monobata à la commission ALEXANDRE DE NICÉE, 14, p.91, À Eustathe, métropolite de Sidé DARROUZÈS – DIVERS, 49, p.378, Au logothéte du prétoire LÉON DE SYNADA, 23, p. 38-9, À Malakeinos, prôtospathaire LÉON DE SYNADA, 24, p.39-40, À Malakeinos, prôtospathaire LÉON DE SYNADA, 25, p.40-1, Au juge Mitylenaios NICÉPHORE OURANOS, 2, p.217-8, À Léon, protospathaire, juge des Anatoliques NICÉPHORE OURANOS, 13, p.223, À Anthyme, protospathaire et Juge NICÉPHORE OURANOS, 22, p.228, À Pierre, protospathaire et Juge NICÉPHORE OURANOS, 24, p.228, Au juge de Coloneia NICÉPHORE OURANOS, 29, p.230-1, À Paul, juge NICÉPHORE OURANOS, 30, p.231, À Paul, juge NICÉPHORE OURANOS, 31, p.232, À Malakeinos, juge NICÉPHORE OURANOS, 33, p.233, À Paul, juge NICÉPHORE OURANOS, 34, p.233-4, À Malakeinos, juge NICÉPHORE OURANOS, 35, p.234, À Paul, juge NICÉPHORE OURANOS, 42, p.241-242, Au juge des Thracésiens NICÉPHORE OURANOS, 44, p.239-40, À Paul, juge NICOLAS IER MYSTIKOS, 127, p.422-3, À Léon, protospathaire et juge de Paphlagonie NICOLAS IER MYSTIKOS, 165, p.490-3, À un officier NICOLAS IER MYSTIKOS, 170, p.496, À un commandant en chef NICOLAS IER MYSTIKOS, 171, p.498-9, À un juge NICOLAS IER MYSTIKOS, 181, p. 510-3, À un juge des Thracésiens PHILETOS SYNADENOS, 5, p. 253, Au patriarche d’Antioche PHILETOS SYNADENOS, 6, p.253-4, Au patriarche d’Antioche PHILETOS SYNADENOS, 7, p. 254, Au patriarche d’Antioche PHILETOS SYNADENOS, 8-13, p.254-5, Au magistre d’Antioche Ouranos PHILETOS SYNADENOS, 9, p.255-6, Au magistre d’Antioche Ouranos parti contre les Arabes PHILETOS SYNADENOS, 10, p.256, Au magistre d’Antioche Ouranos, après la Victoire PHILETOS SYNADENOS, 11, p. 257, Au magistre d’Antioche Ouranos PHILETOS SYNADENOS, 12, p.257-8, Au magistre d’Antioche Ouranos PHILETOS SYNADENOS, 13, p.258-9, Au magistre d’Antioche Ouranos, revenant d’Arabie PROFESSEUR ANONYME, 121, p.99, À Théodore, prôtospathaire et juge
174
SYMÉON MAGISTROS, 7, p.103 SYMÉON MAGISTROS, 21, p. 113-4 SYMÉON MAGISTROS, 53, p.131-2 SYMÉON MAGISTROS, 72, p. 141 SYMÉON MAGISTROS, 86, p.147-8, À Dermocaïtes THEODORE DE NICÉE, 12, p.280, À Théodore, Patrice et éparque THEODORE DE NICÉE, 38, p.303-4, À Constantin, Patrice et éparque THEODORE DAPHNOPATÈS, 19, p.173, À Pierre, spatharocandidat THEODORE DAPHNOPATÈS, 20, p.172-9, À Pierre, spatharocandidat THEODORE DAPHNOPATÈS, 23, p. 180-3, À un ami THEODORE DAPHNOPATÈS, 28, p.188-90, À Eustathe, prôtospathaire et épi tou kanikleiou THEODORE DAPHNOPATÈS, 31, p.192-3, À Basile Ouranos, prôtospathaire et asekrètis THEODORE DAPHNOPATÈS, 32, p.193-4, À Constantin, prôtospathaire et éparque THEODORE DAPHNOPATÈS, 33, p. 195-7, À Sisinnios, prôtospathaire et éparque THEODORE DAPHNOPATÈS, 39, p.227 XIE SIÈCLE JEAN MAUROPOUS, 6, p. 55, Au juge de Paphlagonie JEAN MAUROPOUS, 11, p.64-7, À un juge JEAN MAUROPOUS, 31, p.118-21, À un juge JEAN MAUROPOUS, 32, p.120-1, À un juge JEAN MAUROPOUS, 39, p. 132-3, À un juge de province JEAN MAUROPOUS, 46, p.140-1, À un juge de province JEAN MAUROPOUS, 55, p. 158-9, À un juge MICHEL PSELLOS : GAUTIER, LETTRES, 27, p.179, Au kyr Serge, Juge des Thracésiens. KURTZ-DREXL, 7, p.8-9, Au juge de Macédoine KURTZ-DREXL, 8, p.9, Au Sebastophore Nicéphoritzès KURTZ-DREXL, 9, p.10-1, À un ami, juge KURTZ-DREXL, 10, p.12, À un juge KURTZ-DREXL, 11, p.12, À un ancien camarade, juge KURTZ-DREXL, 35, p.56-9, Au juge de l’Opsikion, Pothos, fils du drongaire KURTZ-DREXL, 37, p.60-2, À Nicolas Sklèros, proèdre KURTZ-DREXL, 38, p.62, À Pothos, fils du drongaire KURTZ-DREXL, 40, p.66, Au César, Jean Doukas KURTZ-DREXL, 41, p.67-9, À Pothos, fils du drongaire
175
KURTZ-DREXL, 42, p. 67-70, À Pothos, fils du drongaire KURTZ-DREXL, 44, p. 74, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 47, p.78-80, Au juge des Cybirrhéotes, frère du métropolite d’Euchaïte KURTZ-DREXL, 50, p.82-3, Au juge des Cybirrhéotes KURTZ-DREXL, 51, p. 83, Au juge des Optimates KURTZ-DREXL, 52, p.83-4, Au juge des Optimates KURTZ-DREXL, 53, p.84-5, A Pothos, fils du drongaire KURTZ-DREXL, 54, p.86, Au métropolite d’Euchaïte KURTZ-DREXL, 55, p.87-8, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 56, p.88-9, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 60, p.92-3, Au juge de l’Egée KURTZ-DREXL, 61, p. 93-4, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 63, p.96-97, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 64, p.97-99, Au juge de Thrace et de Macédoine KURTZ-DREXL, 65, p. 99, Au juge des Bucellaires KURTZ-DREXL, 66, p.99-100, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 69, p.103, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 70, p.103, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 74, p.106, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 76, p.107-8, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 77, p.108-9, Au juge de Thrace KURTZ-DREXL, 82, p.111-2, Au juge des Anatoliques KURTZ-DREXL, 83, p.112, Au juge des Bucellaires KURTZ-DREXL, 84, p.113, Au juge des Bucellaires KURTZ-DREXL, 86, p. 114-5, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 88, p.117, Au Patriarche d’Antioche KURTZ-DREXL, 90, p.118, Au juge du Drougoubitôn KURTZ-DREXL, 91, p.119, Au juge du Drougoubitôn KURTZ-DREXL, 92, p.120, Au juge des Bucellaires KURTZ-DREXL, 96, p.125, Au juge des Arméniaques KURTZ-DREXL, 97, p.126, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 99, p.127-8, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 100, p.128-9, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 107, p.136, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 108, p.137, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 109, p.138, Au juge de Paphlagonie KURTZ-DREXL, 116, p.143, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 119, P.145, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 120, p.145-6, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL,123, p.147-8, Au juge de l’Egée KURTZ-DREXL, 124, p. 148-9, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 125, p.149-52, Au juge de l’Egée KURTZ-DREXL, 126, p.150, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 127, p.150-1, À Nicolas Sklèros
176
KURTZ-DREXL, 128, p.151-2, À Nicolas Sklèros KURTZ-DREXL, 130, p.153, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 131, p. 154, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 132, p.154-5, À Malesès KURTZ-DREXL, 137, p. 163, Au juge de l’Egée KURTZ-DREXL, 142, p.169, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 153, p.176, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 154, p.177, Au juge des Katôtika KURTZ-DREXL, 160, p.187-8, À un ami, juge KURTZ-DREXL, 163, p.190, À un juge KURTZ-DREXL, 166, p. 191-2, À un juge KURTZ-DREXL, 167, p.192, À un juge KURTZ-DREXL, 171, p. 194-5, À un juge KURTZ-DREXL, 173, p.196, À un juge KURTZ-DREXL, 175, p.197-8, À un juge KURTZ-DREXL, 180, p.200-1, Anépigraphe KURTZ-DREXL, 183, p.203, Anépigraphe KURTZ-DREXL, 200, p.227-9, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 201, p.229-30, Au prôtoasékrètis KURTZ-DREXL, 202, p.230-1, À l’Empereur KURTZ-DREXL, 214, p.255, À Constantin, neveu du patriarche Cérulaire KURTZ-DREXL, 220, p.261-2, À Pothos, magistre, fils du drongaire, juge de Macédoine KURTZ-DREXL, 227, p.270-1, À un juge KURTZ-DREXL, 243, p. 293-4, Au juge de l’Opsikion KURTZ-DREXL, 244, p.294, À un juge KURTZ-DREXL, 247, p. 297, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 248, p.298, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 250, p.299, Au magistre et juge de Thrace et Macédoine, Pothos, fils du drongaire KURTZ-DREXL, 251, p.299-300, Au juge de Thrace et Macédoine KURTZ-DREXL, 252, p.300-1, À un juge KURTZ-DREXL, 253, p.301, À un juge KURTZ-DREXL, 254, p.301-2, Au juge des Thracésiens KURTZ-DREXL, 255, p.302-3, À un juge KURTZ-DREXL, 257, p.304, À un juge KURTZ-DREXL, 258, p.305, À un juge KURTZ-DREXL, 273, p.318, À Jean Xiphilin. SATHAS, 18, p.257, Au juge de l’Opsikion SATHAS, 20, p.258, Au juge des Katôtika SATHAS, 21, p.258-9, À une juge SATHAS, 25, p.260, Au juge de l’Egée SATHAS, 26, p. 261-2, Au juge des Katôtika SATHAS, 29, p.263-5, A Zoma, juge de l’Opsikion
177
SATHAS, 32, p. 267-9, Au juge des Katôtika SATHAS, 33, p.268, Au juge des Katôtika SATHAS, 34, p. 268-9, Au juge des Katôtika SATHAS, 38, p.272, À Chasanès, vestarque et juge de Macédoine SATHAS, 39, p.272, À Chasanès, vestarque et juge de Macédoine SATHAS, 47, p.279-80, À Xèros, praitor des Thracésiens SATHAS, 49, p.280-1, Au juge de Paphlagonie SATHAS, 51, p. 282, À Xèros, praitor des Thracésiens SATHAS, 54, p. 285, Au moine Syméon Kenchres SATHAS, 65, p.297, Au juge de l’Egée SATHAS, 66, p.297-8, Au juge des Cibyrrhéotes SATHAS, 67, p. 299, Au juge des Cibyrrhéotes SATHAS, 73, p. 308, Au juge de Charsianon SATHAS, 75, p. 309-10, Au juge des Optimates SATHAS, 76, p.310-1, Au juge des Optimates SATHAS, 79, p.312-3, Au juge de l’Egée SATHAS, 95, p.337-8, Au juge de l’Egée [?] SATHAS, 99, p.342-3, À un juge SATHAS, 100, p.343, À un Vestarque … SATHAS, 101, p.343-4, Anépigraphe SATHAS, 108, p. 352-3, À Machetarios, drongaire de la Veille SATHAS, 116, p.362-3, À un juge SATHAS, 122, p.370, À un juge SATHAS, 130, p.376, À un juge SATHAS, 133, p.379, Anépigraphe SATHAS, 134, p.378, Au juge des Katôtika SATHAS, 135, p.378-9, Au juge de l’Egée SATHAS, 136, p.388-9, À un juge SATHAS, 138, p.391, Anépigraphe SATHAS, 146, p.394-5, À un magistre, juge SATHAS, 147, p.395-6, Au juge des Katôtika SATHAS, 158, p.412, Au juge de Cappadoce SATHAS, 172, p.439-40, À Chasanès, vestarque et juge de Macédoine SATHAS, 180, p.459-61, À un juge des Bucellaires SATHAS, 190, p.483-5, À Zoma, juge de l’Opsikion SATHAS, 193, p.488, Anépigraphe SATHAS, 195, p.489, À un juge SATHAS, 201, p.494-5, Anépigraphe SATHAS, 205, p.499-502, À Constantin Xiphilin, drongaire de la Veille.
178
ANNEXE N°4 - CARTE DES THÈMES VERS 1050
HALDON, J., The Palgrave of the Byzantine History, Basingstoke, 2005, p.71-2
179
BIBLIOGRAPHIE LITTÉRATURE PRIMAIRE ANONYMI PROFESSORIS, MARKOPOULOS A. (ed.), Anonymi Professoris Epistulae,
Berlin, 2000 CICÉRON, Discours, T.III, Seconde action contre Verrès, Livre II : la préture de Sicile,
Paris, 2002 CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE, De Administrando Imperio, MORAVCSIK G.,
JENKINS, R.J.H., (eds.) Washington, 1967 DARROUZÈS J., Épistoliers byzantins du Xe siècle, Paris 1960 EUSTATHE DE THESSALONIQUE, Relation sur la dernière – plaise à Dieu- prise de
Thessalonique, ODORICO, P. (trad., com.) , Thessalonique, Chronique d’une ville prise, Toulouse, 2005, p.141-254
GAUTIER, P., « Monodies inédites de Michel Psellos », Revue des Etudes Byzantines,
36, 1978, p. 83-151 GAUTIER, P., « Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées », Revue des
Etudes Byzantines, 44, 1986 p.111-197 JEAN MAUROPOUS, KARPOZELOS, A. (éd.), The Letters of Ioannes Mauropous,
Metropolitan of Euchaita, Thessalonique, 1990 JEAN SKYLITZÈS, Empereurs de Constantinople, CHEYNET, J.-CL., FLUSIN, B., (trad.,
ed. et com.), Paris, 2003 KEKAUMENOS, SPADARO, M.D. (ed., trad.), Raccomandazioni e consigli di un
galantuomo, Alessandria, 1998 LAURENT, V., “Sceaux byzantins inédits”, Byzantinische Zeitschrift, 33, 1993 p. 331-
361 LAURENT, V., Le corpus des sceaux de l’Empire byzantin, T.2 : l’administration
centrale, Paris, 1981 LEFORT J., OIKONOMIDÈS N., PAPACHRYSSANTHOU D., KRAVARI V., METREVELI H.,
Actes d'Iviron T.1. Paris, 1985
180
LEMERLE P., GUILLOU A., SVORONOS N., PAPACHRYSSANTHOU D., Actes de Lavra. Première partie, Des origines à 1204, Paris, 1970
LÉON DE SYNADA, VINSON M.P. (éd.), The Correspondence of Leo, Metroplitan of
Synada and Syncellus, Washington, 1985 LÉON VI, MIGNE L. J.-P. (ed.), Tactica, PG 107, Paris, 1863 MCGEER, E., NESBITT J., OIKONOMIDES, N., Catalogue of Byzantine seals at
Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art 4: The East, Washington D.C. 2001
MICHEL PSELLOS, KURTZ E., DREXL F. (eds.) Michaelis Pselli scripta minora :
magnam partem adhuc inedita. Volumen alterum, Epistulae, Milan, 1941 MICHEL ATTALEIATÈS, KALDELLIS A., KRALLIS, D., (trad.), The History, Cambridge,
2012 MICHEL PSELLOS, Michaelis Pselli Oratoria Minora, LITTLEWOOD, A.R., (ed.),
Leipzig, 1985, MICHEL PSELLOS, SATHAS K. N. (éd.), Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, Μιχαήλ Ψελλού ιστορικοί λόγοι επιστολαί και άλλα ανέκδοτα,, Venise, 1876
NICOLAS I, PATRIARCH OF CONSTANTINOPLE, JENKINS R.J.H., WESTERNINK, L.G.
(éds.), Letters, Washington, 1973 RHALLES, G., POTLES M., Συνταγµα τῶν θείον καὶ ἱερῶν κανόνων, 3, Athènes, 1853 THÉODORE DAPHNOPATÈS, DARROUZÈS, J. et WESTERINK L.G. (éds.),
Correspondance, Paris, 1978 Theophanes Continuatus, BEKKER, E. (ed.), Bonn, 1838 Traité sur la Guérilla, DAGRON, G., MIHĂESCU H. (eds.), Paris, 1986 LITTÉRATURE SECONDAIRE AGAPITOS, P. A., « Teachers, pupils and imperial power in eleventh-century
Byzantium », LEE TOO Y., LIVINGSTONE, N. (eds.), Pedagogy and Power, Rhetorics of classical learning, Cambridge, 1998, p.170-191
AHRWEILER H. , « Recherches sur la société byzantine au XIe siècle : nouvelles
hiérarchies et nouvelles solidarités », Travaux et Mémoire VI, 1976, p.99-124.
181
AHRWEILER H., « Erosion sociale et comportement excentriques à Byzance au XIe-XIIe siècles », Actes du XVIe Congrès International des Etudes Byzantines, Athènes, 1979, p.21-33
AHRWEILER, H., « Charisticariat et autres formes d’attribution de fondation pieuses
aux Xe-XIe siècles », Zbornik Radova Vizantološkog Instituta, X, 1967, p.1-27 AHRWEILER, H., « Recherche sur l’administration de l’empire Byzantin aux IXe-XIe
siècles. », Bulletin de correspondance hellénique, 84, 1960, p.1-111 ANGOLD, M., « The Byzantine State on the Eve of the Battle of Mantzikert »,
Byzantinische Forschungen, 16, 1991, p. 9-34 ANGOLD, M., Church and Society under the Comneni, 1081-1261, Cambridge, 1995 BERNARD, F., « Gifts and intellectual friendship in eleventh century Byzantium »,
GRÜNBART, M. (ed.), Geschenke erhalten die Freudnschaft, Gabentausch und Netzwerkpflege im Europäischen Mittelalter, Akten des Internationalen Kolloquiums Münster, 19.-20. November 2009, Berlin, 2011, p. 1-13
BROUSSELLE I., Recherches sur les élites dirigeantes de la société byzantine, (IXe
siècle – première moitié du Xe siècle, sous la direction de AHRWEILER H., 1986 (non éditée)
BROWNING, R., « The correspondence of a byzantine Scholar », Byzantion, 24, 1954
p. 397-452 BURY, J.B., The Imperial Administrative System in the Ninth Century, Londres, 1911 CHEYNET, J-CL., « Mantzikert, un desastre militaire ? », Byzantion, 50, 1980, p.410-
438 CHEYNET, J.-CL. “L’Asie Mineure d’après la correspondance de Psellos”,
Byzantinische Forschungen 25, 1999, p.233-241. CHEYNET, J.C., « Point de vue sur l’efficacité administrative entre le Xe-XIe siècle »,
Byzantinische Forschungen, 19, 1993, p.7-16 DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « Psellos et son gendre », Byzantinische
Forschungen, 23, 1996, p.109-149 DE VRIES VAN DER VELDEN, E., « The Letters of Michael Psellos, Historical
Knowledge and the Writing History », L’épistolographie et la poèsie épigrammatique., Paris, 2003, p. 121-135
182
DENNIS, G. T. “Elias the Monk, Friend of Psellos,”, J. NESBITT (ed.), Byzantine
Authors: Literary Activities and Preoccupations. Texts and Translations dedicated to the Memory of Nicolas Oikonomides, Leyden-Boston, 2003, p.43-62.
DUYÉ, N., « Un haut fonctionnaire byzantin du XIe siècle : Basile Malésès », Revue des Etudes Byzantines, 30, 1972, p.167-178 GAUTIER, P., “Précisions historiques sur le monastère de Ta Narsou”, Revue des
Etudes Byzantines, 34, 1976, p.101–110. GKOUTZIOUKOSTAS A., « “Judges of the Velum” and “Judges of the Hippodrome” in
Thessalonike (11th c.) », Byzantina Symmeikta 20, 2010, p. 67-84 GKOUTZIOUKOSTAS A., Administration of justice in Byzantium (9th-12th centuries) :
judicial officers and secular tribunals of Constantinople, Thessalonique, 2004 GUILLAND, R., « Études sur l'histoire administrative de l'empire byzantin : le
sébastophore », Revue des Etudes Byzantines, 21, 1963, p.199-207 GUILLAND, R., « Contribution à l’histoire administrative de l’Empire byzantin. Le
drongaire et le grand drongaire de la Veille », Byzantinische Zeitschrift, 43, 1950, p.340-65
HALDON, J., The Palgrave of the Byzantine History, Basingstoke, 2005, p.71-2 HANNICK C., SCHMALABAUER G., « Die Synadenoi », Jahrbuch der Österreichischen
Byzantinistik, 25, 1976, p.125-161 HATLIE, P. , « Reddeming Byzantine Epistolograpy », Byzantine and Modern Greek
Studies, 20, 1996, p. 213-248 HUNGER, H., Die Hochsprachliche profane Litteratur der Byzantiner, Munich, 1978 JANIN, R., La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, Paris, 1953 JEFFREYS, M., Prosopography of the Byzantine World, Londres, 2011, Disponible à
l’adresse : http://pbw.kcl.ac.uk JONES, A. H. M., The Later Roman Empire, 284-602, A social economic and
administrative survey, Oxford, 1964 KAPLAN, M., Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle, Paris, 1992
183
KARLSONN G., Idéologie et cérémonial dans l’épistolographie byzantine, Uppsala, 1962
KARPOZELOS A., « Realia in Byzantine Epistolography, X-XIIth Centuries »,
Byzantinische Zeitschrift 77/1,1984, p.20-37 KAZHDAN A. P., « Some problems on the biography of John Mauropous », Jahrbuch
der Österreichischen Byzantinistik, 43, 1993, p.87-111 KAZHDAN, A. P., « Social Groups in Byzantium », XVI Internationaler Byzantinisten
Kongress. Résumés der Kurzbeitrage, Vienne, 1981 LAOURDAS, B. « Intellectuals, Scholars and Bureaucrats in the Byzantine Society »,
Kléronomia, 2, 1970 p.273-291 LAURITZEN, F. "Psellos’ early career at court," Vizantijskij Vremennik 68, 1993,
p.135-143 LEMERLE, P., Le premier humanisme byzantin, 1971, Paris LILE, R.J., LUDWIG, C., PRATSCH T., ROWHOW, I., WINKELMANNS F., et alii,
Prosopographie der mittlebyzantinischen Zeit, Berlin, 1998- […] LIMOUSIN, E., Etude du fonctionnement d’un groupe aristocratique à Byzance au XIe
siècle, Thèse de doctorat inédite, sous la direction de ARRIGNON J.-P., Poitiers, 1995
LIMOUSIN, E. “Les lettrés en société: ‘φίλος βίος’ ou ‘πολιτικὸς βίος’?” Byzantion, 69,
1999, p.344-365. LIMOUSIN, E., « L’entrée dans la carrière à Byzance au XIe siècle : Michel Psellos et
Jean Skylitzès », CASSARD, J.C., COATIVY, Y., GALLICÉ, A., LE PAGE, D., Le prince, l’argent, les hommes au Moyen-Âge, Mélanges offerts à Jean Kerhervé, Rennes, 2008, p.67-77
LITTLEWOOD, A. R., « An Ikon of the Soul : the Byzantine Letter », Visible Language,
10, 1976, p.197-226 MAGDALINO, P. « Justice and Finance in the Byzantine State, ninth to twelfth
centuries », Laiou, A. and Simon, D. (eds.), Law and Society in Byzantium, Washington, 1994, p 93 – 115
184
MARKOPOULOS A., « Problème relatifs à l’épistolographie », L’épistolographie et la poésie épigrammatique, Actes de la 16e table ronde du XXe Congrès International des Etudes byzantines, Paris, 2003, p.55-61
MULLET, M. « Madness of Genre », Dumbarton Oaks Papers, 46, 1992, p. 235-243 MULLET, M., « The classical Tradition in the Byzantine Letter », MULLET M., SCOTT,
R. (éds.) Byzantium and the Classical tradition, Birmingham, 1981, p.75-93 MULLETT, M., « From Byzantium, with love », JAMES, L. (ed.) Desire and Denial in
Byzantium, 1999, Aldershot MULLET. M., « The detection of relationship in Middle byzantine literary texts : the
case of letters and letter networks. », L’épistolographie et la poèsie épigrammatique., Paris, 2003, p. 63-74
ODORICO, P., Thessalonique, Chronique d’une ville prise, Toulouse, 2005 OIKONOMIDÈS, N., « L’évolution de l’organisation administrative de l’Empire
byzantine au XIe siècle », Travaux et Mémoires, VI, 1976, p.125-152 OIKONOMIDÈS, N., Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe.), Paris, 1996 OIKONOMIDÈS, N., Les listes de préséance byzantines du IXe et Xe siècle, Paris, 1972 PAPAIOANNOU, S. “A Fragile Literature: Byzantine Letter-Collections and the Case of
Michael Psellos,” in P. ODORICO (ed.), La face cachée de la littérature byzantine. Le texte entant que message immédiat, Paris, 2012, p. 289-328.
PAPAIOANOU, S., « Das Briefcorpus des Michael Psellos. Vorarbeiten zu einer
kritischen Neuedition. Mit einem Anhang : Edition eines unbekannten Briefes », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 48, 1998, p.67-117
PATLAGEAN, E., « Byzance et le blason pénal du corps », Du châtiment dans la cité.
Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982), Rome, 1984,
PRATSCH, T., « Zum Briefcorpus des Symeon Magistros : Edition, Ordnung,
Datierung », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 55, 2005, p.71-86 RIEDINGER, J.-C., « Quatre étapes de la vie de Michel Psellos », Revue des Etudes
Byzantines, 68, 2005, p.5-60
185
SARADI H. G., « The Byzantine tribunals problems in the application of justice and state policy (9th-12th c.) », Revue des Etudes byzantines, 53, 1995, p. 165-204
SARADI, H., Le notariat byzantin du IXe au XVe siècle, Athènes, 1991 SEIBT, W., Die Skleroi, Vienne, 1976 SEIBT, W., « Ioannes Skylitzes, Zur Person des Chronisten », Jahrbuch der
Österreichischen Byzantinistik, 25, 1976, p.81-5 SEVČENKO, I. « Levels of Style in Byzantine Prose », Jahrbuch der Österreichischen
Byzantinistik, 31/1, 1981, p.289-312 SVORONOS, N., « Société et organisation intérieure dans l’empire byzantin au XIe
siècle : les principaux problèmes », Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Oxford, 1966
SYKUTRIS, J. « Probleme der byzantinischen Epistolographie », Actes du IIIe Congrès
international d’études byzantines, Athènes, 1932, p.295-310 TINNEFELD, F., « Freundschaft in den Briefen des Michael Psellos : Theorie und
Wirklichkeit », Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 22, 1973, p.152-168 VERBOVEN K., CARLIER M., DUMOLYN J., « A Short Manual to the Art of
Prosopography », KEATS-ROHAN K.S.B. (ed.), Prosopography Approaches and Applications A Handbook, Oxford, 2007, p.36-69
VOGT., A., « Le protospathaire du Phiale et la marine byzantine », Échos d’Orient,
39, 1903, p.328-332 WEISS, G. , Oströmische Beamte im Spiegel der Schriften des Michael Psellos,
Munich, 1973 WOLSKA-CONUS W., « Les écoles de Psellos et Xiphilin sous Constantin IX
Monomaque », Travaux et Mémoires, VI, Paris 1976, p.223-243 WOLSKA-CONUS W., « les écoles de Droit et l’enseignement du droit à Byzance au
XIe s. : Xiphilin et Psellos », Travaux et Mémoires VII, Paris, 1979, p.1-107 ZACHARIÄ VON LINGENTHAL,D. K. E., Geschichte des griechisch-römischen Rechts ,
Berlin, 1892
187
INTRODUCTION GÉNÉRALE 8
PREMIÈRE PARTIE : LE JUGE BYZANTIN : QUELQUES PRÉCISIONS SUR LA NATURE DE LA FONCTION ET LA PLACE DE CEUX QUI L’EXERCENT. 16
CHAPITRE 1 -‐ LE JUGE BYZANTIN, DÉFINITION ET MILIEU D’ÉVOLUTION. 17 DÉFINIR LE JUGE. 17 LE SYSTÈME JUDICIAIRE À CONSTANTINOPLE. 21 LE JUGE DANS LES PROVINCES. 24 CONCLUSION 29 CHAPITRE 2 -‐ ETUDES STATISTIQUES. 30 LES OFFICIERS DE JUSTICES DANS LES LETTRES : STATISTIQUES. 30 LE RAPPORT ENTRE ÉPISTOLIERS ET CORRESPONDANCE AVEC LES JUGES. 34 CONCLUSION 38 CHAPITRE 3 -‐ ONOMASTIQUE ET STATUT SOCIAL. 40 LE MILIEU SOCIAL DES JUGES. 40 QUELQUES JUGES REMARQUABLES. 45 LA QUESTION DE LA FORMATION ET DE L’ÉDUCATION DES FUTURS JUGES. 49 CONCLUSION 54
CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE. 55
DEUXIÈME PARTIE : LE JUGE SOUS TUTELLE : AFFAIRES, RECOMMANDATIONS, PRESSIONS. 58
CHAPITRE 1 -‐ L’ÉPISTOLIER, UN POURVOYEUR D’AFFAIRE. 59 LE CŒUR DE LA JUDICATURE : LES AFFAIRES JUDICIAIRES. 59 LE JUGE-‐GOUVERNEUR : LES AFFAIRES FISCALES. 64 LE JUGE, UN ANCIEN DISCIPLE SOUS TUTELLE. 70 CONCLUSION 75 CHAPITRE 2 -‐ L’IMPÉRATIF DE L’ÉDIFICATION D’UN RÉSEAU : LES RECOMMANDATIONS. 77 LE JUGE, GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF : LES RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES. 77 LE JUGE TOURNÉ VERS SON THÈME : LES RECOMMANDATIONS INFORMELLES. 82 LA QUESTION DE L’EFFICIENCE DE LA RECOMMANDATIONS. 87 CONCLUSION 92 CHAPITRE 3 -‐ LE JUGE, PION SUR L’ÉCHIQUIER DES « ÉPISTOLIERS ». 93 LE JUGE, PROTECTEUR DES INTÉRÊTS DE SON MAÎTRE. 93 LA LIBERTÉ DU JUGE CONTINUELLEMENT REMISE EN DOUTE. 97 LE JUGE PRODUIT DE LA MENTALITÉ DE L’ÉLITE : LES COMPORTEMENTS PEU VERTUEUX. 102 CONCLUSION 108
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE. 109
188
TROISIÈME PARTIE LE BYZANTIN DERRIÈRE LE JUGE : MOTEUR DE SON ACTION ET CONSÉQUENCE SUR SON EXISTENCE. 112
CHAPITRE 1 -‐ L’AMITIÉ, MOTEUR DE L’ACTION DES JUGES ? 113 DES RELATIONS AMICALES ENTRE JUGES ET ÉPISTOLIERS. 113 L’AMITIÉ PHILOSOPHIQUE PSELLIENNE. 118 LA NOTION DE ΦΙΛΙΑ : PRÉTEXTE À L’ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DE SOUMISSION. 122 CONCLUSION 126 CHAPITRE 2 -‐ L’AMBITION DES JUGES ET LEURS PERSPECTIVES DE CARRIÈRE. 127 PROSOPOGRAPHIE DE QUELQUES JUGES REMARQUABLES : LES CARRIÈRES LES PLUS BRILLANTES. 127 HYPOTHÈSES ET RECHERCHE DE LIGNE DIRECTRICE À PARTIR DU MODÈLE DES GRANDES CARRIÈRES DE JUGE. 132 LA CENTRALITÉ DE CONSTANTINOPLE : CHAÎNE LIANT LES JUGES AUX ÉPISTOLIERS. 137 CONCLUSION 141 CHAPITRE 3 -‐ LA VIE DES JUGES : SUR LES ROUTES DE LA DÉCEPTION ET DE L’ISOLEMENT. 143 LE JUGE-‐PLANÈTE FACE À L’ARBITRAIRE IMPÉRIAL. 143 LE JUGE EN TERRE HOSTILE : LA CONSTANTINOPOLISATION DES ESPRITS. 147 LE JUGE ISOLÉ SOCIALEMENT DANS SON THÈME ET DANS SON MILIEU PROFESSIONNEL 152 CONCLUSION 157
CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE. 159
CONCLUSION GÉNÉRALE 162
Annexe n°1 -‐ Récapitulatif des juges nommés. 170 Annexe n°2 -‐ Statistiques générales. 171 Annexe n°3 -‐ Répertoire des lettres utilisées dans cette étude. 173 Annexe n°4 -‐ Carte des thèmes vers 1050. 178 Bibliographie 179
En couverture : « Psellos éduquant Michel VII Doukas », ms. Athos, Pantokratoros 234, f. 234r. - fin XIIe s. http://proteus.brown.edu/psellos/Home [Consulté le 10 juin 2014]