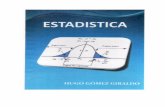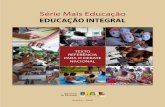DURING Introduction à Durée et Simultanéité de Bergson (2009)
Transcript of DURING Introduction à Durée et Simultanéité de Bergson (2009)
Elie During Introduction au dossier critique de Henri Bergson, Durée et simultanéité, Paris, Presses Universitaires de France, 2009 (p. 219-244) © PUF, 2009.
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE219 (P01 ,NOIR)
Introduction au dossier critique
par Élie During
« Je n’y vois pas seulement une physique nouvelle, mais aussi, à certainségards, une nouvelle manière de penser. » (Henri Bergson, « Discussion avecEinstein », 6 avril 1922.)
Toute nouvelle édition de Durée et Simultanéité sembledevoir s’accompagner de mises en garde, d’avertissements, pourne pas dire d’excuses aux lecteurs. Avouons-le, ce livre a long-temps embarrassé les bergsoniens. Rares sont ceux qui se sontrisqués à le défendre publiquement. Comment comprendre, d’ail-leurs, l’obstination du philosophe à réaffirmer des positions quela communauté des physiciens, sinon dans son ensemble, dumoins à travers certains de ses membres les plus éminents– Einstein en tête –, s’était employée à corriger sans ménage-ment, au risque de lui faire perdre tout crédit ? Lassé des polé-miques et des malentendus accumulés au sujet de son livre,Bergson décida d’en suspendre la publication après la sixièmeédition, celle de 1931. On a cru que ce geste valait répudiation :rien n’est moins sûr. Mais le livre connut dès lors une éclipsequi annonçait peut-être, plus largement, un reflux du bergsonismetout entier. Ce n’est que timidement que l’ouvrage retrouva saplace, après guerre, dans le corpus du philosophe, mais à la
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE220 (P01 ,NOIR)
manière d’une curiosité, tout juste digne des Mélanges1. Prèsd’un siècle après les faits – le livre fut publié en 1922 –, il fal-lait rouvrir le dossier et y apporter, ici et là, les pièces qui man-quaient à son intelligence complète, non certes pour un procès enappel qui n’aurait plus grand sens aujourd’hui, mais parce quela distance qui nous sépare désormais des circonstances de cetteconfrontation entre la philosophie bergsonienne et la théorie de larelativité – confrontation sans précédent dans son genre, si l’onsonge à la stature des protagonistes –, ne peut qu’accentuer leseffets de distorsion, rendant d’autant plus nécessaire le travail demise en perspective destiné à en faciliter l’accès.
Intention de cette édition
Les notes rassemblées dans ce dossier, la constitution de latable analytique, de l’index ainsi que du dossier des « lectures »,ont d’abord été guidées par le souci de restituer au texte uneépaisseur historique et intertextuelle que ne laissent pas toujoursdeviner les références bibliographiques, d’ailleurs curieusementsélectives, données par son auteur. Pour donner une idée justedes circonstances de son élaboration et de sa réception, il étaitnécessaire d’expliciter, quand cela était possible, les sourcesscientifiques de Bergson, d’identifier ses interlocuteurs réels ouvirtuels – et même « fantasmatiques », tant il est vrai que lathéorie d’Einstein, dans le tableau qu’en brosse le philosophe,
1. Sur l’histoire des rééditions successives de Durée et Simultanéité, on pourraconsulter, dans la partie « lectures » de ce dossier, l’avertissement à la septièmeédition, et le commentaire que nous en donnons. Le texte présenté ici reprend celuide la première édition des Presses Universitaires de France, en 1968. Cette éditionétait donc en réalité la septième, si l’on prend les choses dès l’origine ; elle se fon-dait elle-même sur le texte de la deuxième édition de 1923, laquelle ne présentaitaucune variation par rapport à la première édition (Durée et Simultanéité, Paris,Félix Alcan, 1922), à l’exception de trois appendices ajoutés à la fin de l’ouvrage,ainsi que d’un bref avant-propos.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ220
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE221 (P01 ,NOIR)
présente d’étranges ressemblances avec celle de Poincaré –, enfinde réinscrire l’ouvrage dans le contexte d’une réception problé-matique, continuée jusqu’à nous. Cependant, il nous a semblétout aussi important de ne pas perdre de vue que Durée etSimultanéité est, de plein droit, un livre de philosophie. À cetitre, il exige d’être ressaisi du point de vue de ses enjeuxinternes, mais aussi dans sa relation au reste de l’œuvre, commel’expression d’une pensée en devenir qui, jusqu’au bout, auraremis en jeu certains de ses concepts les plus fondamentaux – àcommencer par celui de durée, inscrit dans le titre –, en fonctionde nouveaux problèmes.
La difficulté principale nous paraît d’ailleurs être de ce côté.La plupart des polémiques se sont en effet concentrées, dès laparution du livre, sur la question de savoir si Bergson avait biencompris la théorie de la relativité, et par conséquent si ses argu-ments avaient une quelconque valeur du point de vue scientifi-que. C’était supposer, implicitement, que les erreurs de Bergsonne pouvaient qu’être rédhibitoires, autrement dit qu’elles invali-daient le projet dans son ensemble au point de lui ôter tout inté-rêt autre qu’historique. Cela aurait été le cas si Durée et Simul-tanéité entendait en effet rectifier Einstein sur le terrain mêmede la physique. Or c’est ce dont Bergson s’est toujours défenduavec la dernière vigueur. « C’est la physique de la relativité, etcette physique uniquement, qui est étudiée dans Durée et Simul-tanéité. Seulement elle est étudiée en vue d’une réponse à laquestion posée par le philosophe, et non plus par le physi-cien1. » Il n’empêche : la plupart des critiques qui se sont pen-chés sur son livre ont cru bon de procéder à une correction decopie, sans beaucoup se soucier du problème. Les gens dumétier, physiciens ou mathématiciens, colonels ou généraux (le
1. M, p. 1438
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 221
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE222 (P01 ,NOIR)
polytechnicien André Metz se distinguant, dans cette rubrique,par la constance de ses assauts), étaient évidemment les mieuxplacés pour instruire ce procès en incompréhension ou en« imposture ». Les derniers à sacrifier au genre sinistre du bêti-sier n’étaient pas les plus inventifs : ils reprenaient pour l’essen-tiel leurs arguments à des livres publiés dans les années 19201.
Nous aurons l’occasion de revenir dans les pages qui suiventsur les reproches adressés à Bergson. S’il n’est pas questiond’accorder au philosophe une impunité de principe, il importe debien saisir leur portée, pour ne pas classer l’affaire trop rapide-ment. Mais auparavant, il faut s’arrêter un moment sur un faitqui ne laisse pas d’étonner : la rareté des commentaires propre-ment philosophiques suscités par un livre qui a fait par ailleurstant de bruit. On peut trouver deux raisons à ce silence embar-rassé des philosophes. Il s’explique pour partie par la naturemême de l’enquête : Bergson se donne pour objet la notion detemps, telle qu’elle est en usage dans la relativité restreinte2.
1. Alain Sokal et Jean Bricmont, Les Impostures intellectuelles, 1997. Dans lechapitre qu’ils consacrent à la lecture bergsonienne de la relativité et à sa postérité,les auteurs reprennent la plupart des critiques formulées par Metz, d’Abro ou HervéBarreau, en s’étonnant qu’un livre qui, « d’un point de vue scientifique […] estpresque entièrement faux » (p. 269 n), puisse être « toujours en vente » ! Sur lefond, les objections se concentrent sur deux points : la réciprocité de l’accélérationet le caractère fictif des temps associés aux systèmes en mouvement. Seul le pre-mier point nous paraît réellement problématique, dans la mesure où il conduit Berg-son à refuser a priori les prédictions empiriques illustrées par le célèbre « paradoxedes jumeaux » ; le second est clairement hors de propos, comme nous l’expliquonsplus loin dans les notes. Mais les « erreurs » incriminées sont d’autant plusgênantes aux yeux de Sokal et Bricmont qu’ils considèrent que « cet ouvrage n’estpas seulement un livre de philosophie : c’est aussi un livre de physique… »(p. 269). Il est vrai que Bergson, qui entend discuter la théorie d’Einstein,s’emploie pour une part à en exposer les principaux résultats. Mais à ce compte,Les Impostures intellectuelles devrait être lu comme un ouvrage de philosophie, aumotif que des philosophes y sont cités…
2. La genèse du projet remonte en fait à 1911, année où Paul Langevin intro-duit la théorie de la relativité auprès du public philosophique par une série deconférences remarquées (voir les textes reproduits dans la section « lectures » de cedossier). Si le projet de Bergson était initialement de se livrer pour lui-même à unexercice de mise au point philosophique (« nous l’avions entrepris exclusivement
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ222
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE223 (P01 ,NOIR)
À beaucoup cette entame aura paru trop étroite pour mobiliserdirectement les grandes catégories du discours philosophique ouépistémologique (idéalisme et réalisme, a priori et expérience,substance et relation, etc.). Trop étroite, ou trop austère. Si sonintention n’est nullement d’offrir un ouvrage d’introduction à lathéorie – il en existe déjà d’excellents à l’époque –, Bergson estbien obligé d’entraîner son lecteur dans quelques exercicesdépaysants, et même franchement rebutants, à l’image de ce pre-mier chapitre accumulant les lignes de calcul pour étayer unedescription délibérément pré-einsteinienne de la célèbre expé-rience de Michelson-Morley. Son souci pédagogique le conduitsouvent, comme il le reconnaît lui-même, à reprendre les mêmesquestions sous plusieurs angles, à varier les cas de figure au ris-que de susciter une lassitude ou une impression de redite. Cepen-dant la paresse proverbiale des philosophes, dès lors qu’unematière leur résiste et que s’y mêle un peu de symbolismemathématique1, n’est pas seule en cause. Il faut bien admettre
pour nous », dit-il dans la préface), l’écriture, probablement concentrée sur quelquesmois de l’été 1921, de ce qui ne devait d’abord donner lieu qu’à une simple« note », prit rapidement un tour différent, dès lors qu’apparaissait clairement saportée plus générale, liée à l’examen des fameux paradoxes relatifs au temps. Lapréparation du livre, sans doute perturbée ou retardée par les événements consécu-tifs à la Grande Guerre et à l’investissement personnel de Bergson dans laCommission Internationale de la Coopération Intellectuelle, coïncide avec la pre-mière diffusion de la théorie de la relativité en direction d’un public qui ne selimite plus aux spécialistes de l’électromagnétisme, ni même à la seule communautéscientifique. Voir Vincent Borella, L’Introduction de la Relativité en France,1905-1922, 2000 ; Philippe Soulez et Frédéric Worms, Bergson : biographie, 2002.
1. Bergson s’en plaint à Jacques Chevalier en ces termes : « J’avoue d’ailleursque bien peu de lecteurs philosophes m’ont compris. Je n’ai pourtant donné dansmon livre que des formes mathématiques aptes à être comprises de tous. Mais il estextraordinaire de voir à quel point les philosophes chez nous sont ignorants desmathématiques. » (Entretiens avec Bergson, 1959, texte cité dans les « lectures »). Iln’est peut-être pas inutile de rappeler que Bergson a toujours cultivé un goût et untalent réel pour les mathématiques. Pour autant, il serait ridicule d’invoquer, commeun argument d’autorité, le premier prix au Concours général de mathématiquesobtenu en 1877. Le fait que d’éminents physiciens se soient égarés en leur tempsau sujet des théories d’Einstein montre bien que les compétences supposéesn’offrent ici aucune garantie (voir à ce sujet le livre de Michel Biezunski, Einstein
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 223
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE224 (P01 ,NOIR)
que la facture du livre, son caractère inhabituellement aride, laredondance très accusée de certains passages, les motifs inlassa-blement repris avec des variations parfois indiscernables, n’ontpas beaucoup contribué à rendre lisibles les enjeux philosophi-ques les plus profonds de cette confrontation décisive souhaitéepar Bergson avec la théorie de la relativité. Or c’est là, noussemble-t-il, qu’il faut faire porter l’effort, si l’on veut qu’uneédition critique soit autre chose qu’un exercice de restauration,au sens muséal de ce terme.
Car pour occuper une place singulière au sein de l’ensembledu corpus, Durée et Simultanéité n’est nullement une œuvre péri-phérique. Une fois ce point admis, il est nécessaire de replacerles choses à l’endroit : ce n’est que du point de vue des enjeuxphilosophiques de l’œuvre – enjeux internes à la philosophiebergsonienne, mais aussi problèmes communs à une époque oùse redéfinit en profondeur le rapport entre science et philoso-phie – qu’on peut espérer apporter une lumière sur les« bourdes » ou les « boulettes » attribuées à Bergson à tort ou àraison – et parfois, hélas, à raison. Toute démarche qui s’impo-serait de débusquer et de rectifier au préalable les « erreurs » duphilosophe, s’exposerait immanquablement à manquer la signifi-cation profonde de sa démarche et, si l’on peut dire, les raisonsqu’il avait de se tromper sur certains points. Il sera toujourstemps par la suite de « redresser » ses vues. Encore sera-t-il plusintéressant – nous nous y employons dans les notes – decomprendre la logique qui gouverne les distorsions subtiles ouflagrantes infligées ici et là par Bergson à l’esprit de la
à Paris, 1991). D’ailleurs, Bergson lui-même n’hésitait pas à reconnaître seslimites ; s’il n’a pas consacré à la relativité générale les développements qu’onaurait pu attendre, c’est qu’il ne se sentait pas assez armé pour approfondir concrè-tement – comme sa méthode l’exigeait – les bases mathématiques de la relativitégénérale.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ224
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE225 (P01 ,NOIR)
relativité : plutôt que de traquer systématiquement les erreurs dephysique, au risque de forcer le sens d’arguments qui se veulentd’abord philosophiques, on se rendra sensible aux motifs et par-fois aux images qui polarisent et infléchissent le propos dans unedirection qui finit par l’écarter de la stricte ligne einsteinienne.
Physique et métaphysique
Cependant, la première tâche critique est de rendre comptedes malentendus qui entourent la réception philosophique del’œuvre, malentendus si persistants qu’ils ont conduit à l’occulterjusque dans les rangs des plus dévoués partisans du bergso-nisme. L’origine de ces malentendus n’est pas difficile à identi-fier : la discussion a pâti de la fausse clarté d’un problèmeauquel on a voulu réduire la portée des analyses bergsoniennes.Le lieu commun peut se formuler ainsi : Durée et Simultanéitéchercherait à concilier le temps psychologique et le temps physi-que, à faire reconnaître la priorité épistémologique ou phénomé-nologique du premier et le caractère nécessairement dérivé dusecond. Même les profondes analyses de Merleau-Ponty ou deDeleuze finissent par conforter cette vision des choses. On se ditqu’un règlement à l’amiable, une espèce de coexistence pacifiqueentre deux significations du temps devrait permettre au philoso-phe et au physicien de poursuivre leurs activités sur des voiesparallèles. Réduite à une question de voisinage, l’opposition sco-laire entre le « temps des consciences » et le « temps des hor-loges » – opposition si générale qu’il est même difficile de luiobjecter quoi que ce soit – se résout en trivialité.
Or il est clair que tout le travail de Bergson consiste à préci-ser la nature de la relation entre durée vécue et temps mesuré,pour poser le problème à neuf. À vrai dire, sa démarche est bienplus interventionniste que ne le laisse paraître cette première
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 225
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE226 (P01 ,NOIR)
caractérisation : il ne s’agit pas simplement de tenter de concilierle bergsonisme avec la théorie physique, de faire en sorte que letemps d’Einstein s’ajuste, tant bien que mal, au concept bergso-nien de durée, ni d’obliger le physicien à lui faire une place sousles constructions du temps scientifique ; il s’agit, plus profondé-ment, de montrer que ce fameux « temps » de la relativité n’ad’une certaine manière pas encore été pensé, et que cet impenséentretient des confusions qu’une analyse philosophique est capablede dissiper. Comme le dit Merleau-Ponty, l’idée de temps multi-ples relatifs à divers systèmes de référence repose sur une « onto-logie naïve ». Cette ontologie de fortune qui hypostasie tout cequ’elle pose et s’imagine pouvoir distinguer les temps comme despommes dans un panier, peut bien convenir au physicien lorsqu’illui arrive de quitter le tableau noir pour parler « en prose ». Maisle premier mouvement du philosophe est de s’étonner, et de pro-tester.
À l’époque où écrit Bergson, les pamphlets et les articles semultiplient, jusque dans la presse populaire, qui présentent defaçon enthousiaste ou goguenarde la métaphysique extravagantedu « physicien allemand ». Tantôt on souligne le caractère pro-prement invraisemblable de ces temps ralentis et dilatés par lavitesse, de ces jumeaux éternellement jeunes, de ces espacescourbés à quatre dimensions où l’avenir, comme déroulé sousnos yeux, s’offre à de joyeuses escapades ; tantôt on célèbrel’audace spéculative d’un penseur qui n’hésite pas à sacrifier lesens commun aux intérêts supérieurs du progrès scientifique.
« Mes livres ont toujours été l’expression d’un mécontente-ment, d’une protestation1 ». Cette affirmation de Bergson vaut enparticulier pour ce livre-ci. Protestation double, entretenue par les
1. Cité par Jean de La Harpe dans A. Béguin et A. Thévenaz (dir.), HenriBergson : essais et témoignages inédits, 1941, p. 359.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ226
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE227 (P01 ,NOIR)
excès de la vulgarisation : contre les temps démultipliés, démem-brés et disloqués par les vitesses ; contre la solidification de cesmêmes temps dans la forme d’un bloc espace-temps où plus rienne coule, où le temps s’amalgame avec l’espace. « Impossi-ble ! », s’exclame l’intuition. Selon une image qui caractérisepour Bergson le rapport de la métaphysique à la science, le phi-losophe cherchera donc à « redresser » l’interprétation communede la théorie, ou tout au moins les habitudes verbales contrac-tées par le physicien lorsqu’il entreprend de l’exposer dans lalangue ordinaire. Car, Bergson en est convaincu, la théorie phy-sique se double, presque inconsciemment, d’une métaphysiquetout à fait douteuse, qu’il appartient au philosophe de débusquerin statu nascendi pour en exposer les équivoques.
Peut-être songeait-il tout particulièrement à Durée et Simulta-néité en écrivant, dans La Pensée et le mouvant : « [À] lascience, comme à la métaphysique, nous avons attribué le pou-voir d’atteindre un absolu. Nous avons seulement demandé à lascience de rester scientifique, et de ne pas se doubler d’unemétaphysique inconsciente, qui se présente alors aux ignorants,ou aux demi-savants, sous le masque de la science. » (PM,p. 71). Ainsi une « mauvaise métaphysique », d’autant plus perni-cieuse qu’elle ne se reconnaît pas pour telle, risque toujours de« fausser », sinon la science elle-même, du moins son orientationphilosophique la plus novatrice. « En somme, il n’y a rien àchanger à l’expression mathématique de la théorie de la Relati-vité. Mais la physique rendrait service à la philosophie en aban-donnant certaines manières de parler qui induisent le philosopheen erreur, et qui risquent de tromper le physicien lui-même surla portée métaphysique de ses vues. » (DS, p. 207-208). S’agit-ild’autre chose que d’une question de mots, d’un abus de méta-phores qu’une langue moins fleurie suffirait à dissiper ?
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 227
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE228 (P01 ,NOIR)
Malentendus
Et comment expliquer, alors, que même les philosophes n’yaient en général pas trouvé leur compte ? On a mentionné les« erreurs » de Bergson : le ralliement enthousiaste de physiciensanti-relativistes qui, d’Édouard Guillaume1 à Herbert Dingle2, sedéclareront ouvertement partisans du maintien du temps absolude l’ancienne mécanique, n’arrangeait sans doute pas les choses.On a évoqué aussi le caractère inhabituellement abrupt de l’écri-ture, rapide et dense, de cet essai qui se présente à certainségards comme un exercice de travaux pratiques philosophiques.Mais il faut reconnaître que, dans le flot de publications suscitéespar la diffusion de plus en plus large de la théorie d’Einstein, lesintentions mêmes de l’ouvrage étaient difficiles à cerner. Berg-son utilise, sans beaucoup se soucier de leur cohérence doctri-nale et sans toujours les citer, les écrits de relativistes orthodoxescomme Paul Langevin ou Jean Becquerel – outre Einstein lui-même, bien entendu… –, de relativistes moins orthodoxes commeEbenezer Cunningham, de tenants de l’empirisme logique commeSchlick, d’adversaires de la relativité comme Édouard Guillaumeou Paul Dupont, de médiateurs de talent comme Charles Nord-mann, enfin de métaphysiciens d’obédiences diverses comme Jac-ques Maritain, Alfred North Whitehead ou Herbert WildonCarr… À quoi il faut ajouter la présence tutélaire d’Ernst Mach,dont l’idée d’une caractérisation purement relationnelle du
1. Voir les extraits reproduit ici dans le recueil de « lectures ».2. Ce physicien, d’abord acquis à la cause relativiste, s’employa ensuite et
jusqu’à la fin de ses jours à tenter de démontrer à travers livres et articles, que lathéorie de la relativité restreinte était intrinsèquement viciée et contradictoire dansses fondements mêmes. C’est à lui que l’on doit la longue introduction de la pre-mière édition anglaise de Durée et Simultanéité (Duration and Simultaneity, trad.L. Jacobson, 1965). Ce choix éditorial est assez malheureux, mais le cas de Dingleest tout à fait intéressant en soi (voir Hasok Chang, « A Misunderstood Rebellion.The Twin-Paradox Controversy and Herbert Dingle’s Vision of Science », Studiesin History and Philosophy of Science, 24, 1993, p. 741-790).
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ228
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE229 (P01 ,NOIR)
mouvement parcourt tout le deuxième chapitre, ainsi que celle dePoincaré qui, pour n’être jamais nommément cité, hante plusd’un passage du livre, au point qu’il n’est pas exagéré de direqu’une grande part des distorsions infligées par Bergson à l’espritde la théorie relativiste peuvent se comprendre comme un phéno-mène d’interférence entre la relativité de Poincaré et celle d’Eins-tein1. La ligne est-elle plus claire du côté philosophique ?
Il faut prendre Bergson au mot quand il nous explique qu’iln’avait pas de position à défendre, pas même celle qu’il avait pudéfendre lui-même dans ses écrits précédents, à une époque oùil n’avait pas eu l’occasion de se confronter directement auxquestions nouvelles suscitées par la relativité, pour la bonne rai-son qu’il ne la connaissait pas. De manière générale, le nouagephysique/métaphysique n’a rien d’un rapport d’application ou dejustification. Dans une note capitale de La Pensée et le mou-vant, Bergson explique : « Ajoutons, au sujet de la théorie de laRelativité, qu’on ne saurait l’invoquer ni pour ni contre la méta-physique exposée dans nos différents travaux, métaphysique quia pour centre l’expérience de la durée avec la constatation d’uncertain rapport entre cette durée et l’espace employé à la mesu-rer2. » Cette affirmation confirme un trait caractéristique de laméthode bergsonienne : « J’ai fait chacun de mes livres enoubliant tous les autres. Je me plonge dans la méditation d’unproblème ; je pars de la “durée” et je cherche à éclairer ce pro-blème, soit par contraste, soit par similitude avec elle. Malheu-reusement, voyez-vous, mes livres ne sont pas toujours cohé-rents entre eux : le “temps” de l’Évolution créatrice ne “colle”
1. Nous défendons cette idée dans Bergson et Einstein : la querelle de la rela-tivité, Presses Universitaires de France, 2010.
2. PM, p. 37.
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 229
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE230 (P01 ,NOIR)
pas avec celui des Données immédiates1. » On en dirait autant du« temps » de Durée et Simultanéité. Ainsi le « temps réel », quifigure au cœur de l’essai. Défini au croisement de la durée vécuepar une conscience et du compte des simultanéités impliqué parl’opération de mesure, il ne se confond pas purement et simple-ment avec la « durée réelle » évoquée dans les précédents livres.C’est peut-être là le point le plus difficile à comprendre,lorsqu’un philosophe comme Bergson entreprend de se penchersur la science de son temps. Il ne s’agit jamais simplement de« régler ses comptes2 » avec telle ou telle théorie, mais de rejouerle système tout entier en tentant un montage original, en cher-chant les points de raccord ou d’embrayage qui permettront à lapensée d’aller un peu plus loin qu’elle n’aurait pu autrement.
Répétons-le : Bergson n’a jamais prétendu faire autre chosequ’étudier la théorie de la relativité, mais « en vue d’une réponseà la question posée par le philosophe, et non plus par le physi-cien3 ». Le problème peut s’énoncer ainsi : il s’agit de savoir cequi, parmi les temps évoqués par le physicien, « est temps effec-tivement mesuré, réel, et ce qui est temps attribué, auxiliaire,temps irréel4 ». Contre l’affirmation paradoxale d’une irréductiblepluralité des temps, la conclusion défendue par Bergson prendune forme non moins paradoxale : en faisant le partage entre« réel » et « fictif », il est possible, croit-il, d’extorquer à ladémarche relativiste l’affirmation d’un temps réel unique del’univers matériel. Le concept de « temps réel », on l’a dit, aspécialement été élaboré dans le contexte de Durée et
1. Cité dans A. Béguin et P. Thévenaz, Henri Bergson : essais et témoignagesinédits (1943), p. 360.
2. L’expression est attribuée à Bergson lui-même par Jacques Chevalier,op. cit. : « Je veux régler mes comptes avec Einstein » (texte cité dans ce dossier,7 février 1922).
3. M, p. 14384. M, p. 1438.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ230
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE231 (P01 ,NOIR)
Simultanéité, en fonction d’un problème qui n’est pas directementsuperposable à ceux des autres livres. Mais il reste à compren-dre ce qui motivait, pour commencer, le problème lui-même, etle travail de distinction qu’il appelait. Pourquoi le philosophedevrait-il se soucier de la métaphysique imagée qui soutient lediscours en prose du physicien ? Bergson ne pouvait-il se conten-ter de répéter ce qu’il avait dit ailleurs, et depuis longtemps, del’usage du temps mathématique en mécanique, ce temps qui ne« dure pas »1 ? N’est-ce pas tout usage du temps dans la mécani-que qui méritait d’être réputé « iréel » ou « fictif » ?
On touche ici à l’essentiel, et du même coup aux raisons lesplus profondes du malentendu. La motivation première de laconfrontation tentée par Bergson avec la théorie de la relativitépeut être énoncée simplement : la manière dont le physicienenvisage la pluralité des temps revient à reporter sur la duréevivante le morcelage artificiel de la réalité en systèmes de réfé-rence. Einstein commence par appliquer le temps sur les articu-lations de l’espace galiléen en y faisant courir ses « lignes delumières » à vitesse constante : dans ces conditions, la relativitéde l’espace entraîne, naturellement, celle du temps. Les simulta-néités se disloquent, tandis que la dilatation ou le ralentissementdes durées sous l’effet de la vitesse semble compromettre l’idéed’un temps absolu, indépendant des systèmes de référence. À lalimite, cette démarche conduit à abandonner l’idée même d’unedurée de la matière saisie en totalité, dans son extension maxi-male : que « l’univers dure » signifie seulement qu’on peut ymesurer des durées. Or, avec la durée de l’univers, n’est-ce pasdu même coup la dimension d’ouverture et d’indétermination
1. « Ce fut l’analyse de la notion de temps, telle qu’elle intervient en mécani-que ou en physique, qui bouleversa toutes mes idées. Je m’aperçus, à mon grandétonnement, que le temps scientifique ne dure pas… » (Lettre à William James du9 mai 1908, M, p. 765-768).
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 231
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE232 (P01 ,NOIR)
propre au devenir en général qui finit par se perdre ? L’espace-temps à quatre dimensions, où toute l’histoire de l’univers sem-ble pouvoir être étalée d’un coup, n’illustre-t-il pas de manièreexemplaire l’effacement du caractère irréductible de la durée ?Telles sont les questions que Bergson croit pouvoir formuler, nonpas a priori, en s’appuyant sur on ne sait quelle intuition supra-sensible du temps « en soi », non pas en absolutisant, tellesquelles, les modalités du temps de la conscience, mais en s’avan-çant sur le terrain du scientifique, en entrant dans la fabriquephysicienne du temps pour y faire la part du « réel » et du « fic-tif ».
On n’a pas manqué de reprocher à Bergson de trop attendrede cette science qu’il qualifie par ailleurs si volontiers d’abs-traite, de conventionnelle et de symbolique. Pourquoi chercher àtoute force à réconcilier la science positive et la métaphysique ?N’aurait-il pas été plus simple de revendiquer, comme Alain ouMaritain, le droit de poursuivre librement une élaboration philo-sophique du temps, sans trop se préoccuper des « révélations »d’une science portée à confondre ses constructions avec le fonddes choses ? N’aurait-il pas été plus sage de mettre les tempsdilatés et les simultanéités disloquées d’Einstein sur le compte dela relativité des conditions de mesure, pour laisser le champ libreà une réflexion sur la saisie intuitive du temps vécu ? AinsiBrunschvicg entend dissiper l’« apparence de mythe imaginaire »des paradoxes relativistes en expliquant qu’on ne peut espérertirer des conclusions ontologiques d’une pluralité de temps« devenus les hypostases de leurs mesures […], abstraction faitedes conditions spéciales dont on est parti pour les mesurer1 ».Bergson, lui, choisit la voie escarpée ; il entend redresser l’onto-logie et la science l’une part l’autre, et il faut le prendre au mot
1. Léon Brunschvicg, L’Expérience humaine et la causalité physique, 1922.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ232
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE233 (P01 ,NOIR)
lorsqu’il explique à Einstein que sa théorie apporte aux philoso-phes « une nouvelle manière de penser ».
Bergson-Einstein : un dialogue de sourds
Cette audace a un prix et la « discussion » organisée le6 avril à la Société française de philosophie à l’occasion de lavenue d’Einstein à Paris en 1922 cristallise à elle seule tous lesmalentendus1. Cette rencontre – qui fut aussi un événement mon-dain – eut un retentissement considérable. Chose remarquable,Durée et Simultanéité n’était même pas encore publié à cettedate (il ne le sera pas avant l’automne). La réception du livreétait de toute manière mal engagée, car il n’y eut ce jour làaucun dialogue à proprement parler – plutôt un double monolo-gue. Plus tard, Einstein parlera des « bourdes » ou des « bou-lettes monstres » de Bergson2, tout en s’exclamant « Gott verzeihihm ! » (« Que Dieu le pardonne ! »). Il évoquera l’« erreur3 »(« Das ist ein Irrtum ! »), qui plus est « d’ordre purement physi-que4 », dont se serait rendu coupable le philosophe. Mais
1. Nous reproduisons le texte de la discussion dans les « lectures ». Ce dialoguemanqué constitue le prétexte de notre livre, Einstein et Bergson : la querelle de larelativité.
2. Albert Einstein, Œuvres choisies, vol. 4, Correspondances françaises,M. Biezunski (éd.), Paris, Seuil, 1989, p. 287. Cf. Abraham Pais, Subtle is theLord, Oxford, Oxford University Press, 1982, p. 510.
3. Isaac Benrubi, Souvenirs sur Henri Bergson, Neuchâtel, Delachaux & Nies-tlé, 1942, p. 108. Le passage vaut d’être cité en entier : « Je lui demandai ce qu’ilpensait Durée et Simultanéité ; il répondit que Bergson ne l’avait pas compris, sur-tout qu’il n’avait pas saisi la partie physique de la théorie de la relativité. “Das istein Irrtum !” s’écria Einstein pour exprimer son mécontentement sur la conceptionbergsonienne de sa doctrine. “Avez-vous essayé de discuter avec Bergson sur Duréeet Simultanéité ?” lui dis-je. “Non, répondit-il, et je n’ai pas l’intention de le faire,à moins que Bergson lui-même ne provoque la polémique. D’ailleurs cela ne servi-rait à rien.” Pour ce qui est de l’avenir de la théorie de la relativité : “Es wirdGras darüber wachsen, und dann wird man mit mehr Objektivität darüber urteilen”[“De l’eau passera sous les ponts, et on en jugera ensuite avec davantage d’objec-tivité”]. » (Souvenir du 25 juillet 1924).
4. Extrait de la lettre d’Einstein à André Metz publiée dans la Revue de philo-
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 233
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE234 (P01 ,NOIR)
l’explication n’aura jamais lieu directement. Quant à la discus-sion du 6 avril 1922, elle devait laisser tout le monde sur safaim. Il reste intéressant d’y revenir pour mieux saisir les vérita-bles enjeux d’un ouvrage qu’il est peut-être temps de simplementsonger à lire.
« Il n’y a donc pas un temps des philosophes ; il n’y a qu’untemps psychologique différent du temps du physicien1. » AinsiEinstein concluait-il, sous la forme d’une déclaration quelque peuabrupte, un bref échange sur la question du statut du temps dansla théorie de la relativité. Ce faisant, il retirait d’une main cequ’il offrait de l’autre : car à le suivre, le temps physique n’étaitpas fondamentalement distinct du temps auquel chacun se réfèrecouramment en consultant des horloges ; le physicien en propo-sait seulement une définition plus stricte, en substituant à l’appré-hension intuitive du temps une « construction mentale », un « êtrelogique ». On voit bien ce qu’une manœuvre en apparence silibérale recelait de réelle violence. Cela revenait à dire : si letemps physique est bien le temps de tout le monde, au sens où ilne se réduit pas à un artifice mathématique, c’est bien le physi-cien qui, dans tous les cas, détient la vérité à son sujet. Abruptefin de non recevoir opposée à l’analyse philosophique, où Mer-leau-Ponty verra la menace d’une « crise de la raison ».
Mais voyons comment s’engage la discussion. Bergson vientde présenter le propos de son livre à paraître, en reprenant uncertain nombre d’éléments de ce qui doit en constituer la pré-face. De son allocution, Einstein n’a semble-t-il retenu qu’unechose : l’affirmation, par le philosophe, des droits d’un temps« donné intuitivement », logé au cœur même de la constructionscientifique. Sous la simultanéité mesurée, nécessairement relative
sophie à l’occasion de la polémique avec Bergson (cf. dans ce dossier l’article « Letemps réel et les temps fictifs »).
1. M, p. 1346.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ234
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE235 (P01 ,NOIR)
en vertu des conditions mêmes dans lesquelles on la définit (syn-chronisation par échange de signaux optiques), il y a la simulta-néité vécue ; sous le « temps mesurable » il y a la « duréeréelle ». Qui le nierait ? Certainement pas Einstein, qui fait juste-ment de la simultanéité locale – celle qu’un observateur note àchaque fois qu’il observe conjointement, dans un acte indivisi-ble, la réception d’un signal et une indication d’horloge –, lacondition opérationnelle de toute mesure du temps. Il est vraiqu’il l’entend en un sens bien particulier : là où Bergson évo-que la coexistence entre des flux, il note la coïncidence entre desévénements ponctuels. Mais enfin, un accord minimal peut tou-jours être trouvé sur ce terrain. Les difficultés réelles commen-cent lorsque le philosophe entend se prononcer sur ce qui consti-tue proprement le lieu de l’élaboration relativiste du concept detemps : la simultanéité à distance, et plus généralement l’idéed’une simultanéité globale, étendue à l’univers entier, insépara-ble d’un ordre du temps, autrement dit d’une coordination destemps locaux. C’est cette simultanéité à distance qui se disloquelorsqu’on passe d’un système de référence à un autre : c’est ellequ’il faut soumettre à la critique, si l’on refuse de réduire l’uni-versalité du devenir à la sphère des consciences où se constitue-rait un « temps subjectif », radicalement séparé du temps deschoses ou de la durée de l’univers.
Ce point n’a pas été compris par Einstein ; il cristallise toutle différend. Bergson défend en effet l’idée que la conception dusens commun, qui n’hésite pas à étendre la signification de lasimultanéité locale et intuitive à des événements aussi éloignésqu’on voudra, n’est pas aussi clairement contredite qu’on lepense par la relativisation de la simultanéité aux conditions de lamesure. Il convient de distinguer, à l’en croire, deux simulta-néités : non seulement une simultanéité locale et une simulta-néité globale, qui ne pourrait à la rigueur être perçue que par
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 235
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE236 (P01 ,NOIR)
une conscience surhumaine « coextensive à la totalité deschoses », mais encore une simultanéité relevant du temps mesura-ble, dont il n’est pas étonnant qu’elle n’ait rien d’absolu, et unesimultanéité relevant de la durée réelle, dont chacun peut déjàfaire l’expérience dans son voisinage immédiat en participant àla durée des choses. La relativité de la simultanéité dont parlele physicien apparaît de ce point de vue comme un artefact, unsimple effet de perspective cinématique résultant des conditionsde la mesure ; elle n’invalide en rien la possibilité d’une défini-tion naturelle de la simultanéité, indépendante du découpage ensystèmes de référence1.
Il serait pourtant périlleux de penser que la durée qui sou-tient l’expérience de la simultanéité intuitive doive demeurerconfinée dans les limites d’une conscience subjective. S’il estvrai que l’univers dure, qu’il est lui-même plein de durées diver-sement rythmées et qualitativement différenciées, il reste à articu-ler ces durées dans toute leur extension. Et la simultanéité, si elleest autre chose qu’une désignation raffinée de l’espace, pose jus-tement le problème de leur coexistence, au-delà de la questiontechnique de leur synchronisation par des procédés de mesure.Ainsi les raisons qui motivaient Bergson à approfondir l’enquêteouverte par Matière et Mémoire – et prolongée par L’Évolutioncréatrice – étaient claires : il s’agissait de dégager la portée uni-verselle du concept de durée en situant un peu plus précisémentla durée vécue de la conscience par rapport à deux autresordres : d’un côté, la durée de la matière comme telle, rassem-blée sous la figure d’un « univers », et de l’autre, celle d’un Toutouvert qui apparaît lui-même comme un tressage de durées
1. Pour être « absolue », une telle simultanéité n’a plus rien à voir avec laconception newtonienne d’une simultanéité globale appuyée sur l’hypothèse desactions à distance (transmission de signaux à vitesse infinie). Elle se passe complè-tement du système de référence privilégié, supposé immobile dans l’espace absolu.
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ236
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE237 (P01 ,NOIR)
hétérogènes. Mais de cela, hélas, il n’était pas vraiment ques-tion, ou alors seulement de manière très implicite, dans l’allocu-tion de Bergson à la Société française de philosophie. Il fautreconnaître que Durée et Simultanéité n’a pas beaucoup contri-bué à mettre en lumière les enjeux métaphysiques les plus pro-fonds qui sous-tendent la tâche apparemment modeste que sefixait le philosophe : examiner le concept de temps en usagedans la théorie de la relativité, lever à son sujet quelques équivo-ques.
Le temps et les temps : de l’épistémologie à l’ontologie
Reprenons donc les choses à ce niveau. Que voulons-nousdire en effet lorsque nous parlons du temps physique, par exem-ple ? Quel est le principe de son unité ? N’est-il pas clair, d’ail-leurs, que ce terme est le plus souvent synonyme d’heure oud’époque (le fameux « temps t », tantôt paramètre, tantôt coor-donnée) ? Dans ce cas, la question revient à savoir quel rapportexiste entre les coordonnées de temps intervenant, par exemple,dans les équations de la mécanique, et le temps lui-même, res-saisi dans son unité formelle ou envisagé comme une dimensionconstitutive de l’expérience. Enfin, et c’est peut-être le problèmefondamental, quel rapport entretiennent toutes ces variétés detemps avec la durée réelle, sans laquelle nous n’aurions mêmepas l’expérience d’un temps qui passe ? Avant même d’aborderce point, qui est en effet le plus délicat, il faut noter que Berg-son, tout au long de son étude sur Einstein, ne cesse de distin-guer, en jouant subtilement sur la capitalisation, entre le conceptcommun du temps et les déterminations particulières qu’ilreçoit dans l’usage scientifique, entre le temps ressaisi dansl’unité substantielle de son flux et le temps au sens de la valeurtemporelle, celle que marque l’égalité de deux mesures de
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 237
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE238 (P01 ,NOIR)
temps-coordonnée, ou de deux indications d’horloges. « Le mêmetemps » n’a donc pas de signification univoque ; c’est ce dont lescritiques de Bergson ne se sont pas toujours avisés.
En outre, lorsque Bergson parle de « Temps réel », il nel’identifie pas purement et simplement à la durée pure, ni évi-demment à n’importe quelle variété de temps mesuré ; une lec-ture attentive montre qu’il entend faire surgir, sur le terrainmême du temps mesuré, une différence de nature généralementoccultée par la pratique ordinaire du physicien, entre deuxrégimes d’unification du temps, deux manières de se rapporter autemps comme à un temps. C’est pourquoi Bergson est au fondmoins soucieux de montrer qu’il n’y a qu’un seul temps, qued’établir que le temps est fondamentalement un, du moins tantqu’on l’envisage en durée, non pas en le reconduisant immédia-tement à l’ineffable sentiment de la durée psychologique, maisen se rendant sensible à sa facture, à son mode d’engendrementopératoire. C’est dire que la thèse de l’universalité du temps réelne se confond nullement avec la position d’un temps absolu à lamanière de Newton, ni même d’un temps « vrai » à la manièrede Lorentz, Poincaré ou Guillaume ; elle affirme, plus profondé-ment, son unité. Le temps réel n’est pas un substrat qualitatif quise tiendrait en deçà de toute mesure : alors en effet le physi-cien et le philosophe n’auraient strictement rien à se dire. Letemps réel est le temps effectivement mesuré, Bergson ne cessed’y insister. À condition d’ajouter : effectivement mesuré commeun temps, temps susceptible d’être ressaisi dans son flux par uneconscience qui vit et dure elle-même. Le simple recollement demesures indirectes de temps, ou de valeurs de coordonnéeslocales agglomérées par la vertu d’une formule de transforma-tion, ne saurait en tenir lieu. Encore une fois, le temps réel n’estpas synonyme de durée vécue, bien qu’il ne vive que d’elle : letemps réel est un temps mesuré, ou qui pourrait l’être. En
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ238
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE239 (P01 ,NOIR)
perdant de vue ce point essentiel, on s’interdit de rien compren-dre à la position bergsonienne du problème. Car tout s’enchaîneà partir de là, bien que dans l’ordre d’exposition Bergson nefasse intervenir assez tard (p. 39) ce qui s’avèrera le conceptcentral de son étude.
En somme, il ne faut surtout pas partir du principe qu’il y adeux temps, ou deux concepts du temps : un temps physique etun temps métaphysique, qui seraient pour ainsi dire homonymes.Bergson adopte, dans Durée et Simultanéité comme dans tous sesautres essais, une méthode dont il a souvent exposé le principe :pour comprendre comment deux tendances commencent à diver-ger, il faut les saisir à l’état naissant, en allant les chercher enleur point de recoupement ou d’indifférenciation. On s’intéresseradonc au temps vécu et perçu à l’intersection de la durée réelleet du temps spatialisé, précisément là où le concept de simulta-néité commence lui-même à fourcher en indiquant deux direc-tions : celle de la simultanéité intuitive, immédiatement perçueet vécue, et celle de la simultanéité savante, par réglage d’hor-loges distantes. Ce concept de simultanéité, notons-le, était iden-tifié dès les Données immédiates comme une espèce de conceptmixte ou intersectif : il indiquait précisément une « intersectiondu temps aec l’espace », avant d’apparaître, dans les ouvragessuivants, comme un véritable point d’insertion de la durée dansl’extension. On comprend donc qu’il joue un rôle clé dans ledéveloppement de l’argumentation bergsonienne sur le tempsréel, au point de figurer dans le titre du livre1.
1. Le contraste entre ce titre qui à lui seul semble résumer tout un pan, sinonl’ensemble, de la philosophie bergsonienne, et le sous-titre, sans équivalent dans lereste de l’œuvre par son caractère circonstanciel et circonscrit (« À propos de lathéorie d’Einstein »), n’en est que plus frappant.
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 239
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE240 (P01 ,NOIR)
La durée et les durées : le problème cosmologique
Ainsi il ne faut pas partir de l’opposition entre temps duphysicien et temps du philosophe, comme le suggérait Einsteindans la discussion de 1922, il faut y arriver. Mais à nouveau,pourquoi est-il si important d’établir, malgré Einstein et au nomd’une conception encore plus pure de la relativité – peut-êtretrop pure à force de se vouloir radicale –, l’unité fondamentaledu temps réel ? La réponse à cette question suppose qu’onprenne en compte ce que Bergson a écrit, dans ses précédentsouvrages, de la relation entre la durée consciente et la durée deschoses, mais aussi, à partir de Matière et Mémoire, de la diver-sité des rythmes de durées coexistant au sein du Tout. Le pro-blème principal est au fond de nature cosmologique : il s’agitde savoir comment des durées caractérisées par des degrés detension variables peuvent coexister au sein d’un même univers,sans rompre la trame du devenir qui les emporte toutes. Ce pro-blème finit par se confondre, chez Bergson, avec celui de l’uniténon transcendantale de l’expérience.
À cet égard, l’idée d’une conscience universelle et imperson-nelle, aussi vaste que le Tout, ne nous est d’aucun secours si nousne savons pas comment l’engendrer concrètement ; au mieux ellepermettra de préciser ce que le sens commun – et plus souventqu’il ne croit, le scientifique lui-même – a vaguement en vuelorsqu’il évoque le présent comme un absolu qui résiste à toutesles relativisations de la simultanéité savante. Mais il faut biencompter, et c’est là le point délicat, avec le découpage et la distri-bution des perspectives cinématiques induites par l’usage des sys-tèmes de référence. Sans un tel découpage de surface, sans un tel« morcelage » en systèmes inertiels idéalement isolés, le principe derelativité ne serait bien évidemment d’aucun usage. On a indiquéle risque qu’il comporte : celui d’un morcellement irrémédiable de
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ240
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE241 (P01 ,NOIR)
l’univers en autant de centres de perception fermés sur eux-mêmes,comme des monades. Chaque système aurait alors son « temps pro-pre », distinct en acte de tous les autres.
La défiance de Bergson à l’égard du découpage en systèmesn’est pas nouvelle. Elle tient à ce que les systèmes isolés, selonlui, ne peuvent l’être qu’artificiellement, en se trouvant soustraitsau Tout auquel ils appartiennent, et sans lesquels à la lettre ils nedureraient pas (voir EC, 10-12, 339). Le Tout demeure ouvert,parce qu’il est traversé par des durées vivantes qui portent en soncœur une hésitation, une indétermination, et peut-être une inven-tion qui est le propre de toute durée (EC, p. 341). Mais cetteappartenance commune de toutes les durées au Tout, à ce Tout quidure et que l’on peut toujours nommer « devenir » si l’on aime lesabstractions, cette coexistence qui est coappartenance, rejaillit sur ladurée même des choses, ou de l’univers matériel considéré dans satotalité. De l’univers aussi il faut dire qu’il dure (EC, p. 11). C’estmême là, sans doute, la seule manière de lui redonner une figureconcrète. On peut développer localement l’intuition de sa tenue, desa texture. Mais comment le ressaisir comme un tout, au-delà duvoisinage où nous confine l’expérience vécue des flux environ-nants ? La réponse est dans la doctrine de la matière : celle-ci tendà l’espace comme à une réalisation idéale, et l’espace apparaît enretour comme la condition qui permet de se figurer toute chosede manière simultanée. À la limite, l’image que nous formons del’étendue n’est peut-être que celle d’une « coupe sans cesse renou-velée du devenir universel » (MM, p. 165) : mais cela suffit déjàà la distinguer du temps mathématique et homogène, aussi abstraitqu’universel. La durée du tout de l’univers matériel permet de res-saisir la coexistence des durées sans les dénaturer, sans les figerdans un simple rapport de juxtaposition spatiale. Bergson cherche,en somme, un schème permettant de se figurer l’unité des duréesde l’univers, de les rassembler en gerbe sans les geler dans un
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 241
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE242 (P01 ,NOIR)
temps absolu qui, homogène à l’espace, aurait par là même cesséde durer. Tout se passe alors comme si les durées distribuées dansl’univers étaient scandées de loin en loin par la basse continue queconstitue la durée de l’univers matériel ; comme si ce rapportcontrapuntique, manifesté localement par le phénomène de la per-ception et l’évidence d’une simultanéité vécue entre le flux de laconscience et les flux de la nature, indiquait les voies d’une saisieintuitive de la coexistence et de la communication effective desdurées – celles des vivants et celle de la matière, mais aussi biencelles des vivants entre eux –, communication « sympathique » ausein d’un Tout, qui devient et qui dure, d’un Tout ouvert mais quin’en dure pas moins toujours d’un seul tenant. C’est cette unité,et plus précisément ce mode de figurabilité, ce schématisme du« devenir extensif » (EC, p. 313), qui paraît menacé par la démulti-plication relativiste des durées. C’est elle qu’il faut restaurer, enapprofondissant les conséquences du découpage introduit par lessystèmes de référence, et en clarifiant sur le terrain même de lamesure physique différents usages du temps, sans négliger aucunedes ressources offertes à la pensée par la reconstruction scientifiquede l’expérience. Sur ce point, le projet bergsonien fait écho à celuimené au même moment par Whitehead.
On comprend mieux l’importance que revêt dès lors aux yeuxde Bergson le paradoxe des jumeaux de Langevin, qui prévoit ledéphasage des durées propres de deux individus animés l’un parrapport à l’autre de vitesses relatives. C’est qu’il touche directe-ment au principe même de l’unité des durées, en envisageant lecas particulièrement sensible de la coexistence de deux conscienceshumaines. Les jumeaux en effet ne se contentent pas de transpor-ter des horloges : ils vieillissent ; et aussi éloignés soient-ils l’un del’autre, il vieillissent ensemble. C’est donc finalement toute la cos-mologie bergsonienne qui se joue dans ce paradoxe que Bergson aeu le tort de réduire un peu trop vite à une simple expérience de
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ242
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE243 (P01 ,NOIR)
pensée. Les jumeaux, si par impossible on pouvait les installerdans les conditions décrites par Langevin, ne vivraient pas lemême nombre de jours : disparité métrique prévue par les équa-tions de Lorentz, attestée par le retard des horloges atomiques…Mais s’ensuit-il que le temps se dilate ? Qu’il coule moins vitepour l’un que pour l’autre ? Que son rythme soit substantiellementaltéré ?
Bergson, pour sa part, refuse d’envisager qu’un déphasage dece genre puisse ne pas entraîner de disjonction ou de séparationsubstantielle des durées, et c’est bien là tout le problème.À aucun moment Durée et Simultanéité n’envisage la possibilitéque les flux présentent entre eux une forme d’identité qualita-tive, attestant de l’insistance d’un temps réel unique, tout enexhibant par ailleurs une disparité métrique. Bergson est encoretrop attaché à la perspective globale ouverte sur l’univers parchaque conscience pour embrasser pleinement la conception dutemps local que lui suggère Langevin lorsque, libéral, il assimilele « temps des philosophes » – celui dont Einstein ne voulaitpas – au « temps propre » de la physique, temps mesuré « surplace », le long des lignes d’univers striant l’espace-temps1. Toutse passe comme si, en dépit de ses professions de foi relativistes,il était encore hanté par l’idée d’un éther universel, d’une exten-sion matérielle parcourue en tous sens de frissons et d’ondes depropagation, tissu conjonctif indéchirable assurant l’intercon-nexion globale des phénomènes de l’univers.
L’unité de la durée universelle doit donc être attestée, nonseulement parce que s’y joue le projet même d’une cosmologiecapable de redonner à l’univers une figure en dépit de la plura-lité de durées diversement rythmées, mais parce qu’une telle
1. Cf. les textes cités de Langevin dans ce dossier. Eddington fera à Bergsonune proposition semblable (texte cité).
INTRODUCTION AU DOSSIER CRITIQUE 243
PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-16/9/2009 11H42--L:/TRAVAUX2/PUF/DUREE/TEXTE.857-PAGE244 (P01 ,NOIR)
unité doit fournir la contre-épreuve et la confirmation de l’unitédes durées vécues par des consciences humaines qui marchenttoutes d’un même pas1. L’originalité de la tentative de Bergson,à cet égard, est d’avoir cherché à ressaisir cette unité dans lestermes mêmes du temps physique, en poussant aussi loin quepossible la confrontation avec la théorie relativiste de la mesuredu temps. Tout se passe comme si le temps homogène, nécessai-rement spatialisé pour autant qu’il se laisse mesurer, était finale-ment chargé d’exprimer l’unité sous-jacente de la durée maté-rielle, elle-même garante de l’unité du processus universel.L’univers matériel, en tant qu’il dure pour ainsi dire d’une pièce,est l’expression extensive de l’unité intensive des durées coexis-tantes, variablement contractées. À moins de se condamner à unereconstruction parfaitement artificielle du devenir, la science doiten tenir compte ; elle doit refléter dans son ordre quelque chosede cette durée matérielle à laquelle s’adosse notre existence per-ceptive. Cette exigence a conduit Bergson à porter au cœurmême du temps mesuré la distinction du réel et du fictif, pourredonner à la théorie de la relativité la métaphysique qu’ellemérite. L’aventure n’était pas sans risque, et le philosophe y asans doute perdu un peu de son crédit. Le moment est venu derouvrir son œuvre pour se demander si ce fut vraiment en vain,et si une pensée contemporaine des sciences a quelque chose à ygagner.
Élie During
1. DS, p. 44. Cf. MM, p. 230 : « La durée vécue par notre conscience est unedurée au rythme déterminé, bien différent de ce temps dont parle le physicien etqui peut emmagasiner, dans un intervalle donné, un nombre aussi grand qu’on vou-dra de phénomènes. »
DURÉE ET SIMULTANÉ ITÉ244