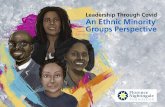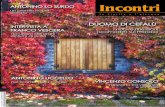Franklin Toker, On Holy Ground. Liturgy, Architecture and Urbanism in the Cathedral and in the...
Transcript of Franklin Toker, On Holy Ground. Liturgy, Architecture and Urbanism in the Cathedral and in the...
b u l l e t i n m o n u m e n t a l
2701
Le château de FontainebleauRecherches récentes
s o c i é t é f r a n ç a i s e d ’ a r c h é o l o g i e s o c i é t é f r a n ç a i s e d ’ a r c h é o l o g i e
bulle
tin
mon
umen
tal•
2012
•To
me
170-
3
1703
Le
chât
eau
deFo
ntai
nebl
eau.
Rec
herc
hes
réce
ntes
b u l l e t i nm o n u m e n t a l
s o c i é t éf r a n ç a i s ed ’ a r c h é o l o g i e
Revue publiée avec le soutien du Centre National du Livre
2701
© Société Française d’ArchéologieSiège social : Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris.
Bureaux : 5, rue Quinault, 75015 Paris, tél. : 01 42 73 08 07, mail : [email protected]
Revue trimestrielle, t. 170-III, septembre 2012ISSN : 0007-4730
CPPAP : 0112 G 86537
Diffusion : Éditions A. & J. Picard, 82, rue Bonaparte, 75006 ParisTél. librairie 01 43 26 96 73 - Fax 01 43 26 42 64
Toute reproduction de cet ouvrage, autre que celles prévues à l’article L. 122-5 duCode de la propriété intellectuelle, est interdite, sans autorisation expresse de la Sociétéfrançaise d’archéologie et du/des auteur(s) des articles et images d’illustration concernés.Toute reproduction illégale porte atteinte aux droits du/des auteurs(s) des articles, àceux des auteurs ou des institutions de conservation des images d’illustration, nontombées dans le domaine public, pour lesquelles des droits spécifiques de reproductionont été négociés, enfin à ceux de l’éditeur-diffuseur des publications de la Sociétéfrançaise d’archéologie.
T A B L E D E S M A T I È R E S
195
235
259
261
262
265
269
270
271
272
274
276
277
281
285
ARTICLES
Fontainebleau de 1541 à 1547. Pour une relecture desComptes des Bâtiments du roi, par Thomas Clouet.......................................
Les « Basiliques et palais du Roi ». Architecture et politique à la cour de Henri IV, par Emmanuel Lurin..............................................
MÉLANGES
Fontainebleau et les guerres. Note à propos d’une publication récente, par Patrick Ponsot.....................................................................
ACTUALITÉ
Mayenne. Laval. Nouvelle datation dendrochronologique de la tour maîtresse du château et de son hourd(Samuel Chollet et Jean-Michel Gousset).......................................................................................................................................
Paris. L’architecture sculptée au Louvre (Yves Pauwels)...............................................................................................................
Vienne. Poitiers. Une maison du XIIe siècle récemment découverte rue Jean Bouchet (Laurent Prysmicki et Pascal Ricarrère).................
CHRONIQUE
Spolia. VIIe-XVIe siècle. L’usage des spolia dans l’architecture de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge (Éliane Vergnolle). — CathédraledeMarseille : identification d’un fragment dumaître autel (Pierre Chastang)...................................................................................
Épigraphie médiévale. L’inscription épigraphique funéraire avant 1250 : une interface entre le monde des vivants et celui des morts(Pierre Chastang)...............................................................................................................................................................
Architecture monastique et universitaire médiévale. Forme, fonction et rôle des bâtiments monastiques médiévaux : pour uneapproche élargie (Pierre Garrigou Grandchamp). — Une nouvelle contribution à la connaissance des léproseries normandes(Pierre Garrigou Grandchamp). —Un nouvel apport à la connaissance de l’architecture universitaire médiévale (Pierre GarrigouGrandchamp)......................................................................................................................................................................
Décors peints entre France et Italie. XVIe siècle. Échanges artistiques entre France et Italie : Albi et Francesco Giovanni Donnela deCarpi (Flaminia Bardati)...........................................................................................................................................................
Mobilier religieux et vitrail. Xe-XIIIe siècle. À propos d’un crucifix offert à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire à la fin du Xe siècle(ÉlianeVergnolle).—L’ensemble de vitraux des Cordeliers de Parthenay : une importante découverte archéologique (Sophie Lagabrielle).
Architecture et société. XVIIIe-XIXe siècle. Les maisons d’enfants : résurgence d’une tradition aristocratique (Hervé Doucet).................
BIBLIOGRAPHIE
Architecture religieuse. Franklin Toker, On Holy Ground. Liturgy, Architecture, and Urbanism in the Cathedral and the Streets ofMedieval Florence (Clario Di Fabio). — Giampietro Casiraghi e Guiseppe Sergi (éd.), Pellegrinaggi e santuari di San Michelenell’Occidente medievale. Pèlerinages et sanctuaires de Saint-Michel dans l’Occident médiéval (Grégory Combalbert). —Isabelle Cartron, Dany Barraud, Patrick Henriet et Anne Michel (éd.), Autour de Saint-Seurin : lieu, mémoire, pouvoir despremiers temps chrétiens à la fin du Moyen Âge (Christian Gensbeitel)........................................................................................
Châteaux et palais. Jean Mesqui, Les seigneurs d’Ivry, Bréval et Anet aux XIe et XIIe siècles. Châteaux et familles à la frontièrenormande (Nicolas Faucherre). — Alain Salamagne, éd., Le palais et son décor au temps de Jean de Berry (Béatrice de Chancel-Bardelot). — Emmanuel Lurin (dir.), Le Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye (Liliane Châtelet-Lange).........................
RÉSUMÉS ANALYTIQUES..........................................................................................................................................................................
Architecture religieuse
Franklin Toker, On Holy Ground.Liturgy, Architecture, and Urbanism in theCathedral and the Streets of MedievalFlorence, London/Turnhout, Harvey MillerPublishers, 2009, 28 cm, 324 p., 52 fig. etill. en n. et bl., plans, cartes, index. - ISBN :978-1-905375-51-6, 110 €.
(The Florence Duomo Project, volume I)
Des quatre volumes qui doivent composerThe Florence Duomo Project – un projet édito-rial important et ambitieux consacré à SantaReparata, l’ancienne cathédrale de Florenceaujourd’hui disparue – le premier vient deparaître ; il est destiné à devenir la référence surle sujet. Les ouvrages portant sur des édificesde cette envergure sont souvent le fruit d’untravail d’équipe, chaque chercheur étant le spé-cialiste d’un aspect de l’histoire du monument,d’un problème, d’une œuvre particulière. Ici,en revanche, il n’y a qu’un auteur, le canadienF. Toker, professeur d’histoire urbaine et d’his-toire médiévale et d’architecture américaine àl’Université de Pittsburg. Seul, mais pleine-ment qualifié pour traiter de l’édifice, puisqu’illui a non seulement consacré plusieurs articles(dont l’un d’eux, publié en 1980 dans l’ArtBulletin lui a valu le Prix Porter de la CollegeArts Association) mais qu’il en a aussi dirigé lesfouilles archéologiques entre 1965 et 1980.
Le premier et le second volume (dont laparution est imminente) ont un même objectifscientifique : présenter de manière raisonnéeles données collectées intéressant l’urbanismeet la liturgie pour le premier et l’archéologiepour le deuxième. Les volumes III et IVreconstitueront quant à eux l’histoire architec-turale de ce site urbain privilégié, occupédepuis l’époque paléochrétienne par le groupeépiscopal, ainsi que son contexte historique,social et politique. « Distinguer les faits desinterprétations » : ainsi pourrait-on – demanière journalistique – résumer la logiqued’un projet éditorial qui affiche la ferme inten-tion de ne pas tomber dans les travers de l’idéo-logie, d’une reconstruction historique (ouhistorico-architecturale) doctrinale.
Si le style est accessible, la méthode est heu-ristique : en effet, On Holy Ground. Liturgy,Architecture, and Urbanism in the Cathedral andthe Streets of Medieval Florence se propose de fairele point sur tout ce qu’un homme du XXIe sièclepourrait savoir de l’ancienne cathédrale deFlorence si on n’y avait jamais fait de fouillesarchéologiques. Pour cette raison, le premierchapitre cherche à restituer l’image de l’églisedétruite à partir des écrits du XIe au XXe siècle (dechroniqueurs, d’historiens, d’archivistes, d’éru-dits et de chercheurs) ainsi que de quelquessources graphiques, peintures ou dessins, du XIVe
au XVIIIe siècle. Et d’abord la célèbre fresque dela Loggia del Bigallo, où l’on voit, dans un pano-rama de la ville – la plus ancienne (1342) repré-sentation connue de Florence – le baptistère etSanta Reparata, qui était encore en service, avecsa façade gothique dont la construction était déjàinterrompue. Le souvenir de la façade romane,détruite pour faire place au projet novateurd’Arnolfo di Cambio, synthèse d’architecture etde sculpture théâtralisée, subsistera toutefoisencore longtemps comme en témoigne unefresque des années 1380, qui se trouvait autrefoisdans le premier cloître de Santa Croce. L’analysede cette peinture, pourtant endommagée, per-met à l’auteur (contraint ici, malgré ses prin-cipes, de recourir aux résultats des fouilles) dedémontrer la solide crédibilité d’un dessin et deplusieurs illustrations de travaux d’érudition duXVIIIe siècle évoquant l’ancienne construction.Parmi eux, l’œuvre de Richa est particulièrementintéressante car, malgré sa facture naïve, elleévoque avec précision une façade dont le pignonétait encadré de bas-côtés couverts de toituresplates fort inhabituelles et qui comportait danssa partie basse un portique à sept arcades repo-sant sur des colonnes, revêtu de marqueterie demarbres bicolores et couronné par une cornichehorizontale soutenue par de puissantes consoles.À l’est, se trouvait le clocher, qui réutilisait pro-bablement l’une des tours de l’enceinte urbainedétruite après 1172. Certes, il existe des diffé-rences entre ces images – qui n’étaient pasfondées sur une connaissance visuelle directe,mais sur des témoignages figurés plus anciens(comme la fresque de Santa Croce citée plushaut), mais les similitudes l’emportent. Ainsitoutes font état de deux grandes figures de partet d’autre du portail principal ; deux autres, pluspetites, sont apparemment abritées dans lespinacles du niveau supérieur, à bonne distancede la grande baie géminée centrale. Ces dernières
étaient certainement des statues, alors que l’au-teur se demande à juste titre s’il ne pouvait pass’agir de peintures dans le cas des premières. Sic’était des statues – comme la présence deplinthes pourrait le laisser à penser – une tellesolution aurait été exceptionnelle. Aussi grandesque le portail, elles représentaient un saintimberbe et un évêque (Saint Zanobi ?). Il peutparaître vain de s’interroger sur l’auteur de cesgéants à partir de représentations approxima-tives, mais même une hypothèse peut ajouterquelques tesselles à la mosaïque complexe del’histoire de la sculpture florentine au tournantdu XIIIe siècle. En effet, ces figures peuvent avoirété les ancêtres directs de ces « statues feintes »,travaillées en trois dimensions sur trois côtésmais plates à l’arrière pour adhérer à la paroi, quel’on trouve à Santa Maria del Fiore – issues del’atelier d’Arnolfo – et à Santa Maria Novella –une seule statue (aujourd’hui au Museo nazio-nale del Bargello), due à un sculpteur proche deMarco Romano.
Des figures de ce type ont certainementappartenu à l’imaginaire de Dante Alighieri. Ledeuxième chapitre du livre, intitulé justementWhat Dante Saw, est consacré à l’étude du rituelde la cathédrale. Même dans le ton de l’exposé,le discours se fait ici plus complexe et plus for-mel, à la recherche des rapports entre d’une partla liturgie, les fonctions rituelles et dévotion-nelles, l’usage social et d’autre part la forme del’édifice roman. L’analyse repose sur deux docu-ments (opportunément transcrits dans le dernierchapitre) : le Ritus in ecclesia servandi, datable desannées 1180-90, et les Mores et consuetudinescanonice florentine, rédigés vers 1230. Ces textestémoignent de l’attention que le clergé de lacathédrale florentine a porté à l’élaborationd’une liturgie et d’un cérémoniel bien plus com-plexes que la moyenne de ceux des autresdiocèses italiens au Moyen Âge.
L’auteur suit pas à pas le déroulement descérémonies et notamment celles à caractère pro-cessionnel qui correspondaient aux grandes fêtesde l’année liturgique et aux fêtes des saints – etsurtout celle de saint Jean-Baptiste, patron de l’é-glise. Ce rituel était étroitement lié à la titulatureet à l’emplacement des principaux autels (ceuxdes deux niveaux du chœur étaient consacrés àdeux saints locaux, Reparata et l’évêque Zanobi,les autels des quatre absidioles ouvrant sur lesbras du transept aux évangélistes, les deux autels
BIBLIOGRAPHIE
Bib
liogr
aphi
e
277277
Bib
liogr
aphi
e
278
placés contre les murs nord et sud du chœur àdes saints romains, le pape Sylvestre et le diacreÉtienne, enfin, les deux autels situés au revers dela façade étaient dédiés à Marie et à saintThomas Becket), mais aussi à la présence desreliques, participant, lors de fêtes majeures, au« powerful psychological environment ». L’auteursouligne cette volonté d’agir sur les émotions duspectateur y compris, comme divers travaux l’ontmontré, à l’aide d’images peintes et sculptéesrévélées de manière spectaculaire par un savantéclairage lors des cérémonies nocturnes.
Une contribution fort intéressante de l’ou-vrage est la restitution du système des autels etdu mobilier liturgique, toujours étayée par unesavante documentation historique, archivistiqueet liturgique, complétée par une sorte de cata-logue analytique, présenté de manière lisible, despeintures sur panneaux qui complétaient l’imagede l’édifice par la vivacité de leurs couleurs et lasplendeur de l’or, à commencer par l’anciendevant d’autel de San Zanobi (vers 1230, Museodell’opera di Santa Maria del Fiore) qui étaitquasiment la transposition dans un autremedium d’un antependium en métal précieuxémaillé : on y voit au centre l’évêque trônant enposition frontale, entouré de deux diacres et dedeux paires de saynètes qui donnaient à voir auxfidèles ses actions de manière concrète. On nesait pas quelle image était placée sur l’autelmajeur du choeur supérieur à l’époque de l’ante-pendium peint, mais autour de 1310 l’atelier deGiotto réalisa pour cet emplacement prestigieuxun polyptique à cinq compartiments (conservé àSanta Maria del Fiore), remplacé seulementtrente-cinq ans plus tard par un polyptique plusimposant et articulé (Florence, Offices), peintpar l’un de ses élèves, Bernardo Daddi qui, grâceà cette commande prestigieuse, atteignit le som-met de sa carrière. Ce polyptique passa ensuite àl’église de Santa Maria Maggiore ; le même sortfut réservé à un haut relief qui pourrait être rat-taché à ce propos au groupe de marbre sculptépar Arnolfo, aujourd’hui conservé au Victoriaand Albert Museum, qui fut copié avant 1330par un sculpteur inconnu (et non par Giroldo daComo, comme on l’a parfois prétendu) ; cetteœuvre identique par la composition et primitive-ment placée sur un des murs à l’extérieur deSanta Reparata avant d’être installée à SantaMaria del Fiore, près du campanile, est men-tionnée en 1355 dans un registre de la confrériedes laudesi. La fidélité de la copie au modèlearnolfien incite à penser que celui-ci devait aussise trouver à l’origine à Santa Reparata (commel’a supposé Enrica Neri Lusanna), peut-être entant que retable dans une de ces chapelles privéesauxquelles le livre consacre un paragraphe spé-cial. Il s’agirait alors du dernier hommage rendupar Arnolfo à l’ancienne cathédrale avant d’en-treprendre les travaux de la nouvelle. Ce faitpourrait accréditer l’hypothèse selon laquellel’atelier d’Arnolfo aurait pu aussi livrer les figures
de la façade de Santa Reparata. Le chapitre quiaborde ces questions s’intitule – rappelons-le –What Dante Saw. L’Annonciation d’Arnolfo futcertainement l’une des sources directes de la cul-ture visuelle du poète, un exemple de ce visibileparlare qui était l’un des buts artistiques du prin-cipal courant de la sculpture italienne entre 1260et 1315, un Kunstwollen que Dante connaissaitbien et qu’il transposa per verba avec une préci-sion extraordinaire dans le chant X duPurgatoire.
Dans le troisième chapitre, la recherche del’auteur porte sur la dimension « urbaine » et« urbanistique » de la cathédrale, sujet déjàabordé à la fin du deuxième chapitre, dans unparagraphe traitant de son usage, certes nonexclusif, comme siège de l’assemblée commu-nale. C’est l’analyse de l’institution canonialesous tous ses aspects qui permet à F. Toker depréciser son interaction avec la topographieurbaine et le proche environnement architecturalde la cathédrale dont le baptistère - encoreaujourd’hui communément désigné suivant l’ex-pression de Dante : le bel san Giovanni - était lepoint fort. Les chapitres IV et V s’intéressentaussi à l’expansion de la cathédrale et de ses cha-noines dans la ville à travers le rituel (les proces-sions solennelles) et à ses rapports avec la cam-pagne environnante, ce contado sans lequel leschanoines (et la cathédrale elle-même) ne pou-vaient subsister, puisqu’il les nourrissait et lesenrichissait par l’exploitation des terres agricoles.D’ailleurs, comme l’écrivait perfidementFrançois Guichardin, « se remplir le ventre est l’unde leurs soucis majeurs ».
Clario Di FabioUniversità degli Studi di GenovaTraduction de Michele Tomasi et
Éliane Vergnolle
Giampietro CaSIraGHI e Guiseppe SerGI(éd.), Pellegrinaggi e santuari di SanMichele nell ’Occ idente medievale .Pèlerinages et sanctuaires de Saint-Micheldans l’Occident médiéval. atti del SecondoConvegno Internazionale dedicatoall’arcangelo Michele. atti del XVIConvegno Sacrense (Sacra di San Michele,26-29 settembre 2007) …, Bari, edipuglia,2009, 23,5 cm, 607 p., fig. et ill. en n. et bl.et en coul., cartes. - ISBN : 978-88-7228-561-9, 50 €.
(Bibliotheca Michaelica, 5)
Pellegrinaggi e santuari constituent le recueildes actes d’un colloque tenu à la Sacra di SanMichele, en Piémont, en septembre 2007. Cecolloque s’est inscrit dans un cycle de trois ren-contres internationales consacrées à l’archangeMichel et à son culte, après le colloque organisé
à Bari et au Mont-Gargan en 2006, à propos duculte et des sanctuaires de Saint-Michel auMoyen Âge, et avant celui tenu à Cerisy-la-Salleen 2008, autour des représentations du mont etde l’archange dans la littérature et les arts. Cestrois colloques occupent une place importantedans le renouvellement, depuis une quinzained’années, des études consacrées au culte de Saint-Michel dans l’Europe médiévale et moderne. Cerenouvellement s’est caractérisé par une collabo-ration renforcée entre les chercheurs français etitaliens donnant lieu, en particulier, à la tenuerégulière de rencontres scientifiques internatio-nales et à une ambitieuse entreprise de recensionet d’édition des sources, dans des projets faisantparfois appel aux nouvelles technologies. L’un deces projets, porté par G. Casiraghi et C. Tosco,ayant pour objectif de répertorier, sous formenumérique, l’ensemble des documents écrits oufigurés relatifs à l’histoire de la Sacra di SanMichele entre 1400 et nos jours, fait d’ailleursl’objet d’une brève présentation dans les actes ducolloque de 2007.
L’ouvrage témoigne de la fécondité de cesrencontres entre chercheurs français et italiens. Ilregroupe 23 contributions – dont 12 en italien et11 en français, après la stimulante introductionde G. Casiraghi et avant la conclusion d’AndréVauchez, qui dépasse de beaucoup le simplerésumé des idées les plus fortes et attire l’atten-tion sur les éléments qui restent à éclaircir dansl’histoire du culte et des pèlerinages à saintMichel. Les contributions sont regroupées encinq parties thématiques cohérentes : 1. Le pèle-rinage dans ses expressions liturgiques et dévo-tionnelles ; 2. La relation écrite du pèlerinage ; 3.Les aspects sociaux et politiques du pèlerinage ;4. Les aires de routes et les chemins de pèleri-nage ; 5. Les images du pèlerin. Chaque parties’ouvre sur une présentation de synthèse, sorte de« leçon inaugurale » sur le thème choisi. Cettearmature constitue l’un des points forts de l’ou-vrage. Plusieurs de ces présentations permettenten effet de replacer les articles de chaque section,et donc les études et les sources relatives au cultede saint Michel, dans l’histoire générale du chris-tianisme, des mentalités et des sociétés duMoyen Âge, en dépassant le strict cadre des« études michaéliques ». On y trouve entreautres, appuyés sur les acquis de la bibliographiela plus récente, des rappels sur les pratiques dedévotion médiévales, les fonctions des reliques(L. Gaffuri), ou les concepts qui permettent depenser et d’analyser le problème spatial et socialque constitue la question des réseaux viaires,des trajets et des déplacements au Moyen Âge(C. Perol).
À travers ce recueil, au-delà des principauxsanctuaires dédiés à l’archange, c’est finalementune Europe tournée vers saint Michel qui estmise en lumière, par l’étude des populations quiconvergent vers ces sanctuaires. L’examen de l’as-pect et des attributs des pèlerins, à partir de
Bib
liogr
aphi
e
278
Bib
liogr
aphi
e
279
Bib
liogr
aphi
e
279
documents textuels et iconographiques (avec denombreuses illustrations à l’appui), conduit fina-lement à poser la question de ce qu’est un pèle-rin au Moyen Âge – la réponse s’affinant au fildu temps –, de la manière dont il est ou doit êtreconsidéré, et à porter attention à ceux qui separent abusivement des attributs du pèlerin. Lesmotivations de ceux qui partent sont égalementexaminées. Les médiévaux vont rarement cher-cher la guérison dans les sanctuaires de Saint-Michel mais plutôt une protection contre le malsous toutes ses formes. Quant au phénomènebien attesté des pèlerinages de jeunes enfants,partant souvent subitement sans l’accord de leurfamille pour se diriger vers le Mont-Saint-Micheldans les deux derniers siècles du Moyen Âge, ilreste encore difficile à expliquer avec certitude.La question des chemins de pèlerinages fait l’ob-jet d’un traitement détaillé à plusieurs échelles,de l’étude très localisée des chemins du Garganopermettant d’accéder à la grotte de l’archange(G. Bertelli), à la tentative de reconstitution deschemins très nombreux qui, à travers laNormandie mais aussi depuis l’Allemagne ou lesud de la France, mènent jusqu’au Mont-Saint-Michel. La plupart des auteurs soulignent com-bien les chemins des pèlerins médiévaux ne peu-vent être assimilés aux chemins bien balisésdestinés aux pèlerins d’aujourd’hui, qui sont pré-sentés comme des routes immuables. Il s’agit, auMoyen Âge, d’espaces mouvants et multiples,des aires de routes caractérisées par des « lieux deroutes » et la présence de nombreux sanctuaireslocaux qui sont eux-mêmes des destinations depèlerinages. Les pratiques dévotionnelles despèlerins lorsqu’ils atteignent le sanctuaire sontlonguement examinées (S. Boesch, P. Bouet,A.-M.Tripputi). Quelles que soient les modalitésde l’accueil ou de l’hébergement, les pèlerinsapprochent des principaux autels du sanctuaire,ils cherchent souvent à repartir avec une pierredu Mont, mais ne peuvent, sous aucun prétexte,passer la nuit dans le sanctuaire, sous peine demourir ou d’être frappés d’infirmité.
Plusieurs auteurs proposent un réexamenserré et convaincant du vocabulaire du pèlerin etdu pèlerinage. Le vocabulaire de la route, du che-min, est ainsi interrogé, de même que l’usage dumot peregrinatio (C. Vincent), et il ressort de l’ar-ticle de H. Jacomet qu’il vaudrait mieux préférer« sac » à « besace » pour désigner l’un des attri-buts fondamentaux du pèlerin. Les deux pre-mières sections de l’ouvrage prennent largementappui sur les récentes éditions des sources latineset françaises du Mont-Saint-Michel [Chroniqueslatines du Mont Saint-Michel (IXe-XIIe siècle). Lesmanuscrits du Mont Saint-Michel.Textes fonda-teurs, I, éd. P. Bouet, O. Desbordes, Caen-Avranches, 2009 et Guillaume de Saint-Pair, LeRoman du Mont Saint-Michel (XIIe siècle). Lesmanuscrits du Mont Saint-Michel.Textes fonda-teurs, II, éd. C. Bougy, Caen-Avranches, 2009]ce qui permet de porter un regard nouveau sur
les pèlerinages au sanctuaire normand et sur lesmiracles attribués à saint Michel, tout en citantde larges extraits des sources produites au seinmême du sanctuaire.
On l’aura compris, les trois principaux sanc-tuaires occidentaux dédiés à saint Michel occu-pent naturellement une place prépondérantedans le recueil. Saint-Michel di MonteSant’Angelo dans le Gargano (Pouilles), le pre-mier des sanctuaires, et, plus encore, le Mont-Saint-Michel au péril de la mer, riche de sourcestextuelles beaucoup plus nombreuses, sont lesprincipales destinations des pèlerinages évoquésdans l’ouvrage. Cependant, le troisième grandsanctuaire de Saint-Michel, la Sacra di SanMichele (ou Saint-Michel-de-la-Cluse, fondé auXe siècle dans le Val de Suse, non loin de Turin)tient une place particulière, dans la mesure oùl’historiographie qui y a été élaborée précise soi-gneusement qu’il est situé à égale distance duMont-Gargan et du Mont-Saint-Michel et enfait une étape importante sur la route reliant cesdeux sanctuaires. Fondé par un noble auvergnatde retour de pèlerinage, il constitue en effet unpoint de passage important pour les pèlerins àdestination de Rome et, secondairement, duMont-Gargan. C’est pourquoi les sources litté-raires du Val de Suse sont spécifiquement inter-rogées (G. Sergi). Les autres sanctuaires de Saint-Michel en Europe – parmi lesquels Saint-Mihielen Lorraine ou le Puy-en-Velay – ne sont pasabsents mais ils occupent une place plus discrète.
Il faut noter que les sanctuaires dédiés à l’ar-change ne sont pas seulement envisagés commedestinations ou étapes d’un pèlerinage. Certainescontributions dépassent en effet assez largementla stricte thématique du pèlerinage à proprementparler pour ajouter à la compréhension des liensculturels et des circulations d’hommes, dereliques, de traditions culturelles, entre les sanc-tuaires dédiés à Saint-Michel ou entre les régionsdans lesquelles se situent ces sanctuaires. Jean-Marie Martin se demande par exemple s’il aexisté un axe entre le sanctuaire du Mont-Gargan et le Mont-Saint-Michel, et montrecombien, après une volonté initiale manifestéeau Mont-Saint-Michel de s’inscrire dans uneforme d’imitation du sanctuaire du Mont-Gargan, les deux établissements connurent desdestinées nettement divergentes sans que desliens durables et réciproques existent entre euxaprès le VIIIe siècle. Les liens entre Saint-Michelde Cuxa et l’Italie font également l’objet d’uneanalyse importante (M. Zimmermann). Cettethématique connexe à celle des pèlerinages per-met de nourrir des questionnements renouvelésparmi les plus dynamiques de ceux qui sontabordés dans l’ouvrage, et complète les travauxdu colloque de 2006. De tels compléments aupremier colloque du cycle concernent égalementle culte de saint Michel en lui-même, parexemple à travers la représentation de l’archange,victorieux du démon, psychopompe et chargé de
la pesée des âmes, dans les églises des valléesdes Alpes occidentales à la fin du Moyen Âge(D. Rigaux).
Si l’ouvrage, dense, riche de belles contribu-tions qui abordent des thématiques élargies au-delà du thème du pèlerinage, est relativementlong, c’est aussi parce qu’il propose, bien plusque son titre ne le laisse entendre, une ouvertureimportante sur l’époque moderne et mêmel’époque contemporaine. Cette ouverture estparfois guidée par les projets de recherche encours, parfois rendue nécessaire par la physiono-mie des sources. Ainsi, l’étude de la liturgie dupèlerinage au Mont-Saint-Michel (V. Gazeau)intègre un grand nombre d’éléments de l’épo-que moderne, et celle des aspects dévotionnelset votifs du pèlerinage au Mont-Gargan (A.-M.Tripputi) porte essentiellement sur les sièclespostérieurs au Moyen Âge, y compris les pèleri-nages qui existaient il y a peu ou qui continuentd’exister autour du sanctuaire en Italie du Sud(par exemple à San Marco in Lamis).
Tout au plus peut-on regretter que certainescontributions, en dépit d’une longueur consé-quente, ne soient pas dotées de véritables conclu-sions reprenant les points les plus forts du rai-sonnement, et qu’il existe au sein de l’ouvrage uncertain nombre de redites. Ces répétitions sem-blaient toutefois difficiles à éviter compte tenude la grande précision du thème abordé et dufaible nombre de sources disponibles pour traitercertains des aspects du sujet. Comme les actesdes deux autres colloques tenus autour de l’ar-change entre 2006 et 2008, cet ouvrage estappelé à occuper une place importante, non seu-lement dans l’historiographie michaélique maisaussi, plus largement, au sein des études récentesconsacrées aux pratiques dévotionnelles liées auculte des saints dans l’Europe médiévale.
Grégory CombalbertUniversité de Caen Basse-Normandie
Centre Michel de Boüard – CRAHAM(UMR CNRS/UBCN 6273)
Isabelle CarTroN, Dany BarrauD,Patrick HeNrIeT et anne MICHeL (éd.),Autour de Saint-Seurin : lieu, mémoire,pouvoir des premiers temps chrétiens à lafin du Moyen Âge. actes du colloque deBordeaux (12-14 octobre 2006), Bordeaux,ausonius éditions, 2009, 28 cm, 351 p., fig.en n. et bl. et en coul., cartes, plans, sché-mas. - ISBN : 978-2-35613-012-2-9, 70 €.
(collection Mémoires, 21)
À l’heure où l’église Saint-Seurin deBordeaux, haut-lieu de l’histoire chrétienne dela métropole aquitaine, fait l’objet de nouveauxprojets de mise en valeur, il est utile de rappe-ler l’importance de ce colloque qui s’est tenu à
Bib
liogr
aphi
e
280
Bordeaux en 2006 et qui a rassemblé autourde ce monument historiens, archéologues ethistoriens de l’art.
À l’initiative de plusieurs membres del’institut Ausonius, qui publie ces actes, et duService régional d’archéologie, fut en effet ima-giné alors de dresser un bilan historiogra-phique et archéologique de ce site bordelaisdont la notoriété, enrichie par les découvertesqui y furent faites lors des dernières décenniesdu XXe siècle, appelait une réactualisation desquestionnements scientifiques qu’il peut susci-ter. Une fois de plus, l’approche croisée dedifférentes disciplines du champ des étudeshistoriques – de l’archéologie aux études hagio-graphiques, de l’histoire de l’art à l’anthropolo-gie – se révèle particulièrement fructueuse.
Saint-Seurin, dont la légende hagiogra-phique et le mythe entretenu par ses chanoinesjusqu’au XIXe siècle renvoient aux origines de lachristianisation de la cité des Bituriges, consti-tue aujourd’hui encore le principal pôle del’identité chrétienne de Bordeaux avec la cathé-drale Saint-André. Longtemps, la commu-nauté de Saint-Seurin revendiqua la primautésur le chapitre épiscopal, entretenant l’idée quele sanctuaire situé hors-les-murs aurait été lapremière cathédrale. La confirmation par l’ar-chéologie de la présence d’une importantenécropole des IVe-VIe siècles fouillée au moinspartiellement sur le flanc sud de l’église, est àl’origine de cette réouverture d’un dossier his-torique des plus passionnants. Cette réactuali-sation se révèle d’autant plus précieuse qu’elleremet en lumière un édifice complexe, parfoisun peu mal aimé en raison de son manqued’unité stylistique et qui n’avait pas fait l’objetd’une véritable synthèse depuis plus d’unsiècle.
L’ouvrage issu de ce colloque s’ouvre surun avant-propos des quatre initiateurs et unemise au point de Patrick Henriet, définissantl’ambition de ce travail collectif comme la res-titution du caractère organique d’un corpuscomplexe qui forme un « monument » au sensancien, une construction, à la fois intellectuelleet matérielle, sans cesse renouvelée et réactua-lisée, ce qui oblige les différentes disciplines às’associer pour tenter d’identifier ces strates quiconstituent le « lieu de mémoire » qu’est l’égliseSaint-Seurin et son histoire. La suite sedécoupe selon quelques grandes thématiques,qui vont du contexte archéologique des ori-gines du site à l’analyse des constructions de lafin du Moyen Âge en passant par le dossierhagiographique et le rôle des reliques, l’interro-gation des textes et des images dans laconstruction identitaire, l’analyse du monu-ment en tant que lieu de mémoire du saintfondateur et l’évocation des enjeux de pouvoirdans lesquels les chanoines étaient impliquésau Moyen Âge. Ces thèmes forment autant de
grands chapitres précédés à chaque fois d’unebrève introduction confiée à des spécialistes deces différents domaines – Brigitte Boissavit-Camus et Jean Guyon pour l’aspect archéolo-gique, Michel Lauwers pour l’hagiographie etles reliques, Cécile Treffort pour les textes etimages, Christian Sapin pour le monumentlieu de mémoire, Françoise Lainé pour lesenjeux de pouvoir et Philippe Araguas pour laconstruction à la fin du Moyen Âge.
Les premières contributions éclairent plusparticulièrement la place qu’occupe le com-plexe religieux de Saint-Seurin dans la topogra-phie chrétienne de Bordeaux. Dany Barraudrappelle, avec l’appui de Wandel Migeon, com-bien la connaissance de cette période s’est enri-chie de nombreuses découvertes au cours desdernières années. En particulier, le mythe de lapremière cathédrale, entretenu au XIXe siècle àtravers le réaménagement « historiciste » de lacrypte par le chanoine Cirot de la Ville, per-sonnalité singulière à laquelle Isabelle Cartronconsacre un article très documenté, n’est plusd’actualité depuis l’observation, lors des tra-vaux d’aménagement du tramway, de la pré-sence d’une basilique de l’Antiquité tardive àcôté de la cathédrale Saint-André. En outre, lesrecherches archéologiques plus ou moins spo-radiques, qui ont conduit à l’aménagementd’une crypte archéologique au sud de l’égliseSaint-Seurin dans les années 1990, ont permisd’établir l’origine probable du site dans unenécropole de l’Antiquité tardive regroupantdivers types de sépultures, dont plusieurs mau-solées, auxquels on est tenté d’associer la cryptede l’église. Jean-François Pichonneau etNatacha Sauvaître se joignent à DannyBarraud et Isabelle Cartron pour présenter lesrésultats des recherches les plus récentes surcette nécropole.
Les questionnements suscités par lesdonnées archéologiques trouvent un nouveléclairage à travers l’analyse du dossier hagio-graphique proposé par Christophe Baillet,Patrick Henriet et Stéphanie Junique à la suited’un rappel fort utile de Brigitte Beaujard surle culte des évêques en Gaule. La mise en pers-pective des différentes strates de l’histoire dusaint, ou plutôt du groupe de saints – saintAmand et saint Fort s’associant à saint Seurin –qui fait l’objet d’un culte dans le sanctuairebordelais, s’est construit progressivement aucours des siècles. La confusion assumée trèsrapidement entre saint Seurin de Bordeaux etsaint Seurin de Cologne depuis les premièresmentions pourtant bien distinctes faites parGrégoire de Tours, puis les différentes adjonc-tions au corpus de textes originels y sontexposées à travers l’analyse renouvelée detoutes les sources hagiographiques disponibles.Pour compléter ce chapitre, trois articles assezbrefs de Patrick Henriet, Marie-Noël Coletteet Geneviève François évoquent l’énigmatique
manuscrit appelé « Eucologue » par Cirot de laVille, et connu indirectement par les histo-riens, puisqu’il se trouve désormais dans unecollection privée.
La construction mémorielle peut égale-ment être appréhendée à travers les inscrip-tions et les images qui ponctuent le cadremonumental. Deux contributions, l’une signéede Vincent Debiais et Cécile Voyer et l’autred’Anne Bernadet, abordent cette question àtravers deux objets singuliers. Le premier, quiintrigue les historiens depuis le XIXe siècle, estle fameux chapiteau de la « mort de saintSeurin », situé sur la face occidentale de l’an-cien porche roman, où il était a priori destinéà « accueillir » les fidèles. La question de sadatation demeure ouverte, après l’analyse trèsprécise de ses aspects épigraphiques, iconogra-phiques et hagiographiques. Est-il du XIe sièclecomme pourraient le faire croire certainsaspects de la graphie du texte et la représenta-tion assez grossière du corps ou d’un XIIe siècletrès avancé, voire plus récent encore ?Correspond-il, comme le suggèrent les auteurs,à une représentation du tombeau du saint telqu’il a pu être aménagé dans l’église durant laseconde moitié du XIIe siècle, mais « vieilli »artificiellement pour créer un effet d’ancien-neté ? Toujours est-il que la mémoire du saintévêque y est exaltée et que ce chapiteau rare estun véritable petit « monument » mémoriel.Plus énigmatique encore par son caractèrefragmentaire, l’unique panneau de vitrail duXVIe siècle provenant de l’église Saint-Seurin etreprésentant un évêque dévoile ses origines etses aléas historiques grâce à l’analyse d’AnneBernadet, mais sans révéler l’identité du per-sonnage représenté.
Trois approches très denses abordent lemonument dans sa dimension architecturale,tout en insistant toujours sur l’idée deconstruction mémorielle, qui traverse touteson histoire. En premier lieu, Philippe Araguaspose le cadre à travers un bilan historiogra-phique et un rappel précieux de l’évolution dela collégiale depuis l’époque romane. Celle-cise présente aujourd’hui comme un édificehétérogène propre à dérouter les historiens del’art malgré la présence de quelques élémentsdu plus haut intérêt, dont la fameuse tour-porche occidentale avec ses chapiteaux romans.Anne Michel développe une analyse fine de lacrypte, dont l’intérêt est rehaussé par la pré-sence d’une série de très beaux sarcophages del’Antiquité tardive. Elle souligne dans ce pre-mier bilan archéologique la complexité de lalecture de cet espace, qui semble avoir connuplusieurs phases importantes de remaniementsdepuis le haut Moyen Âge, et l’usage funérairedu mausolée primitif à l’espace cultuel dédiéau saint, dont celle du XVIIe siècle, en particu-lier, demeure assez obscures. Cet article sou-ligne fort justement la nécessité d’une étude
Bib
liogr
aphi
e
280
d’archéologie du bâti pour aller plus loin dansla compréhension des phases chronologiquesde la crypte et de sa relation avec l’église.Enfin, le troisième article reprend un peu dedistance avec le contexte bordelais pour l’éclai-rer par l’analyse d’une autre église de cha-noines, qui est celle de Saint-Junien, enLimousin. Éric Sparhubert montre combienl’entreprise monumentale de la fin du XIe siècleest motivée par un constant souci de respect etde mise en scène du passé du sanctuaire, enintégrant notamment l’oratoire primitif dansl’organisation du chœur liturgique, selon unesubtile utilisation de la célébration mémoriellecomme ciment d’une identité, ce qui n’est passans rappeler les phénomènes perceptibles àBordeaux.
L’ouvrage se poursuit par trois contribu-tions ayant trait aux relations de pouvoirsentretenues par la communauté avec le mondelaïc et le haut clergé. Frédéric Boutoulle abordeun curieux document, rédigé au XIIe siècle parle sacriste Rufat, suggérant un cérémonial d’in-vestiture au comté de Bordeaux sur l’autel deSaint-Seurin. Ce rituel, qui aurait été instaurépar saint Amand, protocole qui ne sembleavoir réellement intéressé que les souverainsanglais au XIVe siècle. Sandrine Lavaud, fidèle àla voie ouverte par Charles Higounet, dessinede son côté l’emprise territoriale de l’impor-tante seigneurie temporelle des chanoines deSaint-Seurin en Bordelais à la fin du MoyenÂge. Puis, à partir de quelques éléments mobi-liers exhumés lors des fouilles du XIXe siècle,Delphine Boyer-Gardner et Isabelle Cartronapportent un regard neuf sur les objets issusd’un dépôt funéraire et évoquent la sépulturede Raymond Fabri, un chanoine pas commeles autres, qui fut le chapelain du papeClément V au début du XIVe siècle.
Enfin, dans le dernier chapitre thématique,deux articles sont consacrés aux aménagementsgothiques qui ont modifié le monument duXIIIe au XVe siècle. Markus Schlicht livre uneanalyse très détaillée de l’architecture flam-boyante de la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose, construite au nord du chevet entre 1427et 1444, soit au moment où Bordeaux basculede la domination anglaise à celle des rois deFrance. Chiara Piccinini actualise l’étude duportail méridional de la collégiale, œuvregothique trop peu connue et dont elle situe laplace dans la production sculptée en Aquitaineau milieu du XIIIe siècle, suggérant une émula-tion entre les chanoines de Saint-Seurin et ceuxde la cathédrale, qui commandaient à la mêmeépoque le fameux Portail Royal de Saint-André.
Le bilan extrêmement riche de ce colloquepermet d’appréhender très largement l’am-pleur des enjeux historiques et archéologiquesrelatifs à ce site majeur, même si l’on peutregretter que la période moderne n’ait été
abordée que de façon très fragmentaire. Cetteremarquable synthèse interdisciplinaire permetdans tous les cas d’ouvrir de nombreuses pistesde réflexion, propres à stimuler les nouvellesrecherches qu’appelle de ses vœux CharlesBonnet dans sa conclusion. Six ans après le col-loque, ce travail collectif porte ses fruits et lesinvestigations sur le monument sont actuelle-ment sur le point d’être reprises, à travers unlarge partenariat institutionnel et scientifique.
Christian GensbeitelUniversité Bordeaux 3, CNRS UMR
5060/IRAMAT-CPR2A
Châteaux et palais
Jean MeSquI, Les seigneurs d’Ivry, Bréval etAnet aux XIe et XIIe siècles. Châteaux etfamilles à la frontière normande, Caen,Société des antiquaires de Normandie, 2011,25 cm, 413 p., 143 fig. et ill. en coul., cartes,plans, schémas, arbres généalogiques, indexgénéral. - ISBN : 978-2-919026-04-3, 36 €.
(Mémoires de la Société des Antiquaires deNormandie, t. XLVI)
La frontière du duché de Normandie avecl’Île-de-France royale, bordée par l’Eure etl’Avre, fut contrôlée à partir de la fin duXe siècle par la famille d’Ivry-Bréval, qui jouade ses deux hommages respectifs pour renfor-cer son pouvoir. Au prix de luttes épiques etd’une vie de pillages, de brigandages contre lesmonastères et de rançons, que narre OrdericVital, Ascelin Goël réussit à fusionner ces deuxseigneuries avec celle d’Ivry pour constituerune principauté à cheval sur l’Eure, dont lestrois châteaux majeurs relevaient respective-ment des mouvances d’Evreux, de Dreux et deMantes. Mais l’application de la coutume nor-mande, qui ne connaît pas le droit d’aînesse,aboutit à un morcellement de la principauté aucours du XIIe siècle. Prétextant de l’existenced’un fief dépendant de la branche de Bréval etd’Anet sur la rive gauche de l’Eure, Illiers-l’Evêque, Philippe Auguste s’empara de cesdeux sites et fit construire en 1192, face à Ivry,la formidable forteresse de Guainville. Ayantperdu leur raison d’être douze ans plus tardavec la conquête française de la Normandie,les châteaux frontaliers connurent alors desdestins contrastés.
Après cette première partie qui traite desdeux siècles tourmentés d’existence de cettezone, la seconde présente neuf monographiesde sites frontaliers dont les deux forteresses lesmieux conservées, Ivry et Guainville, jalonnentles deux extrémités de la vie active. Ivry, dontsubsistent principalement les substructures de
la turris famosa, la « tour-mère » de toutes lesgrandes tours résidences anglo-normandes, ledonjon-palais de Raoul d’Ivry, a connu cettephase d’emmottement de la résidence primi-tive horizontale, support à l’énorme tour dis-parue. Guainville, posé face à Ivry, sansconnexion avec un village ou une église parois-siale, a probablement connu une vie activecourte avant l’annexion d’Ivry par Bréval, autemps d’Ascelin Goël. Ce site de plateau sanscontrainte topographique est entièrementrefortifié à l’extrême fin du XIIe siècle pourPhilippe Auguste en une grande enceinte àfossé profond et tours à archères multiples. Parses caractères architecturaux, Guainville estatypique au regard du reste de la fortificationphilipienne : tour verticales à ressauts péné-trant dans le talus des courtines, voûtées encoupole un niveau sur deux, archères couvertesen berceau brisé, porte à quatre tours consti-tuant comme un keep-gate-house avant l’heure,multiplication des poternes soigneusement dis-simulées aux vues de l’ennemi ; tous traitsd’une grande originalité, qui pêchent par leurexécution expédiée, « comme si un architectesoucieux d’innovation à tout prix avait ensuitelaissé la main à des maîtres d’œuvre locaux »,comme un coup d’essai sans lendemain avantla normalisation. Comme pour confirmer,Villiers-en-Désœuvre présente une tour dontles caractères architecturaux sont très prochesde ceux de Guainville, accusant la maîtrised’ouvrage de Philippe Auguste, qu’on retrouveégalement à la tour du Diable et à la tour duGouverneur de Gisors, après 1193.
En trois études convergentes, surLillebonne (2008, c. r. Bull. mon. t. 168-3,2010, p. 305-306), sur Guainville (2011,recensé ici), et sur Vernon (2011, « La Tour desArchives… », Bull. mon., t. 169-4, p. 291-318), Jean Mesqui explore ainsi fondamentale-ment le laboratoire qu’à constituer la fortifica-tion en Normandie au temps de PhilippeAuguste.
Nicolas FaucherreUniversité d’Aix-en-Provence
alain SaLaMaGNe (éd.), Le palais et sondécor au temps de Jean de Berry. Textes réu-nis et présentés par alain Salamagne, Tours,Presses universitaires François-rabelais deTours (diffusion Presses universitaires derennes), 2010, 28 cm, 227 p., fig. et ill. enn. et bl. et en coul., plans, schémas. - ISBN :978-2-86906-251-1, 30 €.
En 2004, le musée du Louvre, le musée desBeaux-Arts de Dijon, le musée Condé àChantilly, le musée du château de Blois et lemusée du Berry de Bourges s’étaient associéspour présenter une série d’expositions évoquant
Bib
liogr
aphi
e
281
Bib
liogr
aphi
e
281
l’art vers 1400, à Paris ou dans les cours desprinces aux fleurs de lis. Parallèlement, l’Écoledu Louvre avait organisé un colloque publié en2006, La création artistique en France autour de1400, tandis que l’université d’Orléans-Toursproposait une université d’été sous le titreCréation artistique et mécénat autour du Val-de-Loire à la Renaissance. Avec la publication duvolume dirigé par A. Salamagne, qui édite unepartie des communications présentées à cetteoccasion, le dernier maillon de cette chaîne depublications est maintenant ajouté.
Tout naturellement, A. Salamagne a res-serré la problématique du colloque vers sonthème de prédilection, l’étude du bâti, en yajoutant un gros article sur le Louvre médiéval.
Le contexte historique est introduit avecun texte de F. Autrand (par ailleurs publié dansUne fondation disparue de Jean de France, ducde Berry : la Sainte-Chapelle de Bourges, cata-logue de l’exposition, musée du Berry,Bourges, 2004). Puis J.-Y. Ribault fait le point,à la suite du colloque de Dijon, sur les maîtresd’œuvre et la chronologie des chantiers berri-chons : palais et Sainte-Chapelle de Bourges,château de Mehun-sur-Yèvre (à ce sujet, voir lapublication dirigée par Ph. Bon, Le château etl’art à la croisée des sources. Actes du colloque …23-25 novembre 2001, Mehun-sur-Yèvre, 2011),soulignant la différence de statut entreAndré Beauneveu, maître d’œuvre chargé dudécor sculpté, qui dut séjourner longuement àBourges pour mener le chantier et diriger lasculpture « immeuble par destination », et Jeande Cambrai, sculpteur du duc, qui intervintpour de la sculpture mobilière, comme lastatue de la Vierge aujourd’hui dans l’égliseparoissiale de Marcoussis (Essonne) ou le tom-beau que Jean de France lui commanda, sansdoute vers 1403.
Les interventions suivantes, d’A.Chazelle et dePh. Goldman sur Bourges au temps de Jean deBerry, et de P. Garrigou-Grandchamp sur l’ar-chitecture domestique urbaine vers 1400, ten-tent, chacune à leur façon, de tirer les leçonsd’une certaine pénurie, aussi bien de la docu-mentation que du bâti subsistant. A. Chazelle etPh. Goldman se livrent, en fait, à un véritablebilan d’une trentaine d’années de recherches surl’architecture civile médiévale à Bourges, du XIIe
au début du XVIe siècle. Ces recherches sontprincipalement les leurs et celles de J. Troadec,archéologue de l’agglomération de Bourges ;leurs publications, jusqu’ici disséminées(Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry,Berrymagazine, etc.), sont ici utilement réunies, avec unappareil iconographique modeste, mais évocateur.P. Garrigou Grandchamp compense la relativerareté des exemples d’architecture vers 1400 enélargissant son terrain d’enquête géogra-phique ; à cet égard, il faut souligner que le sudde la France est beaucoup plus riche qu’on ne
le soupçonnait, et l’auteur s’appuie surquelques exemples datés (en particulier par ladendrochronologie), pour faire émerger descaractéristiques typologiques, destinées à facili-ter le repérage d’autres bâtiments à ajouter aucorpus déjà réuni. L’un des phénomènes qu’ilrelève est celui de l’extension de fonctionsd’habitation aux rez-de-chaussée des corps delogis sur rue (déterminée par la présence de lacheminée à ce niveau), alors qu’on pense tradi-tionnellement à une activité d’artisanat ou devente pour l’espace sur rue au rez-de-chaussée.La desserte des étages se fait presque toujourspar un escalier en vis, qui supplante la voléedroite, jusque là majoritaire, et peut être enœuvre, ou logé dans une tourelle sur cour, des-servant parfois différents corps de logis aumoyen de galeries.
A. Salamagne, de son côté, a repris ledossier du palais du Louvre de Charles V.S’appuyant sur un dossier de documentationancienne (iconographie, témoignage d’HenriSauval au XVIIe siècle, fouilles du XIXe siècle) etsur la partie publiée des fouilles menées parMichel Fleury pendant la décennie 1980, ilpropose de nouveaux plans du Louvre, avant etaprès 1364, moment où Charles V entreprendses travaux. Pour lui, le chantier s’est déroulésur un temps long, analogue à celui constaté àBourges pour le palais ducal, ou à Vincennes,pour le château, et l’achèvement a pu même sefaire après la mort du roi, en 1380, ou en touscas vers cette date. Il remet en cause un certainnombre des conclusions auxquelles étaitarrivée M. Whiteley dans ses articles : il situeainsi la grande chapelle dans l’aile ouest, et nondans l’aile sud et surtout formule des hypo-thèses sur les circulations et les distributions,en s’appuyant aussi sur des analyses de textes,en différenciant, après 1365, les espaces priva-tifs du roi et le rôle des pièces de « gouverne-ment » dans l’aile nord (voir en particulier leplan figure 12, p. 90). Il propose également,pour la célèbre « grande vis », un autre tracéque ceux dessinés successivement par Berty,Viollet-le-Duc et M. Whiteley ; son hypothèsed’un tracé hexagonal reste malheureusementinvérifiable, même si sa proposition d’une gale-rie permettant l’accès depuis cette grande vis àla salle du roi semble séduisante. Concernant laprovenance des statues de Charles V et deJeanne de Bourbon (RF 1367 et 1368)conservées au Louvre, il se rallie à l’hypothèsed’une provenance ancienne du Louvre, maissuppose qu’il s’agit des statues de Jean de Saint-Romain, jadis dans la grande vis, et non decelles provenant du châtelet oriental, hypo-thèse privilégiée en 1981 par J.-R. Gaborit.Cet article pourra déjà être complété par la lec-ture de celui écrit par J. Mallet, « Une lecturecontraignante des documents financiersconcernant le Louvre de Charles V », Bulletinde la Société nationale des Antiquaires de France,
2006, p. 86-116. L’ouvrage sur l’histoire duLouvre, coordonné par G. Bresc-Bautier, àparaître prochainement, devrait apporterencore d’autres éléments sur le Louvre médié-val, sous la plume de P.-Y. Le Pogam.
Les quelques pages écrites par J. Malletau sujet des aménagements résidentiels deLouis Ier d’Anjou sont également très éclai-rantes, avec une réflexion sur la différenciationdes espaces de résidence et des espaces de repré-sentation (chambre de parement) ; l’auteursouligne également la démarche analogue deCharles V et de Louis d’Anjou, qui héritèrentd’imposants bâtiments antérieurs, et les com-plétèrent et les adaptèrent, tandis que Jean deBerry (sauf à Poitiers et à Mehun-sur-Yèvre !)et Philippe le Hardi se livrèrent à des construc-tions civiles pratiquement ex nihilo… Il s’inté-resse aussi à la question des ouvertures et desvues, sur le paysage ou sur les jardins, les goûtsde Louis Ier annonçant ceux de René d’Anjoupour la nature.
L. Gaugain présente un dossier détaillé surla tour résidentielle de Trèves en Maine-et-Loire, avec de nombreux plans et relevés, ainsique des clichés d’une bonne partie des élé-ments sculptés (culots, clefs de voûte) de cemonument peu accessible au public, car enmains privées. On remarque aussi des élémentsde second œuvre, comme la grille de la baienord de la grande salle, qui semble intacte.L’auteur se rallie à la position la plus fréquem-ment défendue, celle d’une construction parRobert Lemaçon, qui acquit la seigneurie en1417 et mourut en 1443.
B. Kurmann-Schwarz reprend la questiondes vitraux de la Sainte-Chapelle de Bourges,sur laquelle le catalogue de l’exposition ber-ruyère de 2004 avait par ailleurs tenté de fairele point. Elle attire l’attention sur de possiblesfigurations du duc de Berry, Jean de France, etde sa seconde épouse, Jeanne de Boulogne,dans les vitraux de la Sainte-Chapelle, dontseule une faible partie est conservée, principa-lement à la cathédrale de Bourges. Pour l’au-teur, l’image sur verre a une fonction spéci-fique, celle d’incorporer les effigies desdonateurs à la sphère céleste, tandis que les sta-tues priantes (qui, elles, sont conservées à lacathédrale de Bourges, encadrant toujours uneNotre-Dame la Blanche) étaient une manièrede maintenir une présence quasi corporelle duduc parmi les vivants.
Cl. Vareille-Dahan présente un répertoired’hommes sauvages, une iconographie dont lespremières mentions sont citées en 1308. Ellesignale que les hommes sauvages supportent lesarmoiries de certains grands de la fin duMoyen Âge, en particulier celles de Louis Ierd’Anjou, et de plusieurs membres de la familled’Amboise. Elle a souvent rencontré ces élé-ments d’accompagnement de l’héraldique sur
Bib
liogr
aphi
e
282
Bib
liogr
aphi
e
282
Bib
liogr
aphi
e
283
des portes d’entrée, au manteau des cheminées,ou dans les taques et landiers qui garnissaientles cheminées et se demande s’ils n’ont pas euune fonction protectrice, repoussant à l’exté-rieur et dans les ténèbres d’éventuelles forcesmaléfiques. Aux figures proches qu’elle cite,Hercule ou saint Jean-Baptiste, personnagesrevêtus de peaux de bête à défaut d’être veluseux-mêmes, on peut adjoindre les célèbres« têtes de feuille » du Moyen Âge, motif icono-graphique souvent présent sur les culots et lesclefs de voûte, ou la thématique voisine, peut-être plus britannique et germanique, de« l’homme vert ».
Souffrant d’une pénurie de peinturesmurales civiles contemporaines de Jean deBerry en Auvergne, analogue au manque dedocumentation rencontré par A. Chazelle etPh. Goldman pour l’architecture civile àBourges, A. Courtillé a logiquement élargi sonchamp d’étude. Elle fournit une analysedétaillée du décor peint du château de Saint-Floret (Puy-de-Dôme) (dont de plus nom-breuses reproductions sont en ligne : voir lefichier pdf « Le roman de Tristan », accessiblesur : http://www.paysdissoirevaldalliersud.fr),datant du début de la période, et signale aussides chantiers religieux, en particulier à Ebreuil,et surtout à Ennezat, avec le Jugement dernierde l’église Saint-Victor et Sainte-Couronne,dont la triste histoire est contée dans Le dévoi-lement de la couleur (catalogue de l’expositiontenue à la Conciergerie en 2004-2005, Paris,2004, p. 218-220), puisqu’elle a subi un« lavage » et un changement d’emplacemententre 1855 et 1869. Datées des premièresannées du XVe siècle, ces peintures, de qualitésoulèvent la question de l’intervention d’artistesoriginaires du nord de la France pour des décorsméridionaux. Ici, remarquons qu’Ennezat n’estqu’à quelques kilomètres de Riom et du palaisdu duc de Berry… La problématique est lamême que celle rencontrée par Claudia Rabel etHélène Millet pour la Vierge au manteau, toilepeinte conservée par le musée du Puy-en-Velay,un peu plus au sud (H. Millet et Cl. Rabel, LaVierge au manteau du Puy-en-Velay, Lyon, 2011,c. r. Bull. mon. à paraître), Cl. Rabel supposantl’intervention d’un artiste venu de Paris, etremarquant de possibles influences flamandes.Bien qu’il ne s’agisse pas de peinture murale, etque Brioude se trouve en Haute-Loire, capitaledu Brivadois, mais dans le duché d’Auvergne,on peut aussi mentionner ici le plafond peintaux armes et emblèmes de Charles VI et de Jeande Berry, jadis dans une maison de la place de laFénerie, connu par des relevés de JosephFournier-Latouraille, publiés en 1855 par leurauteur et republiés en 2003 par Cl. Astor,« Armes et emblèmes d’un plafond disparu,Cahiers de la Haute-Loire, 2003, p. 99-116, puispar Chr. de Mérindol, « De l’emblématique deCharles VI et de Jean de Berry : à propos d’un
plafond peint et armorié récemment publié »,Bulletin de la Société nationale des Antiquaires deFrance, 2006, p. 121-135 (avec discussion deshypothèses de datation, soit dans la décennie1380, soit dans la décennie suivante).
Enfin, Jean Guillaume conclut sur l’im-portance de certains éléments apparus à l’é-poque du gothique international pour l’évolu-tion future du château français : escaliersoulignant la verticalité, apparition de la gale-rie chauffée comme un prolongement dessalles et chambres, création de chambres hautesau-dessus des escaliers, lieux d’étude et decontemplation du paysage, comme au Louvrede Charles V, et surtout décor féérique des toi-tures, que l’on retrouve sous François Ier auchâteau de Chambord.
La lecture de ce volume sera donc utile àceux qui travaillent sur l’architecture et ledécor en Val de Loire et jusqu’en Auvergne,dans les anciens domaines de Jean de Berry,mais aussi à ceux qui s’intéressent à l’histoiredu Louvre, et par là, plus largement, à tousceux qui sont concernés par l’architecture civilede la fin du Moyen Âge.
Béatrice de Chancel-BardelotPensionnaire à l’INHA
emmanuel LurIN (dir.), Le Château-Neufde Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye, Les Presses franciliennes, 2010,29 cm, 195 p., fig. et ill. en n. et bl. et encoul., 2 index ( des noms de personnes et delieux). - ISBN : 978-2-95272148-6, 25 €.
Pendant longtemps le nom du Château-Neuf de Saint-Germain-en-Laye n’évoquaitguère autre chose que l’image de la Maison duThéâtre de Delorme connue par les gravures deJacques Androuet du Cerceau et les terrasses avecleurs grottes des Francini gravées par MichelLasne. Cela a bien changé. Depuis une trentained’années plusieurs historiens ont commencé àfaire revivre un site jadis célèbre et depuis quasioublié. Dominique Cordellier publia d’abordplusieurs études sur les peintures de ToussaintDubreuil dans la galerie et l’appartement du Roi(1985, 1987, 2010), suivi par Jean-PierreSamoyault sur les peintures de Louis Poissondans la galerie de la Reine (1990) et finalementce fut Monique Kitaeff qui se concentra sur l’ar-chitecture (1999, 2008). Il faut ajouter encoreun compte rendu de Bertrand Jestaz (Bull. mon.,t.158-4, 2000, p. 375-378) apportant d’impor-tantes précisions au premier article de M.Kitaeff. Le relais a été pris plus récemment par E.Lurin qui publia dès 2003 de nouveaux docu-ments sur les terrasses d’Henri IV. En attendantla publication de sa thèse sur Dupérac, on peuten consulter un résumé dans la position dethèses sur Internet. Du même auteur parut, en
2008, une étude sur le Château-Neuf commevilla royale pour Henri IV dans le Bulletin desAmis du Vieux Saint-Germain (cr. Chronique,Bull. mon., t. 167-IV, 2009, p. 373-374) et,enfin une autre sur la sculpture décorative de lagrotte du roi au Château-Neuf (« De l’ordredans la rocaille ! Sculpture et style rustique à lagrotte sèche de Saint-Germain-en-Laye » dansLa sculpture française du XVIe siècle, Marseille,2011, p. 34-45).
Ainsi le terrain étant solidement préparé,le musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye pouvait présenter, d’octobre2010 à janvier 2011, une exposition sous letitre : Henri IV, prince de paix, patron des arts, àl’occasion de laquelle l’ouvrage d’E. Lurin a étépublié dans le but de présenter une synthèse destravaux les plus récents, auxquels ont été ajoutéesquelques réflexions inédites. Ce livre abondam-ment illustré, bien que certaines vues soient unpeu petites, est un travail collectif, auquel ontcollaboré, en dehors d’E. Lurin, Basile Baudez,Ronan Bouttier, Géraud Buffa, MoniqueKitaeff, Julien Magnier et Aurélia Rostaing. Lessix chapitres s’intitulent : 1) Saint-Germain, rési-dence des Valois et des premiers Bourbon,2) Un château perché : l’architecture duChâteau-Neuf et des terrasses, 3) Deux galeriespour un roi ; les fastes du décor, 4) Lespavillons du Roi et de la Reine, 5) Les mer-veilles hydrauliques des grottes et des jardins,6) Des fastes de l’effacement: le Château-Neuf,de Louis XIII à Louis XIV et sont suivis detémoignages et de documents. Chaque chapitrecommence par un texte introductif, richementdocumenté mais sans nom d’auteur, suivid’illustrations de documents, surtout de plans,élévations, vues et photographies dont chacunest accompagné d’un commentaire, signé par undes collaborateurs. On peut toutefois regretterque les auteurs n’aient pas jugé bon de repro-duire le marché de 1557 avec Philibert Delormepour le premier logis de Henri II, ni celui de1594 avec Guillaume Marchant pour lesagrandissements qui se trouvent tous les deux,il est vrai, chez M. Kitaeff (1999). Dans lepremier marché on lit déjà la formule un peusurprenante et ambiguë : en forme d’un téatre,mais elle désigne uniquement, dans ce cas, lacour avec ses exèdres. C’est quatre ans plus tardque Delorme lui-même, dans ses NouvellesInventions de 1561 l’applique à l’édifice entier :maison du Théatre et baignerie. Le marché de1567, établi avec Primatice parle également dulogis du théatre, appellation qui restera attachéeau château durant le XVIe siècle pour être rem-placée dès le XVIIe par celle de Château Neuf. Jesuis toujours d’avis que ce terme, introduit parSerlio, désigne non pas une fonction, mais bienune forme, il ne s’agit pas d’un lieu pour desreprésentions théâtrales à l’extérieur (p. 17) donton ne connaît qu’un seul cas, à Gaillon, maisd’une forme architecturale, celle d’une exèdre.
Bib
liogr
aphi
e
283
Bib
liogr
aphi
e
284
Déjà M. Kitaeff avait remarqué que sur leplan d’ensemble de Du Cerceau les construc-tions à l’ouest de la cour montrent une distri-bution symétrique absolue, tandis que les par-ties à l’est s’ordonnent irrégulièrement selon ladestination des salles. Le côté ouest ressemble àun plan idéal. Ne peut-on pas se demander sile plan de Du Cerceau de la moitié du châteauconstruit correspond au plan initial deDelorme qui ne comportait qu’un corps delogis à l’est précédé d’une cour fermée d’unsimple mur de clôture en forme d’exèdres ? Lemarché de 1557 avec Delorme prévoit exacte-ment cette solution. D’ailleurs les deux plans,l’élévation et la vue que donne Du Cerceau,montrent le château chaque fois un peu diffé-remment et donnent l’impression d’une certai-ne hésitation : les constructions bordant la moi-tié ouest de la cour pourraient être le produit del’imagination de Du Cerceau ou encorerépondre à quelques projets survenus entre ledépart de Delorme et la réalisation définitive.
La plus grande partie de la publication estconsacrée aux travaux sous Henri IV qui dèsson avènement a terminé les constructionsinachevées de Delorme, qui avait créé le réseaudes ailes qui entourent le corps principal ainsique les célèbres terrasses descendant vers laSeine. Malgré un effort considérable pour réu-nir toutes les sources dont beaucoup étaientinconnues, qu’elles soient écrites ou en images,l’attribution des travaux demeure entouréed’incertitudes, à l’exception de celle des grottesqui sont certainement l’œuvre de Tommaso etFrancesco Francini, et de la grotte sèche, sous lepavillon Henri IV, pour laquelle on a au moinsle nom du fontainier Jean Séjourné. Pour leprojet d’ensemble d’avril 1594 on pourraitpenser à Jacques II Androuet du Cerceau, alorsarchitecte du Roi en titre, mais Louis Métezeaujouait déjà aussi un rôle considérable, surtoutau Louvre, avant d’être nommé architecte ordi-naire au mois d’octobre. En 1605 un docu-ment atteste qu’il a donné le dessin d’une portepour le Château-Neuf. Mais un autre nom esttraditionnellement attaché aux travaux deHenri IV, celui d’Étienne Dupérac, dessina-teur, graveur, architecte et peintre qui a passédix-huit ans à Rome (1560-1578). Dans l’in-troduction au chapitre II on peut lire queDupérac est mentionné à Saint-Germain en1601, sans que le contexte soit précisé. Lelecteur curieux doit se reporter à un articled’E. Lurin (BSHAF 2004, p. 10) pourapprendre qu’à cette date Dupérac s’est mariédans une église proche de Saint-Germain, maisil n’est pas question d’une participation à unchantier. Toutefois le fait que le couple parisiense soit marié en dehors de la capitale laisse sup-poser un séjour prolongé à Saint-Germain.Mais depuis la découverte du projet pour unevilla commandée en 1583 – E. Lurin plaidepour 1585 – pour Catherine de Médicis sur la
colline de Chaillot qui a pu être attribué aveccertitude à Étienne Dupérac 1 nous avons unesorte de missing link entre la série de vues dejardins en pente romains, reconstitutions d’an-tique et contemporains, gravées par Dupérac etles terrasses du Château-Neuf.
Il y a toute raison de penser que leXVIe siècle voyait dans ces jardins en terrassesun héritage antique, d’où leur immense presti-ge. L’auteur de l’introduction au chapitre II yfait une courte allusion. Rajoutons que lejardin du Belvédère, gravé par Dupérac, avecses terrasses et une grotte au centre, bienconnue des lecteurs de la Bibliothèque vatica-ne parce qu’elle leur sert aujourd’hui de cafete-ria, se voit au château Saint-Ange, dans unefresque de Perino del Vaga, transformé par unstyle pompéien, en villa antique (vers 1540) 2.
Aux descriptions citées on peut encoreajouter celle que Jodocus Sincerus (JustusZinzerling) a publiée en latin en 1616(Itinerarium Galliae, Lyon 1616, p. 343-344).Cet Allemand installé à Lyon a visité le châteauet décrit la grotte d’Orphée, la grotte de laDemoiselle, celles de Neptune et de Persée etfinalement la croute seiche. Sous une des gale-ries il situe la statue de Mercure, sans doutecelle de la fontaine dans les bras de l’hémicycle.Dans les intérieurs il ne mentionne qu’un seulépisode de La Franciade peint dans les cubicu-la, donc dans l’appartement du Roi. La scènemontre Francus assis et se lamentant pour quele roi l’élève et le replace dans son état ancien :Et tandem in cubicula quodam Francidos effi-giem plorabundae sedentis quam Rex elevat et inpristinum statum reponit. Le tableau est incon-nu à moins que son iconographie ait été malinterprétée.
Le somptueux décor de la galerie du Roi etde son appartement ainsi que celui de la gale-rie de la Reine font l’objet du chapitre III. Iciles auteurs ont pu s’appuyer sur les études deD. Cordellier et de J.-P. Samoyault. Le cycleillustrant La Franciade de Ronsard et quelquesscènes d’après Ovide peints par ToussaintDubreuil pour la galerie du Roi et de sonappartement ont pu être reconstitué en grandepartie. On reste beaucoup moins renseigné surle décor topographique de la galerie de la Reinepar Louis Poisson, un peintre presque oublié.
Les seuls vestiges du Château-Neuf quisubsistent aujourd’hui, plus au moins bienconservés, sont les pavillons de la chapelle duRoi et de celle de la Reine. Si pour le décor dela chapelle du Roi nous avons peu d’éléments,en revanche pour celle de la Reine existe unmarché de 1614 avec Pierre Poisson pour lapeinture, trouvé par J.-P. Samoyault. Mais levéritable attrait de ces pavillons, les visiteurs entémoignent, était les grottes qui se trouvaientau rez-de-chaussée sous les chapelles, celle de laReine, peut-être pas entièrement achevée, celle
du Roi, dite la grotte sèche, parce que l’élémentde l’eau y manquait, encore presque entière-ment conservée : fortement structurée par desordres et de grandes figures en pierre dans lesvoûtains, elle se distingue des créations plusrustiques des Francini et devait être dû à unartiste français.
Le chapitre V est consacré aux jardins, autravail du jardinier Claude Mollet, à l’adduc-tion difficile de l’eau, aux travaux des frèresFrancini, créateurs des célèbres grottes et aumécanisme des automates hydrauliques.
Le dernier chapitre est l’histoire du déclindu château et des terrasses. Louis XIV avaitencore une fois restauré des terrasses écroulées,mais avec le départ de la cour à Versailles en1682 le Château-Neuf demeura définitive-ment à l’abandon. En 1777 le comte d’Artois,futur Charles X, procéda à la destruction quasitotale du château et des terrasses pour yconstruire un immense château conçu parFrançois-Joseph Bélanger qui ne verra jamais lejour. Après la Révolution tout fut progressive-ment vendu comme bien national, ensuite lotiet des habitations s’y construisirent. Il ne resteque les deux pavillons des chapelles du Roi etde la Reine, ainsi que quelques portions demurs de soutènement.
Ce livre offre la somme des connaissancesactuelles sur le Château-Neuf, ne négligeantaucun aspect de son histoire, événements his-toriques, architecture, décor. Son illustrationest particulièrement riche et passe des pre-mières gravures, très précises, quasi techniquesà des vues de plus en plus pittoresques pourarriver dès la fin du XVIIIe siècle à des paysagesromantiques dont les ruines deviennent finale-ment l’attraction majeure des promeneurs.
Quelques erreurs sont à signaler : la Jeanned’Albert (p. 18) aurait pu être évitée, ainsi quele château de Hellbrunn en Allemagne (p. 114),Louis Poisson (p.88) devait être plutôt Pierre.
En annexe on trouve reproduit quelquesmarchés et des descriptions du Château-Neuf.
Liliane Châtelet-Lange
1. Mon attribution se fondait surtout sur trois arguments.D’une part l’auteur ne pouvait pas être un Italien à cause desnombreuses fautes d’italien dans les annotations, mais plutôtun Français ayant séjourné longtemps en Italie, puis le faitque le château soit dessiné avec une certaine négligence – lesportes menant aux terrasses sont placées asymétriquement,les fenêtres de l’étage dans l’exèdre ne se trouvent pas dansl’axe des arcades du rez-de-chaussée et il y en a une de trop– tandis que le jardin est tracé avec grand soin, indiquait quel’auteur avait donné visiblement une priorité aux jardins et àl’hippodrome. Dès lors le nom de Dupérac s’imposait facile-ment. A ma demande, C. Grodecki a comparé l’écriture dudessinateur avec celle d’un marché signé par Dupérac et a puconfirmer mon attribution. Ce résultat a été communiqué àS. Deswarte-Rosa qui l’a publié.
2. Reproduit dans André Chastel, « Le lieu de la fête »,Les fêtes de la Renaissance, I, Paris 1956, fig. 1 et 3.
Bib
liogr
aphi
e
284