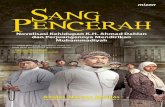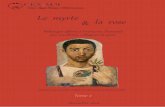Fantasmatiques des couleurs du sang. Sur Le Sang des bêtes (Franju, 1949), The Act of seeing with...
-
Upload
univ-poitiers -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fantasmatiques des couleurs du sang. Sur Le Sang des bêtes (Franju, 1949), The Act of seeing with...
I
Farttasmatiquesd,es couleursd,u sangpar Marie Martirt.
ID*'x*1l*;',re:ffi iiirff iihfiiJ.i,,-#t:::#is:::xabattoirs de Paris; stan Brakhage firme en 1971, frontarement et en coureurs, troisinstitutions du contr6le des corps - aprbs la police et l,h6pital, la morgue constitue ledernier volet de sa ,, trirogie de pittsburgh ,; Thierry Klauffmonte .n tgsz son courtpodme filmique d partir de photographies d'animaux prises dans un abattoir belge parMarc Trivier. La confrontation cle ces trois films s,impose au nom d,un meme travailen degd du regard.
Pourtant, pourquoi mettre sur le m6me plan abattage des animaux et observationau scalpel des corps humains morts dans des situations de viorence? prus qu,unetouche de rouge face au noir et branc des deux autres firms, i,essai de Brakhage ques-tionne ies liens qui unissent hommes et b6tes autour du sang vers6 et d,un m6medevenir-carcasse - viande, aussi bien, Qui n a garile toutes lesiouffrances et pris sursoi toutes les couleurs de la chair uiue. 1...) l,a uiancle est la zone commune cle I'hommeet de la bate, leur zon,e cl,'incli,scernabilitd, elle est ce ,,fai,t,',
cet dtat mame oi) re peintres'identifie aux ob.jets de son horceur ou de sa compassiont,.
L'abattoir et la morgue offrent aux cin6astes et aux spectateurs des cas rimites : cesont deux lieux dont ie filmage et la vision instaurent une autopsie litt6rale duvisible. selon quelles strat6gies de mise en scdne le sang se do.rne-t-il d voir? Queproduit, notamment, l'usage de Ia coureur ou du noir ut blur., non du point devue symbolique, mais dans Ia perception de Ia r6aiit6 la plus concrdte - sang visibieet donc vers6, sang matidre et coureur? Le cin6ma, Bazin n'a cess6 de Ie rappeier,
:E1081.GillesDe}euze'FrancisBacon'Logiquedelasensatitln,LaDiffiirence,1981,r66d.Seuil,2002,p.29-30
impose la densit6 de I'empreinte avant toute signification, au point de faire parfois
trembier le r6el jusqu'au fantasmatique. La confrontation de ces trois dispositifs en
prise sur le sang r6el forme un terrain d'analyse privil6gi6 du jeu des couleurs dans
ie travaii de I'image-iimite comme obturation psychique.
Les uapeurs grises du sang des bAtes
La premidre pariie du Sang des bAtus pr6sente une s6rie d'objets d6sassortis etremis6s aux marges de la grande ville. Cette entr6e en matidre sert surtout de contre-point d une autre r6alit6, beaucoup moins souriante, et qui 1ui est pourtant organi-quement 1i6.e, "
parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres ",dira plus tard la voixoff - d moins qu'i1 n'y ait d6jd, dans ce discours rapport6 sur Iemode de I'indirect libre, une mise en 6vidence ironique de la d6n6gation qui permet
seule de supporter ce m6tier. Dds Ies premidres minutes, Ie malaise nait de 1'6trangejuxtaposition de Ia mibvrerie et de la brutalit6 : musique empruntant d la comptine,voix f6minine trbs douce, images u po6tiques , des friches de la proche banlieueparisienne face au son mat de la d6charge 6lectrique mortelle, imm6diatement suivipar Ie flot de sang fumant qui gicle de i'aorte d'un cheval. La violence du bruit et Iejaillissement du sang font irruption dans un systdme apparemment ba1is6. Ce
rapprochement d6rangeant fait osciller ie regard et perturbe peut-6tre davantageque le douloureux spectacle du sang des b6tes. Dans ce climat de menace, une tensionparticulidre nait de i'utilisation du noir et blanc, dont on subit simultan6ment les
vertus de mise d distance et de stylisation expressive.
Aprds Vaugirard, la seconde partie du fllm s'ouvre sur ie calme plan d'eau du canal
de l'Ourcq et montre successivement les proc6dures d'abattage des breufs, des veaux,
des moutons : 1a Villette est cette fois le th6Atre de la m6me mixit6 inconfortable. Ledocumentaire accentue la faille entre la pr6sentation des ouvriers comme d'admirablesprofessionnels, au savoir-faire indispensable, et ie commentaire qui les qualifie sans
ciller de " tueurs ',. Le Sang des b\tes fonctionne seion une strat6gie dueile. La voixoff sature d'informations techniques qui ne minorent pas i'impact d'images oi, parexemple, on saute litt6ralement sur un cadavre pour que le sang ne stagne pas (" l,e
foulage complite I'd.uacuation dw sang qui est recueilli en grande partie dorus des rdci-
pients. Le trop-plein s'dcoule au ruisseau d'|pandage,). Inversement, le fllm pratiqueaussi la r6tention du commentaire, laissant le spectateur confront6 d des images
indicibles, exc6dentaires. Les cadrages insistent sur les mares de sang noir liquides,
fumantes et plus sombres par endroits, d6jd cai116es, ou bien m6l6es d d'autresmatibres, conlme celle qui s'6chappe de cette poche molle et blanche dont on ne nous
dira rien, car 0n ne parle pas de gn d table - pas plus qu'on ne commentera, d6pos6
sur un 6tabli, Ie fetus de veau sur lequel 1a cam6ra s'attarde.
II est d'usage, dans les abattoirs, pour rendre supportable aux o tueurs , cet acte
d6cid6ment pas si naturel, de Ie diviser en plusieurs actions techniques dont seule 109
la somme est mortelle. Pour l'ethnologue, il y a id une " double disjonction : etttrt . -saignde et la m.ort d'une part; entre La mort et la souffrance d'autre partr ,,. Lt.oscillations du regard r6alisent, au niveau des images du sang, pr6cis6ment I'invers.de ce nrouvement oir l'u ott p€ut \uiter wt acte d I'instant mAme oii on l,accontpli:.tout comme on peut d.uiter un. sens d l'instant mame oiL on le profire. Il suffit porr-cela de ddcouper addquatement dans le continuurn du rd,eL et du signifianl2,. Franjud6coupe iui aussi le visible du scalpel de son regard, mais moins pour rendre lesimages supportables que pour en exhiber Ia brutalit6 habituellement masqu6e. 11
incise le tissu des apparences grace d ces disjonctions formelles qui cr6ent unefaille d l'int6rieur du r6e1 repr6sent6 autant qu'une scission du regard d6nu6 depoint fixe.
Franju procbde sur Ie mode de l'alternance et du va-et-vient. Loin de prot6ger de1a violence des images, il l'accentue en cr6ant une perte progressii,e de repdres oi lamort touche au grotesque. 0n nous dit d'abord que u lo conseruation de la uiandeblanche du ueau ndcessite une saignde totale par d\capitatian,. Sont montr6s, d titred'iliustration, 1'6gorgement d'un veau, le sang qui gicle de 1a praie, et les soubresautsde 1a b6te, mais Ia voix o//nous rassure aussit6t :, L'onirnal mori est encore anim.dde rdflexes, manifestation d'une ttie pwrement u6g6tatiue., PremiBre 6tape, qui opdredans ia scientiflcit6 et la maitrise. Second moment, lorsque trois minutes plus tardon 6gorge i ia chaine une quinzaine d'agneaux : Ie spectacle des saccades rythmiques.align6es sur Ia diagonale d'une grande profondeur de champ, n'a plus rien de maitri-sable. f image et le regard tressautent eux aussi. Et ie flim ne cesse jamais d'alternerentre frontalit6 r6aliste et " inquidtante d.trangetd,, dont Freud notait qu'elle provientsouvent d'une h6sitation sur le statut, anim6 0u non, d'une chose.
La d6r6alisation, qui nait d'abord de i'usage du noir pour figurer le sang, l'entraine,bien au-deld de sa simple repr6sentation, vers 1a subversion. c'est en effet pourr6pondre d 1a commande de la Soci6t6 des Abattoirs de paris que Franju a r6alis6 cefilm. Nul doute que la volont6 apolog6tique n'ait 6t6 d6tourn6e par ce sang noir desb6tes qui gicle, se r6pand et imprdgne chaque photogramme - car si 1e sang ne peutd 1'6poque 6tre rendu i l'6cran que par les seules nuances du noir de la pellicule, larelation s'inverse aussi n6cessairement, faisant de n'importe quel noir du film latrace possible d'une saign6e. La matiEre m6me du film devient ainsi un palimpsesteoi le sang rejaillit sur toutes choses. C'est dans cette subversion color6e que se loge1a v6ritable po6sie du film, loin du r6pertoire d'objets de pacotille que pr6sente sond6but. le sang des bdres semble baliser la possibilit6 d'une vision frontale du sang,puis en laisse resurgir toute la force perturbante : Ie noir et blanc promet Ia distance,mais n'abolit pas la brdche par or) le refoul6 fait retour, immanquablement.
1. Nodlie Vialles, Le Sang et kt Chair, MSH. coll. " Ethnologie de la France ,, n" 8, 1gg?, p. 49.2. Ibid.,p.50.Hbtto
Les corps ouuerts de /'autopsie : une 6tude en rouge
Le fllm de Stan Brakhage a 6t6 tourn6 en 1971 d Ia morgue de Pittsburgh - une
trentaine de minutes, en couleurs. La part de d6r6alisation cesse-t-eile pour autant,
qui rendait d Ia fois la monstration du sang possible et son malaise insidieux? Le
propos n'est plus soutenu par une amorce d'histoire comme celle des n tueurs , de
b6tes chez Franiu, ou m6me un commentaire. Au contraire, comme toujours chez
Brakhage, Ie film d6bute sans autre pr6avis que le seui titre en 6criture cutsive,
trembl6e, blanche sur fond noir : aucune explication, seulement i'examen attentif et
la prise de mesure d'un cadavre fiIm6 au plus prds, souvent en gros plans d6jd s6pa-
rateurs, qui ne cessent d'interroger Ie mystdre de cette peau. La cam6ra et le regard
explorent selon un montage agr6gatif, ajoutant des d6tails sans jamais parvenir d
faire un tout coh6rent ou d 6tablir un savoir sur cette opacit6. Jamais les causes des
morts ou l'explication des proc6dures cliniques ne sont 6voqu6es, puisque l'enjeu ne
reldve pas du policier, mais du visible. L'ceil est i'unique m6diateur de ces images
de morts, se succ6dant au 916 de 1a gestion des corps : examen visuel m6ticuleux,
mesures, palpations, puis ouverture (qui ne commence d proprement parler que vers
1e tiers du film). CrAne, thorax - l'ordre syst6matique soutient Ia vision d'un film qui,
simplement, met au d6fl de regarder en face le d6membrement de la ressemblance.
Cette vioience faite i l'humain qui ne l'est d6j) plus 1ui adresse encore une question
fondamentale : le statut du corps, objet, matidre, couleur. Les m6decins l6gistes ne
sont d'ailleurs jamais montr6s complbtement, et ieur visage est toujours laiss6 hors
champ, d l'inverse des cadavres dont la cam6ra scrutatrice permet d I'occasion une
identification par bribes, s'arr6tant sur des d6taiis jusqu'alors non vus : nombril
saillant, sexes flasques, bras d6charn6s, raidis, mains crisp6es. Seul Ie corps mort se
laisse ainsi montrer, sans pudeur mais pas sans affects puissants sur le fiimeur et le
spectateur : le sang n'apparait que s'il est r6pandu, si ia mort est d l'euvre ou a d6jd
accompli sa tAche. L'absence de commentaire ne r6ussit donc pas d d6sincarner des
corps qui occupent tout Ie champ, avec un poids de pr6sence d6ni6 aux officiants
vivants du mystdre; Ieur examen clinique n'est pas ce vrai regard sur Ie corps, matidre
e/ sensation, que suscite Brakhage grAce d un filmage organique, n organique parce
c4u'index,i non pas sur des uoyances mais sur les battements physiologiclues de son
caur et de ses yeuxl ,.
L'essai documentaire procdde par gradation, selon les 6tapes successives de
l'autopsie et ie caractdre progressif des nouveaux 6tats impos6s d i'organisme :
6piderme et tissus graisseux du thorax incis6s, puis thorax ouvert, enfin thorax
creus6 de ses organes; cuir chevelu d6coup6 au niveau du cou, puis litt6ralement
pei6, retrouss6 avec ses cheveux jusqu'iL venir masquer le visage, d6nudant la boite
crAnienne qu'on tr6pane aussitdt. L'6motion monte peu ir peu et culmine dans un
montage de plus en plus instable, alternant le flou et le net, les bribes identifiables et
1. Nicole Brenez, " Dream Instruction",Cahiers du cindma, n" 578, avril 2003, p. 50. 111-t
les effets de couleur. Le regard se laisse enfin alier, se d6bride, et regoit Ia pleineport6e de ce qu'i] a vu. I1 y a bien en effet deux 6tapes du regard, d,abord successives.puis qui alterneront plus intimement dans Ia seconde moitie du film. Ii s,ag:t d,abordde pr6senter objectivement, ce qui implique une certaine dissociation de la vision,qui voit mais sans forc6ment se formuier ce qui est vu, seul m,yen sans doute de]utter contre le d6goiit, I'horreur, Ia fuite. Brakhage montre, s,approche. caresse duregard, en restant au stade de la vision c,mme enregistrement physiorogique. Laseconde 6tape du regard vient a force de saturation * et c,est .. puruug. que lesl6gistes ne franchissent pas, parce qu'eux doivent 6raborer d partir de ces corps unsavoir, afin de leur faire justice, et non une 6motion. Le film se cl6t d,aijleurs dansune salle d'une blancheur quasi immacul6e, sur des plans d,un m6decin dont on voitle visage. qui dicte des concrusions inaudibles d un magn6tophone : le savoir a eulieu, mais le film en est coup6.
Et le sang dans tout ga? Ir n'apparait d'abord que de manidre fugace, avant m6meles incisions, iongue trace laissde par une t6te lorsqu,on la souldve.-on verra ensuitele sang d'une ponction effectu6e dans le torse d,un vieillard, sang sombre canalis6par le tube de ia seringue qui 6vite l'6coulement, et fait simplement tache de couleur.Les corps sont alors de prus en prus marbr6s de rouge, reurs v6tements souil6s desang, et leur ouverture murtiprie ensuite ies couleurs du sang. matit6, brilance,valeurs'.. commence ainsi d proprement parrer i'6tude.n ro.,lu - terme picturalqui ne suggdre aucune esth6tisation, mais dit simplement une nouvelle disjonctionentre couleur et matidre, disjonction qui d6prace le regard des corps morts vers ressensatious color6es' Le noir et blanc du Song des bltes laissait .n uff.t Franju librede travailler les images du sang en gicl6es ,iorentes et nappes 1iquides, insistant surie sang c.mme flux bouillonnant. En revanche, face d la frontalit6 du rouge sang,Brakhage ren.nce d la matidre, avec sa part intrinsdque de pr6sence r6elle, au profitde la seule couleur.
Le rouge est partout diffus, au hasard d'un acte de d6coupage, de ra rencontred'organes plus ou moins irrigu6s, et se compose avec les autres couleurs, marr.nsombre, blanc grisatre, accentuees par l'impression un peu sale et trembi6e des cou-ieurs de la pellicule. II se passe un ph6nombne d,6change ou de contamination assezsemblable d celui qui instaurait, dans Le sang des bdtus, une espdce de r6versionimaginaire entre le sang forc6ment noir et i'ensemble du noir et blanc du film. Toutesles teintes rougeatres finissent par connoter ce sang dont on ne voit pas 1,6couiement,la matidre, mais qui est surtout trait6 comme une coloration. Au point que Ie milieudu fiim comporte des plans uniform6ment teint6s de rouge, nimb6s d,une lumidre desang, au moment or) certains corps autopsi6s sont remis6s dans une r6serve sombre :
aucun filtre appos6 sur le r6el ne pourrait produire cet effet profond6ment fantasma_tique de submersion totale dans le sang. L'6tude en r.uge de Brakhage ne c,nsacredonc pas l'6loignement du r6el, mais simpiement sa saisie 6motive, son u ing6nsgi.rloptique '. Il ne s'agit plus c.mme chez Franju de d6voiler I'envers des images aumoment m6me oi elles sont montr6es, mais de reconnaitre les effets produits sur ie
rh
-112
.-,::.
i-
:_
c,rps mome du firmeur par cette exp6rience extr6me, ce contact prolong6 avec le sangqui r6ussit d tracer une autre voie dans le film.
Abattoirs : le sang couleur mentale
En 1986, un an avant Abattoirs, Thierry Ifuauff a r6aiis6 Le sphinx.ce premiercourt m6trage inaugure un dispositif qui disjoint l,image .t l. ,o;;l;; photographiespaisibles de promeneurs autour d'une statue de sphinx dan" r, 0"., a. Bruxeres et.e texte de " Quatre heures a chat,a ' de Jean Genet, description ciinique de cadavres,libanais et parestiniens, " nolrs et gonflesl ,, rue d,une voix bianche. La viorenced'Abattoirs, son r6aiisme stylis6 et giacant, se souviennent autant de Franju que deGenet' pour son deuxieme film, Thlrry rrrrn a hava,16 a raii. a. ptu^ tourn6sdans un v6ritabre abattoir, et d partir de crich6s en noir .t biu.,. au photographeMarc Trivier. Le documentariste [erge a simprement refi1m6 res photos au banc_titreen leur imprimant parfois des mou'ements panoramiques 0u de l6gers travelrings.Malgr6 ces nombreux plals flxes, et le peu d.- ^rrrun,.rt a .i,t6rieur du champ, refilm n'est pourtant jamais statique .,u. .*, onze minutes mettent en place un trdsriche espace s,n,re, tout entier ouvert sur ra suggestion et l,imaginaire.
Par un paradoxe qui n'est qu'apparent. Abattoirsest ainsi encore plus dur a soutenirdu regard, bien qu'il ne montre aucune mise d mort, aucune goutte de sang. La viorenceest d'abord imputable au format carr6 du fi1m, asse, inhabituer au cin6ma, et quiproduit des images trds resserr6es, oi |ceil peut tout embrasser d,un seur coup, et setrouve assailii sans possibilit6 de repli. L,i,nugu est d,une nettet6 chirurgicale. safinesse de grain donne en gros plan l'impression de pouvoir v6ritabrement toucher resb6tes du regard, et cr6e imm6diatemeri ,, .uooort 6motionner avec ies victimes. Encela, le film pousse au bout Ia logique ,ubu...iu. du sozg des bates dont le c.mmen_taire esquissait vers la fin des .uip.o.h.*ents anthropomorphiques : n Les o,utreslmoutons] suiuent comme des hommes, rts betnni comme chantent res otages, en sachantque cela ne sert a rien- ' L'image transforme les grands yeux insondables et confiantsdes b6tes promises d ra mort en regards frontaux qui interpellent re spectateur. Ladialectique du fixe et de 1'anim6, qui est ,;;.";, m6me du dispositif, permet d,isoreret de faire durer certaines images, immobiles, de res ancrer dans ia conscience duspectateur comme autant de coups et d,empreintes.Abattoirs ddrdgue donc ihorreur du visibie Jtu tuna.-ron, en reprenant notammentle leitmotiv du sifflement, dont les o tueurs ,, ,rrornprgnuient leur sale boulot dansLe sang des batus. Mais la distanciation i.onfiru de Franju a disparu, puisque res,n' n,n assignable d un ouvrier en particulier, en devient glagant. Les hommes nesont en effet.iamais montr6s, sinon reurs pieds seurs 0u, c.mme le boucher, cadr6 descuisses aux 6pauies dans un tabrie*ouiilo, pour mettre en vareur le long couteau
rc)n
tl-D
f,l
-q
1. Jean Genet. tr'Ennemi dicla16. Textes et entretiens, Gallimard, 19g1. p. 40g. 113-t
pendu d la ceinture. Comme dans le cas du cheval chez Franju, le veau et le spectateur
sont tous deux saisis par surprise au d6but du film. L'image originelle est un trdsgros plan frontal d'un veau, dont on voit une partie de la tdte et surtout, au centre duplan, l'eil gauche qui regarde. Un sifflotement d'homme, suivi d'un coup mat et dur.Le veau tombe brusquement, chass6 si vite par le titre sur fond noir que s'amorce
seulement le mouvement lourd de la chute, sa rapidit6 et sa violence. L'6pure de ce
d6but en forme de coup de poing emp6che d6sormais d'habiller de pudiques pr6textes
la mort des b6tes, rapide parce que moins douloureuse - non qu'ils ne soient pas
wais, mais parce que la rh6torique du film les a invalid6s dans le corps m6me du
spectateur, qui en a ressenti toute la brutalit6.La suite du film alterne comme en des mouvements de diastole et systole les
images-chocs (des carcasses pendues, des entrailles entass6es jusqu'h remplir lecadre,..) et les respirations vers l'ailleurs (les oiseaux, le petit chat noir en planmoyen qui arrive miraculeusement d entrer dans un des bAtiments de l'abattoir en
sautant dans le minuscule trou d'une vitre). Alternance aussi des plans trds sombres
et des plans lumineux avec, par exemple, un zoom avant sur le bAtiment qui permet,
au fur et i mesure de l'avanc6e yers une petite porte sombre, de faire coincider le
cadre entier avec cette bouche d'ombre, 6cran du cauchemar, v6ritable trou noir oi ne
retentit plus que le cri d'un cochon qu'on 6gorge. Toutes ces alternances, ainsi qu'ununivers sonore en prise directe avec l'imaginaire, cr6ent un effet particulier d'immi-nence de la terreur qui suscite ses propres images. Franju u retourne le regard comme
on retourne un. gant. Il I'aiguise conlnle le boucher son couteau ou le chirurgien son
scalpel, et son aiguisoir c'est le fantastique, enuisagd non comnle ffit, surimpression,
mais comme l'impression mAme de la trame du rdelL,. Le court m6trage de ThierryI{nauff prend manifestement acte de la tentative du Song des bAtes en l'amplifiant,en travaillant des images du sang qui ne sont m6me plus montr6es, mais fantasm6espar le spectateur.
Certains plans interrogent ainsi les seuils du visible et du dicible : que voit-on exac-
tement dans l'image, comment Ie qualifier? Ainsi de cette 6nigmatique res extensa,
oblongue et grise, trbs vite chass6e par le fondu au noir qui rythme comme des batte-ments de ccur Ie d6filement de ces images u inwes , : forme certainement organique,mais d6jh au-deld de la reconnaissance certaine et de la d6nomination, coup denvoid'un processus de projection fantasmatique de lhorreur. L'incertitude des formes et
l'atmosphdre de menace obligent sans cesse d formuler l'hypothdse du pire. Dans
Abattoirs,le mouvement toujours retenu, mesur6, compt6, ne permet pas Ie bercement
brakhagien qui restait dans ltnconscient optique en degd des mots, mais oblige d se
poser sans cesse la question du r6f6rent de ces images. On voit, mais on ne sait pas
toujours ce qu'on voit; et c'est dans ce seuil de la visibilit6 que r6side la port6e critiquedu film, dans ce basculement vertigineux de la beaut6 vue d l'horreur innommable.
fr 1. Frangois Niney, Z?preuue du rdel d l'6cran. Essol sur le principe de ridlitd documentaire, Bruxelles,
-
II4 De BoeckUniversit6s, 2000, p, 108.
Le fllm instaure un parcours de ces images-limites qui culmine h Ia fin, d6multi-pli6 par I'accumulation pr6c6dente, dans l'enchainement des derniers pians. Le cadre
est entidrement rempli par 1e gros plan d'un mur blanc orn6 de coul6es sombres,
non pas lin6aires et harmonieuses, mais manifestement projet6es par petits jets et
dessinant autant de courts segments noirs. Suivent, mont6s cut, dix autres plans
repr6sentant ia m6me c/zose sous diff6rents aspects, plans plus rapproch6s. plans
caress6s par un lent panoramique verticai de haut en bas (et inversement) puis
flous, ou en plus grandes cou16es. Au septidme plan de cette s6rie on entend des
gouttes tomber une i une; la dernidre image 6largit enfin le cadre. exhibe le mursouiil6, avant qu'un z00m n'engouffre le regard au cceur de ces gicl6es, coulures,
6claboussures.
Qu'a-t-on vu? Sans doute plus qu'un simpie hornmage d Jackson Pollock, p1ut6t
un dispositif proche de celui du test de Rorschach : c'est bien du sang qu'on est
incit6 d voir, m6me si c'est uniquement sous forme de traces noires, d'indices coup6s
de leur origine. Dans ia logique esth6tique de suspicion d laquelle il est soumis, ie
spectateur est forc6 de projeter sur ce mur les derniers vestiges clu sang des b6tes.
M6tamorphose de l'horreur, dont les coul6es sont f indice, vers une forme de beaut6
abstraite de Ia trace fantasmatique. Le dernier plan dAboflolrs fonctionne luiaussi sur ce mode mental : il s'agit du plan large d'une salle trds sombre ot se
balance lentement, pendue, une simple silhouette, non pas animale, mais allong6e
comme un mannequin, un contrepoids 0u... un homme? El1e est berc6e par ies
grincements lancinants d'une corde. La lumiere lat6ra1e illumine peu d peu lascdne, blanchissant et estompant des conlours dejd indiscernables en une espbce
de fondu au blanc - qui devient ainsi 1'6cran de projection d'une compensation
hallucinatoire oi ce sont enfin 1es bourreaux que I'on pend. Nul savoif ici, mais
simplement une exp6rience vecue, sentie : 0n peut donc voir dans ce dernier pian1'apog6e d'un systbme de repr6sentation qui, non content d'avoir compris Ia partforc6ment imaginaire des images du sang, Ia retourne contre ceux-ld meme qui leversent r6e1lement.
Cette . fausse , trilogre propose une trajectoire constante du r6e1 vers des fantasma-
tiques du sang. Dans les images du sang, en noir et blanc ou en corileurs, 1e specta-
teur est toujours aux prises ar,ec cette diaiectique de distance et d'absorption qui est
le propre de Ia fascination. Le sang, m6me trait6 en nappes de matibre, en brumes de
couieur, ou en drippings sur la surface blanche d'un mur, ne fait pas qu'euvre d'art,en d6pit de la sombre beaut6 formelle des trois fiims. 11 est aussi le signe ent6tantde ia douleur des 6tres, r6e11e ou bien projet6e par l'homme qui regarde, et dont laposition est paradoxale, puisqrlil n'a m6me pas la justification de I'6quarrisseur qui
ouvre les corps p0ur les donner a manger, ou du iegiste qui veut trouver les raisons
d'une mort. Le spectateur ne regarde ici que pour voir. Dans 1es images du sang, il n'ya pas cet enchainement normal du voir au savoir qui a 6t6 1a conqu6te de la cliniqueselon Michel Foucault, ce ( possog,e, exhatLstif et san.s rdsicLu, de lo totalit6 du visible 115-il
d lo structure d'ensemble de I'6nongable 1 ". Naissance de la clinique montre combien
la connaissance de Ia maladie d6pendait de Ia fagon de regarder et de dire Ie corps
du patient. L'ouverture des corps humains d seule fln de voir a 6t6 l'une des 6tapes
cruciales dans Ia g6n6alogie de la connaissance, pour qu'enfin cessent ]es fantasmes
enfouis dans " l'enuers noir du corps que tapissent de longs rAues sans yeux2 ,. Lesimages du sang ressaisissent pr6cis6ment cette part fantasmatique qui ne permet
pas Ie savoir : 1es trois fllms montrent f impossibilit6 d'un regard vierge sur le sang
r6e1. A cause des osciilations constantes de Ia repr6sentation (du d6r6alis6 au r6el, de
1a simple viande aux animaux anthropomorphis6s, des corps creus6s au trop-pleinsensible), 1e regard ne cesse de pivoter et de glisser autour du sang montr6. Les
images cin6matographiques du sang ne peuvent 6tre de vrais objets de savoir, car
leur vision renverse tout propos, volont6 apolog6tique ou critique radicale. L'ultimesubversion du sang, ce serait donc finalement de r6sister d tout traitement d6sireux,par un regard clair - lumidre grise de Franju, vision frontale de Brakhage ou fixit6chez Klauff- de n chasser Les oppressions de la nuit ), comme dans cet autre fiim du
sang fantasmatique qu'est le l,{osferatu de Murnau (1921).
1. Michel Foucault, Noissance de la clinique.
1963, p. 114.
2. Ibid., prdface, p. VII.fr-no
Une archiologie du regard mddical, PUF, coll. . Quadrige '