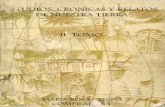F. Gherchanoc, « Maquillage et identité : du visage au masque, de la décence à l’outrage, de...
-
Upload
cnrs-bellevue -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of F. Gherchanoc, « Maquillage et identité : du visage au masque, de la décence à l’outrage, de...
23
Maquillage et identité : du visage au masque,de la décence à l’outrage, de la parure à l’artifice1
Florence Gherchanoc
Université Paris Diderot-Paris 7/IUF, ANHIMA – UMR 8210
Le visage dit et constitue l’identité d’une personne. Il est, avec le corps – qu’il soit nu ou vêtu –, « ce qu’on présente à la vue », le « visible »2, « ce qui transparaît de chacun […] sur sa face, ce qui l’identifie et le fait reconnaître dès lors qu’il est présent au regard d’autrui »3. Or le maquillage4, comme parure, introduit un élément nouveau et artificiel dans l’apparence (eidos) d’un individu suivant une gamme chromatique qui peut sembler assez simple : du blanc (psimuthion ou céruse) pour le teint, du rouge pour les joues et les lèvres (phukos, anchousa ou orcanète et miltos, de l’ocre rouge) et du noir de fumée (asbôlê) pour les yeux5.
1. Je remercie Adeline Grand-Clément pour nos échanges et une collaboration, dans le cadre du séminaire « Logiques de genre dans l’Antiquité gréco-romaine » (épineuil, 16-18 septembre 2010), qui m’ont permis d’enrichir ce texte.Sauf indication contraire, le texte suivi et les traductions adoptées sont ceux de la « Collection des Universités de France » (citée CUF) publiée sous le patronage de l’Association Guillaume Budé aux éditions Les Belles Lettres (Paris) quand ils existent et à défaut ceux de la « Loeb Classical Library » (citée LCL) éditée par William Heinemann Ltd (Londres) et Harvard University Press (Cambridge, Massachusetts).2. Voir F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, Paris, 1995, p. 19-20.3. J.-P. Vernant, « Le corps divin », dans L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, Paris, 1989, p. 12.4. J’entends par « maquillage » – terme qui apparaît en français en 1628 – une substance, pigments végétaux et cosmétiques gras (huile, baume, onguent), qu’on applique et appose sur la peau pour l’habiller et parer ainsi visage et corps. Dans le cadre imparti à cet article, je ne considérerai généralement que son application sur le visage.5. Sur ces substances colorantes, voir notamment T. L. Shear, « Psimythion », dans E. Capps, J. T. Allen, S. E. Bassett (éd.), Classical Studies Presented to Edward Capps, Princeton, 1936, p. 314-317 ; F. T. Walton, « My Lady’s Toilet », G & R, 15/44, 1946, p. 68-73 ; R. J. Forbes, « Cosmetics and Perfumes in Antiquity », dans Studies in Ancient Technology, vol. 3, Leyde, 1955,
Florence Gherchanoc
24
Il est un marqueur qui souligne en les accentuant ou modifiant les caractères qui définissent un être et ses qualités intrinsèques ; il révèle ainsi la nature des individus. Il est, dans certains cas, mélioratif, un moyen d’embellissement et crée un masque de beauté. Mais il agit aussi comme un attribut résolument négatif – un subterfuge – qui déconsidère celles et ceux qui en usent et s’en parent. Dès lors, des pratiques aux discours, que nous apprennent les fards sur les normes culturelles des Grecs ? Autrement dit, comment agissent-ils sur le statut des personnes en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur place dans les sociétés grecques anciennes ?
Des fards pour être belle : un masque de beauté
Comme le note F. Frontisi-Ducroux, « la beauté masculine est corporelle, la beauté féminine réside dans le vêtement et se résume à son visage, sinon à sa chevelure »6. Signes visibles, ces éléments de la parure sont offerts en spectacle dans des contextes variés. En particulier, les filles et les femmes se préoccupent de leurs atours pour séduire les hommes et, en contexte rituel, intercéder auprès des dieux. Dans ces circonstances, quelle place fards et cosmétiques gras occupent-ils ?
Dans l’épopée, le maquillage embellit. Il est notamment préconisé pour effacer la métamorphose qu’a opérée la tristesse sur les traits de Pénélope depuis l’absence d’Ulysse. Aussi, pour que la reine d’Ithaque se présente au mieux de sa personne devant les prétendants et parle à son fils – « pour attiser leurs cœurs et redoubler l’estime que lui vouaient déjà son fils et son mari »7 –, Eurynomê lui conseille-t-elle de se maquiller : « Mais baigne ton visage et farde-toi les joues (chrôt’aponipsamenê kai epichrisasa pareias) ; ne descends pas ainsi les traits bouffis de larmes »8. Le verbe epichriô signifie « s’oindre ». Il n’indique pas une couleur ni un produit particulier. La substance huileuse devrait rendre à la reine sa beauté radieuse (aglaiê) perdue depuis le départ de son époux9. Aussi Athéna agit-elle sur son esprit (periphron) et, à l’instar de la Pandora d’Hésiode, la prépare-t-elle et l’apprête-t-elle elle-même comme si l’épouse d’Ulysse était une jeune fille nubile : « elle lava (kathêren) d’abord son beau visage (prosôpata kala) avec cette essence divine (ambrosios), dont se sert Kythérée à la belle couronne avant d’entrer au
en particulier p. 38-49 ; B. Grillet, Les femmes et les fards dans l’Antiquité grecque, Lyon, 1975, p. 29-50 ; P. A. Hannah, « The Cosmetic Use of Red Ochre (Miltos) », dans L. Cleland, K. Stears (éd.), Colour in the Ancient Mediterranean World, Oxford, 2004, p. 100-105 ; é. Prioux, « Fards et cosmétiques dans les sources littéraires », P. Walter et al., « Les matières de la beauté » et P. Walter, E. Van Elslande, « Les analyses chimiques des fards », dans Le bain et le miroir. Soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, 2009, respectivement p. 35-40, 41-46 et 126-141.6. F. Frontisi-Ducroux, « Idéaux féminins : le cas de la Grèce ancienne », Topique, 82, 2003, p. 117.7. Homère, Odyssée, XVIII, 157.8. Ibid., 173 ; cf. aussi 178-179 : « ton amour me conseille de baigner mon visage !... et de farder mes joues (chrôt’aponiptesthai kai epichriesthai aloiphê) ».9. Cf. ibid., 180-181.
Maquillage et identité
25
chœur des aimables Charites, lui donnant la blancheur de l’ivoire scié »10. Seule l’action d’une divinité est susceptible de restaurer la grâce perdue de Pénélope et de maquiller ainsi cette dernière en « femme divine (dia gunaikôn) »11, en numphê au teint blanc et éclatant pour laquelle les prétendants vont rivaliser12. Il s’agit d’en faire un objet de désir, comparable en ce sens à un agalma, une statue cultuelle13. L’ambroisie agit comme un fond de teint et dissimule ainsi aux yeux d’autrui la perte de sa valeur (aretê), de son allure (eidos) et de la stature de son corps (demas), ravies par les dieux14. Elle constitue une sorte de masque de beauté, mais qui est conforme à la personne de la reine. Néanmoins, plus qu’à une épouse fidèle, la blancheur lumineuse de ses joues apparente cette dernière à une numphê pleine de charis ou dit en elle la numphê au sommet de sa beauté en vue de (ou au jour de) ses noces15. Parée de la sorte et seule devant les prétendants, Pénélope perd pour ainsi dire son statut d’épouse d’Ulysse. Elle re-devient une jeune fille bonne à marier qui, en raison de la situation atypique, a honte (aideomai)16.
Les fards, en effet, rehaussent la beauté de celles qui vont être données en mariage mais aussi de celles qui offrent le spectacle de leur jeunesse pour satisfaire les dieux durant les fêtes de la cité. Ainsi, les jeunes filles pro gamou (nubiles) choisies pour rendre hommage aux divinités dans les grandes processions de la cité comme celle des Panathénées à Athènes sont belles à voir et admirables. Leur âge et leur statut leur permettent et les obligent à se parer joliment de beaux vêtements, de bijoux et à se maquiller le visage de blanc en vue de parfaire leur carnation17. Aussi, dans un registre comique, Chrémès, alors qu’il inventorie
10. Ibid., 192-196.11. Ibid., 208.12. Cf. ibid., 276 sq.13. Lire A. Grand-Clément, Histoire du paysage sensible des Grecs à l’époque archaïque : le problème des couleurs, Thèse de doctorat de l’Université Toulouse-Le Mirail, 2006, p. 368 et 372, à paraître sous le titre La fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens (viiie-début du ve s. av. n. è.), Paris, 2011 chez De Boccard.14. Cf. Homère, Odyssée, XVIII, 251-252.15. Dans le même ordre d’idées, Héra redevient d’une certaine façon « vierge », précisément numphê, quand elle se pare pour séduire Zeus. Elle efface (kathêren) de son corps désirable toutes les souillures (lumata) puis y applique des onguents – « une huile grasse, divine et suave » (cf. Homère, Iliade XIV, 171-172) –, qui renforcent son éclat divin naturel, avant de revêtir d’autres parures. Aphrodite agit en ce sens sur son corps en vue de plaire à Anchise, tout en prenant l’apparence et la taille d’une « vierge ignorante du joug (parthenos admêtê) » (Hymne homérique à Aphrodite I, 82) : « les Charites la baignèrent, et la frottèrent avec l’huile immortelle […] » (Ibid., 61-62). De fait, s’oindre le corps d’huile grasse semble constituer une activité typique de la jeune fille nubile « à la peau délicate (hapalochroos), qui reste à l’intérieur de la maison, aux côtés de sa tendre mère, encore ignorante des travaux d’Aphrodite d’or » (cf. Hésiode, Les travaux et les jours, 519-523).16. Cf. Homère, Odyssée, XVIII, 184.17. Les canéphores sont « ‘belles’ et blanches ». Il pourrait s’agir d’un blanc rituel et par conséquent d’un masque de beauté rituel, un élément du costume de la canéphore : voir P. Brulé, La fille d’Athènes. La religion des filles à Athènes à l’époque classique. Mythes, cultes et société, Paris, 1987, p. 301-302. Sur un autre élément de sa mise : L. J. Roccos, « The Kanephoros and her Festival Mantle in Greek Art », AJA, 99, 1995, p. 641-666.
Florence Gherchanoc
26
ses biens, compare-t-il son plus joli meuble, le bluteau, un tamis à farine, à une canéphore qui aurait blanchi ses joues de poudre et prendrait la tête de la procession qu’il figure : « tu feras la canéphore, poudrée (entetrimmenê) pour avoir retourné tant de sacs de farine »18.
Le maquillage fait également partie de la toilette des femmes, épouses de citoyens, et de l’attirail de toute bonne séductrice, aux côtés des vêtements légers et colorés et des chaussures. D’ailleurs, le jour de leurs noces, on transporte avec les épousées des boîtes à maquillage (pyxides et lekanides)19. Numphai puis épouses, les filles passent du temps devant le miroir à appliquer des onguents et à apposer des couleurs qui agrémentent leur visage, soulignent et accentuent leur beauté. Cette activité typiquement féminine est souvent source de railleries, notamment dans les comédies. Ainsi, dans Lysistrata d’Aristophane, alors qu’il est question pour les épouses de citoyens de sauver la Grèce, Cléonice explique qu’en raison de leurs occupations habituelles, cela semble bien difficile : « Et que veux-tu que des femmes fassent de sensé ou d’éclatant (phronimon ê lampron), quand nous vivons assises avec notre fard (exênthismenai), nos tuniques safranées sur le dos, bien attifées avec des cimbériques tombant droit et des péribarides ? »20. Ces femmes ont en effet des occupations futiles assises devant leur miroir, tandis que leurs maris par leurs actes – des faits physiques et militaires – sont dignes de kleos (renom et gloire). Les premières font la guerre, pour elles-mêmes, avec leurs parures, et exercent leurs charmes sur leurs époux ; les seconds défendent, pour le bien commun, leur cité par les armes. Pour ces femmes, les parures – et non les actes – sont éclatantes de beauté et constituent les accessoires d’une guerre « domestique ». Aussi la séduction est-elle bel et bien une forme de combat dont Lysistrata entend user contre les hommes pour favoriser un retour rapide à la paix. Son idée est de susciter un puissant désir chez ces derniers tout en se refusant à eux : « Tout à fait, par les deux déesses. Car si nous nous tenions chez nous (endon), fardées (entetrimmenai), et si dans nos petites tuniques d’Amorgos nous entrions nues, le delta épilé, et quand nos maris en érection brûleraient de nous étreindre, si nous alors, au lieu de les accueillir, nous nous refusions, ils feraient bientôt la paix, j’en suis sûre »21. Ici, le maquillage figure comme outil de séduction et de
18. Aristophane, Assemblée des femmes, 732.19. Sur ces vases et leur contenu, comme les pastilles de pigments blancs, pigments rouges et fard rose : P. Walter, E. Van Elslande, « Les analyses chimiques des fards », op. cit., p. 128-130. Sur leur transport pendant les cérémonies du mariage : F. Gherchanoc, « Des cadeaux pour numphai : dôra, anakaluptêria et epaulia », dans L. Bodiou, V. Mehl (éd.), La religion des femmes en Grèce ancienne. Mythes, cultes et société, Rennes, 2009, p. 219-220.20. Aristophane, Lysistrata, 44. Sur ces gestes très féminins, cf. aussi Antiphane, CAF II, n° 148, p. 232-233, apud Clément d’Alexandrie, Pédagogue, III, 2, 7 : « Elle va, elle revient sur ses pas, elle s’approche, elle s’en retourne, elle est là, la voici : elle se nettoie la peau (rhuptetai), elle s’enduit d’un onguent (proschrietai), elle se lave (smêtai), elle se peigne (ktenizet’), elle vient de faire un pas (ekbebêke), elle se frotte de fards (tribetai), elle se lave (loutai), elle se contemple (skopeitai), elle s’habille (stelletai), elle se parfume (murizetai), elle se pare (kosmeit’), elle se pommade (alephet’) […] ».21. Aristophane, Lysistrata, 148-154.
Maquillage et identité
27
ruse. Il est un des moyens préconisés par les épouses pour se rendre affriolantes alors qu’elles font la grève du sexe. Il doit agir comme un charme aux côtés des autres parures. Autrement dit, dans l’oikos et dans le cadre d’une relation maritale, le maquillage est bienvenu. Son usage est tout à fait licite22. Les femmes ont à se faire belles pour leurs maris23. Se maquiller le visage et une action sur le corps (épilation et port de petits chitones) rehaussent la beauté et constituent des instruments de séduction féminins. L’ensemble favorise la réunion des corps, en vue de perpétuer l’oikos et la cité par la procréation de futurs citoyens – autre façon, moins gratifiante mais utile, d’œuvrer pour le bien de la polis.
Associé à d’autres parures, le maquillage souligne et accentue les beaux traits et la brillance d’un visage, et donc embellit les jeunes filles et les femmes encore en âge de procréer. Les numphai et les épouses encore fécondes parent leur corps de beaux vêtements, soignent leur chevelure, portent de belles sandales et se fardent les joues – les premières parce qu’elles sont à l’acmé de leur vie, les secondes pour charmer leurs époux. Les jeunes filles, ainsi parées, dignes d’envie et désirables, s’exposent aux regards des hommes et des dieux ; les femmes mariées se rendent attrayantes pour leurs conjoints dans un contexte domestique et marital.
Les courtisanes doivent aussi être jolies et plaire à leurs partenaires. Le maquillage, pour elles, constitue un moyen pour être plus attirantes, car il parfait leur teint. Cette course à la beauté suscite parfois entre elles des rivalités et des moqueries, si l’on se fie à un dialogue fictif et comique d’Alciphron (iie-iiie siècles de notre ère) : « Lors des Halôa – nous étions toutes là, comme de juste, pour la fête de nuit –, j’ai été stupéfaite de l’arrogance d’Euxippê : elle s’est d’abord mise à glousser et à ricaner avec Mégara, montrant déjà ses mauvaises intentions, puis elle a chanté à pleine voix des couplets sur l’amant qui me délaisse. Ce n’est pas cela qui m’a fait le plus mal, mais ensuite, elle a eu l’audace de se moquer de mon rouge et de mon fard [incarnat] (to phukos kai ho paiderôs). J’ai pensé que ses affaires devaient aller bien mal pour qu’elle ne possède même pas un miroir car, si elle s’était vue, avec son teint vermillon (chroma sandarachês), elle ne m’aurait pas accusée d’être laide […] »24. La querelle a pour cadre une fête
22. S. Culpepper-Stroup, « Designing Women : Aristophanes’ Lysistrata and the “Hetairization” of the Greek Wife », Arethusa, 37, 2004, p. 37-73, y voit une « hétaïrisation » des épouses de citoyens.23. En revanche, hors de la maison et en dehors d’un lien marital, une telle attitude est condamnable comme le rappelle électre à Clytemnestre à propos d’une autre parure, la chevelure : « […] ton mari venait à peine de quitter le palais que déjà tu attifais devant un miroir les tresses de ta blonde chevelure. Or une épouse qui, en l’absence de son mari, se pare pour être belle au dehors (ek domon es kallos askei), raie-la du nombre des honnêtes femmes. Elle n’aurait nul besoin d’étaler à l’extérieur les attraits de son visage (euprepes phainein prosôpon), si elle ne cherchait pas à faire mal » (Euripide, Électre, 1070-1075).24. Alciphron, Lettres de pêcheurs, de paysans, de parasites et d’hétaïres, IV, 6 (traduction A.-M. Ozaman, « La roue à livres », Les Belles Lettres, Paris, 2004). Sur les Halôa : I. Patera, A. Zografou,
Florence Gherchanoc
28
nocturne féminine célébrée principalement en l’honneur de Déméter et Korê dans l’Athènes du ive siècle avant notre ère. Thaïs et Euxippê s’affrontent sur le thème de leurs atouts et armes de séduction. Les fards, en principe, devraient s’accorder parfaitement à leur teint pour les embellir au lieu de les rendre laides. Lié à la toilette et à la parure féminines, le miroir, avant les yeux d’autrui, est l’instrument indispensable à ces belles pour se bien maquiller, peigner, coiffer, parer de bijoux et enfin s’admirer25.
Utilisé avec justesse et mesure, dans des espaces appropriés, le maquillage, à l’instar d’autres parures, fait corps avec celles qui le revêtent comme une seconde peau. Si les filles, les épouses et les courtisanes sont belles, l’action des onguents et des fards sur leur peau sera positive. Par un effet de lissage notamment, ceux-ci les rendent encore plus radieuses, jolies et désirables. Ils contribuent au plaisir des sens, à l’attraction sexuelle, au mariage et à la réunion des corps – pour les premières en vue de procréer des enfants légitimes, pour les secondes en vue d’un plaisir exclusivement charnel. Avec les autres parures du corps, ils servent à parfaire une carnation et à plaire, mais à un âge, dans un domaine et pour un sexe donnés.
Du masque de beauté au masque mortuaire
Un usage contre-nature des fards ne procurera pas l’effet escompté. Le suggèrent, entre autres, les remarques qui courent notamment dans les comédies au sujet des vieilles femmes qui en usent. Au lieu d’améliorer ou de rehausser leur éclat, le maquillage les rend encore plus laides, repoussantes et indésirables mais surtout grotesques. En témoigne également le discrédit qui pèse sur les hommes qui utilisent du maquillage et se travestissent. Quand il ne répond pas aux normes attendues, l’usage des fards est dévalorisant.
Pour les vieilles, se farder est totalement déplacé. Sur une « vieille peau ridée », le maquillage enlaidit et surtout dénature car il est inapproprié. Comme le dit un personnage de comédie : « Si on lave cette céruse (to psimuthion), tu verras très manifestes les loques de son visage (tou prosôpou ta rhakê) »26. Le maquillage dissimule mais n’est plus ici une seconde peau ; il ne fait pas corps avec le visage. Il est de trop. C’est un masque « outrageusement » blanc comparable au « masque d’étoffe barbouillé de peinture, blanche, également, que porte l’acteur jouant la vieille. L’effet comique repose sur le parallélisme entre le plan de la fiction que construit le texte, et celui des réalités matérielles du spectacle, qui est soudain révélé, sans que le premier soit aboli »27. De plus, ces vieilles femmes ainsi fardées sont d’autant plus grotesques qu’elles essaient de plaire comme de jeunes et jolies
« Femmes à la fête des Haloâ : le secret de l’imaginaire », dans Festins de femmes. Clio. Histoire, femmes et sociétés, 14, 2001, p. 17-46.25. Lire F. Frontisi-Ducroux, J.-P. Vernant, Dans l’œil du miroir, Paris, 1997, p. 54-59 en particulier.26. Aristophane, Ploutos, 1064-1065.27. F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, op. cit., p. 49.
Maquillage et identité
29
courtisanes. Dans l’Assemblée des femmes d’Aristophane, l’une d’elles se demande « pourquoi les hommes ne sont […] pas arrivés [.] Il y a longtemps qu’il est l’heure. Et moi, plâtrée de céruse (katapeplasmenê psimuthiôi) et revêtue d’une crocote je me tiens là, oisive, fredonnant à part moi un air et folâtrant, pour pouvoir embrasser (perilaboim’) l’un d’eux au passage. Muses, ici, descendez sur mes lèvres, trouvez-moi quelque chansonnette dans le goût ionien »28. Le maquillage est un outil de la séduction qui s’exerce sur les hommes, mais ici d’une séduction décalée en raison de l’âge avancé de celle qui l’utilise. La vieille femme porte en effet les attributs de la numphê, de l’épouse ou de la courtisane : psimuthion, crocote et voix mélodieuse, en vue de jeux érotiques ; mais ces parures ne lui collent pas à la peau ; elles sont inadéquates et la vieille est ridicule. La poikilia, la bigarrure, qui rend en principe les filles et les femmes éclatantes de beauté, n’a pas l’effet escompté.
Finalement, sur ces vieilles femmes infécondes, les fards sont un signe de leur âge et de leur fin prochaine. La réplique qu’adresse une jeune fille à une vieille qui prétend encore charmer est à cet égard explicite : « De toi, vieille épilée ainsi et peinte (entetripsai), la mort a souci »29. Ces parures constituent un masque mortuaire. En se barbouillant le visage d’anchouse et de céruse (v. 928), cette femme âgée se dénature et ressemble sinon à une morte au mieux à un vieux singe – un animal qui, pour les Anciens, est grotesque et incarne la laideur30 : « Voici un fléau bien pire encore que l’autre ! Mais qu’est-ce que peut bien être, je vous prie, cette créature-là ? Une guenon toute enduite de céruse (pithêkos anapleôs psimuthiou), ou une vieille ressuscitée de chez les morts ? »31. Dans tous les cas, elle n’est plus elle-même. Ses atours et son comportement contredisent sa nature définie par des normes sociales et culturelles ; elle ne se conforme plus à la place et au rôle que ses congénères lui assignent. Le maquillage signe un échec car au lieu de rehausser la beauté il accentue la décrépitude de cette femme, comme le montre encore une épigramme attribuée à Lucien, un auteur de la fin du iie siècle de notre ère : « Tu te teins les cheveux, bon ! Mais, ta vieillesse, jamais tu ne pourras la teindre, comme les rides de tes joues, jamais tu ne les effaceras. Ainsi donc, ne va pas enduire de plâtre (kataplattein) tout ton visage. Pour finir, ce n’est plus un visage (prosôpon), mais un masque (prosôpeîon) ! Non, il n’y a plus rien à faire. Pourquoi persister dans cette folie ? Jamais le rouge, jamais la céruse (oupote phukos kai psimuthos) ne feront d’Hécube une Hélène ! »32. Le rouge (phukos), extrait d’algue marine, et le blanc de céruse constituent clairement un artifice, un subterfuge, mais de moindre efficacité que la teinture par exemple. Ils ne permettent pas de dissimuler harmonieusement et parfaitement les traits du visage ni les marques de l’âge quand la peau ne s’y prête plus. Aussi Hécube,
28. Aristophane, Assemblée des femmes, 877-883 (traduction H. Van Daele, CUF, modifiée).29. Ibid., 904-905.30. Cf. e. g. Platon, Hippias majeur, 289 a-b. Lire F. Lissarrague, « L’homme, le singe et le satyre », dans B. Cassin, J.-L. Labarrière (éd.), L’animal dans l’Antiquité, Paris, 1997, p. 458-459.31. Aristophane, Assemblée des femmes, 1068-1073.32. Anthologie palatine, XI, 408 (traduction R. Aubreton, CUF, modifiée).
Florence Gherchanoc
30
qui incarne une femme accomplie âgée, ne redeviendra-t-elle jamais une Hélène, autre figure paradigmatique de la numphê resplendissante. La vieillesse ne peut rivaliser avec la beauté naturelle de la jeunesse. Une autre épigramme satirique insiste de nouveau sur cette idée que rien, ni même le maquillage, n’est susceptible de redonner charme et éclat à celle que l’âge a flétri : « Tu peux bien sans arrêt maquiller tes joues décharnées, juste récompense de ton odyssée, ô Laodicée ! N’élargis pas le sourire de tes lèvres ; car, quel est celui qui, par une ruse maléfique (pharmakoeis dolos), rétablira les rangées de tes dents ? Tout ce charme s’en est allé, ce charme qui était le tien : elle n’est pas intarissable cette source dont ton corps tire son éclat. Ainsi que la rose tu t’épanouissais en ton printemps ; maintenant, c’est la fin : tu te flétris sous l’été brûlant de la vieillesse »33. Dans ce contexte, il est inepte, ridicule, infamant et contre-nature pour une vieille d’avoir recours à un masque comme les acteurs et surtout à des artifices comme les jeunes filles, ainsi que les épouses et les courtisanes encore fécondes et donc en âge de plaire et d’être sexuellement actives. C’est un signe d’hubris de vouloir dissimuler les traits de son visage à ce point. Ces vieilles femmes ont fait leur temps. Elles n’ont plus à séduire ni comme numphai ni comme épouses et encore moins comme courtisanes. Elles ne sont bonnes ni pour enfanter ni pour le sexe. Au mieux, ce maquillage qui recouvre leur visage est un masque qui annonce une mort imminente. Elles sont parées et fardées comme des cadavres. Dans ce cas, le maquillage devient un masque mortuaire.
Pour un homme, le maquillage est à la fois signe de truphê et d’un comportement politique indigne. Telle est, entre autres, la tradition relative à Démétrios de Phalère, ce philosophe au pouvoir, chef d’Athènes en 317 avant notre ère, connu par ailleurs pour l’établissement de lois somptuaires dont l’esprit est contraire à ses propres manières de vie :
« En fait, il surpassa les Macédoniens dans ses dépenses somptueuses lors des banquets, et dans son raffinement les Cypriotes et les Phéniciens ; des averses de parfum descendaient sur le sol et beaucoup de planchers dans les salles de banquet étaient décorés de fleurs artificielles merveilleusement ouvragées. Les rendez-vous avec les femmes se faisaient en secret, aussi bien que les amours nocturnes avec les jeunes gens et le Démétrios qui faisait des lois et régentait la conduite de vie pour les autres passait sa propre vie dans l’absence totale de loi. Il faisait aussi attention à son aspect extérieur (opsis), se teignant les cheveux en blond, s’enduisant le visage d’incarnat (paiderôti to prosôpon hupaleiphomenos) et s’oignant de surcroît d’autres onguents (tois allois aleimmasin egchriôn heauton) : il voulait avoir belle apparence, sembler gai (hilaros) et agréable (hêdus) à tous ceux qui le rencontraient. D’ailleurs, durant la procession des Dionysies, organisées sous son archontat, le chœur chanta des vers composés par Castorion de Soles dans lesquels on le salue comme un être de même forme que le soleil (heliomorphos) »34.
33. Ibid., XI, 374 (traduction R. Aubreton, CUF, modifiée).34. Douris apud Athénée, XII, 542 c-e (traduction Remacle modifiée).
Maquillage et identité
31
Outre la magnificence des banquets qu’il offre et un appétit sexuel conséquent pour les filles comme les garçons, ses atours et les soins qu’il apporte à sa personne révèlent aussi sa nature : son intempérance (akrasia)35 et sa licence (akolasia)36 ; ils définissent au demeurant son pouvoir et la façon dont il l’exerce. Coquet, Démétrios travaille sa brillance – celle de ses cheveux, de son visage et vraisemblablement de tout son corps –, au point d’être lumineux comme le soleil. Sa beauté éclatante dit son appétence et sa disponibilité sexuelle. Elle se veut aussi séductrice.
Le maquillage caractérise, enfin, la mollesse (truphê) et l’oisivité (rhathumia), en particulier dans l’exercice du pouvoir. Dans cette perspective, les fards, parfois, féminisent et « barbarisent ». à cet égard, le portrait de Sardanapale que brosse Diodore de Sicile, entre 60 et 30 avant notre ère, est tout aussi éloquent : « Sardanapale, trentième successeur de Ninos qui avait établi la domination assyrienne, dernier roi assyrien, surpassa tous ses prédécesseurs en matière de luxe et d’oisiveté (truphê kai rhathumia). Car non content d’être à l’abri du moindre regard extérieur, il vécut une vie efféminée (gunaikôdê) : partageant l’existence de ses concubines (pallakides), travaillant des tissus de pourpre et les laines les plus fines, il était habillé d’un vêtement de femme et son visage et tout son corps, par l’application de blanc de céruse et autres soins en usage chez les courtisanes, étaient devenus plus délicats (apalôteroi) que ceux d’une femme, quelle qu’elle fût, vouée aux plaisirs »37. Ce souverain est plus femme que femme en raison de l’espace dans lequel il s’exerce à des activités féminines (travail du textile et de la laine), de ses atours (vêtements ainsi qu’usage d’onguents et de fards) ; il devient finalement une « super » courtisane. Sa vêture caractérise la décadence d’un pouvoir barbare incarné par son chef, tout en mettant en exergue la truphê orientale38. Mais protégé du regard des hommes, Sardanapale n’a pas totalement perdu son identité. En revanche, s’exposer publiquement fardé, c’est se dénaturer. Aussi, dans son commentaire du Décalogue, alors qu’il évoque les pires maux des poleis et, parmi les unions infécondes, la pédérastie, Philon d’Alexandrie (ier siècle avant notre ère – ier siècle de notre ère), un philosophe juif hellénisé, explique-t-il que ceux qui s’accoutument à supporter une « maladie féminisante (nosos thêleia) », en devenant des êtres efféminés, ruinent leur âme et leur corps : « Mais, telle une bande avinée, un vice bien plus grand que celui dont je viens de parler à fait irruption dans les cités : c’est la pédérastie dont le nom même était réprouvé autrefois et dont se vantent aujourd’hui non seulement ses partisans actifs, mais également les partenaires passifs de ces derniers. Habitués à souffrir d’une maladie féminisante (nosos thêleia), ces personnages assistent à la dissolution de leur âme et de leur corps sans laisser couver sous la cendre le moindre tison de virilité (arrên genea). Quelle manière provocante de friser et d’ordonner leur chevelure,
35. Ibid.36. Cf. élien, Histoires Variées, IX, 9 sur le même thème.37. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, II, 23, 1. Cf. aussi Athénée, XII, 528 f.38. Sur cet aspect, lire les analyses de V. Azoulay & V. Sebillotte dans le présent volume.
Florence Gherchanoc
32
de se frotter (tribomenoi) et de se peindre (hupographomenoi) les visages (opseis) avec du blanc de céruse (psimmuthios), du fard rouge (phukos) et des produits similaires, d’enduire leurs lèvres d’huile aux parfums agréables […] Et ils ne rougissent pas de transformer par un comportement artificiel (technazontes) la nature mâle en la nature femelle »39. Ce texte a une portée morale très affirmée. Toutefois il traduit une réalité ancienne. En effet, depuis l’époque classique, prêter attention à soi et se maquiller, en particulier s’enduire de blanc de céruse comme seules les femmes le font, dévirilisent. Se travestir pour un homme, c’est précisément corrompre sa masculinité (la « race » masculine : arrên genea)40, altérer sa personne et perdre finalement son identité de mâle, de citoyen. Le rêve attribué par Plutarque à Alcibiade à la veille de sa mort est de ce point de vue exemplaire : « Lysandre envoya donc prier Pharnabaze d’exécuter cet ordre, et le satrape en chargea Bagaïos, son frère, et Sousamithrès, son oncle. Alcibiade se trouvait alors dans un village de Phrygie, où il vivait avec la courtisane Timandra, et où il eut en dormant la vision que voici : il se vit revêtu des habits de sa compagne, qui lui tenait la tête dans ses bras et lui enduisait de céruse (psimuthiousan) et lui fardait (hupographousan) le visage comme à une femme. D’autres disent qu’il vit dans son sommeil Bagaïos qui lui coupait la tête et brûlait son corps. Mais tous conviennent que le songe précéda de peu sa mort. […] Quand il fut ainsi tombé et que les barbares se furent retirés, Timandra recueillit son corps, et, l’ayant couvert et enveloppé de ses propres tuniques, elle lui fit avec ce qu’elle avait un enterrement brillant et magnifique »41. Dans sa vision, l’ancien stratège athénien est vêtu et maquillé – déguisé – comme une hétaïre. Cette féminisation est le signe annonciateur d’une déchéance politique42. Timandra en fait son double, un double à travers lequel, d’une certaine façon, elle se contemple elle-même. En outre, cette forme de travestissement, de mollesse et de féminité pour un homme adulte – en particulier pour des souverains – est propre aux barbares et à l’Orient43 où Alcibiade séjourne à la fin de sa vie. Enfin, les gestes exécutés par la courtisane ne sont pas sans rappeler aussi l’action des femmes sur un cadavre quand elles préparent le corps, le lavent, l’oignent et le revêtent de beaux atours. En ce sens, un tel rêve annonce la mort, mais une mort anormale comme l’est celle qui suit une amputation de la tête44. Autrement dit, se travestir c’est mourir
39. Philon d’Alexandrie, Lois spéciales, III, 37 (traduction A. Mosès, éditions du Cerf, Paris, 1970).40. Ibid.41. Plutarque, Alcibiade, XXXIX, 1-3.42. Lire P. Schmitt Pantel, « Mœurs et identité politique à Athènes au ve siècle : l’exemple des gouvernants d’après Plutarque », REA, 108, 2006/1, p. 94, sur « le passage du statut viril au statut de femme [comme] métaphore de la perte de tout droit politique » ; ead., « Genre et identité politique à Athènes au ve siècle à partir des Vies de Plutarque », dans V. Sébillotte Cuchet, N. Ernoult (éd.), Problèmes du genre en Grèce ancienne, Paris, 2007, p. 230.43. Cf. infra notes 66, 67 et 68.44. Sur la mort d’Alcibiade qui s’oppose à l’idéal de la belle mort grecque, lire P. Schmitt Pantel, « Mœurs et identité politique à Athènes au ve siècle : l’exemple des gouvernants d’après Plutarque », op. cit., p. 94.
Maquillage et identité
33
ou être travesti c’est être mort, comme le soulignent les vêtements féminins qui enveloppent la dépouille d’Alcibiade ainsi que le maquillage qui crée une sorte de masque mortuaire45.
Pour les vieilles femmes comme pour les hommes, le maquillage masque la véritable nature des individus, en même temps qu’il la révèle. Ceux-ci perdent un peu d’eux-mêmes. Ce masque dont ils se parent abolit et remplace dès lors leur vrai visage46 au point de leur conférer une nouvelle identité et ainsi d’annoncer une mort imminente sociale et/ou politique.
Maquillage et interdits rituels
Il est un bon et un mauvais usage des fards. En fonction de l’âge, du sexe des individus, des espaces et du contexte, il est approprié ou inapproprié de se parer des artifices de la beauté, notamment de se maquiller. Ainsi, lors du deuil d’un proche parent se farder est le signe d’une transgression, d’un outrage social et religieux, d’une absence de conformité aux usages. Le fard dénonce l’indécence et la séduction pervertie, autrement dit la femme adultère. Aussi le mari trompé, dans Sur le meurtre d’Eratosthène de Lysias, s’étonne-t-il de voir le visage de sa femme fardée de blanc de céruse (to prosôpon epsimuthiôsthai) « trente jours à peine après la mort de son frère »47, juste après la fin de la période de deuil à Athènes. Se maquiller et donc se faire belle ne sont pas de rigueur en une telle circonstance.
Des interdits portent plus précisément sur le maquillage lors de célébrations en l’honneur des dieux. Quelques lois sacrées réglementent les parures des fidèles et en témoignent. Les prescriptions concernent les modalités de fréquentation des sanctuaires. Le maquillage n’y figure jamais comme unique élément de la toilette. Ainsi, à Patrai, cité du nord-ouest du Péloponnèse, au iiie siècle avant notre ère, « […] pour les [Dê]mêtria que les fem[me]s ne portent ni or d’un poids supérieur à une obole, ni vêtement brodé, ni pourpre ; qu’elles ne se fardent pas avec de la pommade de céruse (metê psêmuthiousthai) et qu’elles ne jouent pas de flûte ; si l’une d’elles ne respecte pas ces prescriptions, que le sanctuaire soit purifié comme si la coupable avait commis une impiété »48. La cité exige des femmes l’absence de faste et une forme de dépouillement rituel. Néanmoins, parmi les signes visibles et manifestes de la beauté et de l’aristeia, entre toutes les parures, le maquillage – et seulement le psimuthion – n’est cité qu’après les bijoux en or, les vêtements et le pourpre. Il n’est qu’un élément singulier voire secondaire de la parure bigarrée des femmes. Le suggèrent des prescriptions somptuaires
45. Voir F. Gherchanoc, « Les atours féminins des hommes : quelques représentations du masculin-féminin dans le monde grec antique. Entre initiation, ruse, séduction et grotesque, surpuissance et déchéance », RH, CCCV/4, 2003, p. 739-791.46. Voir F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, op. cit., p. 40.47. Lysias, I, Sur le meurtre d’Ératosthène, 14.48. LSCGS, n° 33 A (traduction légèrement modifiée de B. Le Guen-Pollet, La vie religieuse dans le monde grec du ve au iiie siècle avant notre ère, Toulouse, 1991, n° 26, p. 82-83).
Florence Gherchanoc
34
comparables, propres au sanctuaire de Lycosoura en Arcadie et datées également du iiie siècle avant notre ère : « Sanctuaire de Despoina. Défense de pénétrer dans le sanctuaire de Despoina avec des bijoux d’or, sauf en vue de leur consécration, avec un vêtement teint de pourpre, ou fleuri, ou noir, avec des chaussures, avec une bague. Au cas où quelqu’un entrerait avec l’un des objets interdits par l’inscription, il devra en faire don au sanctuaire. Défense aussi d’avoir les cheveux tressés ou la tête voilée ; interdiction d’apporter des fleurs, interdiction aux femmes enceintes ou qui allaitent de se faire initier. Ceux qui offriront des sacrifices devront user à cet effet d’olivier, de myrte, de rayon de miel, d’orge mondé, de statue (sic), de pavots blancs, de lampes, de parfums à brûler, de myrrhe, d’aromates. Ceux qui sacrifieront à Despoina offriront des victimes femelles blanches… »49. La loi cultuelle insiste ici de nouveau sur le dénuement rituel des femmes qui participent aux mystères (l. 1-13). Mais le maquillage, un ajout sans doute moins visible, n’est pas évoqué. En revanche, en Messénie, à Andanie, dans le règlement des mystères en l’honneur notamment de Déméter, daté de 92/91 avant notre ère, les interdits relatifs au maquillage succèdent à des prescriptions somptuaires qui touchent les vêtements (leurs texture, couleur, décoration, nature et prix) portés par « ceux qui accomplissent les mystères » – et parmi eux précisément les femmes mariées (gunaikes), les adultes libres, les filles (paides) et les esclaves (doulai) –, puis durant la procession (pompê) par les hierai (femmes et filles) qui sont directement touchées par les clauses sur les fards : « Qu’aucune d’elles ne porte de (parure en) or (mêdemia chrusia), ni de fard rouge ou blanc de céruse (mêde phukos mêde psimithion), ni de bandeau (mêde anadema), ni de cheveux noués (mêde tas trichas anpeplegmenas), ni de sandales (mêde dêmata), si elles ne sont pas en feutre ou en cuir provenant d’animaux offerts en sacrifice aux dieux. […] Si l’une d’entre elles agit contrairement au règlement en ce qui concerne le vêtement ou quelque autre des interdits, que le gynéconome s’y oppose et qu’il lui soit permis d’arracher (l’objet) et qu’il soit consacré aux dieux »50. Après les vêtements, le visage et les pieds constituent les éléments visibles d’un corps enveloppé (non nu). Les interdits portent ainsi sur ce qui est susceptible d’embellir ces parties de l’anatomie et donc attirer le regard. Le maquillage comme une belle chevelure et le bandeau qui l’orne sont autant de parures du visage. En contexte rituel, celles-ci contredisent la simplicité et la retenue (aidôs) attendues des fidèles de la divinité. Se maquiller et prêter attention à ses cheveux, autrement dit prendre soin de son visage est un signe distinctif. Quant aux gynéconomes, leur rôle est de préserver l’eukosmia de la célébration : son bon déroulement (bon ordre) et la réussite du spectacle qu’elle offre (son bel ordonnancement et sa beauté ou parure). En
49. IG V 2, 514 ; LSCG, n° 68 (traduction de M. Jost, Sanctuaires et cultes d’Arcadie, Paris, 1985, p. 330). Cf., pour un parallèle, un règlement cultuel d’érésos en Arcadie daté du ve siècle avant notre ère et relatif à Déméter Thesmophoros : LSCGS, n° 32.50. IG IV, 1, 1390, l. 22-26. Pour la traduction et un commentaire global du règlement, lire N. Deshours, Les mystères d’Andania. Étude d’épigraphie et d’histoire religieuse, Paris/Bordeaux, 2006, en particulier p. 99-108.
Maquillage et identité
35
surveillant les tenues vestimentaires et autres parures, ces magistrats sont ainsi les garants de l’absence de manifestations de luxe en même temps que de la pureté rituelle ; en d’autres termes, ils veillent à l’eusebeia (piété)51. Pour N. Deshours, ce faisant, « les prescriptions vestimentaires du règlement reviennent à l’impératif pour les femmes hierai de porter une tenue correspondant à leur statut d’épouse de citoyen (cette exigence va donc dans le même sens que le serment qu’elles doivent prêter) »52.
Cette vision schématique est à nuancer. D’une part, les filles sont aussi concernées par les interdits. Certes leur destin est de devenir gunaikes, mais cela ne suffit pas à expliciter la prescription. D’autre part, si le maquillage est bien prohibé pour les femmes et filles de citoyens en contexte rituel, il l’est exclusivement dans des cultes en l’honneur de divinités féminines comme Déméter et Despoina. Cela suggère notamment que ces mêmes épouses et filles de citoyens dans d’autres situations se maquillent ! De surcroît, les lois se contentent d’interdire l’application de deux des matières (céruse – maquillage typique des femmes – seulement à Lycosoura et phukos et psimuthion à Andanie) les plus communes, ordinaires et usuelles parmi les fards. Enfin, au regard de l’ensemble des lois sacrées, les interdictions portent peu sur le maquillage – élément sans doute le moins éclatant et ostensible de la toilette féminine. à cet égard, il est remarquable et significatif également que les lois de contrôle social relatives aux femmes adultères et aux hommes suspectés d’être des courtisans ne mentionnent que rarement le maquillage parmi les signes distinctifs d’un tel état. Ainsi, une loi relative à la bonne conduite (eukosmia) des épouses et attribuée à l’illustre législateur athénien du vie siècle avant notre ère stipule que « Solon […] interdit toute parure (ouk kosmeisthai) à la femme qui a été surprise en adultère, il lui défend de s’associer aux cérémonies sacrées publiques, de peur qu’en ne se mêlant aux femmes honnêtes elle ne les corrompe. Si, en dépit de cette défense, elle prend part à ces cérémonies, ou revêt des parures (kosmêtai), il ordonne au premier qui la rencontrera de déchirer ses vêtements (katarregnunai ta himatia), de lui arracher ses ornements (ton kosmon aphairesthai) et de lui donner des coups en évitant toutefois de la faire mourir ou de l’estropier. Le législateur frappe ainsi cette femme d’une peine déshonorante et lui prépare une vie intolérable »53. La proscription des lieux publics, en particulier des sanctuaires, l’interdiction de participer aux fêtes de la cité, probablement à des cultes féminins, entre autres en l’honneur de Déméter, et la privation des marqueurs d’un statut social et religieux, celui d’épouses légitimes agissant pour le bon renouvellement de la polis, constituent les critères infamants de la peine. Ceux-ci stigmatisent celles qui ne se conforment pas, en raison de leur conduite, au respect des lois et à la bonne reproduction de l’oikos et plus largement du corps civique. Doit-on penser que ces femmes de citoyens ne se fardent pas le visage, ce qui justifierait l’absence
51. Voir D. Ogden, « Controlling Women’s Dress », dans L Llewellyn-Jones (éd.), Women’s Dress in the Ancient Greek World, Swansea, 2002, p. 203-225.52. N. Deshours, Les mystères d’Andania. Étude d’épigraphie et d’histoire religieuse, op. cit., p. 105.53. Eschine, Contre Timarque, I, 183.
Florence Gherchanoc
36
de mention relative au maquillage ou, plus vraisemblablement, que les fards sont des marqueurs mineurs des épouses légitimes de citoyens ? Dans le lot de parures féminines, le maquillage constitue sans doute un signe distinctif et un marqueur visuel plus discrets. L’atteste aussi une loi de Syracuse : « dans le livre XXV de ses Histoires, Phylarchos, nous apprend que, chez les Syracusains, il existait une loi qui interdisait à la femme de se parer de bijoux et d’or et de porter des robes chamarrées, ou tout autre vêtement bordé de pourpre, à moins d’admettre qu’elle était une vulgaire hétaïre ; ailleurs, il dit qu’il y avait une autre loi qui interdisait à un homme de se maquiller comme une coquette (kallôpizesthai) ou de revêtir un habit par trop raffiné (esthêti periergô), sauf s’il avouait être un homme adultère ou un débauché ; en outre, cette législation interdisait à une femme libre de prendre l’air après le coucher du soleil, car c’était la présomption d’une vie déréglée ; même dans la journée, elle ne pouvait sortir sans la permission des gynéconomes, et encore, accompagnée d’une servante »54. Comme parure du corps, les fards ne figurent pas parmi les signes les plus dépréciatifs, en particulier pour les femmes. Socialement, ils disqualifient moins parce qu’ils sont, sans doute, moins voyants que les bigarrures des vêtements et l’éclat de bijoux.
Les fards, entre ruse et artifice
Si l’on se fonde sur les lois, le maquillage constitue un élément de la toilette peu ostensible et peu ou pas réglementé. Néanmoins, les valeurs qui lui sont attachées changent en fonction du type de discours. Des textes, tout autant comiques que philosophiques et médicaux, critiquent, en effet, ceux qui l’utilisent et manipulent, en particulier, habilement les couleurs. Devenus instruments de rhétorique, les fards véhiculent une idéologie. Ils sont un des marqueurs pour classifier les individus et leur comportement, en fonction de leurs attributs, de leurs parures et précisément suivant l’usage qu’ils font et qu’ils ont ou non du maquillage, ainsi que pour jauger les sociétés grecques et barbares.
Les auteurs comiques sont les premiers à se moquer de celles qui se préoccupent de leur apparence et qui pour s’embellir et être attrayantes usent d’astuces en tous genres. Se maquiller, c’est se peindre ou se teindre le visage. Artifices inutiles, les fards disqualifient. Les cibles de ces sarcasmes sont les vieilles, on l’a vu, mais aussi des épouses dès lors comparées à des femmes adultères et à des hétaïres ou encore à de vulgaires prostituées, bref à des femmes aux mœurs légères. Ainsi, chez Alciphron, la femme qui ne s’occupe plus du lit conjugal (eunê) ni de ses enfants ni de sa vie champêtre, pour ne penser qu’à la ville est une épouse qui a perdu sa sôphrosunê (tempérance) et, en cela, est comparable aux filles de l’astu d’Athènes, plongées dans la truphê, avec leur visage recouvert de plâtre (to prosôpon epiplaston). Un maquillage outré – « Elles se barbouillent (deusopoiousi) les joues (tas pareias) avec plus de phukos, de psimuthion et d’incarnat (paiderôs) que nos peintres les plus habiles n’en utilisent » – dit leurs mœurs dépravées55. En effet,
54. Athénée, XII, 521 b.55. Cf. Alciphron, Lettres de pêcheurs, de paysans, de parasites et d’hétaïres, II, 8 [III, 12].
Maquillage et identité
37
ne s’occuper que de ses atours – autrement dit de choses frivoles et futiles – est principalement le propre des courtisanes. Par des subterfuges en tous genres, ce type de femme séduit en cachant ses défauts physiques et vit ainsi de ses faux charmes. Comme ironise Alexis à leur sujet, « pour commencer, par rapport au profit et au pillage de leur prochain, tout le reste est pour elles accessoire, et elles trament leur ruse contre tout le monde. Une fois qu’elles sont riches, elles prennent des novices qui font leur apprentissage du métier. Vite elles les remodèlent (anaplattousi), de sorte que ces filles, changeant de manières et d’extérieur, cessent de se ressembler. L’une est petite ? On lui coud du liège dans ses bottines. Elle est grande ? Elle porte une chaussure mince et ne sort que la tête penchée sur l’épaule. Cela lui enlève de la hauteur. Elle n’a pas de hanche ? Elle se coud sous les vêtements un postiche, si bien qu’en la voyant on s’exclame sur la splendeur de ses fesses. Elle a trop de ventre ? Pour celles-là il y a les (fausses) poitrines, de celles que portent les acteurs comiques ; en se mettant ce postiche bien droit, elles ramènent en avant grâce à lui le vêtement qui couvre leur estomac. Cette autre a les sourcils roux ? On lui peint au noir de fumée (asbolos). Y en a-t-il une qui a le teint trop mat ? Elle s’applique du blanc de céruse (psimuthios). Une autre a le teint trop blanc ? Elle se farde à l’incarnat (paiderôt’entribetai). Mais si quelqu’une a une partie bien faite, elle la montre à nu (gumnon). Elle a de belles dents ? Elle doit rire, c’est indispensable pour que la compagnie voit quelle jolie bouche elle a […] Et voilà par quels artifices (technai) elles se trafiquent (falsifient : skeuopoiousi) le portrait (l’apparence extérieure : opsis) ! »56. Usant d’un savoir faire précis de l’ordre de la mêtis, cette intelligence technique et rusée, les courtisanes se servent de procédés spécifiques pour dissimuler leurs défauts physiques : des chaussures à hauts talons, des postiches pour le corps et des fards pour le visage – comme en portent les acteurs. Par opposition à la beauté nue qui se montre sans artifice, le maquillage constitue un des moyens artificiels pour se parer – di’epitechnêseôs kommôseis – dans le cas présent, non pas pour rehausser sa beauté mais pour cacher des imperfections et améliorer un visage, suivant les normes données du beau. Transformant leur corps et leur visage, les courtisanes dissimulent leur vraie nature pour gagner leur vie et trompent leurs clients. De ce fait, une épouse de citoyens qui se sert de tels artifices devient en quelque sorte une hétaïre car « [leurs] femmes ne se barbouillent pas (ouchi peripeplasmenai) de céruse, ni ne s’enduisent (kechrimenai), comme [elles], les joues (gnathoi) de fard couleur mûre (sukaminos) […] »57. Le maquillage dénote ainsi l’indécence, au moins à partir du
56. Alexis, La juste mesure apud Athénée, XIII, 568 a-d. à titre de comparaison, sur l’opposition entre une femme sage et la façon dont elle rehausse sa beauté – « elle ajoute seulement à sa beauté ce que la bande de pourpre ajoute au vêtement » – et une courtisane « à l’affût des moyens de séduction » par « l’addition de charmes empruntés » comme l’or : cf. Lucien, La salle, VII. Ce « luxe » contrefait leur beauté.57. Euboulos, Les vendeuses de couronnes, CAF II, n° 98, p. 126-127 apud Athénée, XIII, 557 f. Cf. aussi Philippide, CAF III, n° 19, p. 1074-175 : « Tout le visage couvert de fards couleur mûre (sukaminoi) en guise de teinture rouge (phukos) ».
Florence Gherchanoc
38
ive siècle avant notre ère58. Il dit la mauvaise épouse, la femme de mauvaise vie et précisément la courtisane, mais surtout celle qui use d’une technê et d’un charme maléfiques. Ce topos comique est, en effet, toujours d’actualité au iie siècle de notre ère. Dans le Jugement des déesses de Lucien, Athéna reproche à Aphrodite de s’être présentée devant Pâris, pour le concours, embellie (kekallôpismenê) et toute fardée de couleurs (tosauta entetrimmenên chrômata), comme une courtisane. Sa ceinture – un charme néfaste « pharmakis » qui ensorcelle (katagoêteuein) – et son maquillage constituent des subterfuges susceptibles de tromper le jeune homme qui doit déterminer laquelle des déesses possède la plus grande beauté. Or la beauté nue (gumnon to kallos), la vraie beauté n’a nul besoin de se parer de fard59.
Les fards sont ainsi des subterfuges nuisibles et s’opposent à la véritable beauté, dépourvue d’artifices, voire a fortiori à la beauté qui n’est pas de l’ordre de l’apparence, suivant une position très platonicienne. En effet, comme le souligne Françoise Frontisi, « Platon s’inscrit en faux contre l’opinion commune qui assimile chaque individu à son visage. Le prosopon est fondamental, mais il ne relève que de l’apparence, de l’eidos, à quoi le philosophe oppose l’être authentique, la psuchê »60. Sans être aussi radicaux, de nombreux auteurs intègrent néanmoins la question du maquillage au thème plus large du statut de la parure et de l’artifice face à la beauté naturelle, tant pour les femmes que les hommes. Ainsi, au début du ive siècle avant notre ère, Xénophon, dans un texte théorique mettant en scène un aristocrate athénien, Ischomaque, recommande par la bouche de son personnage qu’une digne épouse s’applique « à se montrer toujours sans artifice (pure : kathara) », vraie et dans la tenue qui convient, pour avoir aux yeux de tous « une véritable beauté et non pas seulement l’apparence de la beauté (hôs an tô onti kalé phainoito, alla mê monon dokoiê) »61. Dans cette stratégie de présentation de soi, l’absence de fards joue un rôle aux côtés des activités et exercices féminins (mouiller et pétrir la pâte, plier les vêtements et les couvertures). Ceux-ci confèrent véritablement aux épouses un « beau teint (euchroôtera) » signe de bonne santé (« elle se porterait mieux (hugiainein mallon) »), tandis que « celles qui
58. Selon R. Hawley, « Beauty in classical Greece », dans D. Montserrat (éd.), Changing Bodies, Changing Meanings. Studies on Human Body in Antiquity, Londres/New York, 1998, p. 43, cette nouvelle attitude, à Athènes, est une conséquence de la guerre du Péloponnèse. En effet, le rôle des femmes, même s’il est passif, en matière de légitimité, de citoyenneté et d’héritage, est suffisamment déterminant pour que des citoyens s’inquiètent du comportement de leurs épouses et de leurs filles, d’autant que beaucoup d’hommes en âge de se marier sont décédés.59. Cf. Lucien, Le jugement des déesses, XX, 10 (traduction A. M. Harmon, LCL). Sur le même thème, cf. aussi la fable de Prodicos qui oppose Kakia à Aretê (Xénophon, Mémorables, II, 1, 21-34).60. F. Frontisi-Ducroux, Du masque au visage. Aspects de l’identité en Grèce ancienne, op. cit., p. 29. Cf. Platon, Protagoras, 352 a : « Je suppose qu’on veuille juger (skopôn), sur l’apparence extérieure (eidos) d’un homme, de sa santé et de son aptitude aux exercices physiques, et que, n’apercevant de son corps que le visage et l’extrémité des mains, on lui dise : “découvre-moi donc ta poitrine et ton dos, afin que je puisse mieux t’examiner (episkepsômai)” ; eh bien, c’est quelque chose d’analogue que je réclame en vue de mon examen ».61. Cf. Xénophon, Économique, X, 9.
Maquillage et identité
39
restent toujours assises d’un air fier » sont des « coquettes aux artifices trompeurs (hai kekosmêmenai kai exapatôsai) »62. Autrement dit, appliquer « de [la] céruse pour avoir le teint encore plus clair que nature », être fardée « d’orcanète pour paraître plus rose » qu’en réalité et porter de « hauts souliers pour avoir l’air plus grande » qu’elle n’était naturellement (epephukei), comme les courtisanes mises en scène par Alexis, est dépréciatif pour une épouse car ces subterfuges sont trompeurs63. Mais Ischomaque, pour lui-même, profère les mêmes conseils :
« - Or, dis-je, dans cette association de nos corps, penserais-je mériter davantage ton amour si je tentais de t’apporter un corps que mes soins ont rendu sain et vigoureux (to hugainon te kai errômenon) et si par là tu me vois avec un bon teint véritable (euchrôs), ou si je m’enduisais (aleiphomenos) de miltos ou me fardais sous les yeux avec une couleur chair (hupaleiphomenos andreikelô) pour me montrer à toi et te prendre dans mes bras, en te trompant (exapatôn), en offrant à tes yeux et à tes caresses du miltos au lieu de mon teint naturel (anti tou emautou chôtos) ?- Pour moi, répond-elle, j’aimerais mieux me serrer contre toi que contre du miltos, voir ton teint plutôt qu’un fond de teint couleur chair (andreikelou chrôma), voir tes yeux en bonne santé (hugiainontes) plutôt que fardés (hupalêlimmenoi).- Eh bien moi aussi, crois-le, dit Ischomaque, ma femme, je ne trouve pas plus d’agrément dans la céruse ou l’orcanète que dans ton propre teint (chrôma) ; les dieux ont fait les chevaux la chose la plus agréable du monde pour les chevaux [...], de même les être humains (anthrôpoi) ne trouvent rien de plus agréable que le corps d’un être humain (anthrôpos) sans aucun artifice (katharos) »64.
à l’usage de céruse et d’orcanète pour les femmes correspond celui du miltos et d’un fond de teint couleur chair pour les hommes – une pratique sans doute en vigueur pour améliorer la carnation. Or, pour Ischomaque, seuls de mauvais époux donc de vils citoyens s’enduisent de tels produits. Ce rejet d’un maquillage masculin est analogue à celui de l’usage des fards par les femmes. Mais la réprobation est probablement renforcée par le fait que des acteurs mais aussi des barbares s’appliquent du miltos sur le visage et le corps65. Par exemple,
62. Cf. Ibid., X, 9-13. Sur l’amollissement et la perte de vigueur liés au maquillage et propres aux citadines et aux courtisanes, cf. aussi Alciphron, Lettres de pêcheurs, de paysans, de parasites et d’hétaïres, II, 8 : « Ce n’est pas raisonnable de vouloir rivaliser avec ces dames de la ville, si molles (hupo truphês) qu’elles ne tiennent pas debout ».63. Cf. ibid., X, 2-3.64. Ibid., X, 5-7 (traduction P. Chantraine, CUF, modifiée). Sur l’ensemble du passage, lire les commentaires de S. B. Pomeroy, Xenophon, Œconomicus. A Social and Historical Commentary, Oxford, 1994, p. 303-308 ; P. A. Hannah, « The Cosmetic Use of Red Ochre (Miltos) », op. cit., p. 100-101 ; A. Glazebrook, « Cosmetics and Sôphrosunê : Ischomachos’ Wife in Xenophon’s Oikonomos », CW, 102/3, 2009, p. 233-248.65. Cf. Scholie à Aristophane, Cavaliers, 230 à propos d’Aristophane qui, enduit (huperchrinato) de miltos, jouait sans masque ; Athénée, V, 197 f-198 a, au sujet de 40 Satyres ceints de couronnes de lierre en or et dont les corps sont peints (ekechrinto), pour les uns de couleur pourpre (ostreios), pour les autres de miltos et de plusieurs autres couleurs, durant une procession dionysiaque
Florence Gherchanoc
40
chez les Perses et les Mèdes, le maquillage, entre autres, participe à une mise en scène du pouvoir qui vise à distinguer ostensiblement les chefs de leurs sujets : « car ils ont des souliers tels qu’ils peuvent y ajuster sans qu’on le sache, des semelles qui les font paraître plus grands (hôste dokein meizous einai) qu’ils ne sont. — Ensuite, il [Cyrus] admettait les yeux fardés (hupochriesthai de tous ophtalmous), pour qu’ils eussent l’air d’avoir des yeux plus beaux (hôs euophthalmoteroi phainointo) qu’ils n’étaient, et le maquillage (entribesthai), pour qu’on leur vit un teint plus beau que nature (hôs euchroôteroi horônto ê pephkasin) »66. Parés et fardés comme les hétaïres d’Alexis ou des acteurs de théâtre, ces hommes modifient leur allure pour intensifier leur beauté et exciter le désir, autrement dit pour ensorceler (katagoêteuein)67. Il s’agit « d’une véritable politique de l’éclat » qui doit rendre les chefs presque irrésistibles68. Néanmoins ceux-ci n’ont que la semblance et l’apparence de la beauté.
Dans tous les cas, pour les femmes comme les hommes, dans le cadre de la vie en cité, l’emploi de substances pour colorer la peau et améliorer son teint est condamné. La vraie beauté signe d’une bonne santé ne s’acquiert que par l’exercice. Sur ce dernier aspect, Xénophon fait ici figure d’exception. La beauté véritable ne peut être que masculine car athlétique, comme en témoigne, par exemple, Platon, vers 395/390 avant notre ère. Cherchant à définir la rhétorique, le philosophe oppose notamment le maquillage à la gymnastique : « [La flatterie (kolakeia)] se donna pour l’art, dont elle prenait le masque ; du bien elle n’a nul souci, mais, par l’attrait du plaisir, elle tend un piège à la sottise qu’elle abuse […]. C’est ainsi que la cuisine contrefait la médecine et feint de connaître les aliments qui conviennent le mieux au corps [...]. à la gymnastique correspond de la même façon le maquillage (la toilette : kommôtikê), chose malfaisante (kakourgos), trompeuse (apatêlê), basse (agennês), indigne d’un homme libre (aneleutheros), qui produit l’illusion (apatôsa) par des apparences (schemasi), par des couleurs (chromasi), par un vernis superficiel (leiotêti) et par des étoffes (esthesi). Si bien que la recherche d’une beauté empruntée (allotrion kallos) fait négliger la beauté naturelle que donne la gymnastique »69.
somptueuse à Alexandrie, dans le stade, sous le règne de Ptolémée II Philadelphe et Arsinoé. Sur l’usage du miltos chez les Libyens et les éthiopiens, cf. Hérodote, IV, 191 et 194 ; VII, 69. Lire P. A. Hannah, « The Cosmetic Use of Red Ochre (Miltos) », op. cit., p. 101.66. Xénophon, Cyropédie, VIII, 1, 41 ; cf. aussi ibid., VIII, 8, 20 ; ibid., I, 3, 2, à propos d’Astyage et de l’émerveillement qu’il produit sur son petit-fils, Cyrus, encore enfant, qui le voit « […] paré (kekosmêmenon), avec des yeux peints (ophthalmôn hupographê), un visage fardé (chrômatos entripsei) et des cheveux postiches, selon l’usage des Mèdes, car tout cela est à la mode en Médie, ainsi que les tuniques de pourpre, les robes à manches, les colliers autour du cou et les bracelets aux poignets […] » ; les Iapyges, en association à un visage fardé (to prosôpon entripsamenoi), portent des parures comparables, perruques et vêtements brodés (stolai anthinai), signes de leur truphê et hubris (cf. Athénée, XII, 523 a).67. Xénophon, Cyropédie, VIII, 1, 40.68. Sur cette « politique de l’éclat » et la façon dont Cyrus l’adopte et l’adapte, lire V. Azoulay, Xénophon et les grâces du pouvoir. De la charis au charisme, Paris, 2004, p. 418-426.69. Platon, Gorgias, 464 d-465 b. Cf. aussi id., Phèdre, 239 c-d à propos du désir et du plaisir que procure la beauté – une beauté artificielle ne pouvant être source d’un amour véritable. Ainsi,
Maquillage et identité
41
Exempte d’artifices trompeurs, la parure d’un corps nu exercé au gymnase et qui s’exhibe permet de mieux situer les individus, leur place dans la société et les hiérarchiser, à partir du modèle canonique que constituerait l’adulte mâle citoyen. De fait, la nudité, ici athlétique, qualifie au mieux une personne, sa nature et son statut, contrairement aux fards qui dénaturent et travestissent70. En effet, le corps est investi des valeurs symboliques de la cité. Il est le lieu où se matérialisent et s’admirent la masculinité et le pouvoir physique, ainsi que la supériorité du système politique de la polis grecque. De ce fait, un corps masculin orné et paré d’artifices en tous genres n’incarne pas les valeurs de la cité ni de l’hellénisme et n’est pas digne d’un citoyen véritable. Cette idée se perpétue à travers les siècles. Un auteur comme Lucien l’exploite encore au fil d’un développement où il oppose la poésie – art artificiel – à l’histoire. La première n’a pas de règle (doxa) en dehors de celle du poète inspiré par les Muses, la seconde doit éviter la flatterie (kolakeia) : « C’est un grave défaut, à vrai dire gravissime, que de ne pas savoir séparer ce qui relève de l’histoire et ce qui relève de la poésie, d’introduire dans l’une les ornements (ta kommômata) de l’autre : récits légendaires, éloges et toutes les exagérations qu’ils comportent. C’est comme si l’on prenait un de ces solides athlètes, gaillard rude comme un chêne, et qu’on le revêtait de vêtements teints de pourpre, qu’on l’affuble d’une parure de courtisan (tô allô kosmô tô hetairikô) et qu’on lui maquille la figure avec de la céruse et du vermillon (phukion entriboi kai psimuthion tô prosôpô). Par Héraclès ! On en ferait rire en l’humiliant sous un pareil accoutrement (kosmos) ! »71. La poésie est comme un courtisan – un homme ridicule, laid, sans
celui qui par passion sacrifie le bien au plaisir (hêdu pro agathou) recherchera « un garçon mou qui n’est pas robuste (malthakos kai ou stereos), élevé, non dans la pureté d’un air ensoleillé mais dans une ombre épaisse, ignorant aux fatigues viriles et aux sueurs de l’effort, accoutumé par contre à un genre de vie délicat et sans virilité (apalê kai anandros), paré de couleurs et d’ornements empruntés, faute de beauté naturelle, enfin montrant en tous ses goûts la même mollesse » (traduction P. Vicaire, CUF, modifiée). Ici, notamment, le courtisan s’oppose à l’athlète. Cf. également Cléarque apud Athénée, XV, 687 a, à propos non seulement des parfums mais encore des couleurs qui ont quelque chose de mou (d’efféminé : trupheron) et efféminent aussi (suneklthêluousi) les hommes qui les utilisent ; Anthologie palatine, V, 19, où sont distingués, d’un côté, le « teint naturel des jeunes garçons (paidôn adolou chroos) » et, de l’autre, le « plâtre (gupsou chrimmata) dont [les femmes] se poudrent », le « fard et [...] l’éclat emprunté (phukous anthos epeisodion) ». Sur le gypse (enduit de plâtre qui confère aux objets un aspect blanc lisse, non rugueux), ses fonctions de protection et de dissimulation : lire P. Ellinger, « Le gypse et la boue, I. Sur les mythes de la guerre d’anéantissement », QUCC, 29, 1978, p. 7-35, repris dans La légende nationale phocidienne. Artémis, les situations extrêmes et les récits de guerre d’anéantissement, BCH, supplément XXVII, 1993, p. 47-88, en particulier p. 70. Sur l’utilisation du gypse « mystique » dans un contexte bacchique pour dissimuler les visages et les corps derrière l’apparence fausse (nothon eidos) d’un masque trompeur (pseudomenos prosôpos) et « jeter l’effroi » : cf. Nonnos de Panopolis, Les Dionysiaques, XXVII, 204-205 et 228-230.70. Voir F. Gherchanoc, « Nudités athlétiques et identités en Grèce ancienne », dans F. Gherchanoc, V. Huet (éd.), S’habiller, se déshabiller dans les mondes anciens, Mètis, N.S. 6, 2008, p. 75-101.71. Lucien, Comment faut-il écrire l’histoire ?, 8 (traduction A. Hurst, « La roue à livres », Les Belles Lettres, Paris, 2010). De même, Philosophie s’oppose à Rhétorique parée à l’instar
Florence Gherchanoc
42
force voire féminin, au contraire du héros Héraclès qui personnifie les vraies valeurs du gymnase. La beauté de l’histoire est la manifestation de la vérité72. Le maquillage est donc une parure artificielle, trompeuse, féminine et grotesque qui s’oppose à la beauté nue, virile et athlétique.
Pour les un(e)s, tout doit briller, être coloré, pourpre et or. L’utilisation habile de pharmaka, tels des sortilèges, et d’autres expédients étrangers et trompeurs – des fards et onguents associés aux teintures, parfums, etc., bijoux, vêtements et chaussures – permet aux femmes et à ceux qui se « dévirilisent » ou encore se « féminisent », par la bigarrure, d’acquérir charis et beauté, néanmoins factices et contrefaites. En outre, ceux-ci amollissent. Ils mettent en exergue la truphê et l’hubris des individus (intempérance, licence, séduction extraconjugale, sexualité débridée, goût pour des cultes secrets, etc.). à cette utilisation outrancière des artifices répondent, pour les autres, la simplicité et la mesure73.
Finalement, ces discours visent clairement la maîtrise d’un savoir faire, d’une technê, et son action sur le corps, le plus souvent désignées comme dangereuses pour la cité, au regard des normes culturelles, mais également pour les individus eux-mêmes. Le suggèrent, de nouveau et très précisément, mais dans un autre registre, les remarques de Galien, un médecin du iie siècle de notre ère, qui stigmatise la science du maquillage à laquelle il oppose les vertus de la science médicale : « L’art de la toilette (to kosmêtikon), qui est une partie de la médecine, diffère de l’art du maquillage (to kommôtikon) ; le but du maquillage (to kommôtikon) est de réaliser une beauté étrangère (kallos epiktêton), et celui de la médecine, est de conserver au corps tout son naturel (kata phusin) ; il s’ensuit une beauté naturelle (to kata phusin [...] kallos) »74. La médecine et le maquillage sont des technai. Mais la première préserve la qualité de la peau tandis que la seconde agit sur le corps comme un agent étranger et donc nocif : « Rendre la peau du visage (prosôpou) plus blanche à l’aide de drogues (pharmaka), ou plus rouge (eruthroteron), ou rendre les cheveux frisés, roux, noirs, ou encore comme les femmes, les allonger démesurément, tout cela relève de l’art malfaisant du maquillage (tês kommôtikês kakias), ce n’est pas l’œuvre de l’art médical (iatrikê technê) »75.
Parfaire le teint de son corps et de son visage par des exercices physiques ou en s’en remettant aux médecins est louable. En revanche, agir soi-même sur sa
d’une courtisane comme le prouvent sa chevelure, le port de son manteau et les traces de blanc de céruse et de rouge : cf. id., Les ressuscités ou Le pêcheur, XII.72. Lucien, Comment faut-il écrire l’histoire ?, 9.73. Ce même thème est exploité dans le contexte d’une joute oratoire comique portant sur la triste nécessité d’avoir des épouses, toujours semblables à des guenons en raison des parures multiples qui les dissimulent de la tête aux pieds, et les bienfaits de l’amour avec de jeunes garçons aux corps quasiment nus et à la vêture sobre : cf. [Lucien], Des amours, 38-46 (traduction E. Talbot, Hachette et Cie, Paris, 1874).74. Galien, XII, 434 [Opera omnia (Kühn)].75. Ibid. Sur les dangers du maquillage d’après les Pères de l’église, lire notamment A. Knecht, Gregor von Nazianz : Gegen die Putzsucht der Frauen, Heidelberg, 1972 ; B. Grillet, Les femmes et les fards dans l’Antiquité grecque, op. cit., p. 129 sq.
Maquillage et identité
43
personne au moyen de pharmaka est contre-nature. De surcroît, le plus souvent, le maquillage ne réalise qu’une illusion fragile et constitue un masque de beauté très temporaire. Enfin, cette beauté factice que produit le maquillage, si l’on suit Xénophon, ne peut tromper que « les gens de l’extérieur (hoi men exô) qui ne peuvent les percer à jour ». Dans l’intimité de l’oikos, « ou bien on est surpris au saut du lit avant de s’être préparé, ou bien on est confondu de supercherie parce qu’on s’est mis en sueur, ou bien encore on est mis à l’épreuve par les larmes, ou bien on apparaît tout à coup tel qu’on est, au sortir du bain »76. La beauté artificielle et discrète que peut conférer le maquillage est ainsi une beauté fugace que révèlent la nudité ou bien l’action d’un agent naturel comme l’eau sous forme de sueur ou de larmes, mais encore la chaleur estivale. Aussi Euboulos, dans une comédie susmentionnée, s’en amuse-t-il. L’été, par exemple, le maquillage coule et les courtisanes deviennent ridicules : « Sortez un jour d’été, et voilà deux ruisseaux de noir (duo reousi melanos) qui s’écoulent de vos yeux, et de grosses gouttes de sueur dégoulinant de vos joues sur votre gorge qui vous creusent un sillon de vermillon (aloka miltôdê) ; pendant ce temps, vos cheveux ébouriffés, qui voilent votre visage, sont tout gris, tellement ils sont pourris de céruse (anapleô psimuthiou) »77. Les trois éléments – le blanc pour le visage, le miltos ou vermillon pour les joues et le noir pour les yeux – qui normalement intensifient l’éclat du visage et du regard ne créent qu’une beauté éphémère à laquelle des agents « naturels » peuvent nuire. Ainsi altéré et donc révélé, le maquillage ne constitue plus une seconde peau. Trop ostensible, il enlaidit et fait de ceux qui s’en parent des êtres grotesques ou des épouvantails comme l’indique l’histoire de Phrynê que rapporte Galien pour décrier ses méfaits :
« Aussi me paraît-il fort opportun de raconter ici l’histoire de Phrynê : un jour, celle-ci, au cours d’un banquet où l’on se livrait à cette sorte de jeu qui consiste à donner aux convives, chacun à leur tour, les ordres de son choix, s’étant avisée que les femmes qui étaient là étaient fardées (kekallôpismenai) avec de l’anchouse, de la céruse psimuthion et du rouge (phukos), fit apporter de l’eau, leur ordonna d’y tremper les mains et de les appliquer une fois et une seule sur leur visage, puis de l’essuyer aussitôt avec un linge ; et elle commença par le faire elle-même. Toutes les autres femmes eurent alors le visage couvert de taches, et l’on aurait cru voir des épouvantails (mormolukeia). Mais Phrynê, elle, parut plus belle encore, car elle seule possédait une beauté sans fards et toute naturelle (akallôpistos te kai autophuôs kalê), n’ayant nullement besoin des artifices du maquillage (panourgiai kommôtikês) […] »78.
Phrynê est dotée d’une « beauté véritable (to alêthinon kallos) », « dépouillée de tout ce qui lui est apport extérieur »79. Cependant, même si elle est, en cela, une courtisane atypique car jolie naturellement contrairement à ses congénères,
76. Cf. Xénophon, Économique, X, 8.77. Euboulos, Les vendeuses de couronnes, CAF II, n° 98, p. 126-127 apud Athénée, XIII, 557 f.78. Galien, Exhortation à la médecine, X, 7-8.79. Ibid.
Florence Gherchanoc
44
voire anormalement belle, le médecin entend montrer par cette anecdote les bienfaits de la beauté naturelle. Le maquillage au mieux crée une beauté fragile mais, corrompu, il transforme les êtres, les défigure et les rend monstrueux.
Fards et cosmétiques relèvent des soins apportés au corps, de l’embellissement et de la beauté, du paraître, d’une certaine présentation de soi et enfin de la séduction. Il faut trouver la juste mesure pour que les couleurs (le blanc, le rouge et le noir) se fondent harmonieusement sur un visage, sans quoi le maquillage ne produit plus un masque de beauté. Seul un équilibre subtil80 rend beau ou dit le beau. Un maquillage bien dosé est ainsi un artifice dont on se sert pour rehausser et parfaire sa beauté. Néanmoins, mal utilisé, il est connoté péjorativement et fait de ceux qui en usent des êtres laids, mous et grotesques.
Si comme le remarque M. Nappi, « le maquillage [est] un marqueur social de la femme qui fait commerce de son corps et qui veut attirer le regard […] volontiers associé à l’infidélité et à l’adultère »81, sans être totalement fausse, cette assertion mérite d’être nuancée. En effet, en dépit de toutes les critiques formulées, principalement à partir du ive siècle avant notre ère, les fards ne constituent pas l’élément le plus important de la parure des femmes, à côté des vêtements, bijoux et autres ornements qui leur confèrent leur principale bigarrure et donc leur beauté. Le maquillage s’avère être un signe distinctif mineur. En outre, quand il est instrumentalisé comme parure, il stigmatise un comportement indécent voire signale un outrage social, religieux et politique tout autant pour les femmes que les hommes. Seul le contexte permet d’apprécier et de hiérarchiser la place et le statut qu’occupe le maquillage dans l’ensemble des artifices de la beauté corporelle. Enfin, même s’il connote et dénonce la ruse trompeuse, l’usage des fards est parfois présenté comme la maîtrise d’une mêtis positive, en particulier quand il s’agit de tromper les êtres grotesques, hideux, stupides et au caractère mimétique que sont les singes82. Ainsi, la chasse et la guerre83 sont des registres qui, parfois, autorisent le maquillage comme arme. Mais c’est une autre histoire.
80. Galien, Art médical, XIV, 5, le définit en ces termes : « Les marques distinctives d’un tempérament justement équilibré quant à l’état de l’être vivant tout entier sont : la couleur du teint fondue de rouge et de blanc (eruthrou kai leukou summigês), des cheveux blonds (xanthai) et le plus souvent moyennement frisés, et une chair dont la production est justement équilibrée en quantité comme en qualité. Car le corps ainsi défini occupe exactement une position médiane (meson) entre tous les excès, et l’on pourrait les considérer et les qualifier en le prenant comme référence ». Une analyse des couleurs de la peau et de la complexion comme signe de bonne ou mauvaise santé dans les traités hippocratiques permettrait de compléter ces remarques relatives au maquillage.81. M. Nappi, Professionnelles de l’amour, Paris, 2009, p. 213-214.82. Cf. Diodore de Sicile, XVII, 90, 2-3 ; élien, Sur la personnalité des animaux, XVII, 25 ; Strabon, Géographie, XV, 699 ; Pline l’Ancien, VIII, 215. Lire F. Lissarrague, « L’homme, le singe et le satyre », op. cit., p. 458-459.83. Cf. note 69.




























![F\cRZ_V TcZdZd VdTR]ReVd, dR_TeZ`_d cVXZ^V SVXZ_d](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322297e117b4414ec0bc695/fcrzv-tczdzd-vdtrrevd-drtezd-cvxzv-svxzd.jpg)