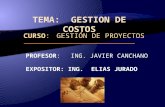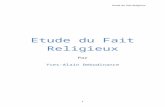Etude diagnostique de la gestion du périmètre forestier de Dogo-Kétou
-
Upload
universitdabomeycalavi -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Etude diagnostique de la gestion du périmètre forestier de Dogo-Kétou
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (UAC)
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES (FSA)
DEPARTEMENT D’AMENAGEMENT ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
(DAGE)
4ème promotion LMD
THEME
Mémoire
Pour l’obtention du diplôme d’Ingénieur des travaux.
GRADE DE LICENCE PROFESSIONNELLE
Option : Aménagement et Gestion des Forêts et Parcours Naturels (AGFPN)
Réalisé par :
KOTY Copernic
Superviseur:
Ir. KAKPO Sunday Berlioz
Année Académique: 2012-2013
i
CERTIFICATION :
Je certifie que ce travail a été conduit et réalisé par Monsieur KOTY Adanmando
Copernic sous ma direction à la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université
d’Abomey-Calavi (UAC), en vue de l'obtention du Diplôme de Licence professionnelle en
agronomie, Option Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (AGRN), spécialité
Aménagement et Gestion des Forêts et Parcours Naturels (AGFPN).
Superviseur
Professeur. Dr. Ir. Jean Cossi GANGLO
Titulaire de foresterie (CAMES)
ii
DEDICACES :
Je dédie ce travail :
À mes parents pour les efforts et sacrifices consentis pour mon éducation. Que ce
mémoire soit pour vous la récompense de vos peines et soucis, puisse Dieu vous le rendre au
multiple.
iii
REMERCIEMENT:
Le présent travail n'aurait pu connaître d'aboutissement sans l'aide de nombreuses
personnes à qui j'exprime ici ma profonde reconnaissance. Je veux nommer :
Le Professeur Jean C. GANGLO qui a accepté de diriger ce travail malgré ses
multiples occupations. Votre rigueur, objectivité, sens de compréhension, votre amour
pour la recherche scientifique et le travail bien fait sont autant de qualités qui forcent
mon admiration pour vous.
L’ingénieur KAKPO Sunday Berlioz pour sa disponibilité, son attention, ses conseils
et sa contribution à l’aboutissement de ce travail en tant que co-superviseur.
Mes sœurs Sylvia et Gloria KOTY pour leur nombreuses marques de soutien pendant
mon séjour à kétou.
Monsieur ESSOU victor chef secteur Dogo-Kétou et Monsieur KAMADE Romuald
Chef des Travaux Dogo-Kétou pour leur disponibilité et leur aide dans la collecte des
données sur le terrain malgré leurs occupations.
Tout le corps enseignant de la FSA en particulier à tous les enseignants du
département d’Aménagement et Gestion des Forêt et Parcours Naturelles (AGRN).
Tous mes camarades de la quatrième promotion de la licence professionnelle, et en
particulier ceux du département d’Aménagement et Gestion des Forêts et Parcours
Naturels (AGFPN) en souvenir des durs moments passés.
Enfin tous ceux que ma mémoire d’homme n’a pas permis de mentionner dans cet
ouvrage et qui, de près ou de loin, d’une manière ou d’une autre ont contribué à forger
ma personne tant sur le plan social, moral que spirituel.
iv
LISTE DES SIGLES:
AGEF: Assemblée Générale des Exploitants de la Forêt
AGFPN: Aménagement et Gestion des Forêts et Parcours Naturels
AGRN: Aménagement et Gestion des Forêt et Parcours Naturelles
CCUA: Conseil de Coordination des Unités d’Aménagements
CENATEL : Centre National de télédétection
CEP: Cellule d’Encadrement Participatif
CGUA: Conseil de Gestion de l’Unité d’Aménagement
CI: Cellule Informatique
Cm: Centimètre
CE : Conseil exécutif
CVGF: Conseil Villageois de Gestion de la Forêt
DG: Directeur Général
DGFRN: Direction Générale des forêts et des Ressources Naturelles
DT: Direction technique
FAO: Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organisation des Nations
Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
FC-DK: Forêt Classé - Dogo Kétou
FFOM: Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces
FSA: Faculté des Sciences Agronomiques
GPS: Global Position System
Km: Kilomètre
LMD: Licence-Master-Doctorat
m: Mètre
ONAB: Office Nationale du Bois
OVGF: Organisation Villageoise pour la Gestion des Forêts
PAP : Plan d’Aménagement Participatif
PDC : Plan de Développement Communal
v
SNAFOR: Société Nationale pour le Développement Forestier
UA: Unité d’Aménagement
UAC: Université d’Abomey-Calavi
UEF: Unité Exploitation des Forêts
UGF: Unité Gestion des Forêts
UP: Unité Protection des Plantations
UPSEC: Unité de Planification Suivi Evaluation et Contrôle
UR: Unité de Reboisement
vi
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Carte de situation des forêts classées de Dogo-Kétou ............................................................ 3
Figure 2: Organigramme du secteur forestier de Dogo-Kétou .............................................................. 11
Figure 3 : Diagramme de venn .............................................................................................................. 19
Figure 4 : Diagramme des problèmes .................................................................................................... 23
Figure 5 : Arbre a problème .................................................................................................................. 25
LISTE DES PHOTOS
Photo 1 : Germoirs ................................................................................................................................ 13
Photo 2 : Empotage ............................................................................................................................... 14
Photo 3 : Dégagement mécanisé ........................................................................................................... 15
Photo 4: Constitution d’un andain ......................................................................................................... 15
Photo 5 : Piquetage des lignes ............................................................................................................... 17
Photos 6 : Ramassage des plants ........................................................................................................... 17
Photo 7 : Pépinière ............................................................................................................................... 18
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Matrice d'analyse FFOM ou SWOT ................................................................................... 22
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Guide d’entretien pour la collecte des données d’enquête au niveau des agents de l’ONAB
............................................................................................................................................................... 32
Annexe 2 : Guide d’entretien pour la collecte des données d’enquête au niveau des groupements
socioprofessionnels ............................................................................................................................... 32
Annexe 3 : Questionnaire administré au chef secteur ........................................................................... 33
Annexe 4 : Fiche individuelle de la connaissance sur le mode de gestion ............................................ 33
Annexe 5 : Zonage de la forêt classée de Dogo - Kétou ....................................................................... 34
Annexe 6: Rôle des différents organes de la co-gestion ........................................................................ 34
Annexe 7: Chronogramme des activités ................................................................................................ 37
vii
RESUME
Notre stage académique ayant abouti au présent mémoire s’est déroulé dans la forêt
classée de Dogo-Kétou du 05 Août au 10 Septembre 2013 et a eu pour objectif général l’étude
diagnostic des potentialités et contraintes liées à la gestion du secteur forestier de Dogo-
Kétou. Le secteur est situé à l’extrémité nord du département du Plateau entre les latitudes
7°10’ et 7°41’17" Nord d’une part et les longitudes 2°24'24" et 2°47'40" Est d’autre part
(Bani, 2006).
Pour atteindre nos objectifs, nous avons utilisé une méthodologie dont l’essentiel est
fait des outils de diagnostic participatif notamment les entretiens, l’observation participative,
l’outil ‘‘Pierre et Caillou’’, le diagramme interrelationnel de Venn ; l’outil FFOM (Forces,
Faiblesses, Opportunités et Menaces), la triangulation.
Les atouts que présente la forêt sont entre autres : la grande superficie que couvre la
forêt : 42852 ha, la disponibilité d’un plan d’aménagement participatif ; les travaux
d’aménagement en cours ; la présence d’un cours d’eau permanent dans la forêt ; la présence
de trois sites de pépinière.
Les faiblesses liées à la gestion de cette forêt sont : la faible participation de la
population riveraine de la forêt aux activités de reboisement ; l’état de dégradation avancé de
la forêt ; la mauvaise gestion de la sous-traitance et le non fonctionnement des structures de
cogestion.
Par ailleurs, plusieurs problèmes qui se trouvent être liés les uns aux autres entravent
la bonne gestion des activités dans la forêt. En tête de ces problèmes, nous avons : la présence
de plantation privées dans le domaine forestier, qui menace dangereusement la gestion
participative. Eu égard à ce problème, nous proposons dans un premier temps que le zonage
de la forêt soit fait afin de définir différentes séries avec pour chacune d’elles une vocation.
Ensuite promouvoir des activités génératrices de revenus tels que l’apiculture afin de
diversifier les sources de revenus des populations.
Aussi, nous proposons de réviser le système de plantation Taungya de sorte à ce que
les paysans tirent davantage de bénéfice du système ceci afin d’inciter ces derniers à adhérer
au système.
viii
ABSTRACT
Our academic training took place in the Dogo-Kétou forest from August 05th to
September 10th 2013. The main goal of our study was to make a diagnostic analysis of
potentialities and limitations related to the management of the Dogo-Kétou forest. It is located
between 7°10’ to 7°41’17" N and 2°24'24" to 2°47'40" E (Bani, 2006).
To reach our aims, we used some participatory diagnosis tools such as fireside chat,
participating observation, ‘‘Stones’’ tool, Venn diagram; SWOT tool (Strengths, Weakness,
Opportunities and Threats), checking…
The assets in the Dogo-Kétou forest are: its extensive area of about 42852 ha, the
availability of participative planning design, the availability of permanent river and the
availability of three tree nursery sites.
Weakness however encompass the weak participation of local people to restoration
acts, the growing habitat increasing degradation, the mismanagement of the sub-
contracting et malfunction of co-management structures.
There are a lot of interconnected problems that hamper the real management of the forest. The
first one is the proximity of some private plantations. We suggest forest zonation as solution
to bedone by assigning a function to each part of the forest. Also promoting income
generative activities for diversifying the sources of incomes and reviewing the Taungya
system could help farmers to get more benefice from the system and forest.
ix
TABLE DES MATIERES
CERTIFICATION : ..................................................................................................................... i
DEDICACES : ........................................................................................................................... ii
REMERCIEMENT : ................................................................................................................. iii
LISTE DES SIGLES : ............................................................................................................... iv
LISTE DES PHOTOS ............................................................................................................... vi
LISTE DES TABLEAUX ......................................................................................................... vi
LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................ vi
RESUME .................................................................................................................................. vii
ABSTRACT ............................................................................................................................ viii
1 INTRODUCTION GENERALE ........................................................................................ 1
1.1. Problématique et justification ...................................................................................... 1
1.2. Objectifs....................................................................................................................... 2
1.2.1. Objectif général ................................................................................................... 2
1.2.2. Objectifs spécifiques ............................................................................................ 2
2 MILIEU D’ETUDE ............................................................................................................ 3
2.1. Localisation des forêts .................................................................................................... 3
2.2. Les facteurs physiques du milieu..................................................................................... 4
2.2.1. Climat ........................................................................................................................ 4
2.2.2. Végétation ................................................................................................................. 5
2.2.3. Géologie et hydrographie .......................................................................................... 5
2.3. Aspects socio-économiques ............................................................................................. 5
3 METHODOLOGIE D’ANALYSE OU DE DIAGNOSTIC .............................................. 6
3.1. Matériels ......................................................................................................................... 6
3.2. Démarche méthodologique .............................................................................................. 6
3.3. Outils de collectes et d’analyses des données ................................................................. 7
3.3.1. L’entretien structuré et l’entretien semi structuré ..................................................... 7
x
3.3.2. L’outil « Pierre et Caillou » ...................................................................................... 7
3.3.3. Le diagramme de Venn ............................................................................................. 7
3.3.4. La triangulation ......................................................................................................... 7
3.3.5. L’outil Forces Faiblesses Opportunités Menaces (FFOM) ...................................... 7
3.4. Méthodes de collecte ................................................................................................... 7
3.4.1. Présentation de la forêt classée de Dogo-Kétou ................................................... 7
3.4.2. Identification des problèmes liés à la gestion des activités dans la forêt ............. 8
3.4.3. Hiérarchisation des différents problèmes ............................................................. 8
3.4.4. Diagnostic du problème prioritaire à la gestion ................................................... 8
4 RESULTATS ...................................................................................................................... 9
4.1. Présentation de l’ONAB .................................................................................................. 9
4.2. Présentation de l’Unité Reboisement de ONAB ............................................................. 9
4.3. Infrastructures et matériels ............................................................................................ 12
4.4. Présentation des activités ............................................................................................... 12
4.4.1. Alimentation en eau de la pépinière ........................................................................ 12
4.4.2. Production de plans en pépinière ............................................................................ 13
4.4.3. Organisation des travaux ......................................................................................... 15
4.4.4. Le défrichement ...................................................................................................... 15
4.4.5. Le jalonnage ............................................................................................................ 16
4.4.6. Le piquetage ............................................................................................................ 16
4.4.7. Le ramassage des plants forestiers .......................................................................... 17
4.4.8. Trouaison et la mise en terre des plants forestiers .................................................. 18
5 Etude diagnostique du fonctionnement de l’unité de reboisement de l’ONAB dans la
gestion de la forêt classée de Dogo-Kétou ............................................................................... 19
5.1. Diagramme de Venn ...................................................................................................... 19
5.2. Inventaire des forces, faiblesses, opportunités et menaces ............................................ 21
5.3. Identification des problèmes limitant la gestion durable du secteur forestier ............... 22
xi
5.4. Hiérarchisation des différents problèmes identifiés ...................................................... 23
5.5. Diagnostique du problème central ................................................................................. 24
5.6. Approches de solution ................................................................................................... 27
5.6.1. La sensibilisation de la population .......................................................................... 27
5.6.2. L’amélioration du système de plantation Taungya ................................................. 27
5.6.3. Instauration un cadre de partage des avantages liés aux plantations ...................... 28
5.6.4. Zonage ..................................................................................................................... 28
5.6.5. Promotion des AGR ................................................................................................ 28
5.7. Analyse des résultats ..................................................................................................... 28
5.8. Difficultés rencontrés et stratégies pour les surmonter ................................................. 29
6 Conclusion et recommandations ....................................................................................... 30
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................. 31
ANNEXES ............................................................................................................................... 32
1
1 INTRODUCTION GENERALE
1.1. Problématique et justification
La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) est une école d’enseignement supérieur
de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), qui forme des cadres compétents dans diverses
spécialités, que sont: Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles (AGRN),
Production Animale (PA), Production Végétale (PV), Nutrition et Santé Animale (NSA),
Economie Socio-Anthropologie et Communication (ESAC).
En effet, la formation supérieure en Agronomie a démarré au Bénin depuis 1970, elle
était organisée au sein du Département des Etudes Agronomiques et Agro Techniques qui fut
transformé en Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi le 22
décembre 1977. La Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) a connu une évolution qui
s’articule autour de trois grandes phases : la phase de démarrage et de développement des
activités (1970-1980), celle d’intensification des activités organisationnelles et de la
diversification de la coopération internationale (1980-1990) et enfin celle marquée par la
consolidation des structures, des programmes et des mécanismes mis en place (1990 à nos
jours). (Affokpe, 2012)
Sa mission est notamment d’assurer la formation initiale devant permettre de fournir
aux structures de développement et de recherche des cadres agronomes et d‘assurer la
formation continue dont l’objectif est le perfectionnement ou le recyclage des cadres en cours
d’emploi dans les domaines des sciences et techniques agronomiques.
Mais, en cette période de mondialisation, et donc de rude concurrence, les dispositifs
pédagogiques universitaires sont en train de subir de profondes mutations à travers le monde
entier aux fins de s’adapter aux nouvelles exigences du marché du travail. Ces réformes sont
une étape nécessaire pour la survie des universités. Les programmes pédagogiques doivent
dorénavant permettre à tout étudiant de se former progressivement en acquérant un ensemble
de compétences adaptées à ses préférences disciplinaires, et à son projet professionnel, qu’il
soit national ou international. Il s'agit d'un processus qui se veut promoteur du développement
des capacités des établissements à adapter et à renouveler leurs offres de formation, en tenant
compte des évolutions scientifiques et technologiques d'une part, et du marché de l'emploi
d'autre part.
2
C’est pour ne pas rester en marge du système en cours dans le monde entier et aussi
modéliser l’offre de formation, faciliter la mobilité et l’insertion professionnelle de ses
apprenants que la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-
Calavi (UAC), a choisi, à partir de 2007, de se conformer au système Licence-Master-
Doctorat (LMD).
Pour se conformer aux exigences de ce système, il est organisé par la Faculté des
Sciences Agronomiques (FSA) à l’endroit des étudiants en fin de formation (Licence
Professionnelle), un stage en milieu réel au cours duquel les étudiants sont amenés à faire une
étude diagnostique de leur structure de stage. Ainsi, nous avons fait notre stage dans la forêt
classée de Dogo-Kétou. A travers ce stage, nous apportons notre contribution à la gestion
durable de cette forêt grâce à l’étude diagnostique qui est faite en vue de dégager le problème
qui mine dangereusement sa gestion durable et de proposer des approches de solutions
concrètes et réalisables.
1.2. Objectifs
1.2.1. Objectif général
L'objectif global du stage est de contribuer à la gestion durable de la biodiversité des
forêts à travers la réalisation d’une étude diagnostique de la forêt de Dogo-Kétou afin de
déceler les différents problèmes qui entravent sa gestion et de proposer des approches de
solutions aux problèmes prioritaires.
1.2.2. Objectifs spécifiques
Il s’agira plus spécifiquement pour nous de :
1. Présenter de la forêt classé de Dogo-Kétou dans sa structuration, ses activités, ses
produits, ses atouts, opportunités, contraintes, faiblesses et menaces ;
2. Identifier les problèmes liés à la gestion des différentes activités de la forêt ;
3. Hiérarchiser les différents problèmes recensés auprès des différentes catégories
d’acteurs intervenant dans la forêt ;
4. Faire un diagnostic du problème prioritaire à la gestion de la forêt afin de proposer des
approches de solutions ;
3
2 MILIEU D’ETUDE
2.1. Localisation des forêts
Le complexe forestier de Dogo-Kétou est localisé dans la commune de Kétou. Cette
commune est située à l’extrémité nord du département du Plateau entre les latitudes 7°10’00’’
et 7°41’17" Nord d’une part et les longitudes 2°24'24" et 2°47'40" Est d’autre part (Bani,
2006). Elle est limitée au Nord par la Commune de Savè au Sud par la Commune de Pobè, à
l’Ouest par les Communes de Ouinhi et de Zangnanado et à l’Est par la République fédérale
du Nigéria.
Figure 1 : Carte de situation des forêts classées de Dogo-Kétou
Source : Plan d’Aménagement Participatif FC-DK, Avril 2010
4
Le complexe forestier de Dogo-Kétou est en réalité constitué de deux blocs forestiers
et s’étend sur une superficie au classement de 42.850 ha répartie comme suit : 11.000 ha pour
la forêt classée de Kétou et 31.850 ha pour la forêt classée de Dogo (Bani, 2006). Constituée
en forêt domaniale classée par arrêté n°2026 SE du 2 avril 1955, la forêt classée de Kétou
avait une superficie approximative de 43.200 hectares selon le Haut-Commissariat de la
République Française à l’époque. Aujourd’hui, cette superficie est évaluée à 11.000 hectares
seulement soit un taux de déforestation d’environ 75% (Bani, 2006). La forêt de Dogo quant à
elle a été classée par arrêté n°675 SE. du 27 janvier 1955. La superficie était évaluée à
l’époque par le Haut-Commissariat de la République Française à 31.850 hectares environ.
Cette superficie n’a pas beaucoup varié jusqu’à nos jours (Bani, 2006). Cette forêt compte
quatre unités d’aménagement : Sodji, Adakplamè, Ofè-otè, Dogo et un noyau central à cheval
entre les unités d’aménagement de Dogo et d’Adakplamè (Bani, 2006).
2.2. Les facteurs physiques du milieu
2.2.1. Climat
La commune de Kétou, bénéficie d’un climat de type tropical à régime pluviométrique
bimodal caractérisé par :
une grande saison des pluies de mars à Juillet ; suivie d’une petite saison sèche en août
(Bani, 2006) ;
une petite saison de pluies de septembre à octobre ; suivie d’une grande saison sèche
de novembre à Février (Bani, 2006).
Cette répartition des pluies à Kétou permet en temps normal d’enregistrer une
pluviométrie annuelle moyenne de 1073 mm de pluies en 65 jours avec une répartition
présentant d’importantes disparités dans le temps et dans l’espace. Mais depuis quelques
années, cette tendance tend à disparaître laissant progressivement place à un régime uni modal
: la deuxième saison des pluies tend à être une prolongation de la première (Bani, 2006)
La température moyenne journalière est à peu près uniforme sur l’ensemble de la
Commune de Kétou. Elle est de l’ordre 25°C et le maxima de 34,5°C (PDC, 2006). La
température reste relativement élevée tout au long de l’année. L’humidité relative mensuelle
moyenne s’établit en un minimum de 78% de janvier à Février et un maximum de 95% en
Septembre (PDC, 2006).
5
2.2.2. Végétation
La flore des FC-DK est constituée d’une mosaïque de formations forestières allant des
galeries forestières aux savanes arbustives et herbeuses (PGFTR, 2010).
Les galeries forestières regroupent les forêts galeries qui sont les formations naturelles
le long des cours d’eau saisonniers et la forêt riveraine située le long du fleuve Ouémé (cours
d’eau permanent).
La galerie forestière à Cynometra megalophylla et Diospyros mespiliformis se retrouve
le long des marigots et des rivières rencontrés dans les FC-DK. Elle se développe sur des sols
argilo-sableux recouverts d’une litière importante (PGFTR, 2010).
On rencontre dans les FC-DK deux types de forêts claires à savoir : la forêt claire à
Anogeissus leiocarpus et Combretum collinum et la forêt claire à Isoberlinia doka et
Pterocarpus erinaceus ; Et trois types de savanes à savoir : la savane boisée à Vitellaria
paradoxa et Combretum collinum ; la savane arborée/arbustive à Lophira lanceolata et
Combretum collinum ; la savane herbeuse à Brachiaria deflexa et Securinega virosa (PGFTR,
2010).
2.2.3. Géologie et hydrographie
Deux types de sols sont rencontrés dans la forêt de Dogo-Kétou . Il s’agit des sols sur
sédiment meuble argilo-sableux du Continental Terminal dont les teneurs en argiles s’élèvent
avec la profondeur (PGFTR, 2010). Ces sols, excellents support culturaux se rencontrent dans
les villages d’Adakplamè, Aguigadji, Agonlikpahou et Dogo. Le deuxième type de sol est
constitué par les sols ferrugineux tropicaux et occupe une petite superficie. Ces sols sont plus
ou moins concrétionnés et moins profonds que les sols ferralitiques mais possèdent des
horizons très différentiés sur plus de 2 mètres d’épaisseur (PGFTR, 2010).
Le réseau hydrographique est peu dense, avec comme composantes le fleuve Ouémé
qui longe la Commune et servant de frontière Ouest ; et quelques rivières et cours d’eau dont
certains sont à régime permanent (Dogo, Orougbé, Illikimou, etc.) (PGFTR, 2010).
2.3. Aspects socio-économiques
Les populations vivant autour et à l’intérieur des FC-DK ont été estimées à 100.499 habitants
(PDC, 2006). Dans les terroirs riverains des FC-DK, on rencontre principalement les différents
groupes socioculturels ci-après : les Nagots ; les Holli ; les Mahi ; les Fon ; les Peuhls (PDC, 2006).
La principale activité économique des populations reste l’agriculture. La technique culturale est
6
traditionnellement extensive. Les principales cultures pratiquées sont : le coton (seule culture de rente
de la région); les cultures vivrières (le maïs, le haricot, le poids d’angole, l’igname, le manioc, la
patate douce, l’arachide, le riz, le piment, la tomate, le gombo, le « goussi » et autres légumes). La
superficie cultivée est d’environ 87 000 ha soit un pourcentage de 39,85% (PGFTR, 2010).
Outre l’agriculture, l’élevage des ovins, caprins, porcins et volaille constitue une autre
source de revenu des ménages.
A ses activités s’ajoutent la chasse qui se pratique surtout pendant la saison sèche, la
pêche et l’exploitation non contrôlé du faite de la dépendance de la population à tirer le bois
énergie de la forêt.
3 METHODOLOGIE D’ANALYSE OU DE DIAGNOSTIC
3.1. Matériels
En vue de collecter les données qualitatives et quantitatives relatives à notre travail, les
matériels suivant ont été rassemblés : 1 cahier de note, un stylo, des crayons à papier et une
gomme ; des fiches de collecte portant le questionnaire administré aux acteurs ; une carte du
secteur étudié pour une meilleure connaissance de la forêt ; un appareil photo (numérique)
pour des illustrations au besoin ; un sac de terrain pour contenir les différents matériels.
3.2. Démarche méthodologique
Elle se résume en trois phases :
La Phase préparatoire : Au cours de cette phase, des échanges ont été faits entre les
enseignants et les étudiants sur divers aspects à savoir : le contexte dans lequel
s’inscrit le stage ainsi que ses objectifs, la forme et le contenu du mémoire ainsi que
les types de structures pouvant accueillir les apprenants et les critères d’évaluation du
stage sont autant de points qui ont été abordés tout au long de cette phase.
La phase de terrain : Cette phase a été essentiellement consacrée à la collecte des
données sur la base d’une étude diagnostique et à la participation aux différentes
activités menées dans la forêt classée de Dogo-Kétou.
Une phase post-stage : Elle a portée sur l’analyse de toutes les données collectées sur
le terrain et leur traitement. La prise en compte des recommandations de nos
superviseurs pour l’élaboration du rapport final met terme à cette phase.
Pour atteindre nos différents objectifs spécifiques, nous avons développé une
méthodologie adaptée à chacun de ces objectifs et avons utilisé des outils diagnostiques.
7
3.3. Outils de collectes et d’analyses des données
3.3.1. L’entretien structuré et l’entretien semi structuré
Nous avions élaborés un questionnaire pour obtenir les informations axées sur les
modes de gestions, l’organisation du personnel et les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Cette technique nous a alors permis d’avoir une idée globale et partagée du point de vue des
différents catégories d’acteurs (Tobada, 2012).
3.3.2. L’outil « Pierre et Caillou »
A même le sol et à l’aide de pierres ou de cailloux, un individu identifie les relations et
caractérise la taille de chaque relation existante entre les institutions et les personnes
physiques et/ou morales intervenant dans la gestion de la forêt (Tobada, 2012).
3.3.3. Le diagramme de Venn
Il est élaboré pour connaître les relations existantes entre une structure donné et les
autres structures externes (Tobada, 2012). Cet outil nous a permis de connaître les différentes
structures qui collaborent avec l’Unité de Reboisement (ONAB) dans le cadre des activités de
reboisement en cours dans la forêt.
3.3.4. La triangulation
Elle nous a permis de confronter et analyser les informations recueillies au niveau de
plusieurs sources lors de nos divers entretiens (Tobada, 2012). Cet outil rend fiable et
authentique les informations reçues et nous a permis de juger de la pertinence des difficultés.
3.3.5. L’outil Forces Faiblesses Opportunités Menaces (FFOM)
Il nous a permis de faire ressortir les atouts (forces et opportunités), les faiblesses et
les menaces liés à la forêt de Dogo-Kétou puis de les résumer sous forme de tableau (Tobada,
2012).
3.4. Méthodes de collecte
3.4.1. Présentation de la forêt classée de Dogo-Kétou
Le principal outil utilisé pour la collecte des données relative à la présentation du
secteur est la documentation. Elle est appuyée par des entretiens avec les responsables du
8
secteur (CTAF) ainsi que les responsables de l’Unité de Reboisement. En ce qui concerne les
différentes activités menées, l’observation est l’outil principal que nous avons utilisé. Cette
observation a surtout été participante pour les différentes activités de reboisement menées au
cours de notre stage. Pour ce qui est des activités qui n’était plus en cours dans le secteur durant
notre période de stage, la documentation et des entretiens structurés et/ou semi-structurés avec les
responsables à divers niveau ont été utilisés pour comprendre l’organisation et le fonctionnement du
site.
3.4.2. Identification des problèmes liés à la gestion des activités dans la forêt
Les problèmes identifiés dans ce diagnostic ont été recensés après avoir analysés les
informations issues de nos différents entretiens avec les riverains de la forêt, et les agents de
l’Unité de Reboisement.
3.4.3. Hiérarchisation des différents problèmes
Suite à l’identification des différents problèmes par les acteurs considérés, nous avons
recueilli par la méthode de « Pierre et Caillou » les ordres de priorité des problèmes suivie de
la note accordée à chaque problème par chaque acteur considéré. Le logiciel Microsoft
EXCEL 2007 a ensuite été utilisé pour le traitement de ces différents problèmes et
l’établissement de l’histogramme.
3.4.4. Diagnostic du problème prioritaire à la gestion
Pour le diagnostic du problème prioritaire, les entretiens ont été conduits avec tous les
acteurs concernés par ce problème. Les résultats de ces entretiens ont été analysés et ont
conduits à la réalisation de l’arbre à problème.
4 RESULTATS
4.1. Présentation de l’ONAB
L’Office National du Bois « ONAB » a été créé par décret n°83-425 du 23 décembre
1983 suite à la dissolution de la Société Nationale pour le Développement Forestier
(SNAFOR). Le dit décret a été modifié par décret n°89-398 du 7 novembre 1989. Le siège
social de l’ONAB est à Cotonou (Akpakpa) PK3, route de Porto-Novo. Il a pour objet la
gestion durable et la commercialisation des ressources forestières de l’Etat et des personnes
morales de droit public, le cas échéant en partenariat avec des personnes privées. L’ensemble
9
des activités sylvicoles et d’exploitation est conduit par la direction technique située dans le
Département du Zou, Commune de Bohicon précisément dans l’arrondissement de Saclo.
L’ONAB fonctionne en ayant sous contrôle six (06) unités à savoir :
l’Unité Reboisement (UR) ;
l’Unité Gestion des Forêts (UGF) ;
l’Unité Protection des Plantations (UP) ;
l’Unité Exploitation des Forêts (UEF) ;
Planification Suivi Evaluation et Contrôle (UPSEC)
la Cellule Informatique (CI) ;
la Cellule d’Encadrement Participatif (CEP)
4.2. Présentation de l’Unité Reboisement de ONAB
C’est cette unité, qui gère les différentes activités de reboisements dans les forêts sous
aménagement de l’ONAB. Administrativement, le secteur forestier de Dogo-Kétou est
organisé de la manière suivante :
Un chef secteur du niveau contrôleur des eaux et forêts, gère le personnel du secteur,
la main d’œuvre et la sous-traitance.
Pour mener à bien sa mission, il bénéficie de l’assistance et de l’appui technique d’un
agent des eaux et forêt : le chef des travaux. Il reçoit et exécute les ordres du chef
secteur et suit toutes les activités planifiées avec ce dernier.
Un chauffeur, qui transport les plants du site de pépinière aux sites de plantations et
conduit également les stagiaires en forêt avec la camionnette mis à sa disposition.
Un animateur de la Cellule d’Encadrement Participatif travaille en étroite
collaboration avec l’Unité de Reboisement. Il est chargé des relations avec les
populations dans le cadre de la gestion participative.
Les représentants des populations sont organisés au niveau de chaque Unité
d’Aménagement (UA) en un bureau et en une association dénommée « association des
paysans utilisant le système Taungya ». Les bureaux constitués par unité
d’aménagement quant à eux ont pour objectifs de s’organiser en groupements pour la
production des plants en pépinière; de sensibiliser la population sur l’importance des
activités de restauration en cours dans la forêt et de participer aux divers activités
d’aménagement dans la forêt. Il faut souligner que le processus de mise en œuvre de la
cogestion est encore en cours dans le milieu. Ainsi, donc les bureaux d’Unité
d’Aménagement existant ne sont pas encore fonctionnels.
10
Acteurs permanents dans la forêt classée de Dogo-Kétou
Acteurs de l’ONAB ayant en charge d’autres secteurs que Dogo-Kétou
Figure 2: Organigramme du secteur forestier de Dogo-Kétou
DG ONAB Dr KOUCHADE
Clément
DT ONAB Capitaine
DOSSA Léonce
C/UR GUESSE
Dénis
C/UPP AHONON
Damien
C/CEP Dr
DJODJOUWIN
Laurent
C/UEF Lieutenant
BELLO Aziz
C/UPSEC AKANI
Idriss
C/Secteur
ESSOU Victor
CB forestière Adjudant
ADJAHO Zéphirin
Animateur
ABI Théodore
Populations Chauffeur GANTIN
Bernard
Sous-traitants
C/Travaux KAMADE
Romuald
11
4.3. Infrastructures et matériels
Infrastructures
L’Unité de Reboisement de l’ONAB (secteur forestier Dogo-Kétou) dispose d’un
bâtiment et un poste de gardiennage. Dans le bâtiment, nous avons un salon qui fait office de
bureau, quatre (4) chambres, deux (2) douches, une cuisine et un magasin.
Matériels
Les matériels de travail dont dispose le secteur forestier de Dogo-Kétou se répartissent
comme suit:
le matériel roulant : une camionnette pour le chauffeur; des motos pour le chef
secteur, le chef travaux et l’animateur
le matériel technique : la boussole et le GPS
4.4. Présentation des activités
Compte tenu de la période à laquelle notre stage s’est déroulé, nous n’avons pas pu
participés à toutes les activités dans le secteur forestier. Toutefois, nous avons tout au moins
participé à quelques activités en pépinière et de reboisement.
4.4.1. Alimentation en eau de la pépinière
Sur le site de pépinière d’Awaya, deux systèmes d’exhaure sont utilisés :
Système d’exhaure motorisé
Il est composé par l’ensemble : puits, motopompe, groupe électrogène, tanks et
tuyauterie. En effet, le puits installé sur le site permet d’alimenter les tanks en eau et ceci par
l’intermédiaire de la motopompe qui permet de remonter l’eau de puits dans les tanks. Ce
dispositif est alimenté par un groupe électrogène. Une fois dans les tanks, l’eau peut être
utilisée à volonté pour les besoins en eau de la pépinière grâce à la tuyauterie qui est relié à
chaque tank.
Système d’exhaure manuel
Il est essentiellement composé des arrosoirs à maille fine et des tonneaux qui sont un
recourt pour pallier à un éventuel problème technique qui pourrait subvenir au niveau du
système d’exhaure motorisé.
12
4.4.2. Production de plans en pépinière
La production des plants consiste à élever dans des pots en plastiques noirs perforés de
10 cm de diamètre et de 20 cm de hauteur, en quantité et en qualité, des plants d’essences
forestières. Cas du teck :
Elle se déroule en plusieurs étapes :
1) La levée de dormance : C’est une opération qui consiste à stimuler les graines de
teck. Elle consiste à tremper les graines de teck dans de l’eau à température ambiante
pendant une semaine et à sécher ensuite au soleil pendant deux jours.
2) La confection des germoirs : C’est une opération consistant à faire des plates-bandes
aplanir et débarrasser des débris végétaux, animaux et cailloux. Il à 1 m de largeur et
peut contenir ainsi 834 sachets lorsqu'elles ont 5 m de longueur.
Photo 1 : Germoirs
3) Semis sur les germoirs : Il se fait à la volée de sorte à ce que les graines soient
réparties uniformément sur le germoir. Elles sont ensuite recouvertes d’une mince
couche de sable. Ensuite, on arrose le germoir.
4) Empotage : Consiste à prélever le sol noir fertile, le débarrasser des matériaux
grossiers et ensuite l’utiliser pour remplir les sachets en polyéthylène. Les pots sont
par la suite alignés.
13
Photo 2 : Empotage
5) Le repiquage : Deux semaines environ après semis sur le germoir les graines germées
peuvent être repiquées dans les pots. Le repiquage se fait dans la matinée ou en début
de soirée après un arrosage copieux.
Les pots sont ensuite placés sous ombrage pendant une semaine voir une semaine et
demi, cela dépend de l’ensoleillement. L’ombrage se fait avec les branches de palmes.
6) Les entretiens
Ils sont de deux sortes :
Les entretiens journaliers : Il consiste à arroser deux fois par jours les plantules
Les entretiens périodiques :
Ils comprennent :
L’habillage : il consiste à diminuer la masse foliaire sans supprimer le bourgeon
terminal développée par les plantules afin de ne pas empêcher l’eau d’arriver dans les
pots lors de l’arrosage
Le désherbage : il consiste à supprimer la concurrence au niveau des pots
L’utilisation des produits phytosanitaires en cas d’attaque parasitaire
Outre le teck, les autres essences forestières produites en pépinière que sont : Gmelina
arborea, Khaya senegalensis, Antiaris africana, Afzelia africana sont semés directement dans
les pots et ne nécessite pas une ombrière.
14
4.4.3. Organisation des travaux
Dans le cadre des activités sur le site de pépinière, la CEP constituent des groupements
pour menés les activités de production de plans. Il faut souligner que ses groupements ne sont
pas constitués au hasard mais en tenant compte du savoir-faire de chacun dans le domaine de
production des plans forestiers. Dans la forêt classée de Dogo-Kétou, sur le site de pépinière
d’Awaya, trois différents groupements y travaillent. Chaque groupement à un certains
nombres de plants à produire pour le compte d’une campagne de reboisement, et ce nombre
est fixé compte tenu de la taille du groupement.
4.4.4. Le défrichement
Défrichement manuel
Le défrichement manuel d'une parcelle ou d'une portion délimitée consiste à faucher à
la main et aras du sol, les mauvaises herbes qui s'y sont installées et à couper à une hauteur de
moins de 10 cm du sol tous les arbustes et autres ligneux qui s'y trouvent.
Défrichement mécanisé
Il se fait avec un bulldozer qui déracine arbres et arbustes et les regroupe en andains
équidistants de 100 m. Au niveau de ses andains les arbres abattus sur la parcelle défrichée
peuvent être utilisé à d’autres fins : les arbres abattus sont notamment façonnés en billes qui
sont utilisés pour la fabrication du bois de charbon.
Photo 3 : Dégagement mécanisé Photo 4 : Constitution d’un an
15
4.4.5. Le jalonnage
Le jalonnage est une opération qui consiste à aligner les jalons afin de déterminer les
lignes de plantation. Toutes les lignes de plantation sont jalonnées avec des jalons d'au moins
1,20 m de hauteur et taillés au fin bout. Les jalons ainsi confectionnés doivent être enfoncés
dans le sol à une équidistance de 50 m sur les lignes de plantations afin de s’assurer de la
rectitude de cette dernière. Pour jalonner une parcelle, il faut :
Définir une ligne de base qui doit être du côté d’accès du domaine afin d’avoir une bonne
vue sur les lignes de plantations
Appliquer la méthode 3-4-5 pour délimiter tout le domaine. Elle consiste à réaliser sur
une corde douze nœuds équidistants de 1 m et à placer les trois premiers nœuds de la
corde sur la ligne de base de sorte que le premier piquet sur la ligne coïncide avec le
troisième nœud. Former ensuite un triangle rectangle de 3 unités sur la ligne de base, 4
unités sur la ligne qu’on veut matérialiser et 5 unités sur l’hypoténuse. La ligne
recherchée est la ligne à 4 unités du triangle. Faire de même à chaque 50 m pour obtenir
les lignes suivantes.
4.4.6. Le piquetage
Le piquetage consiste à matérialiser avec des piquets d’au moins 60 cm de hauteur sur
les lignes de plantation l’emplacement des jeunes plants. Cet emplacement des plants est
défini suivant une équidistance qui est de 2 m sur ligne et de 3 m entre ligne. Pour faire le
piquetage, on utilise un cordeau sur lequel l’écartement de la plantation est déjà marqué. Il
faut ensuite mettre au propre sur une largeur de 1,5 m les lignes matérialisées par les piquets,
soit 0,75 m de part et d’autre de chaque piquet.
Photo 5 : Piquetage des lignes
16
4.4.7. Le ramassage des plants forestiers
C’est une activité qui consiste à transporter les plants forestiers du site de pépinière au
site de plantation. Le transport des plants se fait avec une camionnette après une pluie afin de
faciliter la trouaison et aussi pour réduire le taux de mortalité des jeunes plants. Il faut aussi
noter qu’un arrosage copieux des plants forestiers est prévu sur le site de pépinière avant le
transport des plants sur les sites de plantation toujours dans le but de réduire la mortalité des
jeunes plants.
Photos 6 : Ramassage des plants
4.4.8. Trouaison et la mise en terre des plants forestiers
La trouaison consiste à creuser à l'emplacement des piquets des trous d'une profondeur
correspondant à la taille du sachet contenant le plant. Sur une même parcelle, la trouaison doit
se faire du même côté par rapport aux piquets. Elle est suivit de la mise en terre.
La mise en terre consiste à :
Sélectionner les sachets contenant les plants à environ 5 cm de la base ;
Déposer le plant avec sa motte de terre au fond du trou en retirant par le haut le
sachet ;
S’assurer que toute la motte de terre soit enfouie sous le niveau du sol ;
Refermer le trou avec la terre de retrait en prenant soin de bien la tasser ;
Placer le sachet retiré du plant au piquet.
Ce sachet attaché au piquet signale la position du plant lors du désherbage des parcelles.
La mise en terre se fait tôt le matin
17
L’ensemble de ses activités se déroule suivant un chronogramme prédéfini (Voir
annexe 7)
Photo 7 : Pépinière de la forêt de Dogo-Kétou (Site d’Awaya)
5 Etude diagnostique du fonctionnement de l’unité de reboisement de l’ONAB dans la
gestion de la forêt classée de Dogo-Kétou
5.1. Diagramme de Venn
Nous avons identifié les principales personnes et institutions intervenant dans la prise
de décision concernant la gestion de la forêt et discuter de leur rôle. Le nom de chaque
structure ou institution est inscrit dans un cercle ou cadre. La direction des flèches indique
qu’il existe une relation dans un sens donné entre les structures. Les flèches allant dans les
deux indiquent une interrelation.
18
Flèche indiquant les relations réciproques
Flèche indiquant le sens d’une relation
Structure interne
Structure externe
Figure 3 : Diagramme de venn
Source : Enquête terrain 2013
Commentaire :
Dans le but de satisfaire les besoins sans cesse croissants en bois d’œuvre du pays,
l’ONAB a élaboré un programme de reboisement sur fonds propre de 1000 ha/an sur au
moins 5 ans pour permettre l’extension des superficies reboisées. Pour parvenir à cet objectif,
l’ONAB a recouru à la DGFRN en 2005 et en 2008, avec qui il a convenu d’engager des
actions tests de reboisement respectivement dans les forêts classées de Bonou et
d’Atchérigbé. Au vu des résultats de ses actions, l’ONAB est autorisé par la DGFRN à
poursuivre les actions d’aménagement dans les forêts classées de Bonou, Atchérigbé et dans
d’autres forêt classées prioritairement à Dogo-Kétou, Bassila et Pénéssoulou compte tenu de
19
leur position géographique en rapport avec le rayon d’action actuel de l’Office. C’est ainsi
qu’il a été signé une convention entre la DGFRN et l’ONAB : Convention n°172/2011/DG-
ONAB/DGFRN/DT-ONAB/DCPRN/SA portant mise à disposition de forêts classées pour
aménagement.
Avec les opérateurs des radios Alakétou et Radio Pobè l’ONAB a signé des contrats.
En effet, dans le cadre des activités de reboisement en cours dans la FC-DK il est prévu dans
ledit contrat que ces stations radios (Alakétou et Radio Pobè) émettront des émissions et
passeront des communiqués afin de sensibiliser la population sur le bien-fondé des activités
en cours dans la forêt. En contrepartie, chaque opérateur radio reçoit une somme de 1.000.000
frs CFA au terme de chaque campagne de reboisement.
Les représentants des populations sont organisés au niveau de chaque Unité
d’Aménagement (UA) en un bureau et en une association dénommée « association des
paysans utilisant le système Taungya ». En effet, le système Taungya permet de remédier à la
pénurie de terres agricoles dans les communautés vivant à la périphérie des réserves
forestières et aussi de faire bénéficier aux plants des entretiens à travers les entretiens des
cultures en intercalaire.
Certains ONG interviennent auprès de l’ONAB comme sous-traitants. Ils achètent les
travaux auprès de l’ONAB et les exécutent moyennant une rémunération.
Les universités, lycées et collèges collaborent avec l’ensemble des acteurs, pour la
formation des élèves et étudiants, en particulier ceux de la spécialité aménagement et gestion
des ressources naturelles dans le but de compléter leur cours théorique par la pratique. Les
stagiaires fournissent en retour des documents comportant les résultats des études et des
suggestions pour un bon déroulement des activités de l’Unité.
La Cellule d’Encadrement Participatif travaille en étroite collaboration avec l’Unité de
Reboisement est chargé des relations avec les populations dans le cadre de la gestion
participative.
5.2. Inventaire des forces, faiblesses, opportunités et menaces
L’étude diagnostique vise à analyser les capacités d’organisation du secteur à assumer
la mission qui lui est confiée en faisant ressortir les forces, faiblesses, opportunités et
menaces. Ceci s’est fait à travers un diagnostic participatif réalisé sur la base des
appréciations des membres du personnel, puis des responsables à divers niveaux.
20
Les forces sont les aspects positifs internes de l’unité de reboisement, et sur lesquels on peut
bâtir le futur. Par opposition, les faiblesses sont les aspects négatifs internes mais qui sont
également contrôlés par l’Unité de Reboisement, et pour lesquels des marges d'amélioration
importantes existent. Les opportunités sont les possibilités extérieures positives, dont on peut
éventuellement tirer parti dans le contexte des forces et des faiblesses actuelles. Les menaces
sont les obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou limiter le
développement de la forêt.
Suite aux analyses internes et externes, nous avons pu identifier les forces et faiblesses puis
les opportunités et les menaces liées à la gestion durable de la forêt. Le tableau ci-dessous
résume l’essentiel des informations recueillies par rapport aux forces, faiblesses, opportunités
et menaces.
Tableau 1: Matrice d'analyse FFOM ou SWOT
Source : Enquête terrain 2013
Forces Faiblesses
La grande superficie que couvre la
forêt : 42852 ha
Disponibilité d’un plan
d’aménagement participatif ;
Personnel forestier qualifié ;
Reboisement en cours
Existence de cours d’eau permanent
dans la forêt
Introduction de la méthode Taungya
Disponibilités de trois sites de
pépinière
Faible participation de la population
riveraine aux activités de reboisement
Etat de dégradation avancé de la forêt
Mauvaise gestion de la sous-traitance
Insuffisance de personnel
Le dysfonctionnement des structures de
cogestion
Faible niveau intellectuel de la population
riveraine
Faible productivité de certaines parcelles
Opportunités Menaces
Disponibilité de moyens financiers
et techniques ;
disponibilité d’infrastructures
d’hébergement ;
Recrudescence des coupes frauduleuses
Changement climatique
Forte pression démographique
Les risques d’incendies
La proximité du Nigéria
21
5.3. Identification des problèmes limitant la gestion durable du secteur forestier
Les problèmes recensés sont essentiellement ceux qui entravent le bon déroulement des
activités de reboisement en cours dans la forêt classé de Dogo-Kétou. Aux nombres de ces
problèmes, nous avons :
La présence des plantations privées dans la forêt
Insuffisance de main d’œuvre locale
Le retard dans l’exécution des travaux
Le sabotage des plants forestiers
Les feux de végétation
La déforestation
22
5.4. Hiérarchisation des différents problèmes identifiés
La synthèse des différents problèmes inquiétant la gestion de la forêt et qui ont été
soulevés par les différents catégories d’acteurs enquêtés lors de cette étude est présentée sur la
figure ci-dessous.
Figure 4 : Diagramme des problèmes
Source : Enquête terrain 2013
Légende :
IMDL : Insuffisance de main d’œuvre locale PPP : La présence des plantations privées dans forêt
FV : Les feux de végétation RET : Le retard dans l’exécution des travaux
LD : La déforestation SPF : Le sabotage des plants forestiers
0 20 40 60 80 100 120
PPP
LD
IMDL
RET
SPF
FV
PPP
LD
IMDL
RET
SPF
FV
Problèmes identifiés Hiérachisations
23
Commentaire :
Pour arriver à ce résultat, nous avions menés nos enquêtes aussi bien auprès des agents
de l’ONAB et auprès de la population riveraine de la forêt. Au total, l’échantillon étudié est
constitué de 25 personnes dont 4 agents de l’ONAB et les 21 autres enquêtés sont
essentiellement les populations riveraines.
Suite à l’analyse des donnés des interviews et la méthode de ‘‘ Pierres et Cailloux’’,
les problèmes ont été identifiés puis hiérarchisés. Par ordre d’importance décroissante, nous
avons la présence des plantations privées dans forêt (100), la déforestation (90),
l’insuffisance de main d’œuvre locale (80), le retard dans l’exécution des travaux (50), le
sabotage des plants forestiers (20), les feux de végétation (15).
De cette hiérarchisation, il ressort que la présence des plantations privées du domaine
forestier est le problème qui est au centre de toutes les préoccupations car il a été évoqué par
tous les enquêtés.
5.5. Diagnostique du problème central
24
: Problèmes rencontrés par les utilisateurs de la méthode Taungya
(2) (1) : L’extrémité (1) désigne une conséquence et la seconde désigne sa cause
Figure 5 : Arbre a problème
Source : Enquête terrain 2013
Destruction de plantations
privées
Frustration des populations
Retard des
travaux
Introduction du système Taungya
Insuffisance de
main d’œuvre
locale
Autres activités lucratives
Sabotage des
plans
Faible rendement dès la
deuxième année de plantation
Crainte de quitter la forêt
Difficulté pour nettoyer les
parcelles
La longue période d’inexistence
d’un aménagement
Utilisation de systèmes
d’exploitation inappropriés
Présence des plantations privées
Difficulté d’application du plan d’aménagement participative
Les feux de végétation La mauvaise
gestion des sous-
traitants
La déscolarisation
La déforestation
25
Commentaire :
L’aménagement permet de maîtriser les pressions anthropiques exercées sur les forêts
classées, de restaurer les zones dégradées, de contribuer au maintien de la biodiversité tout en
préconisant des systèmes d’exploitation durable des ressources naturelles (FAO 2004). En
effet, la longue période séparant l’année de classement des deux blocs forestiers (1955) à
l’année d’élaboration du plan d’aménagement participatif des forêts (2010) a favorisé la
surexploitation de ses ressources forestières (la déforestation) et l’utilisation de systèmes
d’exploitation inappropriés. C’est ainsi que des plantations d’anacardiers et de palmiers ont
été installées dans la forêt classée de Dogo-Kétou par la population riveraine.
Après élaboration du plan d’aménagement participatif de la forêt en 2010, des actions
d’aménagement ont été lancés en 2011 pour restaurer la forêt. Ainsi, dans le but de reboiser la
forêt, les plantations privées qui s’y trouvent ont été détruites. Cette situation a entraîné chez
les propriétaires de ces plantations un manque à gagner considérable qui à occasionner la
déscolarisation de leurs enfants. Cela a suscité un sentiment de frustration chez la population
surtout qu’ils n’ont pas été dédommagés. C’est ce sentiment de frustration qui explique
l’absence de main d’œuvre locale et aussi les quelques cas de sabotages de plants et de feux
de végétations enregistrés.
L’absence de main d’œuvre locale s’explique aussi par le faite qu’une partie de la
population s’adonne à d’autres activités lucratives. En effet, la proximité de la République
Fédérale du Nigéria favorise le commerce de l’essence frelaté communément appelé
« kpayô ». Ce commerce leur procure un revenu supérieur aux coûts qui leurs sont offerts
pour les différents travaux d’aménagement menés dans la forêt. La main d’œuvre étant donc
importée, elle n’est pas toujours disponible. Cette situation combinée à la mauvaise gestion de
certains sous-traitants qui ne paient pas à temps les manœuvres, contribuent à ralentir les
travaux.
L’introduction du système taungya pour favoriser la gestion participative n’a pas
arrangé grandes choses de cette situation qui prévaut. En effet, il est déploré par les membres
de l’association des paysans utilisant la méthode Taungya l’utilisation des essences à
croissances rapides tel que le Tectona grandis et le Gmelina arborea. Ces espèces croissent
très vite et font que le rendement des cultures vivrières en intercalaire dans les plantations de
deux ans sont médiocre. Cet état de chose est perçu par ces paysans comme étant une manière
de se faire exclure progressivement du domaine forestier parce que ne trouvant plus de terre à
cultiver il serait contraint de quitté la forêt. Dans le même temps, il est enregistré quelques cas
26
où certains paysans choisissent de saboter les plants forestiers afin de pouvoir rester un peu
plus longtemps sur les parcelles et d’autres qui s’entêtent malgré son interdiction à mettre le
feu pour incinérer la végétation après défrichement sur les parcelles soumis aux systèmes
Taungya. Ceci augmente les risques de survenu de feu de végétation.
De tout ce qui précède, il est visiblement clair que la présence des plantations privées
de la forêt a mis à mal la gestion participative. Mais vu l’importance que présente cette
gestion, il convient de trouver des solutions afin de garantir la gestion durable de la forêt.
5.6. Approches de solution
L'enjeu de la cogestion est fondamental. Il s'agit, dans un contexte de désengagement
de l'Etat, d'aider les populations, d'une part, à mettre tous les moyens en œuvre pour restaurer
et conserver le patrimoine naturel et d'autre part, à développer leur capital de production pour
elles-mêmes et pour les générations futures (FAO, 2005). Pour une gestion durable de la forêt
de Dogo-Kétou nous avons proposé divers approches de solutions.
5.6.1. La sensibilisation de la population
Il faut sensibiliser la population dans un premier temps sur l’importance que requiert la
forêt et ensuite sur le rôle du système Taungya (Tobada, 2012). Cela leur permettra de
comprendre le but visé par l’intégration du système Taungya d’une part et les avantages qu’ils
peuvent en tirer d’autres parts.
5.6.2. L’amélioration du système de plantation Taungya
Les perspectives de la Taungya reposent sur l’intérêt soutenu que les agriculteurs et les
forestiers porteront à son maintien. Ainsi, nous proposons :
Attribution de prime aux agriculteurs ayant bien entretenu les parcelles qui leur ont été
alloués. Cela les incitera à plus s’investir dans l’entretient des parcelles ;
Supervision périodiquement des différentes parcelles allouées dans le cadre de la
méthode Taungya. Cela permettra de suivre les travaux d’entretien afin d’éviter
d’éventuelle déconvenue ;
27
5.6.3. Instauration un cadre de partage des avantages liés aux plantations
Créer dans le but d’asseoir le mécanisme de cogestion dans les forêts classée de Dogo-
Kétou : une Assemblée Générale des Exploitants de la Forêt (AGEF) ; un Conseil Villageois
de Gestion de la Forêt (CVGF) ; un Conseil de Gestion de l’Unité d’Aménagement (CGUA) ;
un Conseil de Coordination des Unités d’Aménagements (CCUA) ; une Organisation
Villageoise pour la Gestion des Forêts (OVGF). Avec pour chaque organe des objectifs bien
précis (Voir annexe 6).
5.6.4. Zonage
Mettre à exécution le zonage proposé par le plan d’aménagement participatif (Voir
annexes 5). Il consiste à découper la forêt en séries qui sont des zones auxquelles on attribue
des activités spécifiques et les conditions d’utilisation de la forêt dans chacune d’elles. Cela
permettra d’asseoir divers séries dont celle agro-forestière dans laquelle les populations
pourront exercer les activités agricoles sans crainte aucune.
5.6.5. Promotion des AGR
Promouvoir les Activités Génératrices de Revenus à travers les PGFTR (Tobada, 2012).
De toutes les opportunités économiques des FC-DK, l’apiculture s’avère la plus
écologiquement rentable. En effet, les abeilles par leur fonction pollinisatrice par excellence
contribuent à l’amélioration de la diversité biologique des écosystèmes forestiers. Cette
activité permettra de diversifier les sources de revenus de la population et favorisera la
cogestion.
5.7. Analyse des résultats
La forêt classée de Dogo-Kétou est un écosystème forestier qui a été surexploité du fait
de l’inexistence d’un aménagement. Cette surexploitation a été si prononcée que le noyau
central a été touché et présente de ce fait un aspect dégradé. Ainsi, les actions de restauration
dans la forêt se révèlent donc nécessaire.
Cette restauration s’avère indispensable d’autant plus que les écosystèmes forestiers
jouent de multiples fonctions dont la séquestration de carbone, la réduction des effets du
changement climatique dont les intérêts dépassent le cadre régional car la survie de
l’humanité en dépend (Kakpo, 2013 ; Dossa, 2013). Dès lors, il a été élaboré un plan
d’aménagement participatif de la forêt en 2010 vu l’enjeu fondamental que présente la
28
cogestion : Il s'agit, dans un contexte de désengagement de l'Etat, d'aider les populations,
d'une part, à mettre tous les moyens en œuvre pour restaurer et conserver le patrimoine naturel
et d'autre part, à développer leur capital de production pour elles-mêmes et pour les
générations futures (FAO, 2005).
Les actions d’aménagement lancé en 2011 ont nécessités la destruction des plantations privées
installé dans la forêt afin de reboiser la forêt. Cela n’a pas du tout été du goût de la population
riveraine de la forêt qui a manifesté son mécontentement notamment par la non-adhésion aux
activités d’aménagement.
La mise en œuvre du plan d’aménagement participatif nécessitant une cogestion, il urge
donc de gérer cette situation avec diplomatie et cela passe par la mise en œuvre de solutions
adéquate dont le zonage et la révision de la méthode taungya proposé ci-dessus. Cela y va du
maintien de la bonne croissance des essences dans les plantations. L’approche participative
apparaît aussi donc comme une stratégie de mitigation des risques de destruction des
ressources de la plantation domaniale.
5.8. Difficultés rencontrés et stratégies pour les surmonter
Au cours de notre stage, nous avons été confrontés à des difficultés qui ont impactés sur
le bon déroulement de notre stage. Il s’agit :
de la contrainte du temps : La durée de notre stage a été relativement courte et ne nous
a pas permis de prendre part aux divers tous les activités qui se déroulent dans le
secteur. Les différentes interviews que nous avions eues à faire nous ont permis de
surmonter cette difficulté.
le fort taux d’analphabétisme dans le milieu, ne nous a pas rendus la tâche facile lors
de nos enquêtes. Cette situation nous a rendu dépendant vis-à-vis de l’animateur qui
lui est du milieu mais n’était pas toujours disponible à nous aider. Pour surmonter
cette difficulté, nous avions essayé de nous conformer à son emplois du temps.
29
6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Notre stage dans la forêt classée de Dogo-Kétou nous a été d’un grand intérêt en ce sens
qu’il nous a offert l’occasion non seulement de nous familiariser avec notre futur cadre
professionnel mais aussi d’approfondir nos connaissances en techniques d’aménagement des
forêts. Par suite de ce stage, nous avons pu comprendre le déroulement des activités au cours
d’une campagne de reboisement. Il nous a également permit de relever grâce à l’outil (FFOM)
les forces-faiblesses, les opportunités-menaces du secteur. Après avoir identifié à travers les
entretiens les problèmes qui entravent la gestion durable du secteur et hiérarchisation de ces
problèmes à travers l’outil « pierre-cailloux » la présence des plantations privées dans le
domaine forestier a été désigné comme problème prioritaire.
En effet, à l'heure actuelle, il serait irréaliste de croire que la cogestion dans la forêt classée de
Dogo-Kétou reste sans aucun problème. Ainsi, dans le cadre d’un aménagement participatif et
d’une gestion durable de la forêt classée de Dogo-Kétou. Nous recommandons ce qui suit :
Réorganiser le système de cogestion en cours dans le secteur ;
Mettre en place les différents organes de cogestion prévus par le plan d’aménagement
participatif ;
Renforcer la sensibilisation des populations riveraines sur l’importance de la gestion
durable de la forêt classée ;
Renforcer les structures locales de cogestion pour qu’elles soient fonctionnelles et
participent à la préservation du patrimoine contre les feux et les sabotages de plants ;
Promouvoir des activités génératrices de revenus : Apiculture, la cuniculture
Réviser le système Taungya
30
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Affokpe D.M., 2012. Etude diagnostique du secteur forestier de Ouèdo. Mémoire de Licence,
FSA/UAC
CPADES, 2005. Plan de Développement Communale (Tome 1). 190 p
Dossa-Gbo C. F., 2013. Caractéristiques Structurales et Ecologiques de la Forêt de Pobè au
Sud- Est du Benin. Thèse d'Ingénieur Agronome, Faculté des Sciences Agronomiques,
Université d'Abomey-Calavi, 57 p.
FAO, 2004. Gestion participative des ressources naturelles: démarches et outils de mise en
œuvre. 85 p
FAO, 2005. Evaluation des ressources forestières mondiales. 322 p
Gassi BANI, 2006. Monographie de la Commune de Kétou. 46 p
Kakpo S.B. 2012. Caractéristiques Structurales et Ecologiques des Forets de Bonou et
D’itchede au Sud Est du Benin. Thèse d'Ingénieur Agronome, Faculté des Sciences
Agronomiques, Université d'Abomey-Calavi, 70 p.
PGFTR, 2010. Plan d’Aménagement Participatif de la Forêt Classée Dogo-Kétou. 139 p.
Tobada P., 2012. Etude diagnostique du fonctionnement du mode de gestion de la forêt de
Pobè au Sud-Bénin
31
ANNEXES
Annexe 1 : Guide d’entretien pour la collecte des données d’enquête au niveau des agents de
l’ONAB
1. Quel est votre nom?
2. Quel rôle jouez-vous au sein de l’Unité de Reboisement?
3. Quand est ce que l’Unité de Reboisement a commencé le reboisement dans la forêt ?
4. Quelles sont les attributions assignées à l’ONAB dans la forêt?
5. Quelles sont les ressources (équipements, infrastructures….) dont l’ONAB dispose?
6. Comment est assurée la gestion durable de la forêt ?
7. Quels sont les atouts du secteur ?
8. Quelles sont les forces et faiblesses du secteur ?
9. Quelles sont les opportunités et menaces rencontrées au niveau du secteur ?
10. Comment se fait le processus de cogestion de la forêt ?
11. Quel est le niveau d’implication de la population dans la cogestion ?
12. Quelles actions menées vous pour sauvegarder la forêt et ces ressources ?
13. Quelles sont les contraintes au développement durable de la forêt ?
14. Quelles sont les limites des lois de protection de la forêt ?
15. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans l’exécution de vos activités ?
Annexe 2 : Guide d’entretien pour la collecte des données d’enquête au niveau des
groupements socioprofessionnels
1. Que faites-vous dans votre association ? Quelles sont les différentes activités que vous
menez individuellement ?
2. Quel rôle joue la forêt dans votre vie économique et sociale ? Vous vous sentez concerner
par la gestion de la forêt ?
3. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités ? Pourquoi ?
4. Quelles solutions préconisez-vous ?
32
Annexe 3: Questionnaire administré au chef secteur
1. Quel est votre nom?
2. Quel est le rôle de votre unité/cellule au sein de l’ONAB?
3. Quelles sont les activités menées au sein de votre unité? (Décrire ces activités)
4. Quelles sont les étapes et démarches adoptées pour l’exécution de chacune de ces activités?
5. Quelles sont les ressources (ressources humaines, matérielles…) dont vous disposez pour
l’exécution des activités menées dans votre unité/cellule?
6. Quelles sont les relations qui existent entre votre unité/cellule et les autres unités de
l’ONAB?
7. Quels sont les secteurs forestiers sous gestion de l’ONAB dans lesquels vous intervenez?
Annexe 4 : Fiche individuelle de la connaissance sur le mode de gestion
I-Identification de l’enquêté
Nom……………………………… Prénom………………………………………
Sexe………………………………. Fonction……………
II- Cogestion
3) Comment se passe la gestion participative dans le périmètre forestier ?
4) Dans quelle ambiance a lieu la cogestion ?
5) Etes-vous satisfait ? Oui Non
Pourquoi ?
6) Si non, quelles approches de solution proposez-vous ?
7) Quelles sont les problèmes que vous rencontrez dans l’exécution de vos activités relatives à
la gestion de la forêt ?
8) Pouvez-vous hiérarchiser ces problèmes ?
9) Donnez quelques approches de solution permettant de résoudre ces problèmes ?
33
Annexe 5 : Zonage de la forêt classée de Dogo - Kétou
Annexe 6: Rôle des différents organes de la co-gestion
Organes Rôles
Conseil de Coordination des Unités
d’Aménagements (CCUA)
- élire en son sein le comité Exécutif
du CCUA dont les membres
proviennent d’une même UA ;
- adopter le budget Annuel de la
Forêt, les Plans Annuels de Travail et
les Budgets Prévisionnels des UA sur
proposition des CE/CGUA ;
- coordonner et superviser les
activités des CGUA ;
- régler les conflits nés de la mise en
œuvre du PAPF ;
Conseil de Gestion de l’Unité
d’Aménagement (CGUA)
- élaborer de concert avec le CPEF,
ou le CS le Plan de Travail de l’UA ;
- veiller à l’application correcte des
dispositions du PAPF au niveau de
34
l’UA ;
- collecter la contribution des usagers
au Fonds d’Aménagement et la
reverser au Trésorier-Comptable du
CE/CCUA ;
- assurer la formation des populations
riveraines ;
- informer les populations des
décisions prises ;
- rendre compte à la base de toutes les
questions relevant de la gestion de
l’Unité d’aménagement.
Conseil Villageois de Gestion de la Forêt
(CVGF)
- assurer la mobilisation et
l’animation du CVGF ;
- assurer la communication entre
l’AGEF et le CGUA ;
- faire exécuter le Plan Annuel de
travail de l’UA et en assurer le suivi ;
- donner un avis consultatif sur les
décisions prises par le CGUA ou le
CCUA à propos des conflits ;
- élire en son sein les membres du
CGUA ;
- collecter et verser au CGUA les
contributions provenant de
l’exploitation des pâturages, des
zones de culture et des plantations
privées ;
- assurer la gestion des conflits au
sein de l’AGEF.
35
Assemblée Générale des Exploitants de
la Forêt (AGEF)
- veiller à l’application des textes
législatifs et réglementaires en
vigueur et de dispositions du PAPF ;
- être les membres du Conseil
Villageois de Gestion de la Forêt ;
- se prononcer sur les admissions, les
démissions et les exclusions des
membres et en informer les instances
supérieures ;
- mettre sur pied une commission
indépendante d’enquête en cas de
mauvaise gestion constatée par le
CVGF, le CGUA et le CCUA ;
- approuver mes modifications des
statuts de l’OVGF/FC/..... .
Organisation Villageoise pour la Gestion
des Forêts (OVGF)
- l’exploitation des ressources
forestières desdites forêts ;
- la création d’emploi et
l’amélioration des revenus ;
- l’amélioration de la productivité des
forêts ;
- l’entretien des pistes.