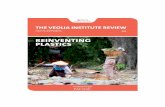Ethnographies politiques de la violence - OpenEdition Journals
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Ethnographies politiques de la violence - OpenEdition Journals
Cultures & Conflits
103-104 | automne/hiver 2016Ethnographies politiques de la violencePolitical ethnographies of violence
Édition électroniqueURL : http://journals.openedition.org/conflits/19332DOI : 10.4000/conflits.19332ISSN : 1777-5345
Éditeur :CCLS - Centre d'études sur les conflits lilberté et sécurité, L’Harmattan
Édition impriméeDate de publication : 20 décembre 2016ISBN : 978-2-343-11087-5ISSN : 1157-996X
Référence électroniqueCultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016, « Ethnographies politiques de la violence » [Enligne], mis en ligne le 20 décembre 2018, consulté le 30 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/conflits/19332 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.19332
Ce document a été généré automatiquement le 30 mars 2021.
Creative Commons License
La définition de la violence politique a donné lieu à des débats dans les sciencespolitiques comme en anthropologie. Elle recouvre un vaste spectre de situations quipeuvent se superposer dans les faits, et dont la qualification – divergeant au gré desacteurs et des mémoires – est elle-même un enjeu politique. En explorant terrainsproches et lointains, systèmes politiques dictatoriaux ou démocratiques, lesethnographies présentées dans ce numéro analysent la complexité des régimes depouvoir au-delà ou en-deçà des catégories instituées de la science politique. Ce numérosouhaite ainsi enrichir la question des usages, des effets et des réalités vécues de laviolence, dans une analyse empiriquement fondée des rapports entre pouvoir etrésistance, obéissance et consentement, mais aussi transformation des subjectivitéspolitiques.The definition of political violence has been the subject of much debate, notably in thedisciplines of political science and anthropology. It covers a vast spectrum of situationsin which it may superimpose itself upon facts and for which the qualification, divergingat the mercy of actors and of memories, is itself political. In exploring lands near andfar as well as both authoritarian and democratic political systems, the ethnographiespresented in this issue analyze the complexity of power regimes beyond and parallel tocategories established in political science. This issue aspires to enrich debates on theuses, effects and lived realities of violence by engaging an empirically based analysis ofrelations between power and resistance, obedience and consent, while equally takinginto consideration the transformation of political subjectivities.
NOTE DE LA RÉDACTION
Ont participé à ce numéro : Marc Bernardot, Jawad Bouadjadja, Colombe Camus,Stephan Davidshofer, Marielle Debos, Konstantinos Delimitsos, Didier Georgakakis,Emmanuel-Pierre Guittet, Fabienne Hara, Monique B. Jeerli, Angelina Peralva, GabrielPériès, Gregory Salle, Amandine Scherrer, Jerôme Tournadre
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
1
SOMMAIRE
Dossier
Ethnographies politiques de la violence IntroductionChiara Calzolaio, Pamela Colombo et Chowra Makaremi
« États d’urgence ethnographiques » : Approches empiriques de la violence politiqueChowra Makaremi
Ethnographier la violence d’État : récits et expériences des victimes de la lutte contre lenarcotrafic à Ciudad Juárez, MexiqueChiara Calzolaio
La fabrique des indésirablesPratiques de contrôle aux frontières dans un aéroport européen Andrew Crosby et Andrea Rea
L’urbanisation forcée comme politique contre-insurrectionnelle La vie au sein des villages stratégiques construits en Argentine (1976-1978)Pamela Colombo
Écrire (sur) un massacre : Acteal 1997-2008 (Mexique)Enjeux d’écriture, enjeux d’interprétationsSabrina Melenotte
Désarmer le sujet : souvenirs de la guerre et citoyenneté imaginée au PérouKimberly Susan Theidon
Hors thème
Les veines ouvertes de l’héritageLes mandats familiaux de la mémoire de l’exil chilienFanny Jedlicki
« Danses macabres » : Une technologie culturelle du massacre des Tutsi au RwandaThomas Riot, Nicolas Bancel et Herrade Boistelle
Regards sur l'entre-deux
Marronnages érotiques : le dancehall jamaïcain entre culture et slacknessEntretien avec Carolyn CooperJérôme Beauchez et Carolyn Cooper
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
2
Ethnographies politiques de laviolence Introduction
Chiara Calzolaio, Pamela Colombo et Chowra Makaremi
1 La définition de la violence politique a donné lieu à des débats dans les sciences
politiques comme en anthropologie 1. Elle recouvre un vaste spectre desituations (arrestations, détentions extra-légales, tortures, disparitions forcées,exécutions, tueries, massacres, guerres civiles, opérations de contre-insurrection…) quipeuvent se superposer dans les faits, et dont la qualification – divergeant au gré desacteurs et des mémoires – est elle-même un enjeu politique. Ce dossier réunit une séried’ethnographies qui, en évitant une définition a priori de la violence, préfèrent dirigerle regard vers les expériences vécues qui en sont faites, et les rapports sociaux danslesquels elles s’insèrent. Par ethnographie, nous entendons une modalitéd’appréhension du réel, mais aussi une pratique réflexive sur ses pratiques empiriquesde recherche (qui ne se limitent pas à faire des observations et des entretiens, ou lesdeux), sur ses expressions théoriques et ses pratiques d’écriture. Fondées sur desterrains approfondis, ces ethnographies sont politiques en ce qu’elles permettent depenser la violence dans son rapport au conflit et au pouvoir, que ce soit du point de vuede son maintien ou de sa contestation.
2 L’anthropologie n’est certes pas la discipline qui s’est intéressée le plus tôt et le plus
volontiers à la question de la violence politique. Au contraire, le prisme du relativismeculturel quant à ce qui est « violent » et le refus d’aborder les enjeux politiquescontemporains de la recherche – du fait d’une complicité directe avec l’entreprisecoloniale, puis plus indirecte avec la domination occidentale 2 –, a amené lesanthropologues – y compris les plus prestigieux – à se taire de façon notoire sur desterrains de violence. Par exemple Julian Pitt-Rivers peut étudier les hiérarchiespolitiques et sociales d’une communauté rurale espagnole en 1954, en laissantentièrement de côté le franquisme et son mode brutal de (re)production des rapportssociaux. Clifford Geertz parvient quant à lui à écrire son étude de référence sur lescombats de coq en Indonésie sans mentionner une seule fois le massacre descommunistes qui vient d’avoir lieu sur son terrain 3. Toutefois, après la guerre froide, la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
4
discipline commence à s’intéresser à la question de la violence et réfléchit sur lesenjeux de terrains « sous les balles », ou « en état d’urgence » 4, ouvrant la voie, à partirdes années 2000, à une anthropologie politique de la violence fondée sur un travailethnographique approfondi 5. Longtemps absente en France 6, la question a été rouverteà la faveur de cette littérature récente 7. Ce numéro de Cultures & Conflits s’inscrit danscette continuité, explorant ce que cette production scientifique contemporaine, moinsdiffusée en France, apporte aux études de la violence dans son rapport au pouvoir, àl’État, et au conflit. Il prolonge une série de réflexions de la revue sur les usages de laviolence dans les démocraties et les pratiques illibérales qu’elles déploient sur ceterrain 8.
3 Tout en prenant appui sur un vaste travail de théorisation de la violence qui a
accompagné le XXe siècle 9, les ethnographies politiques qui composent ce numéro
cherchent à se détacher d’un biais qui a longtemps marqué les sciences sociales : celuide la dichotomie entre, d’un côté, l’intellect, le discours, l’idéologie et de l’autre, lecorps, la violence physique et le domaine de l’irrationnel. Elles proposent ainsi de sedétacher d’une approche essentialiste, pour aborder les situations de violence àl’échelle des expériences individuelles et collectives. La violence politique peut êtrecontestataire et revendiquée comme outil d’opposition à l’ordre social et politique.Mais elle est aussi, et souvent, organisée par l’État (et/ou les élites) et légitimée par lemaintien de l’ordre. Ce dossier propose d’explorer les relations qu’entretiennent cesdeux dynamiques et leurs effets sur les subjectivités des individus. Si les ethnographiespolitiques de la violence se distinguent par le brouillage des dichotomies, c’est aussi enrefusant celle entre terrains lointains, exotiques, où prévaut encore une lectureessentialiste, et un usage pléthorique du concept de culture comme prismed’interprétation et d’explication, et les terrains proches, c’est-à-dire les sociétésoccidentales où la question de la violence est presque exclusivement étudiée commeprocessus politique, souvent saisi dans des débats juridiques. Or, se déprendre de ladistinction entre « eux » et « nous » permet d’affranchir l’analyse des démarcationsnormatives et des catégorisations qui définissent les différents régimes politiques :démocraties, États de droit, dictatures, États faillis, etc.
4 En ouverture du numéro, Chowra Makaremi introduit les débats théoriques et
méthodologiques, mais aussi les enjeux épistémiques qui traversent la littératureanthropologique contemporaine. Chiara Calzolaio explore, dans leur expérience maisaussi leur narration, les pratiques de la violence d’État qui ont accompagné lesopérations militaires de lutte contre le narcotrafic au Mexique. Andrew Crosby etAndrea Rea se penchent quant à eux sur les dynamiques de production de sujets« indésirables » en analysant les pratiques de contrôle policier dans un aéroporteuropéen et les violences symboliques aussi bien que les espaces de pouvoirdiscrétionnaire qu’elles engendrent. Pamela Colombo étudie la vie quotidienne au seindes « villages stratégiques » – dispositifs spatiaux de contre-insurrection créés pendantla dictature militaire en Argentine. Sabrina Melenotte aborde les discours,qualifications et assignations produits autours du massacre d’Acteal comme une voied’accès à la compréhension du phénomène paramilitaire et, plus largement, dufonctionnement du régime mexicain. Kimberly Theidon, enfin, explore les usagespolitiques des récits de la guerre civile dans une région rurale du Pérou et notammentla manière dont ils participent à la création de nouveaux rapports de pouvoir,d’ethnicité et de genre. Nous avons jugé utile d’introduire ce travail, inédit en français,qui présente les modalités théoriques et méthodologiques d’une anthropologie de la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
5
violence à la lumière des enjeux de genre et montre toute la pertinence et la richesseconceptuelle de cette grille d’analyse.
5 Résolument pluridisciplinaires, les articles réunis dans ce numéro présentent un
éventail de la diversité méthodologique qui caractérise le travail ethnographique. Enreprenant les théories de la « street-level bureaucracy », Andrea Rea et Andrew Crosbyanalysent ainsi la mise en œuvre des politiques publiques de contrôle des frontièreseuropéennes à travers une observation des pratiques ordinaires et des interactionsentre gardes-frontières et voyageurs. En se basant sur des récits de vie et des récits desoi de victimes non organisées en association, Chiara Calzolaio creuse les effets desnarrations hégémoniques de la violence sur les expériences sociales. Or, la pratiqueethnographique ne se limite pas à la présence sur le terrain, mais peut s’ouvrirégalement à des façons de travailler avec des documents écrits, des dispositifsd’écritures saisis comme tels et éclairés en retour par l’observation. Sabrina Melenottetravaille ainsi à partir de la production existante d’une littérature juridique autour dela qualification d’un massacre et de ses acteurs. À partir de recherches de terrainsapprofondies, Pamela Colombo et Kimberly Theidon abordent les expériences despaysans qui ont subi la mise en place de différentes politiques de contre-insurrectionen Argentine et au Pérou en les mettant en dialogue avec l’analyse de textes écrits, qu’ils’agisse de la documentation militaire ou des Libros de Actas des communautésindiennes. Cette démarche permet d’approcher la complexité des mémoires et le rôlequ’y jouent les différentes productions écrites. Chowra Makaremi discute la question dela présence sur le terrain et la possibilité d’une ethnographie de l’après-coup ou « àdistance ». Dans cette diversité d’approches, toutefois, une exigence partagée partoutes les contributions demeure la prise en compte de ce que Kimberly Theidonnomme la « polyphonie ». Il s’agit en effet de laisser leur place au foisonnement desvoix et aux contradictions qui font l’étoffe de la réalité vécue, sans opération de lissageou point de vue surplombant unificateur.
6 L’attention portée aux expériences vécues permet d’approcher la violence politique
dans son quotidien, que ce soit dans les pratiques routinières du travail des agents del’État dans un aéroport européen, dans l’organisation de la vie dans un « villagestratégique » sous la dictature militaire en Argentine ou dans une ville frontalière duMexique dans les années de la guerre contre la drogue. Ces observations du routinier, ycompris en situation d’exception, permettent d’entrer dans le grain fin des situationsde violence. Mais elles permettent aussi, à travers une opération de montée engénéralité, d’en compléter, d’en renouveler, d’en infléchir l’analyse conceptuelle etthéorique. Notamment, les études du quotidien explorent les mécanismes politiques etsociaux à travers lesquels la violence est produite et produit, à son tour, des régimes devie, des espaces, des sujets.
7 En explorant terrains proches et lointains, systèmes politiques dictatoriaux ou
démocratiques, les ethnographies présentées dans ce numéro analysent la complexitédes régimes de pouvoir au-delà ou en-deçà des catégories instituées de la sciencepolitique. Andrea Rea et Andrew Crosby s’attachent au déploiement du pouvoirdiscrétionnaire aux frontières des États de droit européens dans la gestion policière desmobilités. Chiara Calzolaio étudie le traitement des délinquants comme « ennemis »dans une guerre contre la drogue qui implique un continuum complexe et opaqued’acteurs policiers et militaires au Mexique. À l’inverse, Pamela Colombo observe lespolitiques « d’action civique » des militaires argentins, analysant l’inclusion forcée de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
6
paysans subalternes dans une nouvelle citoyenneté façonnée à travers les villagesstratégiques – villages situés à quelques kilomètres seulement des centres de détentionet de torture où disparaissaient d’autres citoyen(ne)s considérés comme « subversifs ».L’ethnographie de l’État à l’épreuve de la violence met ainsi en lumière la porosité desfrontières entre ce qui est étatique et ce qui ne l’est pas, tout en ouvrant des pistes deréflexions autour des circulations des savoirs et des pratiques sécuritaires – que ce soità travers la réactivation d’héritages ou les transferts transnationaux.
8 Cette approche pose la question de la visibilité et de l’invisibilité de la violence – de son
invisibilisation et de sa visibilisation, tant par les dispositifs du pouvoir que par ceux del’écriture. Si le massacre d’Acteal dans le Chiapas ou le conflit armé entre Sentierlumineux, militaires et paramilitaires au Pérou sont des situations de violencecollective évidente, d’autres terrains présentés dans ce numéro nous confrontent à laquestion de la violence là où elle ne se pose pas de manière aussi directe dans ses effets,tel que les villages stratégiques en Argentine ou les postes de contrôle aéroportuairesaux frontières européennes. Si le terrain ethnographique rend visible ce qui ne l’étaitpas, il peut aussi changer notre lecture de ce qui l’était déjà, ce que l’on observe deprime abord, ou la documentation écrite avec laquelle on travaille. Ce travail ouvre despistes de recherche sur le fonctionnement du pouvoir, sa localisation, ses productions.
9 L’une de ces dimensions est celle des relations entre espaces et violences. Les dispositifs
spatiaux de contrôle, tels que les aéroports ou les villages stratégiques, sont produitspar des régimes de gouvernementalité différents, dont l’étude nous permet de saisircomment le pouvoir se spatialise et circule dans la société. Un enjeu de la violencerenvoie alors aux façons dont l’État investit et se rend présent dans des espacescontestés, des territoires marginaux – les zones rurales isolées, des régions travailléespar des processus d’autonomisation politique, des zones franches, l’espace ambigu desaéroports, à la fois zones internationales et frontières d’États – pour y produire descitoyens ou des non-citoyens.
10 Les rapports entre violence et subjectivité sont abordés sous plusieurs angles. Certaines
analyses s’intéressent aux modalités par lesquelles la violence façonne des sujetspolitiques marginaux : les usagers de drogue (victimes invisibilisées de la lutte contre lenarcotrafic au Mexique) ou les voyageurs irréguliers incarcérés et renvoyés dans lesespaces de frontière. D’autres creusent la question des acteurs de la violence, lesmanières dont l’État les « fabrique », s’appuie sur eux, les soutient et, à travers ceprocessus, s’enracine (au Pérou andin) et se perpétue dans la longue durée (enArgentine). Si les ethnographies analysent la production de formes d’appartenancenationales dans les zones grises de la violence étatique, elle mettent en lumièrecomment ces formes de (non)citoyenneté se construisent dans les faits au contact d’uneviolence d’État qui se légitime et s’appuie sur des figures de l’ennemi : le migrantclandestin, le subversif, le narcotraficant, le terroriste, le guérillero.
11 Par ailleurs, la production des sujets politiques considérée au prisme de l’appartenance
et des identités collectives pose la question de la mémoire, ou plutôt des mémoires de laviolence. Le travail de terrain ne donne pas accès à une « réalité historique » desévénements, mais permet d’en explorer les expériences vécues et leur impact dans untemps long. Plusieurs textes montrent comment des cadres interprétatifshégémoniques sont élaborés ou repris par différents acteurs. Kimberly Theidon montreainsi comment, au Pérou, les milices paysannes, les « ronderos », s’approprient la notionde citoyenneté en reprenant à leur compte les normes de genre qui survalorisent une
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
7
masculinité guerrière, héritées de la formation militaire à travers laquelle l’État s’estrendu présent dans ces territoires relégués. Le droit apparaît également comme unoutil de production et un espace polémique de mémoire collective. C’est ce qu’illustreSabrina Menelotte à travers le traitement juridique d’un massacre par l’État mexicain,ou encore Chowra Makaremi avec l’évocation des « tribunaux d’opinion » qui utilisentles fonctions symboliques du droit pour dénoncer et pallier l’impunité des crimesd’État, mais aussi les documenter – en fabriquer une contre-mémoire.
12 Or, la question de la violence en tant qu’elle est saisie par le droit introduit la figure de
victime, qui est d’abord une catégorie juridique. Observer les relations entre violenceset qualifications juridiques de la violence permet de montrer les hiérarchisationsimplicites à l’intérieur de cette catégorie, entre par exemple les victime « légitimes » etles victimes « illégitimes » de la violence d’État au Mexique que sont les usagers de ladrogue ; mais aussi les renversements possibles de « bourreau » à « victime » dans lecas de la relecture du massacre d’Acteal une décennie après les événements. Pourautant, il ne s’agit pas de simplifier les relations entre violence et droit en présentant ledroit comme ce qui s’oppose à la violence – ce qui vient la contenir, la résoudre, larésorber, y substituer d’autres régimes de conflictualité. C’est ce que rappelle l’articled’Andrea Rea et Andrew Crosby, en s’attachant à la violence et aux espaces de pouvoirqu’elle produit au sein de l’État de droit.
13 Ainsi, en assemblant des sujets qui ne l’auraient pas été sauf à considérer les approches
anthropologiques dont ils relèvent, ce numéro souhaite enrichir la question des usages,des effets et des réalités vécues de la violence, dans une analyse empiriquement fondéedes rapports entre pouvoir et résistance, obéissance et consentement, mais aussi de latransformation des subjectivités politiques.
NOTES
1. Voir Nagengast C., « Violence, Terror, and The Crisis of The State », Annual Review of
Anthropology, vol. 23, n° 1, 1994, pp. 109-136 ; Bourgois P., « La violence en temps de guerre et en
temps de paix. Leçons de l’après-guerre froide : l’exemple du Salvador », Cultures & Conflits, n° 47,
2002, pp. 81-116.
2. Ces liens (et conditions de production de la connaissance) sont notamment analysés dans
Geertz C. et G. Marcus, Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University
of California Press, 1986.
3. Pitt Rivers J., The people of the Sierra, Chicago, University of Chicago Press, 1971 (1954) ; Clifford
G., « Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight », Daedalus, vol. 101, n° 1, « Myth, Symbol, and
Culture », hiver 1972, pp. 56-86.
4. Voir Nordstrom C. et A. Robben, « Introduction », et Feldman A., « Ethnographic States of
Emergency », in Nordstrom C. et A. Robben (eds.), A. Fieldwork Under Fire. Contemporary Studies of
Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, 1995, pp. 1-23 et pp. 224-252.
5. Ce champ a notamment été balisé par la trilogie : Kleinman A., Das V. et M. Lock (eds.), Social
Suffering, Berkeley, University of California Press, 1997 [1996] ; Das V., Kleinman A., Ramphele M.
et P. Reynolds (eds.), Violence and Subjectivity, Berkeley, University of California Press, 2000 ; Das
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
8
V., Kleinman A., Lock M., Ramphele M. et P. Reynolds (eds.), Remaking a World: Violence, Social
Suffering, and Recovery, Berkeley, University of California Press, 2001. Voir aussi : Scheper-Hughes
N. et P. Bourgois (eds.), Violence in War and Peace: An Anthology, Malden, MA, Blackwell, 2003 ;
Fassin D., « The Trace: Violence, Truth, and the Politics of the Body », Social Research, vol. 78, n° 2,
2011, pp. 281-298.
6. À de rares exceptions près comme Lenclud, G., Claverie E. et J. Jamin, « Une ethnographie de la
violence est-elle possible ? », Études rurales, n° 95-96, 1984, pp. 9-21.
7. Entre autres : Naepels M., « Quatre questions sur la violence », L’Homme, vol. 177-178, 2006,
pp. 487-495 et Conjurer la guerre : violence et pouvoir à Houaïlou, Nouvelle-Calédonie, Paris, France,
École des hautes études en sciences sociales, 2012 ; Lavergne C. et A. Perdoncin, « La violence à
l’épreuve de la description », Tracés. Revue de Sciences Sociales, « Décrire la violence », n° 19, 2010,
pp. 5-25 ; Bourgois P., « Théoriser la violence en Amérique », L’Homme, 2012, vol. 203-204,
pp. 139-168.
8. Voir notamment « La violence dans les démocraties occidentales » (n° 9-10, 1993), « Les
disparitions » (n° 13-14, 1994), « Construire l’ennemi intérieur » (n° 43, 2001), « Suspicion et
exception » (n° 58, 2005), « Antiterrorisme et société » (n° 61, 2006), « Le passage par la violence
en politique » (n° 81-82, 2011), « Militantisme et répression » (n° 89, 2013).
9. Arendt H., The origins of totalitarianism, New York, Brace and Co, 1951 ; Benjamin W.,« Critique
of violence », Reflections, vol. 14, n° 3, 1978 (1927), pp. 277-300 ; Canetti E., Masse et puissance, Paris,
Gallimard, 1966 ; Foucault M., Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978,
Paris, Gallimard, 2004 ; Tilly C., The politics of collective violence, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003 ; Weil S., « L’Iliade ou le poème de la force », in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto
», 1999, pp. 548-49.
AUTEURS
CHIARA CALZOLAIO
Chiara Calzolaio est doctorante en anthropologie sociale et ethnologie à l’EHESS. Elle s’intéresse
aux manifestations contemporaines de la violence, notamment aux violences de genre et à celles
liées à la criminalité organisée et à la lutte contre le narcotrafic au Mexique, en conjuguant deux
niveaux d’analyse : celui des expériences corporelles, subjectives et sociales de la violence et celui
de sa problématisation publique et politique.
PAMELA COLOMBO
Pamela Colombo est docteure en sociologie de l’Université du Pays Basque. Chercheuse Marie
Skłodowska-Curie à l’EHESS et associée au programme ERC « Corpses of Mass Violence and
Genocide » (2014-2016), elle travaille actuellement sur la construction des « villages
stratégiques » en Amérique latine. Ses publications portent principalement sur le lien entre
espace et violence d’État.
CHOWRA MAKAREMI
Chowra Makaremi est chargée de recherche au CNRS, membre de l’Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS). Ses travaux portent sur l’anthropologie de l’État,
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
9
les formes juridiques et ordinaires de la violence et l’expérience qu’en font les sujets, notamment
en situation d’exil.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
10
« États d’urgenceethnographiques » : Approchesempiriques de la violence politique“Ethnographic States of Emergency”: Empirical Approaches to Political Violence
Chowra Makaremi
1 Notre actualité manifeste un intérêt renouvelé pour les approches anthropologiques de
la violence, attendant d’une discipline historiquement tournée vers les sociétés non-occidentales qu’elle nous explique les causes culturelles et religieuses de la violence,comme par exemple la « culture de la mort 1 » qui serait à la racine du terrorismeislamiste en 2001, djihadiste aujourd’hui. Cette mise à contribution du savoiranthropologique lui ouvre de nouveaux champs d’expertise pour éclairer notre présent,en se fondant sur une distinction implicite relevée par Talal Asad : la violence exercéepar les « nations civilisées », souvent étiquetée comme opération de sécurité,intervention humanitaire ou dommage collatéral, ne semble relever d’aucune cultureou rapport à la violence particuliers, tandis que le rapport à la violence des « nationsnon-civilisées » requiert des grilles de compréhension spécifiques mobilisant le conceptde culture 2. À contre-courant de ces attentes, de nombreuses études ont défendu,défini, discuté dans la dernière décennie une anthropologie de la violence qui se fondenon pas sur une exploration de ses dimensions culturelles ou religieuses, mais sur untravail méthodologique et épistémologique, dont cet article veut évoquer quelquesenjeux principaux.
2 Ces approches dialoguent avec les travaux de science politique, bien plus précoces
autour de ces thèmes, en tant qu’elles s’engagent dans une analyse instrumentale de laviolence et de ses effets dans l’institution, le renversement, la consolidation etl’organisation d’ordres politiques et sociaux. Mais sans pour autant réduire l’analyse àcette dimension instrumentale, dans la mesure où la violence, comme « événementcritique 3 », est observée dans une expérience singulière de langage et de temps. Lesenquêtes croisées s’intéressent aux rationalités et aux cultures institutionnelles, maisaussi aux débordements, aux affects et aux non-dits de la violence. Cette démarche
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
11
ethnographique permet de rentrer dans le grain fin des situations, en-deçà desqualifications de génocides, de féminicides, de guerre civile, etc., mais aussi de remettreen perspective ces cadres d’élaboration et de qualification juridique de la violence, parrapport aux différentes mémoires, contre-mémoires, constructions identitaires etformes de rétributions internationales qui y sont liées.
3 Elle permet deux opérations particulièrement heuristiques : d’un côté, entrer dans le
détail de la vie quotidienne et de la routine dans des situations où l’exception devient larègle ; d’un autre côté, offrir à la dimension subjective la part qui lui revient, en sedonnant les moyens d’examiner les émotions politiques et les visions du monde àtravers lesquels la violence est vécue et produite. À travers un jeu d’échelles quiarticule les dimensions politiques et intimes, l’ethnographie explore la place accordéedans l’action aux croyances, aux visions du monde, aux cadres de perception et auxsystèmes moraux, et s’intéresse aux formes psychiques d’intériorisation des conflits 4.Au-delà de l’opposition entre rationalités et débordements (souvent renvoyés à un« indicible »), des auteurs ont fait d’affects comme la colère 5, la peur 6, l’outrage oul’indignation 7, le sujet d’une analyse qui creuse ces moments où les émotions,individuelles, se réélaborent à un niveau collectif et le mouvement par lequel elles« reconfigurent l’espace du politique 8 ».
4 Un nombre grandissant de travaux a illustré les apports de l’ethnographie dans les
études du politique et les relations internationales 9. Tout en insistant sur la méthode,l’entrée par le terrain et le jeu d’échelles, ces travaux conservent les questions derecherche, les pratiques analytiques (telles que l’analyse comparée et le recoursaux case studies) et les catégories conceptuelles propres à ces disciplines. Le présentarticle s’intéresse au contraire aux apports spécifiques de la démarche ethnographiqueen tant qu’elle entraine une travail de restitution, d’écriture et d’analyse, enproblématisant notamment les écarts épistémiques et les expériences subjectives àtravers lesquelles se donne à saisir la violence. Depuis les années 2000, une série detravaux ont ainsi proposé les contours, les thèmes, les méthodes et les modalitésd’écriture d’une anthropologie de la violence politique. À travers une démarche ancréeempiriquement, celle-ci s’attache à décrire et comprendre des phénomènes de violencecollective dans leurs rapports aux structures de pouvoir et aux institutions, auxdynamiques et structures sociales, mais aussi à travers leur empreinte et leurexpérience dans la vie quotidienne, et les modes de subjectivation qui s’y négocient. Cetarticle se veut une présentation et une discussion des enjeux qui traversent cettelittérature, autour de trois thèmes : les implications et les défis de la pratique duterrain dans l’étude de la violence, l’espace/temps de la violence et la relation de laviolence à la question du pouvoir et de l’État.
Écarts épistémologiques
5 J’aimerais entrer dans cette analyse en partant d’une scène observée lors d’un terrain
de recherche sur la violence d’État dans l’Iran post-révolutionnaire (1979-1989) et lesformes de mémorialisation de la violence au sein de la diaspora iranienne. Une partiede ce terrain a consisté en l’observation de la préparation et des audiences d’un« tribunal d’opinion sur les crimes de l’État iranien » qui s’est tenu à Londres en juin2012 et à La Haye en octobre 2012. Cette forme d’événement public, qui reproduit avecprécision les modalités et les procédures de la justice transitionnelle, est organisée de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
12
plus en plus souvent par des mouvements de la société civile pour à la fois dénoncer etpallier l’absence de recours juridiques institutionnels pour l’instruction de certainscrimes d’États 10. En octobre 2012, plus de quarante témoins (proches et survivants) ontété appelés à la barre du « tribunal sur les crimes d’État en Iran entre 1981 et 1988 »,pour témoigner des arrestations massives, des détentions, des tortures et desexécutions, puis des massacres qui ont frappé les opposants de la République islamiquedurant la première décennie de ce régime.
6 Dans la grande salle du « Palais de la paix » de la Cour Internationale de Justice de la
Haye, où se tenait l’événement, appelée à la barre, Madame Alkani a prêté serment,puis elle a donné son témoignage en répondant en persan aux questions du procureur,tandis qu’une traduction simultanée était assurée pour les juges anglophones et lepublic (toutefois largement composé d’Iraniens). Cette femme menue âgée d’unesoixantaine d’années témoignait de la mort de cinq membres de sa famille, enlevés puisexécutés par les milices des Gardiens de la révolution (Sepah) lors des opérationsmilitaires au Kurdistan en 1981. Racontant dans un langage simple la disparition puis larecherche des dépouilles de ses frères, sœurs et père, elle précisait que le corps d’un deses frères avait été rendu par le Sepah dans un cercueil scellé et que, bravantl’interdiction qui leur avait été faite de l’ouvrir, elle avait pu constater de ses propresyeux que « cinq jours après son exécution, il saignait encore ». Des sourires incrédulesont traversé l’audience, composée en partie d’anciens prisonniers et de proches dedisparus. Tandis que ni les juges, ni le procureur n’ont relevé ce détail du témoignage,plusieurs auditeurs m’en ont reparlé par la suite, embêtés par ces proposinvraisemblables qui discréditaient le sérieux du témoignage. Dans une situationd’impunité et de déni des crimes d’État en Iran, où la plupart des perpétrateurs sontaujourd’hui encore au pouvoir et où la mention de ces événements est violemmentréprimée, le tribunal ne pouvait s’appuyer sur aucune documentation administrative nienquête menée sur place. Seuls restaient donc les témoignages des victimes. Celui deMme Alkani était important, en ce qu’il livrait de nombreux faits, lieux et noms, tout endonnant une idée de l’ampleur qu’avait pu prendre la violence et de ses modalités. Maisil était fragile, parce que le témoin racontait ces faits dans une langue sans contestedifférente de celle des juges et des experts de la justice transitionnelle. Cette façondifférente de raconter, cet écart épistémologique, invalidait-il pour autant sontémoignage ?
7 Mes recherches se heurtaient et se heurtent encore aux mêmes obstacles que ceux
rencontrés par le tribunal : absence de sources officielles, de documentationadministrative, impossibilités de l’enquête sur place 11. Dans mon cas également, il restedes récits – histoires orales plutôt que témoignages – et la question suivante : commentcomprendre dans ce contexte le travail d’établissement des faits et comment travailleravec les écarts épistémologiques qui traversent la perception, l’expérience et lesreprésentations de la violence vécue ? C’est l’attention apportée à ces questions quiconstitue la démarche ethnographique.
« C’est en partant de l’inadéquation descriptive entre les assises conceptuelles et lesexcès de l’expérience empreinte de terreur que l’exploration ethnographique doitcommencer, et on ne peut s’attendre à aucune linéarité ou trajectoire continue àtravers ces états d’urgence ethnographiques 12 ».
8 Allen Feldman rappelle la dimension constructive de la violence, qui « possède des
effets de structuration et de cadrages propres », produit de la mémoire, de nouvellesperceptions, des espaces et des temporalités, d’autres rapports sociaux. Dès lors,
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
13
l’entreprise de savoir qui cherche à saisir ces phénomènes se trouve affectée par leurseffets dans le mouvement même par lequel elle enregistre ces matériaux empiriques etles incorpore dans une démarche d’analyse. Cette mise en relation entre l’activitécognitive et les effets de la violence est au fondement de l’écriture ethnographique.
Observer, documenter, représenter la violence
9 L’enquête de terrain et l’« observation participante » s’imposent comme une des lignes
de partage entre ce qui est de l’ethnographie et ce qui n’en est pas. Or, lorsque lesrecherches portent sur des questions de violence politique et de violence collective, laquestion se pose de savoir si étudier la violence, c’est forcément l’observer. Etréciproquement, est-ce que l’absence d’observation de première main de l’interactionviolente nous exclut d’emblée du champ ethnographique ? Les questions se suiventalors en cascade : comment et jusqu’où est-il possible d’observer des phénomènes deviolence en train de se produire ? Est-on nécessairement hors de l’enquêteethnographique lorsqu’on travaille sur une violence qui a eu lieu dans un passé (plus oumoins) proche ?
Violences passées
10 La plupart des travaux cités dans cet article s’attachent à des violences passées et, s’ils
contiennent un volet d’enquête sur le terrain, celui-ci se compose principalementd’entretiens ethnographiques et de récits de vie – et non d’observations. VincentCrapanzano étudie la mémoire de la migration violente des harkis après la guerred’Algérie et sa non-transmission aux générations suivantes 13 ; Nenni Panourgias’intéresse au traitement des opposants communistes comme « ennemis de l’État » sousla dictature grecque jusqu’en 1974 et à leur encampement 14 ; les travaux de KimberlyTheidon portent sur le conflit armé au Pérou qui s’étend de 1980 au milieu des années1990 15 ; l’ouvrage de Michel Naepels sur la conflictualité en Nouvelle Calédonieconsacre cinq chapitres sur six à des épisodes de violence (majoritairement coloniaux)qui eurent lieu avant l’arrivée de l’anthropologue sur le terrain au début des années1990 16 ; les analyses de Veena Das sur les rapports entre violence et langage s’appuientsur une étude des violences sexuelles envers les femmes lors de la partition indo-pakistanaise de 1947-48 17 ; Allen Feldman est présent au cœur du conflit lorsqu’il mènesa recherche sur la terreur politique en Irlande du Nord, analysant en particulier lesconfigurations de l’espace et le corps comme lieu d’inscription et de transcription de laviolence. Il décide pourtant de travailler exclusivement à partir d’entretiens. C’est enpartant non de l’observation mais de la seule histoire orale que l’auteur construit sarecherche comme « projet culturel-politique » de narratologie de la violence et del’événement 18.
11 Ainsi, de nombreuses ethnographies de la violence ne fondent pas l’enquête sur une
observation directe des phénomènes étudiés (souvent passés), mais mobilisent unemédiation qui fait appel aux enjeux de récit, de discours et de mémoire, posant à larecherche des questions spécifiques de méthode et d’éthique. Au niveau du recueil desdonnées, les recherches croisent des matériaux hétérogènes, mêlant entretiensethnographiques et sources documentaires : sources coloniales ; rapports d’expéditionscomme c’est le cas de Michel Naepels en Nouvelle Calédonie ; documentation
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
14
institutionnelle telles que les listes d’attribution des compensations et relogementssociaux collectées par Deepak Mehta pour analyser le rôle de l’État indien dans lesviolences intercommunautaires dans le Gujarat en 2002 ; rapports d’ONG ; témoignagesrecueillis lors des commissions de vérité et réconciliation tels que le corpus extensifqu’utilise Victoria Sanford dans son travail sur les fosses communes au Guatemala 19.
Production de savoir, enjeux de pouvoir
12 La question de l’observation en lien avec la présence sur le terrain pose une autre
question, qui est celle de la position du chercheur. La première difficulté est celled’investir des terrains considérés à risque lorsque les institutions universitairescherchent à se protéger en exerçant un contrôle en amont sur les activités deschercheurs 20. Lorsqu’on parvient à être présent sur ces terrains, comment négocier sesaccès aux lieux et aux récits dans des contextes où la circulation – des corps, de laparole – est saturée d’enjeux de pouvoir, dangereuse, potentiellement mortelle ? Enprenant acte, d’abord, que la neutralité n’est pas une option disponible comme lerappelle Kimberly Theidon :
« Quand la terreur pénètre une communauté, les mots ne sont plus de simplesinformations – les mots deviennent des armes et si vous posez une question, celaveut dire que vous avez l’intention de faire quelque chose de la réponse 21 ».
13 Cette situation peut amener les chercheurs à contextualiser leur enquête en dressant
une réelle cartographie du terrain 22 à partir des zones de libre accès, des zonesinterdites et des espaces autorisés sous accompagnement : les unes dépendant desautres puisque, dans ces univers qui ne disposent pas de la notion de neutralité, lespossibilités de circulation assignent de fait à un camp ou l’autre. Sur ces terrains, cequ’on considère être de bonnes conditions d’observation – la liberté d’aller et de venir,de poser des questions, de s’adresser à toutes les parties – impliquent de fait ou laissenttout du moins croire à une forme de complicité avec le pouvoir, comme le rappellentles auteur d’un article sur l’« anthropologie et l’État sécuritaire » : « nous appelons celafaire une observation participante ; ils appellent cela espionner 23 ». Cette boutade lèveune question incontournable qui est celle des rapports entre pouvoir et savoir danslesquels s’inscrit l’activité de recherche. Ici encore, ce qui compte n’est pas l’intentiondes chercheurs et l’espace idéal ou les normes méthodologiques dans lesquelles ilsprojettent leur recherche. Ce qui compte, ce sont les coordonnées exactes des liens dedépendance et de subordination par exemple entre les organes de pouvoir et lesentreprises de recherche, qui établissent la situation dans laquelle l’enquête peut ou nepeut pas être menée.
14 Un exemple, prolifique à maints égards, est celui de la guerre américaine qui a
commencé en 2003 en Irak. D’un côté, l’occupation militaire et les opérations de contre-insurrection en Irak et en Afghanistan comprenaient un volet « human terrain system »qui a mis à contribution des enquêtes ethnographiques menées par des anthropologuesrecrutés par l’armée, à des fins d’espionnage, de « médiation », de renseignements 24.Pour les chercheurs tout comme d’ailleurs pour les autres observateurs de métiercomme les journalistes, l’accès au terrain se négociait dès lors à travers l’incrustation(embedded) dans l’armée d’occupation. D’un autre côté, afin de se distancier de cetteemprise politique et de conserver une autonomie de recherche, sans pour autantdéserter cette question contemporaine importante qu’était la guerre en Irak, denombreux anthropologues ont mené des observations là où le terrain était moins
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
15
saturé d’enjeux de surveillance et de pouvoir, c’est-à-dire non pas en Irak mais auxÉtats-Unis, où ils ont étudié les anciens combattants de l’armée américaine 25. C’estainsi que s’est développée une littérature sur l’anthropologie de la guerre en Irak, maisqui, pour des raisons d’accès au terrain, s’est focalisée sur le traitement des ancienscombattants, leur PTSD (syndrome de troubles post-traumatiques), leur prise en chargebiopolitique – et jamais sur ce qui se passait en Irak même. En réaction à cet importanteffet (dé)structurant du conflit sur le champ de la production scientifique, une équiped’anthropologues a décidé de mener une ethnographie critique collective de la guerreen Irak, de ses rouages et de ses effets sur le terrain et auprès de la population occupée,qui assumait de ne s’appuyer sur aucune observation directe de terrain. Cettedémarche entre en résonnance avec mon projet de recherche sur le terrain de l’Iranpostrévolutionnaire puisque s’y posent des questions analogues. De quoi dépendl’agenda de la recherche : de la disponibilité des données, ou des zones d’ombre dusavoir qui restent à combler (sur une région, un processus, des pratiques, unévénement) ? Accepter que les frontières de la recherche soient délimitées par lespossibilités d’accès au terrain ne revient-il pas à accepter de suspendre ou deremorquer la recherche aux pratiques du pouvoir – notamment à la topographie de sonimpunité ? Mais alors comment s’y prendre ?
Ethnographier la guerre à distance
15 Comment mener une ethnographie sans possibilité d’enquête sur le terrain ? Pour les
co-auteurs de l’ouvrage L’Irak à distance 26, cet obstacle devient l’occasion d’uneexpérience méthodologique qui interroge les frontières de la pratique ethnographique.Mis à part Nadje Al-Ali, aucun des six contributeurs ne s’est rendu en Irak, où la guerrefait encore rage au moment de la publication du livre. En comparant les données deseconde main et les entretiens en exil recueillis à propos de la situation irakienne avecdes terrains de contre-insurrection ou de guerre qu’ils ont observés par le passé, lesauteurs proposent une analyse des conséquences de la guerre sur la société irakienneen mobilisant une « imagination ethnographique à distance », c’est-à-dire l’« acte de foianalytique et interprétatif requis pour expliquer des phénomènes qui ne peuvent êtreétudiés directement à travers des terrains 27 ». L’approche adoptée est comparative. Lacomparaison a ici une dimension heuristique puisqu’il s’agit d’éclairer des zones deguerre inaccessibles à la lumière d’autres terrains, en se concentrant sur l’analyse des« processus de changement » – tout en gardant à l’esprit que « ces processus similairesproduisent des significations, discours, pratiques, et compréhension différents » selonles contextes 28. C’est parce que les auteurs ont une pratique antérieure d’immersion delongue durée sur les terrains mobilisés dans leurs comparaisons qu’ils sont capables decette analyse à distance, fondée sur une pratique d’observation et d’analyse que CédricJourde appelle la « sensibilité ethnographique 29 ».
16 Ainsi, en s’appuyant sur la recherche ethnohistorique qu’elle a menée sur les relations
entre localité et identité dans les camps de réfugiés palestiniens, Julie Peteet regardesous cet angle la dimension spatiale de la guerre en Irak et la territorialisationémergente de conflits « ethnopolitiques » entre sunnites et chiites 30. L’auteure yobserve des processus de démembrement similaires à ceux en cours en Israël-Palestinesur les six dernières décennies. Notamment, elle pointe des propriétés émergentes del’occupation étrangère qui se sont déjà cristallisées en Israël-Palestine. L’existence d’un« centre nerveux » fortifié de la coalition (la zone verte de Bagdad), la construction de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
16
murs de ciment autour de quartiers sunnites (une solidification de la ségrégationethnique territoriale), un gouvernement par couvre-feu et par une combinaison decheck-points fixes et de check-points flottants sont quelques lignes principales de ladomination spatiale similaire à celle mise en place en Israël-Palestine. L’auteuremontre ainsi comment la ségrégation spatiale, la séparation ethnique et lacompartimentation politique, qui sont le quotidien en Israël-Palestine, émergent enIrak. Dans les deux cas, une séparation spatiale excluante se met en place en opposantzones de distinction et d’indistinction : d’un côté, l’État de droit, les standardsdémocratiques (même s’ils peuvent être suspendus selon une logique de siège) ; del’autre côté, le terrorisme, l’islam radical et un état d’exception permanent. Parailleurs, la compartimentation politique se fonde sur une exploitation de la mobilitécomme ressource rare à des fins militaires et politiques. Dans le tracé de cetteterritorialisation, un changement constant des règles et régulations et la mobilité descheck-points flottants font régner une imprédictibilité qui augmente l’incertitude etl’angoisse comme fondements du quotidien – nouveaux rapports au temps et à l’espace.
17 Cette analyse à distance de l’expérience irakienne à la lumière des modes de
gouvernements mis en place en Israël-Palestine, mais aussi dans le Cambodge desKhmer-Rouges, en Irlande du Nord sous domination anglaise ou dans la doctrinemilitaire argentine sous la dictature souligne deux points quant à l’approche théoriquede la violence. D’une part, l’idée de « laboratoires de gouvernement 31 » oùs’expérimentent des paradigmes de contrôle, des formes de souveraineté, des modes desubjectivation qui peuvent à première vue paraître marginaux ou anomiques. D’autrepart, l’idée que la violence s’actualise dans des « dispositifs politiques d’écriture 32 »,tels que les institutions juridiques, militaires, économiques, idéologiques : c’est avec cesdispositifs que converse le dispositif d’écriture ethnographique.
Espaces/temps de la violence
18 Les ethnographies de la violence s’inscrivent dans une réflexion sur le rapport entre
pouvoir, temps et espace, au croisement de l’ethnographie, de l’histoire et de lagéographie.
19 Un premier axe est celui de la temporalité. L’ancrage historique permet en effet de
« trouver la bonne distance et la bonne échelle 33 »pour contextualiser la violencequotidienne. Tandis que le massacre s’est établi comme « objet d’histoire », comme enrendait compte un récent ouvrage collectif, les anthropologues se sont intéressés à lafaçon dont plusieurs contextes, passés et présents, s’imbriquent dans une situation deconflit ou de répression. La violence est stratifiée : elle s’inscrit pour les acteurs dansune histoire de violence dont les techniques et la mémoire sont activées ouinstrumentalisées pour produire des effets et du sens au présent. C’est ce qu’explorentnotamment les travaux de Nenni Panourgia sur la répression de la gauche grecque de laguerre civile des années 1940 jusqu’à la fin de la dictature des généraux en 1974, ceuxde Michael Taussig sur la cruauté coloniale comme impensé de la violence en Colombie,ou encore ceux de Michel Naepels sur les dynamiques et les représentations du confliten Nouvelle-Calédonie, des guerres coloniales jusqu’au lendemain des accords deNouméa 34. Ces auteurs mobilisent une lecture ethnographique des sources historiquesdans la perspective d’une anthropologie historique de la violence, qui observe aussibien son inscription dans l’histoire (et dans un régime de véridicité historique) que son
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
17
enchevêtrement avec la mémoires sociale. S’intéressant à un cas où ce travaild’inscription manque de façon significative, Ariel Heryanto étudie le massacre descommunistes indonésiens en 1965-66 en analysant comment cet événement spectral estmobilisé dans les massacres politiques de 1984, mais aussi dans les procèsspectaculaires des opposants politiques dans la décennies suivante, et comment, en finde compte, cette stratification permet de saisir les dynamiques de la terreur, de lacoercition et de la fabrique du consentement en Indonésie dans les soixante-dixdernières années 35.
20 Un second axe est celui de l’espace, qui examine la violence à travers les architectures,
les organisations urbaines, les topographies et les géographies du pouvoir. Dans lestraités de la guerre et les rapports de missions coloniales, qui fondent la préhistoire dela science politique et de l’anthropologie, la violence est saisie comme stratégie deconquête et de domination des territoires. Plus récemment, la question de la violencedans son rapport à l’ordre juridico-politique a été pensée comme une opération spatialedu pouvoir à travers l’institution de lieux d’exception 36. D’autres questions émergent :comment les pratiques de violence s’ancrent-elles dans des espaces qu’ellesreconfigurent ? Comment produisent-elles de nouveaux espaces sociaux ? Ces questionssont abordées à travers une série de terrains – Argentine, Espagne, Allemagne, Pologne– dans l’ouvrage coordonné par Estela Schindel et Pamela Colombo, qui explore lesrelations entre les restes (humains) de la violence et la mémoire, à la lumière de laproduction sociale des espaces 37. La topographie de la violence, articulée à uneanthropologie de la mort, se pose dans un contexte contemporain à travers les travauxconsacrés aux migrants morts en Méditerranée 38.
21 Même si l’on a distingué deux axes, les dimensions temporelles et spatiales sont
imbriquées. L’espace de la violence est celui des camps 39, il est celui des fossescommunes et des exhumations 40 : ces deux formes interrogent les processus demémorialisation sur des sites de terreur. La mémoire de la violence est ainsi unemémoire spatiale, et ce que révèle la cartographie de la violence, c’est sa stratification.Dans les dernières années, cette question a été creusée à travers une analyse socio-culturelle qui renouait avec des disciplines historiquement liées à l’anthropologie quesont l’archéologie et l’expertise médico-légale (forensic). Gabriel Moshenskac développeainsi une archéologie des bombardements allemands à Londres, porte d’entrée vers uneapproche du quotidien de la seconde guerre mondiale et des mémoires populaires duconflit. Elisabeth Anstett et Jean-Marc Dreyfus étudient l’institution et l’organisationdu pouvoir dans les violences de masse à travers le traitement des cadavres produits àgrande échelle 41. L’ethnographie des sites d’exhumation au Guatemala permet decomprendre les logiques de la militarisation de la violence contre les communautésrurales, mais aussi la façon dont cette militarisation a été vécue et s’est inscrite dans lamémoire locale 42. Inversement, comme le souligne Michel Naepels, c’est l’ancragespatial et géographique d’une recherche qui permet de repositionner l’approche autemps : « l’actualité des enjeux liés à un lieu entraine une mobilisation locale du savoirhistorique et permet une micro-histoire déshégémonisée 43 ». La position historiquejuste est ici négociée à travers l’espace.
Ordres et désordres sociaux
22 Une autre question qui traverse l’étude de la violence politique est celle de l’ordre et du
désordre : la violence est productrice d’ordre, elle est productrice de désordre, le
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
18
désordre lui-même est producteur d’ordre… La violence est instrumentale dansl’institution de dispositifs d’États et l’organisation d’ordres politiques et sociaux commel’analyse Hannah Arendt 44 ; elle produit des espaces régulés de différenciation sociale.Mais elle est aussi, pour ceux qui en font l’expérience, un bouleversement de l’ordre quientraine un « recalibrage des cadres moraux et des cadres de perception 45 ». Cesdésarticulations se répercutent sur les systèmes moraux, les modes de résolution desconflits, les hiérarchies et les relations entre genres et générations : elles participentd’un pouvoir de réagencement de la violence. C’est notamment dans ce sens que lesperspectives de genre sont éclairantes et permettent de saisir le renversement descadres sociaux ; de même que le concept de « génération sociale » et la prise en comptede la variable générationnelle 46. Cette dernière a été mise en avant pour lescombattants et pour les milices, étudiés comme jeunes hommes dont la carrière estbloquée par le contexte socioéconomique, et qui se servent de la violence pour éleverleur statut social et économique 47. Ces analyses s’attachent aux « rapports entrel’exercice du pouvoir et de la coercition, la production de la violence et les dynamiquesd’appropriation 48 », ce qui pose en dernier lieu la nécessité de décloisonner l’étude desviolences collectives de l’étude de la violence structurelle et économique.
23 Philippe Bourgois et Nancy Scheper-Hughes traitent cette question en identifiant un
« continuum de la violence », de la violence symbolique à la violence extrême, enpassant par la violence quotidienne, la violence structurelle et la terreur. Les enquêtesempiriques ne permettent pas tant de venir nourrir et spécifier ces distinctions entredifférents régimes de violence, que d’explorer les processus de passage, de conversionet d’articulation qui définissent le mieux leurs rapports. Parlant d’un « continuum
génocidaire », Scheper-Hughes identifie ainsi des pratiques d’exclusion etd’objectification de populations reléguées soumises à un nettoyage social comme cequi, en situation de paix, met en place les « microcosmes épistémiques » rendantpossible les crimes génocidaires 49. L’historien Christian Gerlach refuse quant à luid’utiliser le concept de génocide, mais il s’intéresse lui aussi à cette articulation entrel’exceptionnel et l’ordinaire, la violence structurelle et la violence extrême, en étudiantla « logique sociale » qui entraine des modes propres de reconduction de la violencecollective liés à des phénomènes d’appropriation, de redistribution et de mobilitésociales. D’autre part, et à l’inverse, il pointe la façon dont la violence collective estutilisée pour résoudre un certain nombre de problèmes sociaux, comme la question dela redistribution agraire dans un contexte de crise lors des massacres de 1964-65 enIndonésie 50.
24 Au croisement de la temporalité, de la spatialité de la violence et de ses (dés)ordres
sociaux se trouvent les phénomènes de circulations transnationales. De nombreuxtravaux se sont intéressés à la circulation des techniques de la violence et auxtransferts de compétence dans les modes de gouvernement par la violence, qu’ils soientsynchroniques ou issus d’héritages coloniaux. On peut citer par exemple l’enquêteconsacrée par Marie-Monique Robin à l’influence de l’« école française » issue desguerres de contre-insurrection en Indochine et en Algérie, dans la formation nonseulement des officiers américains engagés dans la définition des opérations militairesau Vietnam, mais aussi des équipes militaires aux commandes de l’« opération Condor »qui à travers plusieurs pays d’Amérique latine visait à l’élimination des opposantsassimilés aux guérillas et à la gauche révolutionnaire 51. La question de la circulationdes technologies de pouvoir se pose de façon renouvelée dans l’étude d’Ilana Feldman
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
19
sur l’administration de la bande de Gaza sous mandat britannique puis égyptien, quicombine une ethnographie de la fonction publique et une recherche d’archive multi-située pour analyser les conditions de possibilité du maintien du contrôle et de laroutine administrative en situation de violence, d’exception et de souverainetécontestée. La circulation des pratiques et leur stratification esquissent dans ce cas unegénéalogie instructive de l’occupation israélienne dans son fonctionnement quotidienadministratif et légal 52. Or, si la circulation transnationale des techniques, des discourset des savoir-faire informe les pratiques de violence, elle caractérise aussi les façonsdont ces pratiques sont définies, catégorisées et adressées. Les qualifications juridiqueset les dispositifs de sortie de la violence font eux aussi l’objet d’une circulationtransnationale, posant la question de la pertinence et de l’adaptabilité des panoplies(toolkits) de la justice transitionnelle dans des contextes politiques et sociauxdifférents 53. Cette réflexion critique autour de la justice transitionnelle posenotamment la question des reconfigurations et de la permanence du dispositif étatiqueet nous invite à explorer, à un niveau tout à fait factuel aussi bien qu’à un niveauthéorique, les liens entre pouvoir et violence.
Violence et État
25 Les relations de la violence au pouvoir engagent en première ligne la question de l’État,
non pas seulement que la violence politique soit souvent entendue et étudiée au prismede la violence d’État, mais plus fondamentalement parce que la formation étatique estune condition de possibilité des pratiques de violence collective au vingtième siècle,comme le soutient Zygmunt Bauman 54. Dans ce sens, l’ethnographie de la violencepolitique engage une ethnographie de l’État et de ses dispositifs dès lors qu’il s’agitd’examiner les institutions, les savoirs, les normes et les pratiques qui se cristallisentdans l’exercice de la violence, et la façon dont elles façonnent le quotidien, mais aussiles types d’éclairages que jettent leurs imaginaires sur les rapports de domination et desubordination 55. Une dimension particulièrement intéressante et complexe au regardde notre contemporanéité est la relation entre violence et droit 56. À la jonction descatégories étatiques de violence distinguées par Foucault, la guerre et le crime, NenniPanourgia étudie ainsi la criminalisation de la gauche en Grèce, et la catégorisation desopposants en « citoyens dangereux » et « ennemis », déconstruisant les mécanismes parlesquels « la loi devient la peau de l’État 57 ».
26 Les rapports entre violence, pouvoir et État posent une question que rappelle Nancy
Scheper-Hugues, en reprenant les catégories d’État « fort », « faible », « failli », etc. :celle des liens entre génocides et moments de force et de solidité (comme dansl’Allemagne nazie) ou de faiblesse et de délitement (comme dans l’Empire ottoman) despouvoirs étatiques 58. Si la question se pose, elle sous-entend cependant, dans la longuelignée des genocide studies, que le monopole revient à l’État, agent exclusif de laviolence. C’est ce présupposé que critique l’historien Christian Gerlach, proposant desubstituer au concept juridique de génocide une analyse en termes de « violenceextrême des ordres sociaux » : « des décisions administratives sont bien prises pour lemeurtre, l’expulsion ou la réduction en esclavage de populations, mais ces politiquesdoivent être comprises en relation avec une myriade de choix et de décisions prises pardes individus à l’intérieur et à l’extérieur de la machinerie d’État 59 ». Pour autantqu’elles proposent une analyse complexe des agents et des agencies, ces recherches
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
20
restent concentrées sur les moments où « les États tuent », pour reprendre le titre d’unouvrage collectif consacré aux violences d’État en Amérique du Sud et à leurs relationsavec les États-Unis (transferts de compétence, formation des personnels, supportlogistique et politique) 60. Si le sujet de la violence dans son rapport au pouvoir a prisforme à l’intérieur de la question de l’État au vingtième siècle, elle s’en est aussidétachée dans les dernières décennies. La question ne s’est pas posée en termes de« privatisation des acteurs » de la violence – peut-être parce que le point d’observationn’est pas l’État en tant que tel. Cependant, la fragmentation et la complexité des acteursest un enjeu essentiel, et plusieurs recherches insistent sur l’importance des milicesdans une analyse « par le bas » des relations entre société et État. Les ethnographies desescadrons de la mort rassemblées par Jeffrey Sluka s’interrogent en détail sur les liensentre milices et État et sur les frontières et modalités de la conflictualité interne 61.L’ouvrage s’interroge notamment sur ce qui, dans une crise politique ou un conflitinterne, entraine les États et certains groupes sociaux à sous-traiter la violence etdévelopper les méandres complexes d’un monde extra-juridique. Michael Taussigrestitue dans son ethnographie d’un « nettoyage social » (limpienza) dans un villagecolombien, l’ambiguïté d’une violence dont les acteurs restent aussi difficiles àidentifier, que les liens entre différents groupes, polices, milices et État àcartographier 62.
27 Certes, l’État n’a pas le monopole de la violence politique et, de plus, les qualifications
de guerre civile, de « guerre sale », de contre-insurrection ont joué un rôle importantdans une perception de la violence collective au-delà de la question de la violenced’État stricto sensu. Tilly observe toutefois que « l’existence et l’intensité de la violencecollective dépendent de la manière dont les structures de pouvoir et leursorganisations spécialisées de répression font face à ce qui les défie 63 ».
Terreur d’État
28 Une notion qui traverse ainsi de nombreuses ethnographies de la violence politique est
celle de « terreur d’État » (terme très peu utilisé dans les sciences socialesfrançaises 64) : Sluka propose une « anthropologie de la terreur d’État », Heryanto sepenche sur « le terrorisme d’État et l’identité politique en Indonésie », Panourgia étudie« la gauche grecque et la terreur de l’État ». Rappelant la distinction établie en sciencepolitique entre les termes « terreur », réservé aux États, et « terrorisme », réservé auxacteurs privés, Sluka insiste sur le besoin de combler une lacune d’études empiriquessur le premier thème tandis que le second a fait l’objet d’une production scientifiquepléthorique. Au final, ces deux phénomènes ne différent pas fondamentalement dansleur définition, qui insiste sur l’usage de la violence et de la peur qu’elle inspirelorsqu’elle est employée de façon à la fois imprédictible et régulière 65, créant un régimed’incertitude généralisée à des fin d’ingénierie sociale et, plus particulièrement, deproduction ou de préventions de certains comportements sociaux 66. D’un point de vueméthodologique, les ethnographies de la terreur d’État ont d’abord travaillé avec destémoignages de victimes et survivants, croisées avec d’autres approches telles que le« tournant spatial » (spatial turn) 67, l’analyse psycho-sociale 68, l’analyse de discours etl’ethnographie de procès 69, mais aussi les entretiens avec des perpétrateurs, militaireset miliciens 70. Une analyse des relations entre violence et pouvoir en termes desolidification de dispositifs d’État, d’espaces de droit et d’exception, de mobilité socialeou d’accès aux ressources explore en détail les effets de la violence, mais sans pour
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
21
autant se saisir de la question de la terreur. Celle-ci conjugue en effet différentsregistres matériels et immatériels, de coercition et de persuasion, et des processus departage et de transfusion des imaginaires entre victimes et perpétrateurs : la terreurfonctionne comme un système culturel comme le démontre Taussig. Les modalités parlesquelles elle « pénètre le tissu social 71 » – par lesquelles la peur, de psychologique etindividuelle devient sociale et collective – sont complexes non seulement à capterempiriquement mais aussi à analyser, en tant qu’elles engagent l’analyse des cadres deperception, des « fantasmes collectifs 72 » et des imaginaires qui circulent, s’opposent,se rejoignent. L’histoire a beaucoup à nous apprendre sur ce dernier processus, commel’illustrent les travaux sur les punitions dans les plantations coloniales de caoutchoucau XIXe siècle en Colombie, ou la contre-insurrection pratiquée par les Einsatzgruppen SS
sur le front de l’Est en 1941-44, qui tous pointent les jeux de miroir par lesquels laviolence mime et performe la barbarie que l’on prête à l’autre 73. La notion de« mimétisme social » est utile à plusieurs travaux qui se penchent sur les modalités dedissémination de la violence et de son escalade 74. Robben analyse notamment lesimplications tactiques du mimétisme (faire à l’autre ce que l’on imagine qu’il estcapable de nous faire) dans les guerres asymétriques comme celle menée en Irak, oùl’incertitude sur l’identité et l’assignation des civils a des conséquences tragiqueslorsque le conflit est pris dans un cadre discursif absolu d’opposition du bien et du mal.
Imaginaire, fantômes et fantasmes
29 Si la définition de la terreur comme outil de contrôle social est relativement claire, ses
mécanismes et le détail de leur fonctionnement restent ainsi « difficiles à découvrir »comme le faisait déjà remarquer Walter 75. L’ethnographie de la violence a exploré cesquestions en s’intéressant plus particulièrement à la relation entre violence et silence :Comment la violence produit-elle du silence ? Quels sont les effets réfractésd’entreprises de dissimulation de la violence (disparitions, intimidation) ? Quels typesde silence la violence produit-elle exactement ? Quoique dans des perspectivesdifférentes, Veena Das et Vincent Crapanzano développent une phénoménologie dumutisme, qu’il soit lié à l’incapacité d’articuler ou au refus de transmettre 76. Taussigexplore la question collective du silence à travers la logique du « secret public » : « cequi est généralement su mais ne peut pas être articulé ». Cette approche pense les effetsdu pouvoir dans un savoir social, qui est « l’art de savoir ce qu’on ne doit pas savoir 77 ».L’analyse cherche à comprendre comment, dans cette relation de la violence au secret,se nouent les effets de la violence, les articulations de l’individuel et du collectif, ladomination de l’État sur la société.
30 Plusieurs ethnographies, comme celles de Kimberly Theidon, Marcelo Suarez-Orozco ou
Victoria Sanford attirent l’attention sur la rumeur, qui n’est plus simplement vuecomme un défi méthodologique à l’établissement des faits, mais un espace signifiant oùs’observent des relations et des perceptions du pouvoir 78. Si la question de la rumeur,du ragot (gossip), de la sorcellerie et des chasses aux sorcières sont des thèmesclassiques de l’anthropologie, l’importance qui leur est accordée dans les ethnographiescontemporaines de la violence renvoie aux façons dont « le conflit est généré et gérédans la vie sociale, et (au) rôle spécifique que la confusion et l’incertitude jouent dansce processus 79 ». Une manifestation très contemporaine de cette problématiques’observe par exemple dans les pratiques de suspicion qui traversent la sociétéfrançaise d’après les attentats de 2015 et dans le terme de « chasse aux sorcières »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
22
utilisé par des musulmans français perquisitionnés et assignés à résidence pourévoquer leur vécu de l’état d’urgence 80. Un paradoxe dans le contexte actuel est celuide penser les rapports entre conflits, secret et rumeur, dont on sent la réactivation et lapertinence, tout en les situant dans des dispositifs politiques et sociaux qui offrent lecontrepoint apparent du paradigme de transparence qui est celui des démocraties anti-terroristes 81. La rumeur, prise comme production sociale, est celle d’une expériencecollective en l’absence de crédibilité sociale et politique, qui révèle pour Feldmanl’étendue de notre perte de sens de contrôle sur la réalité, et l’urgence avec laquelle cecontrôle doit être réaffirmé, en palliant à ce qui fait défaut par l’imagination etl’exagération 82.
31 L’exploration des régimes de terreur, la culture de la peur, les rapports entre violence
et silence, les fonctions de la rumeur s’attachent ainsi aux formes et aux enjeux de lamétabolisation de la violence dans la vie quotidienne (disruption, efforts de normalité,déni), par lesquels l’analyse dépasse les groupes polarisés de perpétrateurs et devictimes pour s’intéresser au tissu social plus large de ceux qui n’entrent dans aucun deces groupes institués.
Creuser l’écart
32 Ces quelques éléments permettent également d’éclairer la question qui avait été
ouverte sur mon terrain de recherche auprès du tribunal d’opinion sur les crimes del’État iranien, par le récit embarrassant de ce témoin attestant avoir vu le corpssupplicié de son frère continuer à saigner des jours après la mort de celui-ci. Usaged’une grammaire iconique populaire pour transmettre l’horreur ? Trouble de laperception qui nous en fait sonder la profondeur des effets ? Recours au registresymbolique quand le récit glisse hors de ses possibilités narratives ? Restes, devenusdéplacés, d’une situation hallucinatoire qui était alors le quotidien des témoins ?Quoiqu’il en soit, ce matériau empirique nous dit une chose avec certitude.L’ethnographie n’implique pas seulement de décloisonner le terrain en dehors de lasituation d’entretien et de « passer du temps sur le terrain » – comme tendraient à lesuggérer les plaidoyers pour l’usage de cette méthode en relations internationales 83 –mais elle engage plus fondamentalement des questions épistémologiques. Comment eneffet rendre compte des cadres d’interprétation et de perception auxquels lesexpériences de la violence empruntent la logique qui en organise la mémoire, dans undiscours qui nie ces réalités ou les repousse hors champ ? Comment analyser descomportements, des expériences, des récits et des stratégies en les sortant d’unehistoricité et d’une téléologie uniques, celles de l’occident moderne, qui servent deréférence aux sciences sociales 84 ? Une autre question pointe alors à l’horizon : en quoiune ethnographie qui s’inscrit de la sorte dans les déductions et les perceptionsvernaculaires, et refuse les dichotomies scientifiques, peut-elle légitimement se posercomme une démarche analytique et cognitive ? Cette question des limites se ressentavec clarté dans des travaux comme ceux de Michael Taussig lorsqu’il ethnographie laviolence en développant des méthodes et des formes d’écriture singulières, qui ne sontpas destinées à être reproduites. Or, chez Taussig comme chez les anthropologues quiobservent l’Irak à distance, ce recours à « l’imagination ethnographique », pour impurqu’il soit quant aux règles de la méthode, s’inscrit dans une démarche cognitive quiprogresse en inventant pour saisir au mieux ce qui reste difficile d’accès. « Saisir aumieux », précise l’auteur, « la nature élusive de la chose étatique. Après tout, il n’y a pas
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
23
que l’écrivain qui infuse la réalité d’états hallucinatoires. Ce privilège appartient aussi,comme Kafka nous l’a enseigné, à l’être au monde de l’État moderne 85 ».
NOTES
1. Asad T., On Suicide Bombing, New York, Columbia University Press, 2007.
2. Ibid., pp. 24 et suivantes.
3. Das V., Critical Events: An Anthropological Perspective on Contemporary India, New York, Oxford
University Press, 1996.
4. Naepels M., Conjurer la guerre. Violence et pouvoir à Houaïlou (Nouvelle-Calédonie), Paris, Éditions
de l’EHESS, 2013.
5. Naepels M., op. cit. ; Jaoul N., « The “Righteous Anger” of the Powerless Investigating Dalit
Outrage over Caste Violence », South Asia Multidisciplinary Academic Journal, n°2, 2008 [En ligne],
http://samaj.revues.org/1892 ; DOI : 10.4000/samaj.1892, consulté le 9 novembre 2016. .
6. Green L., « Living in a State of Fear », in Nordstrom C. et A. Robben (eds.), Fieldwork under Fire:
Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, University of California Press, 1995 ;
Pasquetti S., « Legal Emotions: An Ethnography of Distrust and Fear in the Arab Districts of an
Israeli City », Law & Society Review, vol.47, n°3, 2013, pp. 461-492.
7. Crapanzano V., « De la colère à l’indignation : le cas des Harkis », Anthropologie et sociétés,
Passions Politiques, vol. 32, n°3, 2008, pp. 121-138.
8. Pandolfi M. et V. Crapanzano. « Présentation : Les Passions : Au Cœur Du Politique ? »,
Anthropologie et sociétés, Passions Politiques, vol. 32, n°3, 2008, p. 7.
9. Schatz E., Political Ethnography: What Immersion Contributes to the Study of Power, Chicago,
University of Chicago Press, 2013 ; Yanow D. et P. Schwartz-Shea, Interpretation and Method:
Empirical Research Methods and the Interpretive Turn, London, Routledge, 2006 ; Lie J., « Challenging
Anthropology: Anthropological Reflections on the Ethnographic Turn in International
Relations », Millennium - Journal of International Studies, vol. 41, 2013, pp. 201-220 ; Vrasti W., « The
Strange Case of Ethnography and International Relations », Millennium - Journal of International
Studies, vol. 37, 2008, pp. 279-301.
10. Des tribunaux d’opinion ont ainsi examiné les politiques israéliennes en Palestine (2009), la
guerre menée par la coalition américaine en Irak (2003 et 2005), les crimes de l’État Sri-lankais
contre la population tamoule (2013), les massacres de 1964-65 en Indonésie (2015). Ces initiatives
ont pu également prendre d’autres formes, comme par exemple la « Commission d’enquête
citoyenne sur l’implication de la France dans le génocide des Tutsi » (CEC) en 2004.
11. Cette recherche se fonde notamment sur un ensemble d’entretiens menés avec une centaine
de témoins et victimes de la répression d’État au sein de la diaspora iranienne en France, Grande-
Bretagne, Allemagne, Canada, États-Unis, des observations participantes lors des sessions de
travail du tribunal populaire à Londres puis à la Haye en 2012 et un terrain d’enquête auprès
d’une ONG de défense des droits qui travaille à l’établissement d’une base de données numérique
des disparitions et exécutions en Iran depuis 1979. Voir : Makaremi C., « State Violence and Death
Politics in Post-Revolutionary Iran », in Anstett E. et J.-M. Dreyfus (eds.), Destruction and Human
Remains: Disposal and Concealment in Genocide and Mass Violence, Manchester, Manchester
University Press, 2014 ; Makaremi C., « Prison and Motherhood » in Mojab S., H. Halavut et L.
Tabar (eds.), Women and Prison: Iran, Palestine, and Turkey, London, Pluto Press, 2016.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
24
12. Feldman A., « Ethnographic States of Emergency », in Nordstrom C. et A. Robben (eds.),
Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of Violence and Survival, Berkeley, University of California
Press, 1995. Ma traduction. L’auteur souligne
13. Crapanzano V., The Harkis: The Wound That Never Heals, Chicago, University of Chicago Press,
2011.
14. Panourgiá N., Dangerous Citizens: The Greek Left and the Terror of the State, New York, Fordham
University Press, 2009.
15. Theidon K., Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 2012.
16. Naepels M., op. cit.
17. Das V., Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary, Berkeley, University of
California Press, 2006.
18. Feldman A., Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in Northern
Ireland, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 14.
19. Sanford V., Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala, New-York, Palgrave Macmillan,
2003 ; Chatterji R. et D. Mehta (eds.), Living with Violence: An Anthropology of Events and Everyday
Life, Delhi, Routledge India, 2007 ; Naepels M., op. cit.
20. Ainsi les enquêtes de terrain sont-elles soumises au « certificat d’éthique » en Amérique du
Nord, et à l’autorisation du fonctionnaire de sécurité et de défense au CNRS en France.
21. Theidon K., « “Terror’s Talk”: Fieldwork and War », Dialectical Anthropology, vol. 26, n°1, 2001,
pp. 19-35, p. 20.
22. Wood E., « Field Research During War: Ethical Dilemmas », Qualitative Sociology. Special issue:
Political Ethnography, vol. 29, 2007, pp. 373-386, pp. 375 et suivantes ; Makaremi C., « Étudier et
assister les étrangers aux frontières », in Fassin D. et A. Bensa (dir.), Les Politiques De L’enquête :
Épreuves Ethnographiques, Paris, La Découverte, 2008, pp. 177-181.
23. Borneman J. et J. Masco, « Anthropology and the Security State », American Anthropologist,
vol. 117, n°4, 2015, pp. 781-785.
24. Kipp J., Grau L., Prinslow K. et D. Smith, The Human Terrain System: A Cords for the 21st Century,
US Defense Technical Information Center, Fort Belvoir, VA, 2006 ; Fawcett G.S., Cultural
Understanding in Counterinsurgency: Analysis of the Human Terrain System, US Defense Technical
Information Center, Fort Belvoir, VA, 2009 ; González R. J., American Counterinsurgency: Human
Science and the Human Terrain, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2009 ; Forte M., « The Human
Terrain System and Anthropology: A Review of Ongoing Public Debates », American Anthropologist,
vol. 113, n°1, 2011, pp. 149-153 ; Zehfuss M., « Culturally Sensitive War? The Human Terrain
System and the Seduction of Ethics », Security Dialogue, vol. 43, n°2, 2012, pp. 175-190.
25. Gutmann M. et C. Lutz, « Becoming Monsters in Iraq », Anthropology Now, vol. 1, n°1, 2009,
pp. 12-20 ; Wool Z., Emergent Ordinaries at Walter Reed Army Medical Center: An Ethnography of Extra/
Ordinary Encounter, Toronto, University of Toronto Press, 2011 ; MacLeish K., « Armor and
Anesthesia: Exposure, Feeling, and the Soldier’s Body », Medical anthropology quarterly, vol. 26, n°1,
2012, pp. 49-68.
26. Robben A. (ed.), Iraq at a Distance: What Anthropologists Can Teach Us About the War, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 2010.
27. Ibid., p. 5.
28. Ibid., p. 10.
29. Schatz E. (ed.), op. cit., pp. 6 et suivantes ; Jourde C., « The Ethnographic Sensibility:
Overlooked Authoritarian Dynamics and Islamic Ambivalences in West Africa », in Schatz E. (ed.),
Political Ethnography, op. cit., pp. 201-216.
30. Peteet J., « The War on Terror, Dismantling, and the Construction of Place: An Ethnographic
Perspective from Palestine », in Robben A. (ed.), Iraq at a Distance, op. cit., pp. 80-105.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
25
31. Pandolfi M., « Une souveraineté mouvante et supracoloniale », Multitudes, vol. 3, n°3, 2000,
pp. 97-105 ; Rose N. et P. Miller, « Political Power Beyond the State: Problematics of
Government », British journal of sociology, vol. 43, n°2, 1992, pp. 173-205 ; Dewachi O., « “Between
Iraq and a Hard Place”: Urban Governance and Transnational Laboratories of Intervention of
Displaced Iraqis in Syria, Jordan and Lebanon », A selected essay by the Irmgard Coninx Foundation,
Berlin for the 10th Berlin Roundtable on Urban Governance, Berlin, March 18-23, 2009.
32. Feldman A., « Ethnographic States of Emergency », op. cit., p. 226.
33. Das V., Life and Words, op. cit., p. 6.
34. Panourgia N., Dangerous Citizens, op. cit. ; Taussig M., Law in a Lawless Land: Diary of a Limpieza in
Colombia, Chicago, University of Chicago Press, 2005 ; Naepels M., Conjurer la guerre, op. cit.
35. Heryanto A., State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging, New-York,
Routledge, 2006.
36. Agamben G., État D’exception, Paris, Le Seuil, 2003.
37. Schindel E. et P. Colombo, Space and the Memories of Violence: Landscapes of Erasure,
Disappearance and Exception, New-York, Palgrave Macmillan, 2014.
38. Kobelinsky C., « Les vies des morts de la migration », Plein droit, n°2, 2016, pp. 6-9 ; Ritaine E.,
« Quand les morts de Lampedusa entrent en politique : Damnatio Memoriæ », Cultures & Conflits,
n° 99/100, automne/hiver 2015, pp. 117-142.
39. Panourgia N., Dangerous Citizens, op. cit. ; Schindel E. et P. Colombo, Space and the Memories of
Violence, op. cit. ; Crapanzano V., The Harkis, op. cit.
40. Heryando A., State Terrorism and Political Identity in Indonesia, op. cit. ; Sanford V., Burried
Secrets, op. cit.
41. Moshenska G., « Working with Memory in the Archaeology of Modern Conflict », Cambridge
Archaeological Journal, vol. 20, n°1, 2010, pp. 33-48 ; Anstett E. et J.-M. Dreyfus (dir.), Cadavres
impensables, cadavres impensés, Paris, Éditions Pétra, 2012.
42. Sanford V., Burried Secrets, op. cit.
43. Naepels M., Conjurer la guerre, op. cit., p. 32.
44. Arendt H., The Human Condition, Chicago & London, University of Chicago Press, 1958.
45. Theidon K., Intimate Enemies, op. cit., p. 15.
46. Mannheim K., Le problème des générations, Paris, Armand Colin, 2011 [1952].
47. Debos M., « Les limites de l’accumulation par les armes. Itinéraires d’ex-combattants au
Tchad », Politique africaine, vol. 109, n°1, 2008, pp. 167-181 ; Gerlach C., Extremely Violent Societies:
Mass Violence in the Twentieth-Century World, Cambridge, Cambridge University Press, 2010 ; Gayer
L., Milices armées d’Asie du sud. Privatisation de la violence et implication des États, Paris, Presses de
Sciences Po, 2008.
48. Mbembe A., « Pouvoir, Violence et Accumulation », Politique africaine, vol. 39, n° 2, 1990,
pp. 7-24.
49. Scheper-Hughes N. et P. Bourgois, Violence in War and Peace, New-York, Blackwell Publishers,
2004 ; Scheper-Hughes N., « The Genocidal Continuum: Peace-Time Crimes » in Mageo J. M. (ed.),
Power and the Self, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
50. Gerlach C., Extremely Violent Societies, op. cit., p. 282 et pp. 56-66. On retrouve cette dernière
idée chez Michael Taussig (Law in a lawless land, op. cit., 2005) au sujet de la distribution des terres
en Colombie.
51. Robin M. M., « Death Squadrons: The French School », Journal of Latin American Anthropology,
vol. 10, n°2, 2005, pp. 484-485. Sur « l’opération Condor » voir Dinges J., The Condor Years: How
Pinochet and his Allies Brought Terrorism to Three Continents, New-York, The New Press, 2005 et
Menjívar C., Rodriguez N., When States Kill: Latin America, the US, and Technologies of Terror, Austin,
University of Texas Press, 2009.
52. Feldman I., Governing Gaza: Bureaucracy, Authority, and the Work of Rule, 1917–1967, Durham, Duke
University Press, 2008.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
26
53. Une recension exhaustive des initiatives de justice transitionnelle a été effectuée par Hayner
P., Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions, London, Routledge,
2010. Une approche critique de ces initiatives, qui questionne notamment les effets de
l’application d’un même modèle dans des contextes différents, a fait l’objet de deux programmes
de recherches interdisciplinaires financés par le European Research Council ces dernières années :
« Bosnian Bones, Spanish Ghosts: Transitional Justice and the Legal Shaping of Memory » (BBSG,
2011-2013) et le « Transitional Justice Mapping » (TJMap, 2012-2013), voir : http://
bosnianbonesspanishghosts.com/ (consulté le 3 octobre 2016).
54. Bauman Z., Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, Oxford, Wiley-Blackwell, 1995.
55. Mbembe A., « Provisional Notes on the Postcolony », Africa, vol. 62, n° 1, 1992, pp. 3-37, p. 4.
56. Benjamin W., « Critique of Violence (1927) », Reflections, vol. 14, n° 3, 1978, pp. 277-300.
57. Panourgia N., Dangerous Citizens, op. cit., p. 8.
58. Scheper-Hughes N., « Coming to Our Senses » in Hinton A. (ed.), Annihilating Difference: The
Anthropology of Genocide, Berkeley, University of California Press, 2002.
59. Gerlach C., Extremely Violent Societies, op. cit., p. 180.
60. Menjívar C. et N. Rodriguez, When States Kill, op. cit.
61. Sluka J., Death Squad: The Anthropology of State Terror, Philadelphia, University of Pennsylvania
Press, 2000.
62. Taussig M., Law in a lawless land, op. cit.
63. Tilly C., « La Violence Collective Dans Une Perspective Européenne », Tracés. Revue de Sciences
humaines, vol. 19, 2010, pp. 183-214, p. 195.
64. À ma connaissance, le terme est employé dans deux ouvrages sur la guerre d’indépendance
d’Algérie : Barkat M., Des français contre la terreur d’État (Algérie 1954-1962), Paris, Reflex, 2002 et
House J., MacMaster N., Paris, 1961 : les Algériens, la terreur d’État et la mémoire, Paris, Tallandier,
2008.
65. Hannah A., The Origins of Totalitarianism, New York, Brace and Co, 1951, p. 66.
66. Walter E., Terror and Resistance: A Study of Political Violence; with Case Studies of Some Primitive
African Communities, Oxford, Oxford University Press, 1969.
67. Schindel E. et P. Colombo, Space and the Memories of Violence, op. cit.
68. Suárez-Orozco M., « Speaking of the Unspeakable: Toward a Psychosocial Understanding of
Responses to Terror », Ethos, vol. 18, n°3, 1990, pp. 353-383.
69. Heryanto A., State Terrorism and Political Identity in Indonesia, op. cit.
70. Panourgia N., Dangerous Citizens, op. cit. ; Robben A., « How Traumatized Societies Remember:
The Aftermath of Argentina’s Dirty War », Cultural Critique, vol. 59, n° 1, 2005, pp. 120-164.
71. Green L., « Living in a State of Fear », op. cit., p. 108.
72. Walter E., Terror and Resistance, op. cit., p. 340.
73. Sur la torture dans les plantations coloniales, voir : Taussig M., « Culture of Terror—Space of
Death. Roger Casement’s Putumayo Report and the Explanation of Torture », Comparative Studies
in Society and History, vol. 26, n°3, 1984, pp. 467-497. Sur les Einsatzgruppen, voir : El Kenz D., Le
Massacre, objet d’histoire, Paris, Gallimard, 2005 ; McConnell M., « Lands of Unkultur: mass violence,
corpses and the Nazi imagination of the East », in Anstett E. et J.-M. Dreyfus (eds.), Destruction and
Human Remains, op. cit.
74. Feldman A., Formations of violence, op. cit. ; Taussig M., « Culture of Terror », op. cit. ; Robben A.,
Iraq at a Distance, op. cit.
75. Walter E., Terror and Resistance, op. cit., p. 11.
76. Das V., Life and Words, op. cit. ; Crapanzano V., The Harkis, op. cit.
77. Taussig M., Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stanford, Stanford
University Press, 1999, p. 29.
78. White L., Speaking with Vampires: Rumor and History in Colonial Africa, Berkeley, University of
California Press, 2000.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
27
79. Stewart P. et A. Strathern, Witchcraft, Sorcery, Rumors and Gossip, Cambridge, Cambridge
University Press, 2004, p. xii.
80. Voir par exemple : Vigoureux E., « État d’urgence. Nora, musulmane : “C’est une chasse aux
sorcières que nous vivons” », L’Obs, le 27 janvier 2016.
81. Bigo D. et P. Piazza, « Les conséquences humaines de l’échange transnational des données
individuelles », Cultures & Conflits, n°76, 2009, p. 7-14 ; Bigo D. et R.B.J. Walker, « Le régime du
contre-terrorisme global », in Bigo D., Bonelli L. et T. Deltombe (dir.), Au nom du 11 septembre... Les
démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008, pp. 13-35 ; Bauman Z., Bigo D.,
Esteves P., Guild E., Jabri V., Lyon D. et R.B.J. Walker, « Repenser l’impact de la surveillance après
l’affaire Snowden : sécurité nationale, droits de l’homme, démocratie, subjectivité et
obéissance », Cultures & Conflits, n°98, 2015, pp. 133-166.
82. Feldman A., « Ethnographic states of emergency », op. cit.
83. Voir note 9.
84. Asad T., On suicide bombing, op. cit. ; Feldman A., « Ethnographic states of emergency », op. cit.
85. Taussig M., The Magic of the State, New York, Routledge, 1997, p. 1.
RÉSUMÉS
Depuis les années 2000, une série d’études ont proposé les contours, les thèmes, les méthodes et
les modalités d’écriture d’une ethnographie de la violence politique, c’est-à-dire de la violence
dans son rapport au pouvoir et au conflit. À travers une démarche ancrée empiriquement, celle-
ci s’attache à décrire et comprendre des phénomènes de violence collective dans leurs rapports
aux structures de pouvoir et aux institutions, aux dynamiques et structures sociales, mais aussi à
travers leur empreinte et leur expérience dans la vie quotidienne, et les modes de subjectivation
qui s’y négocient. Cet article se veut une présentation et une discussion des enjeux qui traversent
cette littérature, en interrogeant les limites et les apports d’une approche ethnographique des
formes de violence contemporaine.
Since the 2000s, a series of ethnographic studies have explored the outlines, themes, methods
and procedures for writing an anthropology of violence, that is violence and its relationship to
power and conflict. These empirical approaches seek to describe and understand phenomena of
collective violence in their relationship to power dynamics, institutions and social structures.
They also look at how these phenomena are experienced in the everyday, the traces they leave
behind and the modes of subjectivation that are negotiated through them. The article presents
and discusses the issues that run through this literature, questioning the limits and contributions
of an ethnographic approach to contemporary forms of violence.
INDEX
Mots-clés : anthropologie de la violence, ethnographie, observation participante, terreur d’État,
anthropologie de la guerre
Keywords : anthropology of violence, ethnography, participant observation, state terror,
anthropology of war
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
28
AUTEUR
CHOWRA MAKAREMI
Chowra Makaremi est chargée de recherche au CNRS, membre de l’Institut de Recherche
Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux (IRIS). Ses travaux portent sur l’anthropologie de l’État,
les formes juridiques et ordinaires de la violence et l’expérience qu’en font les sujets, notamment
en situation d’exil. Elle a publié : avec D. Fassin, Y. Bouagga, I. Coutant, J.-S. Eideliman, F.
Fernandez, N. Fischer, C. Kobelinsky, S. Mazouz, S. Roux, Juger, Réprimer, Accompagner. Essai sur la
morale de l’État, Paris, Seuil, 2013 ; Le cahier d’Aziz. Au cœur de la révolution iranienne, Paris,
Gallimard, coll. « Témoins », 2011 ; avec C. Kobelinsky (dir.), « Le Confinement des étrangers :
entre circulation et enfermement », Cultures & Conflits, n° 71, été 2008.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
29
Ethnographier la violence d’État :récits et expériences des victimes dela lutte contre le narcotrafic àCiudad Juárez, MexiqueEthnographying State Violence: Narratives and Experiences of Victims of the
“War on Drugs” in Ciudad Juárez, Mexico
Chiara Calzolaio
Je souhaiterais remercier Pamela Colombo, Chowra Makaremi, Martin Lamotte, Julie Castro,
Antonia García Castro et les deux relecteurs anonymes de la revue pour leurs corrections et
conseils précieux.
1 Depuis quelques années, plusieurs rapports d’organisations internationales pour la
défense des droits de l’homme, des enquêtes journalistiques et des témoignages devictimes ou de proches mobilisés dans différentes associations ont permis dedocumenter les violences qui ont accompagné les opérations de lutte contre lenarcotrafic au Mexique 2. Ces rapports tendent à considérer que plus de 70 % des centmille homicides volontaires et des trente mille disparitions qu’a connus le pays pendantle mandat de Felipe Calderón (2006-2012) étaient liés aux opérations militaires de luttecontre le commerce et le trafic des drogues 3. Dans ce contexte, les forces de l’ordre(l’armée, la marine et les différentes corporations policières) ont été impliquées danstout un éventail de pratiques violentes là où elles ont été chargées des opérationsmilitaires : exécutions extrajudiciaires, tortures, disparitions forcées 4.
2 Cet article se propose d’aborder ces violences d’État à partir d’un point de vue rarement
pris en compte dans les rapports dont le but principal est la dénonciation : lesexpériences des personnes qui, tout en ayant vécu ces violences directement ou dansleur famille, n’ont pas rejoint les mouvements de victimes actives dans l’arène politique(et qui sont donc moins facilement joignables par les organisations de défense de droitsde l’homme). Les histoires et les récits de ces victimes qui ne sont pas reconnues entant que telles (et qui ne se perçoivent pas toujours comme telles) permettent d’avoir
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
30
accès à une plus grande richesse des expériences sociales des violences d’État. Celles-cise construisent non seulement sur la base des violences physiques subies, mais sontaussi façonnées par des cadres de perception diffusés et imposés dans l’espace public.Ces cadres de lecture des violences liées à la guerre contre le narcotrafic tendent àséparer les victimes selon des critères d’innocence et de culpabilité et à mélanger desformes différentes de déviance sociale à l’intérieur d’une même catégorie : celle de« bandes du narcotrafic ».
3 Les matériaux ethnographiques qui constituent la base de l’analyse ont été recueillis
dans le cadre d’une enquête de terrain que j’ai menée à Ciudad Juárez entre 2008 et2011 (pendant une période de onze mois) sur les expériences de violence de certains deses habitants. Ciudad Juárez, ville mexicaine à la frontière avec les États-Unis, a étél’épicentre d’une des opérations militaires les plus sanglantes : entre 2008 et 2012, plusde dix mille personnes ont été tuées. Plutôt que d’aborder les témoignages des victimesengagées publiquement, j’ai choisi de partir de réseaux tissés précédemment dans troisquartiers populaires de la ville (mes premiers séjours de recherche dans la ville datentde 2006) 5, pour ensuite suivre les expériences de certaines familles touchées pardifférents types de violence pendant les années de l’opération militaire : des agressionsde la police ou des soldats, le meurtre d’un proche, les disputes entre bandes de lacriminalité organisée ou des violences liées à la délinquance de rue 6. Au milieu de cettecomplexité et de cette diversification des violences (qui n’ont pas commencé avecl’opération militaire et qui n’ont pas pris fin une fois celle-ci terminée), deuxdimensions ont émergé de manière récurrente : les pratiques violentes des forces del’ordre engagées officiellement dans la lutte contre le trafic des drogues (avec desdifférences entre les institutions civiles et militaires qu’il s’agira de creuser) ; desmassacres et des exécutions dans la rue et dans d’autres espaces publics (marqués parun manque total de données quant à leurs auteurs, qu’il faudra interroger). Lesinstitutions ont eu tendance à justifier ces violences en insistant sur la culpabilitéprésumée (ou réelle) des victimes. Narcotrafiquants, petits dealers, usagers de drogue,membres de bande de jeunes : tous rentraient dans une même catégorie de déviancesociale qui les exposait de facto aux violences.
4 L’article aborde le traitement public de ces violences et les récits de certaines des
victimes. La parole de ces dernières est porteuse d’une vérité sur ce qui s’est passé dansla ville pendant les années de l’opération militaire, une vérité qui a été largementdocumentée par les rapports et les enquêtes déjà cités. En même temps, et c’est là où leparallèle avec les discours publics devient heuristique, leur parole nous donne accès àd’autres dimensions, où s’articulent des enjeux « politiques et intimes 7 ». Ainsi, lescritères pour distinguer les victimes innocentes et celles qui ne l’étaient pas, ou ladistinction faite dans les pratiques violentes des différents acteurs, incorporent,rejettent ou enrichissent la narration hégémonique 8 des violences. C’est dans cesallers-retours entre expériences et récits, cadres de lecture hégémoniques et senssubjectif que j’envisage ici une ethnographie des violences politiques.
5 La première partie du texte se concentre sur l’émergence d’un discours public à propos
des violences liées aux opérations militaires de lutte contre le narcotrafic et de leursvictimes. La deuxième et la troisième partie abordent ensuite deux casethnographiques : celui d’un ex-soldat emprisonné illégalement pendant un mois etdemi et celui d’un groupe d’usagers d’héroïne et leurs familles. Ces deux ensemblesd’expériences ont été choisis parce qu’ils permettent de mettre en lumière les réalités
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
31
des violences vécues et les différentes manières, parfois contradictoires, que les acteursont trouvées pour leur donner du sens. En focalisant le cœur de l’analyse sur deux casethnographiques, je me réfère ici à un ensemble d’auteurs qui critiquent l’utilisationcompassionnelle de témoignages exemplaires dans certaines études anthropologiquessur la violence 9 et abordent les récits des sujets comme une voie d’entrée vers lacomplexité et les contradictions des expériences humaines de souffrance et deviolence 10. Celles-ci prennent forme à l’intérieur de cadres discursifs et de codesculturels, sans pourtant s’y réduire. Les hésitations, les changements de perspective, lesdifférents points de vue à l’intérieur d’une même famille ou groupe social ne sont pas« lissés » : ils constituent la richesse de la matière ethnographique et sont donc au cœurde l’analyse 11.
La construction d’un cadre : violences et victimes
6 Les opérations militaires de lutte contre le narcotrafic ont commencé au Mexique bien
avant que Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), deuxième président en alternanceaprès soixante-dix ans de régime priiste, organise son mandat en fonction d’unestratégie nationale de lutte contre la criminalité et pour la sécurité collective 12. Lesannées de la présidence Calderón ont pourtant marqué une nouveauté quantitative etqualitative dans les stratégies de lutte contre les trafics de drogues et leurs effetssociaux. Si les premières opérations militaires de destruction de cultures de marijuanaremontent aux années 1970 13, le gouvernement de Calderón a élevé la militarisation dela lutte contre le narcotrafic au rang de politique nationale, choisissant de déployerl’armée dans un large éventail d’actions et de fonctions qui auparavant étaient géréespar les forces civiles. Les effets de la stratégie militaire en termes d’augmentation de laviolence sont évidents : après des décennies où le taux d’homicides au niveau nationaln’avait fait que descendre (à quelques exceptions régionales près), le chiffre des crimesn’a fait qu’augmenter dans toutes les régions où l’armée était chargée des opérations delutte contre le narcotrafic 14.
7 Lancée en décembre 2006 avec l’envoi de cinq mille soldats de l’armée et de la marine
nationale et d’environ mille cinq cents agents de la police fédérale 15 dans l’État deMichoacán 16, la stratégie militaire de lutte contre le narcotrafic est étendue dansl’espace de quelques mois à plusieurs zones « chaudes » du pays : les centres principauxde production de marijuana et de pavot (comme la Sierra Madre, région montagneusepartagée entre les États de Sinaloa, Durango et Chihuahua au nord) et les zones detransit (notamment celles limitrophes aux trois mille deux cents kilomètres defrontière entre le Mexique et les États-Unis, comme la ville de Tijuana, métropole àl’extrême ouest du pays, et l’État de Tamaulipas, donnant sur le golfe du Mexique) 17. Sion se centre maintenant sur Ciudad Juárez on peut voir comment un discours autourdes violences – et notamment autour de ceux que l’on considère leurs auteurs et leursvictimes – se construit dans l’espace public.
La présomption de culpabilité comme narrationhégémonique
8 À Ciudad Juárez, ville industrielle d’un million trois cent mille habitants, entourée par
le désert et située juste au milieu de la frontière dans l’État du Chihuahua, les soldats
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
32
sont arrivés le 28 mars 2008. Sept mille troupes sont d’abord envoyées, rejointes aubout de quelques mois par deux mille autres unités. En avril 2010 les soldats sontpresque tous remplacés par des policiers fédéraux. Bien qu’il s’agisse d’une force civile,les tactiques et l’apparence de la police fédérale en font un corps fortement militarisé.L’Opération conjointe Chihuahua, ainsi nommée parce qu’elle prévoit la collaborationet la coordination des forces des trois niveaux de gouvernement (fédéral, fédéré,municipal), s’étend pendant quatre ans. Elle doit permettre de freiner les activités d’undes groupes du crime organisé les plus importants d’Amérique du Nord, connu sous lenom de « Cartel de Juárez », qui contrôle depuis la fin des années 1980 ce que SabineGuez définit comme la « frontière pivot sur la route transaméricaine de la cocaïne, de lamarijuana, de l’héroïne et de la méthamphétamine 18 ». Dans les mois qui suiventl’arrivée des soldats, le nombre d’homicides ne fait qu’augmenter dans la ville. D’aprèsles statistiques de mortalité du ministère de Santé, on comptabilise pour l’année 20081 589 homicides, 2 399 pour 2009 et 3 766 pour 2010, l’année la plus meurtrière del’histoire de Ciudad Juárez. En 2011, les chiffres concernant les homicides commencentà redescendre, avec un total de 2 282 cas, tandis qu’en 2012, pour la première fois aprèsquatre ans, les statistiques repassent sous le millier 19. Pour comprendre l’ampleur dutournant de 2008, il faut savoir qu’en 2007 les homicides enregistrés étaient de 189,chiffre très proche de celui des années précédentes.
9 Cette escalade de la violence est présentée par le gouvernement comme le résultat de
l’efficacité de la stratégie de lutte contre la criminalité organisée. Le combat frontalcontre les cartels de la drogue aurait provoqué la désarticulation des plus grandsgroupes, ce qui aurait produit à son tour une « guerre » pour le contrôle de la zone deCiudad Juárez. Les morts ne sont qu’une question interne à la criminalité organisée : telest le message véhiculé depuis le début 20. La manière dont le gouvernement traite leschiffres sur les homicides permet de mieux voir cette attitude à l’œuvre. Déjà, enjanvier 2009, la Procuraduría General de la República 21 adresse une directive à sesdélégués dans les États pour solliciter l’envoi de statistiques sur les délits et donne unesérie de critères pour définir les « homicides volontaires liés au crime organisé(exécutions) », comme l’utilisation d’armes de gros calibre, la présence de signes detorture sur les corps ou de messages écrits dans les lieux où ils ont été retrouvés 22.Deux ans après, le gouvernement diffuse une base de données sur les « homicides quel’on présume être liés à la criminalité organisée 23 » prenant en compte les« exécutions » (définies à partir des mêmes critères 24) et les « agressions et combats »(entre des groupes armés et les forces de l’ordre). D’après cette base, entre 2008 et 2011à Ciudad Juárez les homicides liés à la criminalité organisée auraient été de 6 300, soitenviron 80 % du total des homicides 25.
10 Un extrait du discours tenu en 2011 par le Président Calderón lors d’une réunion avec
des entrepreneurs de Coahuila, un des États limitrophes de Chihuahua, montre d’unemanière éclairante comment, dans la lecture des violences et la justification de l’actiondu gouvernement, la criminalité organisée et la délinquance commune se mélangent :
« Ceux qui tuent, voilà les criminels. Ceux qui tuent des jeunes innocents, voilà lescriminels. Ceux qui enlèvent et tuent des migrants, voilà les criminels. C’est ladélinquance qui fait des ravages dans notre société et notre territoire. C’est ladélinquance qui afflige les familles mexicaines, qu’elle soit organisée ou non,grande ou petite, qu’il s’agisse du vol d’un sac à main ou de l’enlèvement d’unhomme d’affaires ou de l’assassinat d’un migrant. Voilà les délinquants. Voilà lescriminels. Voilà les ennemis du Mexique. C’est eux qu’il faut freiner. C’est eux qu’ilfaut condamner. C’est à eux qu’il faut diriger un “ça suffit !” collectif et national. Un
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
33
“ça suffit !” aux criminels. Et tel est notre but à tous, j’en suis sûr, société etgouvernement. Il ne faut donc pas nous confondre. Les ennemis sont ceux quienlèvent et tuent. Non ceux qui luttent contre ceux qui enlèvent et tuent. Lesennemis sont ceux qui assaillent, volent et empoisonnent les jeunes, non ceux quiles combattent 26. »
11 L’idée d’une culpabilité présumée des personnes tuées au cours des actions des forces
de l’ordre ou pendant les affrontements entre groupes armés traverse comme un filrouge tous les discours publics sur les violences qui ont accompagné l’opérationmilitaire depuis ses débuts. En mars 2009, vingt détenus du pénitencier de l’État duChihuahua ont trouvé la mort pendant des émeutes et, en septembre de la même année,un centre de réhabilitation pour toxicomanes a été attaqué par un commando armé.Dix-huit personnes qui y étaient réunies pour la prière ont été tuées. Dans ces cas etdans d’autres massacres qui ont frappé la ville pendant les années suivantes 27, lesréactions des autorités rapportées par les médias ont toutes attribué les violences à lalutte pour le contrôle de la ville menée par deux groupes du crime organisé : le « Cartelde Juárez » et le « Cartel de Sinaloa » 28. Les antécédents judiciaires des victimes et leurparticipation à des bandes de rue étaient souvent mis en avant par les journalistes. Desarticles ont retracé l’histoire des gangs qui agissaient, selon cette lecture, comme « brasarmés » des cartels 29. Présents dans les prisons, ces gangs auraient aussi commencé àutiliser les centres de désintoxication pour se cacher 30.
12 Petits voleurs et dealers, toxicomanes et jeunes des bandes, structurellement unis à la
criminalité organisée par leur condition sociale, seraient responsables de la violencequi touche la ville. Dans ce parcours qui va du vol jusqu’au transport et à la vented’importantes quantités de stupéfiants, un élément est complètement passé soussilence : le rôle des forces de l’ordre dans l’escalade de la violence. Au cours de l’année2011, une série d’événements se sont produits où tantôt l’armée, tantôt la policefédérale ont directement été engagées dans les violences contre des civils : lespremières mobilisations massives des victimes organisées ont permis de remettre aucentre du débat public cette dimension. La question des « dommages collatéraux » de laguerre a ainsi émergé dans les discours publics et un débat autour des indemnisationsdes proches des « victimes innocentes » s’est ouvert. Le recours à la « présomption deculpabilité » pour justifier la montée des violences a perdu une partie de son emprisedans tous les cas où l’« innocence » des victimes était indéniable. Cependant, etparadoxalement, ce rappel à l’innocence de certaines victimes n’a fait que renforcer,pour toutes les autres, la présomption de culpabilité. Le rapport de 2010 de la plusgrande institution publique de défense des droits de l’homme au Mexique, la CNDH,dénonçait le fait que 111 personnes innocentes avaient été tuées au cours de combatsentre forces de l’ordre et groupes de la criminalité organisée (en reprenant donc ladistinction entre « exécutions » et « combats » proposée par le gouvernement). D’aprèsles chiffres du gouvernement, cette même année, les victimes totales des combatsétaient au nombre de 1 723. Si seulement 111 d’entre elles étaient « innocentes », laquestion qui vient à l’esprit est comment considérer les autres ? Cette distinction entrevictimes qui traverse les discours publics a des effets profonds sur les expériences desacteurs. Avant d’aborder les récits de ceux et celles qui ont été mes interlocuteurs surle terrain, un rapide détour par les mobilisations de victimes organisées permet demieux appréhender comment ces cadres de lecture des violences traversent aussi lesdiscours des activistes.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
34
Un non-dit autour des victimes qui ne sont pas« innocentes »
13 Depuis avril 2011, un mouvement « pour la paix » s’est affirmé sur la scène publique
nationale. Sa figure symbolique la plus importante est un écrivain, poète catholique,Javier Sicilia. Son fils de vingt-quatre ans a été tué le 28 mars 2011 avec cinq autrespersonnes, leurs corps abandonnés dans une voiture présentant des signes de torture.Les homicides ont été attribués à des anciens militaires soupçonnés de faire partie d’undes groupes criminels qui agissent dans la région (limitrophe de la ville de Mexico) etprésentés comme l’énième acte criminel de délinquants sans scrupules. À partir de là,Sicilia, entouré d’un groupe d’autres intellectuels provenant d’une élite progressiste etcatholique, a lancé un appel à l’opinion publique, envoyé des lettres, appelé à desmanifestations (deux cent mille personnes ont défilé dans les rues de Mexico en mai2011), promu l’élaboration d’un accord pour exiger la fin de la stratégie militaire delutte contre le narcotrafic. Une « marche pour la paix avec justice et dignité » (unevingtaine d’autobus et des dizaines de voitures privées) a parcouru 3 200 kilomètrespour arriver le 9 juin 2011 à Ciudad Juárez, ville qui a été reconnue comme le symbolede la faillite de la stratégie de la « guerre contre le narcotrafic ». La marche du « deuil »ou de la « consolation », comme l’a appelée Sicilia, a réuni des proches de victimes, desparents de disparus, des frères et sœurs, des femmes et des maris de victimes, qui ontdonné en public leurs témoignages dans toutes les villes du centre et du nord, où lamarche s’est arrêtée 31. La participation à Ciudad Juárez a été importante, environ 4 000personnes se sont réunies sur la place centrale le dernier jour, au moment de lasignature du « pacte pour la paix », et beaucoup d’entre elles sont sorties avec leurspancartes artisanales, avec la photo du parent assassiné ou disparu. Certaines d’entreelles ont pu prendre la parole publiquement, raconter leur histoire. J’ai assisté aux deuxjournées pendant lesquelles la marche s’est arrêtée à Ciudad Juárez, et j’ai discuté avecplusieurs participants, vu ou écouté les témoignages recueillis par beaucoup de médiasindépendants les jours précédents. La question de redonner la parole aux victimes,redonner la dignité aux victimes, revendiquer leur mémoire et leur innocence estdevenue un leitmotiv du mouvement, le cœur des revendications et la base de l’unionentre des gens de tout le pays.
14 Le mouvement pour la paix, avec ses mobilisations et sa visibilité internationale, a
contribué de manière décisive à remettre la question des victimes 32 et des violationsdes droits de l’homme au centre du débat public mexicain. Cependant, dans sesapparitions publiques comme dans les témoignages que ce mouvement a contribué àdiffuser, il y a une sorte de non-dit qui touche à toutes ces personnes tuées au cours dela guerre qui avaient un rôle dans la délinquance. Non pas les grands chefs du crimeorganisé (dont la mort, on l’a vu, est annoncée comme manifestation de l’efficacité de laguerre), mais ceux qui ont eu un rôle dans le bas de l’échelle de la longue filière dutrafic, les petits délinquants, les usagers de drogues, les membres des gangs engagéspar les groupes criminels pour transporter de la drogue ou tuer. Il ne s’agit pas, mesemble-t-il, d’un déni conscient ou d’un choix politique des activistes. Depuis sapremière prise de parole publique, seulement quelques jours après la mort de son fils,Javier Sicilia rapprochait dans leur condition de victimes ces jeunes qui « nonseulement sont tués mais après, criminalisés, accusés à tort » avec d’autres qui « enraison de l’absence d’un bon programme de gouvernement, n’ont pas l’opportunité de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
35
s’éduquer, de trouver un emploi digne et, chassés dans les banlieues, deviennent desrecrues possibles de la criminalité organisée et de la violence 33 ». Mais si on tientcompte des témoignages publiés par les sites de diffusion du mouvement ou les figuresqui en sont devenues les plus représentatives, c’est l’innocence des victimes ou leurengagement politique ou social qui va être mis en avant.
15 Le Mexique a une longue histoire de violence d’État à l’encontre d’activistes, de
journalistes, de syndicalistes, des défenseurs de droits de l’homme et le mouvementpour la paix avec justice et dignité a aussi payé de son sang cette violence, avec la mortde certains de ses militants 34. C’est le cas, par exemple, de Nepomuceno Moreno, pèred’un jeune de Sonora (autre État du nord, à l’est du Chihuahua) disparu en juillet 2010.Il avait rejoint le mouvement de Sicilia et soutenait activement une loi sur ladisparition forcée. Depuis début 2011, il dénonçait aussi avoir subi des menaces de mortde la part de la police de l’État de Sonora à cause de son engagement. Il a été tué dansdes circonstances peu claires en novembre 2011 à Hermosillo, capitale de l’État. Leporte-parole de la police de l’État affirmait devant la presse que Nepomuceno Morenoavait des antécédents pénaux qui permettaient de lier son assassinat à la criminalitéorganisée. Ce que le porte-parole ne disait pas, tout en ne pouvant pas l’ignorer, c’estque l’« antécédent » évoqué était en fait une erreur de la part de la police, ce que lajustice de l’État avait reconnu. Comme l’écrit Fédérico Mastrogiovanni enreconstruisant l’histoire de Nepomuceno Moreno, il s’agit là d’un exemple de la« criminalisation systématique des victimes par les institutions de l’État 35 ». La critiquede Mastrogiovanni – et plus généralement celle du mouvement des victimes – au travailsymbolique de stigmatisation des victimes par des institutions est puissante. Pourtant,elle ne semble pas arriver à interpeller toutes les personnes qui ont été touchées par laviolence d’État. C’est vers la complexité de leurs expériences et la richesse, parfoiscontradictoire, de leurs récits que l’on va maintenant se tourner.
Pratiques de la violence d’État
16 Bonnet noir, chemise blanche aux manches larges et lunettes de soleil bas de gamme, la
peau foncée par le soleil sec du désert, Rafael 36 a 48 ans et travaille commeparquero dans une des centaines d’épiceries qui parsèment les longues avenues deCiudad Juárez. Il passe ses journées à aider les clients à se garer dans le parking et àcontrôler leurs voitures, en échange de quelques pièces. Le syndicat indépendant oùtravaille Liliana, une ancienne ouvrière devenue mon amie au fil des ans, a unprogramme spécifique destiné aux travailleurs informels (parqueros, cireurs dechaussures, prostitués…) qui n’ont pas accès aux bénéfices de l’emploi salarié, pour lesaider à revendiquer leurs droits. Ils organisent des ateliers et font des réunions pouridentifier des besoins spécifiques à chaque secteur et Rafael fréquente régulièrement legroupe des parqueros. Je l’ai pris en photo le jour de l’arrivée de la Caravane pour la paixà Ciudad Juárez, avant de le rencontrer et qu’il me fasse le récit de sonemprisonnement. Sur cette photo, on le voit très droit, soutenant la banderole dusyndicat au milieu de dizaines d’autres personnes venues accueillir le poète JavierSicilia et d’autres proches des victimes de la « guerre contre le narcotrafic ». Sur labanderole on peut lire : « Bienvenue à Ciudad Juárez où le peuple organise son propredestin ». Rafael est là en tant que membre du syndicat et rien ne laisse imaginer qu’il avécu dans sa chair les violences dénoncées par les participants à la Caravane. Moins
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
36
d’un mois après le passage de la Caravane à Ciudad Juarez en juin 2011, grâce à lamédiation de Liliana qui venait d’apprendre qu’il avait été emprisonné, je rencontreRafael au siège du syndicat. Et il me raconte son histoire 37. Avant d’être parquero, ilavait été simple soldat pendant quinze ans. Accusé de narcotrafic par une connaissance,il avait été détenu illégalement dans une prison clandestine à l’intérieur de la caserne :« Ceux qui m’ont coffré, c’était des soldats. Je savais où on était, et tout. On était dans labase [militaire] ». Rafael parle de son emprisonnement avec simplicité et pudeur. Latraduction française 38 ne rend pas justice de son langage, farci de mots d’argot etémaillé des quelques fautes communes à ceux qui n’ont pas fait beaucoup d’études :
« C’était en mai 2008, le 20 mai 2008 […] J’étais en congé. Ben c’est quand j’suisrevenu [au travail à la caserne] qu’ils m’ont emmené… à la torture, pour le direcomme ça. Tout de suite, dès que j’suis arrivé… je commence à 8 heures,normalement, et à 11 heures, ils m’avaient déjà coffré. Ils m’ont emmené là-bas,pour me poser des questions… Il y avait ce type dont je t’ai parlé, et son fils. [Ilsdisaient] qu’ils avaient tué 34 personnes… et que j’étais mêlé… »
17 Rafael connaissait l’homme qui avait provoqué son emprisonnement. Quelque temps
auparavant, cet homme était allé lui demander des renseignements à propos de son fils,qui avait disparu depuis une semaine, emmené par les soldats. Il lui avait laissé un petitpapier avec son numéro, au cas où Rafael aurait obtenu des informations dans sacaserne. Quelques semaines après, ce même papier avait été retrouvé dans les affairesde Rafael : cela avait suffi à le coincer. Entre-temps, cette connaissance de Rafael avaitété retenue, accusée de s’être mêlée des affaires du fils. C’était ce dernier qui avaitdonné le nom de Rafael. Ils s’étaient retrouvés tous les trois dans la même cellule 39. Onles avait mis l’un à côté de l’autre, pour voir s’ils allaient « parler de leurs affaires » etainsi montrer aux soldats leur culpabilité. Ils avaient les yeux bandés, mais Rafael avaitreconnu la voix du père et en plus « Ils étaient très gros tous les deux et ils ronflaientbeaucoup ».
« Tout a commencé à partir de là. Tous les jours. Dès que je suis arrivé c’était lematelas… celui des décharges électriques. On t’attache, il y a de l’eau, on tedéshabille et après on te laisse reposer parce que… ça t’épuise. Et après c’est autrechose, c’est comme un fer, je crois. Mais comme t’as les yeux bandés, on voit rien. Etça, on te le met là [en m’indiquant son flanc] et dans la tête, et dans la figure, le cou,le dos. Si t’essaies de l’attraper… ben tu te brûles ! Parce que c’est du feu. »
18 Au bout de quelques semaines ils avaient arrêté les tortures plus strictement physiques.
Comme il l’apprend plus tard, sa famille et ses amis avaient commencé à se réunir tousles jours devant la base, avec d’autres proches de personnes disparues. C’est à cemoment-là que les tortures avaient diminué : « Ils ne me faisaient plus rien. Seulementde la psychologie et des trucs comme ça. Par exemple les sorties, quand ils te disentqu’ils vont te tuer… tous les jours… et ils te la mettaient là, l’arme, sur ta tête. Et on lasentait là ! [en me montrant sa tête] ». On les amenait dans des pick-up, toujours avecles yeux bandés, les pieds nus contre le sable. On les faisait marcher l’un derrièrel’autre pendant quelques minutes : « C’est comme ça qu’on nous tuait », dit Rafael 40.
19 Une fois sorti de l’emprisonnement clandestin, « réapparu » pour ses proches auxquels
on avait toujours dit qu’il ne se trouvait pas là, Rafael avait pu choisir : soit passerdevant le tribunal militaire sous l’accusation de trahison à la patrie et être enfermépendant 35 ans, soit démissionner, renoncer à sa retraite, ne plus mettre les pieds dansla caserne. Il avait choisi cette dernière option. Aucune possibilité de porter plainte :
« Qu’est-ce qu’elle peut faire ma famille contre l’armée ?… Rien ! Personne ne peutrien contre l’armée. C’est la plus haute autorité ! À tous les niveaux… et partout !
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
37
Pratiquement… Je vous l’ai dit… et ils le disaient aussi. Ils te disaient “tu vas teplaindre à qui, hein ? C’est le président qui nous envoie faire ça. Alors ! Tu vas teplaindre à qui ?” C’est la plus haute autorité… Ben ouais, on voyait bien quand ils tetabassaient, ils te disaient, “c’est lui qui nous a envoyé faire ça” ».
20 L’expérience de Rafael n’est pas unique, et depuis quelques mois elle a été reconnue par
la justice mexicaine, comme le montre le cas d’un ancien commandant d’une unité del’armée active dans l’État du Chihuahua qui a été condamné pour avoir ordonné destortures et des exécutions extrajudiciaires pendant les années de l’opérationmilitaire 41.
21 Si Rafael revient à plusieurs reprises sur les responsabilités des chefs militaires et du
Président, ses jugements ne sont jamais tranchés (notamment envers les simplessoldats) et les mots à travers lesquels il m’explique (et s’explique) ce qui lui est arrivésont parfois contradictoires. Deux éléments m’ont particulièrement frappée dans lesmanières de rendre intelligibles les violences qu’il a partagées avec moi lors de nosdeux longues rencontres. Le premier concerne les auteurs des violences, le deuxièmeleurs raisons. La distinction entre victimes innocentes et d’autres dont on interroge laculpabilité revient à plusieurs reprises.
Les bourreaux : une distinction entre simples soldatset soldats d’élite
22 Tout d’abord, peut-être du fait qu’il a lui-même servi dans l’armée, il a insisté plusieurs
fois sur le fait que les simples soldats ne font que suivre des ordres et que, d’ailleurs, ilsont pu remettre dans les mains de la justice des délinquants : « c’est son boulot. Lesoldat, il reçoit des ordres. J’ai été dans ce boulot… et l’armée a fait beaucoup, aussi !Elle en a attrapé beaucoup ! » L’opération militaire avait ouvert aux méthodes violentes:
« Ils [les soldats] n’avaient jamais fait ça. Jamais. Les soldats ne torturaient jamais.Et les narcos, quand ils les appréhendaient, ils les enfermaient… quand ils lestrouvaient avec de la drogue, ils ne les frappaient pas ! Ils les amenaientseulement… […] en prison, mais sans les toucher. Ils les respectaient. Et puis, suite àla [Opération] Conjointe Chihuahua, c’est quand ils ont commencé à attraper tout lemonde, partout… »
23 Dans cette évolution, tous les soldats ne sont pas chargés des tortures. D’après Rafael,
c’est la tâche des membres des groupes d’élites. Il s’agit de « los gafes » : des groupesd’élites de l’armée mexicaine formés aux tactiques de contre-insurrection. « Des fousfurieux », comme dit Rafael 42. Ceux-ci empruntaient des techniques de torture auxmafias :
« Les soldats non… en général ils tuent pas. Parce qu’ils ont la mesure… de latorture. On peut dire ça comme ça. Mais après… ça oui, on m’a menacé. “On va tepunir à la manière de la mafia”, c’est comme ça qu’ils me l’ont dit. C’est que la mafiac’est encore une autre affaire. Ils t’enlèvent les ongles ou un doigt. Ils te coupent…ton oreille… ou un bras. C’est ce qu’ils m’ont dit. »
24 Si les soldats commettent les violences dans le but de lutter contre la criminalité, il n’en
va pas de même pour les policiers fédéraux. À plusieurs reprises, Rafael parle despoliciers fédéraux qui « maintenant contrôlent le trafic de la drogue », qui kidnappentpour obtenir de l’argent, font du racket : « y en a beaucoup qui font partie des deux, pasvrai ? Les flics… les fédéraux… sont des mafieux et ils sont la loi, pour ainsi dire. C’est ça
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
38
qui rapporte ». À d’autres moments de l’entretien, néanmoins, Rafael reconnait que lessoldats aussi étaient impliqués dans le trafic. Il cite par exemple une unité de la Sierra(une zone montagneuse à l’ouest de l’État du Chihuahua où l’agriculture a presqueentièrement été reconvertie à la marijuana 43) qui protégeait les trafiquants : « c’étaittous des narcos là-bas ». Cette incertitude face aux auteurs des violences est revenuecomme un fil rouge pendant tous les mois de mon enquête. Le taux d’impunité (onestime que moins de 2 % des crimes donnent lieu à des procès 44) nourrit la confusionnon seulement autour des auteurs des violences mais aussi de leurs victimes. Lemanque d’informations judiciaires sur les crimes, amplifié par l’absence de donnéesstatistiques rigoureuses autour des victimes, ouvre à des questionnements sur lesraisons des violences. Comme on l’a vu, les discours publics tendaient à séparer desvictimes innocentes des autres, et à associer ces dernières à la criminalité organisée.Les propos de Rafael qu’on analyse ci-après font écho à ces discours, tout en ouvrantd’autres pistes d’intelligibilité.
Ruptures de sens autour des victimes
25 On en vient donc au deuxième élément important à retenir dans les récits de Rafael : les
raisons possibles des violences commises par les soldats. Il n’y a pas d’explicationssimples – d’après Rafael – ni sur son histoire, ni sur celle de ses collègues arrêtés outués à peu près à la même époque :
« –Rafael : …pour moi, c’est ça, ils voulaient pas payer les retraites !« –Chiara : …mais… du coup il y a eu beaucoup de soldats dans la même situation ? « –Rafael : Ben, plusieurs ! Un avec 17 ans [d’ancienneté], un autre avec 12… etensuite ; les deux qui ont été tués, un avait pris sa retraite depuis 3 mois… Et il avaitdes années [d’ancienneté] ! Et du coup il part [à la retraite] et après… tu vois ? Maisbon, va savoir s’ils étaient pas mêlés… ou qu’ils vendaient des voitures… Eddy, jesavais qu’il faisait passer des voitures à Chihuahua. C’est pour ça qu’on allait letuer…« –Chiara : Il faisait passer des voitures illégalement ? « –Rafael : Oui, pour aller dans la ville de Chihuahua 45 « –Chiara : C’étaient des voitures frontalières ou… ?« –Rafael : Bah… lui, il était genre le conducteur… il les amenait à d’autres gens. C’estpour ça qu’ils ont [essayé de le tuer]… je dis que c’est pour ça, parce que c’était pasun trafiquant, un trafiquant ça a plein d’argent et lui, il en avait pas. »
26 Dans cet extrait, il me semble que l’on peut bien percevoir les directions mouvantes que
prennent les chemins de construction de sens dans les récits de Rafael. Quand le traficde drogue (ou la lutte contre celui-ci) ne peut pas être constaté, la violence des rapportssociaux devient pour lui une explication tout à fait possible dans un contexte de criseéconomique. Les distinctions de classe et la distribution inégale du pouvoir de gestionde la violence fournissent alors un horizon de sens [ne pas payer les retraites]. Il s’agitpourtant d’un sens incertain et mobile qui n’échappe pas toujours aux cadres delectures hégémoniques. Ainsi, dans le cas de son ami Eddy qui conduisait des voituresillégales, c’est bien son activité qui devait être à l’origine de la tentative d’homicidequ’il avait subi (dont il m’avait parlé lors de notre première rencontre). Quant à lui,Rafael m’avait répété plusieurs fois son extranéité à la criminalité. En retraçant lespremiers jours dans la cellule, suite aux sessions de torture, Rafael raconte que :
« C’est là qu’ils [les soldats] m’ont dit qu’ils étaient tous les deux, le père et le fiston,en train de raconter toutes sortes de choses. [En faisant comme s’il était un des soldats]
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
39
“Ils racontent que t’en fais partie, que t’es dans la mafia et qu’ils te donnent vingt-cinq mille dollars et que tu vas et tu planques les armes dans un ranch et tout ça” etje lui dis : “noon !” je lui dis… “moi… je suis innocent”... “moi, non…” »
27 Selon Rafael, les violences des soldats sont illégitimes du fait qu’il n’avait aucun lien
avec la mafia, mais non pas dans l’absolu. Rafael ne s’explique pas comment les soldatsont pu le croire coupable. Ils auraient pu facilement constater son extranéité à partir desimples informations sur sa vie. Ainsi, à un autre moment, il m’expliquait qu’ilsauraient dû comprendre qu’il n’avait rien à voir parce que sa maison était sa seulepropriété, qu’il l’avait construite lui-même avant d’être soldat, et qu’elle était toutesimple. Comme il me l’avait explicité en parlant de son ami Eddy, et comme j’ai pu leremarquer avec le travail ethnographique, le pouvoir économique permet dans lesquartiers de distinguer ceux qui « sont mêlés » à la criminalité organisée des autres.Mais il y avait plus. D’après Rafael, la mafia était parfaitement au courant si un de sesmembres était attrapé par les soldats. S’il sortait vivant de l’emprisonnement ça voulaitdire qu’il avait donné des noms et c’est à ce moment-là qu’on le tuait ou que l’on s’enprenait à quelqu’un de sa famille. Or, Rafael était rentré chez lui une fois libéré sanscraindre les représailles des criminels, ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait travaillé poureux. Le problème, dans ce que Rafael exprime lors de notre entretien, tenait moins auxméthodes violentes de l’armée, qu’au fait que des personnes innocentes avaient étéemprisonnées.
28 L’échange suivant que j’ai eu avec lui me semble particulièrement pertinent pour
montrer comment la référence à l’innocence et à la culpabilité revient dans ce récit. Ildévoile aussi les effets que la relation d’enquête peut avoir sur les propos de nosinterlocuteurs :
« –Rafael : …beaucoup n’avaient rien à voir avec tout ça. Et ils étaient là ! Mettonsque moi, peut-être, j’étais coupable… parce que je connaissais ces gens-là [le père etle fils], ou juste parce que j’avais leur nom sur moi… c’était une part de faute ! « –Chiara : …mais même si vous aviez une part de faute…« –Rafael : Ils avaient pas le droit de faire tout ça ! « –Chiara : C’est-à-dire… il y a des tribunaux, n’est-ce pas ? On peut être jugé dans lecas où…« –Rafael : eh ben, c’est ça, ils avaient pas le droit de faire ce boulot !! Ouais… ilsétaient mal aussi… je vous ai pas dit tout ce que l’armée m’a fait ? J’ai perdu lesommeil et puis que j’ai même failli être traumatisé… Parce que ça a été un truc defous ! Avec un boulot comme ça… non… moi, comme, je vous l’ai dit, j’avais desconditions [physiques] ! J’ai tout supporté. Tout. Et tous les jours! Y avait pas unjour sans qu’on te bouge, on te parle, un coup de pied, ou un coup de trique… Etaprès les chefs débarquaient … “Quoi, on t’a encore frappé ?” “Nooon! Non. Tout vabien” Fallait leur dire que tout allait bien. Pourquoi ? Ben, parce qu’une fois qu’ilspartaient… y avait pas moyen. »
29 Au moment de l’entretien, mon attention était probablement trop focalisée sur les
tortures et l’injustice du traitement que Rafael avait subies pour avoir la présenced’esprit de lui demander pourquoi il considérait avoir « une part de faute », ou qu’est-ce qu’il entendait par « faute ». Comme le montre l’échange rapporté, c’est sur lespratiques violentes des soldats que notre discussion s’est toute de suite centrée ànouveau. La question de la distinction entre les victimes innocentes et celles qui ne lesont pas reste pourtant centrale. Et les propos de Rafael qui concluent l’entretien endonne un autre exemple :
« [Les soldats] ont visé juste beaucoup de fois… ils ont fait beaucoup de nettoyage.Même s’ils m’ont pris aussi, de toutes manières, je reconnais qu’ils ont attrapé
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
40
beaucoup de gens qui étaient vraiment coupables. Et en plus, moi, je les entendais…[en mettant en scène un dialogue entre des personnes emprisonnées avec lui] : “non, mec,tu vas pas tout déballer !” “De ces affaires là motus et bouche cousue, on vaseulement leur dire que…” – quand les soldats n’étaient pas présents – “Non,maintenant on va raconter ça de machin et de bidule, mais rien des autres !”… parexemple, si on m’implique... parce que j’ai entendu... j’aurais pu enlever monbandage – parce que beaucoup l’enlevaient – et j’aurais pu voir qui ils étaient et unefois dehors, j’aurais pu leur dire… il ne leur a manqué que ça, me faire bossercomme espion parmi ces gens-là ! »
30 La violence d’État s’exerce dans la matérialité des pratiques des tortures. Elle s’exerce
aussi au niveau symbolique. Le manque de données sur les auteurs et l’impunité dont ilsjouissent, d’un côté, ainsi que l’incorporation des discours qui tendent à culpabiliser lesvictimes, de l’autre, façonnent le vécu des acteurs et leur capacité à donner du sens àleurs expériences.
Les violences envers les usagers
31 C’est grâce à Compañeros 46, une association qui travaille dans la réduction des risques,
que j’ai pu rencontrer des personnes habitant dans des quartiers particulièrementfrappés par les homicides. Situés à proximité du centre-ville, il s’agit de quartierspopulaires, parmi les plus vieux de la ville. Dans ces quartiers, la consommationd’héroïne est énormément répandue et son trafic est contrôlé par une bande connuesous le nom des « Aztecas » et liée à la structure de pouvoir locale de la criminalitéorganisée. Les travailleurs de Compañeros, en grande partie des anciens usagers,accompagnés parfois par des psychologues, des médecins et des travailleurs sociaux, serendent toutes les semaines dans les picaderos 47 de ces quartiers pour échanger lesseringues usées avec des nouvelles, distribuer des préservatifs, se renseigner sur lasanté des usagers et réaliser des ateliers ou des cours de formation avec eux. Cette zoneanimée (on est assez proche du centre, des marchés publics, des zones des bars et dessaloons) devient de plus en plus silencieuse à mesure qu’on progresse vers les collinesarides qui délimitent l’ouest la ville. C’est vers cette zone, vallonnée et difficile d’accès,que l’on a poussé les migrants depuis le milieu du XXe siècle : elle a été peuplée à travers
les occupations des terres et l’auto-construction. Comme les rayons d’une bicyclette, lesrues principales qui délimitent les quartiers descendent vers le centre et sontaujourd’hui presque toutes pavées, tandis que les chemins qui permettent la mobilité àl’intérieur des quartiers et entre eux sont encore souvent en très mauvais état : en terreet pierre, exposés aux inondations fréquentes pendant la saison des pluies.
32 Si les violences et le harcèlement de la part des policiers envers les usagers n’ont pas
commencé avec l’opération militaire, celle-ci a néanmoins produit un changement – enquantité et en qualité – considérable.
Les dangers du récit
33 Toño a 27 ans. Grand, les yeux verts et les traits fins et beaux, typiques des terres de
migrants du nord du Mexique. Il porte sur son corps les stigmates de la dépendance,dans son cas à l’héroïne et, plus récemment, au Rivotril, un anxiolytique détourné dumarché légal très diffusé parmi les marginaux : il est extrêmement maigre, ses dentssont cassées et abimées, ses yeux brillants. Il habite dans une maison avec sa mère, ses
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
41
deux sœurs et leurs familles. Plusieurs jeunes consommateurs d’héroïne se réunissentdevant la maison, où ils peuvent trouver des seringues propres apportées par lestravailleurs de Compañeros. Ils peuvent alors bénéficier de la tranquillité de la chambrede Toño, accessible depuis la cour de la maison, pour se piquer.
34 La maison de Toño et de sa famille est humble mais accueillante et bien rangée. Elle est
construite d’adobe 48, comme beaucoup d’autres dans ces quartiers. Elles ont l’airsolides, ces vieilles maisons, mais les baraques qui surgissent encore aux coins des ruesmontrent que cette solidité n’a été construite qu’au fil des ans. Le grand et vieux frigo,le four à micro-ondes, une vieille télé, le lave-linge qui fait du bruit depuis la petitecour intérieure racontent la facilité à acquérir ce genre de biens qui, depuis les États-Unis, échouent de ce côté de la frontière. Onze personnes se partagent les quatrechambres qui composent la maison : Guille, la mère de Toño ; Flor, sa sœur ainée, sonmari et leurs deux enfants de dix-sept et dix-huit ans dont Mari, l’aînée, a un bébé d’unpeu plus d’un an et en attend un deuxième ; Betty, l’autre sœur de Toño de trente-sixans, avec ses trois enfants de dix-neuf, treize et neuf ans. Il y a deux ans, le restaurantoù Guille travaillait au centre-ville avait dû fermer à cause du racket et, à ses soixanteans, elle s’était retrouvée à chercher du travail. Flor, qui travaillait comme femme deménage à El Paso et qui apportait le seul autre salaire à la maison, l’avait aidée àtrouver des familles chez qui faire des ménages de temps en temps. La vente decigarettes importées illégalement des États-Unis leur permettait d’avoir une autreentrée d’argent, bien qu’irrégulière.
35 L’usage des drogues, le « vice » comme tout le monde l’appelle 49, fait partie de leur vie
au quotidien et suit des lignes genrées. Le mari de Betty, tué un mois avant notrerencontre, était dépendant à l’héroïne, comme l’époux de Flor. Leur fils consomme del’agua celeste, un inhalant issu du mélange de plusieurs solvants communs très répandudans toutes les villes de la frontière 50. Pendant les mois de mon enquête je l’ai vupasser par des périodes de désintoxication, marquées par quelques kilos de plus et parles commentaires fiers et pleins d’espoir de ses parents, pour ensuite le voir retomberdans la consommation. « Il y a beaucoup de vice ici… les gars… ils aiment le vice »,m’avait dit Guille avec une certaine honte la première fois qu’on avait discuté.
36 Dès ma première visite, la nouvelle de la mort du beau-frère de Toño a été une présence
à la fois lourde et silencieuse. Elle ne m’a été avouée par Betty qu’au bout de quatremois, mais était déjà apparue dans les conversations sous forme de silences émus quiinterrompaient d’un coup les récits sur les violences qui avaient augmenté dans la villeaprès l’arrivée des soldats. Peu encline à rester avec nous pendant mes visites, Bettyavait été persuadée par sa mère à s’assoir à nos côtés et m’avait raconté l’histoire deson mari. De notre conversation d’un peu plus de deux heures, j’ai gardé dans moncarnet la sensation aiguë que Guille et Flor voulaient que Betty se confie à moi, pour sesoulager peut-être, et décharger sa rage. J’ai marqué aussi les commentaires méfiants,tranchants, presque cyniques de Betty, si différents par rapport à la franchise ouverteet accueillante de sa sœur et à l’émotivité quelque peu timide de sa mère.
37 Quand Flor se montrait critique envers les violences des policiers et des soldats, Betty
défendait l’action du gouvernement et imputait les morts à l’efficacité de sa stratégiede lutte contre la criminalité : « c’est le premier gouvernement qui s’est missérieusement à ça ». Si les deux sœurs étaient d’accord sur la difficulté de vivre avecdes usagers de drogues et étaient conscientes de la présence des bandes de lacriminalité organisée qui géraient le trafic dans leur quartier, Flor soulignait la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
42
corruption des policiers locaux qui les laissaient agir en toute impunité et soutenait queles soldats et les policiers fédéraux ne voulaient pas arrêter le trafic mais plutôtimposer d’autres réseaux criminels. Betty, de son coté, reprochait aux dealers de payerles policiers et soutenait que tous les policiers n’étaient pas corrompus : « parmi lespoliciers il y en a des bons et des mauvais ». Toute notre conversation s’était dérouléecomme ça : entre les récits de violences de Flor et les réactions pleines de méfiance etde rage froide de Betty.
38 Ce jour-là, Flor, qui nous laissait seules de temps en temps, était sortie faire des courses.
On était en train de discuter des familles. Betty, peut-être pour interrompre le silencegênant qui s’était instauré entre nous, m’avait demandé si j’étais mariée et si j’avais desenfants. Et c’est à ce moment que les mots sont sortis tous en même temps :
« Le fait est que… ils m’ont tué mon époux. C’était il y a quatre mois. Je m’en suisrendue compte par le journal. Il allait pas bien, pourquoi je devrais te dire lecontraire ? Il allait mal, il était dans le vice. Je l’ai su par le journal parce qu’il étaitdéjà cinq heures et il ne revenait pas et donc je suis allée acheter le PM 51, et il étaitlà. »
39 À cette irruption abrupte du récit, je n’ai su répondre que par un moment de silence. Et
le récit avait repris : « Ma fille aînée était là quand j’ai vu sa photo dans le journal, elleétait là… et alors je suis restée avec elle… Ma mère et ma sœur sont allées à la morguepour l’identifier… ». Aucune possibilité de savoir qui avait tué son mari : « Pourquoiqu’on devrait demander quoi que ce soit ? Pour qu’ils nous tuent tous, nous aussi ? ».
40 Dans un article sur les témoignages des femmes ayant vécu des violences pendant la
partition entre l’Inde et le Pakistan, l’anthropologue Veena Das fait référence aux« dangers de la remémoration » auxquels nous exposons nos interlocuteurs dans nosrencontres ethnographiques 52. Manjeet, une des femmes rencontrées par Veena Das,avait choisi la formalité d’un texte écrit pour commencer son récit, en signalant ainsiêtre consciente de « la tâche douloureuse » que l’anthropologue lui avait demandée eten même temps sa volonté de l’assumer. Je crois que la réticence de Betty, ses réactionstraversées par la rage et la méfiance, ont en partie à voir avec les dangers symboliquesdont parle Veena Das. Le fait qu’à l’occasion des rencontres suivantes elle se soitmontrée beaucoup plus tranquille en est peut-être un indice. Mais dans le cas desviolences dont Betty et sa famille ont été témoins et victimes, les dangers ne sont passeulement symboliques. La manière dont elle raconte les circonstances de la mort deson mari permet de souligner cette question.
41 Du récit de Betty, deux éléments me semblent significatifs. D’abord, l’insistance sur le
« vice », sur le fait que son mari « allait mal » comme pour souligner la précarité de sacondition et la conscience, tachée d’un sentiment amer de culpabilité, qu’il s’exposait àce genre de violences. En insistant sur la dépendance de son mari, Betty semblait d’unecertaine manière avoir incorporé l’idée selon laquelle les comportements stigmatiséspouvaient expliquer la mort. Mais, et c’est le deuxième élément, les responsables de cesviolences sont loin d’être clairs pour elle. Au contraire, elle évoque la présence d’unacteur sans nom (« ils ») qu’on ne peut chercher à révéler, sous peine de représailles.Anonyme et puissant, cet acteur collectif revient constamment dans les narrations quej’ai recueillies dans ces quartiers. Pouvant impliquer tantôt les forces de l’ordre, tantôtle crime organisé, sans que les frontières entre les deux soient toujours claires, c’est desa main que la plupart des violences arrivent.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
43
Policiers vs. narcos : distinction dans les violences
42 « Quand les policiers fédéraux arrivent nous savons que nous devons les laisser entrer
parce que sinon ils entrent de force et détruisent tout. Nous devons aussi les suivrepartout pour éviter qu’ils laissent la drogue et disent ensuite qu’ils l’ont trouvée », meraconte Flor un jour où l’on discutait des répercussions que l’opération militaire avaiteues dans leur quotidien. C’est un récit qui revient constamment. Ils « sèment » ladrogue dans les maisons, ils proposent aux usagers d’en vendre pour eux, ils volent leurargent. Un mois auparavant seulement, ils avaient à nouveau interpellé Toño et lesautres usagers qui se réunissaient chez lui et avaient commencé à les frapper. QuandFlor s’en était rendue compte, elle avait noté les plaques des patrouilles mais lespoliciers l’avaient affrontée tout de suite. Ils l’avaient insultée et menacée, enl’appelant par son nom et son prénom et en lui disant qu’ils connaissaient toute safamille. Une jeune fille qui habitait en face de chez eux et qui revendait de la marijuanaavait été violée par les policiers.
« Il y a aussi les narcos, mais ils savent qui chercher, ils savent qui tuer. S’ils tuent,c’est parce qu’on leur doit quelque chose. Ou c’est pour frapper l’autre groupe. Lespoliciers non, les policiers arrivent comme des fous, attrapent tout le monde, tirentdans le tas et les jettent dans un coin. »
43 En me racontant cela, Flor cherchait moins à défendre les narcos qu’à souligner le
désarroi d’être confrontée à une violence dont on ne comprend pas les raisons. Si, desnarcos, ils avaient appris à connaitre les méthodes, les militaires et les policiersfédéraux semblaient commettre des violences sans sens. Cette distinction entre desmeurtres compréhensibles (d’une certaine manière) et d’autres qui arrivent par« erreur » ou sous l’emprise de la « folie » revient aussi dans le récit de Chito, un amid’enfance de Toño qui habite à quelques rues de chez lui.
44 Chito et Toño ont grandi ensemble et, ensemble, ils ont commencé à se piquer. Plus
menu que Toño, Chito a un caractère assez opposé. Autant Toño est silencieux ettimide, autant Chito est bavard et se montre sûr de lui. Il intervient souvent pendant lesateliers organisés par Compañeros et raconte sans réticences son parcours dans latoxicomanie, qu’il associe aux expériences douloureuses qu’il a vécues dans sa famille.Son père travaillait comme déchargeur de marchandises sur les trains et passait delongues périodes loin de la maison. Sa mère s’occupait de leurs quatre enfants, dont lepremier, le seul plus âgé que Chito, était né d’une union précédente. Les deux « étaientfous », d’après ses mots. Il me raconte qu’il lui était arrivé de partager de la drogue avecson père, dépendant à la cocaïne. Quand Chito a huit ans, sa mère meurt d’un cancer, etil déménage avec ses frères chez une tante. Avec déjà sept enfants, la tante n’arrive pasà s’occuper toute seule de Chito et de ses frères et elle les envoie dans une école pourdes enfants défavorisés gérée par des religieuses où ils sont hébergés pendant lasemaine. Ils y restent jusqu’à ce que Chito, en première année de collège, s’enfuit. Ilrévèle à sa tante que les sœurs les frappent beaucoup et lui demande de revenir à lamaison. C’est à ce moment qu’il commence à essayer des drogues, suivant unetrajectoire commune parmi les usagers. De la marijuana d’abord, pour ensuite passer àl’agua celeste, et finalement à l’héroïne. Deux de ses frères et tous ses cousins sont mortsau cours des deux dernières années. Sa tante, avec qui Chito et ses trois frères ontgrandi après la mort de leur mère, a déménagé récemment, après avoir perdu laplupart de ses fils :
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
44
« Elle les a déjà tous perdus. Pour les drogues… non, pas pour les drogues, je mens.Elle en a perdu un à cause de la drogue. Les autres… ils les ont tués. Ils lui ont tuépar balle tous ses fils. Dans les bagarres qu’il y a ici. Tu sais ? Il y avait des conflits. Ily avait des disputes avec d’autres gens et ces gens –comment te dire ? – ces gens“andaban movidas 53” [se mouvaient – il baisse sa voix]. À un moment donné ils sontarrivés et… [silence] Mon frère, oui, ils me l’ont tué… bah… Ils l’ont pris pour unautre. Et mon cousin aussi. L’un des enfants de ma tante. Ils me l’ont tué aussi. Ilsm’ont tué les deux en même temps, ils me les ont tués… Là-bas, Chiara. Ils sontarrivés comme des fous et… ils ont tiré dans le tas et… ils ont frappé mon frère, moncousin et un de mes camarades. Tous les trois en un instant. »
45 Au moment de parler de la mort de ses cousins, Chito change soudainement de
discours. Sans vouloir rentrer dans les détails, il marque une différence entre leursmeurtres et ceux de son frère et de son autre cousin. Les premiers avaient des disputesavec des personnes qui étaient liées à la criminalité organisée, qui « se mouvaient »,dans le jargon local, ce qui d’une certaine manière inscrit leur mort dans un horizon desens, qu’il évite pourtant d’aborder. Pour les seconds, des acteurs anonymesreviennent. Ils arrivent et tuent « comme des fous », a lo loco. Ils confondent des gensentre eux. À plusieurs reprises de mon enquête, mes interlocuteurs ont évoqué la mortde personnes qui avaient été prises pour quelqu’un d’autre. Il s’agissait toujours depersonnes marginales, assises aux coins de rue des quartiers populaires. C’était lesvoyous, les toxicos, les cholos du quartier, terme qui désigne dans les villes frontalièresles jeunes des bandes 54. Comme Michael Taussig l’a montré dans sa remarquableethnographie du nettoyage social dans une ville colombienne, c’est dans ce mélange destigmatisation et de confusion que s’ouvre l’espace pour une violence contre les« indésirables » de la société 55.
Les violences des soldats
46 Comme beaucoup d’autres usagers que j’ai connus, Chito n’a pas seulement été témoin
de la mort de son frère. Il a aussi fait l’expérience de pratiques violentes de la part dessoldats. Quand son frère a été frappé par les projectiles, ils ont appelé une ambulance etdes policiers municipaux ont rejoint les lieux. C’est en me racontant ces momentsfrénétiques que Chito aborde rapidement, comme si de rien n’était, d’autres violences,celles que des soldats avaient commises contre lui. La reprise d’un long extrait del’entretien permet de voir ce basculement à l’œuvre :
« –Chito : Le policier me disait “elle va arriver [l’ambulance], elle va arriver” et moi“mais quand ?! Si c’était quelqu’un de ta famille, t’aurais déjà fait quelque chose !”Et le policier “tu me causes pas comme ça, hein !” “Je te cause comme ça mechante ! Tu te prends pour qui ? Juste parce que t’as ta plaque et ton uniforme !Vas-y voir, t’as qu’à les enlever !” Et ils allaient m’emmener, ils allaient me mettredans le fourgon, mais une fille, une de mes copines, m’a pris et m’a éloigné, elle medisait “laisse tomber ! On s’en balance, qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils vont rienfaire”. « –Chiara : c’était des [policiers] municipaux ? « –Chito : c’était des municipaux. Et des soldats… mais moi, je m’en prenais auxpoliciers… [en riant] bien sûr, j’allais pas m’en prendre aux soldats, hein ! Parcequ’avec eux… ben, faut faire gaffe avec eux ! La dernière fois ils m’ont bien tabassé,hein. Mais quelque chose de bien, quoi. La dernière fois ils m’ont brûlé les pieds.Dieu merci, ils m’ont pas emmené… mais… ils m’ont brûlé les pieds. »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
45
47 Surprise par cette irruption de souvenirs, à la fois abrupte et banale, je demande à
Chito ce qui s’était passé avec les soldats. Comme j’avais pu le remarquer dans le récitde Rafael, Chito parle des violences avec pudeur, en réfléchissant aux mots et enchangeant soudainement de discours, sans suivre un fil chronologique, en s’attardantsur les détails les plus sordides sans aucune emphase :
« –Chiara : Comment ça ? « –Chito : Ils m’ont brûlé.« –Chiara : Mais quand ? Comment ? Pourquoi ? « –Chito : Hum… ils m’ont trouvé… ben… ils m’ont trouvé avec plusieurs bouteillesde solvants. J’étais en train de… bah, à ce moment-là je vendais des solvants [enbaissant le ton de sa voix]… et donc… ils sont arrivés et ils m’ont pris… et ils m’ontemmené… »
48 Les soldats l’avaient emmené derrière une colline non loin de son quartier, dans un
endroit où ils n’étaient pas visibles. Ils l’avaient tabassé et forcé à boire de l’eau avec dusavon et à manger du piment « pour que je vomisse, je crois, pour ça », pour aprèsl’obliger « à ramasser mon vomi avec ma bouche ». Finalement :
« Ils m’ont aspergé avec le solvant que je vendais, ils m’ont entièrement aspergé.Ensuite, ils ont mis le feu à mes baskets. Ils ont jeté une allumette… sur mes baskets.Dieu merci, le feu n’a pris que sur mes baskets et j’ai pu l’éteindre tout seul. Là oùon était il y avait de la terre et j’ai pu me rouler par terre… j’ai roulé et roulé et,Dieu merci, le feu n’est pas monté plus haut. »
49 Plus que la retranscription de l’entretien, ce sont mes notes et les intonations de la voix
qui permettent de rendre justice à la manière dont Chito perçoit et raconte lesviolences : les hésitations et le changement de ton (quand il avoue qu’il dealait dessolvants) s’accompagnent d’une manière presque plate de raconter ce que les soldatsl’ont obligé à faire (très différente du ton quelque peu gémissant avec lequel il avaitévoqué les difficultés de son enfance). L’hésitation avec laquelle il évoque le fait qu’ildealait des solvants pourrait évoquer sa crainte d’une réprobation de ma part. Notrerencontre, il faut le rappeler, s’est faite dans le cadre des politiques de réduction desrisques et c’est en raison de la consommation de drogues – en non pas de leurcommerce – que le statut des usagers en tant que personnes et patients est reconnudans l’association. Au-delà de ça, il me semble que c’est la quotidienneté avec laquelleles usagers font l’expérience de pratiques violentes de la part des forces de l’ordre quele récit plat de Chito évoque. Depuis 2009, une série de réformes connues sous le nomde « loi sur le trafic de fourmis » (Ley de narcomenudeo) régule le commerce, lapossession et la consommation de certaines drogues illégales. Ces quantités sonttellement réduites que les usagers interpellés se trouvent très souvent au-delà deslimites consenties et exposés au harcèlement et à la criminalisation 56.
Conclusion
50 Comme l’écrit Didier Fassin dans son ouvrage sur les expériences et les politiques du
sida dans l’Afrique du sud post-apartheid, les sciences sociales ont parfois risqué dereproduire des généralisations qui ne prennent pas en compte les individus et leursvécus. En parlant spécifiquement de l’anthropologie, il écrit que : « L’analyse qu’ellepeut donner des structures et des processus de domination, d’exploitation et deségrégation tend à opérer des généralisations et des simplifications qui finissent par neplus refléter les expériences individuelles et collectives 57 ». Cette approche n’invite pas
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
46
à défendre le subjectivisme, mais essaie au contraire de montrer l’articulation entreexpériences individuelles et collectives, entre la détermination sociale (et culturelle,quant aux cadres de lecture) des violences et les voies multiples à travers lesquelles lessujets incarnent cette détermination.
51 Les récits des personnes ayant vécu directement ou dans leurs familles l’expérience des
violences permet de suivre à la fois les trajectoires sociales de leur victimisation et leschemins, parfois contradictoires et toujours mouvants, à travers lesquels ils essayent dereconstruire un sens à leur vécu. Les cadres de lecture centrés sur la culpabilité desvictimes influencent ces récits, sans pour autant les déterminer. En se rapprochant deces expériences, on voit par exemple émerger une distinction entre les différentsacteurs de la violence qui ne correspond pas à la séparation entre forces de l’ordre etdélinquants mise en avant par la narration hégémonique. Celle-ci se trouve ainsidébordée par les relations sociales. Dans un contexte où les auteurs et leurs raisons nesont pas toujours identifiables, le pouvoir économique devient un indice socialementreconnaissable pour établir ceux qui sont impliqués dans la criminalité organisée. Ildonne aussi, de fait, un pouvoir sur la gestion des violences.
52 L’expérience de Rafael, ancien soldat accusé de narcotrafic, a été une voie d’entrée vers
la réalité de la violence d’État qui a accompagné les pratiques des forces de l’ordrependant l’opération militaire. Elle a permis aussi d’interroger les ruptures de sensprovoquées par l’irruption de cette violence dans le vécu de quelqu’un qui a été, à unmoment de sa vie et dans une position subalterne, membre de ces mêmes forces del’ordre. Rafael aborde explicitement la question de certaines personnes qui avaient unrôle dans la criminalité et qui, comme lui, avaient été emprisonnées et torturées. Ladistinction entre victimes innocentes – dont on ne s’explique pas la disparition ou lamort – et victimes coupables – pour lesquelles les méthodes violentes des soldatssemblent tout à fait justifiées –revient dans les récits de Rafael et contribue à façonnersa manière de donner du sens à son histoire. Ces mêmes distinctions semblentbeaucoup plus subtiles et mouvantes dans les récits des différents membres del’entourage d’un usager d’héroïne tué en 2011. Ceux-ci ont permis d’élargir la questionde la violence d’État et d’aborder la stratification des violences dans la vie des usagers,tout en montrant les tensions entre différents points de vue et les manières diversesd’incorporer ou de rejeter les cadres hégémoniques de perception des violences. Si les« mafieux » et les membres de bande qui y sont associés semblent agir de manièreintentionnelle, les soldats et certains policiers sont les auteurs, d’après ces victimes, deviolences gratuites, tout en étant parfois de mèche avec les criminels. Les expériencesdes usagers, stigmatisés et conscients de se trouver dans une position moralementreprochable, parlent ainsi d’une quotidienneté des violences contre les indésirables dela société.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
47
NOTES
2. HRW, Neither Rights Nor Security. Killings, Torture, and Disappearances in Mexico’s « War on Drugs »,
Human Rights Watch, 2011 ; Reveles J., Levantones, narcofosas y falsos positivos, México D.F.,
Grijalbo, 2012 ; Mastrogiovanni F., Ni vivos ni muertos: La desaparición forzada en México como
estrategia de terror, Mexico D.F., Grijalbo, 2014.
3. Méndez J., Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 2014 ; Heyns C.,
Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 2014.
4. CIDH, Situación de los derechos humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos
Humanos - Organización de los Estados Americanos, 2015.
5. Dans un article paru dans une des revues mexicaines d’anthropologie les plus connues,
Alteridades, Salvador Maldonado parle des « possibilités réalistes des ethnographies » qui se
déroulent dans des contextes de violence, dans son cas l’État de Michoacán, et raconte à ce
propos avoir décidé de suivre les réseaux qu’il avait créés au cours de recherches
ethnographiques avant l’explosion des violences. Dans ce choix, s’articulent des raisons de
sécurité et la volonté de ne pas succomber au « présentisme » qui impose certaines thématiques
et certains interlocuteurs : Maldonado Aranda S., « Despejando caminos inseguros: Itinerarios de
una investigación sobre la violencia en México », Alteridades, vol. 24, n°47, 2014, pp. 63-76.
6. Une autre partie du travail de terrain s’est intéressée aux institutions de prise en charge des
victimes et à la manière dont leurs agents (psychologues, avocats, assistants sociaux, policiers)
ont perçu et vécu les violences. Pour une analyse des dimensions de genre, de classe et de
citoyenneté d’un programme spécifique dédié aux enfants des victimes : Calzolaio C., « Contre la
violence. Fabriquer de “bons” citoyens à Ciudad Juárez (Mexique, XXIe siècle) », Clio. Femmes, Genre
et Histoire, n°43, printemps 2016, pp. 117-138.
7. Voir Makaremi C., dans ce même numéro.
8. En utilisant les expressions « narration hégémonique » et « cadres de lecture hégémoniques »
je fais référence à des auteurs qui ont récemment repris les réflexions gramsciennes autour de
l’hégémonie pour analyser les rapports de pouvoir de manière dynamique et non essentialiste.
Gourarier M., Rebucini G., Vörös F., « Penser l’hégémonie », Genre, sexualité & société, n°13, 2015
[En ligne], n° 13, printemps 2015, http://gss.revues.org/3530 [consulté le 29 septembre 2016].
Dans le contexte des violences liées à la lutte contre le narcotrafic, un ensemble de pratiques
(pour lutter contre la criminalité) et de représentations (autour des auteurs et des victimes de la
violence) se sont affirmées dans l’espace public. Elles constituent des référents à partir desquels
se façonnent les expériences des acteurs sociaux, sans pour autant les définir de manière
déterministe.
9. Butt L., « The suffering stranger: Medical anthropology and international morality », Medical
Anthropology, 2002, vol. 21, n°1, pp. 1-24.
10. Das V., « Témoignages de femmes sur la violence durant la Grande Partition », Revue
européenne de migrations internationales, vol. 7, n°1, 1991, pp. 31-44 ; Das V., « The Act of
Witnessing. Violence, Knowledge, and Subjectivity », in Das V., Kleinman A., Ramphele M.,
Reynolds P. (eds.), Violence and Subjectivity, Berkeley, University of California Press, 2000,
pp. 205-225 ; Good B., Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994 ; Fassin D., Quand les corps se souviennent. Expériences et politiques
du sida en Afrique du Sud, Paris, La Découverte, 2006 ; Fassin D., Le Marcis F., Lethata T., « Life &
Times of Magda A. Telling a Story of Violence in South Africa », Current Anthropology, vol. 49, n° 2,
2008, pp. 225-246.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
48
11. Il est possible de faire un parallèle avec la manière dont Arlette Farge entend le travail de
l’historien qui s’intéresse au « minuscule », au « singulier » : il devra être capable de révéler les
continuités du temps long de l’histoire, sans faire l’économie des assonances et des dissonances à
travers lesquels les individus en font l’expérience : « S’il est vrai que l’écriture de l’histoire
requiert de passer du désordre à l’ordre (désordre des sources, des hypothèses, des documents ;
ordre raisonné de la narration), il faut savoir qu’il n’y a pas d’histoire sans reconnaissance de ce
qui fait désordre, énigme, écart, irrégularité, silence ou murmure, discorde dans le lien entre les
choses et les faits, les êtres et les situations sociales ou politiques. » Farge A., « Penser et définir
l’événement en histoire », Terrain, n°38, 2002, pp. 67-78, p. 68.
12. Astorga L., Seguridad, traficantes y militares: el poder y la sombra, México D.F., Tusquets, 2007.
13. La première opération militaire de destructions de champs de marijuana remonte à 1977 :
Astorga L., El siglo de las drogas. El narcotráfico, del Porfiriato al nuevo milenio, México D.F., Plaza Janés
[1ère ed. 1996], 2005, p. 115.
14. Escalante Gonzalbo F., El Homicidio en México Entre 1990 y 2007: Aproximación Estadística, El
Colegio de México, 2009 ; Escalante Gonzalbo F., « Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso
revista », Nexos, n°397, 2011, pp. 36-49.
15. Situé au centre-ouest du Mexique, l’État rural du Michoacán est l’un des principaux
producteurs de marijuana et de pavot : Maldonado Aranda S., « Drogas, violencia y militarización
en el México rural. El caso de Michoacán », Revista Mexicana de Sociología, vol. 74, n° 1, 2012, pp.
5-39.
16. Le Mexique étant une République fédérale, il existe des polices relevant des trois niveaux de
gouvernement (municipale, de l’État fédéré et fédérale) avec des juridictions différentes. Le
narcotrafic, les délits contre la sécurité de la nation ou ceux commis par des fonctionnaires
publics doivent être poursuivis et jugés au niveau fédéral (cf. Código Penal Federal).
17. Sur le développement du trafic des drogues aux Mexique et son changement d’échelle après
les années 1980, voir Astorga L., op. cit.
18. Guez S, « La frontière et au-delà. Une enquête ethnographique sur le narcotrafic à Ciudad
Juárez (Mexique) et El Paso (États-Unis) », Cultures & Conflits, n°72, 2008, pp. 13-29, p. 14.
19. INEGI, « Estadísticas de Mortalidad. Defunciones por homicidio, por entidad federativa y
municipio de ocurrencia (1990-2013) », Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e
Informática, 2013, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?
p=mortgral&c=33465&s=est&cl=4 [consulté le 28 juillet 2013]
20. Alejandro Poiré, porte-parole du gouvernement sur les questions de sécurité, diffuse
régulièrement des communiqués sur les progrès et les résultats de la « guerre ». Sur la violence,
voir notamment Poiré A., El aumento de la violencia en México, Consejo de Seguridad Nacional, 2011.
21. La PGR est l’institution chargée de la justice au niveau fédéral, proche dans ses fonctions et
compétences du General Attorney aux États-Unis.
22. J’ai eu accès au document grâce à une journaliste de la ville rencontrée en 2011 par la
médiation d’un ami. Le journal pour lequel elle travaille avait reçu cette directive de la part de la
PGR pour le traitement des informations et notamment dans les notes publiées. PGR, « Circular
No. CGD/004/2009 », Procuraduría General de la República. Subprocuraduía de control regional,
procedimientos penales y amparo. Coordinacíon general de delegaciones, 19 janvier 2009.
23. La Base de Datos de los Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada
change de nom quelques mois après et devient la Base de datos de fallecimientos ocurridos por
presunta rivalidad delincuencial (base de données de décès dus à une rivalité criminelle présumée).
24. Voir à ce propos le document méthodologique de la base de données (Presidencia de la
República, Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial. Metodología,
2011).
25. La base de données, rédigée à partir des statistiques du Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen), n’inclut pas le nombre total d’homicides. La proportion obtenue en comparant
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
49
les statistiques du Gouvernement avec celles de l’Inegi déjà citées (qui comptent 7 754 homicides
entre 2008-2010) est de 81,24 %.
26. Calderón F., Palabras del Presidente Calderón durante la Comida con Empresarios de Coahuila,
Coahuila, Presidencia de la República, 2011. Toutes les traductions de l’espagnol (extraits de
textes et d’entretiens) ont été retravaillées en collaboration avec Antonia García Castro.
27. Entre 2008 et 2011, plusieurs centres de désintoxication de la ville ont été visés par des
commandos armés, en provoquant la mort de plus de 30 personnes.
28. Macías Medina S., « “Masacre es el reflejo del exterminio entre la delincuencia organizada”
Operativos están dando resultados: Procuradora », El Diario, 9 avril 2009.
29. Ponce de León A., « Nacieron en Texas bandas de “Aztecas” y “Mexicles”; sirven a narcos
mexicanos », El Diario, 3 mai 2009.
30. Sánchez Briones P., « Ven infiltración de narco en albergues », El Diario, 26 septembre 2009.
31. Une autre caravane vers le sud du pays s’est aussi déroulée en septembre de la même année.
32. Une loi fédérale sur les victimes a été approuvée en 2013 par le Gouvernement d’Enrique Peña
Nieto qui a succédé à Felipe Calderon en 2012.
33. La lettre de Javier Sicilia, son « j’accuse » au gouvernement et à la criminalité organisée,
responsables, les deux, de l’escalade de violences vécue dans le pays, a été publiée par les
principaux journaux mexicains. On peut toujours la lire sur le site web de la revue Proceso :
« Javier Sicilia: Carta abierta a políticos y criminales », Proceso, 3 avril 2011, http://
www.proceso.com.mx/266990/javier-sicilia-carta-abierta-a-politicos-y-criminales [consulté le 29
septembre 2016]
34. L’assassinat et la disparition forcée des 43 jeunes élèves de l’école rurale d’Ayotzinapa en
septembre 2014 n’a été que le dernier épisode de cette histoire de violence politique. Le rapport
du GIEI, le groupe d’experts internationaux nommés par la Commission interaméricaine des
droits de l’homme, a démenti la version officielle et prouve la participation des militaires à la
disparition et à l’assassinat des jeunes. Il possible de le consulter sur leur site internet : http://
prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe-
35. Mastrogiovanni F., Ni vivos ni muertos. La sparizione forzata in Messico come strategia del terrore,
Rome, DeriveApprodi, 2015, 93.
36. Par souci d’anonymat, tous les noms ont été changés et certains détails sur les lieux omis.
37. L’entretien avec Rafael s’est étendu sur deux après-midis. La première fois Liliana était
présente aussi. Elle craignait que Rafael ne se sente pas assez à l’aise, seul avec moi, et elle voulait
rester au moins au début. Nous ne nous attendions pas à ce que Rafael, silencieux et réservé de
caractère, rentre dans les détails des tortures et de son emprisonnement avec autant de facilité et
de rapidité. Il n’en avait parlé avec personne, nous dit-il. Surprise par cette entrée en matière si
directe, et prise par le récit, je n’ai pas eu le courage de lui demander d’enregistrer et je n’ai pris
que des notes lors de ce premier entretien. C’est seulement à la fin de cette première rencontre
que j’ai pu lui proposer de nous revoir pour que je puisse enregistrer. Il a accepté et la plupart
des extraits viennent de la transcription de ce deuxième entretien (qui reprend et précise le
premier).
38. Ma traduction, retravaillée en collaboration avec A. García Castro.
39. De grandes cellules où de nombreux prisonniers sont entassés.
40. Human Rights Watch, dans son rapport de novembre 2011 sur la « guerre contre le
narcotrafic » au Mexique, donne un excursus rapide de ces mêmes pratiques : « les techniques de
torture les plus communes utilisées par les forces de sécurité consistaient en passages à tabac,
asphyxie à travers des sacs en plastique ou par étouffement, décharges électriques, torture
sexuelle, menace de mort ou simulacre d’exécution ». HRW, Neither Rights Nor Security. Killings,
Torture, and Disappearances in Mexico’s « War on Drugs », Human Rights Watch, 2011, p. 33.
41. Breach M., Villalpando R., « Chihuahua: 33 años de prisión a cinco militares por tortura,
homicidio e inhumación clandestina », La Jornada, 21 janvier 2016, p. 29.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
50
42. On les connait comme « gafes » dans le langage courant en référence à la dénomination qu’ils
ont eu entre 1990 et 2004 : Grupo Aeromovil de Fuerzas Especiales. Le noyau de formation d’une des
organisations criminelles les plus meurtrières de l’histoire récente du Mexique, les Zetas, était
composé d’anciens membres de ces groupes d’élite.
43. Arellano Rodríguez A., « Modelo económico de exclusión: caso etnográfico de la siembra de
marihuana en la región o ́óba », Tesis para optar el título de licenciada en Antropología social,
Escuela Nacional de Antropología a Historia Unidad Chihuahua, Chihuahua, 2011.
44. Rivera M., Ch R., « Números Rojos del Sistema Penal », CIDAC - Centro de Investigación para el
Desarrollo A.C., 2011.
45. La ville de Chihuahua, capitale de l’État homonyme, se trouve à environ 4 heures de Ciudad
Juarez. Suite aux accords de libre commerce (1994), les voitures venant des États-Unis peuvent
circuler librement à l’intérieur de la zone franche frontalière qui s’étend jusqu’à 20 kilomètres au
sud de la frontière. Au-delà de cette limite il faut payer des impôts pour l’importation qui varient
en fonction de l’année et du modèle de véhicule. La criminalité organisée s’est insérée depuis des
années dans le commerce illégal des voitures vers l’intérieur.
46. S’agissant de la seule organisation de la ville travaillant dans la réduction des risques, je n’ai
pas changé le nom de Compañeros, l’anonymat de mes interlocuteurs étant garanti par le nombre
élevé des personnes travaillant avec cette association.
47. Le picadero est le lieu où les consommateurs d’héroïne vont se « piquer ». Ce peut être dans
une maison privée, comme dans le cas de Toño, dans un bâtiment abandonné (connus comme
tapia), dans des lieux publics (des parcs) ou des centres de loisirs (notamment des hôtels de
passe). Normalement on n’y vend pas la drogue, en dépit du sens commun qui conçoit les
picaderos comme des lieux de trafic : Ortiz R., Magis C., Ramos M.E., Noriega S., « Vigilancia de
segunda generación de VIH: mapeo y encuestas de comportamiento en usuarios de drogas
inyectables. Reporte del trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México ». [Ce document m’a été
remis par la présidente de l’association, il est inédit.]
48. Des briques faites avec un mélange de terre et de paille, proche du torchis.
49. Les usagers et leur famille utilisent couramment le mot « vice » (vicio) pour se référer à la
drogue (mais non à l’alcool). Les usagers sont appelés les « vicieux » (viciosos) et, quand ils sont
sous les effets de la drogue, c’est qu’ils sont « fous » (andan locos ou están locos). « Devenir fou »
(ponerse loco), c’est l’équivalent de « se shooter ». Ces manières de s’auto-définir reviennent dans
d’autres contextes géographiques et sociaux, par exemple en France : Fernandez F.,
« L’engagement émotionnel durant l’enquête sociologique : retour sur une observation
“anonyme” auprès d’ex-usagers de drogues », Carnets de bord en sciences humaines, n°9, 2005, pp.
78-87.
50. Morris M., Case P., Robertson A., Lozada R., Vera A., Clapp J., Medina-Mora M.E. et Strathdee
S., « Prevalence and correlates of “agua celeste” use among female sex workers who inject drugs
in Ciudad Juarez, Mexico », Drug and alcohol dependence, vol. 117, n°2-3, 2011, p. 219-225.
51. Un quotidien local de faits divers très populaire.
52. Das V., « Témoignages de femmes sur la violence durant la Grande Partition », op. cit., p. 32.
53. Il s’agit d’une expression courante pour parler de l’implication d’une personne dans la
criminalité organisée. On ne l’utilise pas pour les petits délinquants de quartier qu’on nomme
plutôt « malandros », voyous.
54. Valenzuela Arce J. M., ¡A la brava ese! Identidades juveniles en México: cholos, punks y chavos banda,
Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1988.
55. Taussig M., Law in a lawless land: diary of a limpieza in Colombia, Chicago, New Press, 2003.
56. Un tableau expliquant dans le détail les quantités autorisées pour chaque produit peut être
consulté dans Pérez Correa C., « (Des)proporcionalidad y delitos contra la salud en México »,
Cuadernos CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 2012, www.cide.edu.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
51
57. Fassin D, Quand les corps se souviennent. Expériences et politiques du sida en Afrique du Sud, op. cit.,
p. 300.
RÉSUMÉS
Avec un bilan de plus de dix mille victimes, Ciudad Juárez, ville mexicaine à la frontière avec les
États-Unis, a été l’un des théâtres les plus violents de la « guerre contre le narcotrafic » lancée
par l’ex-président mexicain Felipe Calderón pendant son mandat (2006-2012). L’article met en
parallèle la manière dont le gouvernement a problématisé cette escalade d’homicides avec les
expériences et les récits de personnes ayant été victimes de violences de la part des forces de
l’ordre. À partir de matériaux ethnographiques recueillis pendant une enquête de terrain réalisée
entre 2008 et 2011, les pratiques de la violence d’État qui ont accompagné l’opération militaire
sont ici abordées dans leur dimension expérientielle, mais aussi narrative.
With over ten thousand victims, the Mexican city of Ciudad Juárez was one of the most violent
theatres of the war against drug trafficking, which was initiated by the former Mexican
president, Felipe Calderón, during his 2006-2012 mandate. This article draws parallels between,
on the one hand, the manner through which the government problematized the rise in
homicides and, on the other hand, the experiences of some of the victims of violence inflicted by
law enforcement agencies. Drawing from ethnographic material collected between 2008 and
2011, the practices of state violence implemented during the last military operation are
approached here through the experiences and narratives of victims.
INDEX
Mots-clés : ethnographie, violence d’État, guerre contre le narcotrafic, récits, expériences,
Ciudad Juárez, Mexique
Keywords : ethnography, state violence, war on drugs, narratives, experiences, Ciudad Juárez,
Mexico
AUTEUR
CHIARA CALZOLAIO
Chiara Calzolaio est doctorante en anthropologie sociale et ethnologie à l’EHESS. Elle s’intéresse
aux manifestations contemporaines de la violence, notamment aux violences de genre et à celles
liées à la criminalité organisée et à la lutte contre le narcotrafic au Mexique, en conjuguant deux
niveaux d’analyse : celui des expériences corporelles, subjectives et sociales de la violence et celui
de sa problématisation publique et politique. Sur ces questions elle a notamment publié : « “Toi
aussi, tu es venue pour les mortes ?” Figures de l’horreur et de la compassion autour de la
violence à Ciudad Juarez », in Fassin D. et Eideliman J-S. (dir.), Économies morales contemporaines,
Paris, La Découverte, 2012, pp. 95-114 ; « Les féminicides de Ciudad Juárez. Reconnaissance
institutionnelle, enjeux politiques et moraux dans la prise en charge des victimes », Problèmes
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
52
d’Amérique Latine, n°84, 2012, pp. 61-76 ; « Contre la violence. Fabriquer des “bons” citoyens à
Ciudad Juárez (Mexique, XXIe siècle) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, n°43, 2016, pp. 117-138.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
53
La fabrique des indésirablesPratiques de contrôle aux frontières dans un aéroport européen
Producing Undesirables at the Border. Border Control Practices at a European
Airport
Andrew Crosby et Andrea Rea
Les auteurs tiennent particulièrement à remercier les nombreux lecteurs et commentateurs de
cet article, Jo Heyman, Chowra Makaremi, Mark Salter, Karine Côté-Boucher, Federica Infantino,
Françoise Tulkens et Han Entzinger, ainsi que les lecteurs anonymes.
1 L’aéroport n’est ni un « non-lieu 2 » ni un « espace des flux 3 » ; il constitue un espace
social de surveillance et de contrôle des flux de personnes et des biens. Considérantl’aéroport comme un espace où les « amis et ennemis » doivent être séparés 4, ilreprésente aussi le lieu du pouvoir du maintien de l’ordre de l’État souverain.L’aéroport a pour fonction de contrôler et de filtrer toutes les menaces (terrorisme,immigration irrégulière, trafics de produits illicites, contrebande, traite, etc.) quipèsent sur le pays ou l’entité supranationale, tel que l’espace Schengen en Europe. Lapolice des frontières à l’aéroport doit contrôler les intentions réelles des voyageurs ets’assurer de la sécurité du pays. Elle contrôle à la fois les voyageurs qui circulent etceux qui entendent s’établir. De la sorte, elle procède au contrôle de la mobilité et àcelle de l’immigration. Pour atteindre ces objectifs, les garde-frontières disposent deplusieurs instruments de contrôle. Le premier est le contrôle du passeport. Celui-ci estl’instrument le plus ancien. Avec son instauration, l’État dispose du « monopole desmoyens légitimes de circulation 5 ». Salter 6 souligne que le passeport indique le paysd’origine où le voyageur peut être rapatrié, le cas échéant. Si les passeports fournissentles moyens de gouverner la mobilité d’une population, les visas poursuivent le mêmebut. En Europe, la mobilité des ressortissants de pays tiers est surtout régie par ladélivrance de visas de courte ou longue durée 7 aux frontières délocalisées telles que lesconsulats 8, en poursuivant l’objectif du contrôle à distance 9. Néanmoins, le contrôledes visas est répété à l’entrée du point de destination ou de transit, en particulier dansles aéroports. Les visas Schengen sont les principaux instruments de tri des voyageursen Europe. Une première sélection est effectuée par la distinction entre les voyageurssoumis à une obligation de visa et ceux qui n’en ont pas besoin 10. Ceci constitue une
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
54
méthode de gestion des risques aux contrôles aux frontières. La définition des payssoumis à l’obligation d’obtenir un visa Schengen C comme condition pour entrer sur leterritoire est une manière de créer des pays à risque dont le motif de la mobilité desressortissants est considéré potentiellement suspect et soumis à vérification 11. Lerisque encouru relève de la crainte que sous la mobilité de courte durée ne se cache unevolonté de migration irrégulière.
2 Les activités principales aux frontières, en particulier à l’aéroport, sont dès lors le
triage, la catégorisation et le profilage 12. Avec l’augmentation du nombre de voyageursdans les aéroports, tous ne peuvent pas être contrôlés rigoureusement, ils sont doncclassés au sein de catégories qui nécessitent ou non des mesures supplémentaires 13.L’amélioration du triage dépend de l’utilisation d’outils efficaces de surveillance, et toutparticulièrement des technologies biométriques (empreintes digitales ou rétiniennes,etc.) et des bases de données 14, qui sont utilisées pour contrôler tous les voyageurs bienqu’un profilage tende à se focaliser sur une minorité d’entre eux considérés comme unemenace pour la sécurité. Selon Lyon, l’aéroport constitue un « filtre de données 15 » oùcirculent à la fois les individus physiques et leur doublon numérique (data double) 16 quisont les identités virtuelles situées dans les bases de données mises en réseau 17. Al’aéroport, l’identité des voyageurs est aussi condensée dans des bases de données sedéplaçant séparément du corps physique via des circuits informatisés. Ce processuscrée la frontière dite intelligente. L’identification s’opère en recourantsystématiquement au doublon numérique.
3 Toutefois, le contrôle des frontières repose avant tout sur les pratiques professionnelles
des agents de la police des frontières. Cet article s’inscrit dans l’agenda de recherchequi consiste à appréhender les frontières comme une série de pratiques 18 en portantune attention centrale aux acteurs, à leurs pratiques, à leurs représentations et à leurorganisation. La frontière est performée par les pratiques de frontières 19 et son analysesuppose un examen minutieux des pratiques quotidiennes des multiples acteursimpliqués dans sa sécurisation 20. Basé sur une recherche empirique réalisée dans unaéroport européen, cet article analyse les pratiques de contrôle des garde-frontières àpartir de deux traditions théoriques complémentaires bien que peu souvent associées.Les pratiques de contrôle aux frontières des acteurs sont étudiées selon une approcheen termes de « street-level bureaucrats 21 » donnant une grande importance à l’étude del’usage du pouvoir discrétionnaire des acteurs professionnels et de l’organisation dutravail. À cette perspective s’en ajoute une autre, plus interactionniste, moinsfréquente dans les études sur les frontières, qui restitue toute l’importance dessignifications des pratiques dans les interactions et des conséquences de celles-ci sur laconstruction des identités.
4 Afin de comprendre les pratiques de contrôle aux frontières où les voyageurs sont triés
selon différentes catégories, chacune avec des devoirs et droits différents, il fautconsidérer la frontière autrement que comme une enveloppe contenant un territoire 22.Nous proposons la conception de frontière-réseau 23 afin d’analyser les pratiques desacteurs mais aussi de l’incidence de l’usage des frontières intelligentes. La frontière-réseau est composée d’une chaîne d’interactions s’opérant dans des espaces sociaux(aéroports, ports maritimes, frontières extérieures, rues, places, etc.) dans lesquels deshumains (garde-frontières, officiers de police, agents des consulats, personnel descompagnies de transport, voyageurs, etc.) et des non-humains (lois, procédures, basesde données, etc.) 24 interagissent, conduisant à l’activation de pratiques de contrôle
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
55
exercées au nom de la souveraineté étatique. Elle est condensée dans des pratiques desurveillance et de contrôle à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national lorsd’interactions entre acteurs et/ou lors d’interactions entre acteurs et actants,interactions qui activent et constituent la frontière.
5 Suivant Bigo et al. 25, la frontière-réseau vise, d’une part, à accélérer la circulation des
voyageurs disposant des moyens légitimes de mobilité 26, les voyageurs désirables, etd’autre part, à filtrer et/ou bloquer les personnes essayant de contourner les lois demobilité et d’immigration, ceux ne disposant pas des moyens légitimes de mobilité,acquérant dès lors l’identité de voyageurs indésirables. Pour les voyageurs, lesaéroports sont ainsi des lieux soit d’accélération de leur mobilité, notamment grâce auxsystèmes sécuritaires de voies rapides, soit de filtrage et/ou de blocage résultant despratiques de contrôle du passage de la frontière. Les acteurs chargés du contrôle de lafrontière « doivent agir en établissant le “risque migratoire” de chaque individuvoulant traverser la frontière 27 ». Les pratiques de frontières visent d’abord à fluidifierla circulation des voyageurs désirables, tout en consacrant un temps important àl’action de filtrage en vue d’arrêter les voyageurs indésirables. Ces actions sont aussieffectuées par les agents des compagnies de transport 28 et par les agents de liaison quiopèrent dans les pays de départ 29, autres acteurs de la frontière-réseau.
Enquête dans un aéroport européen
6 Nous avons effectué un travail de terrain ethnographique dans plusieurs aéroports
dont celui analysé dans cette contribution. Ce travail a été possible grâce àl’intervention du commanditaire auprès des ministères de l’Intérieur de plusieurspays 30. Le terrain présenté dans cet article a eu lieu en mars 2012 dans un des plusimportants aéroports européens. En 2012, près de 61 millions de passagers ont voyagévers, en provenance ou via cet aéroport. Parmi ces passagers plus de la moitiéproviennent d’un pays hors espace Schengen.
7 Pendant le travail de terrain, nous avons effectué, avec l’aide d’une équipe composée de
cinq doctorants 31, des observations directes des contrôles de première et deuxièmelignes dans trois terminaux différents, qui sont les trois plus grands en termesd’arrivées intercontinentales, entre 5 heures et 17 heures. Toutefois, l’activité la plusimportante a lieu entre 5h et 8h du matin, période durant laquelle arrivent denombreux longs courriers d’Amérique du nord, d’Afrique et d’Asie.
8 Nous avons également pu observer les contrôles aux portes d’embarquement, visiter le
centre de détention attenant à l’aéroport, interviewer la brigade mobile de recherchequi détecte, suit et démantèle les réseaux de traite d’êtres humains. La question derecherche du commanditaire portait sur le traitement des ressortissants des États tierslors de leur contrôle à la frontière. Outre des observations, nous avons conduit cinqentretiens semi-structurés et quarante-cinq entretiens structurés avec des garde-frontières sur la manière dont ils réalisent leurs contrôles. Nous avons également menévingt-cinq entretiens semi-structurés et soixante-quatre entretiens structurés avec desvoyageurs provenant des pays tiers. La grande majorité des voyageurs interviewés ontété interrogés par des garde-frontières et soumis au contrôle de deuxième ligne.
9 Cet article ne traite pas des questions relatives à la détention, à l’asile, à la traite des
personnes ou à la fraude documentaire. Il se concentre sur le travail des garde-frontières et leurs interactions avec les voyageurs. L’objet principal de cette analyse
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
56
consiste donc en l’examen des pratiques quotidiennes de contrôle des frontières dansun aéroport et propose une anthropologie du pouvoir des contrôles aux frontières quin’exclut pas l’usage de la violence symbolique et du pouvoir étatique discrétionnaire.Cette analyse porte exclusivement sur des voyageurs provenant des pays tiers soumisou non à un visa Schengen.
Pratiques de surveillance quotidienne
10 Les garde-frontières placés dans les terminaux de l’aéroport effectuent les contrôles de
première ligne dans des aubettes et ceux de deuxième ligne dans les bureaux de lapolice des frontières. Les garde-frontières de première ligne effectuent un contrôlerapide. Ils laissent soit entrer les voyageurs sur le territoire ou dans l’espace de transit,soit décident de procéder à un contrôle approfondi en deuxième ligne. Ils ne prennentaucune décision autre que celle de déterminer si un deuxième contrôle est nécessaireou non. En deuxième ligne, le voyageur est soumis à diverses vérifications. L’officier degarde prend la décision de laisser le voyageur entrer sur le territoire ou continuer sontransit. Il vérifie s’il ne remplit pas les conditions d’entrée et l’oriente vers le centre dedétention le cas échéant. Pendant le contrôle, il peut demander des conseils à unofficier supérieur en charge du terminal. Les voyageurs qui ne sont pas admis sur leterritoire sont transférés en dehors des terminaux de l’aéroport, vers un centre dedétention. C’est à cet endroit que la décision finale est prise par une autre section de lapolice des frontières. Cette section examine les décisions prises par l’officier de gardesur la base des éléments ayant été fournis pendant le contrôle de deuxième ligne. Ellepeut aussi prendre en compte de nouveaux éléments fournis par le voyageur non-admiset annuler la décision de l’officier de garde.
11 Dans le hall où les contrôles de premières lignes sont effectués, les aubettes sont
différenciées selon la nationalité du voyageur : d’une part, les citoyens européens etd’autre part, les ressortissants des pays tiers. Les citoyens européens peuvent choisirentre se présenter eux-mêmes devant un poste où un garde-frontière contrôle leurpasseport ou ils peuvent passer par un portail automatique qui vise à accélérer lecontrôle à la frontière. Divers aéroports européens ont mis en place ce dispositif deportique automatique basé sur des identifications numériques ou biométriques.Moyennant la transmission volontaires d’informations (passeport biométrique,empreintes digitales, empreinte de l’iris, etc.) et de l’enregistrement préalable auxservices de la police des frontières, des voyageurs considérés comme disposant desmoyens légitimes de mobilité ont accès à des dispositifs d’accélération du passage de lafrontière. Ces voyageurs acceptent d’être soumis à des technologies de surveillanceavant l’embarquement, car un régime d’exception est en vigueur à l’aéroport 32. Cetteauto-soumission à des pratiques de surveillance, supposant une renonciation à laconfidentialité, fonctionne selon l’adage de « qui n’a rien à cacher, n’a rien à craindre ».Ce dispositif d’accélération du passage de la frontière fondé sur une auto-soumissionfonctionne tel un gouvernement automatique 33.
12 Les procédures sont différentes pour les ressortissants des pays tiers. Les contrôles de
première ligne impliquent l’examen des conditions d’entrée prévues dans l’article 5 duCode Frontières Schengen. Cela signifie consulter le passeport en scannant le codechiffré, les bases de données (le Système d’Informations Schengen 34), vérifier les visas,si nécessaire, le but du voyage et les moyens de subsistance. Si le garde-frontière est
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
57
satisfait de la vérification, le voyageur peut entrer sur le territoire ou dans la zone detransit de l’espace Schengen. Dans l’un des terminaux, les passagers sontprincipalement nord-américains. Ils s’avancent vers le poste le passeport dans la main.Le garde-frontières vérifie la photographie et regarde la personne. Si la personne porteun chapeau, il lui est demandé de le retirer. Les garde-frontières demandent parfois ladestination finale des voyageurs tout en parcourant leur passeport. Après cela, lapersonne peut s’en aller. Les questions sur les moyens de subsistance sont rares. Parfoisl’argent est compté en première ligne. Dans un autre terminal, plusieurs passagerschinois passent sans qu’on leur pose aucune question. Faisant partie d’un voyage engroupe, l’organisateur du voyage est seul à être interrogé par les garde-frontières dansun autre poste. En règle générale, les garde-frontières ne posent pas souvent desquestions aux voyageurs. De temps à autre, ils posent quelques questions sur le lieu dedestination, le ticket de retour ou la réservation d’un hôtel.
13 Si le garde-frontières a quelques doutes ou suspicions après la première vérification, il
peut demander au voyageur de le suivre vers le contrôle de deuxième ligne pour unevérification approfondie. Ceci se produit surtout lorsque des pièces justificatives duvisa sont manquantes ou si un doute apparaît quant aux motifs du voyage. Lesvoyageurs qui ont besoin de subir des vérifications plus approfondies sont amenés aubureau de police se trouvant juste à côté du contrôle de première ligne (voir plan).
14 Afin de mieux comprendre les pratiques de contrôle, nous utilisons la séquence du
contrôle de deuxième ligne de l’un des terminaux illustré dans le plan. Les bureaux decontrôle de deuxième ligne sont situés juste à côté du hall de la première ligne. Avantde décrire les pratiques de contrôle, examinons les conditions de travail des garde-frontières. Le local attribué aux garde-frontières de la deuxième ligne de contrôle estassez vétuste, surtout s’il est comparé aux espaces commerciaux luxueux de l’aéroport.Le mur séparant le hall du contrôle de première ligne et celui de deuxième ligne estformé de fenêtres qui sont toujours occultées par des stores. Par conséquent, les salles àdroite sur le schéma sont toujours illuminées artificiellement. L’unique salle avec unefenêtre est celle de la salle de repos qui contient également un distributeurautomatique vendant des boissons gazeuses et du café. Une quinzaine de garde-frontières travaillent dans ces bureaux. Au cours de l’enquête, la température étaitassez élevée et l’air conditionné ne fonctionnait pas correctement. L’atmosphère étaitlourde. Les salles sont vieilles, tout comme les meubles et les bureaux. Les chaises nesont pas confortables. Les murs sont couverts de feuilles de papier sur lesquelles sontimprimés les lois, règlements et procédures, et en particulier les conditions financièresauxquelles les voyageurs sont soumis en fonction de leur destination en Europe. Il y atrès peu d’ordinateurs, quatre au total, utilisés pour les recherches, les rapportsd’admission ou de non-admission. Cela conduit à la constitution d’une file d’attente desgarde-frontières devant utiliser l’un des ordinateurs et entraîne une grande perte detemps dans l’exécution des tâches. Dans le local de l’officier de garde se trouve unordinateur avec accès au Système d’information sur les visas (VIS) 35 qui n’a pasfonctionné pendant deux jours. Un autre ordinateur donne accès au système de lapolice nationale qui contient des listes des personnes poursuivies pour différentesinfractions (terrorisme, vol, falsification, etc.). La détérioration des bureaux est encoreplus frappante dans la salle de détention, sale et parfois surpeuplée. Enfin, le symbolereprésentant le mieux la précarité des conditions de travail des garde-frontières estl’unique toilette pour hommes et femmes, qui n’est accessible que via une clé qu’il fautdemander à un agent de police au deuxième étage. Les gardes-frontières soulignent
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
58
souvent eux-mêmes la précarité de leurs conditions de travail. C’est d’autant plusfrappant si l’on compare ces « coulisses » négligées à la scène principale où lesvoyageurs circulent dans des boutiques de luxe occupant un large espace.
15 Chaque fois qu’un voyageur est amené en deuxième ligne, il est conduit dans la salle
d’attente (1). Il est interrogé par un officier de garde (2) qui vérifie les documents devoyage (passeport, visa, les conditions d’entrées sur le territoire ou dans la zone detransit). Les voyageurs en transit qui entrent dans l’espace Schengen sont soumis auxmêmes contrôles, même s’ils seront contrôlés à leur destination finale si elle est endehors de l’espace Schengen. En théorie, l’interrogatoire sur les motifs du voyage estmené par un officier de garde. En pratique, il commence toujours par le garde-frontières de la première ligne. Un officier supérieur est présent pour répondre auxquestions des assistants. Néanmoins, pendant l’enquête nous avons noté que l’officiersupérieur intervient rarement et uniquement lorsque les assistants de l’officier de jourlui posent des questions. Il n’intervient jamais dans le travail et dans les décisions del’officier de garde. Si le voyageur ne parle pas la langue des garde-frontières, l’officierde garde fait appel à un interprète qui est toujours un opérateur privé externe. Cecipeut durer un certain temps. Il demande à ses assistants de vérifier les conditionsd’entrée (3). Ces derniers consultent les bases de données, notamment le SIS et le VIS,et EURODAC 36. Ils effectuent des appels téléphoniques afin de vérifier les documents devoyage (réservation d’hôtel, assurance, personne chargée de l’accueil, etc.). Pendant lesvérifications, le voyageur attend sur un des bancs de la salle d’attente (4). Lorsque lesvérifications sont terminées, l’officier de garde et ses assistants se consultent. Si lesrésultats sont concluants, l’officier de garde autorise l’entrée sur le territoire et lesassistants écrivent un rapport qui doit être signé par le voyageur. Si les résultats nesont pas concluants, l’officier de garde interroge de nouveau le voyageur (5). À la fin decette audience, le voyageur est autorisé à entrer ou non sur le territoire. S’il n’est pasautorisé, un rapport de non-admission est rédigé et doit être signé par le voyageur. Uninterprète est appelé pour que le voyageur puisse comprendre le contenu du rapport denon-admission qu’il doit signer. Ensuite, il est amené dans la salle des fouilles (6). Tousles objets de valeur lui sont retirés (portefeuille, argent, bijoux, téléphone, etc.) etstockés dans la salle des coffres (7). Ensuite, il est placé dans la salle de détention (8)jusqu’à ce qu’il soit transféré vers le centre de détention. Parfois les voyageurs non-admis passent plusieurs heures dans la salle de détention avant d’être transférés dansle centre de détention. La salle de détention est peuplée des voyageurs non-admis quiviennent du contrôle de deuxième ligne et de ceux provenant du centre de détention etqui vont être rapatriés dans la journée. Les voyageurs ont le droit à un jour francdurant lequel ils ne peuvent pas être rapatriés. Leur détention est examinée par un jugeaprès quatre jours et ne peut être prolongée par ce dernier que de vingt jours, après cedélai les voyageurs non-admis doivent être libérés.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
59
Plan des bureaux de contrôle de la seconde ligne
16 La majorité des contrôles à la frontière examinent la conformité des conditions
d’entrée des voyageurs en possession d’un visa Schengen, qui autorise son titulaire àvoyager librement dans les vingt-six pays de l’espace Schengen pour une duréemaximum de quatre-vingt-dix jours sur une période de six mois. Le visa est délivré parle Consulat dans le pays d’origine du voyageur à des fins de tourisme, business, missionscientifique, voyage artistique, visite familiale, etc. Pour obtenir un visa Schengen auConsulat, les ressortissants des pays tiers doivent remplir cinq conditions qui sont parailleurs les conditions d’entrée sur le territoire Schengen. Ils doivent être en possessiond’un billet de retour, d’une assurance d’assistance ou de rapatriement, de moyens desubsistance suffisants pour leur voyage (65 € par jour), d’une réservation d’hôtel, d’uncontrat de location ou d’une attestation de logement de la personne qui assure l’accueilet d’une justification de voyage (une lettre d’invitation dans le cas d’un voyaged’affaires ou d’une conférence). Le voyageur doit également enregistrer ses empreintesdigitales qui sont stockées dans le VIS, consulté par toute personne impliquée dans lecontrôle aux frontières. Le Code frontières Schengen exige en outre que tout voyageursoit en possession de ces pièces justificatives aux points d’entrée de l’espace Schengen,comme l’aéroport. La possession d’un visa Schengen constitue une condition nécessairemais pas suffisante pour entrer dans l’espace Schengen. Les garde-frontières disposentd’un pouvoir discrétionnaire attribué par le Code frontières Schengen leur autorisant àrefuser l’entrée sur le territoire à un voyageur muni d’un visa Schengen s’ils estimentqu’une des conditions d’accès au territoire n’est pas remplie.
17 Avant d’analyser les pratiques de contrôle, présentons quelques situations
emblématiques et exemplatives de celles que nous avons enregistrées le plus souvent,et ce dans les différents terminaux étudiés. La typologie des situations se construit trèsrapidement au cours d’une seule journée d’observation. Vers cinq heures et demi du
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
60
matin, un groupe de dix Irakiens arrive au contrôle de deuxième ligne. Ils viennentd’Irak et vont à Bruxelles pour une conférence sur la situation dans leur pays. Aucund’entre eux ne parle la langue des garde-frontières, mais ils sont accompagnés d’unorganisateur parlant anglais. Bien que se rendant à Bruxelles, ces personnes sontcontrôlées dans cet aéroport, leur première entrée dans l’espace Schengen. Le garde-frontières a des doutes sur le motif du voyage. Ils sont tous en possession d’un visaSchengen ainsi que de leurs pièces justificatives. Ils ont une lettre d’invitation pour laconférence. Cependant, la lettre est écrite en arabe et aucun des garde-frontières nepeut la lire. L’officier de garde demande à l’un de ses assistants de vérifier leurhébergement en téléphonant à l’hôtel où ils seront logés et à l’un des organisateurs dela conférence pour vérifier le motif du voyage. Ils appellent un interprète, mais il esttrop tôt pour en trouver un. Trois heures plus tard, l’un des assistants arrive à joindrel’un des organisateurs de la conférence à Bruxelles qui lui confirme que les personnescontrôlées sont invitées. Suite à cet appel les personnes sont admises sur le territoire.
18 Une femme angolaise, en transit vers Lisbonne où vit sa sœur à qui elle va rendre visite
pour une durée de quinze jours, a été emmenée au contrôle de deuxième ligne parcequ’elle ne dispose pas du montant nécessaire en espèces (65 € x 15 jours = 975 €) pourentrer dans l’espace Schengen. Néanmoins, elle dispose d’une carte de crédit, autoriséepar le Code frontières Schengen. L’assistant de l’officier de garde téléphone à sa sœur àLisbonne afin de vérifier le motif de son voyage. Bien que la sœur soit prête à envoyerde l’argent et que la voyageuse dise qu’elle peut retirer de l’argent avec sa carte decrédit, l’officier de garde estime qu’il est en droit de lui refuser l’accès à l’espace detransit pour se rendre au Portugal. Le pouvoir discrétionnaire que lui confère le Codefrontières Schengen l’autorise à prendre cette décision.
19 Un homme d’affaires du Mali possédant un visa Schengen de neuf jours est emmené au
contrôle de deuxième ligne pour deux motifs souvent énoncés par les garde-frontièresde première ligne. Ces derniers ont des doutes quant aux motifs de son voyage. Il vientdans ce pays européen pour la première fois pour y développer des relationscommerciales. Ensuite, il a payé trois nuits d’hôtel seulement. Les assistants de l’officierde garde vérifient la réservation de l’hôtel et le paiement des trois nuits. Même s’ilpossède 595 € en espèces, l’officier de garde lui refuse l’entrée sur le territoire parceque selon lui il aurait dû payer l’hôtel pour toute la durée de son séjour. Le voyageur ditque ce n’est pas nécessaire selon le Consulat ayant délivré le visa. Également, le Codefrontières Schengen ne formule pas cette exigence. Le voyageur répond qu’il souhaiteaussi se donner la possibilité de trouver un autre hôtel si celui qu’il a réservé ne luiconvient pas. Lors de la deuxième audience avec le voyageur, l’officier de garde lequestionne vigoureusement sur les motifs de son voyage (voir infra).
20 L’analyse des données suggère que le contrôle de première ligne fonctionne selon un
mode aléatoire sur un public sélectionné spécifiquement, telles compagnies aériennesen provenance de tel pays. En effet, en raison des flux des voyageurs, il est impossiblelors du contrôle de première ligne de vérifier chaque personne appartenant à ce qui estdéfini comme un groupe à risque (pays d’origine, nationalité, profil migratoirespécifique, compagnies aériennes, etc.). Si les garde-frontières énoncent l’agitation oul’anxiété apparente des voyageurs comme source principale de leur attention etcontrôle, le choix d’interroger en première ligne de façon plus approfondie unvoyageur plutôt qu’un autre repose sur un travail antérieur et sur l’expérience desgarde-frontières. Par exemple, les passagers voyageant en groupe avec un tour
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
61
opérateur sont moins sujets à des contrôles individuels. Comme nous avons pu leconstater dans le cas d’un groupe de voyageurs chinois, le garde-frontières sait que lesagences de voyage fonctionnent elles-mêmes comme une police des voyageurs. Unvoyageur ayant déjà des tampons d’entrée et de sortie dans son passeport n’est pascatégorisé comme essayant d’immigrer, puisqu’il a déjà reçu différents visas en ayanttoujours respecté les entrées et sorties. Inversement, un voyageur soumis au visa quientre pour la première fois dans le pays éveille plus l’attention des garde-frontières. Ilexiste un facteur de risque et les garde-frontières sont plus enclins à penser que cettepersonne pourrait essayer de contourner les lois d’immigration. Cette tendance estrenforcée lorsque les autorités consulaires ont délivré un visa d’une très courtepériode, moins de trois mois par exemple. Cette approche crée d’énormes différencesentre les ressortissants des pays tiers qui sont soumis à des contrôles plus approfondis.Ces éléments constituent des critères à la base de la catégorisation et du profilage desvoyageurs ressortissants des pays tiers. Les résultats dans les bases de données peuventaussi éveiller des suspicions, mais il arrive très rarement qu’une personne soit bloquéepour cette raison en première ligne. Enfin, les expériences individuelles et collectivesdes interrogatoires sur les motifs de voyages mènent à l’inventaire d’un ensemble derécits considérés comme plus crédibles que d’autres. Les réponses des garde-frontièresreposent ainsi sur un typification des récits. Ceux éveillant des suspicions conduisent àun examen approfondi en deuxième ligne.
21 En 2010 et 2011, il y a eu respectivement 7 499 et 6 777 non-admissions dans l’aéroport
étudié. En 2010, 40 % des personnes non-admises ont été rapatriées. Cela signifie quevraisemblablement 60 % des non-admissions étaient soit non-fondées soit que ladétention n’était pas requise. Au cours de sept jours de terrain, 124 ressortissants depays tiers ont été non-admis, pratiquement le même nombre que la moyennehebdomadaire en 2011 à savoir 130. Sur les 64 ressortissants des pays tiers ayantrépondu aux entretiens structurés, 57 étaient non-admissibles. Les 7 restants ont étéadmis. La majorité des données collectées nous mène à l’hypothèse que le renvoi aucontrôle de deuxième ligne conduit essentiellement à la non-admission ; et que lecontrôle de deuxième ligne, en raison de procédures internes, de l’organisation dutravail et de l’utilisation du pouvoir discrétionnaire, fonctionne comme un ensemble depratiques construisant des voyageurs inadmissibles, des voyageurs indésirables. Pourdémontrer cette hypothèse, nous devons tout d’abord analyser les usages du pouvoirdiscrétionnaire de la part des garde-frontières.
Les usages du pouvoir discrétionnaire et de laresponsabilité (accountability)
22 Le pouvoir discrétionnaire, qu’il soit individuel ou organisationnel, est la pierre
angulaire pour comprendre le processus de contrôle aux frontières à l’aéroport.Suivant Lipsky, la discrétion est le pouvoir d’interpréter la règle générale et/ou dedécider ou non de l’application ou de l’interprétation de la règle, pouvoir dontdisposent des agents bureaucratiques comme les garde-frontières. Par ailleurs, dansl’aéroport, l’utilisation individuelle du pouvoir discrétionnaire implique toujours uneinteraction de face à face. Ainsi, la décision d’agir ou non sur un voyageur au contrôlede première ligne et, en deuxième ligne, après avoir vérifié les conditions d’entrée surle territoire du ressortissant d’un pays tiers, la décision finale qui se traduit par
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
62
l’admissibilité ou la non-admissibilité d’entrée, sont toutes les deux l’expression dupouvoir discrétionnaire individuel. Quant au pouvoir discrétionnaire organisationnel, ilappartient à l’institution, au nom de l’organisation elle-même et définit des règlesbureaucratiques et des procédures qui doivent être suivies par les agents. Les règlesbureaucratiques et la division du travail sont mobilisées pour éviter la confrontationavec les voyageurs.
23 Le cas suivant illustre cette situation. Un ressortissant d’un pays tiers étant en
possession d’un visa Schengen délivré par le Portugal et entrant pour la première foisdans l’UE est retenu, alors même qu’il a une réservation dans un hôtel, parce qu’il ne l’apas payée entièrement et qu’il n’est pas en possession d’assez d’argent en liquide. Ceressortissant d’un pays tiers est étonné, parce que, comme il nous l’explique :
« Nous sommes au XXIe siècle. Avec un simple coup de téléphone, je peux obtenir
1 000 euros avec ma carte Western Union. Cet hôtel dont vous parlez, je peux tout lepayer ! Je peux tout le payer en espèces et continuer avec ma carte. Je ne pense pasque ça soit un problème !« – Est-ce que vous avez expliqué cela au garde-frontière ? « J’ai essayé de l’expliquer, mais il m’a dit que la procédure ne le concernait pas. Ilm’a donné cela [l’avis de non-admission] […] et ils vont m’emmener je ne sais pas où [=le centre de détention] où une autre agence de sécurité… tu as 24 heures pour le faire[…] tu peux expliquer et trouver une solution ».
24 Cette citation illustre bien comment la division du travail fonctionne comme un outil
permettant d’éviter les confrontations avec le voyageur en le renvoyant vers uneinstance bureaucratique ultérieure. Avec ce système qui consiste à renvoyer à l’étapesuivante de la procédure, tout se passe comme si la prise de décision, et au premier chefl’usage du pouvoir discrétionnaire, était dissoute en vue de réduire la confrontation duvoyageur avec un agent supposé avoir pris une décision. Lorsqu’il arrive dans le centrede détention, une autre section de la police des frontières examine le rapport de non-admission du voyageur. Cependant, les agents de cette section reconnaissent qu’ilsreviennent rarement sur la décision prise lors du contrôle de deuxième ligne. Même siune situation peut être résolue facilement, le voyageur doit passer par toute laprocédure administrative : soit être arrêté et chaque jour suivant le jour franc, êtreconduit à l’aéroport où on tentera de l’expulser du territoire ; soit, après quatre joursde détention et de tentatives d’expulsion, comparaître devant un juge. Ainsi, laprocédure pour rectifier la situation d’une personne, une fois qu’elle a été refusée àl’entrée, se révèle être elle-même très lourde et bureaucratique, entrainant une grandeperte de temps et favorisant une grande part de la frustration et de la fatigue physiquechez les voyageurs non-admis, comme l’a observé Makaremi 37 pour la France.
25 Ceci soulève la question de la responsabilité, entendu au sens de l’« accountability »,
c’est-à-dire de la responsabilité comme remise de compte. En réalité, il existe unerelation intrinsèque entre le pouvoir discrétionnaire et la responsabilité ou l’absencemanifeste de celle-ci. Comme Lipsky 38 le note, « les règles bureaucratiques produisentune apparence de responsabilité sans contraindre trop le comportement ». Cetteapparence de responsabilité est double. Dans les interactions directes, elle fonctionne« comme une défense contre le pouvoir discrétionnaire » permettant aux agentsindividuels de se protéger eux-mêmes contre les pressions des clients en niant qu’ilspossèdent un quelconque pouvoir discrétionnaire. Selon Lipsky, « ces affirmationsdoivent être considérées comme des stratégies pour détourner les demandes desclients 39 ». Dans les interactions indirectes avec un public plus large, l’organisation
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
63
peut se protéger elle-même de la critique puisque ses efforts « ont une valeursymbolique qui fournissent aux publics concernés l’assurance que les employés sontresponsables, même quand ils ne le sont pas. Ceci rend très difficile pour les individusde contester le preneur de décision dont les agents disent qu’il revêt toutes lescompétences, en dépit des apparences et des expériences personnels des clients 40 » (lesvoyageurs dans notre cas).
26 Si, en apparence, la division du travail semble produire un discours de
déresponsabilisation à l’encontre des non-admis, en réalité elle produit des décisions nepouvant être que très difficilement contestées. Par conséquent, la personne non-admiseest de facto dépouillée de ses droits à contester, à faire appel. Elle n’est plus un sujetporteur de droits. De même, afin de limiter les résistances et les plaintes de voyageursnon-admis, les garde-frontières utilisent des euphémismes dans certaines de leursinterventions. Ainsi, ils qualifient la salle de détention de la zone de deuxième ligne de« salle d’attente » (voir plan) et, surtout, ils dénomment le centre de détention« l’hôtel » lorsqu’ils annoncent aux voyageurs non-admis qu’ils vont être transportésdans un autre lieu. Il arrive fréquemment que les voyageurs non-admis pensentréellement qu’ils sont envoyés dans un hôtel, d’autant plus que l’officier de garde leurdit que là-bas, ils seront en mesure de résoudre leur problème d’accès au territoireparce qu’ils auront plus de temps pour communiquer avec le personnel d’une autresection de la police des frontières.
27 Ceci aide à comprendre comment, indépendamment de l’officier de garde présent ou du
terminal fréquenté, tous les voyageurs arrivant dans cet aéroport qui ne possèdent pasles moyens de subsistance en espèces ou qui n’ont pas réservé et payé toutes leurs nuitsà l’hôtel, et ce même si leur séjour est court, se voient systématiquement refuserl’entrée sur le territoire. Bien que ceci ne figure pas dans le Code frontières Schengen,cette régularité des motifs de refus d’entrer montre que derrière le pouvoirdiscrétionnaire individuel des garde-frontières, se trouve une règle bureaucratique 41
qui doit être comprise comme le pouvoir discrétionnaire organisationnel. Quand unvoyageur refusé à l’entrée possède d’autres moyens que de l’argent en liquide, commedes cartes de crédit, le garde-frontière ne les prend pas en considération.
« [Le garde-frontière] dit qu’il manque un certain montant, ce montant s’élève à 900euros. Je lui ai dit que j’ai de l’argent parce que je l’ai envoyé via Western Union. J’aiun peu plus de 2 000 euros, plus 400 euros que j’ai dans ma poche. C’est-à-direpresque plus de 3 000 euros et il n’est pas satisfait avec cela. Le document deWestern Union ne signifiait absolument rien pour lui. Il a seulement regardé les 400euros que j’avais dans ma poche ».
28 Le Code frontières Schengen énonce que les voyageurs peuvent disposer des moyens de
subsistance en espèces, chèques de voyages et cartes de paiement internationales. Demême, il n’indique pas que le paiement de l’hôtel doit être intégralement versé. Sur cespoints, seul le juge intervenant après un maximum de 4 jours de détention pourradéfaire la base de la justification de la non-admissibilité du voyageur. Le pouvoirdiscrétionnaire organisationnel s’apparente alors à un processus décisionnel sans sujet,interdisant de la sorte les voyageurs à se confronter aux garde-frontières.
29 Tous les voyageurs non-admis ne relèvent bien évidemment pas que de ce cas de figure.
Les observations analysées ici concernent principalement l’entrée sur le territoire devoyageurs des pays tiers soumis ou non à la possession d’un visa Schengen. Enconstatant que seuls 40 % des voyageurs non-admis en 2010 ont été rapatriés, onpourrait penser que le système est inefficace ou qu’il existe de nombreux ratés dans la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
64
procédure de contrôle des frontières. Sans doute faut-il donner plus d’importance auxstatistiques présentant des non-admissions en début de procédure plutôt qu’à la fin.Pour comprendre le niveau élevé de non-admis qui sont finalement admis après untemps passé en centre de détention, il convient d’interpréter d’une autre manière lecontrôle aux frontières. La valeur symbolique des statistiques générales sur les non-admissions donne l’impression que les frontières sont sécurisées et que les garde-frontières font leur métier. Par ailleurs, si la majorité des cas se révèle êtreincorrectement non-admise, l’absence manifeste ou les faibles fréquences deprotestation démontre bien comment ces pratiques de contrôle aux frontièresneutralisent les ressortissants des pays tiers.
30 En adoptant la perspective de Howard Becker 42 relative aux pratiques déviantes et qui
voit dans celles-ci avant tout le résultat de la réaction sociale, nous pouvons dire queles pratiques, et en particulier celles issues ici de l’usage du pouvoir discrétionnaireorganisationnel, produisent l’irrégularisation de la mobilité de voyageurs. Ce sont lespratiques de contrôle des frontières (refus d’accepter la carte de crédit, le paiementpartiel de l’hébergement ou de croire à la légitimité du motif de voyage) quitransforment les voyageurs en indésirables parce qu’étiquetés de potentiels « migrantsirréguliers ».
31 La gestion des apparences est très importante dans les contrôles aux frontières. Elles
communiquent à un public plus large que les frontières sont sécurisées. Selon PeterAndreas 43, les agences de contrôle des frontières jouent un rôle politique et symboliqueen transmettant une impression convaincante que la morale et les autres standardssont en cours de réalisation. Puisque cette performance est dirigée vers un public, ellecorrespond bien au mécanisme mentionné ci-dessus du pouvoir discrétionnaireorganisationnel détournant la critique publique décrite par Lipsky.
La construction de passagers inadmissibles
32 Lorsque les voyageurs sont emmenés au contrôle de deuxième ligne, leurs identités ont
tendance à changer. Ils deviennent des suspects. Comme Salter le mentionne, « unvoyageur est l’auteur de sa propre identité, mais pas l’arbitre final de son appartenanceou de sa mobilité 44 ». Suivant les analyses de Goffman 45 sur la stigmatisation, enpassant en deuxième ligne, ces voyageurs deviennent des personnes discréditablesparce qu’elles portent des caractéristiques qui peuvent conduire à leur stigmatisation.Leur identité peut changer de voyageur légitime à celle de voyageur illégitime ;potentiellement un immigré en situation irrégulière. L’élimination du discréditpotentiel dépend de la vérification des doutes concernant le motif de voyage et desconditions matérielles à l’entrée lors du premier face à face avec le garde-frontières.Pendant la première phase de l’examen en deuxième ligne, le garde-frontières depremière ligne, l’officier de garde ou un de ses assistants examine les questions qu’il sepose au sujet des conditions d’entrée. Un de ces gardes-frontières vérifie, par exemple,la réservation de l’hôtel et son paiement, la participation effective à une conférence,l’existence de la personne qui va accueillir le voyageur, etc. Si le doute concerneprincipalement le motif du voyage, le contrôle approfondi est souvent mené parl’officier de garde. Pendant cette phase, le contrôle est réalisé en tenant compte desdroits du voyageur. Cependant, si après avoir entendu le voyageur une dernière fois,l’examen des conditions d’entrée et du motif de voyage mène l’officier de garde à
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
65
établir un rapport de non-admission, l’identité du voyageur se transforme de personne« discréditable » à personne « discréditée ». Le voyageur est alors étiqueté commevoyageur illégitime, à savoir potentiellement un immigré en situation irrégulière. Sonidentité change ; il porte alors le statut juridique de personne non-admissible et lestatut sociologique d’indésirable, une identité sociale de voyageur non respectable qui apour conséquence dans la pratique une transformation de ses droits en privilègesoctroyés ou non selon le bon vouloir de la police des frontières.
33 La performance bureaucratique de la police des frontières et sa production de
passagers non-admis correspondent parfois à ce que Garfinkel 46 appelle la constitutionde l’identité de l’autre comme objet social à travers le processus de dégradation destatut. Le but est de dénoncer que l’autre « n’est pas ce qu’il paraît, mais qu’il est parailleurs et dans son essence d’une espèce inférieure 47 ». Si Garfinkel voyait dans letribunal un espace dans lequel se constituent ces cérémonies, nous pouvons aussiconsidérer que les bureaucraties telles que la police des frontières « ont quelque chosecomme un monopole certain de telles cérémonies, et elles sont devenues une routineprofessionnelle 48 ». En effet, les conditions pour la réussite d’une cérémonie dedégradation sont parfois facilement rencontrées dans les bureaucraties et leurs modi
operandi spécifiques. Lors de la déclaration faite par le passager à l’officier de garde, ladécision prise par le dénonciateur (l’officier de garde) doit être considérée comme laseule possibilité pour que la « validité de son choix, sa justification, soit maintenue parle fait que [c’est lui qui] l’a prise 49 ». En outre, dans l’aéroport étudié la déclaration n’apas lieu dans une salle privée mais dans un espace ouvert où un public, à savoir lesassistants de l’officier de garde, partage les mêmes valeurs et analyses du« dénonciateur » et participe dans la dénonciation publique de l’identité représentéepar le voyageur. Nous avons assisté à une telle situation lorsque l’officier de garde meten cause la véracité du motif de mobilité d’un voyageur malien en l’accusant de ne pasêtre un entrepreneur en recherche de nouvelles opportunités en Europe, mais d’être unvoyageur qui cherche à contourner les lois sur l’immigration, d’être un futur immigréen situation irrégulière. Dans le bureau de l’officier de garde étaient présents desassistants de ce dernier, d’autres gardes-frontière et nous-mêmes. Aux réponsesfournies par le voyageur malien, le public sourit et ironise sur ses affirmations venantde la sorte conforter l’interprétation de l’officier de garde. Ce rituel collectif participe àla dénonciation publique de l’identité de voyageur légitime, dégradé de la sorte à cellede « profiteur » et de « menteur ». Dans cette situation aussi, la conséquence est lebasculement du régime des droits des voyageurs à celui des privilèges attribués ou paspar les agents bureaucratiques.
34 Qu’il soit discrédité ou dégradé, le voyageur qui voit son identité sociale se transformer
en celui d’un potentiel immigré en situation irrégulière ne proteste généralement pas.S’il le fait, il est confronté, comme nous l’avons vu, à une apparence de responsabilité(accountability) qui le neutralise. Étant incapable d’exprimer sa protestation et étantdiscrédité, il n’est plus un sujet de droits. Il est plutôt transformé en un objet depolitique à la merci de l’attitude arbitraire, et non plus discrétionnaire, des garde-frontières. En pratique, cela se traduit par de la moquerie, des abus, des insultes ou deshumiliations.
35 Nous avons observé de telles attitudes lors de nos investigations. Ainsi, les garde-
frontières se sont moqués d’un transsexuel ressortissant d’un État tiers parce que lenom et le genre inscrits sur son passeport ne correspondaient pas à l’aspect physique
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
66
de la personne présente. Quant à l’abus de position, nous avons été témoins de lamanière dont un voyageur considéré comme une personne en situation irrégulière aété prise et emmenée dans le bureau deuxième ligne. Cette personne est assise sur lebanc opposé au bureau du garde-frontières (voir le plan). Elle demande un verre d’eauet se dirige vers le bureau de l’agent. Ce dernier lui répond d’un ton autoritaire :« assieds-toi, je te dirai si tu peux avoir de l’eau. ». La personne s’est donc rassise. Àpeine assis, le même agent, avec le même ton de voix lui dit : « Tu peux aller prendre del’eau ». La fontaine à eau se situe juste à côté du bureau où l’agent est assis.
36 Ces abus de pouvoir peuvent devenir de vraies menaces. Un voyageur raconte comment
pendant la fouille, qui a toujours lieu après la déclaration de non-admission, unealtercation survient entre lui et le garde-frontières. Pendant qu’ils passent en revue seseffets personnels, parmi lesquels son argent, il demande au garde-frontières d’arrêter,parce qu’il ne l’a pas encore lui-même compté. L’échange tumultueux qui s’ensuit faitintervenir un troisième garde-frontières. Le voyageur relate l’échange de la manièresuivante :
« Un troisième est arrivé […] et il a dit des choses que je n’ai pas comprises, mais ildisait des choses, des mots qui ressemblaient à des insultes, des grossièretés dont jene connaissais pas le sens. Mais je lui ai dit que je n’élevais pas la voix, mais qu’ils [=les deux autres gardes-frontières] étaient en train d’élever leur voix et que donc, s’ildevait réprimander quelqu’un, il devrait le faire avec ses hommes, parce qu’ilscriaient. Je lui ai dit en le regardant : “Celui qui est en train de crier ici c’est vous,pas moi”. C’est ce que je lui ai dit. Il m’a fait comprendre que je devais baisser monregard. Je lui ai dit “non, pourquoi ?” et il a commencé à m’ennuyer.« – Étaient-ils physiquement agressifs ?« Verbalement. Pas physiquement, parce que le policier était à une certainedistance et me regardait avec beaucoup de rage. Mais je n’ai pas baissé le regard. Àun certain point il est venu plus près, quasiment sur moi ».
37 Lorsque les passagers subissent le contrôle de deuxième ligne et sont catégorisés non-
admissibles, ils sont conduits dans la salle de détention. Là, ils ont le droit d’utiliser letéléphone et parfois ils sont autorisés à prendre leur téléphone portable avec eux, àcondition qu’il ne possède pas de caméra. Cependant, si le téléphone est confisqué, lesvoyageurs ne peuvent même pas le consulter pour chercher les numéros de téléphonedes personnes qu’ils doivent contacter. Par ailleurs, le téléphone à l’intérieur de la sallede détention est connecté à la ligne interne de l’aéroport. Cela signifie que pourtéléphoner en dehors de l’aéroport, un code doit être composé. Les voyageurs n’en sontpas informés et ils ont donc de nombreuses difficultés à téléphoner. Cette informationn’est disponible que grâce à l’expérience accumulée par d’autres voyageurs non-admis.
38 Un autre problème se pose lorsque les personnes dans la salle de détention ont besoin
d’une aide quelconque. Ils doivent frapper fort sur la porte pendant un temps parfoislong pour que les garde-frontières décident de l’ouvrir. Nous avons pu observercomment certains garde-frontières passent devant la salle de détention en ignorant lesdemandent formulées par les voyageurs non-admis. Cela vaut autant pour lespersonnes ayant simplement besoin d’informations que pour celles qui doivent accéderaux toilettes situées en dehors de la salle de détention. Des voyageurs ont fait part desituations extrêmes conduisant des personnes à faire leurs besoins dans la salle dedétention.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
67
Pratiques discrétionnaires et gouvernance frontalière
39 Examinons à présent comment les pratiques discrétionnaires de la police des frontières
(individuelles et organisationnelles) sont adaptées au cadre analytique de lagouvernance des frontières. Au contrôle de première ligne et sur un plan juridique, legarde-frontières est confronté au Code frontières Schengen qui l’oblige à contrôler lesconditions d’entrée de tous les ressortissants des pays tiers. En effet, selon l’Article 7(3)du Code frontières Schengen, les ressortissants des pays tiers doivent être soumis à descontrôles approfondis dans les « conditions d’entrée fixées à l’article 5, paragraphe 1,ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activitéprofessionnelle ». Au même moment, le garde-frontières est confronté à l’autre objectifde la frontière-réseau qui est de permettre l’accélération de la mobilité d’un grand fluxde voyageurs disposant d’un motif légitime. En pratique, les garde-frontièrescontrôlent très peu de personnes lors du contrôle de première ligne. Heyman 50 a décritle travail de ces gardes-frontière comme des actions de « non-action » où les gardes-frontière « trient » les individus en tant que membres de « groupes sociaux supposés ».Selon le groupe auquel les garde-frontières pensent que la personne appartient, ellesera considérée soit comme digne de confiance, et pourra donc passer – sachant quedans les ports d’entrée la vaste majorité de ceux qui passent la frontière sontcomplètement légitimes 51 – soit comme pas digne de confiance, ce qui donnera suite àdes contrôles approfondis. En d’autres termes, les garde-frontières exercent un pouvoirdiscrétionnaire individuel non négligeable, leur permettant de raccourcir la procédurede contrôle et de diminuer leur charge de travail.
40 Ce raccourci se solde par le triage et la catégorisation des seules personnes ayant
potentiellement le profil migratoire et donc nécessitant un contrôle à première vue. Leprofil migratoire est basé sur des tendances, l’actualité ainsi que des documentshistoriques et donc sur un ensemble de pays d’où les personnes présentent un plusgrand risque à contourner les lois sur l’immigration. Par exemple, si nous analysons lesstatistiques que nous avons récoltées pendant le terrain, sur les 64 ressortissants despays tiers qui ont été envoyés au contrôle de deuxième ligne, 30 étaient africains etseulement 4 venaient d’Amérique du Nord 52. Cependant, ce contrôle n’implique pas lanon-admission, tout au plus un contrôle de deuxième ligne suivra. Toutefois, tous lescontrôles de première ligne ne se transforment pas en contrôle de deuxième ligne. Iln’est malheureusement pas possible de quantifier cela, étant donné que les contrôles depremière et de deuxième ligne ne sont pas enregistrés en tant que tels et qu’aucunestatistique n’est disponible sur le nombre des contrôles.
41 Si le contrôle de première ligne consiste à surveiller (trier et policer), le but de la
deuxième ligne est de contrôler, ce qui suppose l’exercice d’un pouvoir. Si lasurveillance suppose une mise à disposition volontaire d’informations, le contrôlerenvoie à l’exercice d’un pouvoir légitime de vérification réalisé même sans accord duvoyageur. En ce sens, le contrôle est une pratique de pouvoir plus asymétrique que lasurveillance. Lorsqu’un voyageur est emmené à la deuxième ligne, cela signifie que lecontrôle à première vue n’a pas levé tous les doutes du garde-frontières sur le risquemigratoire que représente le voyageur. Le garde-frontières à l’aéroport est un acteur dela frontière-réseau qui peut ne pas faire confiance à l’action d’autres agents de contrôleintervenus précédemment (par exemple les agents consulaires) ou émettre des doutessur la légalité ou la véracité des conditions d’accès au territoire (par exemple, s’il y a un
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
68
problème avec le visa, la réservation de l’hôtel, les moyens de subsistance, ou si lesintentions de la personne ne sont pas clairement établies). Dans ce cas, le voyageur estretenu et doit se soumettre à un contrôle approfondi et souvent long. Ce contrôle estcensé consolider ou réfuter la suspicion quant au profil du voyageur arrêté dans samobilité. L’établissement du profil du voyageur non-admissible suffit à bloquer levoyageur bien que les critères objectifs motivant cette décision restent parfoisimprécis, voire contraires à la législation en raison du recours au pouvoirdiscrétionnaire. L’exercice de pouvoir discrétionnaire est généralement expliqué pardes formes de « travail mental bureaucratique 53 », par l’organisation du travail 54 oupar des codes bureaucratiques 55. Comme nous l’avons mentionné, nous sommes plusenclins à suivre cette dernière approche théorique en ajoutant une dimensiondramaturgique et intersubjective goffmanienne.
42 Les pratiques de contrôle en deuxième ligne, comme nous les avons décrites
commencent avec le garde-frontières de première ligne suivi de l’action de l’officier degarde qui prend une décision. Dans le cas de non-admission du voyageur, une autresection de la police des frontières examine la décision lors de l’arrivée du voyageur encentre de détention. En d’autres termes, le processus de prise de décision semble suivreune division du travail typique des bureaucraties destinée à éliminer les élémentsarbitraires 56. Ainsi, à partir de la deuxième ligne, la police des frontières semble agircomme une bureaucratie autonome, plutôt que comme acteur dans un réseau.Pourtant, dans la pratique, cela ne sert pas l’objectif de transparence et de respect l’étatde droit, étant donné que, comme décrit plus haut, les agents individuels peuventmobiliser un discours sur la structure de leur organisation afin d’éviter toute sorte deconfrontation avec les voyageurs. Comme nous l’avons vu auparavant, c’est ce queLipsky a appelé la « défense contre le pouvoir discrétionnaire ».
43 Nous pouvons déduire de ce qui précède qu’il existe deux modalités de gouvernance des
frontières dans le travail à l’aéroport : le réseau et la bureaucratie. D’une part, lafrontière-réseau est caractérisée par le pouvoir du réseau où la confiance dans lesautres acteurs du réseau 57 ou dans les instruments technologiques (frontièresintelligentes) est centrale. Le réseau constitue un champ inter-organisationneld’acteurs institutionnels et d’actants non-humains (base de données, systèmes de voiesrapides) auquel la police des frontières appartient. Par exemple, à l’aéroport, le garde-frontière fait confiance au consulat qui délivre les visas ou aux informations contenuesdans les bases de données. L’intérêt du champ inter-organisationnel est qu’il y a desacteurs modèles qui sont vus comme ayant des politiques ou approches modèles et quipar conséquence influencent les pratiques d’autres acteurs 58. Cela peut expliquerpourquoi dans le contrôle de première ligne la majorité des voyageurs passent sansproblème, puisque l’objectif principal de la frontière-réseau est d’améliorer la libertéde circulation légitime. Le revers de ce principe est de filtrer la circulation illégitime, cequi explique pourquoi les garde-frontières de la première ligne doivent aussi surveillerle flux de voyageurs menant à des contrôles occasionnels.
44 Toutefois, dès que la confiance lors du contrôle de première ligne est suspendue et que
la suspicion apparaît, la modalité de gouvernance en réseau semble s’effacer au profitde pratiques bureaucratiques déterminées par la police des frontières elle-même. Eneffet, à l’intérieur du réseau, des organisations singulières, telles que la police desfrontières, jouent un rôle important dans la transmission du sens juridique aux agentssur le terrain, qui possèdent un certain pouvoir discrétionnaire. La présence de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
69
différents modèles, chacun avec ses propres pratiques et interprétations de la loi, ausein du champ inter-organisationnel, conduit à une ambiguïté de la loi due au surplusd’interprétations légitimes de la loi. Afin de standardiser le comportement des agents,les organisations peuvent développer une politique de la mise en œuvre del’organisation. Cela revient à du pouvoir discrétionnaire organisationnel et doit êtreconsidéré comme un sous-produit de la manière dont le champ inter-organisationnelest structuré 59. Dans le cas de la police des frontières de l’aéroport, ses pratiquesbureaucratiques visent à opter pour des interprétations spécifiques des règles régissantl’entrée afin de structurer la fonction normative des pratiques de contrôle à lafrontière-réseau. Par exemple, le refus d’entrée à chaque fois qu’un ressortissant despays tiers n’est pas en possession d’assez d’argent en liquide ou n’a pas payé l’entièretéde son séjour à l’hôtel.
45 Dans les deux modalités de gouvernance des frontières, nous avons mentionné que les
garde-frontières possèdent un pouvoir discrétionnaire individuel, ce qui impliquetoujours une interaction de face à face. Lors de la première ligne, cela est caractérisépar l’action de « non-action » et à la deuxième ligne par la prise de décision finaledéterminant si le voyageur est admissible ou non. Il semble donc que le pouvoirdiscrétionnaire individuel soit également paradigmatique pour le contrôle auxfrontières. Ceci nous amène à une structure complexe de gouvernance des frontières oùtrois niveaux différents, mais imbriqués, opèrent. Au niveau macro, nous avons lechamp inter-organisationnel de la frontière-réseau, au niveau méso, le pouvoirdiscrétionnaire organisationnel et les pratiques bureaucratiques de la police desfrontières et au niveau micro, le pouvoir discrétionnaire individuel des gardes-frontières. Ils sont imbriqués parce que les niveaux les plus élevés délimitent toujoursles marges au sein desquelles les niveaux les plus bas peuvent exercer leur pouvoirdiscrétionnaire.
Conclusion
46 À l’aéroport, un espace social de la frontière-réseau, s’opère le triage des voyageurs
disposant des moyens légitimes de mobilité et de ceux qui vont être étiquetés devoyageurs inadmissibles, les voyageurs dont les garde-frontières vont estimer qu’ils nedisposent pas des moyens légitimes de mobilité, et dans le cas d’espèce le droit d’accèsau territoire ou à l’espace de transit. Quels sont les modi operandi de ces pratiques detriage et de catégorisation et quelles sont les pratiques de contrôle exercées en vue defiltrer ou de bloquer des voyageurs ? Ces questions ont été abordées en vue d’analyserles pratiques de frontières dans un aéroport. En raison du cadre théorique choisi et ducas empirique analysé, cette contribution entend aussi suggérer un élargissement desapproches des études sur les frontières en incluant la problématique des relations entreconstruction des identités et accès aux droits lors des pratiques de frontière.
47 L’approche street-level bureaucrats associée à une perspective interactionniste permet de
mieux apprécier les diverses formes que prennent les pratiques de frontière. Si lesbases de données jouent un rôle essentiel dans le profilage, il semble que Lyon 60 etAdey 61 surestiment l’importance de l’utilisation des bases de données dans le processusd’identification et négligent le pouvoir discrétionnaire que possèdent les garde-frontières. De même, l’affirmation de Lyon 62 relative au « déclin général de la relationde face à face » dans les pratiques de filtrage doit être nuancée. On pourrait considérer
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
70
que l’usage des bases de données sert surtout à accélérer la mobilité des voyageurslégitimes et que pour ceux-ci le face à face avec les garde-frontières tend à diminuer.Lors d’un contrôle en deuxième ligne, par contre, l’interaction entre voyageur et garde-frontières joue toujours un rôle central. Cette interaction, la « confession » pourreprendre les termes de Salter 63, est la pierre angulaire des décisions d’admission ou denon-admission. En suivant une perspective plus anthropologique, comme celle deHeyman 64, nous avons pu voir que si les garde-frontières ont souvent recours aux basesde données, si les doutes ne sont pas levés avec les alertes des frontières intelligentes,ils ont recours in fine à leur discernement fondé sur des expériences antérieures de faceà face. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il y a lieu de juger la crédibilité du motif demobilité. Le garde-frontières est le juge final devant décider de la légitimité du récit.C’est sur cette base qu’il prendra la décision de laisser le voyageur entrer sur leterritoire ou de le bloquer à la frontière.
48 Dès lors, on peut considérer que la surveillance est un dispositif de sécurité basé
essentiellement sur les frontières intelligentes qui vise à accélérer la mobilité de lamajorité des voyageurs légitimes. Par contre, le contrôle est un dispositif de sécuritéfondé sur l’usage des frontières intelligentes et un face à face conséquent dans lequel lepouvoir discrétionnaire des garde-frontières est important parce que de son exécutionrésulte la qualification de voyageur inadmissible. Même si une base de données justifiela non-admissibilité sur le territoire, à l’aéroport son exécution suppose toujoursl’établissement d’un rapport et donc un face à face. Même si cela se fait par la mise enplace d’un réseau d’informations et de bases de données interconnectées, le face à face,l’expérience personnelle et les relations intersubjectives sont décisives dans leprocessus de qualification des voyageurs indésirables.
49 En première ligne, un aspect de l’organisation du réseau est mis en scène dans laquelle
la confiance dans le réseau des acteurs prévaut. Cela cadre bien avec les objectifs de lafrontière-réseau qui est d’améliorer la circulation des voyageurs disposant des moyenslégitimes de voyage en continuant à filtrer et à bloquer les « indésirables ». En effet, lesgarde-frontières ne peuvent pas remplir leur devoir légal de contrôler exhaustivementtous les ressortissants des pays tiers à cause de l’importante charge de travail que celareprésente. Au lieu de cela, ils doivent choisir de ne pas agir dans la grande majoritédes cas, c’est-à-dire, trier les passagers selon ceux en qui ils ont confiance et qu’ilslaissent donc passer, et ceux qu’ils jugent suspects et contrôlent.
50 L’usage du pouvoir discrétionnaire dans les pratiques de frontière en première et en
deuxième ligne diffèrent. Si, lors du contrôle de première ligne, le pouvoirdiscrétionnaire est exercé individuellement, impliquant essentiellement de déciderquand « ne pas agir 65 », lors du contrôle de deuxième ligne le pouvoir discrétionnaireest exercé individuellement et organisationnellement par l’exécution de règlesbureaucratiques et procédurales définies par l’organisation police des frontières. Lepouvoir discrétionnaire, tant organisationnel qu’individuel, est essentiel pourcomprendre les pratiques des garde-frontières dans cet aéroport.
51 Le pouvoir discrétionnaire organisationnel repose sur un accord entre les membres de
l’équipe des garde-frontières sur la manière de procéder au contrôle et sur les modes deprise de décision. En suivant, la métaphore théâtrale de Goffman, en deuxième ligne lesgarde-frontières constituent un acteur collectif en représentation dont la performancedépend de la capacité à maîtriser l’accès aux « coulisses ». Dans celles-ci se définissent,par exemple, des règles de conduite qui sont cachées au public. Dans le cas d’espèce, la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
71
police des frontières a élaboré des règles bureaucratiques dans le contrôle de l’accès auterritoire de voyageurs des pays tiers munis ou non d’un visa Schengen qui conduisentà la non-admission de certains d’entre eux, quand bien même le prescrit légal estrespecté. Ainsi, nous avons relevé que l’interprétation restrictive de certainesconditions d’entrée sur le territoire formulées dans le Code frontière Schengen (avoirde l’argent liquide, payer l’intégralité des nuits d’hôtel) résulte d’une norme interne etnon de pratiques discrétionnaires individuelles. Cette norme n’est pas perçue commetelle par le public, l’ensemble des voyageurs. Les voyageurs y sont confrontésindividuellement. La performance de ce pouvoir discrétionnaire organisationnel tienten dernière instance à la capacité de cacher que le résultat recherché est tout autre quecelui du contrôle singulier en cours. Il vise à la production des statistiques des non-admissibles sur le territoire.
52 Une des propriétés de la performance bureaucratique tient au processus de
déresponsabilisation dans la chaîne de décision. Nous avons vu que lors de laproduction des identités des voyageurs non-admissibles, il n’y a pas un garde-frontièresspécifique qui assume la décision du blocage. Le renvoi à une instance décisionnelleultérieure réduit la confrontation avec le voyageur non-admis tout en évitant que desplaintes ne soient formulées. La performance bureaucratique semble très efficacepuisque très peu de voyageurs protestent. La faible disposition à la contestation tientcomme nous l’avons vu à l’occultation d’une règle générale mais aussi au changementde l’identité du voyageur. Que les raisons du blocage soient fondées ou non, l’identitéd’inadmissible fait du voyageur un paria. Il n’est pas un voyageur légitime mais unusurpateur. Les pratiques de frontières ont révélé sa véritable identité, celle d’unpotentiel immigré irrégulier. Ce changement d’identité qui s’opère dans un espacepublic, celui de la deuxième ligne, neutralise également la légitimité du voyageur àdéfendre ses droits. Comme il n’est pas un voyageur légitime, tout se passe comme s’iln’avait pas de droits. L’identité du voyageur est discréditée, ce qui affaiblit la légitimitéde sa capacité à se défendre. Le processus de déresponsabilisation et les processus destigmatisation ont pour effet de neutraliser ou de réduire les ressources desmobilisations et des constatations.
53 Le contrôle en deuxième ligne ne sert pas seulement à contrôler les conditions d’accès
au territoire mais constitue un instrument de production des statistiques de l’activitédes garde-frontières et par conséquent de la politique du contrôle migratoire. Laproduction de voyageurs non-admissibles alimente les statistiques publiques sur lecontrôle aux frontières, qui sont d’une importance primordiale pour la police desfrontières et le ministère de l’Intérieur, et ce pour tous les pays européens, qui ontsouvent un grand impact dans les espaces médiatique et politique. La performancebureaucratique produit une apparence de responsabilité (accountability) des agences desécurité visant à détourner les critiques publiques, à justifier la pertinence del’existence de l’organisation et, surtout, avec la managérialisation des pratiques defrontières, l’efficacité de leur action. Comme le souligne Andreas 66, des méthodes quisont inefficaces par rapport aux objectifs à atteindre, notamment de dissuader desmigrants potentiels, peuvent être optimales du point de vue d’une politique deconstruction de l’image de l’autorité d’un État. Sans aucun doute, l’efficacité résidemoins dans l’arrêt de l’immigration irrégulière que dans la réalisation de la politique duchiffre, dont l’effet est avant tout symbolique. L’efficacité de ces politiques n’est passeulement de bloquer des personnes, mais aussi de rassurer l’opinion publique des paysd’immigration et d’apaiser l’anxiété du public à propos de l’immigration irrégulière. Le
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
72
contrôle aux frontières constitue, avant tout, une politique symbolique 67, mais l’actionsymbolique est au cœur de cette politique 68.
54 Cependant, une lecture complémentaire de cette performance peut aussi être proposée.
Suivant la perspective de la réaction sociale de la sociologie de la déviance 69, laproduction de règles bureaucratiques qui se traduisent lors de pratiques du pouvoirdiscrétionnaire organisationnel peuvent être interprétées comme la production del’irrégularisation non de la migration mais de la mobilité. La définition d’uneinterprétation très restrictive des lois, la production d’un pouvoir discrétionnaireorganisationnel, le processus de déresponsabilisation et le processus de stigmatisationde certains voyageurs ont pour effet de rendre irrégulières des mobilités qui sontparfois régulières. En cela, des pratiques de frontières visent à la constitution del’irrégularisation de la mobilité de ressortissants de pays tiers alors qu’elles sontprésentées comme des pratiques de lutte contre l’immigration irrégulière.L’irrégularisation de certaines mobilités instaure un climat d’incertitude permanenteauprès des ressortissants des pays tiers sur leurs droits d’accès au territoire et sur leurspratiques de mobilité toujours suspectes d’être illégitimes. En cela, certaines pratiquesde frontières à l’aéroport, notamment celles en deuxième ligne, servent à irrégulariserla mobilité de certains voyageurs provenant de pays tiers.
NOTES
2. Augé M., Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Le Seuil, 1992.
3. Castells M., The Rise of the Network Society - Volume 1: The Information Age: Economy, Society and
Culture, Oxford, Blackwell, 1996.
4. Lyon D., « Filtering Flows, Friends, and Foes: Global Surveillance », in Salter M.B. (ed.), Politics
at the Airport, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, pp. 29-49.
5. Torpey J., The Invention of the Passport: Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge,
Cambridge University Press, 2000.
6. Salter M. B., Rights of Passage: The Passport in International Relation, Boulder, Lynne Rienner, 2003.
7. Bigo D. et Guild E., Controlling Frontiers: Free Movement Into and Within Europe, Londres, Ashgate,
2005.
8. Infantino F., Rea A., « La mobilisation d’un savoir pratique local : attribution des visas
Schengen au Consulat général de Belgique à Casablanca », Sociologies Pratiques, vol. 24, 2012,
pp. 67-78 ; Infantino F., « State-Bound Visa Policies and Europeanized Practices. Comparing EU
Visa Policy in Morocco », Journal of Borderland Studies, 2016 [Online] dx.doi.org/
10.1080/08865655.2016.1174603 ; Alpes M.J. et Spire A., « Dealing with Law in Migration Control :
the Powers of Street-level Bureaucrats at French Consultates », Social and Legal Studies, n° 23,
2014, pp. 261-274.
9. Guiraudon V., « Before the EU Border: Remote Control of the “Huddled Masses” », in
Groenendijk K., Guild E. et Minderhoud, P. (eds.), In Search of Europe’s Borders, La Hague, Kluwer
Law International, 2003, pp. 191-214 ; Zolberg A., « The Archaeology of Remote Control », in
Fahrmeir A., Faron O. et Weil P. (eds.), Migration Control in the North Atlantic World, New York,
Berghahn Books, 2003, pp. 195-222.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
73
10. Bigo D. et Guild E., op. cit.
11. Bigo D., « Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease »,
Alternatives: Global, Local, Political, n° 27, 2002, pp. 63-92 ; Rea A., « Laisser circuler, laisser
enfermer : les orientations paradoxales d’une politique migratoire débridée en Europe », in:
Kobelinsky C. et Chowra M. (dir.), Enfermés dehors : enquêtes sur le confinement des étrangers,
Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2009, pp. 265-280.
12. Lyon D., Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital Discrimination, London, Routledge,
2003.
13. Heyman J. McC., « Trust, Privilege, and Discretion in the Governance of the US Borderlands
With Mexico », Canadian Journal of Law and Society/Revue Canadienne Droit et Société, vol. 24 n° 3,
2009, pp. 367-390.
14. Adey P., « Secured and Sorted Mobilities: Examples From the Airport », Surveillance and
Society, n° 1, 2004, pp. 500-519.
15. Lyon D., « Airports as Data Filters: Converging Surveillance Systems After September 11th »,
Information, Communication and Ethics in Society, vol. 1, n° 1, 2003, pp. 13-20.
16. Lyon D., op. cit., 2008.
17. Haggerty K. D. et Ericson R.V., « The Surveillant Assemblage », British Journal of Sociology,
vol. 51, 2000, pp. 605–22.
18. Parker N. et Vaughan-Williams N., « Lines in the sand? Towards an agenda for critical border
studies », Geopolitics, vol. 14, n° 3, 2009, pp. 582-587.
19. Andersen D. J., Klatt M. et Marie Sandberg M. (eds.), The Border Multiple. The Practicing of
Borders between Public Policy and Everyday Life in a Re-scaling Europe, Londres, Routledge, 2012.
20. Côté-Boucher K., Infantino F. et Salter M., « Border security as practice: An agenda for
research », Security Dialogue, vol. 45, n° 3, 2014, pp. 195-208.
21. Lipsky M., Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russel
Sage Foundation, 1980.
22. Bigo D., « Freedom and Speed in Enlarged Borderzones », in Squire V. (ed.), The Contested
Politics of Mobility. Borderzones and Irregularity, Londres, Routledge, 2010, pp. 31-50.
23. Rea A., « Processes of Bordering in the Age of Mobility », in Bousetta H., Zickgraf C. et Bernes
L.-A. (eds.), Migration, Mobility and Borders in the Western Mediterranean: Enduring and Emerging Issues
in the Context of the Arab Spring, Londres, Routledge, à paraître.
24. Latour B., Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society, Harvard,
Harvard University Press, 1987.
25. Bigo D., Jeandesboz J., Ragazzi F. et Bonditti P., « Borders and Security: the Different Logics of
Surveillance in Europe », in Bonjour S., Rea A. et Jacobs D. (eds.), The Others in Europe, Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, 2011, pp. 77-86.
26. Torpey J., op. cit.
27. Rea A., op. cit.
28. Guiraudon V., « Logiques et pratiques de l’État délégateur : les compagnies de transport dans
le contrôle migratoire à distance », Cultures & Conflits, n° 45, 2002, pp. 51-79.
29. El Qadim N., « Postcolonial challenges to migration control: French-Moroccan cooperation
practises of forced returns », Security Dialogue, vol. 45, n° 3, 2014, pp. 242-261.
30. À la demande du commanditaire, la publication de ce papier est autorisée moyennant
l’anonymisation, d’une part, de l’aéroport analysé et, d’autre part, de l’institution ayant financé
la recherche.
31. Dilnur Polat, Rim Otmani, Alice Sarcinelli, Clémence Henry, Sina Safadi. Nous les remercions
pour leur travail.
32. Fuller G. et Harley R., Aviopolis: A Book About Airports, Londres, Black Dog Publishing Ltd., 2005.
33. Weaver R. K., Automatic Government: The Politics of Indexation, Washington DC, Brookings
Institution Press, 1988.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
74
34. Le SIS est une base de données regroupant des informations sur des personnes qui pourraient
avoir été impliquées dans un crime grave ou ne pouvant pas entrer ou rester dans l’UE. Il
contient aussi des alertes concernant des personnes disparues, en particulier des enfants.
35. Base de données reprenant les données et décisions relatives aux demandes de visa Schengen.
36. Base de données européenne d’empreintes digitales qui identifie les demandeurs d’asile et les
personnes traversant la frontière illégalement.
37. Makaremi C., « Violence et refoulement dans la zone d’attente de Roissy », in Kobelinsky C. et
Chowra M. (eds.), Enfermés dehors : enquêtes sur le confinement des étrangers, Bellecombe-en-Bauges,
Éditions du Croquant, 2009, pp. 41-62.
38. Lipsky M., op. cit. Traduction des auteurs.
39. Ibid., p. 149.
40. Ibid., p. 164.
41. Baumgarter M.P., « The Myth of Discretion », in Hawkins K. (ed.), The Uses of Discretion,
Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 129-162.
42. Becker H., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York, The Free Press, 1973.
43. Andreas P., Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide, Ithaca, Cornell University Press, 2001.
44. Salter M.B., « Governmentalities of an Airport: Heterotopia and Confession », International
Political Sociology, vol. 1, n° 1, 2007, p. 53. Traduction des auteurs.
45. Goffman E., Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Prentice-Hall, Englewood Cliffs,
1963.
46. Garfinkel H., « Conditions of Successful Degradation Ceremonies », American Journal of
Sociology, vol. 61, n° 5, 1956, pp. 420-424.
47. Garfinkel H., op. cit., p. 421. Les traductions de Garfinkel sont faites par les auteurs.
48. Ibid., p. 424.
49. Ibid., p. 423.
50. Heyman J. McC., « Trust, Privilege, and Discretion in the Governance of the US Borderlands
With Mexico », op. cit.
51. Heyman J. McC., « Ports of Entry in the “Homeland Security” Era: Inequality of Mobility and
the Securitization of Transnational Flows », in Martinez S. (ed.), International Migration and Human
Rights: The Global Repercussions of U.S. Policy, Berkeley and Los Angeles, University of California
Press, 2009, pp. 44-59.
52. Les 30 autres représentent moins de 10 individus par continent.
53. Heyman J. McC., « Putting Power in the Anthropology of Bureaucracy: The Immigration and
Naturalization Service at the Mexico - United States Border », Current Anthropology, vol. 36, 1995,
pp. 261–89.
54. Gilboy J.A., « Deciding Who Gets in: Decisionmaking by Immigration Inspectors », Law and
Society Review, vol. 25, 1991, pp. 571-599.
55. Bigo D. et Guild E., op. cit.
56. Meuleman L., Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets,
Heidelberg, Physica-Verlag, 2008, p. 22.
57. Meuleman L., op. cit., p. 32 ; Fleming J. et Rhodes R., « Bureaucracy, contracts and networks:
The unholy trinity and the police », Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 38, 2005,
pp. 192-205.
58. Grattet R. et Jenness, V., « The Reconstitution of Law in Local Settings: Agency Discretion,
Ambiguity, and a Surplus of Law in the Policing of Hate Crime », Law & Society Review, vol. 39, n° 4,
2005, pp. 893-941.
59. Ibid.
60. Lyon D., op. cit., 2003.
61. Adey P., « Facing Airport Security: Affect, Biopolitics, and the Preemptive Securitisation of
the Mobile Body », Environment and Planning D: Society and Space, vol. 27, n° 2, 2009, pp. 274-295.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
75
62. Lyon D., op. cit., 2008.
63. Salter M.B., op. cit., 2007.
64. Heyman J. McC., « Trust, Privilege, and Discretion in the Governance of the US Borderlands
With Mexico », op. cit.
65. Heyman J. McC., « Ports of Entry in the “Homeland Security” Era: Inequality of Mobility and
the Securitization of Transnational Flows », op. cit. ; Heyman J. McC., « Trust, Privilege, and
Discretion in the Governance of the US Borderlands With Mexico », op. cit.
66. Andreas P., op. cit., p. 9.
67. Edelman M., The Symbolic Uses of Politics, Chicago, Chicago University Press, 1964.
68. Guiraudon V. et Joppke C., Controlling a New Migration World, New York, Routledge, 2001.
69. Becker H., op. cit.
RÉSUMÉS
Basé sur une recherche ethnographique réalisée dans un aéroport européen, cet article analyse
les pratiques de contrôle des gardes-frontières auprès des voyageurs ressortissants de pays tiers,
proposant une anthropologie du pouvoir des contrôles aux frontières qui examine l’usage de la
violence symbolique et du pouvoir étatique discrétionnaire. En nous appuyant sur les théories
des « street-level bureaucracies » et celles des interactions sociales, nous analysons les pratiques de
travail, les routines professionnelles et l’organisation du travail des gardes-frontières en
démontrant que ce sont ces dernières qui activent et constituent la frontière et la politique du
contrôle de la mobilité. Nous soutenons que le contrôle au sein de l’aéroport est basé à la fois sur
l’influence de la frontière-réseau, ainsi que sur une performance dramaturgique de gestion
bureaucratique qui créent les voyageurs légitimes et les passagers indésirables, évitent de
potentielles protestations de ces derniers et feignent une responsabilité (accountability), destinée
à un public plus large de citoyens. En tant que tel, le contrôle de la frontière serait dès lors plus
un acte politique symbolique qu’un outil efficace de politique de mobilité et d’immigration.
Based on empirical research in a European airport, this article analyses how border guards
control third-country nationals by advancing an anthropology of the power of border control as
exhibited by the use of symbolic violence and discretionary state power. Leaning on the theories
of street-level bureaucracies and organizations, we analyze the work practices, professional
routines and organization of the work of border guards in order to show how border guards
activate and constitute the border and the control of mobility. We argue that control at the
airport is based both on the influence of the network-border and on a dramaturgical
performance of bureaucratic governance, which is meant to create legitimate travelers and
undesirable passengers, while circumventing potential protests of the latter and simulating
accountability toward the broader public of citizens. As such, border control is more of a
symbolic act than an efficient tool of immigration policy.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
76
INDEX
Keywords : airport, discretion, border control, network-border, bureaucracy
Mots-clés : aéroport, pouvoir discrétionnaire, contrôle des frontières, frontière-réseau,
bureaucratie
AUTEURS
ANDREW CROSBY
Andrew Crosby est aspirant FNRS et doctorant à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et membre
du Groupe d’Études sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Égalité (GERME). Il réalise une
thèse de doctorat sur les centres de détention des étrangers en Belgique. Parmi ses publications
récentes : « Moralisation and criminalisation: a socio-political history of the expulsion of
foreigners in Belgium (1830-1952) », International Journal of Migration and Border Studies (à paraître
en 2017).
ANDREA REA
Andrea Rea est professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et membre du Groupe d’Études
sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Égalité (GERME). Parmi ses publications récentes :
New Dynamics in Female Migration and Integration, avec Marco Martiniello, Chris Timmerman, Johan
Wets, (Routledge, 2014), Long and Winding Road to Employment. The migratory carrers of refugees in
Belgium, avec Johan Wets (Academia Press, 2015), Politiques antidiscriminatoires, avec Julie
Ringelheim et Ginette Herman (De Boeck, 2015).
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
77
L’urbanisation forcée commepolitique contre-insurrectionnelle La vie au sein des villages stratégiques construits en Argentine(1976-1978)
Forced Urbanization as a Counter-Insurgency Policy. Everyday Life inside
Strategic Villages Built in Argentina (1976-1978)
Pamela Colombo
Je souhaiterais remercier Antonia Garcia Castro, Chowra Makaremi, Chiara Calzolaio, Elisabeth
Anstett et les deux relecteurs anonymes de la revue pour leurs corrections et conseils.
1 C’est l’heure de la sieste. Les rues sont encore plus désertes que d’habitude. M. a sorti
deux chaises sur le trottoir. C’est là que nous faisons l’entretien. Le soleil tape fort bienque l’on soit en hiver. Au loin, on voit le monte 1 et, aux alentours, soixante-dix maisonstoutes pareilles. Nous sommes dans l’un des quatre villages créés par les militaires dansla province de Tucumán pendant la dictature militaire (1976-1983). M. a la soixantaine,elle est femme au foyer et mère de dix enfants. Tous, dans sa famille, ont travaillé à larécolte de la canne à sucre, principale ressource économique des paysans de Tucumán.M. raconte que c’est en 1976 qu’ils ont été expulsés de chez eux et déplacés dans l’undes nouveaux villages. Elle se souvient qu’un matin, elle était allée avec une voisinecueillir des avocats dans une propriété qui se trouvait au-delà du périmètre du village.Une fois sur place, un hélicoptère s’est mis à survoler le secteur :
« Nous sommes sorties et nous avons commencé à faire des grands signes àl’hélicoptère pour qu’il se pose. On nous a dit que c’était interdit – d’aller dans cesparages – qu’on ne devait pas recommencer et ils nous ont emmenées à la base[militaire]. Ils nous ont gardé un moment et puis ils nous ont demandé ce qu’onfaisait là, parce que c’était là que se cachaient “les autres types” [les guérilleros] etils croyaient que nous étions là pour les contacter. Ce jour-là, quand ils nous ontemmenées à la base, nous avons vu des prisonniers attachés au sol, écartelés 2. Ilsm’ont dit de ne plus jamais sortir comme ça, plus jamais, ni dans les maquis ni oùque ce soit. Je n’ai plus osé m’aventurer par là-bas. 3 »
2 La technique de la disparition forcée de personnes a été utilisée par l’État argentin pour
désarticuler le mouvement social de tendance révolutionnaire qui lui disputait des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
78
domaines du pouvoir et remettait en question le monopole de la violence. C’est en 1975que les disparitions commencent dans la province de Tucumán, puis elles ont étépratiquées sur l’ensemble du territoire national de manière systématique à partir ducoup d’État qui instaure une dictature militaire entre 1976 et 1983. Les disparitionsforcées sont alors organisées par l’ensemble des forces armées qui articulent larépression à partir d’une constellation d’espaces de disparition 4. Cependant, ledéploiement des politiques contre-insurrectionnelles n’a pas pour seule priorité ladestruction de l’ennemi, il s’agit aussi – et c’est une question centrale – de « gagner lescœurs et les esprits 5 » de la population civile. C’est dans ce contexte qu’émerge le Plan
de reubicación rural (Plan de relogement rural), dans la province de Tucumán. En vertude ce plan, la population rurale a été déplacée dans quatre villages créés dans la zoned’opérations militaires : Teniente Berdina, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres etSargento Moya (les noms choisis pour nommer les villages sont des noms de militairesqui – selon le récit des forces armées – seraient décédés lors d’affrontements avec laguérilla dans la zone d’opérations).
3 Le Plan de relogement rural trouve ses origines dans le programme militaire de
création des « villages stratégiques » conçu au début de la guerre froide et souventreproduit avec l’intervention de gouvernements étrangers. Entre autres applications, ilconvient de souligner que la Grande-Bretagne a créé des « New Villages » en Malaisie(1952-1954) 6, les États-Unis des « Strategic Hamlets » au Vietnam (1962-1963) et laFrance des « Centres de Regroupement » en Algérie (1959-1962). Entre la fin des années1970 et le début des années 1980, des villages stratégiques ont également été construitsen Amérique latine. Parmi les premiers, ceux de l’Argentine (1976-1978) 7.
4 Le programme visait la construction d’espaces urbains ex nihilo afin d’y déplacer la
population rurale qui résidait dans des zones sous l’influence des mouvements deguérilla. Bien que le nombre de déplacés et la taille des villages aient été différents àchaque fois, ce programme présente une caractéristique commune : la volonté derompre les liens entre la population et la guérilla par le biais de l’urbanisation forcée.En dépit de l’ampleur de l’impact de cette politique de contre-insurrection dans diverspays du monde, la question n’a guère été étudiée jusqu’à présent. Parmi les quelquestravaux universitaires, on peut citer des analyses réalisées par des historiens 8, desgéographes 9, des politologues 10 et des architectes 11. Il existe aussi des écrits demilitaires sur la planification et l’adoption de ce type de programme 12. Mais il n’y apratiquement pas de travaux ethnographiques réalisés auprès de la population affectéequi permettent de rendre compte de leur expérience et d’analyser l’impact socio-politique sur le long terme de cette stratégie militaire.
5 Aujourd’hui, plus de quarante ans après la mise en place en Argentine du programme
en question, ces villages stratégiques existent toujours et une grande partie despersonnes déplacées y demeure encore. Mais, quelles sont les reconfigurations que ceprogramme a produites dans l’espace social et quelles sont celles qui perdurent ? Letravail ethnographique se présente ici comme un outil essentiel. D’un côté, devant larareté des archives et des témoignages de militaires argentins sur la conception etl’adoption du Plan de relogement rural, le travail ethnographique permet d’aborder lesconditions du déplacement des populations, la manière dont ces villages ont été bâtis,les acteurs impliqués et les caractéristiques des débuts de la construction. D’un autrecôté, cela permet d’analyser les effets sur le long terme : comment se déroulait la viequotidienne lorsque les militaires étaient présents ? Comment s’est faite la transition
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
79
une fois que les militaires ont cessé de contrôler les villages ? Comment invente-t-on ourecrée-t-on, dans la durée, la vie quotidienne au sein de ces villages, après la fin de ladictature ?
6 La présente analyse prend appui sur un travail de terrain réalisé en 2014, à Tucumán,
basé sur des entretiens approfondis semi-directifs. Il s’agit d’une quarantained’entretiens d’une durée moyenne de deux heures chacun, réalisée avec des personnesdéplacées dans ces villages entre 1976 et 1978, et qui, au moment de l’entretien,vivaient toujours dans les mêmes habitations qui leur avaient été assignées par lesmilitaires. La plupart des interviewés étaient ou avaient été des travailleurs saisonniersaffectés à la récolte de la canne à sucre et employés par de grands propriétaires de larégion. Avant les déplacements, ils vivaient le plus souvent dans de petites localités –connues sous le nom de « colonies » – dans des cabanes cédées par le patron 13. Letravail d’entretiens a été complété par une consultation d’archives menée dans desbibliothèques, des hémérothèques, des archives militaires et d’organismesgouvernementaux.
7 Ce présent travail se propose ainsi d’explorer les modalités de la violence d’État telle
qu’elle a été déployée dans le cadre de la construction des villages stratégiques àTucumán, sur la base d’une recherche ethnographique réalisée sur la populationdéplacée. Cette analyse repose également sur une approche du contexte historique quipermet de saisir les enjeux de ces villages stratégiques au moment où ils ont étéconstruits, ce qui permet de proposer une réflexion exploratoire relative à la portée,sur la longue durée, de ce type de programme.
L’urbanisation forcée au cœur des politiques decontre-insurrection
8 Le décret n°261/75 (1975) marque le début de l’Opération Indépendance au sud de
Tucumán. L’objectif est explicite : éliminer la guérilla rurale « Compañía de Monte Ramón
Rosa Jiménez » rattachée à l’Armée révolutionnaire du peuple (ERP) – bras armé du Partirévolutionnaire des travailleurs (PRT). À la différence du reste de l’Argentine, àTucumán, il y a eu une coexistence forcée de la population avec l’armée : des couvre-feux se sont succédés, des perquisitions ont été menées dans les maisons, ainsi que desopérations de quadrillage ; il y a eu des actions punitives publiques, des détentionsmassives dans les villages et des bases militaires ont été installées dans la région.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
80
1. Carte de l’occupation militaire sud-ouest de la province de Tucumán.
La plupart des données utilisées pour élaborer cette carte proviennent du journal d’Acdel Vilas (1977),commandant de l’Opération Indépendance en 1975.
Carte élaborée par l’auteure.
9 La dictature militaire en Argentine (1976-1983) a sans doute été marquée par la figure
du disparu 14. Le Centre clandestin de détention a joué un rôle central comme dispositifspatial pour articuler le processus de disparition forcée 15. Cependant, les militaires ontégalement eu recours à des méthodes moins connues pour désarticuler le mouvementrévolutionnaire qui s’implantait alors dans la société : les Plans d’action civique. Dès ledébut de l’Opération Indépendance, on en trouve des références explicites : « Lesopérations militaires en zone montagneuse seront suivies par des actionsgouvernementales concrètes, principalement en matière d’assistance sociale,susceptibles de mettre un frein de la sorte à n’importe quelle tentative desubversion 16 ». Les programmes d’action civique avaient plusieurs volets tels que ladistribution d’aliments et des travaux publics : construction d’hôpitaux, d’écoles, deroutes et de villages stratégiques.
10 La nouveauté du programme des villages stratégiques ne réside pas seulement dans
l’urbanisation forcée à laquelle sont soumis les paysans, mais au fait qu’il est mené dansle cadre de modèles d’urbanisation, conçus et élaborés ex-nihilo par les militaires. Ilimporte de signaler, d’autre part, que les villages stratégiques ont été utilisés pourreprendre des territoires contrôlés par la guérilla et, en même temps, pour produiredes reconfigurations de l’organisation spatiale et sociale là où ils ont été implantés etdans les environs.
11 À partir du concept d’urbicide, des chercheurs ont tenté de penser comment la ville
pouvait s’ériger en cible à détruire, en objectif de la violence 17. La nouveauté théoriqueà laquelle nous confronte ce programme militaire est qu’il n’y a pas dans ce cas de« lutte » contre la ville ou dans la ville – comprise dans son acception culturelle etcomme mode de vie –, mais avec la ville. L’urbanisation est utilisée comme un
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
81
instrument contre-insurrectionnel en soi 18. En dépit de la petite échelle des espacesconcernés par ce programme, l’intention de l’État est claire : il s’agit d’urbaniser lespaysans et d’incorporer ces territoires à un réseau d’espaces urbains sous contrôle.
12 Dans les stratégies contre-insurrectionnelles, la destruction est souvent accompagnée
d’importantes « politiques de développement 19 » : les villages stratégiques sont unexemple clair de ce processus à deux faces : destruction et construction. La périodependant laquelle le général Bussi a gouverné de facto la province (de mars 1976 àdécembre 1977) s’est justement caractérisée par l’importance des travaux publicsréalisés, avec pour objectif « d’améliorer » les conditions socio-économiques de lapopulation affectée 20. Des années plus tard, un des fils de Bussi pouvait ainsi affirmer :« mon père a été invité par l’armée nord-américaine en qualité d’observateur militaireau Vietnam. C’est là qu’il a appris que, dans ce type de guerre de guérilla, le soutien dela population est fondamental. Là où est le soutien de la population, là est la victoire etil a vu que les Américains n’avaient pas le soutien de la population […] Ce que mon pèrea fait, c’est mener une action civique, une action politique, très forte dans la région, entermes d’infrastructure, de soutien à la population, quatre nouveaux villages ont étécréés 21 ». Et en 1995, dans le cadre d’élections démocratiques, Bussi a été élugouverneur de la province de Tucumán pour quatre ans, ce qui témoigne de laprégnance du soutien de la population.
2. Inauguration du village Teniente Berdina, en présence de Videla et de Bussi lors de la cérémonie,1977.
Album de photos de Teniente Berdina, 2014 22.
13 Ainsi, l’analyse du programme militaire des villages stratégiques permet d’explorer
d’autres modalités de la violence d’État, au-delà de l’assassinat et de la destructiond’espaces de vie, et de relever l’objectif consistant à produire de nouveaux citoyens etde nouveaux espaces de vie de manière forcée, l’État imaginant et planifiant des sitesidéaux dans lesquels la guérilla ne peut exercer aucune influence ni se réimplanter.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
82
Au sein des villages stratégiques
À propos de la construction d’espaces de vie et de non-vie
14 Vider le maquis. Voilà l’objectif clairement brandi à l’arrivée des militaires en 1975. Il
fallait combattre la guérilla rurale et, en même temps, faire en sorte que le monte soitinhabitable : « le vider, pour éviter que la population aide la guérilla ou ne soit recrutéepar celle-ci : les guérilleros venaient recruter des gens » (G.) ; « ils ont fait des villages àcause des extrémistes » (D.) ; « le village a été fait à cause des circonstances, c’est grâceaux guérilleros, Bussi ne l’aurait pas fait autrement » (F.) ; « l’idée des villages estapparue parce qu’il y avait les extrémistes, la vérité c’est que tout ça c’était des maquis,et ils les ont fait [les villages] parce qu’ils voulaient éliminer tout ça » (H.) ; « lesmilitaires nous ont réunis parce que ça les intéressait de faire bouger ceux qui étaientdispersés » (G.).
15 Vider le territoire, regrouper la population dans la plaine, éliminer les éléments
subversifs. Le maquis était l’espace que la guérilla rurale de l’ERP utilisait dès 1973 pourinstaller ses campements 23. Comme un « bouclier naturel », la végétation luxurianteempêchait que les campements de la guérilla rurale soient identifiés à l’œil nu. Laproximité avec les villages, qui avaient une longue histoire de mobilisations socialesderrière eux, offrait la possibilité de compter avec le soutien de la population civile, quece soit en termes de nourriture, de refuge ou de recrutement. C’est pourquoi, dans lecadre de l’Opération Indépendance, les militaires ont basé leur action sur l’idée selonlaquelle le maquis constitue un territoire à partir duquel la guérilla tente de mettre enéchec la souveraineté nationale 24.
16 La loi qui décrète le déplacement de la population précise que « la dispersion des
habitants dans cette zone rurale en rend difficile le contrôle pour les forces desécurité 25 ». Les déplacements concernent une population perçue par les militairescomme éparpillée, isolée, lointaine et non soumise à leur contrôle. Déplacer les paysansvers de nouvelles localités devait ainsi permettre d’exercer un contrôle « plusrigoureux » afin de les maintenir en dehors de l’influence de la guérilla.
17 Pour les déplacés, la sensation est contradictoire. Avec les villages arrive l’espace
urbain, jusque-là socialement inaccessible. Au demeurant, les militaires ne lesemmènent pas à la ville : ils construisent des villages à proximité de là où ils vivent. Lesmilitaires leur apportent « la ville », « la civilisation », la propriété privée, lesinstitutions bourgeoises, le contrôle et la surveillance, mais tout cela à la frontière dumaquis. De ce point de vue, il faut tenir compte de l’importance du territoire où cesvillages ont été bâtis.
18 Le Plan de relogement rural a modifié radicalement l’usage de l’espace dans cette zone.
Le maquis – caractérisé par sa végétation sauvage – a été vidé et, en parallèle, descentres urbains ont été construits sous contrôle militaire. L’emplacement des villageset de la route ont été choisis de manière stratégique. Dans ce sens, il faut signaler que laconstruction matérielle et symbolique de frontières n’est pas une stratégie nouvelle ausein des forces armées mais remonte au travail « civilisateur » entrepris pendant lafondation de l’État argentin 26. L’État a fait face au monte de Tucumán en ayant recoursnon seulement aux arguments propres à la doctrine contre-insurrectionnelle mais aussien réactualisant de vieux récits sur le processus « civilisateur » contemporains de laformation de la Nation. La campagne militaire appelée la « Conquête du désert »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
83
(menée à la fin du XIXe siècle en Argentine) a eu comme objectif de conquérir des
territoires qui étaient jusque-là sous le contrôle des peuples autochtones. Or cesespaces ont été imaginés, mis en récit comme autant d’espaces vides, et s’est ainsi qu’ilsont été occupés. Acdel Vilas, dans une autre partie de son Diario de Campaña, signaleque : « le 14 février 1975 [,] l’armée argentine [,] affrontait de nouveau, après cent ansde paix, un ennemi de la Patrie : le plus dangereux, si on le juge comme il faut, [car] lemarxisme ébranle les racines fondamentales de notre culture, et porte atteinte à notreindépendance 27 ».
19 Ces correspondances entre vieux espaces (« le désert ») et nouveaux espaces (le
maquis), entre vieux récits (la conquête) et nouveaux récits (la lutte contre lasubversion marxiste) résonnent et s’entremêlent. Les militaires ont lutté pour imposerl’image de la « nation récupérée » et celle de la « geste héroïque ». Ils ont regardé enarrière pour construire une identité et ont inscrit leurs actions dans la longue durée quiremonte aux origines violentes de l’État-Nation argentin. La réorganisation spatialeproduite dans le cadre du Plan de relogement rural récupère ce temps long qui renvoieaux discours civilisateurs du XIXe siècle tout en mobilisant les discours contemporains
de la contre-insurrection dans le cadre de la guerre froide.
20 La construction des villages stratégiques reconfigure radicalement un territoire
« rebelle » considéré par l’État comme celui qui pouvait mettre en péril la souveraineténationale. L’objectif était à la fois de faire en sorte que les paysans quittent le maquismais aussi de leur prendre le maquis. Des espaces de vie sont construits – les villagesstratégiques – mais on construit aussi, en parallèle, des espaces de non-vie – le maquisest vidé de force.
Mobilités restreintes : surveillance de l’espace et de ses habitants
21 Quatre villages ont été ainsi construits entre 1976 et 1978, dans la province de
Tucumán, dans un rayon de 30 kilomètres, puis reliés entre eux par la route 324,construite à la même période [voir image 3]. La construction de chaque village a duréun an environ et une grande partie des hommes déplacés a travaillé comme ouvriersdans les chantiers. Environ deux mille personnes auraient été contraintes audéplacement 28. En 2014, quatre mille personnes environ y vivaient encore. Les quatrevillages sont pratiquement identiques, aussi bien du point de vue des éléments qui lescomposent que de leurs dimensions. Au début chacun comprenait six pâtés de maisonsde soixante-dix logements, un centre civique où étaient situés la Mairie, labibliothèque, l’épicerie, le commissariat, l’église, le centre commercial, un centre desoins (avec un médecin généraliste et un dentiste), ainsi qu’un complexe sportif, uneplace, une zone industrielle, des maisons destinées aux fonctionnaires et des cabanespour les touristes. Au moment de l’inauguration, un certain nombre de services publicsétaient assurés tels que l’éclairage public, la lumière électrique, l’eau courante, les ruespavées, les transports en commun qui assuraient les liaisons avec les autres villages etle reste de la région. Par ailleurs, là où les villages ont été construits, les militairesavaient installé des bases militaires dès les débuts de l’Opération Indépendance.Certaines de ces bases seront par la suite dénoncées comme des Centres clandestins dedétention.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
84
3. Carte avec les quatre villages construits entre 1976 et 1978, dans la province de Tucumán, reliésentre eux par la route 324, construite à la même période.
Carte élaborée par l’auteure.
4. Plan du village Soldado Maldonado.
Source : Cadastre de la Province de Tucumán
22 La présence des bases militaires est contemporaine de la période de construction des
villages mais aussi de celle où les villages ont commencé à être habités. On ne sait pasvraiment à quel moment les bases ont été démantelées. Mais des témoignages signalent
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
85
que jusqu’au retour de la démocratie, en 1983, quelques militaires sont restés pour« veiller » sur les villages.
« Ils étaient postés là, sur le bord de la route, dans un fossé, et au cri de “qui va là !”,fallait que tu donnes ton nom » (I.)« À cette époque, on ne pouvait pas sortir le soir, il y avait des barrières dans la rueen direction de “la cheminée” 29, fallait s’identifier à chaque fois qu’on voulaitpasser par là » (C.)« On ne pouvait pas sortir sans être vu, on devait prévenir et avoir ses papiers » (J.)« Après 20h, on ne pouvait plus sortir, parce qu’il y avait des ratissages. Tout lemonde devait être à la maison à cette heure-là » (I.)
23 Un habitant raconte qu’il n’a pas été facile de s’habituer à la vie au village : « on devait
se coucher tôt, la nuit il n’y avait plus personne, il fallait demander une permissionpour sortir et prendre une lampe à pétrole pour qu’ils sachent que c’était nous » (F.).Un autre homme raconte que : « pour sortir et rentrer dans le village, on devaitprévenir la base, s’identifier, donner les motifs, dire où on vivait, où on allait ; tout letemps, fallait donner son nom, son prénom et le numéro de la carte d’identité » (I.). Lesvillageois signalent aussi que les militaires avaient fourni des cartes pour pouvoir sortiret rentrer au village, et il fallait la présenter à chaque fois qu’il y avait un contrôle :« cette carte a été donnée à tout le monde pour prouver qu’on était bien d’ici et pourpouvoir circuler aux alentours » (C.). Une sorte de seconde pièce d’identité liée non auterritoire national mais à l’espace d’exception. Des laissez-passer pour certifier que lesvillageois avaient bien le « droit » d’être là. Le système de contrôle instauré dans cesvillages remplissait bien les critères fournis par le colonel Roger Trinquier concernantles villages stratégiques créés pendant la guerre d’Algérie :
« Les habitants ne pourront quitter le village que par des portes où toutes les sortiesseront contrôlées ; ils ne pourront emporter avec eux ni argent, ni ravitaillement.La nuit, personne ne pourra quitter le village ou y entrer. Nous rétablirons ainsi levieux système des villages fortifiés du Moyen-âge, destinés à protéger les habitantscontre les “grandes bandes” 30 ».
24 Le contrôle sur la mobilité intérieure et extérieure des villages s’appuyait sur une
connaissance exhaustive de la population et la possibilité de dire qui est qui, qui faitquoi, qui vit comment. L’antécédent immédiat de ce type de contrôle se trouve dans lerecensement de la population réalisé dans la zone d’opérations dès le début del’Operativo Independencia 31. Le recensement a permis d’identifier une partie de lapopulation pour la soumettre au contrôle de l’État : du fait du lieu de résidence, cegroupe constitue un nouveau groupe spécifique soupçonné a priori d’avoir des liensavec la guérilla. L’espace apparaît tout à la fois comme stigmatisant et comme facteursuffisant pour semer le doute (ce recensement n’a été mené que dans la zone sud-ouestde Tucumán et parmi les personnes qui vivaient « trop près » du maquis). Cerecensement travaille avec des données susceptibles de permettre des enlèvements, etétablit aussi un stéréotype de la personne qui pourrait être liée à la guérilla. Ainsi, lerecensement non seulement « produit » une population mais sert en même temps àréinscrire ces sujets – et leurs pratiques – au sein de coordonnées géographiquesdéterminées et accessibles. À travers une vieille technique de contrôle de population,les militaires réussissent à situer les sujets et, en parallèle, à les rendre visibles et àsuivre leurs actions. La population « choisie » pour être déplacée vers les villagesstratégiques a été soumise sans exception à ce type de pratiques. Dans un rapportconsacré aux deux premières années de gouvernement militaire à Tucumán, on lesignale clairement : « Une fois complété le recensement de la population dans la Zone
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
86
d’opérations antisubversives, le gouvernement provincial a initié le “Plan derelogement rural”, qui a eu pour finalité : assurer l’accès à la propriété privée pouraméliorer les conditions de vie et éduquer les villageois de la zone sur les bénéfices dela vie en communauté 32 ».
25 La surveillance ne concerne pas seulement les usages et la circulation dans l’espace
mais aussi la manière dont la population l’occupe. Un espace construitgéométriquement pour être facilement contrôlé et une nouvelle population choisie etutilisée comme source d’expérimentation pour participer à un programme où se mêlentcréation ex nihilo d’espaces urbains, utopie du contrôle total et des programmes dedéveloppement social. Autant d’éléments qui soutiennent un plan expérimental : lecontrôle et la surveillance sur le sujet et son espace, mais en même temps celui de lacréation de citoyens et d’espaces de vie par la coercition 33.
26 En étudiant les politiques contre-insurrectionnelles appliquées par les États-Unis en
Afghanistan, Oliver Belcher signale que « le rôle de la population déplacée au sein duplan stratégique de contre-insurrection, je le comprends comme faisant partie de ladestruction (ou “nettoyage”) des mondes-de-vie aux seules fins de reconstruire des“modes-de-vie” en accord avec l’ordre politique contre-insurrectionnel 34 ». Plus loin, ilajoute : « ce n’est pas seulement le déplacement mais aussi la ré-forme de modes-de-viesusceptibles d’être adaptés à la surveillance, documentation et prédictibilité 35 ». Leprogramme des villages stratégiques apparaît comme la création forcée et ex nihilo demondes-de-vie qui prétendent créer des modes-de-vie. L’État imagine des espaces oùdes citoyens sont fabriqués sur mesure. Des mondes-de-vie inventés qui modifient,créent, et imposent des modes-de-vie particuliers. Le monde urbain est choisi pourcréer des espaces de vie ascétiques, d’où la possibilité de la révolution est bannie.
La vie sous contrôle : violences sur la vie quotidienne et sesespaces
27 Du fait qu’il travaillait pour la sucrerie Providencia, K. avait la possibilité de vivre dans
la Colonie 5 avec sa famille. Au milieu de cet ensemble de logements en bois, destinésaux travailleurs du sucre, les militaires ont installé une base militaire. Des mois plustard, la Colonie 5 a été détruite et ses habitants conduits au nouveau village appeléSargento Moya. K. se rappelle ce premier moment de l’occupation, alors qu’il vivaitencore dans la Colonie 5, en « cohabitation » avec les militaires : « Nous utilisions leslatrines et il fallait aller aux toilettes avec tes papiers et laisser la porte ouverte avec lesmilitaires qui te pointaient » (K.) 36. L’intromission dans la vie privée commence avecl’installation de la base militaire et se poursuit une fois les villages construits et habités.Les forces armées luttent non seulement pour conquérir le territoire occupé par laguérilla rurale, mais s’immiscent également, de façon simultanée, dans des lieux privéset l’intimité.
28 Dans l’espace ordonné et géométrique du village, la violence continue à s’exercer
quoique sous des modalités plus indirectes. Les villages stratégiques se construisentpour entraîner et discipliner des corps considérés comme « indociles ». M. fait une listedes obligations auxquelles les habitants de son village étaient tenus : « à six heures dumatin, il fallait hisser le drapeau et chanter l’hymne national ; à six heures du soir, tousles jours, fallait aller à la messe ; des “réunions d’information” avaient lieu avec lesmilitaires ; chaque personne avait des tâches différentes relatives à l’entretien et au
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
87
fonctionnement du village ; tous les jours, dès 9 heures du matin, les enfants de plus desix ans et jusqu’à treize ans devaient faire du sport 37 ; les femmes étaient chargéesd’activités manuelles ou devaient apprendre à tricoter, faire du crochet, couper lescheveux, coiffer, etc. » (M.). Des espaces et des temporalités consacrés à la réinventiondu « bon » citoyen, de la femme et de l’enfance « vertueuses ». Une cité et des citoyens« modèles » au service des politiques contre-insurrectionnelles.
5. Image aérienne du village Teniente Berdina.
Source: s/a, Dossier de gestion du gouvernement. 1976-1977 Tucumán, berceau de l’Indépendance,Gouvernement de Tucumán, 1978.
29 Afin de vivre dans un de ces nouveaux espaces urbains à proximité du maquis, les gens
ont dû soumettre leurs pratiques les plus quotidiennes à une régulation stricte et ontété forcés de changer de nombreuses habitudes. Ainsi, il était interdit d’emporter desanimaux dans les nouveaux villages, les militaires obligeaient les gens à cuisiner d’unecertaine manière, il n’était pas possible de modifier l’aspect des nouvelles maisons, toutdevait « être propre ». La présence « d’assistantes sociales » dans tout le processus dedéplacement et de relogement est souvent signalée dans les entretiens, y compris unefois que les personnes se sont installées dans les villages : « une assistante sociale venaitnous dire comment il fallait s’occuper de la maison, par exemple on ne pouvait pas fairedu feu » (L.). Le contrôle continue bien après que les villages soient inaugurés.« Lorsque nous sommes arrivés on ne pouvait pas avoir des poules dans la maison nisemer. Si nous voulions semer, il fallait une autorisation spéciale » (C.). Le contrôlen’existe pas seulement dans le tracé même de l’espace de vie mais aussi dans la manièredont il faudra l’occuper, la manière dont il faudra l’habiter. Le contrôle sur la viequotidienne se déploie à l’intérieur et à l’extérieur des limites du foyer. La maison esttoujours en alerte car des contrôles peuvent y avoir lieu à tout moment.
30 Cette volonté de créer un nouveau type de citoyen est révélée avec éloquence par
l’épisode des mariages forcés organisés par les militaires. Pour avoir le titre depropriété de la maison, les couples devaient être mariés mais une grande partie ne
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
88
l’était pas. Devant cette situation, les militaires procédaient à des mariages massifs. Unefemme raconte qu’avant l’inauguration de son village, il y a eu soixante mariages forcéset que des curés venaient exprès marier les gens (N.). Ces mariages massifs et forcéspermettent d’inscrire dans les registres de l’état civil (et religieux) des individus dontles trajectoires de vie n’étaient pas répertoriées par l’État national et catholique. Lesvillages stratégiques sont des espaces de production de citoyenneté forcée et contrôlée.
La violence dans l’appellation
31 Une épopée militaire est créée autour de ces hommes « héroïques » qui auraient donné
leur vie pour la patrie (Teniente Berdina, Soldado Maldonado, Capitán Cáceres etSargento Moya) et qui donneront, de ce fait, leur nom aux villages. Actuellement, lesvillages ont toujours les mêmes noms et, devant les tentatives timides des hommespolitiques locaux pour les modifier, les habitants n’hésitent pas à exprimer leurdésaccord : « je suis contre le fait de changer les noms des villages car ce serait uneforme d’oubli. Le militaire qui a donné son nom au village a donné sa vie pour que nousayons une maison. Si les Anglais ne doivent pas enlever les croix des Iles Malouines, icic’est pareil » (Q.).
32 Le contrôle sur les noms des lieux ne se limite pas à l’espace des villages mais aussi à
leurs habitants. P., une femme de 57 ans, qui est allée à l’école et a pu finir ses étudesprimaires, me raconte qu’ils sont arrivés dans le village en 1977 et que leur fils est nédeux mois plus tard. Ce fils a été le premier nouveau-né du village. Ils l’ont inscrit avecle nom de son mari mais les militaires : viennent et me disent « il va falloir changer lenom du bébé car c’est le premier ». Elle explique que le mari est allé à la Mairie (commecela lui avait été indiqué par le sous-lieutenant) mais à la Mairie on lui a dit que s’ilétait déjà inscrit sous un nom on ne pouvait pas changer. Alors les militaires nous ontfait un papier, et avec ce papier nous avons changé le nom du petit. La femme préciseque le militaire qui est mort s’appelait de la sorte, que le village s’appelle ainsi de lamême manière et que c’est à cause de cela que son premier fils a un prénom et deuxnoms de famille : celui du militaire puis celui de son père. Je lui demande ce qu’ellepense du fait qu’on l’ait obligé à changer le nom de son fils : « c’est bien parce qu’ils ontparticipé et ils m’ont aidé avec les vêtements. Ils passaient tous les jours voir si ça allait,ils venaient voir le petit. Nous sommes passés à la radio, à la télé, dans le journal... »Dans d’autres entretiens, il a été signalé que le général Bussi en personne a été leparrain des premiers enfants nés dans ces villages. Ainsi, l’État non seulement rêvait decréer des espaces de vie et de nouveaux citoyens mais engendrait, presquelittéralement, des espaces et des sujets, en créant des filiations forcées. Le contrôle surle nom donné au premier nouveau-né dans chaque village signale justement les modessous lesquels s’exprime la volonté « créatrice » de certaines violences déployées parl’État.
33 Comme on peut le déterminer dans le récit de P., mais aussi dans ceux d’une grande
partie du reste des habitants, s’expriment des tensions au moment de la narration deces expériences où se mêlent la violence vécue mais aussi une manière d’exprimer sa« gratitude » aux militaires pour « tout » ce qu’ils ont donné. En ce qui concerne ceconflit des affects qu’articule le récit des déplacés, il est impossible de comprendrel’impact de la construction des villages stratégiques sans penser à leur impactémotionnel. Revaloriser le point de vue affectif de l’espace permet d’appréhender la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
89
manière dont celui-ci affecte l’expérience humaine 38. Yael Navarro-Yashin, qui appuieson analyse sur un travail ethnographique sur les maisons chypriotes que les Turcshabitent après l’occupation, remarque le fait que « les ruines politiques – ici les restesde la guerre – provoquent des affectivités conflictuelles et complexes. Je soutiens quel’affect doit faire l’objet de recherches non seulement pour autant qu’il fait partie ouémerge de la subjectivité humaine (ou de l’individu), mais aussi comme étant le produitd’engagements politiques qui se produisent dans l’espace et dans l’entrelacement dematérialités 39 ». Ce cadre théorique permet d’appréhender la façon dont se produisentet transmettent des affects de manière relationnelle entre les espaces construits par lesmilitaires et les gens qui y vivent.
34 Il est pertinent de considérer ces réflexions pour aborder de manière critique, par
exemple, les souvenirs des habitants de leurs premières impressions de l’arrivée auxvillages stratégiques : « C’était tellement beau, ça a été impressionnant […] Pour nous,c’était une ville » (O.) ; « Tout était beau, asphalté, il y avait de l’eau, des salles de bain »(I.) ; « Au début c’était comme si nous étions allés vivre à Buenos Aires, tout était beau »(H.). Les déplacés interprètent leur arrivée aux villages comme un moment charnièrede leur expérience vitale, le passage de la campagne à la ville. Le village se présentecomme un « progrès » vu qu’il permet d’avoir accès à des choses qui étaient autrefois« inimaginables » pour eux. L’analyse de ce type de références permet d’accéder et, enmême temps de conserver, le caractère conflictuel et en apparence contradictoire durécit des déplacés. Au sein de leurs récits coexistent ainsi des éléments qui fontréférence à la violence du déplacement et à des appréciations positives concernant lefait d’avoir une maison à soi et de vivre en milieu urbain. Par exemple, quand cespersonnes décrivent leur vie antérieure, elles évoquent le fait qu’il fallait utiliser del’eau de puits, des lampes à pétrole, que pour faire des achats elles devaient faire deskilomètres (quand elles pouvaient le faire et n’étaient pas isolées par la montée deseaux). « Avant on vivait dans le noir » (O.).
6. Photographie de l’entrée du village Soldado Maldonado, 2014.
Source : cliché de l’auteure.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
90
35 Cependant, cette nouvelle disposition des sujets dans l’espace, la proximité que le
village impose entre une maison et une autre, changent la dynamique des relationssociales entre paysans qui ne sont pas habitués à cette proximité des uns avec lesautres. Dans le rapport militaire qui fait état des travaux publics réalisés pendant cettepériode, il est signalé qu’il a fallu « éduquer les habitants de la zone à propos desbénéfices de la vie en communauté 40 ». Le village fait irruption et change radicalement– entre autres – les manières d’établir des liens sociaux, l’usage de l’espace, lesdistances, les temps pour réaliser les tâches de la vie quotidienne…
Réflexions finales : dompter les espaces, un rêve del’État
36 La formule trouvée par les militaires semble avoir été de modeler des sujets « civilisés »
qui habitent dans des espaces urbains « idéaux ». Des violences qui non seulementdétruisent et font disparaître des modes de vie, mais qui créent et engendrent despatrimoines : les villages stratégiques sont un exemple de patrimoine encombrant etpresque invisible que la société argentine a hérité de l’époque de la dictature, mais donton sait peu de choses.
37 Ordonner l’espace, l’urbaniser, faire en sorte que des sujets totalement éloignés des
institutions de l’État deviennent des citoyens, leur donner l’accès à la propriété privée,sont quelques-uns des éléments de la vie « moderne et civilisée » qui – selon le discoursmilitaire – devaient assurer un changement radical dans la société. À traversl’urbanisation forcée, les militaires ont cherché à contrôler la population mais aussi àcréer un type de citoyen particulier. Processus bicéphale où l’État fait disparaître despersonnes « subversives » et construit des citoyens de manière forcée.
38 Afin de désarticuler et d’annihiler l’espace où quelque chose de nouveau était en train
de naître, il fallait réaménager de manière radicale l’espace : il fallait déterritorialiser lapossibilité de la révolution. « Ceux qui vivaient dans le monte, dans le maquis, ceux-là ilsont été “bannis” » (D.). On ne prive pas les paysans de n’importe quel espace, mais decelui où est en train de se forger la possibilité d’une révolution. Vidé et séparé du restedes espaces habités, l’État a réincorporé le maquis à ses territoires. La présence dupouvoir de l’État peut opérer et exister à partir du vide. L’État se construit et disciplineaussi grâce à ces espaces qu’il laisse inoccupés. Dans ce cas, la sphère d’influence de sonpouvoir s’amplifie à partir de l’opération consistant à vider le maquis 41. « Ici ce n’étaitqu’un hameau perdu au milieu des maquis, ils sont venus, ils ont modifié et nous ontfait vivre de manière civilisée » (M.). Le maquis, cet espace « autre », sauvage, nonurbain 42, devient l’espace à partir duquel on mesure l’amélioration du monde urbainfabriqué par le militaire. Avec le programme des villages stratégiques on détruit pour« sauver », on construit ex novo pour inventer un citoyen là où on tue et où on faitdisparaître d’autres personnes. Ce programme rend habitables certains espaces etd’autres inhabitables. L’objectif n’est pas seulement d’annihiler un certain groupe avecune orientation politique contraire à celle de l’État mais aussi de détruire les conditionsd’émergence de ce mouvement. Les villages stratégiques reconfigurent des espaces devie, altèrent les identités et les habitudes de ceux qui seront forcés d’y vivre. Devant lamenace de l’ennemi intérieur, l’État planifie des espaces forcés de vie, où il imagine la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
91
modernisation des paysans, l’urbanisation de la zone et, surtout, le démantèlement duprojet révolutionnaire.
39 La personne citée au début de cet article, qui raconte comment les militaires l’ont
arrêtée alors qu’elle marchait au-delà du périmètre autorisé, et dont le mari disparaîtrapendant une semaine, précise aussi au cours de l’entretien : « il faut dire que lesmilitaires ont fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Une des bonnes choses ça aété de civiliser les gens, de nous donner l’électricité, l’eau, les rues pavées, des chosesqu’on ne pensait jamais avoir. Avant, ici, c’était le monte et personne n’y entrait. Maisils ont fait de mauvaises choses aussi » (M.). À la différence d’autres applications duprogramme des villages stratégiques (comme ce fut le cas au Vietnam où le programmea été rejeté par la population), en Argentine, même en 2016, quarante ans après leurconstruction, les villages sont là, les gens n’en sont pas partis, ils sont restés. Leshabitants ne veulent pas changer le nom des villages et ils remercient les militaires deleur avoir donné une maison.
40 Ce que le programme des villages stratégiques met à l’œuvre c’est une tentative
extrême de gouverner les corps et les lieux de la vie quotidienne. Les villagesmatérialisent une utopie du contrôle total à partir de la réécriture des formes de vie. Ense basant sur un travail ethnographique avec les habitants, cet article a explorécertaines modalités de cette violence, son déploiement, sa circulation à l’intérieur desvillages. L’analyse des villages stratégiques permet d’examiner un espace de violenceétatique qui constitue, en même temps, un instrument de contre-insurrection et unespace de production d’une citoyenneté – docile et « civilisée ».
NOTES
1. Monte, en espagnol : désigne une zone de relief à la végétation luxuriante. Proches du
« maquis » dans tous les sens du terme puisque, du fait des caractéristiques de la végétation, ces
lieux ont pu être utilisés par la guérilla pour établir ses campements comme on le verra plus loin
dans le texte.
2. Estaqueados : pratique qui consiste à immobiliser le prisonnier par terre, bras et jambes écartés,
retenus par des pieux.
3. Au cours des entretiens, il a été décidé qu’ils seraient anonymisés. Les noms ont ainsi été
remplacés par des lettres attribuées au hasard. On ne donnera pas non plus les noms des villages
où vivent les personnes interviewées afin de protéger leur identité. Étant donné le caractère
sensible des thèmes traités, les entretiens n’ont pas été enregistrés. Les extraits qui figurent ici
sont restitués à partir des notes de terrain prises durant et immédiatement après l’entretien.
4. Colombo P., Espacios de desaparición. Espacios vividos e imaginarios tras la desaparición forzada de
personas (1974-1983) en la provincia de Tucumán, Argentina, thèse de doctorat en sociologie, non
publiée, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2013.
5. L’idée de « gagner les cœurs et les esprits » a été appliquée pour la première fois dans un
contexte de lutte antisubversive en Malaisie à la fin des années 1950 et elle est attribuée au
général britannique Sir Gerald Templer (Egnell R., « Winning “Hearts and Minds”? A Critical
Analysis of Counter-Insurgency Operations in Afghanistan », Civil Wars, vol. 12, n°3, septembre
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
92
2010, pp. 282–303). Pour un travail critique sur la généalogie de cette maxime voir Olsson C.,
« Guerre totale et/ou force minimale ? Histoire et paradoxes des “cœurs et des esprits” », Cultures
& Conflits, n°67, 2009, pp. 35-62.
6. C’est en Malaisie qu’aurait eu lieu la première application de cette stratégie militaire, dirigée
par le général Sir Gerald Templer (Karl Hack, « Malaya – Between Two Terrors: “People’s History”
and the Malayan Emergency », in Gurman H. (ed.), Hearts and minds. A people’s history of
counterinsurgency, New York and London, The new press, 2013, pp.17-49).
7. Pour une première approximation historique des différentes applications du programme, on
peut consulter le travail pionnier de Sackley N., « The village as Cold War sites: experts,
development, and the history of rural reconstruction », Journal of Global History, n°6, 2011,
pp. 481-504. Pour une généalogie de la répression militaire, en particulier sur le mode
transnational du déploiement des politiques antisubversives, voir : Wasinski C., « La volonté de
réprimer », Cultures & Conflits, n°79-80, automne-hiver 2010, pp. 161-180.
8. Sackley N., op. cit. ; Tenenbaum É., « Les déplacements de populations comme outil de contre-
insurrection : l’exemple du programme des hameaux stratégiques au sud-vietnam », Guerres
Mondiales et conflits contemporains, 3(239), 2010, pp. 119-141 ; Sacriste F., Une histoire de l’État
colonial et de la société rurale pendant la guerre d’indépendance algérienne 1954-1962, Thèse en histoire,
Université de Toulouse 2 Le Mirail, 2014.
9. Belcher O., The afterlives of counterinsurgency: postcolonialism, military social science, and
Afghanistan 2006-2012, thèse de doctorat en géographie, The University of British Columbia, 2013 ;
Tyner J., War, Violence, and Population. Making the Body Count, New York, The Guilford Press, 2009.
10. Stepputat F., « Politics of Displacement in Guatemala », Journal of Historical Sociology, vol. 12,
n°1, 1999, pp. 54-80.
11. Forensic Architecture Group, « The earth Scorched: Environmental Violence and Genocide in
the Ixil Triangle, Guatemala, 1980-1983 », in Forensis, The Architecture of Public Truth, Berlin,
Sternberg Press and Forensic Architecture, 2014.
12. Sur le cas français : Cornaton M., Les regroupements de la décolonisation en Algérie, Paris, Éditions
Économie et Humanisme / Les Éditions Ouvrières, 1967 ; Galula D., Contre-insurrection. Théorie et
pratique, Paris, Economica, 2008 ; Trinquier R., La Guerre Moderne, Paris, Economica, 2008. Sur le
cas britannique : Thompson R. G. K., Defeating communist insurgency: the Lessons of Malaya and
Vietnam (Studies in International Security No. 10), New York, FA Praeger, 1966.
13. Les paysans n’avaient pas de titres de propriété de ces maisons.
14. Calveiro P., Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Colihue,
2001. Version en langue française : Calveiro P., Pouvoir et diparition, les camps de concentration en
Argentine, Préface de Franco M., Postface de Benasayag M., Paris, La Fabrique, 2006 (trad.
Taudière I.) ; Feierstein D., El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. Version en langue française : Feierstein D., Le
génocide comme pratique sociale. Entre le nazisme et l’expérience argentine, Genève, MétisPress, 2013
(trad. Périès G.) ; Gatti G., Identidades desaparecidas. Peleas por el sentido de los mundos de la
desaparición forzada, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011 ; Jelin E., Los trabajos de la memoria,
Madrid, Siglo XXI, 2002.
15. Le nombre de disparus dans la province reste incertain : le rapport de la Commission
bicamérale de Tucumán fait état de trois cent quatre-vingt-sept personnes disparues et de cent
vingt survivants, tandis que les organismes de droits de l’homme parlent d’environ mille et deux-
mille personnes dans toute la province.
16. Déclaration du secrétaire de presse et de diffusion du gouvernement provincial J. Villone,
dans le journal La Gaceta, 12 fév. 1975 (cité dans Artese M. et Roffinelli, G., « Responsabilidad civil
y genocidio. Tucumán en años del “Operativo Independencia” (1975-76) », Documentos de Jóvenes
Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, n°9, 2005,
p. 38). Voir aussi l’article 5, du décret N261/75.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
93
17. Coward M., Urbicide. The politics of urban destruction, New York, Routledge, 2009 ; Graham S.,
« Chapter 10. Constructing Urbicide by Bulldozer in the Occupied Territories », in Graham S.
(ed.), Cities, War, and Terrorism. Towards an Urban Geopolitics, Malden, Blackwell Publishing, 2004,
pp. 192-213.
18. Selon Sackley N. : « Bien qu’ils aient été promus comme des communautés modèles faites
pour gagner les cœurs et les esprits des villageois à travers l’assistance d’experts et la protection
des militaires, les villages stratégiques, qui renferment des paysans relogés de force à l’aide de
barbelés et de patrouilles de défense civile, ont été fondamentalement des instruments de
guerre. » (Sackley N., op. cit., p. 483).
19. Belcher O., op. cit.
20. Voir González Bread E., La guerrilla en Tucumán. Una historia no escrita, Buenos Aires, Circulo
Militar, 2001.
21. Ramos Ramírez A., « Bajo el amparo de la democracia: el bussismo, de la Casa de Gobierno a
los tribunales », XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional , sept. 2010,
Santiago de Compostela, Centro Interdisciplinario de Estudios Americanistas Gumersindo Busto,
Consejo Español de Estudios Iberoamericanos, p. 1754.
22. La photo figure dans un album dans lequel les institutrices de l’école de Teniente Berdina ont
incorporé les photos de toutes les cérémonies et événements qui se produisaient dans l’école.
23. Né en 1965, le Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT) était de tendance léniniste et
guévariste. Proche du mouvement des travailleurs du sucre, ce lien sera très fort pendant ses
premières années d’existence. En 1970, le PRT opte pour la lutte armée et crée la fraction armée
de son parti : l’Armée révolutionnaire du peuple, ERP selon ses sigles en espagnol. Parmi les
formations de gauche non péronistes, le PRT-ERP deviendra à cette époque le parti de gauche le
plus important d’Argentine. Voir : Carnovale V., Los combatientes: historia del PRT-ERP, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2011 ; De Santis D., La historia del PRT-ERP: por sus protagonistas,
Capital Federal, A FORMAR FILAS editora Guevarista, 2010.
24. Dans le discours militaire, il est signalé que la guérilla est une menace pour la souveraineté
nationale. Selon les mots du Commandant Vilas : « Il ne s’agissait pas de contrecarrer l’ERP afin
d’arranger les affaires du péronisme, mais de sauvegarder la souveraineté de la patrie en
danger », Vilas A., op. cit.
25. Loi 4.530, Pouvoir exécutif, 16 août 1976.
26. Sur ce sujet, voir Rama A., La ciudad letrada, Hannover, Ediciones del Norte, 1994, ainsi que
l’ouvrage de Blengino V., La zanja de la Patagonia. Los nuevos conquistadores: militares, científicos,
sacerdotes y escritores, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2005.
27. Vilas A., op. cit., parte III.
28. Le chiffre total de la population déplacée est une estimation faite à partir des données
recueillies lors de notre travail de terrain. L’absence de chiffres officiels montre à quel point le
thème reste inexploré en Argentine.
29. La cheminée : référence aux vestiges de la vieille entreprise sucrière qui a été utilisée pour
installer la base militaire à côté de ce village stratégique.
30. Trinquier R., op. cit., p. 71. Pour une approximation plus générale sur la dimension
transnationale de la doctrine dite de la « Guerra Revolucionaria », voir : Périès G., « La doctrine de
la “guerre révolutionnaire” : Indochine, Algérie, Argentine, Rwanda. Trajet d’une hypothèse », in
Coquio C., Guillaume C. (dir.), Des crimes contre l’humanité en république française (1990-2002),
L’Harmattan, 2006, pp. 212-241.
31. Cruz M., Jemio A. S., Monteros E., Pisani A., « Las prácticas sociales genocidas en el Operativo
Independencia en Famaillá, Tucumán, febrero 1975 - marzo 1976 », in compte rendu du congrès
Jornadas de Historia Reciente del NOA “Memoria, Fuentes Orales y Ciencias Sociales”, Tucumán, 2010 ;
Vilas A., op. cit.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
94
32. S/a, Memoria de la gestión de Gobierno. 1976-1977 Tucumán, cuna de la independencia,
Gobierno de Tucumán, 1978, p. 119.
33. On peut trouver une référence importante concernant la technique consistant à quadriller le
territoire dans la doctrine française de la lutte antisubversive (voir : Denis L., « La “doctrine de la
guerre révolutionnaire” : théories et pratiques », in Bouchène A. et al., Histoire de l’Algérie à la
période coloniale, Paris, La Découverte, 2014, pp. 526-532).
34. Belcher O., op. cit., p. 128.
35. Ibid., p. 131.
36. Les toilettes ne faisaient pas partie des cabanes de bois : elles étaient collectives et se
trouvaient hors du logement.
37. Le centre sportif, par exemple, joue un rôle central dans le village, articulant une grande
partie de la vie sociale de la nouvelle communauté mais aussi en rééduquant les corps.
38. Gordillo G., Rubble. The afterlife of destruction, Duke University Press, 2014.
39. Navaro-Yashin Y., The Make-Believe Space. Affective Geography in a Postwar Polity, Durham et
Londres, Duke University Press, 2012, p. 134.
40. S/a, Memoria de gobierno, op. cit., p.119.
41. Dans ce sens, N. Brenner et S. Elden soutiennent que l’État produit constamment son
territoire et que, dans ce sens, le territoire national est le résultat d’une articulation spécifique
entre l’État, les processus de contestation qui se jouent à l’intérieur, et la terre et le sol qu’il
habite, possède, contrôle et exploite. Brenner N., Elden S., « Henri Lefebvre on State, Space,
Territory », International Political Sociology, n°3, 2009, p. 362.
42. La réflexion que fait N. Brenner concernant l’opposition binaire entre urbain et non urbain
est sans doute intéressante pour ce débat : « Le terrain du non-urbain, présent en permanence
“dans un autre lieu” a joué pendant longtemps le rôle d’extérieur constitutif qui stabilise
l’intelligibilité même du champ d’études urbaines. Le non-urbain apparait en même temps
comme l’Autre ontologique de l’urbain, son opposé radical, et comme sa condition
épistémologique de possibilité, la base sur laquelle on peut le reconnaitre comme tel » (Brenner
N., « Theses on Urbanization », Public Culture, 25 (1), 2013, p. 98).
RÉSUMÉS
Le programme militaire de création des « villages stratégiques » – qui émerge au début de la
guerre froide – a pour objectif la création d’espaces urbains ex nihilo pour y déplacer la
population rurale qui habite dans des zones sous influence de groupes guérilleros. Cet article
analyse le Plan de relogement rural mené dans la province argentine de Tucumán (1976-1978) qui
a donné naissance à quatre villages stratégiques. Quelles sont les reconfigurations que ce
programme a produites dans l’espace social et quelles sont celles qui perdurent ? Comment se
déroule la vie quotidienne au sein de ces espaces où monde militaire et monde civil coexistent ?
Quelles sont les caractéristiques d’un espace urbain pensé et conçu pour empêcher les
populations de soutenir la guérilla ? L’analyse d’entretiens approfondis réalisés avec des
habitants des villages stratégiques de Tucumán permet d’examiner l’impact social et politique de
l’urbanisation forcée comme technique de contre-insurrection.
The military program for building “strategic villages”, which emerged at the beginning of the
Cold War, sought to develop ex nihilo urban spaces to displace rural populations living in zones
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
95
influenced by guerrilla groups. This article analyses the Rural Relocation Plan implemented in
the Argentinian province of Tucumán between 1976 and 1978 that led to the construction of four
strategic villages. In doing so, it seeks to establish whether or not space has the power to
transform a community’s political and social life in the long term. This article equally addresses
the following three questions: What is everyday life like in spaces where military and civil worlds
cohabit and hybridize? What are the characteristics of urban spaces designed to dissuade
populations from rising up in support of the guerrillas? The analysis of in-depth interviews
conducted with the inhabitants of strategic villages in Tucumán allows for an examination of the
social and political effects of forced urbanization as a counter-insurgency technique.
INDEX
Mots-clés : espace, déplacements forcés, politiques contre-insurrectionnelles, expérience
quotidienne de la violence, Argentine
Keywords : space, forced displacement, counter-insurgency policies, everyday experience of
violence, Argentina
AUTEUR
PAMELA COLOMBO
Pamela Colombo est docteure en sociologie de l’Université du Pays Basque. Chercheuse Marie
Skłodowska-Curie à l’EHESS et associée au programme ERC « Corpses of Mass Violence and
Genocide » (2014-2016), elle travaille actuellement sur la construction des « villages
stratégiques » en Amérique latine. Ses publications portent principalement sur le lien entre
espace et violence d’État. Elle a notamment co-édité l’ouvrage Space and the Memories of Violence
(Palgrave Macmillan, 2014) et dirigé un numéro spécial de la revue Human Remains & Violence sur
la question des exhumations en Amérique Latine (2016).
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
96
Écrire (sur) un massacre : Acteal1997-2008 (Mexique)Enjeux d’écriture, enjeux d’interprétations
Writing (about) a Massacre: Acteal 1997-2008 (Mexico). The Stakes of Writing
and of Interpretations
Sabrina Melenotte
1 En adoptant une perspective d’anthropologie politique et pragmatique 1, cet article
revient sur quelques enjeux herméneutiques et politiques d’un massacre survenu le 22décembre 1997. C’est dans la localité d’Acteal, située dans la municipalité de Chenalhódans la région des Hautes-Terres du Chiapas, que quarante-cinq tsotsil appartenant àl’organisation religieuse pacifique, les Abeilles, trouvent la mort 2. L’analyse descontroverses autour du massacre, qui se sont produites immédiatement après lemassacre puis dix ans plus tard, permet de revenir sur le phénomène paramilitairedans le conflit armé au Chiapas. L’accent ou, à l’inverse, l’effacement de certaines« traces indiciaires 3 » relayées ensuite sur les scènes judiciaire et médiatiquepermettent de discerner ainsi quelques spécificités du régime mexicain par rapport àd’autres pays latino-américains.
2 Dès 1998, la médiatisation du massacre d’Acteal cristallise l’ambivalence de l’État
mexicain qui réprime sa population la plus vulnérable alors qu’il entame un processusde démocratisation depuis la fin des années 1980 et aspire à entrer dans le « Premiermonde » depuis la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Ledéni du gouvernement sur sa responsabilité dans les faits survenus à Acteal a engendréune bataille discursive de la part d’acteurs non-gouvernementaux émergents, desmilitants, universitaires et journalistes indépendants, qui ont dénoncé l’aporie desinterprétations officielles et ont érigé Acteal en paradigme de la violence politique auMexique. Dix ans plus tard, ces controverses ont été réactivées dans une affaire 4 faisantla part belle à une version portée par de nouveaux acteurs politiques et religieux,gouvernementaux et non-gouvernementaux, et qui vise cette fois-ci à innocenter et àlibérer les prisonniers considérés jusque-là comme les « auteurs matériels » dumassacre. Cette nouvelle controverse médiatique et judiciaire a contribué à légitimer
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
97
une nouvelle catégorie de victimes, celle des « prisonniers innocents », entrant enconcurrence avec celle des survivants directs du massacre qui avait prédominé pendantdix ans.
3 Je reviendrai d’abord sur le contexte du premier scandale et de l’affaire pénale qui a
opposé deux rapports, l’un officiel et l’autre non-gouvernemental, rédigés directementaprès le massacre en 1998. Dans un second temps, j’examinerai la nouvelle version miseà jour dix ans plus tard par de nouveaux acteurs politiques, juridiques et universitaires,qui s’en sont emparé pour se placer sur l’échiquier politique national. Celle-ci se réfèreà une « autre injustice » provenant de vices de procédures au moment des arrestationsen 1998 et qui traduit une inversion rhétorique relative à une technique de défensevisant à innocenter les prisonniers. Enfin, au-delà des interprétations officielle et non-gouvernementale, il s’agira de proposer une anthropologie politique du massacre,appréhendé comme un rituel de répression visant à restaurer l’ordre établi.
Le massacre d’Acteal : un pavé dans la mare de latransition démocratique au Mexique
4 Le tournant multiculturel et néolibéral entamé au Mexique au début des années 1990
s’est manifesté dans l’État du Chiapas de manière explosive par une rébellion demilliers de paysans indiens qui, sous la bannière de l’Armée zapatiste de libérationnationale (Ejército zapatista de liberación nacional, EZLN), répondaient dès 1994 à une criseéconomique et politique que le tournant néolibéral avait accélérée. Dans lamunicipalité de San Pedro Chenalhó, située dans la région de Los Altos, cette crisegénéralisée a abouti deux ans plus tard à la privatisation des espaces communautaireset à l’autonomisation de la justice hors du cadre légal. En effet, fin 1995, la municipalitéde Chenalhó à majorité indienne est devenue un bastion du zapatisme, rompant demanière inédite avec un puissant contrôle social de la part des hommes politiqueslocaux, les caciques indiens affiliés au Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI) et quirégnaient en maître depuis la période postrévolutionnaire 5.
5 Entre 1996 et 1997, l’auto-proclamation d’une municipalité autonome zapatiste,
légitimée par la majorité des habitants, a formé un contre-pouvoir qui a ébranlél’hégémonie du PRI et déclenché des peurs puissantes chez les caciques indiens et leurssympathisants, qui ont répondu par l’auto-organisation et l’armement des membres lesplus actifs, jusqu’à la formation d’un groupe d’autodéfense, appelé à ses débuts« pojwanej » (les « protecteurs » en langue tsotsil). Dès lors, de nombreuses tensionsanciennes ont éclaté simultanément dans plusieurs localités de Chenalhó pour desmotifs politiques, agraires ou religieux, augmentant les clivages parmi les pedranos 6.Des assassinats et des violences diverses (kidnapping, embuscade, lynchage, torture,déplacements forcés, expulsions) se sont enchaînés pendant deux ans, suscitant l’effroide la population civile dans une région où se multipliaient les acteurs armés. Leparoxysme des violences a été atteint lors du massacre d’Acteal, exécuté par un groupelocal de paysans indiens appartenant à l’organisation politique cardéniste 7, sedésignant eux-mêmes de « protecteurs », nommés groupe « d’autodéfense » par legouvernement et qualifiés de « paramilitaires » par les défenseurs des droits del’homme. Il causa la mort de quarante-cinq personnes, essentiellement des femmes etdes enfants, tsotsil comme leurs agresseurs, affiliés à l’organisation religieuse,sympathisante des rebelles néo-zapatistes mais pacifique, les Abeilles.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
98
Le scandale Acteal en 1998
6 Le scandale suscité par ces violences a été immédiatement porté par des universitaires
et par des défenseurs des droits de l’homme qui ont récusé radicalement la versionofficielle du gouvernement contenue dans le Livre blanc sur Acteal publié en 1998.
La version officielle du Bureau du Procureur de la République
7 Immédiatement après les faits, l’interprétation officielle a été prise en charge par le
Bureau du Procureur de la République (Procuraduría General de la República, PGR),responsable de l’enquête 8. Quelques mois plus tard, le Livre Blanc sur Acteal (Libro blanco
sobre Acteal) a offert trois variations d’une même lecture : un conflitintercommunautaire, un conflit interreligieux, ou une vengeance de sang commeexpression « coutumière » des résolutions de conflits locaux. En s’appuyant sur destravaux d’anthropologie sur les pratiques intolérantes des caciques locaux 9,notamment sur les conflits religieux et politiques anciens, puis sur une discordefoncière autour d’une carrière de sable, la version officielle a présenté le massacrecomme une série de « conflits internes » aux communautés, naturellement intoléranteset dont la violence serait une « coutume ». Les informations sont éparses dans cerapport écrit dans l’empressement de l’après-massacre dans le but évident dedissimuler les faits d’un événement qui aurait pu être évité. Mais surtout, le Livre Blanc
sur Acteal est rempli de contradictions. Malgré la théorie du règlement de comptesentre indiens, le Bureau du Procureur de la République (PGR) reconnaît la complicité de« quelques » policiers de la Sécurité publique (Seguridad Pública) :
« La participation de quelques éléments de la coordination de Sécurité Publique del’État du Chiapas, plutôt que de minorer les tensions de la zone, augmente lepotentiel de violence et contribue au processus de décomposition du tissu social deChenalhó 10. »
8 Mais la thèse qui prédomine est celle de l’« omission » et de l’« indifférence » des forces
policières, qui constituent un délit condamné par l’institution :
« La Sécurité publique détachée dans la zone n’a pas réussi à empêcher l’escaladedes agressions. « Face au manque d’action de la justice à Chenalhó et de fermes politiques desécurité publique, les sympathisants du Conseil municipal constitutionnel et lesmembres du Parti Cardéniste ont formé dans chaque communauté leurs propres“Commissions de Sécurité et Vigilance”, pour maintenir l’ordre et se protéger face àla présence des bases d’appui de l’EZLN dans la municipalité.« En revanche, il est absolument injustifiable que des éléments de la SécuritéPublique se soient impliqués dans l’action, et même dans l’équipement de cescommissions de sécurité et de vigilance qui, davantage que des corps d’auto-défense de la propre communauté, ont fini par maintenir une coordination uniquesous le commandement des caciques de Los Chorros. Par conséquent, il estcondamnable que face à l’escalade des vols et agressions commis par ce groupecontre les Abeilles, l’autorité soit restée indifférente. Cette indifférence a contribuéà ce que l’agression ait lieu à Acteal, non seulement par omission dansl’accomplissement de fonctions, mais aussi par l’indolente complicité pour ne pasprévenir le massacre le jour des faits 11. »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
99
9 Le Bureau du Procureur de la République conclut pourtant qu’il n’y a jamais eu de
groupes paramilitaires au Chiapas :
« Le Bureau du Procureur de la République (PGR) a documenté l’existence degroupes de civils armés dans la municipalité de Chenalhó, ni organisés, articulés,entraînés, ni financés par l’armée mexicaine, ni par d’autres instances gouvernementales,mais leur gestation et organisation répond à une logique interne déterminée par laconfrontation, entre les communautés et au sein des communautés, avec les basesd’appui zapatistes 12. »
10 On remarque dans ces conclusions officielles l’absence totale de mention au rôle de
l’Armée. Or comment des armes de haut calibre à l’usage exclusif de l’Armée arrivent-elles entre les mains de groupes civils ? Comment les techniques de contre-insurrectionsont-elles apprises par ces pojwanej ? Quid de la Sécurité publique : comment expliquerla circulation et le libre-transit des armes et des uniformes parmi les civils ?
11 Finalement, de manière arbitraire et aléatoire, la PGR a arrêté le 25 décembre à
Chenalhó quatre-vingt-seize hommes, convoqués par les autorités municipales sansmotif précis à une réunion à laquelle ils se rendaient dans un transport en communlocal (redila). Le maire de Chenalhó alors en fonction, un cacique local du PRI, JacintoArias Cruz, a également été arrêté et accusé de l’armement des groupes paramilitaires.Il a reçu la peine la plus sévère : trente-six ans et trois mois de prison. Vingt-quatreautres personnes ont reçu la même peine pour délits d’homicide qualifié, lésionsqualifiées, port sans licence d’armes à feu à l’usage exclusif de l’Armée et de la ForceAérienne. Dans l’urgence, l’institution a également condamné des fonctionnaires et ex-fonctionnaires de l’institution judiciaire pour leur mauvais travail dans dix-sept destrente-quatre enquêtes préalables. Au total, quinze fonctionnaires d’État de la Sécuritépublique ont été jugés, soit pour des délits d’homicide et de lésion par omission, soitpour ne pas avoir accompli leur devoir de sauvegarder l’intégrité des habitants le jourdu massacre, ou encore pour ne pas avoir agi avant le massacre. En revanche, les hautsfonctionnaires politiques n’ont pas été jugés, mais démis de leur fonction, sous lapression médiatique et les mobilisations populaires : le Ministre de l’Intérieur EmilioChuayffet, le gouverneur de l’État du Chiapas Julio César Ruiz Ferro, son secrétaireHomero Tovilla Cristiani, le vice-Ministre de l’Intérieur Uriel Jarquín Gálvez et leSecrétaire du Conseil de Sécurité Publique de l’État du Chiapas (Consejo Estatal de
Seguridad Pública) Enrique Cervantes Aguirre, ont « démissionné » de leur fonction surinvitation pressée. Beaucoup de ces hauts-fonctionnaires se sont reconvertis dans ladiplomatie, obtenant des postes aux États-Unis 13.
La version non-gouvernementale des survivants et du Centre desdroits de l’homme Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC)
12 Cet épisode violent a eu une portée nationale et internationale, décloisonnant
l’événement du niveau local, grâce notamment à l’usage d’Internet par l’EZLN, lesmilieux militants et les défenseurs des droits de l’homme locaux, nationaux etinternationaux. Les organisations civiles ont déployé immédiatement une campagned’information et de diffusion très importante dans les médias, exerçant ainsi unepression sur le Président Ernesto Zedillo pour qu’il intervienne, au moment où ilnégociait par ailleurs un accord commercial préférentiel avec l’Union Européenne. Legouvernement a dû déclarer l’ouverture d’une enquête et s’engager à ce que justice soitfaite. Sa dénonciation a également été portée par des anthropologues, notamment
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
100
féministes 14, qui ont étayé la théorie de la guerre de basse intensité comme stratégie decontre-insurrection et comme guerre intégrale. Cette version s’appuie sur lestémoignages des survivants ainsi que sur le Plan de Campagne Chiapas 94 (Plan de
Campaña Chiapas 94) du Ministère de la Défense Nationale (Secretaría de la Defensa
Nacional) 15 qui prévoit de développer une stratégie de contre-insurrection au Chiapasdès 1995, sous couvert de l’application d’un Plan de défense nationale qui autorisel’action de forces armées face à un « ennemi interne » portant atteinte à la zone desécurité et à la souveraineté nationales : les populations indiennes et paysannesorganisées sous la bannière de l’EZLN. Le Plan en appelle à des tactiques psychologiqueset à des actions indirectes de l’État en vue de soutenir et entraîner des organisationsparamilitaires et diviser la population civile 16. Cette stratégie contre-insurrectionnelleconsiste à « enlever l’eau au poisson 17 », l’eau étant la base sociale et populairesoutenant la guérilla 18. Dès 1997, le Centre des droits de l’homme Fray Bartolomé de lasCasas (CDHFBC) a publié une étude où il comparait les méthodes employées par lesagresseurs d’Acteal à la stratégie de guerre de basse intensité employée au Vietnam 19.La méthode consiste en la création de forces d’« autodéfense » à partir de civils recrutésdans une structure parallèle subordonnée à l’armée, vouée à des opérations de contre-guérilla et de restauration de l’ordre. Confortée par d’autres sources non-gouvernementales 20, la conclusion est formelle : l’attaque du 22 décembre 1997 est lefruit d’une stratégie contre-insurrectionnelle planifiée depuis les hautes sphèrespolitiques visant à attaquer la population la plus vulnérable, les femmes et les enfants,d’une organisation pacifique sympathisante de l’EZLN. Sous couvert de problèmesterriens, de confrontations entre partis, de conflits religieux, d’inimitiés personnelles,de vengeances familiales, est ainsi dissimulée une stratégie paramilitaire de contrôle,de déstabilisation, de fractionnement et de répression sélective dirigée par les plushautes instances du pouvoir qui menait alors une « guerre sale » au Chiapas.
13 Ainsi, dès 1998, ce premier scandale déjà bien documenté traduit la transformation de
la nature des rapports entre l’État et la société civile au Mexique. Un nouveau discoursd’injustice relayé dans les médias nationaux et internationaux, porté par des acteursissus du milieu des droits de l’homme, d’universitaires et d’avocats engagés, a « faitl’opinion 21 » dans un mouvement unanime qui a eu un écho retentissant sur les scènesnationale et internationale. Bien vite, le massacre d’Acteal est devenu une référenceincontournable qui a forgé l’imaginaire national contemporain et un paradigme de larépression d’État persécutant les indiens. Mais les recours nationaux s’étant épuisésaprès quelques années, les défenseurs des droits de l’homme ont cherché à fairereconnaître le massacre d’Acteal comme un crime contre l’humanité et un féminicideauprès de la Commission internationale des droits de l’Homme (CIDH), en vain. En 2011,des survivants du massacre ont tenté de poursuivre le président de l’époque ErnestoZedillo Ponce de León, en vain. En parallèle, à l’aide du travail pastoral du Diocèse, lesAbeilles ont fait du massacre un mythe fondateur qui a permis de relancerl’organisation touchée en son cœur. Ce processus que l’on pourrait qualifierd’ethnogenèse s’est ritualisé autour des commémorations mensuelles organisées le 22de chaque mois depuis 1998. Il a fait des victimes et des survivants d’Acteal des héros decette localité rebaptisée Terre des Martyrs.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
101
L’autre injustice en 2007
L’affaire pénale dix ans plus tard
14 Ce n’est que tardivement dans ma recherche doctorale que j’ai décidé de prendre à bras
le corps l’affaire complexe concernant les faits survenus le 22 décembre 1997. Je m’étaisgardée jusque-là d’apporter une lecture de plus à ce massacre déjà bien documenté.Pourtant, deux événements majeurs et d’ampleur nationale ont eu lieu à la fin del’année 2007 et au cours de l’année 2008, alors que j’habitais la ville de México. D’unepart, les Abeilles préparaient une commémoration pour les dix ans du massacre àActeal, devenu le cœur cérémoniel et politique de l’organisation. D’autre part, et demanière concomitante, une nouvelle version du massacre diffusée dans la pressenationale faisait la part belle aux agresseurs d’antan, les « auteurs matériels » devenantsoudain des « prisonniers innocents ». Quelques mois après cette publication, la CourSuprême de Justice de la Nation (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) devaitstatuer sur la possible libération de vingt prisonniers accusés dix ans plus tôt d’être les« auteurs matériels » du massacre, alors même que la question des « auteursintellectuels » n’était pas réglée.
15 C’est donc dans le contexte d’une « forme affaire 22 » sur le massacre d’Acteal que j’ai
intégré ces observations à ma recherche et que j’ai suivi la commémoration desAbeilles, assombrie par cette nouvelle version. Les membres de l’organisationreligieuse, accompagnés d’organisations des droits de l’homme du Chiapas et de lacapitale, ont décidé de se rendre à la capitale pour être présents le jour du verdict de laCour Suprême. Je m’étais jointe aux Abeilles, accompagnées de défenseurs des droits del’homme que je connaissais depuis le début de mes recherches, ce qui a facilité maprésence à leurs côtés et levé toute suspicion. Elles décidèrent d’organiser une marcheet une conférence de presse pour contester la libération éventuelle des « auteursmatériels » emprisonnés. Je marchai à leurs côtés lors de leurs deux venues en juin eten août 2009 à Mexico, en les accompagnant près du caballito 23 de la grande avenueReforma jusqu’à la Cour Suprême (SCJN) collée au zócalo. Voici un extrait de mon carnetde terrain de la marche du 11 août 2009, qui relate une découverte surprenante :
« Le jour de la marche des Abeilles à México et de leur mobilisation devant la CourSuprême de Justice de la Nation située au Sud du Palais national du zócalo endirection de Pino Suárez, je décide de me dégourdir les jambes car l’attente duverdict de la Cour suprême de Justice de la Nation (SCJN) se fait longue. Quel n’estmon étonnement quand sur la même place centrale du zócalo, exactement de l’autrecôté du Palais national, à moins de 300 mètres, j’aperçois un autre campement entrela cathédrale et les ruines aztèques du Templo Mayor. Je repère qu’il s’agit d’un autregroupe de pedranos, facilement identifiables à l’habit brodé des femmes, d’ailleursplus nombreuses que les hommes. Je tombe par hasard sur ce campement collé à laplace qui jouxte la Cathédrale et m’approche, en leur demandant de quoi il s’agit.L’une d’elles me tend simplement un tract imprimé où l’on peut lire que les mèreset les enfants des “emprisonnés injustement” réclament la libération desinnocents. »
16 Le verdict de la Cour Suprême sur le sort de vingt prisonniers n’a pas uniquement
mobilisé les Abeilles. D’autres pedranos se trouvaient à quelques mètres de là, de l’autrecôté du zócalo. Soixante familles s’étaient organisées depuis Chenalhó, menées par lesépouses des prisonniers accompagnées de leurs enfants, pour se rendre à la ville deMéxico et être également présents le jour du verdict de la Cour Suprême. Je m’étonnai
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
102
de n’avoir rien vu de ces mobilisations auparavant et restai stupéfaite de découvrir une« autre injustice » vécue par les femmes des prisonniers, qui reprenaient le mêmediscours d’innocence que les avocats et intellectuels dans la presse.
17 La révision des éléments sur le massacre d’Acteal avait lieu simultanément sur les
scènes judiciaire et médiatique. Le procès a eu lieu à huis clos et je n’ai pas pu y assister,mais la publication à la une de la presse nationale pendant des semaines de dépositionsdes agresseurs, d’articles d’avocats, d’hommes politiques et d’intellectuels, a offert denouveaux éléments riches de sens pour démêler cet imbroglio. Il m’a été possible desituer les premiers indices de cette réécriture de l’histoire le 21 décembre 2006, lorsquele Centre de recherches et d’enseignement économiques (Centro de Investigación y
Dociencia Económicas, CIDE), Alternative Citoyenne 21 (Alternativa Ciudadana 21) 24, ainsique des avocats et journalistes de renom 25, ont annoncé qu’ils assumaient la défensedes 75 détenus ayant fait appel (amparo), convaincus qu’ils étaient tous des boucsémissaires 26. Le journaliste et chercheur Ricardo Raphael a insisté sur la déterminationde ce groupe à défendre les prisonniers en raison des violations aux principes d’un« procès juste » (debido proceso) 27 qui se fonderait sur la présomption d’innocence,considérant ces violations si graves qu’elles en devenaient un « cas paradigmatique ».Ces arguments s’appuyaient sur la réforme portant sur la présomption d’innocencealors en cours d’intégration au droit pénal en 2009 dans le pays, ce qui ouvrait la voie àde nombreuses opportunités de libération de prisonniers 28.
18 Dix ans après donc, les avocats du CIDE qui reprennent l’affaire veulent pointer les
irrégularités du Bureau du Procureur de la République PGR lors de l’arrestation massiveet aléatoire de pedranos en 1998 29. La défense conteste les procédures de détention etinsiste sur des points davantage techniques et juridiques que sur la dimension politiquede l’affaire. En revanche, la responsabilité des « auteurs intellectuels », celle desfonctionnaires publics de niveau intermédiaire et supérieur (y compris celui duPrésident de la République alors en fonction, Ernesto Zedillo Ponce de León) passetotalement à la trappe.
19 Mais le fait le plus marquant est la campagne médiatique qui enveloppe l’affaire pénale,
surprenant tout le monde à la veille de la commémoration des dix ans du massacre parles Abeilles à Acteal. La publication dans la revue Nexos d’une trilogie signée parl’historien Hector Aguilar Camín semblable à un roman policier jette un voile surl’événement. Cette trilogie s’accompagne d’extraits de dépositions de deux agresseursqui ont confessé avoir participé au massacre en 1997 lors de l’enquête mise en place parle Gouverneur Jaime Sabines (2006-2012) et menée par le Bureau Spécial pour l’affaireActeal (Fiscalía Especial por el caso Acteal) 30.
20 On ne sait pas précisément dans quel contexte ni quand ces dépositions-confessions ont
été réalisées, si ce n’est qu’elles ont été « reconstruites » par l’avocat de la défense àpartir de dépositions faites en partie en tsotsil et en partie en espagnol. Les dépositionsont été minutieusement choisies parmi les confessions de six coupables ayant admisavoir participé à l’attaque du 22 décembre. Au-delà de leur valeur dans le procès alorsen cours et du caractère individuel de ces dépositions, elles fournissent de nouveauxéléments totalement éludés dans les témoignages publiés des survivants Abeilles, telsque le rôle des zapatistes, l’affrontement qui précéda le massacre, ainsi que la stratégied’attaque des groupes d’autodéfense de Los Chorros (pojwanej) et le lien de ces derniersavec la Sécurité Publique.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
103
21 Par exemple, la déposition de Roberto Méndez Gímenez, réalisée le 16 avril 2007,
illustre cette nouvelle version du massacre :
« §41. Le jour suivant, le 22 décembre, je me suis levé à six heures du matin avecmes compagnons pour prendre le petit-déjeuner. Une fois terminé, on a commencéà se préparer. J’ai mis un uniforme bleu-marine que j’avais acheté à un élément ducommandant de Sécurité Publique Felipe V. E., je ne me souviens plus de son nom nidu prix auquel il me l’a vendu. J’ai aussi mis des bottes, achetées pour deux centspesos à cette même personne de la Sécurité publique, et j’ai noué un foulard blancsur ma tête. Mes compagnons ne portaient aucun uniforme, juste un foulard blanc.Quelques-uns se l’étaient noués sur la tête, d’autres à l’épaule, pour que l’on puissese distinguer en tant que membre du groupe et éviter toute confusion pendant laconfrontation.« §42. À huit heures du matin, je suis sorti de la maison d’Antonio V. S., avec un“corne de bouc” [AK-47], en compagnie de [4 compagnons], eux aussi avec des“cornes de bouc”, et Augustin S. G. avec un Uzi. Là, Felipe L. P., Mariano L. R. etAlfredo H. R., nous ont rejoints avec des fusils de calibre 22. Nous sommes tous allésau panthéon en passant par l’église presbytérienne qui se trouve dans lacommunauté d’Acteal Alto. À dix heures du matin environ, ceux de Quextic ontcommencé à tirer et ils ont incendié la maison du père des frères M. P. […] Quandnous sommes arrivés, les zapatistes nous attendaient déjà et nous ont accueillisavec des coups de feu et c’est comme ça qu’a commencé l’affrontement qui a duréjusqu’à trois heures de l’après-midi ce jour-là.« §43. Nous avons formé deux groupes pour nous diriger vers l’école d’Acteal où setrouvaient les zapatistes. […] Le groupe de Lorenzo allait passer par le sud, tandisque moi et mon groupe nous allions arriver par le nord, pour nous rejoindre àl’école d’Acteal. En passant par le cimetière, nous avons trouvé plusieurs tranchéesmais sans personne. Nous nous sommes allongés au sol pour ramper jusqu’à l’école,mais nous n’avons réussi à avancer que sur cinquante mètres environ. Leszapatistes ont commencé à nous tirer dessus et nous avons réponduimmédiatement, la confrontation a commencé vers dix heures et demi. Nous avonscontinué à avancer jusqu’à une petite maison qui se trouve au sud de la route, àdeux cents mètres environ d’Acteal Centre, en passant par une tranchée où sontmortes deux personnes vêtues de noir et cagoulées, armées de deux cornes de bouc.« §44. Nous avons continué à avancer vers l’école à Acteal Centre. Vers onze heureset demi, nous sommes passés à environ trente mètres d’une autre tranchée d’où onnous a encore tiré dessus, jusqu’à arriver à cinquante mètres environ de l’école. Delà, j’ai pu voir qu’il y avait des membres de la Sécurité publique sur le terrain debasketball d’Acteal Centre, alors nous avons décidé d’entrer dans la chapelle en bois(ermita) d’Acteal qui était gardée par les zapatistes. Je suis revenu sur mes paspendant quarante mètres environ en passant sous la tranchée précédente et suistombé sur Lorenzo P. V. et Alfredo H. R. Ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas pu entrerdans l’école parce qu’ils avaient vu des membres de la Sécurité publique sur leterrain de sport. Ils m’ont dit aussi que Felipe L. P. avait été blessé et qu’il étaitrevenu. Ils ne m’ont pas dit où. Pendant ce temps, la bataille continuait. »
22 Cette version a eu un effet extrêmement puissant sur l’interprétation du massacre.
D’abord, elle complète les récits des survivants qui ont parlé depuis une positionimmobile de prière jusqu’à ce qu’ils fuient pour se cacher. Elle confirme ce que lesdéfenseurs des droits de l’homme et les survivants ont dénoncé pendant plusieursannées, en vain, à savoir la présence de la Sécurité Publique sur les lieux du massacre,l’achat en amont d’uniformes à un seul policier, le port d’armes de haut calibre(néanmoins sans que l’on sache où elles ont été achetées) et la division du groupe despojwanej en deux groupes pour attaquer par le haut et par le sud. Mais surtout, elleintroduit des éléments nouveaux et divergents par rapport aux anciennes versions : leszapatistes jusque-là absents des récits sont introduits dans le récit, l’attaque des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
104
pojwanej étant désormais présentée comme une « bataille » avec les zapatistes quiauraient attaqué les premiers ; certains de leurs corps morts ont été vus par lesagresseurs mais ils auraient ensuite disparu ; les pojwanej auraient rebroussé cheminface à la crainte d’autres éléments de la Sécurité publique qu’ils ne s’attendaient pas àvoir devant l’école. Ce dernier point complexifie d’ailleurs le rapport de ces groupesd’autodéfense aux forces de police, invitant à nuancer l’idée que l’on se faitgénéralement du paramilitarisme comme d’un lien solide, généralisé et durable.
23 Ainsi, les dépositions accompagnées de la trilogie réalisée par l’historien sur les faits du
22 décembre consistent à démontrer qu’il n’y a pas eu d’attaque unilatérale de groupesparamilitaires, mais bien un affrontement et une « bataille » entre deux groupes armés,les groupes d’autodéfense et les zapatistes. Cette nouvelle version ajoute une couche aumille-feuille interprétatif élaboré les années précédentes autour des victimes etsurvivants du massacre. Elle jette surtout un voile sur la théorie du « massacre » portéepar les survivants et les défenseurs des droits de l’homme, qui suppose uneunilatéralité de l’agression. L’une des techniques de la défense a consisté à déconstruirela théorie du paramilitarisme pour individualiser l’action collective violente del’attaque. Le massacre est devenu une juxtaposition d’homicides sans intention niorganisation préalable, ce qui n’est pas sans rappeler l’interprétation de la PGR dix ansplus tôt, mais dont le dessein était alors différent.
Des « auteurs matériels » aux « prisonniers innocents »
24 En se déployant dans la presse nationale, ces dépositions ont participé de la réécriture
non-officielle du massacre en même temps qu’elles ont servi le plaidoyer des« prisonniers innocents ». La réactivation du massacre d’Acteal en une « forme affaire »a donc mis en scène de nouveaux acteurs institutionnels, universitaires et hommespolitiques à différentes échelles, et a marqué un tournant au sein de la sociétémexicaine. Elle s’est inscrite dans un processus de disputes et de controverses qui enont fait une nouvelle épreuve 31 à la fois pour les pedranos et l’ensemble de la sociétémexicaine 32. La nouvelle version est venue asseoir publiquement des témoignages deprisonniers ayant confessé leur participation au massacre, en matérialisant de manièredurable des données fournies de manière décontextualisée, sans en expliquer les enjeuxpolitiques et juridiques. Mais le choix de publier des extraits de dépositions dedéclarants ayant plaidé coupables n’est pas anodin, leur confession servant deux autresfinalités : l’une individuelle, et souvent liée à une quête de rédemption 33 ; l’autrecollective, la confession canalisant sur leur personne la responsabilité de l’attaque denombreuses autres le 22 décembre. En d’autres termes, la confession concentre laculpabilité sur six d’entre eux pour mieux décharger les soixante-treize restants.
25 Dans la trilogie de Nexos, on peut également consulter une nouvelle chronologie
réalisée par l’organisation cardéniste et comportant des éléments inédits sur lemassacre. Quelques mois plus tard, je visitai Norberto Gutiérrez Guzmán, l’un desmembres de cette organisation entrée en conflit avec les zapatistes en 1996. Alors quenous parlions de la libération des prisonniers d’Acteal, il a évoqué la mobilisation quej’avais vue quelques mois plus tôt au zócalo. Il m’a montré plusieurs documents, dont lesActes constitutifs du Comité des épouses des prisonniers innocents d’Acteal, datésd’avril et de juin 2008.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
105
26 Les femmes du nouveau Comité familial des prisonniers innocents avaient cherché le
soutien de Norberto, car il se considérait lui aussi comme une victime dans le conflitarmé, suite à l’expropriation en 1996 par les zapatistes de la carrière de sable que lui etson groupe convoitaient de longue date. Partageant un même sentiment d’injustice, ilsexigeaient du gouvernement que des mesures soient prises pour libérer les prisonniersen mettant en avant la souffrance des familles privées de leurs maris et en demandantréparation pour les dommages occasionnés, ainsi qu’un « procès juste » (debido proceso),les injustices en question remontant aux arrestations aléatoires de 1998. L’alliance duComité des épouses des prisonniers avec Norberto se devait également à la fineconnaissance de la bureaucratie et la maîtrise de l’espagnol de ce dernier. Cettenouvelle action collective en parallèle de la commémoration des Abeilles a croisél’intérêt de l’historien Hector Aguilar Camín qui prenait en charge la réécriture de lanouvelle version à paraître dans la revue Nexos. Ce dernier s’était rendu dans la localitéde Majomut et avait rencontré Norberto lors d’une courte visite en 2007, avant lapublication de la trilogie. L’historien de notoriété a joué volontiers le rôled’« entrepreneur de la cause » participant au processus de production statutaire de lacatégorie de nouvelles victimes 34. Il a constitué une caution morale en tant que tiercepersonne présentant des garanties suffisantes de neutralité et de désintéressement,utile aux prétendants du statut de victime. La publication par l’historien dans la pressenationale de la version des cardénistes de Majomut et des femmes des « prisonniersinnocents » a joué un rôle fondamental en tant que ressource probatoire capitale pourfaire reconnaître les coupables en victimes d’une nouvelle injustice dans l’affaireActeal.
27 La finalité politique de la publication de cette nouvelle version dans la presse est donc
de créer un cadre idéologique qui accompagne la procédure judiciaire pour construireune nouvelle catégorie de victimes dans l’opinion publique. La médiatisation de latechnique de la défense déployée dans le cadre du procès a entraîné un retournementrhétorique qui a fait des « auteurs matériels » des « prisonniers innocents ». Lescoupables dix ans plus tôt devenaient des victimes qui se plaçaient dans une mêmeposition de dénonciation du système d’administration de la justice et de revendicationde leur innocence que les survivants. Cette mise en symétrie de la catégorie de victimepar rapport à l’État et la justice mexicaine est allée plus loin qu’une simple« concurrence des victimes 35 ». En partant du constat que la quête de justice desAbeilles a généré aussi l’exclusion d’autres pedranos et que leur version avait évacuépendant dix ans d’autres éléments sur le massacre, la symétrisation et la réécriture del’histoire par ces nouvelles victimes ont eu un effet extrêmement pervers sur lamobilisation des Abeilles.
28 Quelques mois après ces mobilisations et le procès, la quasi-totalité des prisonniers a
été libérée et relogée près de Tuxtla Gutiérrez, la capitale du Chiapas. L’affaire a étéd’autant plus déroutante qu’une semaine exactement après la première vague delibération de vingt prisonniers en août 2008, la chercheuse Kate Doyle a rendupubliques des archives du ministère de la Défense aux États-Unis au nom de la loi sur latransparence 36. Ces documents décrivent le rôle de l’Armée américaine dans le soutienmilitaire des groupes locaux paramilitaires au Chiapas pour attaquer les communautéspro-zapatistes de la région. Ils impliquent le ministère de la Défense nationale(SEDENA) et certains militaires qui auraient échangé protection et entraînement degroupes paramilitaires par des forces appelées HUMINT (Human Intelligence) contre des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
106
informations sur les « sympathisants zapatistes », en particulier dans la région de LosAltos et de Las Cañadas. Ces archives déclassifiées contredisent totalement la versiondu Livre Blanc du Bureau du Procureur qui a construit l’histoire officielle sur le massacreet confirment la thèse de la contre-insurrection soutenue par les défenseurs des droitsde l’homme du CDHFBC depuis le début. Ainsi, la libération des « prisonniersinnocents » voile la question du paramilitarisme sous-jacente à cette affaire,dépolitisant l’affaire et annulant toute possibilité d’enquête sur le rôle de l’État dans lemassacre d’Acteal.
Le massacre d’Acteal comme rituel de répression
29 Que nous enseigne l’ensemble des éléments dont on dispose depuis la réactivation de
l’affaire Acteal sur les violences perpétrées en 1997 ? D’abord, la dimension fratricidedu massacre d’Acteal est indéniable. Il faut donc intégrer à l’analyse du crime d’État laproximité inhérente des ennemis et, partant, la dimension privée de la violencepolitique. Ensuite, le recours à une coercition exécutée par les acteurs locaux,notamment les caciques, a caractérisé l’hégémonie PRiste tout au long du XXe siècle
avec des relents autoritaires récurrents et chroniques. C’est dire la nécessité dedépasser la dichotomie des controverses qui opposent la violence endémique etintercommunautaire à la théorie du crime d’État, vu comme une violence exogène.
30 La tradition politique autoritaire du parti-État qu’a instaurée le PRI pendant soixante-
dix ans s’est appuyée sur des forces militaires et policières qui ont davantage faitpreuve de non-ingérence plutôt que d’action directe et active, accordant un rôleprimordial aux factions locales armées, dans ce cas, les caciques locaux et les groupesd’autodéfense. Alan Knight 37 donne une profondeur historique à ce qu’il nomme le« culte de l’arme » au Mexique. L’Armée n’est pas intervenue, ou très peu, dans lesrégions reculées, préférant s’appuyer sur le pouvoir des caciques qui utilisaient demanière sporadique la violence, ou sur la présence de mercenaires, de pistoleros, degardes blanches qui ont souvent fait le « sale boulot 38 » de l’Armée. C’est dire si lerégime mexicain ne s’est pas tant appuyé sur une bureaucratie autoritaire comme dansle Cône Sud ou au Guatemala que sur tous ces acteurs privés et publics de la violence.Les modes de résolution anciens et non-sophistiqués des caciques et de diverses milicescontinuent d’être des recours privilégiés par l’appareil étatique pour rétablir l’ordrepar la violence ponctuelle et imposer des sorties de conflit à moindre coût pour lui. Ence sens, ces formes de « justice par soi-même » des caciques locaux et des groupesd’autodéfense ne s’opposent pas à des expressions étatiques de répression et enconstituent même des extensions.
31 Pour mener une anthropologie de la violence, il est aussi nécessaire d’articuler Acteal à
d’autres violences politiques survenues dans des circonstances semblables, comme lemassacre d’Aguas Blancas (1995), les répressions d’Atenco et d’Oaxaca dans un contextepréélectoral (2006), auxquels il est possible d’ajouter une longue liste de crimes commiscontre les femmes dans la ville de Ciudad Juárez, le massacre d’étudiants sur la placedes trois cultures de Tlatelolco en 1968 et, plus récemment, celui des étudiantsd’Ayotzinapa en septembre 2014. Ces massacres sont des répressions politiques qui onten commun de renvoyer au répertoire d’action de l’ancien parti hégémonique aupouvoir 39 qui s’appuie sur les caciques et autres intermédiaires locaux et régionaux dela violence. En ce sens, il est possible d’affirmer que les massacres constituent des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
107
rituels de répression de l’État moderne mexicain. L’expression sert à souligner avant toutle caractère itératif, chronique et standardisé des violences politiques au Mexique,notamment les assassinats et les massacres de la population la plus subversive pourl’ordre établi. Mais elle admet tout à fait que les « officiants » de la violence puissentêtre pluriels, se situer à plusieurs échelles, et entretenir un rapport ambivalent, voireparadoxal, à l’État.
32 Par exemple, le phénomène paramilitaire est intrinsèquement équivoque car il est à la
fois un supplétif de l’État, son extension locale dans la vie civile et s’inscrit dans desformes de violence endémique propres à la vie communautaire. En revanche, parlerd’autodéfense suppose uniquement une violence endémique : un groupe d’habitantsdécide de s’armer et de se faire justice par soi-même contre une menace que l’État n’estpas en mesure de régler. Ainsi, de tels groupes peuvent parfois agir de manièreindépendante ou même définir des domaines où l’État a peu de moyens pour exercerson autorité. Mais ils peuvent aussi jouir de la formation, du soutien, voire de lasupervision de l’État. Ainsi, dans l’affaire Acteal, il est nécessaire de distinguer lesgroupes d’autodéfense de Los Chorros des caciques du centre de Chenalhó. Les premiersn’ont pas eu de lien direct avec les autorités régionales et entretenaient une inimitiéhistorique avec les caciques. Les caciques sont au contraire des intermédiairesprivilégiés entre les autorités régionales et les communautés, qui emploient de manièreponctuelle et récurrente la force physique contre les dissidents. Car le régime mexicains’est construit tout au long du XXe siècle sur la capacité de ces élites locales à dominer
par un usage équilibré de consentement et de coercition, de récompenses et desanctions, ce qu’Alan Knight résume par la formule « pan y palo 40 ». Loin d’un usageprétorien de la force, les caciques opèrent sur un mode de hiérarchie politique qui serépartit sur les différents niveaux de pouvoir (national, fédéré, régional, municipal,local). Néanmoins, ce système fut marqué par la présence de plus en plus centraliséedes caciques au centre de Chenalhó à partir des années 1970, la bureaucratie côtoyantun système ancien de stratification sociale. Au moment du conflit armé dans les années1990, c’est donc un pouvoir coercitif combiné, un appareil répressif d’État via la policeet l’Armée et un pouvoir hiérarchique issu des caciques municipaux et régionaux, dugroupe d’autodéfense qui se sont entrelacés pour former le « massacre d’Acteal ». Ellene peut se réduire à la seule « logique d’État », aussi structuré soit le modèle militairedu Plan de Campaña Chiapas 94. Et le « lien paramilitaire » s’appuie alors sur des liensclientélistes complexes et préalables aux violences. Cette idée ne remet en rien enquestion l’implication de l’État dans les violences politiques au Chiapas, mais signifieque les violences de 1997 ont été combinées et que plusieurs acteurs politiques et armésont agi à différentes étapes avant et pendant la journée du 22 décembre 1997. Ainsi, iln’y a rien de contradictoire à parler de crime d’État, reconnaître la formation degroupes paramilitaires par les équipes HUMINT entre 1994 et 1997 et constater que laréalisation des violences et des attaques en 1997 s’est faite par des groupesd’autodéfense qui ont bénéficié ponctuellement du soutien des caciques du centre deChenalhó pour « faire justice par eux-mêmes ».
33 La réactivation de controverses et d’affaires autour des violences politiques comme
celles survenues à Acteal en 1997 tient au fait qu’elles décrivent et catalysent lestransformations de la nature de l’État mexicain. Le régime mexicain se veut« moderne » et se targue fréquemment d’appartenir au « Premier monde » alors queson élite dirigeante est entachée de sang, rendant in fine la modernité de l’Étatindissociable d’une forme de violence singulière qui caractérise le régime politique
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
108
mexicain contemporain. L’ethnographie et l’historiographie récentes de cettemunicipalité, et plus généralement du conflit armé au Chiapas, infirment le succèsd’une transition démocratique des années 1990 qui aurait mis fin à la violence. Leconflit armé chiapanèque et le massacre d’Acteal ont jeté un pavé dans la mare del’optimisme démocratique et multiculturel des promoteurs de la démocratie, rendant àl’évidence la question d’une transition d’un régime politique autoritaire à un régimepacifié plus difficile et complexe. L’histoire récente du pays confirme cet échec d’unetransition démocratique qui aurait mis fin à la violence.
34 L’un des faits les plus surprenants dans l’affaire Acteal réside dans le paradoxe à
disposer d’une quantité importante de documents alors que les questions les plusimportantes sur le massacre restent dans l’ombre, comme si elles avaient été enseveliessous le palimpseste des récits existant sur Acteal : qui sont les HUMINT et qui a étéformé par ces HUMINT ? Ces paramilitaires sont-ils réellement les « auteurs matériels »emprisonnés depuis 1998 ou s’agit-il d’autres groupes totalement absents des récitsexistants car protégés par l’État ? Ces interrogations qui subsistent confirment que lelien entre l’armement de paysans indiens et l’Armée fédérale est un lien obscur et nonassumé par l’État mexicain. Les massacres réalisés par des groupes irréguliers luioffrent la possibilité de nier sa responsabilité dans les violences exercées sur lespopulations tout en rejetant la responsabilité sur les civils. L’armement de civils et leurlien à l’Armée a produit un silence qui n’est pas sans rappeler la difficultéméthodologique à « décrire le caché 41 », là où des arrangements politiques, négociés encatimini, se font sur la base des relations interpersonnelles. Le lien politique entreautorités fédérales, forces publiques et groupes de pouvoir locaux est difficile, voireimpossible, à « démontrer » à l’aide de « preuves » (juridiques) car il renvoieprécisément au même silence et déni de l’État mexicain sur ses intentions violentes àcaractère expiatoire en temps de crise. En ce sens, l’affaire Acteal éclaire le rapport dela modernité de l’État mexicain à la violence.
NOTES
1. Cet article est le fruit d’une recherche doctorale en anthropologie politique à partir de
nombreux terrains menés entre 2003 et 2010 au Chiapas. La thèse, intitulée « Caciquismes,
résistances, violences. Les pedranos et l’État mexicain dans le Chiapas postrévolutionnaire » a été
soutenue le 12 novembre 2014.
2. L’organisation les Abeilles (Las Abejas) a été créée en 1992 dans la région des Hautes-Terres,
soit deux ans avant le soulèvement zapatiste. Il s’agit d’une organisation catholique progressiste
proche du Diocèse de San Cristóbal de Las Casas et de l’ancien Évêque Samuel Ruiz. Les membres
des Abeilles partageaient les mêmes demandes de justice sociale que les zapatistes mais
refusaient la voie armée.
3. Ginzburg C., « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », Le Débat, n°6,
novembre 1980, pp. 3-44.
4. Je reprends ici la définition d’Elisabeth Claverie de l’affaire, en tant que modèle historique
qu’elle identifie avec l’intervention de Voltaire pour dénoncer des injustices, et qui devint par la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
109
suite un modèle politico-judiciaire repris notamment par Zola dans l’affaire Dreyfus en tant
qu’outil critique. Cf. Claverie E., « Procès, affaire, cause. Voltaire et l’innovation critique », Politix,
vol. 7, n°26, 1994, pp. 76-85.
5. Rus J., « La comunidad revolucionaria institucional: la subversión del gobierno indígena en Los
Altos de Chiapas, 1936-1968 », in Chiapas: los rumbos de otra historia, México, UNAM/CIESAS/
CESMECA/Universidad de Guadalajara, 1995, pp. 251-277.
6. Pedranos est le gentilé par lequel s’identifient les habitants de la municipalité de San Pedro
Chenalhó, en référence à saint Pierre.
7. Les « cardénistes » constituent un groupe d’opposition historique précoce au PRI, au pouvoir
pendant 70 ans. Cette faction locale dissidente se situait sur des terres collectives à Los Chorros,
en marge du centre de la municipalité où se trouvaient les caciques du PRI. Ces ennemis
historiques firent néanmoins alliance en 1996 et 1997 contre le même ennemi zapatiste.
8. Le Bureau du Procureur de la République (Procuraduría General de la República, PGR) est l’organe
exécutif du Pouvoir exécutif fédéral au Mexique responsable des investigations et poursuites des
délits d’ordre fédéral. Celui-ci préside le Ministère Public de la Fédération et ses organes
auxiliaires que sont la police et les experts.
9. Pineda L. O., « Maestros bilingües, burocracia y poder político en Los Altos de Chiapas », in
Chiapas: los rumbos de otra historia, México, UNAM/CIESAS/CESMECA/Universidad de Guadalajara,
1995, pp. 279-300.
10. Procuraduría General de la República, Libro blanco sobre Acteal, Chiapas, México, Procuraduría
General de la República, 1998, p. 73, nous soulignons.
11. Ibid., p.95.
12. Ibid., p.56, nous soulignons.
13. Peu de temps après les faits, Julio César Ruiz Ferro a été désigné comme attaché agraire
(agregado agrario) à l’Ambassade du Mexique aux États-Unis. Jorge Madrazo Cuellar, directeur de
la PGR, a été désigné peu de temps après comme Consul du Mexique à Seattle. L’ancien Président
Ernesto Zedillo vit actuellement aux États-Unis où il enseigne à l’Université de Yale et est
conseiller d’entreprises transnationales (Protect & Gamble, IAP Morgan).
14. Hernández Castillo R. A, La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas, antes y después de Acteal,
México, International Work Group for Indigenous Affairs, 2007.
15. Le Plan de Campagne Chiapas 94 a été élaboré et rédigé par le Général José Rubén Rivas Peña,
un diplômé de l’École militaire des Amériques à Fort Benning en Géorgie. Au Chiapas, les groupes
« paramilitaires » ont été rattachés à la Force opérationnelle Arc-en-Ciel (Fuerza de Tarea Arcoiris),
un groupe d’élite aéroporté créé par le général Renán Castillo. À Chenalhó, cet engagement de
l’État dans le conflit s’est matérialisé surtout par l’intervention d’anciens militaires et de
policiers dans la formation de groupes armés locaux, puis par de nombreuses « omissions »
concernant les fonctionnaires locaux et des hautes sphères de l’État fin 1997.
16. Selon cette lecture, le conflit armé chiapanèque a consisté en une guerre menée sur tous les
fronts (militaire, économique, psychologique), utilisant les moyens de communication et la
culture locale pour installer la peur auprès de la population paysanne et indienne du Chiapas. Cf.
Castro G., Hidalgo O., La estrategia de guerra en Chiapas, México, Centro de Investigaciones
Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, 1999.
17. Castro Apreza I., « Quitarle el agua al pez: la guerra de baja intensidad en Chiapas
(1994-1998) », Chiapas, n°8, 1998.
18. La métaphore du poisson dans l’eau est employée dans ce manuel qui recommande d’agiter
l’eau des poissons, soit en y incorporant un venin pour qu’il ne puisse plus survivre, soit pour
mettre des poissons plus forts encore qui les attaquent, les poursuivent ou les obligent à
disparaître ou à courir le risque d’être mangés par des poissons affamés et agressifs qui sont donc
les contre-guérilleros.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
110
19. Castro Apreza I., « Quitarle el agua… », op. cit. ; Los grupos paramilitares en Chiapas, México,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 1999 ; Tavanti M., Las Abejas: Pacifist
Resistance and Syncretic Identities in a Globalizing Chiapas, New York, Routledge Member of the
Taylor and Francis Group, 2003, p. 76.
20. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Chiapas. La guerra en curso, México,
ProDH, 1998.
21. Champagne P., Faire l’opinion, Paris, Éditions de Minuit, 1990.
22. Claverie et Boltanski ont distingué l’« affaire » de la « forme affaire », la seconde débutant
quand un ou plusieurs acteurs se détachent du groupe jusque-là unanimement scandalisé pour
prendre la défense non des victimes imputées au fauteur de scandales, mais de ce dernier, dont
ils entreprennent de montrer et de faire reconnaître aux yeux de tous qu’il n’est pas le coupable
qu’on désigne à la vindicte publique, mais, au contraire, qu’il est lui-même une victime. Cf.
Boltanski L., Claverie E., « Du monde social en tant que scène d’un procès », in Boltanski L.,
Claverie E., Offenstadt N., Van Damme S., Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet,
Paris, Stock, 2007, p. 422.
23. Il s’agit d’une grande sculpture jaune représentant un cheval stylisé.
24. Il s’agit d’un groupe politique proche du parti conservateur, le Parti d’Action Nationale
(Partido de Acción Nacional, PAN), dirigé par Ricardo Raphael, neveu de l’ancien Président de la
République, journaliste de télévision (Programme « Espiral » de la chaîne Canal Once), directeur
de la Division d’Administration Publique du CIDE et à l’Institut Autonome de México.
25. Le sénateur Eric Hugo Flores (membre de l’Église Presbytérienne), les avocats Ana Laura
Magaloni Kerpel et Alejandro Posadas Urtusuástegui, et le journaliste et historien Héctor Aguilar
Camín.
26. Quarante-neuf des quatre-vingt sept détenus avaient fait appel immédiatement après leur
sentence. Le CIDE décida ainsi de mettre en avant les douze cas les plus emblématiques des
déficiences du système de justice mexicain, ceux des « plus innocents ».
27. Un debido proceso est un principe légal par lequel l’État doit respecter tous les droits légaux
que possède une personne selon la loi. C’est un processus juridique personnel selon lequel toute
personne a droit à un résultat juste et équitable au cours du procès. On doit lui permettre d’être
entendu et de faire valoir ses prétentions légitimes face au juge.
28. Celle de Florence Cassez a été l’une des plus médiatiques en France.
29. Il y avait d’autres irrégularités, comme le fait que l’institution n’avait pas fourni de
traducteurs aux accusés, souvent monolingues, pour leur déposition ; on demanda aux accusés et
aux survivants de répéter à plusieurs reprises leurs versions des événements, ce qui ne fut pas
sans dérouter les témoins et modifier leurs versions des faits ; des « erreurs » dans les
dépositions ne furent jamais rectifiées ; des jugements furent souvent reportés.
30. Posadas Urtusuástegui A., Flores H. E., « Acteal nueve años después: ¿Los culpables? », Nexos,
n° 348, décembre 2006 ; Aguilar Camín H., « Regreso a Acteal I. La fractura (octubre, 2007) »,
Nexos, n° 358, octobre 2007 ; « Regreso a Acteal II. El camino de los muertos », Nexos, n° 359,
novembre 2007 ; « Regreso a Acteal III. El día señalado », Nexos, n° 360, décembre 2007 ; Especial
Acteal, « Reconstrucción de las declaraciones ministeriales de Lorenzo Pérez Vázquez, Felipe
Luna Pérez, Mariano Luna Ruiz Segundo, Roberto Méndez Gutiérrez y Alfredo o Agustín
Hernández Ruiz », Nexos, n° 360, décembre 2007 ; Especial Acteal, « Reconstrucción de las
declaraciones ministeriales de Roberto Méndez a la Fiscalìa Especial del Caso Acteal », Nexos,
n°360, décembre 2007.
31. La notion d’épreuve provient des travaux de la sociologie pragmatique de Luc Boltanski et
Laurent Thévenot. Cf. Boltanksi L., Thévenot L., De la justification : les économies de la grandeur,
Paris, Gallimard. Les épreuves sont des dispositifs permettant de s’accorder sur la grandeur
relative des personnes et spécialement d’évaluer la pertinence de certaines de leurs prétentions
ou attentes ; Cf. Blic D. de et Lemieux C., « Le scandale comme épreuve, éléments de sociologie
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
111
pragmatique », Politix, n°71, pp. 9-39 : ils en donnent une définition plus agonistique, en tant que
rupture en situation de dispute et de conflit, dans laquelle les individus déplacent et refondent
l’ordre social qui les lie.
32. Lemieux C., « À quoi sert l’analyse des controverses ? », Mil neuf cent, vol.1, n°25, 2007,
pp. 191-212.
33. Certains ont trouvé le salut en devenant pentecôtistes.
34. Lefranc S., Lilian M., Mobilisations de victimes, Rennes, PUR, 2009.
35. Chaumont J.-M., La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, Paris, La
Découverte, 1997.
36. La Loi de Liberté d’Information (FAOI).
37. Knight A., « Caciquismo in the Twentieth Century México », in Knight A., Pansters W.,
Caciquismo in the Twentieth Century México, London, Institute for the Study of the Americas, 2005,
pp. 1-50.
38. Hugues E. C., Le regard sociologique. Essais choisis, Paris, Éditions de l’EHESS, 1996.
39. La nature et l’expression de ces violences politiques obligent à les différencier des dictatures
du Cône Sud ou des crimes actuels perpétrés dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic qui a
plongé le Mexique dans l’une des périodes les plus violentes depuis la Révolution mexicaine.
40. La récompense, le pain, peut s’exprimer par des aides matérielles (terre, crédit, argent), être
médiatisée par des bénéfices intangibles (emplois) ou non-matériels (protection contre le bâton
d’un cacique rival). Le bâton, quant à lui, n’est pas systématisé comme dans un régime militaire
où la violence est institutionnalisée. Au contraire, le recours à la force ne se fait que de manière
ponctuelle, mais souvent de manière directe et brutale sur les corps, cf. Knight A.,
« Caciquismo… », op. cit.
41. Blundo G., « Décrire le caché », in Blundo G., Olivier de Sardan J-P (dir.), Pratiques de la
description, Enquête 3, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2003,
pp. 75-111.
RÉSUMÉS
Cet article revient sur les enjeux politiques et herméneutiques du massacre d’Acteal, survenu le
22 décembre 1997 dans la municipalité de Chenalhó (État du Chiapas, Mexique) dans le cadre du
conflit armé qui débuta après le soulèvement zapatiste de 1994. Il se penche sur les différents
récits émis par les acteurs politiques (gouvernementaux et non-gouvernementaux),
universitaires et judiciaires qui, en dix ans, ont érigé le massacre en un paradigme de l’État
persécuteur. L’analyse des controverses et de la double affaire produite sur le massacre met en
exergue la bataille discursive entre ces acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. Dix
ans après les faits, une notable concurrence des victimes consista en une inversion rhétorique,
relayée sur les scènes judiciaire et médiatique, faisant des « auteurs matériels » du massacre des
« prisonniers innocents ». En outre, le caractère performatif de la violence, qui s’adosse à une
reconstruction postérieure des faits par les acteurs concernés, permet d’examiner l’évolution du
traitement du paramilitarisme au Mexique et d’analyser quelques spécificités du régime
mexicain par rapport à d’autres pays latino-américains.
This article reviews the policies and hermeneutical issues of the Acteal massacre, which occurred
on the 22nd of December 1997 in the municipality of Chenalhó (Chiapas, Mexico) and took place
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
112
in the context of an armed conflict that began after the Zapatista uprising of 1994. It examines
the different accounts issued by both governmental and non-governmental political actors
alongside academic and judicial actors who, in ten years, have established the massacre as being
in the paradigm of the persecuting state. An analysis of the controversies and the two-sided story
produced on the massacre underlines the discursive battle between those aforementioned
governmental and non-governmental actors. Ten years after the fact, noteworthy competition
between the victims consisted of a rhetorical inversion, relayed on judicial and media scenes,
turning the “material authors” of the massacre into “innocent prisoners”. Moreover, the
performative nature of the violence that leans against a subsequent reconstruction of events
from concerned actors enables an examination of the evolution of the issue of paramilitarism in
Mexico and an analysis of some of the specific features of the Mexican regime in comparison to
other Latin American countries.
INDEX
Keywords : Mexico, massacre, anthropology of violence, victims, ritual of repression
Mots-clés : Mexique, massacre, anthropologie de la violence, victimes, rituel de répression
AUTEUR
SABRINA MELENOTTE
Sabrina Melenotte est docteure en anthropologie sociale et ethnologie (spécialité anthropologie
politique) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Rattachée au Laboratoire
d’anthropologie des institutions et organisations sociales (LAIOS) de l’Institut interdisciplinaire
d’anthropologie du contemporain (IIAC), elle a mené ses recherches doctorales sur le
(post-)conflit armé dans l’État du Chiapas et poursuit actuellement des recherches sur les
disparitions dans l’État du Guerrero. Ses principales publications portent sur le zapatisme et la
violence politique au Mexique.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
113
Désarmer le sujet : souvenirs de laguerre et citoyenneté imaginée auPérouDisarming the Subject: Remembering War and Imagining Citizenship in Peru
Kimberly Susan Theidon
Traduction : Chowra Makaremi
NOTE DE L’ÉDITEUR
Cet article, paru en anglais dans Cultural Critique, n° 54, printemps 2003, pp. 67-87, estreproduit avec l’aimable autorisation de la revue.
1 La guerre et l’après-guerre sont de puissants paradigmes pour l’élaboration et la
transmission d’histoires individuelles, collectives et nationales. Ces histoires reflètentl’expérience humaine mais elles la façonnent aussi, en traçant les contours de lamémoire collective et en produisant des effets de vérité. Ces histoires utilisent le passéde manière créative, en en combinant et recombinant les éléments au service d’intérêtsdu présent. Dans ce sens, l’appropriation délibérée de l’histoire implique à la foismémoire et oubli – deux processus dynamiques imprégnés d’intentionnalité.
2 Dans cet article, j’explore les usages politiques des récits élaborés dans les villages
ruraux du département d’Ayacucho au sujet de la guerre civile qui a déchiré le Péroupendant près de quinze ans. Je montre que chaque récit a un dessein politique ets’adresse à une audience à la fois interne et externe. En effet, le déploiement des récitsde la guerre a beaucoup à voir avec la création de nouveaux rapports de pouvoir,d’ethnicité, de genre qui sont des composantes essentielles des redéfinitionscontemporaines du politique dans cette région. Ces nouveaux rapports influencent laconstruction des pratiques démocratiques et les modèles de citoyenneté élaborés dansle contexte actuel.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
114
3 De la même façon, ces récits sont une composante centrale de l’élaboration des
identités locales et nationales, l’épopée héroïque de la guerre structurant à la fois laforme et le contenu des histoires. Ce style épique, qui met l’accent sur l’héroïsmemasculin, a été canonisé non seulement dans ces communautés mais aussi dans lalittérature académique 2. L’effet « homogénéisant » de ces récits a obscurci lesexpériences et les compréhensions alternatives de la guerre, en compressant lesmémoires polyphoniques dans le paradigme dominant du récit guerrier 3. Cette versionmasculine de la guerre – des ronderos défendant leurs villages, triomphant du Sentierlumineux et instituant de nouvelles pratiques démocratiques et de nouvelles demandesde citoyenneté – masque la réalité contradictoire et disjonctive de la construction de lacitoyenneté dans ces villages 4. Je souhaite démontrer que ces disjonctions reflètent lesaxes de différenciation qui opèrent dans ces villages – des axes qui incluent le genre, lagénération et l’ethnicité.
4 Si la guerre a permis à des franges subalternes de la population rurale d’occuper le
devant de la scène nationale dans une construction lente et erratique de la citoyenneté,la participation armée contre le Sentier lumineux et la relation entre les rondas
campesinas (les patrouilles paysannes armées) et les forces armées ont renforcé lesrelations patriarcales à l’intérieur des villages, donnant lieu à un exercice inégalitairedes droits et du sentiment d’appartenance à cette communauté imaginée appeléenation. Lorsque l’intégration nationale s’opère par la participation à un conflit armé,elle influence la culture politique d’après-guerre, contribuant à ce que Caldeira etHolston appellent une « démocratie disjonctive ». Comme ils l’expliquent :
« En qualifiant la démocratie de disjonctive, nous voulons mettre l’accent sur le faitqu’elle est constituée de processus d’institutionnalisation, de pratiques et de miseen sens de la citoyenneté qui ne sont jamais uniformes ou homogènes. Au contraire,ces processus sont par nature irréguliers, déséquilibrés, hétérogènes, arythmiqueset de fait, contradictoires. Le concept de démocratie disjonctive souligne ainsi qu’àn’importe quel moment, la citoyenneté peut s’étendre dans un domaine de droitstandis qu’elle se contracte dans un autre. Le concept insinue aussi que ladistribution et la profondeur de la démocratie dans une population de citoyensdans un espace politique donné sont inégales 5. »
5 Si la distribution de la démocratie varie en fonction des axes de différenciation qui
caractérisent tout espace politique donné – que ce soit la nation ou une communautécampesina –, alors cela fait imploser la possibilité de parler du « subalterne » ou du« populaire » comme de groupes monolithiques dont les intérêts découlent« naturellement » des positions marginalisées de leurs membres. Toute logique binairequi construit une dichotomie rigide entre l’« officiel » et le « populaire » brouille à lafois la porosité de cette dichotomie et la fragmentation qui existe de chaque côté de lagrande division, tombant dans ce que Spivak appelle « l’apartheid féroce desoppositions binaires ».
6 Les oppositions binaires peuvent être féroces, mais les méta-récits montrent aussi les
crocs lorsqu’il s’agit d’imposer les termes du débat. Cette même logique binaire semanifeste en effet dans plusieurs textes sur la répression politique, les processusd’après-guerre et la mémoire. Il y a une structure analytique répétitive qui informe laproduction académique aussi bien que militante autour des ces thèmes. D’un côté de ladichotomie, nous avons la catégorie « mémoire officielle ». Cette catégorie semblerésumée par des noms et des adjectifs variés : « État », « institutionnel », « groupedominant », « mémoire hégémonique » – en bref, la « mémoire néfaste ou répressive ».
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
115
De l’autre côté, nous avons la « mémoire populaire ». Ses porteurs et adjectifs sont les« groupes subalternes », « les marginalisés », la « société civile » ou « la mémoirecontre-hégémonique » – en bref, la « mémoire bonne ou émancipatrice ». Reflétantl’influence de la psychanalyse sur nos façons de penser la mémoire, ce qui est réprimé apartie liée d’une façon ou d’une autre avec « la vérité » – le refoulé détient la cléproverbiale du réellement réel. Dès lors, le but implicite est de remplacer la « mémoireofficielle » par la « mémoire populaire » comme projet intrinsèquement démocratique.
7 Est-ce vrai qu’il n’y a ni pouvoir ni stratification au sein du « subalterne » et du
« populaire » ? Qu’y deviennent les axes de différenciation précédemmentmentionnés ? Homogénéiser le « populaire » revient à effacer le fait que celui-ci, quelque soit le contexte, peut être à la fois d’opposition et hégémonique. Comme le relèveMallon :
« La question de la complicité, de la hiérarchie, de la surveillance dans lescommunautés et les cultures subalternes est une question bien épineuse, unequestion qui a désespérément besoin d’être traitée avec nuance et bienveillance.Poser cette question montre qu’aucune identité subalterne ne peut être pure ettransparente ; la plupart des subalternes sont des sujets à la fois dominés etdominants, en fonction des circonstances et du lieu où on les rencontre 6. »
8 Dès lors, mon objectif dans cet essai est de décentraliser la production des mémoires –
toujours au pluriel – sans reproduire cette structure analytique binaire. Je cherche àmettre en lumière le potentiel démocratique de ces récits de guerre campesinos, aussibien qu’à capturer la manière dont le pouvoir du discours – l’autorité requise pourraconter ces événements – reste solidement ancré dans la bouche des hommes. C’estpourquoi je m’efforce de préserver la polyphonie qui interrompt le méta-récit, enespérant que la multiplication des voix historiques puisse contribuer à une démocratiemoins disjonctive et plus inclusive.
9 Les informations que j’utilise dans cet essai proviennent d’un terrain d’enquête effectué
dans diverses communautés à travers l’Ayacucho rural entre 1995 et 1999 7. Elles sontcomplétées par des documents écrits, les Libros de Actas 8 de plusieurs des communautésétudiées et des éléments d’histoire écrite produite par les autorités locales. Marecherche s’intéresse aux villages des montagnes du nord de l’Ayacucho, une régionayant joué un rôle central dans l’essor et le déclin du Sentier lumineux et où l’effort derepopulation initié en 1994 a été le plus intense. Par ailleurs, les processus de retour etde pacification qui ont été menés à bien dans la zone ont impliqué de nouveaux acteurssociaux, au-delà de la présence militaire. En effet, la présence d’organisations nongouvernementales et d’entités étatiques ajoute à la complexité des relations dans cesvillages et joue un rôle important dans les nationalismes campesinos qui sont imaginésdans l’Ayacucho rural.
Militariser la masculinité
10 En 1991, un jeune rondero d’Huayllay dans la province de Huamanga expliquait à mon
collègue Ponciano Del Pinto la rupture dans les relations de pouvoir entretenues avec leSentier lumineux et l’initiative d’une réaction paysanne organisée sous forme decomités de défense civils (rondas campesinas). Durant les premières années de la guerre,les relations entre les paysans et le Sentier lumineux relevaient d’une stratégie decoexistence, c’est-à-dire une posture ambiguë vis-à-vis des bénéfices potentiels offertspar les guérillas et une volonté d’attendre et de voir s’il y avait autre chose que des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
116
mots derrière le discours des insurgés. Mais cette relation s’est rapidement détérioréedu fait des pratiques autoritaires et de la violence létale des insurgés et des pressionsmilitaires subséquentes. Dans les mots d’un jeune rondero, la réponse organisée descampesinos envers le Sentier lumineux a impliqué un changement de la part de cespremiers – un changement de conscience qu’il résumait par « les gens commencèrent àdevenir virils (macho) 9 ».
11 Cette réaction campesina s’est rapidement étendue à travers plusieurs communautés du
nord de l’Ayacucho, où les villageois se sont mis à institutionnaliser leurs activités dedéfense dans le cadre de leurs rondas campesinas 10. Les rondas offraient de touteévidence une réponse à des menaces extérieures ; toutefois, elles ont été porteusesd’implications contradictoires quant aux relations à l’intérieur même des villages.
12 La trajectoire des rondas a varié d’une région à l’autre, et souvent, d’une communauté à
l’autre 11. Au départ, les rondas étaient dirigées par les autorités communales en place, àl’intérieur des structures et des organisations déjà établies. De plus, les Libros de Actas
des villages de Balcòn et Carhuapampa dans le Tambo et de Carhuahuràn dans leHuanta mentionnent la participation d’hommes aussi bien que de femmes 12. Cessources communales indiquent que les veuves et les mères seules ont étéréquisitionnées par les patrouilles de jour. Cette participation est corroborée par mesentretiens avec des villageoises. Par exemple, dans leurs témoignages, des femmes deCarhuahuràn et des hameaux annexés à ce village décrivent leur rôle dans la défense deleurs communautés. À rebours des images essentialistes montrant les femmes quifuient et se cachent, plusieurs d’entre elles évoquent la façon dont « nous nous sommesdéfendues avec des pierres, des couteaux et des lance-pierres ». En plus de leurparticipation armée, les femmes suivaient systématiquement les rondas lors de leurspatrouilles dans les campagnes, fournissant la nourriture et portant les munitions. Leconflit armé a remis en cause les codes de conduite d’usage et les rôles de genresinstitués. Cependant, la militarisation a essentialisé ces rôles – non pas au moment descombats mais dans la narration qui en est faite a posteriori.
13 La présence des femmes dans des activités de défense a perduré tout au long de la
guerre, mais sans que leur rôle soit officiellement reconnu. Ce manque dereconnaissance n’était pas dû à l’absence des femmes, mais plutôt aux valeursmasculinistes avec lesquelles les militaires sont arrivés dans la zone. La construction del’« hypermasculinité » du guerrier ne laissait aucune place discursive au rôle joué parles femmes paysannes dans l’effort de guerre. En effet, la présence militaire a importéde nouveaux modèles de masculinité mais aussi de féminité, qui se sont superposés auxschémas de genre existants, soulignant la dimension hiérarchique de ces relations degenre plutôt que leur complémentarité, qui était pourtant un thème fréquent dansl’étude du genre dans la région des Andes 13. Cet exemple nous permet d’ailleurs decritiquer la myopie de la littérature scientifique qui construit un modèlecomplémentaire en utilisant le foyer domestique comme unité d’analyse, passant soussilence à la fois les inégalités à l’intérieur de la famille et les concepts genrés quifaçonnent le monde plus large et inégalitaire dans lequel se situent ces foyers.
14 Quand l’alliance inconfortable entre militaires et population civile est devenue plus
étroite, entrainant la formation d’unités d’auto-défense spéciales composées de jeunesronderos payés par la communauté pour patrouiller à plein temps, la distance sociale etles hiérarchies de pouvoir fondées sur les catégories de genre, de génération etd’ethnicité se sont exacerbées. Ces jeunes ronderos ont repris à leur compte non
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
117
seulement le discours militaire mais aussi une constellation de pratiques quireprésentaient une nouvelle façon d’être des hommes. Par leurs noms de guerre –Rambo, Beast, Tiger, Wolf –, ils ont cherché à construire une identité qui rejetait leséléments considérés comme féminins ou « faibles ». En conséquence, l’identité qu’ils sesont construite contraste violemment avec les valeurs féminines, permettant à cesjeunes guerriers de se définir comme les « plus virils ». Cette nouvelle façon « d’être unhomme » s’appuie sur des formes globalisées de masculinité armée – des éléments dusoldat universel tel que représenté dans les films d’action omniprésents dans la région– pour établir une nouvelle posture au sein de la communauté ainsi que vis-à-vis del’État. Ces hommes ne sont plus d’humbles campesinos, baissant la tête et détournant leregard lorsqu’ils interagissent avec les sections plus larges d’une société qui les tientpour ignorants ; ce ne sont plus des campesinos méprisés, qui ont un accès minimal à desressources comme l’éducation ou la maîtrise de la langue espagnole. Comme le suggèreNelson dans son travail sur le Guatemala, « l’Indien est souvent connoté commeféminin » précisément par le manque d’accès aux ressources citées et au rôle de cesressources dans la définition de la masculinité 14. Être un guerrier a été un moyen deréduire la distance entre une identité féminisée et une masculinité désirée.
15 Au cours de ce processus de militarisation – un processus qui n’a pas seulement
impliqué des changements structurels mais aussi une transformation des consciences –les organisations communales établies ont laissé place à l’hégémonie des comités dedéfense et à leurs commandos. D’un côté, les senderistas ont assassiné nombre denotables locaux dans leur campagne de décapitation (descabezar) et de soumission descommunautés paysannes à leur idéologie révolutionnaire. De l’autre, les représentantsdes autorités locales, plus âgés, ont été supplantés par un nouveau leadership composéde jeunes ronderos. Ce nouveau leadership a légitimé leur position du fait de leurparticipation à la guerre et des liens étroits noués avec les militaires. Ainsi la guerre a-t-elle fini entre les mains de jeunes guerriers, qui ont par la suite immortalisé cettepériode à travers des histoires communales. Les guerres sont menées ; elles sont aussiracontées.
16 Appartenir à des patrouilles spéciales – être membre des Tigres 15 – signifiait pour ces
jeunes hommes l’obtention d’une reconnaissance au sein de la communauté et l’accèsau prestige masculin dans les représentations publiques. Ce capital symbolique asouvent été mobilisé par ces hommes dans leur recherche d’une compagne et fut aussiutilisé pour défier les hiérarchies de pouvoir traditionnelles, inversant les relations quiauparavant garantissaient autorité et pouvoir aux hommes plus âgés et, dans un degrémoindre, aux femmes plus âgées.
17 Toutefois, dans cette nouvelle hiérarchie, ces jeunes ronderos avaient des rivaux leur
disputant le titre de l’homme « le plus viril ». Ils pouvaient avoir développé cetteperception d’eux-mêmes au terme de la lutte contre le Sentier lumineux, mais lesmilitaires n’étaient pas disposés à leur céder ce titre. Parmi les stratégies utilisées pourasseoir leur pouvoir, les soldats ont à leur tour « féminisé » les ronderos. Dans mesentretiens avec les autorités dans les bases militaires de Carhuahuràn et Qellaqocha,celles-ci insistaient sur le fait que durant les attaques de Senderistas (combattants duSentier lumineux), les villageois avaient fui avec leurs armes, laissant derrière eux lesfemmes et les enfants. Dans la version militaire des attaques, c’étaient les soldats quiavaient sauvé la communauté villageoise, ce qui laissait entendre que les villageoisavaient été incapables de tenir leur rôle et de défendre « leurs propres femmes ».
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
118
18 Mais il y avait d’autres acteurs sociaux encore sur place : les Senderistas. Au long de la
guerre, les militants senderistas ont également usé de la féminisation afin de remettreen cause la valeur de leurs ennemis. Les Senderistas qualifiaient les soldats de« tapettes » qui étaient trop effrayés pour quitter la sécurité de leurs bases. De plus, lesvillageois se souvenaient de la façon dont les Senderistas se postaient au sommet descollines, baissaient leurs pantalons et les provoquaient en leur criant « Viens prendremon cul si tu peux », jouant par métonymie avec leurs fusils comme évocation du pénis.On observe ainsi de multiples masculinités déployées en vue d’établir des légitimités etdes relations de pouvoir à l’intérieur de nouveaux modèles militarisés définissant cequ’est « être un homme ». C’est la construction et la prédominance de ces valeurs quel’on peut qualifier de « patriarchie militarisée » et qui constitue le contexte dans lequelces populations vivent depuis vingt ans 16.
19 Les hommes ne sont toutefois pas les seuls à avoir joué de ces masculinités multiples.
Les femmes aussi se sont intégrées à cette scène. Face aux exigences de la violencepolitique et à l’absence de leurs proches, les veuves et les mères seules ont été forcéesde redéfinir leurs rôles et d’assumer de nouvelles responsabilités de défense, certainesdevenant même, dans certains cas, présidentes de leurs communautés et de leurscommandos de rondas. Par exemple, la présidente Modesta à Pampay, un village de lavallée du Huanta, évoquait ainsi sa trajectoire et la manière dont elle était devenuecommandante en chef de la ronda campesina du village en 1988, puis présidente de lacommunauté villageoise en 1994 :
« Nous étions devenues veuves, il y avait tant de veuves. Donc nous avons étéobligées de prendre des cargos [responsabilités communales]. Parce que nous étionsdes veuves et nos fils avaient quitté le village pour travailler ailleurs – qu’on leveuille ou non, nous devions faire quelque chose. »
20 La présidente Modesta a évoqué ensuite son expérience comme commandante de la
ronda à Pampay :
« Question : Et comment patrouilliez-vous ? En armes ?« Modesta : Oui, en armes. En mâchant notre coca, c’est comme ça que nous nousprotégions. Nous nous mettions dans la position d’un homme. « Question : Est-ce qu’il y avait beaucoup de peur ? « Modesta : Oh oui, une grande peur. Nous pensions qu’ils [les Senderistas] pouvaientdébarquer de jour comme de nuit et tous nous tuer. Mais nous étions expertes en lamatière. Qu’un chien se mette ne serait-ce qu’à aboyer et nous sautions sur nospieds ; avec tout ce que nous avions traversé, nous étions des expertes. »
21 L’idée de « se mettre dans la position d’un homme » montre à quel point
l’investissement de l’espace public et du pouvoir est associé à cette patriarchiemilitarisée. De fait, la femme qui assumait la fonction de commandante à Pampay medit : « Nous avons assuré la défense avec des armes, qarichakuspanchiik [en devenant
viriles] 17 ». Ce devenir viril n’est pas limité aux femmes de Pampay. D’après lesinformations recueillies auprès de ces mêmes autorités locales, en 1994, vingt-deuxfemmes de différents villages à travers la vallée du Huanta ont participé aux réunionsde coordination avec les patrouilles de défense civile dans la base militaire deCastropampa.
22 Cette présence relativement tardive des femmes dans le leadership des rondas
campesinas est assez exceptionnelle et témoigne non seulement de l’absence de leursmaris mais aussi d’une redéfinition de la stratégie militaire. Tandis que les premièresannées de la guerre étaient caractérisées par la présence de la marine – branche la plus
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
119
blanche et la plus élitiste des forces armées péruviennes – les efforts contre-insurrectionnels qui ont suivi se sont concentrés sur le développement d’alliances avecla société civile, donnant lieu à une plus grande ouverture vis-à-vis des villageoislocaux et une évolution vers l’intégration des lugareños [locaux] dans les rangs 18. Cetteintégration n’a pas impliqué de changements quant aux idées de masculinité et deféminité, mais a plutôt reflété une posture pragmatique assumée au niveauinstitutionnel. De plus, cette stratégie a fait partie du récit national du« fujimorisme 19 ». Ce récit triomphant soulignait les alliances entre forcées armées etpopulation civile plutôt que les massacres, les viols et autres abus qui ont aussi faitpartie de l’histoire de la guerre civile péruvienne.
23 Toutefois, le rôle des femmes n’était pas limité au processus du devenir viril
(qarichakuspanchiik) ; elles ont développé de multiples identités qui répondaient auxchangements abrupts accompagnant les années de guerre. Les femmes sont restéesresponsables de la préservation du foyer face au double péril de la violence politique etd’une pauvreté sévèrement exacerbée par la guerre.
24 Bien que la survie soit un enjeu moins dramatique que la lutte armée, une analyse de
l’économie domestique en temps de guerre révèle à quel point cette survie elle-mêmedevient une lutte quotidienne. Vivre dans des caves durant des mois et parfois desannées, changer d’abri tous les jours, cuisiner et s’occuper des enfants dans ces âpresconditions : les femmes n’ont pas limité leur participation à la guerre aux modèlesépiques masculinistes. Comme le racontaient les membres du club des mères à Purus :« Nous étions très tristes car nous ne pouvions pas nourrir nos enfants correctement.Nos enfants pleuraient pour avoir à manger, et c’est à la mère qu’il revient de fairequelque chose ». Ce que soulignent ces entretiens avec les femmes, c’est lareconnaissance implicite du rôle central des femmes, non seulement dans le système deproduction mais aussi de reproduction sociale – les deux étant menacés par la guerrequi met en doute jusqu’à la possibilité de la survie elle-même.
25 Néanmoins, le rôle actif qui fut celui des femmes durant la guerre est resté dans
l’ombre des historiographies locales élaborées dans ces villages. Je relève la différenceentre les discours et les pratiques, c’est-à-dire la différence entre les événements de laguerre et la mémoire sociale élaborée dans cette période de transition. La plupart deshistoires sur la violence politique dans la région sont des histoires d’hommes racontéespar des hommes. Comme le suggère Hayden White 20, seul un imaginaire narratif peutnous offrir une histoire parfaitement cohérente, sans contradictions, sans logiquesmultiples – une grande épopée héroïque à prétentions hégémoniques. De plus, Whitesuggère que la forme du récit n’est pas neutre mais informe activement le contenu, dufait des stratégies éculées de construction de l’intrigue. Il est certain que l’histoireépique est très familière. Depuis l’enfance nous sommes habitués à la forme épiqueprésente dans les histoires, les bandes-dessinées et les films. Comme l’affirme Cooke,ces histoires reflètent la paradigme dominant de la guerre « qui ressuscite les clichésessentialistes éculés sur l’agressivité des hommes et le pacifisme des femmes 21 ». Deplus, comme le montre Aretxaga dans son travail avec les femmes nationalistes enIrlande du Nord, ces clichés réduisent la participation des femmes à des anomalies dansles représentations du conflit 22.
26 Le mot d’« anomalie » mérite qu’on s’y attarde. Le dictionnaire de la langue anglaise
Third New World Dictionnary de Webster propose les entrées suivantes pour ce mot :« l’état ou le fait de ne pas être à “sa” place (vraie, normale ou attendue) ; déviation de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
120
la règle commune ; quelque chose qui ne s’aligne pas en particuliers avec les notionsétablies ou acceptées d’ordre ou de convenance ». Réduire les positions multiplesassumées par les femmes en tant que sujets, à la fois pendant et après la guerre, réduitaussi leur espace politique dans l’ordre nouveau formé sur les cendres de celle-ci.Clairement, les récits sont plus que « juste des histoires » : ils sont à la fois le lieu et lemedium de luttes politiques.
27 Je voudrais maintenant aborder les histoires élaborées dans l’Ayacucho et les
implications de ces histoires dans la construction des identités nationales et locales.
Mémoire et narrativité : politiques de l’identité
28 Chaque communauté se construit un passé, aussi bien pour forger un sentiment de
collectivité que pour présenter une identité cohérente à l’extérieur. Il me semble que laproduction revendiquée d’une mémoire historique commence là où il y a besoin d’unedéfinition de l’identité collective. Toutefois, le « nous » qui est construit est unecatégorie glissante et peut servir des intérêts à la fois inclusifs et exclusifs.
29 La question n’est pas de savoir si l’on possède ou non un passé, mais quel passé l’on
possède. Les historiens locaux portent la responsabilité de la sélection du passé dont onse souvient et de celui qu’on oublie. C’est à travers les histoires qui soulignentl’héroïsme masculin que les membres de la communauté ont développé une identitéstratégique qui leur a permis de présenter des revendications à l’État.
30 Dans les témoignages que j’ai recueillis dans plusieurs communautés du nord du Pérou,
où les communautés villageoises se sont organisées pour résister au Sentier lumineux,il est fréquent d’entendre des histoires avec une structure narrative similaire et lemême discours nationaliste. L’héroïsme de la résistance paysanne est une composantecentrale de la construction des identités individuelles et locales. C’est une identité quioffre aux hommes une reconnaissance et une fierté dans une société fortementmarquée par les distinctions sociales, linguistiques, ethniques : elle leur permet de seprésenter vis-à-vis de la société et de l’État comme légitimes « défenseurs de La Patria etde la démocratie ». Dans ces représentation publiques, ces hommes performent lemême nationalisme militarisé qui imprègne leurs récits. Alonso fait remarquer quel’argumentation d’Anderson au sujet de la communauté imaginée s’est révélée très utilepour saisir la construction de la nation, mais qu’« Anderson ne va pas assez loin dansl’identification des stratégies à travers lesquelles ce qui est “imaginé” devient une“seconde nature”, une “structure du sentiment” incarnée dans les pratiquesmatérielles et les expériences vécues 23 ». C’est précisément durant ces performancesque le concept de nation – la perception d’une nation à laquelle ils participent commecitoyens plutôt que comme « Indiens » – est incarné. Comme le remarque Connerton,« la mémoire performative est corporelle. Dès lors, un aspect de la mémoire sociale aété grandement négligé, qui est pourtant absolument essentielle : la mémoire socialecorporelle 24 ». Ainsi les ronderos vivent-ils leur nationalisme et revivent-ils leur passéglorieux à travers ces techniques du corps, incarnant la nation à chaque marche au pasde charge et à chaque main droite levée en salut au drapeau.
31 Prenons l’exemple des Fiestas Patrias (les célébrations du jour de l’Indépendance) dans
la communauté de Carhuahuràn en 1998, lors desquelles le maire a fait un discourspour tous les ronderos présents durant la levée du drapeau. Le maire Rimachi étaitconsidéré comme un héros du conflit armé et un historien légitime des années de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
121
guerre. Son corps même portait la preuve de son héroïsme : au lieu de dix doigts, sesphalanges se terminaient pas des moignons mutilés, fruit de l’explosion d’une grenadesenderista alors qu’il déchirait le drapeau rouge que la guérilla avait hissé par défi ausommet d’une colline bordant le village.
32 Lors de la levée du drapeau péruvien – usage en vigueur chaque dimanche dans les
villages ruraux de l’Ayacucho –, le maire Rimachi s’est adressé à la foule qui s’étaitformée en rangs et en colonnes, le fusil à l’épaule :
« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de notre pays, et nous tous, en tant que Péruviensdevons le célébrer avec fierté, affection et respect. C’est un jour comme celui-ci quenous nous sommes libérés de la domination espagnole, et que nous nous sommesbattus contre le Sendero pour défendre ce que cela veut dire que d’être Péruvien. Cesentiment de nous être battus doit être présent en nous afin que nous nous sentionsfiers et nous souvenions que le combat n’est pas terminé, mais pourraitrecommencer à n’importe quel moment. C’est pourquoi nous devons être prêtspour cette tâche et ne pas perdre la ferveur que nous avions. »
33 J’aimerais préciser que le « nous » invoqué n’englobe pas tous les membres de la
communauté. Dans cette cérémonie de levée du drapeau, comme dans les autresauxquelles j’ai assisté, seuls les hommes participaient ; les femmes observaient de loinsur le pas des portes ou assises en groupe avec leurs enfants. De plus, reflétant larelation intime entre langage, prestige et pouvoir, le maire Rimachi s’adressait à lafoule en espagnol et non en quechua, langue maternelle de tous les membres del’assemblée. En effet, la grande majorité des ronderos rassemblés (et virtuellementtoutes les femmes présentes en périphérie) ne parlaient que le quechua, et dès lors nepouvaient pas saisir grand chose du discours du maire. De toute évidence, il était plusimportant d’employer la langue nationale pour son impact, que de parler dans unelangue compréhensible par tous ceux qui étaient réunis dans le champ. Andersoninsiste sur le rôle du langage comme véhicule de l’intégration nationale, prêtant uneattention moindre aux façons dont le langage peut servir des objectifs d’exclusion 25. Ilest significatif que le maire Rimachi ait changé de registre, du quechua à l’espagnol,dans ses discours publics, démontrant ainsi sa capacité à accéder à un pouvoir extra-local et à s’imposer comme médiateur entre la société rurale et la nation.
34 De plus, j’aimerais souligner l’histoire glorieuse de lutte que raconte le maire Rimachi,
tissant ensemble deux siècles de résistance au nom de La Patria. L’histoire ici n’est passeulement racontée, elle est utilisée. La réappropriation du passé est encore plusfrappante dans l’histoire écrite que le maire a composée pour un concours sponsorisépar une organisation non gouvernementale en 1997. La compétition s’adressait auxprésidents des communautés villageoises et les invitait à écrire l’histoire de leurcommunauté pendant la guerre, un prix étant décerné à la « meilleure histoire ».
35 Dans un texte appelé « Le problème des résistants : une histoire qui se répète après 182
ans », le maire Rimachi commençait en expliquant à ses lecteurs que « les villageois decette région ont une histoire de rébellion qui remonte aux temps où les pocras
s’allièrent avec les chancas et les wancas afin de repousser les Incas qui arrivaient depuisleur base de Cuzco. Lors des soulèvements des Iquichanos, Carhuahuràn était le centrelogistique. Dans les guerres d’indépendance, nous nous battîmes pour les Espagnols,prenant plus tard les armes contre la dictature de Bolívar en 1827. » Il continuait sonrécit en faisant la chronique des principales offensives senderistas qu’endurèrent lacommunauté de Carhuahuràn et ses annexes, le nombre de morts faits par lesditesoffensives et comment les « paysans rebelles » renversèrent la guérilla. Il finit son
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
122
histoire en déclarant : « On peut affirmer que le meilleur paysan est le paysan péruvien,pour sa résistance, sa capacité à se rétablir et son adaptation aux inclémences, auxdésastres et aux problèmes civils que nous avons enduré durant les quatorze années dela guerre contre les subversifs, et la façon dont il prouve devant l’histoire ses capacitéset sa résilience lorsqu’il se trouve confronté à de mauvais éléments ».
36 Dans cette histoire glorieuse d’un « peuple rebelle », on voit la construction d’une
identité qui s’étend sur deux siècles et réhabilite une population longtempsmarginalisée comme chutos (sauvages) des montagnes. En s’appropriant l’espace publicde la levée du drapeau lors des Fiestas Patrias, les ronderos ont réinvesti cet actenationaliste en y projetant leur propre signification – non seulement comme desmembres de la nation, mais comme des héros de La Patria. Cette réinscription s’est faitelittérale plus tard dans la journée, lorsque les ronderos des villages alentours se mirent àparader avec un drapeau péruvien retravaillé de sorte que la figure d’un rondero avecson fusil remplaçait le symbole national du bouclier qui figure normalement au centredu bandeau blanc.
37 J’insiste sur le fait que c’est « un peuple » qui se recrée à travers des récits. Dans cette
histoire glorieuse, ce dont on se souvient se combine à ce qu’on décide d’oublier. Nullepart dans cette longue chronique, il n’est fait mention de la servitude de cettepopulation soumise aux haciendas qui, il y a trente ans, existaient encore partout dansla région. Oublier peut également signifier se souvenir d’autre chose – remplacer unehistoire de traitements racistes et humiliants infligés par les hacendados par une autrehistoire qui efface ce stigmate ethnique.
38 L’ethnogenèse des montagnes est un élément central dans ce processus d’effacement.
Parmi les profondes évolutions politiques des trois dernières décennies, il y a eu lepassage d’une « administration ethnique » dans les hacendados à l’élaboration d’uneidentité ethnique nouvelle et amorphe d’« Altoandinos » (Hauts-andins). Ce terme futd’abord utilisé par des organisations non gouvernementales en 1993 pour définir lecadre géographique de leur intervention, mais à mesure que les villageoiss’organisaient pour retourner dans leurs villages et les reconstruire, ils ont commencéà l’utiliser comme un marqueur d’identité régionale, insistant sur le fait que « nous nesommes plus des chutos, nous sommes des Altoandinos ». En sept ans seulement, unenouvelle identité ethnique a été créée à partir des catégories usuelles développées parles organisations non gouvernementales qui ne se rendaient souvent pas compte desréinvestissements complexes des étiquettes technocratiques par leurs « bénéficiaires »,et l’émergence de nouvelles subjectivités à laquelle elle donnait lieu 26. Les leaderslocaux ont récemment commencé à s’organiser et lancer des pétitions afin que leurscommunautés montagnardes soient reconnues sous le nom de Province altoandine.
39 J’aimerais revenir à ce dimanche dans le village et aux drapeaux si fièrement
retravaillés. Même si aucune femme n’était présente dans l’assemblée, cela ne veut pasdire qu’elles n’imaginent pas la nation. Par exemple, ce jour-là, je me suis assise et mesuis mise à discuter avec Victoria, qui m’a demandé si par hasard j’avais un drapeauqu’elle pourrait suspendre à sa fenêtre. Elle m’a dit : « Si je ne suspends pas de drapeau,ils peuvent dire que je suis une terroriste et me donner une amende ». Chaque année,m’a-t-elle raconté, des drapeaux étaient suspendus aux fenêtres pour la Fiestas Patrias ;mais dans sa jeunesse, ils n’en suspendaient jamais. Victoria a continué : « Depuis queles violences ont commencé et que les soldats sont arrivés, nous nous sommes mis àconnaître le drapeau péruvien ». Auparavant, les montagne étaient « una zona
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
123
olvidada » (une zone oubliée), mais la violence a entraîné une présence de l’État dansdes villages reculés, et c’est d’abord en envoyant des soldats que l’État a marqué saprésence.
40 Ce nationalisme campesino est disjonctif, contradictoire et imaginé de façon différente
selon l’emplacement social des acteurs, mais aussi selon l’audience. Non seulement uneorganisation non gouvernementale sponsorise-t-elle un concours pour les« meilleures » histoires de guerre, mais d’autres agents extérieurs viennent aussi enrecherche de sens du passé, insufflant la réélaboration et la narration de ces souvenirs.Ainsi des anthropologistes, qui arrivent avec des questions ciblées sur les patrouilles dedéfense civile et la violence politique. Dans le premier cas, on entend ces récits épiquesde bravoure armée, et dans le second, on élabore une ethnographie de la violenceplutôt qu’une étude de la vie humaine dans toute sa complexité. Il est important desouligner l’intersubjectivité de la mémoire – le narrateur et son audience tracentensemble les contours du souvenir.
41 Tandis que ces structures narratives sont manipulées par la mémoire, elles ont des
effets directs sur les pratiques politiques et l’accès à l’espace public. L’idéologie del’héroïsme masculin s’inscrit comme nous l’avons vu dans des pratiques spatiales, quide fait marginalisent les femmes. La pratique symbolique qui revient à lever le drapeaunational chaque dimanche tandis que les ronderos se mettent au garde à vous – cetusage par lequel les hommes affirment un sentiment d’appartenance à l’État etperforment le nationalisme militarisé forgé durant la guerre – est une pratique spatialemasculiniste qui, littéralement, relègue les femmes aux marges.
42 Je ne cherche pas à nier l’importance des rondas campesinas dans l’infléchissement du
cours de la guerre et dans l’apprentissage politique des villageois en tant qu’acteurshistoriques et sujets possédant des droits. Mais j’insiste sur l’emprise inégale dusentiment d’appartenance à l’État et d’intégration nationale. Les récits de guerremasculinistes ne touchent pas seulement une audience externe mais sont dits et reditsau sein même des villages. Et c’est là aussi qu’ils produisent leur effets de vérité et depouvoir.
43 Je voudrais renverser la focale d’Anderson et d’Hobsbawm et Ranger 27, qui considèrent
les élites comme les auteurs principaux des communautés imaginées de la nation et del’invention des traditions. Il est intéressant à l’inverse de suivre l’horizon d’enquêteproposé par Joseph et Nugent ainsi que Manrique et Mallon 28, en explorant lesnationalismes campesinos et les formes quotidiennes de formation de l’État. C’est ce quej’aimerais approfondir à présent.
Citoyenneté et nouvelles pratiques politiques
« Kimberley : Pourquoi lèvent-ils le drapeau chaque dimanche ?« Victor (onze ans, Carhuahuràn) : Pour que s’il y a des terroristes sur les collines, ilssachent que des Péruviens vivent ici.« Kimberley : Victor, pourquoi n’y a-t-il pas de femmes lors de la levée du drapeau ? « Victor : Les femmes ne participent pas.« Kimberley : Et pourquoi ?« Victor : Les femmes sont moins péruviennes, elles ne sont pas armées. »
44 Bien que la guerre constitue le thème central de l’histoire de ces villages, la lecture des
Libros de Acta de Balcón, Carhuapampa et Carhuahurán a révélé des informationssurprenantes. Même au plus fort des années de guerre, ces documents communaux font
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
124
état de la tenue d’assemblés discutant « el progreso del pueblo » (les progrès du village).Dans les périodes de calme relatif entre les attaques, les villageois continuaient deplanifier et de travailler en vue du développement de leur village, que ce soit enpétitionnant pour la construction de routes, de centres de santé et d’écoles, ou enmettant en place une districtalisation comme à Carhuahurán. Ces Libros de Actas sontdes archives qui ne témoignent pas seulement de l’horreur de la guerre, mais aussid’une posture développementaliste inébranlablement orientée vers le futur.
45 Ce tandem peu probable de la guerre et du progrès répète la même logique : les femmes
y sont vues comme moins agissantes. Dans son remarquable travail 29, De la Cadenaanalyse les thématiques du genre et de l’ethnicité dans le contexte cuzcaincontemporain. Elle suggère que parce que les femmes parlent moins l’espagnol et ontmoins d’expérience urbaine, elles sont considérées comme « plus indiennes ». C’est-à-dire que le genre, la race et l’ethnicité sont des axes de différenciation qui fonctionnentde façon multiplicative, portant préjudice aux femmes qui se trouvent au croisement deces façons de catégoriser les gens et de construire des hiérarchies fondées sur cescatégories 30.
46 Dans le contexte ayacuchan, la construction des femmes comme « plus indiennes » – ou
« moins développées » – est exprimée par Victor qui les tient pour « moinspéruviennes ». Cette catégorisation trace un lien invisible entre le modèle decitoyenneté qui a émergé durant les années de violence politique et l’image des femmessubordonnées à la patriarchie militarisée. Ce lien a des implicationsintergénérationnelles dans la mesure où les enfants absorbent ces valeurs masculinistescomme requis fondamentaux de la construction de la citoyenneté. Nous avons là unexemple de cette citoyenneté armée et masculiniste que Elshtain appelle la « vertucivique armée », c’est-à-dire la fusion des idées de la citoyenneté et du concept du bonguerrier (homme) 31.
47 Ce modèle de citoyenneté militarisée correspond non seulement au désir des ronderos
de maintenir leur pouvoir au sein de la communauté, mais aussi à une forme de capitalsocial qui permet à ces hommes de négocier leur entrée dans le « monde moderne ».Alors que je récoltais des témoignages, plusieurs ronderos me soutenaient que leursrécits de guerre avaient une valeur marchande. En effet, plusieurs hommes insistaientsur le fait que j’étais en train de mettre par écrit leurs fables héroïques afin de lesvendre à des radios internationales pour des sommes extravagantes. Il est significatifqu’ils se soient mis à penser à la valeur marchande des choses uniquement lorsqu’ilsont commencé à parler de leur participation à la lutte armée contre le Sentierlumineux. Il semble que la seule forme de capital qu’ils possèdent sur le marché globalest celui qu’ils peuvent mettre en récit.
48 Si les femmes sont reléguées aux marges de ce « mercado de valor » (marché du courage/
de la vertu), cela ne veut pas dire pour autant qu’elle ne franchissent jamais ces marges.En réalité, elles ont bénéficié elles aussi d’un apprentissage politique à travers leurspropres luttes. Par exemple, la présidente Modesta, lorsqu’elle évoquait les exactionscommises par les Sinchis (les troupes de contre-insurrection gouvernementales) durantles premières années de la guerre, me dit : « En ce temps-là, nous n’avions pas notreexpérience. Si ça avait été alors comme c’est aujourd’hui, oh ! qu’est-ce qu’on n’auraitpas fait – on serait allées voir les juges, les groupes de droits de l’homme – on seraitallées partout. Mais ce n’est que récemment que nous avons acquis nos capacités. En cetemps-là, nous étions juste comme des enfants, sans aucun discernement du tout. »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
125
49 Il n’y a pas que les femmes devenues des autorités villageoises qui commentent les
évolutions des années de guerre. Le sentiment d’avoir vécu des « temps accélérés » estgénéralisable. Ces changements sont plus sensibles encore pour les villageois déplacésinternes vers les villes. Citons par exemple Teodora, une femme âgée de 26 ans deMacabamba, une « communidad retornante » (communauté retournante 32). Bien qu’ellesoit jeune, elle parle en entretien comme une vieille grand-mère se souvenantd’histoires sorties d’un passé lointain :
« De mon temps, les parents n’autorisaient pas leur filles à aller à l’école. “Si vousvoulez y aller, alors emmenez vos bêtes avez vous !” Voilà ce qu’ils disaienttoujours. Avant, et aujourd’hui encore, les filles travaillaient plus dans les familles,lavant les vêtement, cuisinant, s’occupant des bêtes, ramassant le bois. Avant,c’était encore pire parce que les gens pensaient que les choses resteraient toujourscomme ça. Mais les choses ne sont pas ainsi. Ensuite, nous avons compris cela etnous avons compris qu’aujourd’hui et dans le futur, la vie est à los que tienen ojos [ceux qui ont des yeux/une vision/une éducation]. Cette différence est apparue après losaccidentes [la guerre]. C’est pour cela que maintenant les filles font des étudescomme les garçons, elles finissent même l’école primaire. Maintenant, elles nousprennent comme des exemples d’ignorance, de ce qu’elles ne doivent pas être. »
50 Les changements brusques de la guerre semblent avoir eu pour effet d’élargir les rôles
des femmes dans leurs communautés. On aurait pu espérer que les narrations de laguerre reflèteraient cette ouverture au lieu de l’étouffer.
51 Il semble opportun de conclure en pensant en termes d’hégémonie en relation à la
mémoire aussi bien qu’au genre. L’hégémonie est toujours partielle, et demande à êtrepréservée face aux assauts contre-hégémoniques. Ortner nous invite à être attentifsaux contradictions et à la multiplicité des logiques qui opèrent dans une sociétédonnée ; en fait, elle suggère qu’il est fructueux d’analyser ces situations en termes detransformations sociales. « Il y a un ordonnancement – une hégémonie dans le sensd’une domination relative de certaines pratiques et significations sur les autres. C’est àla fois cette mise en ordre et son brouillage potentiel qui m’intéresse 33. » L’intérêtd’écouter et d’enregistrer des versions multiples de la guerre tient précisément dansleur potentiel de désordre.
52 À l’évidence, l’idée n’est pas de remplacer une narration monolithique par une autre,
tout aussi univoque. Cela me rappelle la première vague de la théorie féministe nord-américaine. Écrivant à l’intérieur du cadre théorique du matérialisme historiquemarxiste, de la sociologie wébérienne et de la psychanalyse freudienne, cette vague deféminisme académique cherchait à remplacer la grande théorie (androcentrique) en yapportant une méta-correction féministe. Le problème était la domination masculine,la solution, la théorie féministe : toutes deux au singulier.
53 Préserver la polyphonie des voix historiques – déconstruire « le subalterne » pour en
examiner les multiples fragments et la totalité complexe, et articuler ces deuxdimensions aux relations de pouvoir aux niveaux locaux, régionaux et nationaux –désarme le sujet qui fonde le modèle de la citoyenneté émergeante dans ces villages. J’aiespoir que si jamais l’on parvenait à désarticuler les droits à la citoyenneté du symboledu rondero armé, alors il serait peut-être possible de développer une démocratie plusprofonde qui permette à tous les membres de ces communautés – todos y todas – de sesentir membres à part entière de la communauté nationale.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
126
NOTES
2. Par exemple, voir Degregori C. et al., Las rondas campesinas: la derrota de Sendero Luminoso, Lima,
Instituto de Estudios Peruanos, 1996.
3. Cooke M., Women and the War Story, Berkeley, University of California Press, 1996.
4. Les ronderos sont les hommes qui participent aux rondas campesinas, les patrouilles paysannes
armées dans les villages en zone rurale. Le Sendero Luminoso (Sentier lumineux) est un groupe de
guérilla d’inspiration maoïste qui a initié un mouvement de lutte armée pour renverser l’État
péruvien en 1980. Ses membres sont appelés Senderistas.
5. Caldeira T. et J. Holston, « Democracy and Violence in Brazil », Comparative Studies in Society and
History, vol. 40, n° 40, 1996, p. 717.
6. Mallon F., « The promise and Dilemna of Subaltern Studies: Perspectives from Latin America
History », American Historical Review, vol. 148, décembre 1994, pp. 1491-1515. Sherry Ortner fait un
même raisonnement lorsqu’elle évoque de façon éloquente le « refus ethnographique », qui
consiste en l’aseptisation des politiques, l’appauvrissement des cultures et la dissolution des
acteurs, donnant lieu à une étude romantique des subalternes et de la résistance (voir
« Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal », Comparative Studies in Society and History,
vol. 37, 1995, pp. 173-193).
7. Ma recherche a été rendue possible grâce à des bourses du Social Science Research Council, de
l’American Council of Learned Societies, de la Wenner Gren Foundation, la Inter-American Foundation, et
du Human Rights Centre de l’université de Berkeley. Je suis aussi reconnaissante du temps
d’écriture qui m’a été offert grâce au soutien de l’Institute on Violence, Culture and Survival à la
Virginia Foundation for the Humanities, du Centre for International Security and Cooperation de
l’université de Stanford et de la Harry Frank Guggenheim Foundation. Je suis reconnaissante du
soutien financier et des relations académiques cordiales entretenues avec les représentants de
chacune de ces institutions. Pour les discussions fécondes sur les thèmes développés dans cet
article, je remercie José Coronel, Ponciano Del Pino, Kathleen Dill, CaroGluck, Elizabeth Jelin, Ron
Kassimir, Pablo Efraìn Loayza, Carlo Nasi, Madelene Pariona Oncebay, Barry O’Neill et Susana
Villaràn. Je remercie les relecteurs anonymes pour leurs commentaires extrêmement utiles.
8. NdT. Cahier ou livre où sont enregistrées toutes les réunions communautaires, toutes les
décisions de la communauté, et tous les évènements importants qui se sont produits.
9. Cité dans Del Pino P., « Los Campesinos en la Guerra: o de cómo la gente comienza a ponerse
macho », in Degregori C., Escobal J., Marticorena B. (eds.), Perú: el problema agrario en debate/SEPIA
IV, Lima, UNAP/SEPIA, 1992.
10. Le nord de l’Ayacucho comprend les provinces de Huamanga, Huanta et LaMar. Je ne cherche
pas ici à analyser les raisons de la mobilisation de la population paysanne contre le sentier
lumineux, mais m’intéresse plutôt aux implications de la guerre en termes de relations de
pouvoir et de rôles genrés dans l’Ayacucho rural. Pour une analyse approfondie des processus de
violence et de l’histoire des rondas campesinas en Ayacucho, voir Degregori et al., Las rondas
campesinas, op. cit.
11. La trajectoire des rondas campesinas dans le nord du Pérou est évoquée dans Starn O.,
Nightwatch: the Politics of Protest in the Andes, Durham, Duke University Press, 1999 et Huber L., Las
rondas campesinas de Piura, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1995.
12. Je remercie Ponciano Del Pino pour le partage des documents de Tambo.
13. Voir : Arnold D., « Introduction », in Arnold D. (ed.), Màs allà del silencio: las fronteras de género
en los Andes, La Paz, CIASE/ILCA, 1997 ; Harris O., « Complementarity and Conflict: An Andean
View of Women and Men », in Fontaine J. S. (ed.), Sex and Age as Principles of Social Differentiation,
New York, Academic Press, 1978 ; Isbell B. J., « La otra mitad esencial: Un estudio de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
127
complementaridad sexual andina », Estudios Andinos, vol. 12, n° 5, 1979, pp. 37-56 ; Silverblatt I.,
Moon, Sun, and Witches: Gender Ideologies and Class in Inca and Colonial Peru, Princeton N. J., Princeton
University Press, 1987 ; Reynaga G., « Cambios en las relaciones familiares campesinas a partir de
la violencia política y le nuevo rol de la mujer », Documento de Trabajo, n° 75, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 1996.
14. Nelson D., A Finger in the Wound: Body Politics in Quincentennial Guatemala, Berkeley, University
of California Press, 1999, p. 26. Il est également à noter que la présence des soldats a augmenté la
prostitution, promouvant l’acte sexuel comme un bien à valeur d’échange dans ces villages : cette
dimension est analysée en profondeur dans ma dissertation doctorale : Traumatic States: Violence
and Réconciliation in Peru, University of California at Berkeley, 2002.
15. « Les Tigres » est le nom d’un commando spécial d’autodéfense, une organisation civile qui
opérait à temps plein avec un salaire mensuel payé par les membres de la communauté. Ce
commando était composé de jeunes hommes âgés de 15 à 33 ans, qui sont aujourd’hui parmi les
plus expérimentés aux combats.
16. Je remercie Ponciano Del Pino pour la discussion autour de ce terme.
17. Entretien mené à Pampay en 1995.
18. Voir Degregori C. et C. Rivera, FFAA, subversión y democracia, 1980-1993, Lima, Instituto de
Estudios Peruanos, 1993 ; Tapia C., Las fuerzas armadas Sendero Luminoso: Dos estrategias y un final,
Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1997.
19. Alberto Fujimori a été président du Pérou de 1990 à 2000. Il a fondé en grande partie sa
crédibilité politique et son pouvoir sur sa victoire sur le Sentier lumineux. Depuis, il a été écarté
du pouvoir du fait d’accusations de fraude électorale, corruption et crime contre l’humanité.
20. White Instituto de Estudios Peruanos, The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical
Representation, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1987.
21. Cooke M., Women and the war story, op. cit., p. 15.
22. Aretxaga B., Shattering Silence: Women, Nationalism, and Political Subjectivity in Northern Ireland,
Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 10.
23. Alonso A. M., « The Effects of Truth: Re-presentations of the Past and the Imagining of
Community », Journal of Historical Sociology, vol. 1, mars 1988, pp. 33-57, p. 15.
24. Connerton P., How Societies Remember, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 71.
25. Pour une discussion des hypothèses erronées d’Anderson sur la standardisation linguistique
et la construction nationale, voir Silverstein M., « Whorfianism and the Linguistic Imagination of
Nationality », in Kroskrity P. (ed.), Regimes of Language: Ideologies, Polities, and Identities, Santa Fe,
School of American Research Press, 2000.
26. Escobar A., Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton,
Princeton University Press, 1995.
27. Anderson B., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres,
Verso, 1991 ; Hobsbawm E. et T. Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge
University Press, 1987.
28. Joseph G. et D. Nugent, Everyday Forms of State Formation, Durham, Duke University Press, 1994
; Mallon F., Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru, Berkeley, University of
California Press, 1995 ; Manrique N., Campesinado nación: Las guerrillas indígenas en la guerra con
Chile, Lima, Centro de Investigación Instituto de Estudios Peruanos Capacitación-Editora Ital Perú,
1981.
29. De la Cadena M., « Las mujeres son más indias: Etnicidad y género en una comunidad del
Cusco », Revista Andina, n° 17, 1991, pp. 216-249.
30. Pour une argumentation analogue sur les rapports entre ethnicité, genre et construction
nationale (nation building) au Guatemala, voir Nelson D., A Finger in the Wound: Body Politics in
Quincentennial Guatemala, Berkeley, University of California Press, 1999.
31. Elshtain J. B., Women and War, New York, Basic Books, 1987.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
128
32. Désigne ceux qui ont quitté une zone de guerre, puis qui sont revenus s’y installer (NdT).
33. Ortner S., « Gender Hegemonies », Cultural Critique, vol. 15, hiver 1990, p. 46.
RÉSUMÉS
La guerre et l’après-guerre sont de puissants modèles pour l’élaboration et la transmission
d’histoires individuelles, collectives et nationales. Ces histoires reflètent l’expérience humaine
mais elles la forment aussi, en traçant les contours de la mémoire collective et en produisant des
effets de vérité. Ces histoires utilisent le passé de manière créative, en en combinant et
recombinant les éléments au service d’intérêts du présent. Dans ce sens, l’appropriation
délibérée de l’histoire implique à la fois mémoire et oubli – tous deux processus dynamiques
imprégnés d’intentionnalité. Cet article explore les usages politiques des récits élaborés dans les
villages ruraux du département d’Ayacucho au sujet de la guerre civile qui a déchiré le Pérou
durant quelque quinze années. Chaque récit a un dessein politique et s’adresse à une audience à
la fois interne et externe. En effet, le déploiement des récits de la guerre a beaucoup à voir avec la
création de nouveaux rapports de pouvoir, d’ethnicité, de genre qui sont des composantes
essentielles des redéfinitions contemporaines du politique dans cette région. Ces nouveaux
rapports influencent la construction des pratiques démocratiques et les modèles de citoyenneté
élaborés dans le contexte actuel.
War and its aftermath serve as powerful motivators for the elaboration and transmission of
individual, communal, and national histories. These histories both reflect and constitute human
experience by contouring social memory and producing truth effects. These histories use the
past in a creative manner, combining and recombining elements of that past that serve to
interests in the present. In this sense, the conscious appropriation of history involves both
remembering and forgetting—both being dynamic processes permeated with intentionality. This
essay explores the political use of the narratives being elaborated in rural villages in the
department of Ayacucho regarding the internal war that convulsed Peru for some fifteen years.
Each narrative has a political intent and assumes both an internal and external audience. Indeed,
the deployment of war narratives has much to do with forging new relations of power, ethnicity,
and gender that are integral to the contemporary politics of the region. These new relations
impact the construction of democratic practices and the model of citizenship being elaborated in
the current context.
INDEX
Keywords : war and its aftermath, memories, gender, citizenship, Peru
Mots-clés : guerre et après-guerre, mémoires, genre, citoyenneté, Pérou
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
129
AUTEURS
KIMBERLY SUSAN THEIDON
Kimberly Susan Theidon est anthropologue, professeure titulaire de la chaire Henry J. Leir
d’études humanitaires internationales à la Flechter School, Tuft University. Ses travaux portent
sur la violence domestique, structurelle et politique, les gender studies, les droits humanitaires et
humains, la justice transitionnelle, les politiques de réparation post-conflit, les politiques
antidrogues des États-Unis. Elle a notamment publié El conflicto armado interno y la política de la
reconciliación en el Perú (Instituto de Estudios Peruanos, 2004) et Intimate Enemies: Violence and
Reconciliation in Peru (University of Pennsylvania Press, 2012).
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
130
Les veines ouvertes de l’héritageLes mandats familiaux de la mémoire de l’exil chilien
The Open Wounds and Pains of Inheritance: The Chilean exile’s family mandates
of memory
Fanny Jedlicki
1 Il est question ici du surdéterminisme de l’histoire sociale et familiale dans les
constructions identitaires, essentiellement politiques, nationales et territorialesd’enfants d’exilés 1 et retornados (littéralement « retournés ») chiliens. Nous nousintéressons à une mémoire transmise et partagée, composée d’injonctions, plus oumoins conscientes et explicites, à la continuité familiale. Dans le cas des familles qui ontconnu l’exil et/ou le retour chiliens, la transmission d’aspirations à la mobilité socialeou au maintien de positions dominantes est relativement moins centrale et investie quedans d’autres familles aux coordonnées sociales identiques non concernées par l’exil.En effet, les destinées sociales et morales 2 des parents et enfants ont été heurtées parles expériences politiques et migratoires fortes.
2 Ensemble de représentations, de valeurs et de pratiques communes, liées à l’histoire
familiale, au Chili et au politique, la « mémoire de l’exil » chilien s’est articulée autourde rapports ambivalents aux territoires, aux identités et à l’engagement. Mémoirecollective, structurée par des cadres sociaux 3, unifiant et assurant sa pérennité, elle futportée par des acteurs politiquement engagés au sein d’une large gauche d’obédiencemarxiste 4, ayant affronté un « même destin historique » 5. Elle plonge ses racines dansles expériences de l’Unité Populaire (UP), du coup d’État et de la répression, qui enconstituent autant d’événements fondateurs 6, inscrivant l’exil dans le continuum de laviolence politique extrême 7. Celle-ci caractérise la répression politique, mise en placedès le coup d’État militaire, à l’encontre des militants et sympathisants de l’UP,entraînant des traumatismes 8 psychiques, transmis à la génération suivante. Pour lesappréhender, des emprunts explicatifs à la psychanalyse 9 ont été nécessaires.
3 Nous retraçons d’abord ce qu’ont signifié les épreuves de l’exil (essentiellement dans le
contexte français) et du retour pour les différents membres des familles. Nousanalysons ensuite la dimension traumatique de la mémoire, ses modes de transmissionset ses effets sur la génération des enfants. Enfin, nous examinons ce que ces derniers à
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
132
l’âge adulte ont fait de leur héritage et ce qu’ils en disent au moment de l’enquête. Nousexplicitons ainsi le contenu de ce que nous appelons des « mandats familiaux » etmontrons comment ils assurent sous une forme spécifique les impératifs de continuitésociale du groupe familial.
La recherche de terrain
L’analyse est issue d’une recherche doctorale, menée auprès de familles chiliennesréfugiées dans une vingtaine de pays ; certains des membres de ces familles sontrevenus au Chili, d’autres sont restés en exil. Ils ont été interviewés à Santiagoentre 1998 et 2003. D’autres entretiens ont été effectués entre 1998 et 2005, en Ile-de-France, auprès d’enfants de réfugiés, n’étant jamais retournés au Chili ou ayantvécu l’expérience du retour et étant revenus vivre en France. Une centained’entretiens semi-directifs ont été conduits : la génération des enfants d’exilésconstitue la population centrale de cette enquête (n=62). Âgés de 19 à 40 ans, ilssont majoritairement issus des classes moyennes cultivées et des classessupérieures chiliennes. La majorité d’entre eux est née au Chili et l’a quitté avantl’âge de deux ans. 40 % des jeunes interviewés ont au moins l’un de leurs parentsqui a été arrêté, emprisonné et torturé.
Ce travail a été complété par des observations ethnographiques durant lesmobilisations contre Pinochet (1998-2006) 10. Enfin, la constitution et l’analyse d’uncorpus d’archives militantes, cinématographiques et littéraires ont été effectuées.
Les extraits d’entretiens cités dans cet article ont été traduits par nos soins.
Les épreuves de l’exil et du retour chiliens
4 Un million de personnes ont quitté le Chili entre 1973 et 1989, soit 7,5 % de la
population – ne sont considérés rétrospectivement comme exilés politiques qu’un quartd’entre eux. Il s’agit d’une migration dispersée, autour de trois grands pôles :l’Amérique latine et centrale ; les pays traditionnellement dits d’immigration (Canada,Australie, États-Unis) ; l’Europe (de l’Ouest et de l’Est). Elle s’est étalée jusqu’en 1989,autour de trois grandes vagues de départ 11.
5 Le nombre d’exilés chiliens en France est généralement estimé à 15 000. Figure
valorisée, le réfugié chilien incarne, principalement aux yeux des partisans etsympathisants socialistes, communistes, radicaux et révolutionnaires français, unealtérité relativement proche : plutôt blanc et catholique, il est membre d’une gauche àlaquelle il est aisé de s’identifier. Mais le stéréotype du militant moustachu à guitare etponcho, incarné sous les traits de quelques célèbres artistes, ne recoupe évidemmentpas la réalité sociologique du groupe réfugié : il est constitué majoritairement denombreux couples venus avec un ou deux enfants en bas âge ; ils sont plus souventissus des classes moyennes et supérieures, bien qu’on rencontre également nombred’ouvriers et employés 12. Comme tous les immigrés, les exilés chiliens connaissent toutd’abord un déclassement économique, symbolique et social. Si les plus dotés d’entreeux disposent de ressources (maîtrise du français, capital social…) leur permettant d’yrésister mieux que d’autres, ce sont ceux qui perdent le plus. En effet, les fractions desclasses supérieures occupaient au sein de la société chilienne, très ségrégée,
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
133
d’importantes positions de pouvoir et de prestige. Par ailleurs, les fractions cultivéesdes classes moyennes exerçant des responsabilités politiques ou syndicales ont pubénéficier d’une position plus confortable que leurs homologues sans responsabilitéslors de l’UP. Enfants de la bourgeoisie, personnalités politiques, syndicales etculturelles deviennent en France des anonymes, soumis à des conditions de vie leséloignant beaucoup de leurs précédentes positions. Si certains d’entre eux finissent àterme par trouver des conditions de vie relativement satisfaisantes, d’autres n’yparviennent pas. L’exil est pour tous une épreuve vécue en famille mais de façoninégale selon les ressources détenues.
« Être chilien » en exil : la transmission d’une ambivalence
6 Ce sont des images et sentiments à la fois très positifs et très négatifs qui se
transmettent en même temps qu’ils sont construits par les enfants. Il n’est en effet pasquestion de seuls éléments hérités dans le cours de la socialisation, mais aussi, mêmepour ceux qui ne sont pas nés au Chili, de rapports réels avec une entité à la foisnationale, géographique et symbolique. L’exil est une expérience partagée parl’ensemble du groupe familial.
7 Les rapports entretenus au Chili sont ambivalents : le pays est à la fois idéalisé et
assimilé à la violence et à la souffrance par les parents comme par les enfants 13.
8 Pour les parents, l’exil ne peut être appréhendé autrement que comme temporaire : il
est vécu comme une sanction terrible et injuste, une dépossession de soi et de sonexistence. La cassure brutale de l’action politique, à partir du coup d’État, estcruellement vécue. S’ils ont pour la plupart rebâti des structures partisanes en exil,dans lesquelles ils se sont fortement investis, leur engagement évolue peu à peu 14, sefaisant progressivement plus associatif et culturel. Cet engagement est individuel,parfois conjugal, voire familial : les enfants peuvent être présents aux réunions etmanifestations, lorsqu’ils ne fréquentent pas des structures ad hoc, inspirées desmouvements de « pionniers » communistes, comme à Cuba et à l’Est du Mur.
9 Le Chili constitue pour la majorité un paradis perdu, fantasmé. Les exilés
surinvestissent des objets et pratiques culturellement marqués, ayant pour fonction derappeler « là-bas » et réaffirmer qui l’on est : un Chilien marxiste chassé injustement deson pays. Les symboles nationaux (drapeau, « cueca » 15…), politico-folkloriques (et enparticulier musicaux) sont convoqués dans les regroupements communautaires, tandisque la plupart des foyers sont décorés d’objets artisanaux saturés de signifiantspolitiques 16. Autant de marqueurs identitaires à la fois nationaux et idéologiquesrappellent ainsi que la migration est politique. Ces sentiments et affirmationsd’appartenance sont transmis aux enfants qui, socialisés en France, peuvent, à l’instarde nombre d’enfants d’immigrés, se sentir « déchirés entre deux sociétés » 17. Ils sontnombreux à évoquer le sentiment d’avoir vécu leur enfance comme dans « dans unesalle d’attente », suspendus au retour… Aussi, la question du choix du lieu de vie à plusou moins long terme se pose de façon relativement aiguë et douloureuse pour toutes lesfamilles de réfugiés chiliens.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
134
Le retour, un devoir militant et existentiel
10 Pour les parents, le projet de retour est présent dès les premiers jours de l’exil. Il
contient une composante politique : il faut revenir afin de poursuivre ce qui a étéentrepris sous l’UP. Ses anciens militants et sympathisants adhéraient globalement auprojet de société à la fois socialiste, réformiste et révolutionnaire, contenu dans lemouvement politique, syndical et social qui a accompagné le gouvernement dirigé parAllende durant mille jours 18. Ce projet politique impliquait à terme une redéfinition dela répartition des richesses et des classes sociales. Les efforts consentis étant à la foiscollectifs et individuels, les destinées de chacun épousaient la destinée nationale dansla marche frénétique d’une Histoire en train de se faire. Il s’agit là de souvenirsvalorisés a posteriori, liés à des émotions positives, que l’on retrouve par exemple dansle célèbre documentaire « La Bataille du Chili », de Patricio Guzmán (1977).
« C’est magnifique ce qui s’est passé au Chili. Mais pourquoi c’est si magnifique si çat’a coûté l’exil ? Si une fois dans ta vie tu peux vivre une révolution, c’est fabuleux !C’est un moment unique ! Fort, speed, tu crois que tout est en train de changer, tuvis pleinement, le reste de ta vie ne sera plus que train-train […] C’est comme unorgasme ». Juan, 60 ans, cadre du PS, réfugié en France en 1974 où il réside toujours,interviewé à Paris en 1999.
11 Pour les militants issus de la bourgeoisie chilienne 19, adhérer à l’UP signifiait renoncer
à reproduire les positions sociales et économiques familiales. Dans une société perçuealors en cours de transformation, ce déclassement objectif était compensé par uneascension morale 20 : faire advenir un monde nouveau et plus juste. Les valeurs politiqueset morales transmises plus tard à leurs enfants seront fortement imprégnées de cettevision du monde et de soi dans le monde.
12 Par ailleurs, « le droit à vivre dans sa patrie » représente une exigence existentielle, qui
s’impose aussi aux moins engagés politiquement. Il peut se décliner sous la forme d’unprojet collectif, porté par certains partis, et/ou comme un projet individuel et/oufamilial, connaissant des variations dans le temps. On distingue plusieurs vagues deretours 21.
13 On considère au début des années 2000 que seul un tiers des personnes ayant quitté le
Chili serait rentré 22 : la société chilienne a profondément changé, comme les exilés. Les« retrouvailles » s’accompagnent de profondes désillusions, d’autant plus fortes qu’ellesavaient été très investies durant l’exil. L’État chilien est devenu ultralibéral ; le régimede terreur (1973-1989) a valorisé des formes d’individualisme qui perdurent, perçu parles retornados comme un rejet de leurs valeurs et pratiques politiques. Ils sontconsidérés comme de « dangereux marxistes » par la droite, qui a réussi à imposerl’image de « profiteurs », partis en « exil doré », dans des sociétés d’abondance et/oudes États-Providence. Aux yeux de la gauche radicale en particulier, il s’agit de« traîtres » ou de « lâches », qui n’étaient pas là pour mener la résistance. Les élitespolitiques revenues d’exil, membres de la Concertación, suscitent la critique de ceux quiconsidèrent que les nouveaux dirigeants poursuivent et renforcent le régimeéconomique et social mis en place par la dictature. Quant aux enfants de retornados, ilssont considérés le plus souvent comme des « étrangers », aux accents et pratiques« bizarres », tandis qu’ils héritent des étiquettes politiques parentales. Aussi, lesretornados sont-ils fortement stigmatisés au Chili, ce qui pèse sur leur (ré)insertion.
14 D’autant plus que le retour constitue une nouvelle migration. Il l’est davantage pour les
enfants, qui ne « reconnaissent » pas le pays qu’ils avaient imaginé et ne s’y sentent ni
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
135
bienvenus, ni « chez eux »… Certains disent : « c’est moi qu’on a exilé maintenant ! ».Tout se passe donc comme si les enfants connaissaient à leur tour et à une tout autreéchelle l’effondrement d’un projet collectif, décliné comme un rêve dans lequelpourraient s’accomplir leur habitus de gauche et les dispositions acquises durant lasocialisation primaire. Ils subissent une perte de repères culturels dans un paysfinalement étranger, le déclassement socioéconomique familial les premiers temps, lerenversement de la polarité positive de leur étiquette de gauche valorisée dans les paysd’exil. Les jeunes retornados font l’expérience directe de profonds désajustements etconnaissent des sanctions symboliques, inattendues. Ces expériences sont vécues sousle sceau du déshonneur et de l’injustice, rappelant les sentiments blessés de leursparents, autrement dit de ceux qui ont été vaincus et qui ont survécu au coup d’État,eux-mêmes une troisième fois disqualifiés par l’expérience du retour. Le retour signeainsi pour les enfants l’effondrement d’un pays rêvé et d’un projet existentiel,semblable à l’effondrement vécu par leurs parents en 1973.
Les empreintes profondes de la violence et sesrésurgences fantomatiques
La mémoire blessée des vaincus
15 L’exil, soit le bannissement de la communauté et du territoire nationaux d’un citoyen
en raison de ses valeurs et actions, voire de ce qu’il est, est une sanction politique quiremonte à l’antiquité athénienne, où elle était considérée comme plus grave que lamort. Sur le plan politique, le coup d’État signifie pour les exilés une lourde défaite.Perdants et victimes à l’identité blessée 23, ceux qui n’ont pas subi dans leur chair lesexactions physiques et morales infligées massivement aux partisans de l’UP tendent àse sentir coupables d’y avoir échappé 24. Leurs rapports à leur histoire, donc à eux-mêmes et à l’avenir, sont entravés par des traumatismes, largement refoulés. Briser lessurvivants est l’un des objectifs de la répression par la terreur, qui consiste à détruirel’opposition politique présente et à brider toute velléité de résistance future. Elles’adresse à tout le corps social à travers certaines victimes choisies : hommes et femmesde gauche (ou suspectés tels), ouvriers particulièrement. La répression est d’autant plusterrifiante qu’elle est à la fois cachée et visible, notamment à travers le phénomène dedétention-disparition, nié officiellement 25. La torture place les individus qui lasubissent dans une expérience-limite, apparentée à la folie 26. La perte de l’intégritéphysique et psychique, l’ébranlement du sens qui en résulte s’effectuent dans uncontexte de déni, partie intégrante du terrorisme d’État. Ce qui rend les processusd’élaboration psychique, donc de mise en souvenir et de narration, difficiles voireimpossibles. Plus souvent refoulées, les atrocités vécues restent inscrites dans les corpset se révèlent souvent de manière somatique. D’autant plus que les anciens prisonnierstendent à minorer les épreuves qu’ils ont vécues, en raison de la culpabilité d’avoirsurvécu. Les priorités définies par les partis politiques réorganisés en exil seconcentrent sur l’action militante, stigmatisant toute parole sur ce qui s’est passé,perçue comme une « complainte petite-bourgeoise psychologisante ». Il n’y a doncpendant longtemps pas d’espace permettant une élaboration collective de la répressionsubie. L’affaire Pinochet et la joyeuse mobilisation qu’elle entraîne en Europe amèneune libération des paroles, vécue comme « cathartique » 27.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
136
« Quand Pinochet a été arrêté… c’est là que j’ai trouvé un sens à mon histoire. Avantc’était quelque chose d’individuel, complètement, qui me concernait et que jegardais parce que c’était mon histoire, mon problème individuellement et pasraccroché à quelque chose qui pouvait faire avancer les choses et en fait c’est quandPinochet est arrêté […] là j’ai fait le lien entre mon histoire et celle-là… et dans cettehistoire, il y avait toute une place pour revenir à ce que ça signifiait à l’intérieurd’un mouvement et non pas seulement individuellement comme victime ». Maria-Paz, 52 ans, ex-miriste, prisonnière politique, elle a été exilée en France en 1974, oùelle réside encore, interviewée à Paris en 2000.
Transmission de la mémoire traumatique
16 Viñar, qui a travaillé auprès de survivants des dictatures argentine, chilienne et
uruguayenne, explique que les effets mortifères de la violence extrême s’exercent surtrois générations 28. La littérature scientifique sur les descendants des survivants de laShoah ou encore sur les descendants de rescapés de guerre, le rejoignent. De facto, leschercheurs spécialistes du Cône Sud se réfèrent aux travaux sur les génocides juif etarménien en particulier pour rendre compte de ce qui s’est passé sur le continent sud-américain. Hirsch 29 propose le concept de « post-mémoire » pour signifier les relationscomplexes de la « génération d’après » avec un passé qu’elle ne peut se remémorer,mais avec lequel elle est si liée qu’elle pense parfois « s’en souvenir » ; la post-mémoireest essentiellement d’ordre traumatique et s’applique également au cas chilien.
17 C’est durant l’affaire Pinochet que de nombreux enfants de réfugiés « apprennent enfin
ce qui est arrivé à leurs parents », bien qu’ils déclarent « avoir toujours su ». Si parlerdes expériences de la torture et de l’enfermement dans la sphère publique est ardu, ilest encore plus difficile de le faire auprès de ses propres enfants. Aussi, y a-t-il eugénéralement peu de paroles dans les familles ; pour autant, une transmissionintergénérationnelle traumatique s’est effectuée de façon clandestine. La psychanalysteGampel propose le concept d’« identification radioactive » pour rendre compte de cetype de transmission, silencieuse et presque invisible 30. Les silences familiauxproduisent les mêmes conséquences que les dénis, soit une impossible symbolisation :le non-dit est érigé en impensable impensé, pourtant présent durablement dans lapsyché des enfants 31. Les psychanalystes adoptant le paradigme transgénérationnelparlent également d’« encryptement », comme si le trauma était enfermé dans unecrypte hermétique, sans possibilité pour le sujet psychique d’y pénétrer. Les enfantsdont les parents n’ont pas connu la prison ni la torture n’échappent pas à cettemémoire collective traumatique : des proches, familiaux, amicaux, camarades, en ontété victimes et le sentiment de culpabilité de leurs parents, qui y ont eux échappé,semble si aigu qu’il entraîne une transmission des effets de la terreur.
18 Aussi, observe-t-on chez les enfants de réfugiés chiliens une prise en charge, complexe,
des traumatismes parentaux. La violence extrême reconfigure en effet les rôlesfamiliaux : les parents apparaissent aux yeux de leurs enfants bien souvent comme de« fragiles héros » 32. Constituées en figures emblématiques inégalables du fait de leurengagement et de la tragédie de 1973, ils sont aussi en souffrance : impossible tâche, ilfaut les protéger, sinon réparer, ce qui donne au mandat parental une résonanceaccrue.
« J’ai mal pour mes parents. Penser à eux peut me faire m’écrouler complètement.[...] Et dire que moi je ne suis que leur fils. Ils ont vécu ce tremblement de terre, quine me touche que comme une répercussion sismique ! […] Ils ont perdu les plus
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
137
belles années de leur jeunesse, tous ces efforts pour construire quelque chose,donner la vie au parti, se donner entièrement aux autres… pour construire unemeilleure société ! […] Alors quand je pense à eux qui firent tant, […] qui ontsouffert toute leur vie pour pouvoir construire quelque chose qui n’a jamais puréussir à se construire, qui a été abattu littéralement, cela me provoque une grandedouleur. [Il fond en larmes puis en sanglots] […] Ils sont tristes et je sais qu’ils neseront jamais vraiment heureux, parce que c’est une douleur très forte et ils mel’ont racontée, ils me l’ont pleurée, je l’ai vue, j’ai vécu avec eux alors je la connais,et moi aussi cela m’arrive… [...] la douleur est si forte que la chose la plus minime,comme une manif, un hymne, un symbole te détruit, qu’on te fasse parler de ça, çate brise… […] La dictature nous a tué l’âme. » Rodrigo, 28 ans, a vécu en ex-Yougoslavie et en Équateur, revenu au Chili en 1983, parents socialistes, interviewéen 2002 à Santiago du Chili.
19 Cette économie affective, liée et renforcée par l’exil 33, s’explique également du point de
vue de la dynamique d’ensemble du groupe familial : en effet, en prenant le rôle deprotecteurs généralement dévolu aux parents, les enfants participent à la survie del’entité familiale dont ils dépendent, et au containment de ses composantes fragilisées 34.
Des héritiers meurtris
20 Une forme de névrose commune est repérable chez les enfants de réfugiés politiques
chiliens. Entrelacée aux histoires intimes singulières qui l’alimentent aussi, elle sedécline sous de multiples variations. Pour autant, c’est à un certain « rapport aumonde » 35 partagé, saisi par l’enquête sociologique, que nous nous intéressons. Il s’estainsi révélé durant la quasi totalité des entretiens à travers l’expression d’émotionsfortes, de lapsus, voire de récits de rêves et cauchemars marquants 36.
21 Les jeunes gens interviewés se caractérisent par une tendance à la culpabilité qui, alliée
au sentiment de ne pouvoir « être à la hauteur » (vis-à-vis d’un engagement héroïque,de circonstances tragiques et, au-delà, des attentes parentales réelles et supposées,voire des rôles sociaux à tenir), entraîne des conduites d’évitement de diversessituations sociales (scolaires, amoureuses, professionnelles) ou encore des difficultés àétablir des relations durables. Aussi, la toute-puissance infantile est infléchie par laconjugaison des effets diffus de la terreur, héritée, et du sentiment de n’être protégé nipar les institutions 37 ni par ses parents. La configuration psychique qui en découle estcaractérisée par une fragilité et une difficulté à se projeter dans l’ordre desgénérations, en tant qu’adulte susceptible d’égaler et de remplacer des parents, dontl’existence serait alors menacée une seconde fois.
22 Meurtris durablement, les enfants de réfugiés politiques chiliens apparaissent
fortement agis par une histoire collective, en partie encryptée, dont il est impossible outrès difficile de dépasser les néfastes effets psychiques, même dans un cadrepsychanalytique 38. Aussi, la grande majorité des jeunes gens interviewés déclarent êtrepassés par des phases de leur existence dominées par des rapports malheureux à eux-mêmes et au monde. Les plus tourmentés d’entre eux (1/6 du corpus enquêté) ontconnu des trajectoires (scolaires, amoureuses, professionnelles, migratoires) trèsaccidentées. Ils sont toujours au moment de l’entretien dans des situations instables.Les parcours de leurs parents sont pour partie également chaotiques, sans que l’on nepuisse établir ce qui pourrait relever strictement de l’exil ou d’autres phénomènes 39.
23 Ces jeunes-là évoquent des sentiments aigus de dissonance 40 envers leurs
environnements (scolaires et professionnels en particulier, ainsi que dans la famille
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
138
élargie) qu’ils résident au Chili ou en France où ils sont « restés », lorsqu’ils n’y sont pasre-revenus 41. Dépressions nerveuses, fortes addictions alcooliques et/outoxicomaniaques, pratiques délictuelles parsèment les parcours adolescents et/ouadultes de nombre d’entre eux. Il est encore très difficile pour ceux-là de trouver leurplace dans le monde 42.
24 La majorité des enfants de réfugiés rencontrés sont néanmoins parvenus, au fil du
temps et d’expériences socialisatrices moins dépendantes du cadre familial, à sestabiliser. Accommodant l’héritage, ils ont réussi à désimbriquer la mémoire de l’exil, àsavoir la triade politique-territoriale-nationale qui la fonde : des éléments clés del’héritage sont conservés, d’autres mis de côté, la plupart bricolés 43. Ainsi certainsmilitent, mais vivent en France ; d’autres résident au Chili, tandis que leurs parentssont restés en terres d’exil, mais ils n’ont pas d’activité politique. Diversescombinaisons existent, confirmant que les identifications ne sont jamais figées niprincipalement nationales. Ainsi un jeune homme, ayant passé cinq années dansl’ancienne RDA, déclare : « ma seule patrie c’est le socialisme » ; un autre, ayant grandien France, se définit comme « profondément chilien », mais rêve et projette de s’établiraux États-Unis ; une jeune femme s’auto-définit « latino-américaine ». Pour échapperaux grandes catégories étatiques, d’autres déclinent encore l’appartenance au-delà desterritoires et nationalités : « ma nation, c’est mes amis » ; « mon lieu, mon territoire,c’est avec la personne que j’aime/mon enfant. »
« Je suis autant chilien qu’allemand ou chinois, je m’en fiche, j’ai des chosesallemandes, des choses chiliennes, mais je ne suis pas à 100 % l’un ou l’autre […]mais je ne me sens pas, comme je l’ai beaucoup entendu, apatride, je sens que je n’aipas besoin de patrie. » Pedro, 38 ans, fils de communiste, exilé avec ses parents enex-RDA, revient au Chili en 1970, membre du FPMR 44, interviewé à Santiago en2002.
25 Certains de ces jeunes gens seraient particulièrement adaptables, ayant pris l’habitude
de vivre des situations très contrastées durant leurs enfances, du fait de l’exil et duretour : ils ont pour la majorité d’entre eux vécu dans plus de trois pays. Ayant lesmêmes parcours migratoires, d’autres se déclarent au contraire profondémentimmobiles, affirmant la nécessité d’ancrages stables (territoriaux, familiaux,professionnels, politiques). Tous expriment par ces deux rapports au mondediamétralement opposés à la fois l’importance de la question territoriale, soit du lieu oùvivre et la manière dont cette question est résolue : les sentiments d’appartenance sontreportés sur des individus ou groupes, plutôt que sur des collectifs et des espacesnationaux. Il s’agit là d’accommodements identitaires 45, évolutifs.
26 Ces trajectoires heurtées, produites par la violence et l’exil, doivent être également
mises en lien avec ce qui est fait de l’héritage social et politique.
La loyauté politique comme mandat parental respecté
Déplacements géographiques : décalages socioéconomiques ?
27 Si le coup d’État, l’exil et le retour viennent infléchir négativement les destinées
psychiques des exilés et de leurs enfants, qu’en est-il de leurs trajectoires sociales ?
28 L’expérience de l’exil a été synonyme d’un déclassement, plus ou moins important
selon les pays d’accueil, en particulier pour les membres des classes supérieures, même
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
139
si au cours du temps, et en France en particulier, les réfugiés accèdent généralement àde meilleures positions qu’à leur arrivée, toutes classes sociales confondues.L’expérience du retour entraîne des réinstallations difficiles, notamment sur le plan dulogement et de l’emploi, les retornados connaissant un chômage 2,5 à 3,5 fois supérieur àcelui des autres Chiliens 46. Revenir sous la dictature est le plus socialement coûteux.Pour autant, la plupart des retornados finissent par retrouver dans la société chilienne laposition sociale qu’ils occupaient ou plutôt celle qu’ils étaient destinés à occuper, sil’exil n’avait pas eu lieu. Ainsi, les fractions dominantes du groupe bénéficient descapitaux économiques et sociaux familiaux, leur permettant de posséder un domicile,de monter une entreprise ou encore de trouver, à partir de 1990 et de l’instaurationd’un gouvernement civil, un emploi dans la haute administration par exemple,lorsqu’ils n’exercent pas une profession intellectuelle supérieure. Aussi, s’ils ont puexpérimenter une misère de position 47 à certains moments de leurs trajectoires, ledéplacement social n’est que temporaire et à long terme assez relatif. Sur le planpolitique, les concessions multiples faites aux valeurs idéologiques initiales sontfréquentes ; pour ceux qui participent de près ou de loin à la Concertación ou encorepour ceux qui rejoignent le secteur entrepreneurial, elles peuvent être moralementcoûteuses :
« Tu imagines, devenir chef d’entreprise, patronne, comme mon père, ce que çapeut vouloir dire pour une socialiste ! Je n’aurais jamais cru le devenir, moi qui étaisà fond dans l’UP… », s’exclame ironiquement Aurélia, 50 ans, ex-militante socialiste,réfugiée à Cuba et en Équateur, revenue au Chili en 1987, interviewée à Santiago duChili en 1999.
29 Les retornados issus des classes moyennes et des classes populaires réintègrent
globalement les positions qui leur étaient initialement dévolues dans l’espace socialchilien 48. Certains d’entre eux reconvertissent positivement des ressources acquises enexil, qui sont particulièrement activées pour leurs enfants. Ils peuvent accéder auxprestigieuses et onéreuses écoles privées (française et allemande, par exemple)gratuitement, du fait de la possession d’une autre nationalité, lorsqu’ils ne sedistinguent pas sur le marché scolaire et de l’emploi par la maîtrise d’une langueeuropéenne : une petite mobilité sociale ascendante, ou tout du moins une forme derésistance à la fragilisation socioéconomique liée à l’ultralibéralisme chilien, peut ainsiêtre effectuée.
30 In fine, pour la génération des parents, l’exil a produit des déplacements qui s’observent
davantage au plan de leurs positionnements politiques que de leurs trajectoiressociales. Cependant, leurs engagements initiaux pèsent sur ce qu’ils transmettent àleurs enfants : nous l’observons en particulier dans les familles les plus dotées, pourlesquels il s’agit moins d’occuper (ou réoccuper) des positions dominantes que dereproduire du capital culturel associé à certaines dispositions et aspirations moralesantérieures à l’exil. Le choix d’études supérieures 49 et des professions des enfants entémoigne nettement. Ils se tournent plutôt vers des filières universitaires que desécoles de commerce et plutôt vers des métiers intellectuels ou encore d’aide(enseignement et recherche, arts, professions médicales et paramédicales, journalisme)que vers le secteur entrepreneurial. Sur le plan socioéconomique, c’est précisément auregard de l’importance attachée à la reproduction du capital culturel qu’ils sedistinguent de leurs homologues chiliens qui se sont massivement dirigés vers desétudes de gestion et des carrières commerciales.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
140
Être chilien et de gauche
31 L’exil entraîne un sentiment de perte de maîtrise de sa destinée ; aussi nombre de
parents, comme beaucoup de migrants 50, souffrent d’entendre leurs enfants s’exprimer[mieux] dans une autre langue que la leur. La peur que sa progéniture ne « perde » la« culture d’origine » est fréquemment évoquée. Aussi, les relations que les enfantsentretiennent au Chili et leur attachement aux valeurs politiques parentales, peuventrevêtir une dimension existentielle pour leurs aînés. La perspective d’une rupture« culturelle » dans la continuité familiale les bouleverse d’autant plus qu’elle estattribuée à la répression : « Pinochet a vraiment gagné, il nous a même volé nosenfants, qui sont devenus de petits Français ! ».
32 Les parents tendent ainsi à transmettre à leurs enfants des injonctions à être plutôt
Chiliens que Français et plutôt « de gauche ». En substance le message adressé est celui-ci : « Nous avons été injustement chassés de notre terre, qui est un paradis ; nous yrentrerons un jour, pour renverser Pinochet et réinstaurer le socialisme pour lequelnous avons lutté ; toi aussi, tu es chilien, tu es et seras de gauche, militant, et tu vivrasdans cette terre qui nous manque tant ».
33 Il s’agit là d’un mandat familial imbriquant étroitement identification politique et
nationale, se déclinant également sous la forme d’une inscription territoriale. Cemandat est d’autant plus puissamment reçu qu’il se mêle à l’impératif psychique deréparation de la souffrance parentale. Il est ainsi particulièrement difficile de lecontester ou de le refuser. Concrètement, le mandat familial de l’exil chilien peut sedécliner principalement sous la forme d’actions politique et migratoire (rentrer auChili) de la part des enfants, autrement dit par l’accomplissement, différé, des désirsparentaux. La façon dont nombre d’enfants de retornados évoquent le retour familial,voire les retours que certains d’entre eux effectuent seuls, en témoigne :
« Même si je n’avais pas envie de rentrer, je ne pouvais pas leur faire ça. »« En rentrant, j’ai accompli ma dette. »
34 Dans notre corpus d’enquête, un individu sur six tend à se conforter à ces mandats
familiaux. Ces jeunes gens sont revenus vivre au Chili, parfois s’y sont même installésseuls, alors que leurs parents restaient vivre dans les sociétés d’exil. Ces jeunes-là semontrent très loyaux envers les messages parentaux, en particulier sur le plan de leursengagements au sein d’organisations politiques et syndicales traditionnelles, couvrantle large spectre des gauches chiliennes des années 1980 et 90. Certains d’entre eux (plussouvent des hommes) sont revenus dès la fin des années 1970 afin de participer à lalutte armée et/ou politique pour renverser le régime militaire. La politique officielle estégalement investie, par exemple par le petit-fils d’une haute figure de l’État chilien,devenu diplomate chilien et membre du PS. Le volet territorial du mandat parental estégalement acquitté par ceux qui vivent au Chili et s’y trouvent toujours au moment del’entretien.
Rodrigo a 28 ans, issu d’une famille de gauche sur au moins deux générations ducôté paternel, ses parents socialistes fuient le Chili en 1973. Ils vivent plus de troisans en Équateur, avant de s’installer, par choix politique, en ex-Yougoslavie, où ilsrésident plus de cinq ans. Ils reviennent au Chili, alors qu’il a 9 ans, en 1983.Rodrigo est né dans la clandestinité, « le poing dressé » ; il a milité dans unebrigade d’enfants chiliens, son héros était alors Tito. Le retour au Chili est difficile
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
141
pour lui, il est alors pétri de terreur et de colère, passant une adolescence plutôtisolée, marquée par sa timidité. Il s’engage à l’âge de 13 ans, au sein de son lycée,dans les rangs de FPMR, avant de rejoindre brièvement le MIR ; il connaît desaffrontements violents avec la police et entre rapidement au PS dans lequel il restejusqu’au référendum en 1988. Sa déception face au gouvernement de laConcertación est si importante qu’il cesse de militer pendant dix ans. Il se consacrealors à ses études, de journalisme, qu’il ne termine qu’aujourd’hui, après unelongue période instable l’ayant amené à travailler dans d’autres pays latino-américains. Il sera bientôt père et souhaite poursuivre une carrière journalistiqueet/ou politique : il a en effet réintégré les rangs du PS, dans lequel il occupeactuellement un poste de dirigeant. L’engagement est pour lui tout à la fois unhéritage familial et une obligation morale : même s’il « n’espère plus changer lemonde », il entend participer à son amélioration. L’entretien a lieu dans les locauxdu PS.
Des legs politiques recomposés
35 Qu’en est-il des rapports à la politique des autres enfants de réfugiés et retornados
chiliens ? On n’observe qu’une seule rupture radicale, synonyme ici d’unpositionnement politique dans un bord opposé à celui des parents : les enfants d’exiléschiliens se situent, sans surprise, massivement sur la gauche de l’échiquier politique.Mais cela ne signifie pas qu’ils s’engagent tous, ni qu’ils s’engagent comme leursparents. Ils se montrent, sans surprise, plus écologistes et antiracistes et plus souventaltermondialistes que marxistes révolutionnaires. Ce type de glissement est observéchez beaucoup d’enfants de marxistes, indépendamment du facteur migratoire et dupays d’origine. De même, leurs engagements sont très typiques des jeunes adultes deleurs âges. Ils sont en cela le fruit d’une socialisation effectuée dans d’autres sociétésque celle où leurs parents ont été formés idéologiquement et ont milité et dans unepériode historique marquée par l’effondrement du bloc socialiste. Les formes queprennent leurs engagements diffèrent également : ils s’engagent plus ponctuellementet de façon plus circonstanciée, plutôt dans le secteur associatif que dans desorganisations politiques traditionnelles, lorsqu’ils ne le font pas professionnellement,en reconvertissant l’héritage. Ils ont néanmoins hérité de préférences politiques, ainsique de dispositions à la politique 51, voire de modes de faire de la politique, c’est-à-dired’un capital militant 52, clairement positionné à gauche.
36 Du côté des retornados, notons que les jeunes rentrés au Chili avant le plébiscite de 1988,
qui ont été lycéens et/ou étudiants durant cette période, ont pour la plupart connu unparcours semblable : ils se sont engagés dans le mouvement des étudiants dusecondaire (1983-1988) ou à l’université, participant à des réunions publiques etclandestines, des manifestations et des occupations de leurs établissements. C’est dansl’institution scolaire qu’ils sont approchés ou qu’ils approchent des militantsd’organisations de gauche (socialistes, miristes, communistes et armées 53), que lamajorité d’entre eux finissent par rejoindre. Leur engagement est plus ou moinsintense et tend à s’affaiblir sinon à disparaître avec l’arrivée au pouvoir de laConcertación, enterrant les espoirs de changement politique radical. Rares sont ceux quipoursuivent et/ou se remettent à militer dans des structures partisanes traditionnellesdans les années 1990 54. En revanche, la plupart se rendent systématiquement aux
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
142
manifestations commémoratives du 11 septembre et sont inscrits sur les listesélectorales. Une fraction, minoritaire, d’interviewés déclarent se tenir les plus éloignéspossible de la politique. C’est la marque d’un rapport négatif à ce qui est perçu commeun engagement dangereux, sinon sacrificiel, de la part de leurs parents, ayant faitpasser en second les soins et attentions portés à leurs enfants 55. C’est du moins lafaçon, douloureuse, dont ces jeunes ressentent les choses ; les plus meurtris parlentmême d’abandon 56.
37 Ainsi, ce que nous appelons la « mémoire de l’exil chilien » et plus spécifiquement les
« mandats familiaux » sont deux vecteurs contigus de la construction de soi, autantqu’ils participent à la production et reproduction des positions sociales et moralesoccupées par les enfants de réfugiés chiliens. Un mandat familial renvoie à ladélégation d’une génération à une autre d’un « pouvoir d’agir au nom et pour unautre ». Ils priment dans le cas présenté plus que toute autre chose dans l’économieaffective familiale. Les messages qui les constituent s’expriment durant la socialisationprimaire et ils se transmettent de façon inconsciente entre les générations. Ce sont lestraumatismes liés aux violences extrêmes qui en forment le socle. Les mandatss’imposent de manière contraignante ; ne pas en remplir les exigences signifieraittrahir les parents et leur histoire. C’est enfin un déterminant de choix opérés par lesenfants à l’âge adulte ; ici il s’agit des choix politiques, territoriaux et nationaux. Toutse passe comme si les enfants de réfugiés et retornados chiliens devaient réaliser lesdestinées parentales brisées par le coup d’État de 1973. La dimension morale de ceux-ci,synonyme notamment d’injonction à rester de gauche, tient à deux éléments : d’unepart à l’histoire singulière de l’exil chilien où les engagements de gauche se sonttrouvés « magnifiés » par la terreur, associée à un contexte historique particulier, où lasanglante répression contre les partisans d’un gouvernement marxistedémocratiquement élu a été largement condamnée dans le monde ; d’autre part, àl’échelle des individus, par l’impossibilité de contrarier les desiderata de parents blessés.Si la dimension politique et traumatique de la transmission peut se retrouver chez lesenfants de militants et sympathisants chiliens qui sont restés au Chili, les expériencesmigratoires intensifient le poids du mandat, en raison principalement du sentiment dedépossession lié à l’exil tandis que l’idéalisation-répulsion pour une société finalementméconnue accentue les décalages sociaux de ceux qui vivront au Chili. Aussi,l’expérience malheureuse du retour que connaissent les enfants, renforce laconnaissance directe de formes de déclassement symbolique, voire de déshonneurqu’ont connues dans un autre contexte et avec une autre intensité leurs parents.
NOTES
1. L’exil politique a une définition juridique aux frontières mouvantes selon qu’il est considéré du
point de vue des autorités du pays de départ, du pays d’arrivée, voire des différents pays de
transit. Plusieurs décrets-lois chiliens édictés entre 1973 et 1975 ainsi que la Constitution de 1980
encadrent l’expulsion et l’interdiction d’entrée sur le territoire des indésirables. Les législations
des pays d’accueil sont quant à elles nombreuses ; les Chiliens vivant à l’étranger ne prennent pas
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
143
tous le statut de réfugié politique. Il est d’autant plus complexe de reprendre les catégories
juridiques qu’elles sont aussi morales, distinguant de bons réfugiés politiques et de moins
louables migrants économiques (voir Jedlicki F., « De l’exilé héroïque à l’illégitimité du retornado.
Les retours des familles de réfugiés chiliens en France », in Anuario de Estudios Americanos,
Espagne, 2007, vol. LXIV, n°1, 2007, pp. 87-110.). Aussi utilisons-nous les termes exilé et réfugié
sans tenir compte des statuts légaux mais des autodéfinitions des personnes interviewées.
2. Morale renvoie ici à une forme d’éthique politique.
3. Halbwachs M., Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994 (1e éd., 1925).
4. Dans les partis de l’Unité Populaire (Parti Socialiste, Parti Communiste, Parti Radical social-
démocrate, MAPU (Mouvement d’action populaire unitaire, frange radicale des Chrétiens
Démocrates) et API (Action populaire indépendante) comme au MIR (Mouvement de la Gauche
Révolutionnaire), dans les syndicats et les organisations de quartier et d’usines.
5. Mannheim K., Le problème des générations, Paris, Nathan, 1990 (1e éd., 1928).
6. Ricœur P., « Événement et sens », in Petit J.-L. (dir.), L’Événement en perspective, Paris, EHESS,
1991.
7. Courante en Amérique Latine, cette expression désigne les répressions politiques dictatoriales
relevant d’une organisation systémique. Elle est plus souvent utilisée dans la littérature
académique française à propos des génocides.
8. Au sens d’empreinte laissée par un événement passé dans le psychisme d’un sujet, le
désorganisant. Voir aussi d’Halluin E., « La santé mentale des demandeurs d’asile », Hommes et
migrations, n°1282, 2009, pp. 66-75.
9. Puget J. et al., Violence d’État et psychanalyse, Paris, Dunod, 1989 ; Pudal B., « Du biographique
entre “science” et “fiction” Quelques remarques programmatiques », Politix, n°27, 1994, pp. 5-24 ;
Assoun P.-L. et al., « Transferts disciplinaires. Psychanalyse et sciences sociales. Table ronde…»,
Politix, n°29, 1995, pp. 186-221 ; Zarca B., « Triple démarche pour une transformation de soi.
Psychanalyse, socio-analyse et autobiographie », Le Coq-héron, n°198, 2009, pp. 118-130.
10. Le 16 octobre 1998, l’ancien dictateur alors à Londres est arrêté par la police britannique à la
demande du juge B. Garzón. Après moult rebondissements judiciaires, Pinochet est libéré pour
raisons de santé en 2000. Il rentre aussitôt au Chili, où les actions judiciaires continuent jusqu’à
sa mort en 2006.
11. Araujo A.-M., Vásquez A., Exils latino-américains : la malédiction d’Ulysse, Paris, CIEMI-
L’Harmattan, 1988 ; Bolzman C., Sociologie de l’exil, une approche dynamique : l’exemple des réfugiés
chiliens en Suisse, Zurich, El Séismo, 1996.
12. Araujo A.-M., Vásquez A., ibid. ; Gaillard A.-M., Exils et retours. Itinéraires chiliens, Paris, CIEMI/
L’Harmattan, 1997.
13. Jedlicki F., « Venceremos, Pinocho y las empanadas… Grandir en exil à l’ombre du retour »,
Hommes & Migrations, n°1305, 2014, pp. 33-39.
14. Avec son lot important de reconversions et désengagements. Cf. Willemez L., « Perseverare
Diabolicum : l’engagement militant à l’épreuve du vieillissement social », Lien social et Politiques,
n°51, 2004, pp. 71-82.
15. Danse nationale traditionnelle.
16. Arpilleras (tableau textile cousu à la main, fabriqué le plus souvent par les femmes de
prisonniers politiques, détenus-disparus), posters d’Allende, etc.
17. Voir aussi Sayad A., L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Les enfants illégitimes, Paris,
Raisons d’agir, collection « Cours et travaux », 2006 [1979].
18. Gaudichaud F., Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2013.
19. Cette situation concerne plus de la moitié des parents de nos interviewés.
20. La croyance en un modèle tenu pour juste est vertueuse, permettant à celui qui la porte de
l’être également. Il y a en ce sens une carrière morale – Goffman E., Asiles. Études sur la condition
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
144
sociale des malades mentaux, Paris, Éditions de Minuit, 1968 (trad.) – et une possible élévation
morale.
21. À partir de 1982 et surtout de 1984, sont publiées des listes autorisant une série de personnes
à revenir (ou interdites de retour) : les premiers retours significatifs ont lieu. Un décret suprême
met fin à l’exil politique le 1er septembre 1988. En 1990, le gouvernement de la Concertación
(Concertation de partis pour la démocratie, née en 1988, rassemblant le centre et la gauche
chilienne, à l’exception du PC) met en place une politique d’aide au retour jusqu’en 1994.
22. Gaillard A.-M., ibid.
23. Pollak M., Une Identité blessée, études de sociologie et d’histoire, Paris, Métaillé, 1993.
24. Levi P., Le devoir de mémoire, Paris, Mille et Une Nuits, 1995 ; Semprun J., Wiesel E., Se taire est
impossible, Paris, Mille et Une Nuits, 1995.
25. Garcia Castro A., La mort lente des disparus au Chili sous la négociation civils-militaires (1973-2002),
Paris, Maisonneuve & Larose, 2002.
26. Viñar M. et M., Exil et Torture, Paris, Denoël, 1989.
27. Jedlicki F., « Les exilés chiliens et l’affaire Pinochet. Retour et transmission de la mémoire »,
Les cahiers de l’Urmis, n°7, 2001, pp. 33-51.
28. Viñar M., « L’énigme du traumatisme extrême » (Re)penser l’exil, n°1, Genève, 2010/2011 ;
« Violenca política extrema y transmission intergeneracional », (Re)penser l’exil, n°3, Genève,
2013, pp. 147-153.
29. Hirsch M., « The Generation of Postmemory », Poetics Today, n°29, 2008, pp. 103-128.
30. Gampel Y., Ces parents qui vivent à travers moi. Les enfants des guerres, Paris, Fayard, 2005, p. 81.
31. Viñar M., 1989, ibidem ; Araneda M., « Les influences de la réalité externe dans les situations
extrêmes », communication au 44e Congrès de l’Association Internationale de Psychanalyse, Rio
de Janeiro, 28 au 31 juillet 2005.
32. Expression empruntée au documentaire de Pacull E., « Héros fragiles », Paris, éditions
Montparnasse, 2007, 87 min., 35 mm/1.85.
33. L’exil tendant à produire du resserrement sur la cellule familiale et de l’interdépendance
entre ses membres.
34. Cette hypothèse s’inspire de l’analyse du don de rein (par donneur vivant à son épouse), pas si
« désintéressé » que cela. Cf. Baudelot C., Baudelot O., Une promenade de santé. L’histoire de notre
greffe, Stock, 2008.
35. Zarca B., ibid.
36. Le sentiment de libération éprouvé par une partie des interviewés à la fin des entretiens
attesterait également de l’existence de cette névrose commune (Zarca B., ibidem).
37. Tous se caractérisent également par une détestation commune, mâtinée d’une grande
méfiance voire de peur, envers les forces de l’ordre, particulièrement militaires.
38. Viñar M., ibid.
39. Décès et/ou maladie d’un membre de la famille nucléaire, séparations douloureuses entre les
parents, difficultés d’emploi, tendance à changer de lieux de résidence (parfois de pays), etc.
40. Pagis observe le même sentiment chez des enfants de soixante-huitard. Cf. Pagis J., Les
incidences biographiques du militantisme en mai 68. Une enquête sur deux générations familiales : des «
soixante-huitards » et leurs enfants scolarisés dans deux écoles expérimentales (Vitruve et Ange-Guépin),
thèse pour le doctorat de sociologie, EHESS, 2009.
41. Soit après être rentré au Chili.
42. Pagis J., ibid.
43. Bastide R. « Mémoire collective et sociologie du bricolage », L’Année sociologique, vol. 21, 1970,
pp. 65-108.
44. Frente Patriótico Manuel Rodríguez, bras armé du PC.
45. Camilleri C., Kartersztein J. et al., Stratégies identitaires, Paris, Presses Universitaires de France,
1997.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
145
46. Gaillard A.-M., ibid.
47. Bourdieu P. (dir.), La misère du monde, Paris, Seuil, 1993.
48. Il faut néanmoins souligner combien les écarts entre les plus riches et les plus démunis ont
augmenté sous la dictature. Le Chili post-dictatorial est considéré par la statistique
internationale comme l’un des pays de l’OCDE les plus inégalitaires en termes de répartition des
revenus.
49. Au Chili, l’enseignement supérieur et secondaire est privatisé et très onéreux.
50. Sayad A., ibid.
51. Percheron A., La socialisation politique, Paris, Armand Colin, 1997 ; Pagis J., ibid.
52. Qui diffère très légèrement de la définition donnée par Matonti F. et Poupeau F., « Le capital
militant. Essai de définition », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 155, 2004, pp. 4-11. Ici, ce
capital s’acquiert dès l’enfance, dans des expériences que les enfants ne vivent pas
nécessairement comme militantes, mais auxquelles ils participent réellement, sans en être de
simples spectateurs.
53. FPMR ; MAPU-Lautaro.
54. Cuadros D., « Répression, transition démocratique et ruptures biographiques. Le cas des
militants communistes chiliens», Cultures & Conflits, n° 89, 2013, pp. 53-69.
55. Pagis J., ibid.
56. Les parents parfois également, notamment lorsqu’ils ont confié leurs enfants à d’autres
camarades. Voir notamment le film de Carmen Castillo « Rue Santa Fe », Les films d’ici/ Institut
National de l’Audiovisuel, Love Streams agnès b Productions, 2007, 160 min., 35 mm/1.85.
RÉSUMÉS
Plus de quarante années ont passé depuis le coup d’État militaire du 11 septembre 1973 qui
renversa le gouvernement d’Unité Populaire, présidé par Salvador Allende, incarnant à ce
moment de la guerre froide l’espoir d’un modèle d’alternative socialiste susceptible de se
propager dans le monde. Si l’année 2013 a été l’occasion d’importantes commémorations de
l’événement, en particulier en France, il s’agira ici d’analyser les effets de ce dernier sur les
mémoires familiales d’exilés et retornados (littéralement retournés) chiliens, ayant vécu
principalement en France. Autrement dit, il sera question d’héritage et de construction de soi, à
partir d’un cas sociologique spécifique : l’exil et son corollaire le retour, expériences migratoires
forcées marquées par des engagements politiques sur la gauche de l’échiquier politique et par la
violence extrême, traumatisant au moins deux générations.
More than forty years have passed since the military coup of the 11th of September 1973, which
overthrew the Government of Popular Unity headed by Salvador Allende and incarnating at that
point of the Cold War the only hope of an alternative socialist model capable of spreading
throughout the world. If 2013 marked an important moment of commemoration of the coup,
notably in France, this article proposes an analysis of the effects of that event on the family
memories of Chilean exiles and the retornados (literally “the returned”) who predominately lived
in France. In other words, this article addresses the issues of inheritance and construction of the
self in the framework of a specific sociological case: exile and its corollary of return, alongside
experiences of forced migration marked by political engagements with the left of the political
spectrum and extreme violence, which has traumatized at least two generations.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
146
INDEX
Keywords : Chile, exile, family order, sociology, post-dictatorship
Mots-clés : Chili, exil, mandat familial, sociologie, post-dictature
AUTEUR
FANNY JEDLICKI
Fanny Jedlicki est maîtresse de conférences en sociologie à l’Université du Havre, chercheure au
laboratoire IDEES (UMR 6266). Ses travaux ont porté sur les phénomènes migratoires et de
transmission d’une mémoire familiale en Amérique Latine (Chili et Argentine). Elle travaille
aujourd’hui sur les déterminants de (l’im)mobilité sociale et géographique de primo-étudiants
français d’origine rurale.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
147
« Danses macabres » : Unetechnologie culturelle du massacredes Tutsi au Rwanda“Dance of Death”: Cultural Technology of Tutsi Slaughter in Rwanda
Thomas Riot, Nicolas Bancel et Herrade Boistelle
1 Kigali, le 1er juillet 1987. En ce jour de célébration du vingt-cinquième anniversaire de
l’indépendance du Rwanda, un groupe de danseurs intore (élus, choisis) réalise uneperformance chorégraphique. Le spectacle prend forme au stade national de Kigali,érigé en scène commémorative de l’indépendance. Une troupe composée d’unecentaine d’enfants et d’adultes spécialement sélectionnés pour l’occasion se place surdix rangées parallèles au front de scène. L’alignement des intore se réalise par laconstitution d’une série de rangs, selon un ordre chorégraphique qui se lie peu à peu auchant qui l’accompagne :
« Tu as dit adieu au pouvoir monarchique, le joug féodal et colonial sont partisensemble, tu as obtenu la démocratie dont tu es fier […] Cher Rwandais, jette unregard en arrière et souviens-toi du fouet, des travaux forcés […] Souviens-toi desjournées de marche où tu transportais des cadeaux au chef et au roi, en privant tafamille qui avait pourtant besoin, et une fois à destination tu n’obtenais même pasde récompense […]. Viens qu’on fête les bienfaits de l’indépendance [paroleschantées] 1 ».
2 La marche d’approche se compose de pas esquissés, de flexions de genoux à peine
marquées et de légères détentes de bras armés d’arcs et de lances. Cette entrée enmatière est suivie du « cœur » de la chorégraphie. Au centre du groupe, un noyau dedanseurs d’excellence (le « nombril ») est chargé de produire les « pas de base », àpartir desquels les autres danseurs (à gauche et à droite) règlent leur prestation.Partant de cette « base », chaque intore a la possibilité de broder des figures inéditesplus ou moins complexes. Ils jouent avec les contre-temps, les objets (armes, coiffes,grelots, etc.) et les techniques soumises à l’ordre guerrier de la danse : saltations,retraits, feintes, attaques, etc. Il s’agit de composer un ensemble d’exhibitions en soloset en duos, après quoi chaque danseur est invité à rejoindre l’ensemble de la « mêlée »
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
148
ainsi reconstituée. La troupe effectue alors une dernière et courte séquence suite àlaquelle les intore quittent la scène en pas cadencés.
3 Ainsi, et tandis que les techniques des danseurs marquent les figures individuelles et
collectives de la chorégraphie, la cérémonie du vingt-cinquième anniversaire del’indépendance y ajoute un chant de danse qui pose la ligne idéologique del’événement. Cette « ligne » s’inscrit dans l’activation du paradigme de la « révolutionhutu », qui aurait conduit la libération du « peuple hutu » vis à vis de son oppresseur leplus direct : la monarchie tutsi.
4 Identifiée à un joug ancestral opposant deux catégories de la population rwandaise
(serfs hutu vs féodaux tutsi), la féodalisation de la monarchie tutsi est en réalité unproduit de l’histoire coloniale du Rwanda : le colonisateur (allemand de 1897 à 1916,belge de 1916 à 1962) délégua aux chefs tutsi l’œuvre d’exploitation de la majoritécolonisée (identifiée à l’ethnie hutu), tout en essentialisant les rapports socio-ethniquesen distinguant nettement, sur les cartes d’identité, l’appartenance ethnique. Être« hutu » signifiait être cantonné dans les fractions les plus pauvres et les emplois lesmoins dotés de l’économie coloniale. Au cours des années 1950, ce mode « autochtone »de domination coloniale favorisa la levée d’une « contre-élite hutu » 2, pour qui ladécolonisation s’articulait à la disparition des privilèges attribués aux Tutsi. Entre 1959et 1961, une série d’assassinats et de pogroms visant les élites tutsi précéda la chute dela monarchie Nyiginya et l’instauration de la Première république hutu (le 1er juillet1961) 3. Après l’indépendance, les régimes successifs de Grégoire Kayibanda (1961-1973)et de Juvénal Habyarimana (1973-1994) renforcèrent cette ligne idéologique,continument mobilisée dans les appels à l’élimination des ennemis du « peuplemajoritaire » 4.
5 À la fin des années 1980, l’État rwandais – gouverné par le parti unique du Mouvement
révolutionnaire national pour le développement (MRND) – est sujet à de nombreusestensions politiques. Arrivé au pouvoir suite à un coup d’État (en 1973), le gouvernementHabyarimana se montre directement affecté par l’angoisse de voir le pays reconquis pardes groupes ayant fui le pays entre 1959 et 1961, composés de Tutsi traqués par desgroupes de radicaux hutu alliés à l’ancien gouvernement colonial. À la fin des années1950, le colonisateur belge avait en effet opéré un retournement d’alliance en faveur deces groupes hutu, retournement motivé par les aspirations de plus en plus nettementexprimées par les élites tutsi à conquérir l’indépendance. Dans les décennies quisuivent celle-ci, une diaspora composée de tutsi ayant fui les persécutions construisentun appareil militaire, le FPR (Front patriote rwandais), engagé dans la reconquête desterritoires rwandais frontaliers avec le Burundi et l’Ouganda et, à plus long terme,visant la reconquête du pouvoir au Rwanda. Dans ce contexte, les bourgmestres etpréfets du MRND puisent au jour le jour des informations relatives à l’activité decolonnes du FPR. À chaque nouvelle tentative d’incursion des troupes de la diasporatutsi, chaque préfecture concernée déploie (à l’encontre des Tutsi de la zone) uneviolence physique révélatrice du sentiment d’angoisse paranoïaque qu’elle manifeste.Une archive missionnaire nous rappelle que ce mode extrême de réaction s’enracina auRwanda au début des années 1960 :
« La réaction populaire a été très vive surtout dans les régions où les infiltrationsavaient été plus nombreuses. La politique de la main tendue qui avait été celle dugouvernement, admettant dans ces services de nombreux Tutsi qui se disaientfidèles au nouveau régime, a été soldée par un échec. Chacun de ces employésversait un tiers de son traitement à l’UNAR (Union nationale rwandaise) pour
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
149
acheter des armes qui devaient servir à reconquérir le pays et y réinstaller lamonarchie. […] Le Rwanda s’est retrouvé du jour au lendemain en état de guerre etles ennemis étaient partout. Évidemment on en a trouvé là où il n’y en avait pas, etce fut l’occasion d’assouvir des vengeances personnelles. On ne peut nier qu’il y aiteu des massacres, et beaucoup trop 5».
Une approche pratique et symbolique de la violence demasse
6 Plus de vingt années après sa perpétration, le génocide qui a visé les Tutsi du Rwanda
au cours de l’année 1994 a rarement été appréhendé dans le « comment » de sonexécution 6. Avec une très grande efficacité, des hommes « d’action », principauxacteurs des pogroms, ont mis en œuvre une technologie du massacre des Tutsi. Unpremier groupe (majoritairement masculin et bien entraîné) avait fait ses classes dansles organisations de jeunesse et les cellules « d’animation » 7 du parti unique, leMouvement révolutionnaire national pour le développement MRND 8 (jusqu’en 1991).Dès le début des années 1990, de nombreux cadres du parti s’engagèrent dans laformation d’un second groupe de miliciens 9, le plus efficace exécutant des crimes. Eneffet, ensemble (cadres et exécutants), ces deux groupes forment la masse des 50 000hommes, femmes et jeunes (soit environ 25 % des 200 000 auteurs des tueries) et sontresponsables du massacre d’environ 600 000 Tutsi, soit environ 75 % des 800 000meurtres exécutés en cent jours 10.
7 Le massacre des Tutsi au Rwanda a fait l’objet de nombreuses publications. Tandis que
l’essentiel de ces études se concentrent sur l’histoire socio-politique 11 et idéologique 12
de l’événement, d’autres recherches l’abordent sur un plan micro-sociologique quiéclaire les dynamiques locales du mûrissement et de l’exécution des pogroms 13. Cesétudes constituent le point de départ de notre approche de la violence de masse. Ellespermettent d’une part de repérer les dispositifs (communaux, ruraux et nationaux) etles organisations qui se trouvent à l’origine des mutations sociales, économiques etpolitiques des acteurs de la violence. Elles autorisent d’autre part l’élaboration d’unsavoir axé sur une démarche processuelle et générative : comment un certain nombrede relations sociales, de confrontations symboliques et de techniques de gouvernementinteragissent dans l’engagement politique et armé des individus formés par cesdispositifs ?
8 Devenue célèbre à l’échelle internationale, la danse guerrière rwandaise (umuhamirizo)
n’a jamais été interrogée sous l’angle de sa potentielle articulation aux politiques de laviolence de masse. Comme d’autres « techniques réflexives du corps » 14, lachorégraphie peut s’envisager selon les modifications corporelles entraînées parl’action des danseurs, ainsi que selon l’agencement politique et symbolique de leursfigures. En langue kinyarwanda, cette action se rapporte au verbe guhamiriza, quidésigne un dispositif corporel et guerrier destiné à « faire fuir l’ennemi de sorte quecelui-ci prenne ses jambes à son cou sans oser même se retourner » 15. De la fin desannées 1970 au début des années 1990, de nombreux bourgmestres et animateurslocaux du MRND ont organisé le recrutement et l’initiation de plusieurs milliers dedanseurs. On les retrouve à Kigali, à Kibemge ou à Gitesi, comme dans les 70 communes(sur 145) orchestratrices du mouvement : des groupes composés d’individusmajoritairement issus de la communauté racialisée des Hutu, qui furent affectés – de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
150
gré ou de force – à la « technologie politique » des danses communales et nationalesimihamirizo 16 (dont l’action guhamiriza dérive).
9 Dans le cadre de nos réflexions sur la potentialité d’un lien entre ces techniques et
l’exercice de la violence de masse, nous proposons d’étudier les actions menées par descorps sur d’autres corps : le « corps propre », celui que l’on peut toucher, combiné àla « chair », c’est-à-dire les dimensions éprouvées de la corporéité. À ce sujet, notonsque les « corps dansants » qui se trouvent au centre de notre propos ne constituent pasdes instruments « prêts à tuer ». Suivant le registre conceptuel foucaldien de la« microphysique du pouvoir », il s’agit de comprendre une part de la subjectivationgénocidaire et la façon dont les rapports de pouvoir qu’elle impulse passent par lescorps. Nous rejoignons ainsi toute une tradition anthropologique qui, de Veena Das 17 àJoao Biehl 18 en passant par Arthur Kleinman 19, a composé une anthropologie dessubjectivités largement inspirée des travaux du philosophe français. En matière dedanse, nous nous rapprochons de même des travaux pionniers de J. Clyde Mitchell, quiconsidère la « situation dansée » non dans le cadre d’une fin en soi, mais plutôt commeun prisme autour duquel les conflictualités sociales se matérialisent 20. Selonl’environnement social et politique de ces répertoires symboliques et technologiques, ilexisterait selon lui un espace de tension et d’opposition qui ne pourrait se relâcher quedans la violence, ou dans ce que Randall Collins appelle une « panique aggravée 21 ». Ils’agit là de la situation la plus dangereuse et la plus explosive qui soit ; situation dontles « techniques réflexives du corps » constituent, par hypothèse, les coulisses.
10 Au cœur de la situation génocidaire que nous explorons se trouve une mise à
disposition des corps par les techniques qu’ils mettent en mouvement et qu’ilss’approprient. À ce sujet, nous postulons que ces techniques pourraient – selon descirconstances sociales et politiques déterminantes – constituer une forme d’initiationouvrant sur les pratiques de la violence de masse. Dans notre cas, il s’agit decomprendre comment – par le medium de la danse guerrière – se forment une hexis
guerrière potentiellement mobilisable dans les pratiques, s’articulant aux imaginairesdu génocide. Notre propos consiste ainsi à décrire et analyser la façon dont se tisse lelien entre la sédimentation d’une disposition agonistique et son activation dans laviolence aussi extrême que paradoxalement normalisée du génocide. Pour ce faire,nous combinons à la littérature ethnographique et microsociologique sur le génocide,un corpus d’archives et de témoignages collectés en Belgique, en Italie et au Rwandaentre 2007 et 2014. Ces sources – archives missionnaires et gouvernementales,monographies, entretiens menés auprès d’anciens dirigeants rwandais et de plusieursrescapés du génocide 22 – ont été analysées dans le souci de reconstituer les médiationspar lesquelles une formation chorégraphique a été mobilisée dans les arènes de laviolence de masse. Nous suggérons que dans la période visée (entre 1987 et 1994), lesdanses guerrières imihamirizo agencent des corps dont les parties (membres, fictionssymboliques, répartitions matérielles) entrent en tension. Dans les conceptions ques’en font les acteurs et les techniques qu’ils s’approprient, ces corps contiendraientégalement leurs « impuretés » (leurs « virus », identifiés à l’infection du corps socialpar les Tutsi), à l’encontre desquels il va s’agir de prendre des mesure prophylactiques.Le démembrement des corps ne serait-il pas dès lors une manière de rétrécir l’action deceux qui ne peuvent plus être membres du corps social ? On découpe ainsi les membressurnuméraires comme on rétablirait la santé d’un organisme purifié de ce qui semblel’infecter. Afin de mettre à l’épreuve cette dernière hypothèse, il s’agit d’explorer lapart « dansée » de cette « mise en ordre » de la violence génocidaire, dans le souci de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
151
comprendre comment ces techniques se sont inscrites dans la matérialisation d’uneidéologie qui a désigné ses victimes émissaires 23.
Faire fuir l’ennemi, purifier le « mal »
11 Des années 1960 aux années 1980, la continuité des procédures d’élimination politique
et physique des éléments « inappropriés » à l’ordre de la « révolution hutu » – soit lesindividus présentant le caractère d’une alliance potentielle avec les troupes de ladiaspora tutsi – ne fait aucun doute. C’est ainsi que chaque situation de tensionentraînée par la réintroduction potentielle des « ennemis de la démocratie » (ceux queles gouvernements du Rwanda dénomment les « féodaux ») génère – en retour – lamobilisation d’éléments hutu affectés à la purification ethnique d’un territoire donné.Ces formations radicalisées puisent leurs ressources matérielles et idéologiques auniveau local, au sein des communes et des préfectures les plus engagées dans lemaintien de « l’ordre hutu » face au « danger tutsi ».
« C’était notre devoir de défendre la démocratie, donc le pouvoir du peuple ! Alorsquand il se passait des choses qui pouvaient la mettre en danger, il fallait résoudrela situation et éviter que les choses vacillent. Cela faisait partie du quotidien desdirigeants ! Moi à Kigali j’ai connu plusieurs fois des désordres. Alors on a essayé decalmer les choses, mais tous les gens ne tenaient pas forcément à les arranger […].Alors on a essayé de mobiliser les gens pour développer le pays sur de bonnes bases.Dans les communes il y avait des groupes de jeunes qui faisaient des travauxcollectifs, d’autres qui chantaient, qui dansaient… C’est le président qui avait eucette idée, et nous nous étions chargés d’organiser tout ça 24 ».
12 Sous la Seconde république rwandaise (1973-1994), les entités administratives
décentralisées que constituaient les communes se composaient de plusieurs secteurs(regroupant environ 5 000 personnes) dans lesquels des responsables de cellules(regroupant environ 1 000 personnes) étaient chargés d’exécuter les ordres dubourgmestre 25. À partir de 1977, le parti unique MRND institua le fait que chaquecellule devait concevoir un dispositif « d’animation politique » composé d’une troupede chant et de danse 26. Le recrutement des membres était confié à des comités de cinqou six personnes choisies, qui parcouraient les environs du centre afin d’affilier denouveaux danseurs (agriculteurs, petits commerçants, ouvriers, jeunes délinquants) àce programme de « développement culturel » 27.
13 Confiés à des spécialistes de danse guerrière, les entraînements avaient lieu au moins
une fois par semaine. Chaque séance commençait par les déclamations des défis du jour(guhiga). Le ton était donné par l’animateur principal : « Il pouvait choisir par exemplenkubito, ce qui incite à la vaillance et à la rapidité. Alors on donnait ce thème et le tonde ce thème, et chacun devait dire ce qu’il allait faire 28 ». Dans le cadre des cellulescommunales d’animation, ces défis pouvaient s’articuler à la promesse d’unengagement sans faille en faveur de l’ordre développementaliste prôné par legouvernement :
« Ils disaient qu’il allaient lutter pour leur pays, que nul ne saurait surpasser leshéros du MRND, qu’ils ne craignaient pas la bataille, et qu’ils protègeraient leRwanda contre tous ceux qui cherchaient à le combattre 29 ».
14 De fait, les défis des intore opérant dans les centres communaux rejoignaient la ligne
d’auto-défense du régime vis à vis des « courants maléfiques » qui, selon les termes duMRND, pouvaient porter atteinte à la « nation rwandaise » et provoquer sa
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
152
« désintégration » 30. L’imihigo (défi) est lancé. Il s’agit d’une préparation des corps àleur mise en action, couplée à des processus d’identification au « combat » ques’apprête à mener chaque intore : « Comment oses-tu me défier ? Je suis le brave que nulne saurait dépasser. Je suis l’expert qui ne cesse d’entasser l’adversaire dans des maresde sang figé 31 ».
15 Suite au guhiga, l’action guhamiriza se déploie selon une triple dimension symbolique,
matérielle et politique. Vêtus de pagnes et de coiffes guerrières, accompagnés delances, d’arcs ou de boucliers, les danseurs effectuent un enchaînement de sauts, defeintes, d’assauts ou d’esquives. La technique s’inscrit dans la construction de l’appareilcollectif de conquête et de défense du territoire de la danse. Simultanément, unecompétition s’exerce à l’intérieur du groupe, au centre de la lutte que mènent des« corps noirs » (impurs) face à des « corps blancs » (purs, fastes). Jean-BaptisteNkulikiyinka a réalisé un schéma de formalisation de l’organisation matérielle, spatialeet symbolique de la chorégraphie. Dans l’agencement qu’il présente, les lignes debataille ingamba forment les unités collectives de base du corps-dansant. À l’avant de lascène, la première rangée est composée des danseurs les plus compétents. Les suivantessont considérées comme des lignes d’appoint. Les subdivisions de ces ensemblesrendent compte d’une organisation spatiale codifiée. Chaque rangée de danseurs estrépartie en trois parties principales : le milieu ou « nombril » ; les deux flancs ou« coudes » ; les extrémités ou « ailes » 32.
Schéma de la danse umuhamirizo
D’après Jean-Baptiste Nkulikiyinka, Introduction à la danse rwandaise traditionnelle, Tervuren, Annalesdes Sciences humaines, 2002.
16 Cet agencement est conçu comme un ordre hiérarchique matérialisé par les actions des
danseurs. Elles sont en premier lieu associées aux rôles et aux places qu’ils occupent. Àpartir d’un centre composé des éléments les plus compétents, le corps de la danse sedéploie du « nombril » jusqu’aux « ailes ». La danse prend les allures d’un corps enmouvement. Chaque individu compose un membre de cette entité, et chaque membre(ou partie du corps : ici les danseurs) fait partie d’un organe plus large (ici le
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
153
« nombril », les « coudes » et les « ailes ») qui a sa fonction propre, différente desautres. Inégaux en puissance, en moyens et en attributions, ces organes sontcomplémentaires et se fondent dans un tout organique.
17 Au cœur du « nombril » se trouve le « capitaine », chargé de mener le jeu ; les autres
danseurs règlent leur prestation sur la sienne. Partant du centre du corps incarné parle « nombril », les mouvements des « coudes » transmettent la force physique et le fondsonore nécessaire à la cohérence de l’ensemble du corps. L’ensemble circule jusqu’auxextrémités, qui agitent leurs « ailes » dans le strict respect de la hiérarchie gestuelle etmusicale orchestrée depuis le « nombril », transmise par les « coudes ». La hiérarchie sefonde donc sur un ordre agencé de l’avant vers l’arrière et du centre vers lesextrémités. La différenciation qui s’opère entre la droite et la gauche estsymboliquement caractérisée par les appellations « Noirs » (à droite) et « Tout Blancs »(à gauche). Ces deux groupes se livrent à une compétition permanente qui permet – infine – de désigner l’élément le plus « compétent » : celui qui répond le mieux au tondonné (vaillance, ardeur, rapidité, etc.) et qui porte plus de « coups » que sesconcurrents à l’adversaire de l’action mobilisée.
18 Du début des années 1990 au mois de juillet 1994, le glissement de ces conduites
chorégraphiques guerrières vers la mise en œuvre du génocide a été grandementconditionné par l’engagement (volontaire, conseillé ou forcé) de quelques milliers dedanseurs dans les groupes extrémistes qui menèrent les pogroms (notamment lesgroupes interahamwe). À partir de l’année 1991 et conjointement à l’officialisation dumultipartisme 33, les territoires culturels des partis politiques en présence seradicalisent :
« Je savais tout simplement que j’étais membre du MDR, car celui qui se refusaitd’adhérer à ce parti était condamné. C’était une façon de se racheter. […] Donc il yavait des meetings, nous passions toute la journée à danser, celui qui le pouvait,celui qui n’était pas capable, il restait à la maison, mais avec sa carte, de façon quesi on le surprenait, il pouvait montrer cette carte pour que les autres voient qu’ilétait lui aussi membre. C’est comme ça que nous vivions 34 ».
19 Au cours de l’année 1992, ces espaces politico-culturels constituent l’un des viviers du
recrutement de miliciens préparés à briser l’opposition politique par la violence. Dansle monde très concret de l’initiation au combat, il n’est plus question de danser ; il s’agitde parfaire sa formation dans l’exercice des techniques et des objets appelés àconstituer un front d’« auto-défense » face aux opposants potentiels au« développement » de l’institution : « En bref, nous les entraînions à courir longtempset acquérir de l’endurance, à monter à l’aide d’une corde, à tuer avec le couteau et aussiaux exercices de tir 35 ». La guerre menée par d’anciens réfugiés tutsi depuis l’Ougandaet le Burundi voisins est un élément important de justification de cette initiationmilicienne. Entre 1990 et 1993, chaque tentative d’incursion de l’Armée patriotiquerwandaise (APR) est suivie de la mobilisation de groupes conditionnés à l’idée de« survie de l’ethnie majoritaire », qui massacrent des milliers de Tutsi identifiés aux« alliés de l’intérieur » du FPR 36.
20 Dans ce cadre, et conjointement à la violence de masse qui s’exerce dans le champ
matériel et idéologique des combats miliciens menés par le mouvement Hutu Power 37,certains de ses membres participent encore (jusqu’en 1994) à des séances de danseguerrière. La combinaison de l’idéologie milicienne anti-Tutsi aux techniques de dansedonne corps à la technologie politique du mouvement. Dans cette situation, des actionsmenées auprès des Tutsi de la cellule matérialisent le paradigme d’une opposition
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
154
ethnique entre Hutu et Tutsi, révélant dans l’espace de la danse le « combat » plus largedans lequel les radicaux hutu se trouvent engagés. À l’échelle locale, il peut s’agir defaire danser de force (sous peine de coups et des heures durant) certains Tutsi de lazone, contraints d’ajuster leurs pas à des chants de louanges au parti politique danslequel s’exerce l’action (comme par exemple celui des partisans du MDR 38 ). Un extraitde l’un de ces chants (le plus diffusé de l’époque) indique la férocité avec laquelle lesdanseurs hutu radicalisés allaient s’engager dans la technologie plus large du génocide :
« Qu’ils viennent les fils de Sebahinzi ! Nous devons savoir que si les Inkotanyiprenaient le pouvoir par les armes, ce qui est d’ailleurs impossible, leurs différentspartis disparaîtraient et leurs membres seraient exterminés comme ce fut le caspour les roitelets hutu avant que le lendemain le Tutsi victorieux ne proclame : “Ilétait une fois, que ce ne soit plus. Les chiens et les rats sont morts, seuls survivent lavache et le tambour. Nous ne nous souvenons pas vraiment de cet épisode” 39 ».
21 Au début des années 1990, les chants des danseurs, comme les récits radiophoniques de
leurs épopées, donnaient une tonalité émulatrice au monde matériel et imaginaire del’auto-défense face aux « ennemis » de la République 40. Ils reprenaient en ces termes lerépertoire bien connu de « l’animation », dans lequel s’inscrivait – depuis la fin desannées 1970 – les danses guerrières imihamirizo. Mais de fait, comment pourrait-on direqu’au cours des années 1980, un jeune paysan rwandais qui s’adonnait à une séance dedanse guerrière se préparait à utiliser une lance pour décimer – au cours de l’année1994 – ses voisins tutsi ? Il ne s’y préparait pas. Il s’exerçait à « faire fuir l’ennemi desorte que celui-ci prenne ses jambes à son cou sans oser même se retourner ».
Danser la guerre, exterminer les Tutsi
22 Au cœur des espaces sociaux et politiques dédiés aux chorégraphies guerrières, l’ordre
des danseurs n’est pas celui du génocide. Pourtant et sous de multiples facettes, il lerappelle. Dans le cadre d’une symbolique plus ancienne, le corps rwandais est appelé àtemporiser la situation ambivalente d’un monde terrestre où la mort ne cesse deguetter la vie 41. Cette conception désigne les « corps blancs » comme des élémentsfastes, vivants, alors que les « corps noirs » manifestent l’oubli, la disparition de lasurface des vivants. Suivant le schéma précédent, alors que les « Noirs » et les « ToutBlancs » déploient – dans une relation concurrentielle – des forces obscures d’un côté,fastes de l’autre, la convergence de ces fluides vers le centre du corps assure unrééquilibrage de l’apparente opposition pur/impur, vice/vertu. Si les « Noirs »incarnent le « mal » et les « Blancs » le « bien », la lutte qu’ils mènent doit conduire à lavictoire d’une seule et même entité : l’ordre de la guerre menée par le mouvementguhamiriza. Au cœur de cet « ordre » se trouve le combat du centre : axe de l’exercicelégitime du pouvoir incarné par l’action des danseurs.
23 Il s’agit d’un appareil de production des techniques du « bien » et du « mal », des vices
et vertus par le médium desquelles se forge la normativité du danseur guerrier : oùl’oisiveté se décline en ardeur ; où la crainte renvoie à l’audace ; où le désordres’institue en ordre. L’ennemi est donc en premier lieu celui qui s’oppose àl’organisation, qui tente de la déstabiliser, allant jusqu’au combat final. Ce dernier setrouve associé à la subjectivation d’un certain nombre de ressources pratiques etsymboliques : porter et recevoir un coup ; s’attendre à être déstabilisé ; armer soncorps ; connaître les manifestations du faste et de l’impur. Dans l’ensemble, lesmembres combattent les forces d’opposition au modèle légitime forgé par l’institution.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
155
Le pouvoir qu’elle exerce s’apparente au produit disséminé de « l’anatomie politique »du dispositif. Dans les arènes normatives du « bien » et du « mal » comme dans lestechniques belliqueuses menées par la troupe, il donne un sens social à l’expérience ducombat. La technologie de l’ordre guerrier ainsi créé laisse apparaître l’ennemi de sondéveloppement : les corps infectés par un ensemble de virus pouvant porter atteinte àl’intégrité des « sauveurs ». Chacun lutte, en interne et dans la projection du groupeface à l’extérieur, contre la dissémination des « maladies » qui pourraient atteindre legroupe. Et chacun renforce, à titre individuel et collectif, la lutte engagée face audésordre, à l’impur, à l’irrégularité.
24 Sous la Seconde république rwandaise, un tel dispositif pratique et symbolique a
alimenté les fractures autour desquelles se sont agencés les territoires de l’institutionet les ennemis de l’ordre subjectivé par les techniques de danse. Depuis 1990, la guerreenclenchée entre le pouvoir rwandais et les armées du FPR alimentait l’angoisseparanoïaque des membres de mouvements politiques et (para)militaires préparés àsystématiquement riposter aux attaques du FPR par le massacre de leurs « alliés ».Conjointement, et notamment à partir de 1991, les cellules de danse affirment denouveaux besoins : il s’agit de collaborer avec les partis politiques en présence (MDR,MRND, etc.) et d’offrir aux Hutu de la région la possibilité de remporter la « guerre » 42
que ces partis entendent mener face aux « ennemis de la nation » (les Tutsi) 43. À partirde ce moment, les quelques Tutsi qui officient encore dans les troupes communalessont considérés comme des « maladies à soigner ». Il s’agit de prendre à leur encontredes mesures prophylactiques qui se manifestent dans la répétition de danses et dechants pour « la sécurité de l’État » :
« Dis aux fils de Sebahinzi de venir ! Ils doivent comprendre que le peuplemajoritaire doit s’unir et avoir un seul objectif pour sauvegarder ses intérêts. Lesfils de Sebahinzi doivent soutenir fermement, avec abnégation les forces armées etau besoin les rejoindre pour protéger la mère patrie et l’intégrité de laRépublique 44 ».
25 Le 6 avril 1994, des milliers de militaires, miliciens et civils apprennent la mort du
président Habyarimana 45. Associé aux violentes rivalités entre les partis politiques enprésence, à la crainte et à la haine du régime envers ceux qu’il identifie aux« féodaux de l’extérieur et de l’intérieur » (soit le mouvement du FPR et les Tutsi dupays), la faille politique causée par l’assassinat du président est un appel à la conquêtedu pouvoir. Des groupes d’intermédiaires locaux (préfets, bourgmestres, militaires,responsables de mouvements de jeunesses, chefs de groupes miliciens) activent destechnologies politiques de mise en œuvre de la violence collective. Le principal vivierde recrutement des milices du génocide est composé des membres les plus actifs denombreuses organisations : supporters et joueurs de football, danseurs-guerriers,jeunes et adultes militants politiques, membres de groupes (para)militairespotentiellement mobilisables par le régime (« l’armée populaire » convoquée parMonsieur Z 46 dès janvier 1993) 47. Ces organisations composent les unités paraétatiquesautour desquelles se tisse peu à peu un lien entre les dispositions agonistiques desdanseurs et les technologies politiques plus larges du corps génocidaire. Un tel « lien »peut s’expliquer par le fait que les danses guerrières agissent selon une tripledimension psychique, symbolique et sensorielle. Depuis les chorégraphies menées dansles cellules communales de l’intérieur du Rwanda, la mise en tension des danseurs serenforce sous la menace de voir les Tutsi piétiner leurs territoires. Les techniques des
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
156
initiés hutu peuvent se lire face à ceux qu’ils considèrent comme leurs ennemis les plusintimes 48. La « guerre des frontières » s’actualise sous les pas et les chants des troupes :
« Nous partons en guerre. Nous répondons à l’appel des frontières. Nous voici,pareils au fer de lance, ennemis déclarés de la peur […]. Réponds à cet appel à laguerre, toi, lance prête à s’élancer. Manie ta lance, pare avec ton bouclier, dresse lesflèches dans ton arc et déclame tes hauts faits à l’agrément de tous, tant que noussommes 49 ».
26 À l’intérieur du pays, les danseurs-guerriers hutu les plus radicalisés ont désigné les
victimes émissaires de leur combat (les Tutsi) dans ce que l’on peut appeler une « luttepour la survie de la troupe » : les imaginaires d’auto-défense qui se déploient dans lesgestes et paroles des danseurs constituent la trame symbolique la plus aggravante duphénomène ; cédant à une sorte de « panique aggravée » face au « risque » d’êtrelittéralement « mangés » par les Tutsi, des danseurs hutu prennent les chemins d’uneradicalisation politique des plus extrêmes : « Certains étaient devenus fous… Alors ilsont arrêté de danser, et se sont mis au travail 50 ».
27 Au moment de l’exécution du génocide, la rationalité du massacre transparaît de
l’action collective et individuelle des tueurs. Elle consiste dans un premier temps àencercler les futures victimes, et à placer les cibles dans la visée de la première ligne.Composée de forces militaires et policières, elle mitraille les premiers réfugiés à saportée. La seconde ligne de miliciens armés de fusils et de machettes effectue l’essentieldu « travail ». On reconnaît d’anciens membres et cadres des cellules artisanales etd’animation de la commune 51. Cruauté et efficacité s’imbriquent dans les techniquesqu’ils utilisent pour mettre fin à la « race tutsi ». Tandis que certains découpent lestibias et les avants bras de ceux qu’ils dénomment les inyenzi, d’autres s’emploient àensevelir les corps encore vivants de leurs victimes. La dernière ligne a pour rôle etmission de terminer le « travail ». Elle y associe saignées, diffraction des corps,défigurations. Ce qui n’est pas « croyable » devient raison, animé par des techniques demassacre précises. Mais ces techniques ne sont pas uniquement déterminées par larationalité de leur mise en œuvre. Du point de vue du psychisme des tueurs, l’angoissede se trouver confronter au « virus » tutsi est l’un des préalables à la mutilation de leurcorps.
28 Les actions de découpe des membres (notamment les tibias et les bras) ont ainsi
d’autres significations que la seule cruauté. Dans l’espace particulier de la danse, cesactions prophylactiques (coups, traques, etc.) ne donnent pas lieu à des mesuresd’élimination concrète des Tutsi. Ces dernières se réalisent suite au transfert de ces« syndromes » au sein des organisations paramilitaires affectées à l’exécution despogroms. Entre ces deux espaces (les cellules de danse guerrière et les formationsmiliciennes) circulent les pratiques et les imaginaires formés et réactualisés d’uneorganisation à l’autre. Au sein des groupes miliciens, l’apprentissage du maniement desarmes n’est qu’une dimension d’un faisceau bien plus large d’éléments psychologiques,imaginaires et matériels plus anciens. Les dispositions à la guerre totale acquises par lesmiliciens se lient aux imaginaires dévorants de « l’ogre tutsi ». Les techniques qu’ils ontincorporées dans les cellules culturelles et politiques des communes leur donnent lapossibilité de physiquement répondre au danger qu’ils ressentent : traques, feintes,attaques, jusque dans l’élimination systématique de l’ensemble de leurs victimesémissaires.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
157
29 Mais de fait, les cibles visées par les milices extrémistes hutu se confondent dans la
désignation d’un seul ennemi : le Tutsi, désigné comme le plus intime responsable des« maux » des Hutu. Dans une certaine mesure, les corps des tueurs ne font aussi plusqu’un : entité psycho-socio-biologique chargée de purifier le Rwanda du virus tutsi.Concrètement, il s’agit de couper tout ce qui dépasse, et en particulier les bras et lesjambes, conduisant aux pires mutilations. C’est ici que dans une certaine mesure, lasituation dansée qui consistait à purifier l’espace chorégraphique de ses ennemispotentiels donne matière à penser à la technologie du massacre. D’un espace à l’autre –et selon une mise en œuvre aggravante –, il s’agit de maintenir l’ordre du dispositif etde garantir la « santé » de ces membres ; situation dans laquelle les membressurnuméraires potentiellement infectés doivent être éliminés. Les danseurs radicaliséset les miliciens hutu conçoivent ce « surnombre » dans l’anatomie politique du Tutsi,composée de bras et de jambes dont la taille leur rappelle la grandeur dévastatrice de« l’esprit féodal » qui ronge leurs affects. Dans la situation dansée comme dans leconflit armé et sociétal plus large qui gagne la subjectivité des tueurs, leurenvironnement est systématiquement repensé à la lumière d’une infection incarnée par« ce qui dépasse » du corps tutsi et qui pourrait conduire à la contamination de leurchair. Dans l’espace de la danse, il s’agit de réduire l’action des membres Tutsi par uneplus forte mise en tension des techniques du groupe identifié à la « pureté » de l’ordrehutu. Dans l’espace du génocide, il s’agit de couper le mal à sa racine et de mutiler toutmembre menaçant la « survie de l’espèce ». Des techniques de danse à celles despogroms, l’on trouve ainsi quelque chose à penser dans l’ordre de l’activation d’unehexis guerrière purificatrice dont la subjectivation précède la mise en œuvre dumassacre. Cette hexis se matérialise dans une séparation radicale des corps, alors mêmequ’ils étaient censés faire partie de cet ensemble organique qu’aurait pu figurer l’Étatrwandais. Or, dans les situations dansées, culturelles et politiques qui ont précédé legénocide, on constate que les frontières ethniques et symboliques s’instillent jusquedans la chair des auteurs des crimes et des victimes. Entre bien d’autres techniquesréflexives du corps, les danses guerrières matérialisent ces frontières, les fontapparaître et les rendent palpables par le medium du combat imaginé qu’ellesincarnent.
Les corps de la violence génocidaire
30 Dans la situation génocidaire, l’atrocité des tueries ne voile pas la rationalité de leur
exercice. Elle présente l’univers pratique et symbolique qui précède l’activation destueries. Un rescapé le formule en ces termes : « Ils ne coupaient par hasard, ils savaients’y prendre et avaient leurs techniques 52 ». Un ancien bourgmestre dénomme la miseen œuvre de cette action comme une « intention » 53. Elle fut pour partie conditionnéepar la subjectivation de savoirs et de techniques mobilisés par les unités affectées àl’exécution des pogroms et des mutilations corporelles qui les accompagnent.
31 Dans le cadre d’une conception plus ancienne du corps au Rwanda, les actions souvent
réductrices et parfois mutilatrices exercées sur les membres et les organes des défuntsconsistaient à les rendre inaptes à revenir menacer l’activité de ceux qui, pour untemps, demeuraient aux frontières de la vie et de l’oubli 54. Les techniques pouvaientconsister à plier le corps, noircir sa peau, ou encore ligaturer ses articulations. Leurefficacité consistait en une protection face aux sources d’infection. Pour le mouvement
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
158
extrémiste hutu et ses membres « danseurs », le corps tutsi est un « corps-pot ». Lesactes de manducation de la chair des vaincus (identifiés à la majorité raciale hutu)auraient nourri sa vigueur légendaire ; ses organes seraient imprégnés de laputréfaction de ses victimes ; sa peau, son odeur et ses fluides sont pour les tueursautant d’indices de la mort incarnée par cet homme devenu un « animal démoniaque ».Sa figure et ses actes sont régulièrement identifiés au Kalinga, l’un des tamboursroyaux de l’ancienne monarchie Nyiginya. Pour les génocidaires, les guerres menéespar le corps inyenzi ont forgé la matière du récipient (le Kalinga).
32 Ainsi, la principale tâche du corps tutsi aurait été d’apporter « vie » et nourriture à l’un
des symboles de la fertilité guerrière du royaume. Les récits concordent pour formulerle fait qu’au retour des champs de bataille, les guerriers pouvaient accrocher lestesticules des hommes de pouvoir qu’ils avaient vaincus. Le discours racialo-politiquehutu a fait de ces « épopées » des éléments essentiels de son œuvre de reconstitutionhistorique du Rwanda précolonial. Des données criminologiques, militaires ou encorepsychologiques se sont formées à partir du cumul d’un savoir d’État caractérisant lesTutsi par les marques raciales et politiques qui ont dessiné plusieurs aspects de leur« irrégularité » : culture de la dissimulation, gloutonnerie, barbarie, etc. 55 Dans cescorpus de connaissances qui nourrirent nombre de membres de l’animation politique 56,le corps hutu est identifié à la principale cible des conquêtes tutsi ; les récits en font lasubstance essentielle des « repas » du Kalinga, ventre de la domination « hamite » 57.Les organes du pouvoir tutsi auraient été alimentés par l’énergie vitale des« défricheurs », devenus cibles d’une gloutonnerie physique et politique. Comme sourced’épanouissement de la domination tutsi, la manducation des organes hutu auraitentraîné leur putréfaction : perspective dans laquelle le corps tutsi est un organe fétideconstitué de la souillure de ses actes barbares. Si telle est la composition imaginée ducorps tutsi et de son « aliment » hutu, l’action des génocidaires peut aussi se lire selonune mythologie politique appelée à rendre possible la « libération » du corps hutu desentrailles de son ogre.
33 L’objet de cette contribution (soit la sédimentation d’une disposition agonistique
véhiculée par la danse dans l’ordre du génocide) nous a poussé à différencier lestechniques chorégraphiques de celles qui ont directement gouverné l’actiongénocidaire. De notre point de vue, la subjectivation des techniques de danse s’inscritau cœur d’une organisation sociale et politique (celle de « l’animation ») dans laquelledes imaginaires « coupants » et des actions guerrières réorientent et structurent laréalité des initiés de façon durable. La disposition que nous évoquons s’inscrit dans untel processus, autour duquel un certain entraînement martial des corps peut êtremobilisé dans la pratique de la guerre, jusque dans les actes les plus extrêmes. Selonune telle dynamique, la supposée fonction cathartique des pratiques artistiques ne tientpas. Dans le cas rwandais, ces dernières officient en effet bien plus dans le cadre d’une« zone de tension » dont les membres entrent en relation d’opposition au sein du méta-organisme que compose le collectif des danseurs. Dans la situation sociale et politiqueque connut le pays au cours des années 1980-90, cette tension a trouvé son« relâchement » dans l’exercice de la violence de masse à l’encontre des Tutsi du pays.Pour le sociologue susceptible d’observer cette « montée en panique » 58, il s’agit de lasituation sociale la plus dangereuse et la plus explosive qui soit ; une situation – et sonhorreur – dont les danses guerrières constituent une part des coulisses étrangementrendues publiques.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
159
NOTES
1. Celui-ci a été écrit et prononcé à l’occasion de la commémoration des 25 ans de
l’indépendance, le 1er juillet 1987. Il fut retranscrit par Chrétien J.-P. (dir.), Rwanda. Les médias du
génocide, Paris, Karthala, 1995, p. 121.
2. L’expression est de Ian Linden. Lire à ce sujet Linden I., Christianisme et pouvoir au Rwanda
(1900-1990), Paris, Karthala, 1999.
3. Pour une analyse socio-historique de ce basculement politique, lire Lemarchand R., Rwanda and
Burundi, London, Pall Mall Press, 1970.
4. Du point de vue des identités politiques engagées dans le génocide, lire Hintjens H. M., « When
identity becomes a knife: reflecting on the genocide in Rwanda », Ethnicities, vol.1, n°1, 2001,
pp. 25-55.
5. Lettre du Père Boutry au Père de Rasilly, Kabgayi, le 30 janvier 1964. Archives de la société des
missionnaires d’Afrique (ARCHPB), Rome, Kabgayi 738 (1).
6. Claudine Vidal avait signalé cette « lacune » à peine quelques années après l’exécution du
génocide : Vidal C., « Le génocide des Rwandais tutsi et l’usage public de l’histoire », Cahiers
d’études africaines, vol. 38, n°150-152, 1998, pp. 653-663.
7. L’« animation » correspond au développement de cellules politico-culturelles attachées aux
communes et aux préfectures. Jeunes et adultes y pratiquaient danses, sports, débats, chansons…
8. Le MRND fut créé à la suite du coup d’État mené par les troupes du général Habyarimana en
1973.
9. Notamment les miliciens interahamwe, bien souvent prélevés dans la société civile.
10. Les chiffres que nous mentionnons ont été collectés par Scott Straus au cours de sa longue et
minutieuse enquête sur « l’ordre du génocide » : Straus S., The order of genocide. Race, power and
war in Rwanda, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 2006. Les espaces de voisinage dans
lesquels ont opéré les groupes de génocidaires soulignent la proximité et la localisation précise
des attaques. Voir à ce sujet l’enquête menée par Dumas H., Le génocide au village. Le massacre des
Tutsi au Rwanda, Paris, Éditions du Seuil, 2014.
11. La liste serait longue, mais il nous semble important de citer un auteur qui s’est penché sur
les dimensions populaires du massacre : Kimonyo J-P., Rwanda. Un génocide populaire, Karthala,
Paris, 2008.
12. Citons à ce sujet le travail de référence de Jean-Pierre Chrétien et ses collaborateurs, paru une
année après l’exécution du génocide : Chrétien J-P. (dir.), Rwanda : les médias du génocide, op. cit.
13. Luft A., « Toward a dynamic theory of action at the micro-level of genocide: killing,
desistance, and saving in 1994 Rwanda », Sociological Theory, vol. 33, n°2, 2015, pp. 148-172 ;
McDoom O. S., « Who killed in Rwanda genocide? Micro-space, social influence and individual
participation in intergroup violence », Journal of Peace Research, vol. 50, n°4, 2013, pp. 453-467 ;
Viret E., « La langue amère des temps nouveaux. Dynamiques de la violence au Rwanda rural »,
Questions de recherche, n°29, août 2009 ; Dumas H., Le génocide au village, op. cit.
14. Crossley N., « Mapping reflexive body techniques: on body modification and maintenance »,
Body & Society, vol. 11, n°1, 2005, pp. 1-35.
15. Cité par Nkulikiyinka J-B., Introduction à la danse rwandaise traditionnelle, Tervuren, Annales des
Sciences humaines, 2002, p. 166.
16. Pluriel de umuhamirizo.
17. Das V., Life and words: violence and the descent to the ordinary, Berkeley, University of California
Press, 2007.
18. Biehl J., Vita: life in a zone of social abandonment, Berkeley, University of California Press, 2005.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
160
19. Das V., Kleinman A., Ramphele M. (eds.), Violence and subjectivity, Berkeley, University of
California Press, 2000.
20. Mitchell J. C., The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern
Rhodesia, Manchester, Manchester UP on behalf of the Rhodes Livingstone Institute, 1956.
21. Collins R., Violence. A Micro-Sociological Theory, Princeton & Oxford, Princeton University Press,
2008.
22. Archives de la Société des missionnaires d’Afrique (ARCHPB), Rome : lettres de règle, rapports
d’activités ; Centre de documentation de la section d’ethnohistoire et d’ethnosociologie du Musée
royal de l’Afrique centrale, Tervuren : monographies datant de la seconde république ; Archives
nationales du Rwanda, Stade Amahoro, Kigali : coupures de presse, manifestes programmes,
brochures ; Archives africaines du ministère des Affaires Étrangères, Bruxelles : rapports
politiques ; Nous avons associé l’analyse de ces sources à huit entretiens menés en Belgique et au
Rwanda au cours de l’année 2007 : quatre auprès de rescapés du massacre, quatre auprès
d’anciens dirigeants de la seconde république (bourgmestres, préfets et ministres).
23. Nous tenons à chaleureusement remercier Jérôme Beauchez, qui a réalisé une analyse
critique passionnante de ce texte, analyse dont nous nous sommes inspirés tant dans la forme
que dans le fond de notre propos.
24. André Sebatware (ancien bourgmestre, préfet, puis ministre du gouvernement Habyarimana),
entretien réalisé à son domicile de Bruxelles, janvier 2007.
25. Straton Semanyenzi, entretien réalisé à son domicile de Bruxelles, janvier 2007. Lire aussi
Human Right Watch (HRW), Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), Aucun
témoin ne doit survivre, Paris, Karthala, 1999, pp. 55-57.
26. L’ensemble des personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de nos entretiens nous
ont confirmé cette information. Voir sur le même sujet Kimonyo J-P., Rwanda. Un génocide
populaire, op. cit., pp. 259-262.
27. Les anciens dirigeants que nous avons rencontrés s’accordent sur le fait de qualifier ce
dispositif politique comme l’une des facettes d’un programme plus large de développement
économique, social et culturel. Sur le rôle joué par des intermédiaires (social brokers) dans le
passage de l’idéologie du développement à l’ordre du génocide, lire Emmanuel Viret, « La langue
amère des temps nouveaux. Dynamiques de la violence au Rwanda rural », op. cit.
28. Entretien avec Léon Musoni, ancien danseur, Kigali, août 2007.
29. Jean-Damascène X, rescapé, interviewé à plusieurs reprises à Butare, juillet-août 2007.
30. Discours du président Habyarimana à l’ouverture du 4ème congrès ordinaire du MRND, le 26
juin 1993, extrait, Archives nationales du Rwanda, Kigali.
31. Charles Ndekwe, ancien danseur, rescapé, interviewé à la paroisse de Kimonyi au cours du
mois d’août 2007.
32. Cette figure de la danse umuhamirizo a été réalisée à partir de celle que propose Nkulikiyinka
J-B., dans le cadre d’une ethnographie historique des chorégraphies guerrières au Rwanda,
op. cit., p. 194.
33. Sous la Seconde République, le multipartisme fut instauré suite à l’amendement
constitutionnel du 10 juin 1991. Il visait à reconnaître la quinzaine de partis politiques
développés avant et après sa mise en application.
34. Témoignage collecté et cité par Kimonyo J-P., Rwanda. Un génocide populaire, op. cit., p. 312.
35. J*, ancien interahamwe, Témoignages filmés par Georges Kapler et discussion Journée du
Mardi 23 mars, document de la Commission d’enquête citoyenne pour la vérité sur l’implication
française dans le génocide des Tutsi, http://cec.rwanda.free.fr, 2004.
36. Le FPR prit le pouvoir en juillet 1994, suite à la guerre qu’il mena face aux troupes du
gouvernement rwandais.
37. Terme qui désigne l’idéologie et les actions les plus radicales menées par les groupes
politiques en présence.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
161
38. Le parti de l’ancien président Kayibanda, au pouvoir de 1961 à 1973.
39. Chrétien J-P. (dir.), Rwanda. Les médias du génocide, op. cit., pp. 353-354.
40. Les rescapés que nous avons interviewés vont même jusqu’à affirmer le ton humoristique que
pouvaient prendre les appels à la traque des Tutsi, ainsi que la joie des miliciens lorsqu’ils avaient
accompli leur « mission », partageant bières et marijuana au rythme des chants et des récits de
leur journée de « travail ».
41. Lire à ce sujet Smith P., « Aspects de l’esthétique au Rwanda », L’Homme, vol. 25, n°96, 1985,
pp. 7-22.
42. Il s’agit du terme employé par les quatre anciens dirigeants que nous avons rencontrés, qui
rejoint les imaginaires guerriers articulés à la mise en œuvre du massacre.
43. Projet qui préexistait à l’avènement du multipartisme, et qui fut exprimé dès l’essor du parti
unique MRND : MRND, Manifeste et Statuts, Archives nationales du Rwanda, Kigali.
44. Chrétien J-P. (dir.), Rwanda. Les médias du génocide, op. cit., pp. 353-354.
45. Soit l’attentat contre l’avion présidentiel du 6 avril 1994, qui déclencha le commencement des
pogroms de masse à l’encontre des Tutsi.
46. Soit Protais Zigiranyirazo, considéré comme l’un des principaux cerveaux du génocide.
47. Lire à ce sujet Riot T., « Les politique de loisir et le génocide des Rwandais tutsi. Du racisme
culturel aux donjons de la mémoire », Politique africaine, n°133, 2014, pp. 131-151.
48. Dans un tout autre contexte, mais selon une situation d’intimité meurtrière comparable, lire
Theidon K., Intimate Enemies. Violence and Reconciliation in Peru, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 2013.
49. Chant retranscrit par Rugamba C., Chansons rwandaises, Butare, Institut national de la
recherche scientifique, 1979, pp. 219-222.
50. Charles Ndekwe, op. cit.
51. Nous prenons ici appui sur les témoignages que nous avons recueillis, ainsi que sur le travail
de terrain mené par les équipes d’HRW et de la FIDH, Aucun témoin ne doit survivre…, op. cit.
52. Jean-Damascène X., op. cit.
53. Straton Semanyenzi, op. cit.
54. Voir Hertefelt M. et Coupez A., La Royauté sacrée de l’ancien Rwanda : texte, traduction et
commentaire de son rituel, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale, 1964.
55. Dont la formalisation remonte à la période de décolonisation du pays, en ceci qu’elle postule
une lutte atavique entre un peuple de défricheurs (hutu) et une caste de seigneurs (tutsi). Nous
nous référons ici aux archives politiques de la période, et notamment au document Rapport de la
15ème session du Conseil Supérieur du Pays, du 19 mai au 29 mai 1958, Annexe 1 – Exposé des
représentants Bahutu et certains autres Bahutu, Archives du Ministère des Affaires Étrangères,
RA/RU 11, Bruxelles.
56. Voir notamment la thèse de doctorat remaniée en pamphlet historique de l’un des principaux
idéologues du génocide : Nahimana F., Le Rwanda. Émergence d’un État, Paris, L’Harmattan, 1993.
57. L’idéologie hamitique est née pendant l’époque coloniale. Elle propose de resituer
l’ascendance des Tutsi de la région des Grands lacs dans la lignée raciale de populations
originaires de la corne de l’Afrique. Lire à ce sujet Chrétien J-P. et Kabanda M., Rwanda. Racisme et
génocide. L’idéologie hamitique, Belin, Paris, 2013.
58. Collins R., Violence. A Micro-Sociological Theory, op. cit.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
162
RÉSUMÉS
Au cœur de l’important répertoire chorégraphique du Rwanda républicain, les danses dites
imihamirizo composent une technologie guerrière qui marque les corps de « l’animation
politique » du pays. La souillure et l’irrégularité constituent les principaux éléments adverses
contre lesquels combat le groupe. Dans le cadre de la sédimentation d’une hexis guerrière
purificatrice, l’ennemi est rigoureusement identifié à la chair tutsi, prétendument responsable de
l’infection des organes hutu. Du combat des danseurs à l’action de couper les inyenzi (serpents),
danses guerrières et techniques des pogroms fabriquent une technologie culturelle du massacre
des Tutsi au Rwanda.
At the center of the large choreographic repertoire of Republican Rwanda, the so-called
imihamirizo dances constitute a technology of war that marks the bodies of the “political
animation” of the country. The group of dancers mainly fights two major opposing components:
filth and irregularity. Within the frame of the sedimentation of a purifying war hexis, the enemy
is closely identified with the Tutsi flesh, which is allegedly responsible for the infection of Hutu
organs. From the dancers’ fights to the slicing of inyenzi (snakes), war dances and pogrom
techniques build a cultural technology of Tutsi slaughter in Rwanda.
INDEX
Mots-clés : Rwanda, génocide, danses guerrières, anthropologie, 1990-1994
Keywords : Rwanda, genocide, war dance, anthropology, 1990-1994
AUTEURS
THOMAS RIOT
Thomas Riot est chercheur FNS à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de
Lausanne. Après avoir réalisé une thèse traitant de la participation des activités physiques et
sportives au processus de décolonisation du Rwanda, il s’intéresse aux cultures motrices et aux
liens qu’elles entretiennent avec le nationalisme et la violence armée en Afrique.
NICOLAS BANCEL
Nicolas Bancel est historien, spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale, professeur à la
Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne. Il s’intéresse en particulier
à l’histoire des mouvements de jeunesse, à l’anthropologie des représentations du corps et aux
imaginaires politiques de la colonisation.
HERRADE BOISTELLE
Herrade Boistelle est doctorante à la Faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de
Lausanne. Dans le cadre de sa thèse, elle s’intéresse aux pratiques physiques et à leurs impacts
sur la formation des jeunesses scolaires et militaires en Ouganda.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
163
Marronnages érotiques : ledancehall jamaïcain entre culture et slacknessEntretien avec Carolyn Cooper
Erotic Marronage: Jamaican Dancehall, between Culture and Slackness. An
Interview with Carolyn Cooper
Jérôme Beauchez et Carolyn Cooper
NOTE DE L'AUTEUR
Entretien réalisé le lundi 13 juillet 2015 à Fort-de-France dans le cadre d’une recherchesur les expressions artistiques de l’Atlantique noir menée au sein du programme ANRSocioresist. Nb : Lorsqu’elles sont signalées par un astérisque, les références musicaleset filmiques citées au fil du dossier peuvent être consultées par le biais d’une listeYouTube créée à cet effet et accessible via le lien suivant : https://www.youtube.com/playlist?list=PLbCt_9Yhu8O9AHUA-mk0D6mDHIayjeqbi. L’ensemble a été regroupé àpartir de matériaux déjà diffusés par les internautes ; toutes les fois que cela a étépossible, les documents présentant des sous-titres en français ont été privilégiés.
1 Professeure de littérature et d’études culturelles à l’Université des West Indies en
Jamaïque, Carolyn Cooper peut à maints égards être décrite comme une instigatrice desrecherches sur le dancehall ; un espace musical ô combien décrié, mais dont lapopularité ne se dément pas dans l’ensemble des Antilles – voire bien au-delà. Sorte decousin caribéen du rap américain, le dancehall est souvent présenté comme l’enfantterrible du reggae, auquel il aurait succédé au cours des années 1980 pour finir paroccuper le devant de la scène musicale jamaïcaine 2. À l’instar du rap, c’est d’abord unemusique qui porte l’expérience de la pauvreté ; elle résonne comme l’écho de la duretédes conditions de vie dans les ghettos de Kingston. Ainsi le dancehall fait-il souventscandale auprès de la « bonne société », tant par ses mises en scène du sexe, de la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
165
violence et de l’argent – autant de sujets qui renvoient au domaine du slackness (i.e. dela débauche) – que par les frasques de ses acteurs dont une partie fait régulièrement lesgros titres des quotidiens. Pourtant Carolyn Cooper voit plus loin. Débutés dans lesannées 1990, ses travaux sur le sujet montrent que le dancehall s’enchâsseprofondément dans la trame des cultures populaires jamaïcaines, dont il fait entendrenombre de conflits ; une propension à la critique sociale que ses artistes rangentprécisément sous la bannière de leur culture (celle du peuple des ghettos). L’un desprincipaux arguments développés par l’auteure consiste dès lors à plaider pour unecompréhension du phénomène qui ne se contente pas d’opposer, mais cherche plutôt àarticuler culture et slackness comme les deux faces d’une même pièce où se joue – par larupture des codes de la bienséance (le slackness) ou la critique sociale explicite (laculture) – un même élan de résistance affiché par les plus pauvres à l’égard de la sociétébourgeoise dont ils éprouvent le rejet tout comme la domination. C’est donc de ceregard à l’entre-deux dont il sera question tandis que nous évoluerons au rythme dudancehall. Afin qu’il puisse être pleinement entendu, les lignes qui suiventcomposeront une brève introduction à l’ethnohistoire de ce style musical dont l’analysecontemporaine sera ensuite assurée par l’une des meilleures spécialistes du genre 3.
Des bruits dans le sang, ou comment la rue jamaïcainerésonne…
2 D’un point de vue formel, le dancehall moderne se compose de rythmiques le plus
souvent digitales – les riddims, selon leur appellation jamaïcaine – amplifiant lessyncopes du couple basse-batterie, lesquelles servent d’appui à la scansion des rimesqu’élancent les deejays. Le terme désigne en Jamaïque celles et ceux qui – tels les M.C.(Masters of Ceremony) du rap américain – ne parlent pas plus qu’ils ne chantent sur lamusique. Ces performeurs de l’oralité déclament plutôt leurs textes, et chevauchent lesrythmes en jouant de la musicalité d’un phrasé qui participe du sens qu’ils déploientautant que les mots qu’ils emploient. Leur premier lieu de formation et leur habitatnaturel, si l’on peut dire, est le sound system : un système de sonorisation dont lescolonnes d’enceintes, généralement disposées en plein air, permettent de jouer de lamusique amplifiée ; c’est-à-dire les fameux riddims choisis par un selecter, qui officie auxplatines en tant que responsable de la sélection musicale sur laquelle le talent vocal desdeejays est appelé à s’exprimer.
3 Si l’on voulait densifier la description d’un tel art expressif, il faudrait ajouter qu’il est
plus ancien que le dancehall actuel ne le laisse supposer. Car les premiers sound systems
se sont établis dans les rues de Kingston dès les années 1950 4. Ils participaient alorsd’une stratégie commerciale visant à animer le passage devant les boutiques désireusesd’attirer le chaland. Tom “The Great Sebastian” Wong, considéré comme un pionnier enla matière, a ainsi modestement débuté par l’animation des abords de sa quincaillerie,dont l’entrée résonnait des dernières productions du rhythm’n’blues en provenancedes États-Unis ; prenant la mesure du potentiel commercial de cette activité musicale, ils’est alors lancé dans l’organisation de soirées qui ont élu domicile sur de grandespelouses – les lawns – où lui et ses concurrents ont transporté leurs discothèquesmobiles, de plus en plus nombreuses au fil de la décennie. Un marché concurrentiel dudancehall était en passe de se structurer. Au cours des années 1960, il allait être dominépar les Big Three (les trois grands) – i.e. Clement “Sir Coxsone” Dodd et son Downbeat
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
166
Sound System, Arthur “Duke” Reid propriétaire du Trojan Sound et Vincent “King”Edwards qui possédait le Giant Sound System. Tandis que la compétition sonore faisaitrage, la qualité de la sélection musicale de même que l’inventivité des animateurs desoirée – les deejays – ont très vite constitué autant d’arguments décisifs dans laconquête des publics. Ainsi Count Machuki (Winston Cooper)*, King Stitt (WinstonSparkes)*, Sir Lord Comic (Percival Wauchope)* et bien d’autres à leur suite, se sont-ilsemparés des micros pour lancer en rimes et en rythme les morceaux qui faisaientdanser les foules. Bientôt leurs interventions ne se sont plus limitées aux seulesintroductions des titres pour s’étendre à toutes les parties instrumentales (les versions)qu’ils ont conquises comme leur espace d’expression 5. Tandis que le public attendaitleurs exubérances verbales au moins autant que les morceaux qui leur servaientd’appui, ces hommes ont posé les fondations d’un nouvel art expressifindissociablement vocal et musical : le deejaying, ou toasting – puisqu’ils portaientlittéralement un toast à la musique en la magnifiant par leurs rimes.
4 Quant aux propriétaires de sound systems qui employaient ces deejays, ils ont également
ouvert des studios d’enregistrement. Ceux-ci – à l’instar du Studio 1 de Coxsone Dodd –ont permis de graver dans le vinyle les premiers actes d’une musique populairejamaïcaine dont l’essor a rythmé l’accès de l’île à l’indépendance, acquise à l’égard del’Angleterre en 1962 6. Le ska* constituait alors la bande son des ghettos de Kingston. Néde l’inventivité d’un petit groupe de musiciens – les Skatalites – qui ont réalisé unsyncrétisme musical composé de rythm’n’blues, de mento (une sorte de variante localedu calypso) et de jazz, le ska a très vite imposé sa rythmique répétitive sur laquelle dejeunes chanteurs n’ont pas tardé à s’essayer. Parmi eux se trouvaient quelquesadolescents et futures stars internationales comme Bob Marley, Peter Tosh (membresdu trio The Wailing Wailers*) ou Jimmy Cliff*. Au fil de la décennie, le tempo effréné duska est devenu à la fois plus lent et langoureux, donnant naissance au rocksteady –lequel faisait la part belle aux trios vocaux et à leurs ritournelles* – puis au reggae* 7.Ce dernier n’a pas tardé à s’affirmer comme la musique jamaïcaine emblématique dutournant des années 1970 ; une période qui a également été celle de son succès mondial,tandis que les scansions rythmiques du reggae s’alliaient aux percussions ainsi qu’auxthématiques du rastafarisme.
5 Présent en Jamaïque dès les années 1930, ce mouvement spirituel afro-centriste tire son
nom du dernier empereur d’Ethiopie – le Ras Tafari, Haïlé Sélassié – dans lequel lesrastas voient un messie et la figure du Christ noir réincarné. À l’instar du peuple juifdont l’exode est rapporté par la Bible, les rastas estiment que depuis l’esclavage ilsvivent en déportation dans la nouvelle Babylone coloniale dont ils combattent toutesles institutions – politiques, religieuses ou scolaires – perçues comme vectrices del’esclavagisme mental dans lequel l’homme noir serait maintenu. Le salut de ce dernierse trouverait dès lors dans l’idée de repatriation*, à savoir le retour sur la terreancestrale d’Afrique (équivalent du royaume de Sion, ou Zion). En attendant lapossibilité d’un tel retour, l’idée est de s’en remettre à Jah (le nom hébreu de Dieu) afinde résister au système babylonien dont il s’agit de déconstruire tous les mécanismesd’oppression qui ont éloigné les Noirs déportés de leur moi profond (far I) 8.
6 Dans les années 1970, alors que reggae et rastafarisme font cause commune contre
l’oppression occidentale, ils deviennent (paradoxalement ?) des références de la contre-culture en Occident. L’allure et le style de vie des rastas – notamment leurs dreadlocks
(littéralement des « nattes effrayantes » composées de longues nodosités capillaires) et
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
167
leur usage de la ganja (marijuana) – en font des effigies rébellionnaires auprès de touteune jeunesse blanche inspirée par la musique de Bob Marley et quelques films en voguesur les écrans européens 9. En Jamaïque, ce sont les deejays – tels U Roy (EwartBeckford)*, Big Youth (Manley Buchanan)*, Prince Far I (Michael Williams)* ou Trinity(Wade Brammer)* – qui propagent leurs dread talks (le langage rasta, souvent composéd’ellipses et de double sens 10) dans les sound systems et sur les vinyles qui diffusentleurs scansions vocales au-delà des frontières de l’île. Si Rastafari devient ainsi lesynonyme d’une spiritualité et d’une culture populaire consciente d’elle-même, desconflits et de l’oppression que vivent les Noirs les plus pauvres, les thématiques légèreset relâchées ne disparaissent pas pour autant des dancehalls. Car on y vient égalementpour oublier la pénibilité des semaines de travail – voire son absence –, chassée l’espaced’un moment par les rythmes tonitruants du reggae. Ces deux aspects de la musiquepopulaire jamaïcaine – conscience et relâchement, ou culture et slackness dans levocabulaire du dancehall contemporain – structurent aujourd’hui encore une grandepart de la production musicale de l’île. Au cours des décennies 1980 et 1990, la tendanceau slackness s’est d’ailleurs faite de plus en plus explicitement sexuelle, tandis que ledancehall reflétait un nouveau durcissement des conditions de vie dans les ghettos oùles armes à feu, la drogue et la violence n’ont cessé de proliférer. Une fois encore, lamusique jamaïcaine et ses sound systems se sont faits l’écho de la rue et d’une nouvellegénération de deejays dont les rimes ont résonné de toutes ces turpitudes, ces envies ouces espoirs déçus.
Soul Rebel
2011
© Dan23
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
168
7 Or c’est précisément à l’entame de la décennie 1990 que Carolyn Cooper a publié son
premier livre – Noises in the Blood [Des bruits dans le sang] 11 –, dont un chapitre traitedu dancehall replacé dans la continuité historique d’une oraliture où la languejamaïcaine prend littéralement corps au travers de la culture et de la geste populairequ’animent celles et ceux qui la vivent au quotidien. Écrivains des proverbes ettraditions du peuple, auteurs ou acteurs d’un théâtre où l’on s’exprime non pas enanglais littéraire mais en créole jamaïcain, activistes du reggae et – last but not least –danseuses, danseurs et deejays de la scène dancehall : Carolyn Cooper voit là autant deperformeurs des arts expressifs qui tissent la trame d’une culture populaire dont l’undes piliers est la résistance qu’elle oppose aux institutions (post)coloniales. Non pas quecette résistance soit cherchée a priori. Mais sa langue et ses rythmes en provenance desrues vibrent plutôt dans le poignet de l’auteure, et résonnent ainsi jusque dans sonécriture. Aussi a-t-elle consacré toute une série de textes au dancehall, dont ellepropose une lecture des corps dansés qu’elle assimile à une forme de « marronnageérotique » ; comprenez une érotisation des corps – et notamment celui des femmes –qui entre ouvertement en résistance (d’où l’idée de marronnage) vis-à-vis des codesbourgeois de la décence 12. Si elle se réclame d’un féminisme noir en rupture avec lestraditionnelles diatribes sur la sexualisation à outrance du corps féminin dans lesperformances dansées, une telle interprétation ne laisse pas de susciter les plus vivescritiques en Jamaïque et ailleurs. Mais sur ces sujets, comme sur celui de l’homophobiedans le dancehall et la culture populaire jamaïcaine en général, Carolyn Cooper necraint pas la polémique ; plus que sa propre voix, c’est celle des deejays qu’elle tente defaire entendre sans que leurs mots ne soient sortis du contexte jamaïcain qui leurconfère leur sens, et sans avoir nécessairement à choisir entre « bien » et « mal », ou« bon » et « mauvais »…
***
–Jérôme Beauchez (J.B.) : Pourriez-vous nous expliquer ce que les Jamaïcains entendentpar « dancehall » et la différence qu’ils font entre slackness et culture ?
–Carolyn Cooper (C.C.) : Le dancehall est la dernière version de la musique populairejamaïcaine : des rythmes accélérés et une tendance générale aux thématiques de lasexualité, mais aussi de la violence – beaucoup de violence et d’armes à feu ! Vouspouvez entendre des morceaux où il est question d’arracher la moelle osseuse desgens, pour ne citer qu’un exemple… Tout semble d’ailleurs se passer comme sil’exacerbation de la violence dans le dancehall consistait en une tentative pourtranscender la violence sociale par le biais d’une sorte de catharsis. Je sais que cegenre d’analyse n’est pas apprécié de tout le monde. Les gens croient parfois quej’excuse la violence verbale des deejays. Or il n’est pas question de ça. Mais si les Grecsont pu opérer leur catharsis au travers du théâtre classique, alors pourquoi lesJamaïcains ne pourraient-ils pas le faire dans le dancehall, puisqu’il s’agit là aussi defaire face à la violence et à ses affects en les transposant sur une scène artistique ? Entout cas, c’est une lecture possible 13 !
Dans le dancehall, vous avez donc le slackness qui représente tout ce qu’il y a de plusirrespectueux : le sexe, la violence et tous ces comportements antisociaux que l’onassocie au crime. Je présume que quelqu’un comme Vybz Kartel constitue l’exempleclassique d’un parolier brillant, capable d’écrire sur tous ces sujets à la fois : le
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
169
slackness aussi bien que la culture dont la conscience – c’est-à-dire la réflexion sur soiet tout un ensemble de problèmes sociaux – apparaît précisément comme l’opposé duslackness… Dans les colonnes du Gleaner [avec le Jamaica Observer, l’un des deux grandsquotidiens de la presse écrite], il m’est arrivé de tracer des parallèles entre BobMarley et Vybz Kartel pour ce qui concerne l’écriture dite « consciente ». Pourtant, eten dépit de tous ses talents, Vybz Kartel n’a pas été en mesure de trouver sa placedans la société ; de sorte qu’il a fini en prison. Du point de vue de certains Jamaïcains,il incarne la quintessence de tout ce qui est mauvais dans le dancehall !
Gaza made in Jamaica
Adidja Palmer – plus connu sous le nom de Vybz Kartel – est né en 1976 et a grandidans le ghetto de Portmore, à l’Ouest de Kingston. Fréquentant dès l’enfance les sound systems de son quartier, il s’y taille rapidement une réputation de ciseleur derimes cadencées au rythme d’un environnement dont il éprouve chaque jour ladureté. Ses rues poussiéreuses jalonnées de baraques en tôle et de maisonnettes enfibrociment révèlent le dénuement, mais aussi la condition des sufferers – lespauvres – condamnés à vivre, ou plutôt à souffrir dans ce « Gaza » made in Jamaica.C’est en tout cas ainsi que Vybz Kartel a renommé son quartier, et baptisé sagarnison de fidèles – le « Gaza crew » – en allusion directe à la situation desPalestiniens opprimés par un gouvernement israélien qui les a, eux aussi, parquésdans leurs territoires et confinés au mépris ; une situation que le deejay décrivaitdéjà en 2005 dans un morceau intitulé « Emergency »*. Cette conscience del’oppression vécue par les siens ne l’a pourtant pas empêché d’en perpétuer labrutalité au travers d’un système entrepreneurial basé sur l’exploitation du ghettocomme étendard et comme marque. Un rhum estampillé au nom de Vybz Kartel,un cake soap (i.e. un savon conçu pour blanchir la peau) et un night-club ouvert àKingston se sont ainsi ajoutés à d’innombrables odes au sexe et à la violence dontcertains effets, loin d’être seulement cathartiques, ont vraisemblablement conduitau meurtre*. Tout du moins celui de Clive “Lizard” Williams, un ancien associé deKartel que lui et ses complices sont accusés d’avoir battu à mort avant de fairedisparaître son corps.
Prononcée en 2011, une première inculpation a lancé un véritable feuilletonjudiciaire soldé en 2014 par la condamnation d’Adidja Palmer à trente-cinq ans deprison. Les médias locaux ont estimé qu’au moment de son arrestation ses revenusatteignaient la somme mensuelle de dix millions de dollars jamaïcains (environsoixante-sept mille euros) 14. Loin d’avoir entamé sa notoriété, l’incarcération deVybz Kartel est perçue par ses thuriféraires comme un combat de plus livré parl’« empereur de Gaza » contre l’appareil d’État. Quant à ses nombreux adversaires– y compris dans les ghettos –, ils voient plutôt en lui une sorte de « clown blanc »outrageusement tatoué et pratiquant le bleaching (i.e. l’éclaircissement del’épiderme par l’application de produits dépigmentants) comme un reniement desoi ainsi que de tous les idéaux d’une fierté noire prônée par les rastas et leurs deejays « conscients » – dont les figures les plus populaires sont sans douteincarnées par Capleton (Clifton Bailey)* ou Sizzla Kalonji (Miguel Collins)*. Ôcombien clivantes et clivées, la personnalité comme la musique de Vybz Kartel nesauraient pourtant être rangées d’un seul côté d’une frontière qui isoleraithermétiquement le slackness de la culture. En 2012, le deejay s’est d’ailleurs piqué de
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
170
livrer son analyse culturelle de la société jamaïcaine et de la pauvreté qui lagangrène dans un ouvrage qu’il a choisi d’intituler The Voice of the Jamaican
Ghetto 15. Sur la première de couverture, on peut lire : « Je prie pour que ce livreaide à changer la Jamaïque pour toujours »…
Mais si Vybz Kartel peut représenter le pire visage du dancehall aux yeux d’unemajorité de gens, il faut ajouter que l’autre versant, celui de la culture, présente luiaussi une face que l’on oublie très souvent. Dans notre musique, l’aspect culturel estinternationalement représenté par toutes ces compositions associées à Bob Marley et,dans une certaine mesure, à Peter Tosh ainsi qu’à tous les grands du reggae qui ontchanté contre l’injustice, tandis qu’ils paraissaient suivre un agenda politiqueclairement universaliste ; c’était une sorte de programme humaniste, si vouspréférez, autour duquel toutes sortes de gens pouvaient se rassembler. Mais dans lemême temps, et alors qu’on a fini par ériger ces artistes au rang d’icônes culturelles,les gens ont semblé omettre un élément central de cette culture qui n’est autre quel’engagement contre le colonialisme, les nouvelles formes d’impérialisme et toutesces choses qui, en Jamaïque, sont précisément perçues comme relevant de la « hauteculture ». De telle sorte que le reggae a d’abord constitué un langage de résistancecontre certains systèmes élitistes dans notre pays. Et ce sont ces mêmes élitesjamaïcaines qui voudraient aujourd’hui faire passer le reggae pour de la « hauteculture » et ravaler le dancehall au rang du slackness ! Ils font mine de ne pas serendre compte de la contradiction. Ils veulent plutôt voir le reggae comme cettegrande chose qui s’est produite, et le dancehall comme cet affreux petit rejeton quien est sorti ! Quant à moi, je m’efforce de montrer que les choses sont un peu pluscomplexes. Par exemple – et c’est ce que je fais remarquer dans un chapitre de monlivre Soundclash –, lorsque Bob Marley fait usage du « feu » ses paroles sont entenduescomme une métaphore biblique qui renvoie à l’idée du jugement. Mais lorsqueCapleton en fait usage à son tour, il est perçu comme un incendiaire au sens propredu terme 16 ! Vous comprenez ? Les gens ne voient pas le même feu révolutionnairedans le dancehall et dans le reggae !
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
171
Magic Music
2013
© Dan23
–J.B. : Comment décririez-vous la place des femmes dans le dancehall, où elles semblent àpremière vue entièrement dominées par les hommes et soumises à leurs désirs ?
–C.C. : Le dancehall constitue en effet un espace d’hégémonie masculine, de violenceet de pénis symboliques représentés par les armes à feu ! Vous savez, il y a de cela unmoment Shabba Ranks* parlait déjà de cette connexion métaphorique entre le péniset le flingue 17. Donc oui, la société jamaïcaine apparaît comme très patriarcale. Maisle fait que les femmes y assument souvent toute l’économie domestique ne signifiepas pour autant qu’elles sont dénuées de pouvoir. Ce que ça signifie est plutôt que leshommes censés s’occuper de leurs enfants demeurent souvent absents. Donc lesfemmes ont été forcées d’endosser un double fardeau : le leur et celui des hommes…Cela dit, tous ne sont pas délinquants ! En vous arrêtant uniquement au dancehall,vous obtiendriez une représentation aussi négative que tronquée de la masculinitédans la culture jamaïcaine. Le dancehall ne vous révèle pas l’entière vérité ; c’estl’expression musicale d’une théâtralité où l’on joue des rôles : celui du badman [levoyou] en est un ! Mais il véhicule bel et bien tout un ensemble de représentationsselon lesquelles les hommes doivent gagner des choses, être en responsabilité au sensdu leader, vous comprenez 18 ?
Ceci dit, il ne faudrait pas oublier l’affirmation des femmes deejays sur la scènedancehall au cours des vingt-cinq dernières années. Quelqu’un comme TanyaStephens, une chanteuse et une deejay tout à fait brillante, remet en cause un grandnombre de ces stéréotypes masculins dont nous venons de parler. Dans un morceaucomme « Big Ninja Bike » (1998)*, elle chante qu’elle est d’une nature sensuelle,qu’elle recherche la satisfaction sexuelle et qu’elle ne veut pas d’un homme qui n’a
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
172
jamais que des mots à la bouche et ne serait pas capable de lui offrir une bonne virée[a good ride] ! Dans le même temps que les hommes vantent leur grande puissancesexuelle, vous avez donc des femmes – on pourrait également citer Lady Saw 19 – quiles tournent en dérision et leur répondent : « Oh, tout ça c’est du baratin ! Montre-moi plutôt ce que tu sais faire au lieu de causer ! » Il y a beaucoup de mise en scène[hype] de la part des hommes dans le dancehall, et les femmes sont venues lescontester sur ce qu’ils croyaient être leur domaine de prédilection…
Alors oui, peut-être qu’au premier regard les femmes dans le dancehall peuventapparaître comme dénuées de pouvoir. Et une fois encore, on entend la vieillerengaine sur la façon dont les corps féminins sont exposés dans les vidéos et ainsi desuite… Moi je vois plutôt beaucoup de prise de pouvoir [empowerment], tant dans leverbe des femmes deejays qu’au niveau des représentations que les danseusesdonnent d’elles-mêmes dans le public. Leurs corps suggèrent un sens de la fierténoire ; il y a même beaucoup de fierté dans ces corps ! Elles savent très bien qu’ellesne ressemblent pas à Miss Jamaica, mais qu’importe ! Au contraire, dans le dancehallvous voyez des femmes callipyges, avec leurs gros arrière-trains [big hips], leurspoitrines volumineuses et leurs tailles larges qui contrôlent l’espace et marquent unevéritable présence ! Elles n’ont pas peur de se montrer ! Elles ne viennent pas pour secacher, elles s’affichent et vous disent : « me voilà ! ». Donc il s’agit bien d’une prisede contrôle de l’espace et, par voie de conséquence, d’une prise de pouvoir !
–J.B. : De ce point de vue, il y aurait donc une forme de féminisme noir et populaire dans laculture dancehall…
–C.C. : Absolument. C’est ce que je ne cesse pas de répéter depuis vingt ans tout enrécoltant une foule de critiques, mais je continuerai 20 ! Parce que le féminisme n’estpas univoque. Au contraire, c’est un discours très complexe. Alors plutôt que d’enimposer une vision unique, il faut tenir compte de ses expressions racialisées etculturellement spécifiques ! Je pense par exemple à Nanny qui, pour nous Jamaïcains,représente la quintessence du féminisme [voir encadré n°2]. À propos de Nanny, notreculture a conservé ce beau fragment mythique qui raconte qu’elle utilisait sonarrière-train pour dévier les balles tirées par les soldats britanniques. Pour ma part,j’ai suggéré qu’il y a peut-être une connexion à déceler entre le puissant arrière-trainde Nanny et la façon dont cette partie du corps féminin est utilisée dans le dancehall !Vous savez, l’arrière-train peut être une arme très puissante pour les femmes ! Cesaut imaginatif que je me suis amusée à faire m’a néanmoins conduite à l’idée de« marronnage érotique ». Je l’ai exprimée la première fois il y a un certain nombred’années lors d’un colloque sur l’émancipation qui se tenait à l’Université des WestIndies ; j’y ai proposé un papier qui traitait du dancehall comme d’un espace de rejetde la société plantocratique dont je voyais des survivances dans certaines catégorieseurocentrées du discours normatif. Je laissais donc entendre que oui, il y a bien uneforme de « culture du marronnage » dans l’érotisme du dancehall lorsqu’il rejette lesconceptions occidentales de la respectabilité féminine.
Nanny, le marronnage et son esprit
Le 31 mars 1982, le gouvernement jamaïcain a reconnu en Nanny, reine desMarrons, la première et seule héroïne de la nation 21 ; une héroïne dont lesfragments d’histoire doivent être recomposés puis lus au travers des rares piècesd’archive laissées par les colons anglais qui l’ont combattue. D’ascendance Ashanti,
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
173
Nanny est censée avoir vu le jour à la fin du XVIIe siècle dans l’actuel Ghana, avant
d’être capturée et déportée vers la Jamaïque afin d’y être vendue comme esclave.Là, elle aurait appris l’existence de fugitifs regroupés dans les Blue Mountains ; leurdésignation par le terme « marrons » – ou marroons en anglais – est un dérivé del’espagnol cimarrón, qui suggère l’idée de « vivre sur les cimes ».
Avec quatre de ses frères d’infortune – Accompong, Cudjoe, Johnny et Quao –Nanny s’est échappée de la plantation où elle était détenue pour rejoindre lescommunautés de Marrons protégées par les montagnes et leur accès difficile. Saconnaissance de la spiritualité africaine – on la décrit souvent comme une Obeah
woman (un terme qui renvoie aux sphères de la magie et de l’occulte) –, sa finessed’esprit et son charisme l’ont peu à peu menée à la tête d’un groupe qui a fondé uncamp retranché baptisé Nanny Town. Ainsi son nom est-il peut être dérivé du motashanti Ni, qui signifie « mère » 22. Quoi qu’il en soit, les colons anglais n’ont pastardé à livrer une véritable guerre aux Marrons dont ils ont attaqué les placesfortes qu’ils appelaient Negroes towns (les « villes des Nègres »). Nanny Town, situéeprès de l’actuelle Portland, apparaissait sur leurs cartes comme l’une des plusimportantes. C’est lors de cette Première Guerre des Nègres marrons (First Marroon
War, 1729-1739) que Nanny Town tombe en décembre 1734. D’aucuns prétendentque Nanny serait morte au cours de l’attaque ; d’autres attestent qu’elle a pris lafuite, puis refondé une communauté dans laquelle ses vieux jours se seraientécoulés en position de matriarche.
Parmi les nombreux textes écrits au sujet des Marrons de la Jamaïque,l’anthropologue et juriste autrichien Werner Zips a composé une ethnohistoire deces figures archétypales de la résistance aux colonisateurs dont les sources tententde contourner les biais d’une lecture par trop eurocentrée. Plutôt que de se fieraux seules archives de la répression constituées par les colons, Zips a convoqué sonexpérience des sociétés ouest-africaines combinée à un long travail de terrain enJamaïque où il a recueilli de nombreux fragments de tradition orale qui évoquent àla fois l’histoire et l’héritage des Marrons. Le chercheur reconnaît ainsi dans leconcept de Kromanti – forgé par les Marrons comme une expression de leur façonafricaine de faire communauté – la racine et le ferment d’une culture de larésistance aux ramifications sociales, culturelles, artistiques et politiques 23.Certains travaux de Stéphanie Melyon-Reinette se situent dans le prolongement decette idée en proposant d’étudier les survivances du marronnage et de son espritdans les arts expressifs de la Caraïbe ou, plus largement, de l’Atlantique noir 24. Sila résistance est une femme, pour nombre de caribéens et de membres de ladiaspora africaine, ses traits originels ne laissent pas de dessiner le visage et deprolonger le regard de Nanny.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
174
Nanny of the Maroons
Portrait publié sur le site internet du gouvernement jamaïcain
Prenons l’exemple du regard, et des corps exposés au regard. Pour le féminismeoccidental – tout du moins certaines de ses versions – le regard des hommes estconçu comme quelque chose d’offensant : dans bien des situations, les femmesseraient à la fois les objets et les victimes du regard masculin. De telle sorte que toutel’idée d’être vue est considérée sous l’angle de l’appropriation : l’homme vous regardecomme s’il voulait instiller en vous l’idée de son contrôle, par le regard… Or, dans laculture dancehall le regard signifie tout le contraire ! Dans ce contexte, les femmess’habillent dans le but d’être regardées. Lorsque vous vous habillez comme elles lefont et que vous montrez votre corps, le regard est sur vous – clairement !
Donc il s’agit bien d’une lecture différente : au lieu de concevoir les femmes commeautant d’objets dominés par le regard, il faut déceler leur pouvoir qui consiste àcapter le regard et non pas à être captées par lui ! La raison pour laquelle on vousregarde étant précisément que vous constituez un puissant objet d’attention. Ce quivous pousse à regarder cette femme plutôt qu’une autre est son pouvoir érotique ;son pouvoir de captation du regard, plutôt que le fait d’en être une simple victime. Aulieu de concevoir les femmes en tant qu’objets passifs du regard, on peut dès lors lesconsidérer comme des sujets qui captent le regard, et le désir. C’est ainsi que je tentede relire toute cette politique du regard, laquelle peut s’avérer très différente d’uneculture à l’autre ! Donc je dis aux féministes occidentales : « Ne nous imposez pasvotre regard, nous avons le nôtre et il signifie autre chose que ce qu’il vous arrive decroire ou de voir ! »
–J.B. : J’aimerais à présent évoquer avec vous la haine des homosexuels, très présentedans le dancehall. Je me suis souvent demandé ce qu’indiquaient les affirmations, sanscesse répétées par certains deejays, d’une masculinité agressive qui se trouve être proférée
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
175
par des subalternes issus des ghettos. Ces affirmations ne constituent-elles pas le signed’un doute, doublé d’une peur concernant leur valeur d’homme dans une société jamaïcaineoù ils ne sont pas respectés, pour ne pas dire simplement exclus ?
–C.C. : Vous touchez à quelque chose que j’ai essayé de penser. Tout d’abord, il mesemble qu’il faut dire que l’homophobie telle qu’on l’observe dans la sociétéjamaïcaine vient tout droit de la Bible. Elle provient d’une lecture fondamentaliste del’Ancien Testament, Lévitique, Chapitre 18. Je crois bien qu’il y est écrit quel’homosexualité est une abomination et ainsi de suite [§22]. C’est une idéologie droiteissue du fondamentalisme chrétien ; ce n’est pas quelque chose de mauvais que lesJamaïcains auraient entièrement conçu par eux-mêmes. Ça vient de la Bible, et pournombre de Jamaïcains la Bible reste un texte sacré. De sorte que vous ne pouvez pasconvaincre des fondamentalistes chrétiens du fait que l’homosexualité ne constituepas une abomination. C’est impossible ! Peu importe la façon dont vous tenterez deleur expliquer qu’il n’y a aucune anormalité dans ces comportements… Non, pour euxc’est un péché ! Beaucoup vont même au-delà de cette idée du péché et pensent qu’ils’agit de quelque chose dont la société doit se débarrasser ! Donc oui, la sociétéjamaïcaine est bel et bien homophobe. Et les deejays ne cessent pas d’affirmer leuridentité hautement pro-masculine. Ce qui n’est peut-être pas sans ambiguïté ! Je vousrejoins donc sur l’idée que, sans doute, toute cette affirmation agressive del’hétérosexualité cache une véritable incertitude quant à la sexualité de certainshommes qui s’affichent pourtant comme vigoureusement homophobes. C’estvraiment très compliqué ! Dans le même temps, j’essaie d’expliquer d’où provientl’homophobie en Jamaïque ; et le fait qu’elle provienne de la Bible ne la rend pas sidifférente des positions homophobes qui sont affichées dans bien d’autres endroits.Donc je ne pense pas que ce soit une analyse honnête de la politique sexuelle globaleque de présenter la Jamaïque comme l’endroit le plus homophobe au monde. En tantque critique de ma propre culture, je me dois de résister à la partialité d’une telleaffirmation.
Qui plus est, j’aimerais ajouter que je trouve très ironique l’attitude des Européensqui consiste à dire aux deejays jamaïcains : « ok, venez en Europe, mais évitez de nousservir vos textes homophobes parce que, sur notre marché, ça ne prend pas ! ». Dèslors que vous tournez les choses sous la forme d’un argument commercial, les deejays
tendent à l’accepter d’autant plus facilement. Parce que oui, évidemment, ils veulentaussi faire de l’argent ! Mais ça ne s’arrête pas là : les Européens ne veulent passimplement que vous renonciez à vous exprimer sur ces sujets lorsque vous venez enEurope ; ils veulent votre signature au bas d’une feuille qui stipule que vous ne direzrien en Jamaïque non plus ! Ils exercent sur les deejays une police des textes à l’échelleglobale ! Comprenez-moi bien : je ne défends en aucun cas les textes homophobes dupoint de vue d’un contenu dont je ne soutiens pas une seule idée. Mais je ne peux quem’élever contre la croisade morale que je viens de dénoncer – une de plus !
Faya pon dem 25, ou les enfers promis aux homosexuel(le)s
Une note de l’organisation non gouvernementale Human Rights First publiée le 15mai 2014 sous le titre « LGBT Issues in Jamaica » rappelle que l’homosexualité y estillégale depuis 1864 et qu’aucune modification de la loi n’est à l’ordre du jour.Entre 2009 et 2012, le principal groupe de défense LGBT (Lesbiennes, gays, bi ettrans) de l’île – le Jamaican Forum for Lesbians, All-sexuals and Gays (J-Flag) – a
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
176
recensé plus de deux cent trente et une affaires de discrimination et de violenceimpliquant des questions d’identité de genre et/ou d’orientation sexuelle.Toujours selon le J-Flag, plus de 80 % des Jamaïcains accréditeraient l’opinion selonlaquelle l’homosexualité est immorale et 75 % d’entre eux s’opposeraient à touteabrogation des textes de loi existant à ce sujet 26. Durant la campagne qui a précédéles élections générales de 2002 remportées par le People’s National Party (i.e. les« démocrates »), le camp adverse du Jamaican Labour Party a choisi comme chant deralliement un morceau dancehall explicitement homophobe : « Chi Chi Man »*, parT.O.K., qui appelle à brûler (métaphoriquement diront d’aucuns) leshomosexuel(le)s. Comme l’explique Dona Hope, l’homophobie affichée dans ledancehall ne saurait dès lors être comprise comme une création ex nihilo ; elle faitplutôt écho à un fonds homophobe aussi ancien qu’actif dans la culture jamaïcaine.Quant à la crudité de cet écho sur la scène dancehall, il s’accorderait selonl’auteure à la position subalterne de la plupart des deejays qui, issus des ghettos,verseraient dans une surenchère d’affirmation masculine visant à compenser lafragilité de leur position sociale au détriment de la figure-repoussoir del’homosexuel – le batty man, ou chi chi man dans le vernaculaire local – conçucomme l’homme inauthentique par excellence 27.
Nombre de deejays ayant atteint une stature internationale, depuis Shabba Rankset Buju Banton (Mark Myrie) dans les années 1990 jusqu’à Vybz Kartel au cours dela dernière décennie, se sont ainsi attirés les foudres des activistes et autresdéfenseurs des droits de l’homme en Occident. En 2003, l’association LGBTbritannique OutRage! a par exemple déposé plainte contre l’organisation des Music
of Black Origin Awards 28, lesquels ont décerné des prix à Beenie Man (AnthonyDavis), Bounty Killer (Rodney Price) et Elephant Man (O’Neil Bryan) – trois deejays
aussi célèbres que connus pour leurs diatribes homophobes. Diffusé par BujuBanton en 1992, le morceau « Boom By-By »* est considéré comme l’acte fondateurde cette controverse qui a valu aux deejays incriminés l’annulation de nombreuxconcerts en Europe.
En revanche, dans les ghettos jamaïcains de telles attaques contre les stars dudancehall sont le plus souvent perçues comme autant de menées perversesorchestrées par Babylone (i.e. les institutions qui portent les valeurs de l’Occidentpostcolonial) et ses lobbys mondialisés pour affaiblir la culture ainsi que le style devie de ceux qui ont fait le choix de s’y opposer. Un deejay comme Buju Banton,lequel a refusé tout compromis en s’arc-boutant sur ce qu’il considère comme lesprincipes inaliénables d’une morale inspirée du rastafarisme – une attitude qu’ilscande dans le morceau « Complaint » (1995)*, où il moque les plaintes desOccidentaux –, est ainsi conçu par les plus pauvres tel un authentique résistant quiporte haut la fierté et les valeurs des sufferers 29. Carolyn Cooper a forgé le conceptde « border clash 30 »pour désigner ces affrontements (clashes) qui se déroulent dansdes zones de conflits où les économies morales s’opposent aux frontières (borders)des mondes : ceux de la religion – ou certaines de ses interprétations – et de lasécularité, ceux du Nord et du Sud globalisés, ou ceux des sociétés instituées et desghettos qui en constituent les marges.
–J.B. : « Résistance » apparaît comme un mot-clé dans les textes « conscients », depuis lereggae des commencements jusqu’à l’actualité du dancehall dit « culturel ». Que pensez-
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
177
vous d’un tel concept et comment l’articulez-vous à la musique ainsi qu’à la culturepopulaire jamaïcaine ?
–C.C. : Je dirais que le concept de résistance est très complexe. Mais je crois que lepremier sens que je lui attribue est inspiré d’un morceau de Bob Marley où il parle dela rythmique du reggae et de la sensation que lui procurent ses percussions alors queson cœur bat avec elles à l’unisson. Les rythmes vibrent alors comme la pulsationd’une résistance contre le « système » 31. Je me sens en phase avec cette idée dureggae : le rythme, la musique et les textes comme un langage de résistance contre le« système »… Dans la culture jamaïcaine et dans le mouvement Rastafari, le« système » est appelé Babylone, i.e. tout ce nexus composé de politique, d’éducationet de religion : toutes ces institutions eurocentriques qui ont été imposées aux Noirset ont véhiculé leurs normes morales, leurs appareils de pouvoir intellectuel, leursrègles de gouvernement, etc. Ce que dit Marley, c’est que le reggae entre encontradiction avec tout ce corpus d’idées, avec toute cette idéologie ! De sorte que larésistance apparaît comme une forme d’engagement critique vis-à-vis de tous cesdiscours qui proviennent de l’extérieur et constituent les leviers de l’oppression.Pour certains d’entre nous, notre manière de réagir à la soi-disant culture« dominante » est dès lors pour le moins prudente ; notre première disposition est auscepticisme : à la résistance, et pas à la simple soumission. Donc nous restons deboutet refusons de mettre un genou à terre. Une fois encore, c’est une forme demarronnage. C’est une attitude oppositionnelle qui consiste à dire : « je dois voir lestenants et les aboutissants de toutes ces choses avant de consentir à les accepter ».D’ailleurs, l’étymologie latine du mot « résistance » renvoie à l’idée de « se retirer »,« ne plus avancer » et « tenir sa position » ; ce qui implique de ne rien accepteraveuglément. Il s’agit d’une forme de distance intellectuelle, ou de désengagementconscient à l’égard d’une certaine idéologie que l’on vous impose. C’est comme ça queje vois la chose : la résistance comme une attitude fondamentale tendant vers lescepticisme de principe. Cette idée m’a bien des fois guidée dans mon travail commedans ma vie !
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
178
Make Sure
2015
© Dan23
Made in Jamaica : regards sur l’entre-deux
8 La discussion avec Carolyn Cooper s’est poursuivie bien au-delà des limites de ce
dossier. J’ai donc dû faire des choix pour restituer l’essentiel – ou ce que j’ai tenu pourtel – de ce regard porté par une intellectuelle jamaïcaine à l’entre-deux, voire auxconfluences de la littérature dont elle est une spécialiste et de l’oraliture des deejays quiportent la voix d’une scène dancehall à laquelle nombre de critiques seraient tentés dedénier la qualité d’art, fût-il populaire. C’est pourtant à l’intersection du dit et de l’écrit– ou de l’oral et du scribal, pour reprendre ses termes – que toute l’œuvre de CarolynCooper a été composée comme une tentative d’analyse dialogique de sa propre culture,où il s’agit moins de porter un regard en surplomb que d’entendre toutes les voix qui encomposent l’expression. Si bien que l’analyse culturelle se conçoit dès lors comme unintertexte offrant une multiplicité de points de vue et de lectures des situations.Exposer celles que les deejays donnent des ghettos jamaïcains ne signifie pas accréditerleurs opinions, justifier ou encore excuser leurs violences verbales et leurs excès.Montrer ne saurait être l’équivalent d’adhérer. C’est faire apparaître la vision interned’un monde ; lui emprunter ses mots et parfois les traduire de sorte à ce qu’ils puissentêtre lus du dehors sans pour autant tronquer leur expression du dedans. Cet entre-deuxconstitue le défi et la position de nombre d’analystes culturels, qui sont peut-être avanttout des « auteurs en traduction ».
9 Quant aux codes du dancehall traduits par Carolyn Cooper, eux aussi montrent un
perpétuel entre-deux incarné par les deejays dont les mots ne cessent de balancer entre
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
179
culture et slackness, ou extrême violence et conscience aigüe de l’oppression. Les rastasexpliquent cette manière janusienne de vivre dos à dos avec soi-même comme larésultante du schisme interne que porteraient en eux tous les Noirs héritiers del’esclavage et de sa Babylone plantocratique dont le système de domination a ouvertune insondable brèche dans leur moi profond ; depuis, la haine de soi et des siensinculquée par les anciens maîtres continuerait d’infecter le quotidien des ex-esclavesdont le métal des chaînes a été remodelé en armes à feu. Voilà ce que dit par exempleNeville Livingston, plus connu sous le nom de Bunny Wailer (dernier survivant du trioqu’il constituait avec Bob Marley et Peter Tosh), dans une séquence très forte du filmMade in Jamaica* – réalisé par le français Jérôme Laperrousaz et sorti sur les écrans en2007. Ce remarquable documentaire – entièrement sous-titré en français, si bien qu’ilpermet un accès aux textes des chanteurs et autres deejays – présente le récit d’unescène musicale jamaïcaine où les rythmiques organiques du reggae roots, et l’âpreté deses critiques sociales, côtoient les pulsations digitales d’un dancehall dont les ondestraversent les corps dans le même temps qu’elles restituent les échos du sexe, de laviolence et de l’argent pour lesquels les sufferers ne laissent pas de s’entretuer. Aussi lanarration filmée débute-t-elle par le meurtre en janvier 2005 de Gerald “Bogle” Levy,danseur emblématique du Black Roses Crew (un groupe de rue qui a posé son empreintesur l’histoire du dancehall). Made in Jamaica reste dès lors comme hanté par le fantômede Bogle, a.k.a « Mr. Wacky » (« Mr. Déjanté »)*, et la présence d’une violence marquéepar son absence. Nombre de deejays dont il a été question au cours de l’entretien avecCarolyn Cooper apparaissent dans le film, depuis Lady Saw – qui a délaissé le slackness
pour une conversion au christianisme évangélique prononcée le 14 décembre 2015 –jusqu’à Vybz Kartel (dont la peau était encore noire et vierge de tatouages). Tandis qu’ilinterprète « Emergency », une charge violente contre le gouvernement et les partispolitiques dénoncés pour l’importation des armes à feu distribuées dans les ghettos,Kartel s’entoure de femmes à demi-nues qui s’exhibent, ondulent et miment des coïtssur fond de texte « conscient » ; le schisme est bien là, qui traverse les corps, la cultureet ses conflits…
NOTES
2. Sur cette acception du dancehall, voir : Katz D., Solid Foundation. An Oral History of Reggae, New
York, Bloomsbury, 2003, pp. 329-348 ; voir également, traduit en français : Bradley L., Bass Culture.
Quand le reggae était roi, Paris, Éditions Allia, 2005 [2000], pp. 573-617.
3. Outre les remerciements que l’auteur de ces lignes adresse à Carolyn Cooper pour sa grande
disponibilité, il tient également à signaler sa dette vis-à-vis du travail de Denis-Constant Martin.
Auteur en 1982 d’un ouvrage fondateur des recherches françaises sur la musique jamaïcaine
contemporaine – Aux sources du reggae, Roquevaire, Éditions Parenthèses –, ce chercheur est une
véritable inspiration pour toutes celles et ceux qui s’efforcent de prolonger son intérêt pour ces
OPNI (objets politiques non identifiés) que sont les musiques populaires de l’Atlantique noir ou
d’ailleurs.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
180
4. À ce sujet, voir l’essai d’historiographie proposé par l’anthropologue Norman Stolzoff dans son
ouvrage Wake the Town and Tell the People. Dancehall Culture in Jamaica, Durham & Londres, Duke
University Press, 2000, pp. 41-64.
5. À ce propos, voir : Vendryes T., « Des versions aux riddims. Comment la reprise est devenue le
principe de création musicale en Jamaïque (1967-1985) », Volume !, vol. 7, n° 1, 2010, pp. 191-222.
6. Concernant le rôle de ces studios d’enregistrement dans la naissance puis l’établissement d’un
« son jamaïcain », voir : Hitchins R., Vibe Merchants : The Sound Creators of Jamaican Popular Music,
Londres & New York, Routledge, 2016 [2014], pp. 73-96.
7. Sur ces changements stylistiques dans l’expression musicale jamaïcaine, voir : Chang K. et
Chen W., Reggae Routes. The Story of Jamaican Music, Philadelphia, Temple University Press, 1998,
pp. 30-52. En 2003, le français Pierre Simonin a publié un documentaire de cinquante-deux
minutes intitulé Portraits de la musique jamaïcaine*, lequel part sur les traces des pionniers qui ont
été à l’instigation de ces diverses sonorités caractéristiques de la richesse comme de l’identité
musicale de l’île.
8. Sur tous ces points, voir notamment The Rastafarians (Boston, Beacon Press, 1997 [1988]),
l’ouvrage de référence rédigé par l’anthropologue jamaïcain Leonard Barrett.
9. Ainsi par exemple de Rockers* (Kingston, Rockers Film Corporation, 1978) réalisé par le
cinéaste helléno-américain Ted Bafaloukos, lequel a employé nombre d’entre les principaux
acteurs de la scène reggae qui jouent leur propre rôle dans ce film-chronique du quotidien des
ghettos jamaïcains, de leur violence et de l’espoir suscité par la musique mêlée au culte rasta.
10. Voir : Pollard V., Dread Talk. The Language of Rastafari, Kingston, Canoe Press University of the
West Indies, 2000 [1994].
11. Cooper C., Noises in the Blood. Orality, Gender and the “Vulgar” Body of Jamaican Popular Culture,
Oxford, Macmillan, 1993.
12. Ibid., p. 161. Voir également Soundclash: Jamaican Dancehall Culture at Large (New York, Palgrave
Macmillan, 2004) – la principale publication de Carolyn Cooper sur le sujet – et, plus récemment,
l’ouvrage collectif qu’elle a dirigé à propos de l’internationalisation de la musique populaire
jamaïcaine sous le titre Global Reggae (Kingston, Canoe Press, 2012). Quant à la traduction
française de ses travaux, à ma connaissance elle se limite au texte « Du reggae au ragga : que
reste-t-il de la contestation ? », paru dans un ouvrage collectif qu’a dirigé Alain Darré sous le titre
Musique et politique. Les répertoires de l’identité (Rennes, PUR, 1996). L’ouvrage comme le texte en
question sont disponibles en ligne : http://books.openedition.org/pur/24557?lang=fr
13. Pour une approche similaire, voir : Gaye A., « De l’espace dancehall comme refuge cathartique
à la Jamaïque », Espaces et Sociétés, n° 144-145, 2011, pp. 105-119.
14. Personnage récurrent de la vie médiatique, Vybz Kartel a fait l’objet de toute une série
d’articles publiés tant dans le Gleaner que le Jamaica Observer. Pour ce dernier, Patrick Helber s’est
livré à un travail d’analyse des caricatures qui ont représenté le deejay avant, puis au moment de
son inculpation pour meurtre ; voir : Helber P., « “Ah My Brownin’ Dat!”: A Visual Discourse
Analysis of the Performance of Vybz Kartel’s Masculinity in the Cartoons of the “Jamaica
Observer” », Caribbean Quarterly, vol. 58, n° 2-3, 2012, pp. 116-128.
15. Palmer A., Dawson M., The Voice of the Jamaican Ghetto: Incarcerated but not Silenced, Kingston,
Ghetto People Publishing Company, 2012.
16. « “More Fire”: Chanting Down Babylon From Bob Marley to Capleton », Soundclash, op. cit.,
pp. 179-206.
17. Rexton Gordon, a.k.a Shabba Ranks, fut l’un des deejays les plus populaires des années 1990 au
cours desquelles il a atteint une renommée internationale et fait maintes fois scandale pour la
crudité de ses propos. Au sujet des armes à feu et des métaphores qu’il a forgées à partir d’elles,
voir : Cooper, C., « Lyrical Gun: Metaphor and Role-Play in Dancehall Culture », Soundclash, op. cit.,
p. 154-157.
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
181
18. À ce sujet, voir également : Zips W., « Tout n’est pas si noir dans cet Atlantique… noir. Du
bandit au rebelle : transformations de la masculinité dans la musique reggae-dancehall »,
Volume !, vol. 8, n° 2, 2011, pp. 123-159.
19. Marion Hall, a.k.a Lady Saw*, est la première femme deejay à s’être imposée – et ce dès les
années 1990 – sur le terrain presque exclusivement masculin du slackness. Si bien que Carolyn
Cooper voit en elle une pionnière qui, tout en parlant ouvertement de sa sexualité, n’a cessé
d’affirmer le pouvoir des femmes sur leur corps et le désir qu’il peut susciter ; voir : Cooper C. ,
« Lady Saw Cuts Loose: Female Fertility Rituals in the Dancehall », Soundclash, op. cit., pp. 99-123.
20. Voir par exemple l’ensemble du dossier critique publié par le journal Small Axe (vol. 10, n° 3,
2006) suite à la parution de l’ouvrage Soundclash, op. cit.
21. Voir sa présentation officielle dans la liste des Jamaican National Heroes publiée sur le site du
gouvernement : http://jis.gov.jm/heroes/nanny-of-the-maroons/(consulté le 14/08/2016).
22. Tuelon A., « Nanny – Maroon Chieftainess », Caribbean Studies, vol. 19, n° 4, 1973, p. 21.
23. Zips W., Nanny’s Asafo Warriors. The Jamaican Maroons African Experience, Kingston & Miami, Ian
Randle Publishers, 2011.
24. Melyon-Reinette S. (ed.), Marronnage and Arts: Revolts in Bodies and Voices, New Castle,
Cambridge Scholars Publishing, 2012.
25. Littéralement, « le feu sur eux » : interjection fréquemment employée dans le dread talk – et
donc dans le dancehall – pour appeler à la punition des « corrompus ».
26. http://www.humanrightsfirst.org/resource/lgbt-issues-jamaica (consulté le 14/08/2016).
27. Hope D., « Passa Passa: Interrogating Cultural Hybridity in Jamaican Dancehall », Small Axe,
n° 21, 2006, pp. 132-133. De la même auteure, voir également : Man Vibes. Masculinities in Jamaican
Dancehall, Kingston & Miami, Ian Randle Publishers, 2010.
28. Il s’agit d’une cérémonie annuelle créée au Royaume-Uni en 1996 afin de saluer les apports
des artistes qui contribuent aux « musiques noires ».
29. En 2009, Buju Banton a toutefois été arrêté à Miami par la Drug Enforcement Administration (la
brigade des stupéfiants) en possession de cinq kilogrammes de cocaïne ainsi que d’armes à feu.
Suite à quoi un juge de la cour de Floride l’a condamné en 2011 à dix ans de réclusion ferme. Ses
demandes d’extradition vers la Jamaïque ont jusqu’alors été refusées.
30. Cooper C. et Gutzmore C, « Border Clash. Sites of Contestation », Soundclash, op. cit., pp. 35-72.
31. Il s’agit du morceau « One Drop »* publié en 1979 sur l’album Survival ; entre autres choses,
les paroles disent : « So feel this drum beat [Alors ressens la percussion]/As it beats within [Alors
qu’elle bat à l’intérieur]/Playing a rhythm resisting against the system [Jouant ce rythme qui résiste
au système] ».
RÉSUMÉS
Cousin jamaïcain du rap américain, le dancehall est souvent présenté comme l’enfant terrible du
reggae. À l’instar du rap, c’est d’abord une musique qui porte l’expérience de la pauvreté. Elle
résonne comme l’écho de la dureté des conditions de vie dans les ghettos de Kingston. Ainsi le
dancehall fait-il souvent scandale auprès de la « bonne société », tant par ses mises en scène du
sexe, de la violence et de l’argent – autant de sujets qui renvoient au domaine du slackness (i.e. de
la débauche) – que par les critiques sociales proférées par ses artistes à l’encontre des valeurs de
la classe dominante auxquelles sont opposés les principes de leur culture : celle des exclus de la
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
182
société jamaïcaine. À partir d’un entretien avec Carolyn Cooper, professeure à l’Université des
West Indies, ce dossier propose une lecture des codes du dancehall en dialogue avec une
chercheuse qui a initié son étude en Jamaïque. Entre culture et slackness, un tel regard dépasse les
limites de la scène musicale pour ouvrir une perspective originale sur la culture populaire
jamaïcaine, ses résistances et ses conflits.
A Jamaican cousin of American rap, dancehall is often described as the enfant terrible of reggae.
Like rap, dancehall is first and foremost a music that conveys the experience of poverty. It
provides an echo of the harsh living conditions of the Kingston ghettos. Dancehall often
scandalizes “polite society,” both by its staging of sex, violence and money – issues that all relate
to slackness (i.e. debauchery) – and by the social criticism voiced by its artists, who challenge the
values of the ruling class who are opposed to the principles of their culture, that is of the
excluded of Jamaican society. Through an interview with Carolyn Cooper, a professor at the
University of the West Indies, this article offers a reading of dancehall codes in dialogue with a
researcher who initiated its study in Jamaica. Between culture and slackness, such a perspective
goes beyond the boundaries of the music scene and opens up an original perspective on Jamaican
popular culture, its resistances and its conflicts.
INDEX
Keywords : Jamaica, reggae, dancehall, culture, slackness, erotic marronage, conflicts, resistance
Mots-clés : Jamaïque, reggae, dancehall, culture, slackness, marronnage érotique, conflits,
résistance
AUTEURS
JÉRÔME BEAUCHEZ
Jérôme Beauchez est sociologue, maître de conférences à l’université de Lyon/Saint-Etienne,
chercheur au Centre Max Weber et membre du LabEx « Intelligences des Mondes Urbains ».
Actuellement en délégation CNRS auprès de l’Institut interdisciplinaire de recherche sur les
enjeux sociaux (IRIS), il coordonne le programme ANR Socioresist. Dans ce cadre, Jérôme
Beauchez mène des enquêtes ethnographiques auprès de différentes populations marginalisées
dont il s’agit d’interroger les résistances quotidiennes à l’adversité des dominations de « genre »,
de « classe » ou de « race ». Dernière publications : « ‘Chaos in France’: Fieldnotes from the
French Punk Experience », Cultural Dynamics (à paraître en décembre 2016) ; avec Pierre Lauret,
« “Ôter leurs majuscules aux concepts” : ethnographie d’un sport de combat. Entretien avec
Jérôme Beauchez », Cahiers philosophiques, n° 146, 2016, pp. 83-119.
CAROLYN COOPER
Carolyn Cooper est professeure de littérature et d’études culturelles à l’Université des West
Indies en Jamaïque. Elle a notamment publié : Noises in the Blood. Orality, Gender and the “Vulgar”
Body of Jamaican Popular Culture (Oxford, Macmillan, 1993), Soundclash: Jamaican Dancehall Culture at
Large (New York, Palgrave Macmillan, 2004) et a récemment dirigé l’ouvrage collectif Global
Reggae (Kingston, Canoe Press, 2012).
Cultures & Conflits, 103-104 | automne/hiver 2016
183