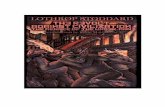Entre piétin et loup. Menace interne et menace externe dans l'élevage de rennes des Tožu
Transcript of Entre piétin et loup. Menace interne et menace externe dans l'élevage de rennes des Tožu
1
Entre piétin et loup. Menace interne et menace externe dans l’élevage de
rennes des Tožu1
Charles Stépanoff
Cahiers d'anthropologie sociale, 2012 8, pp.137-151.
Résumé : Tout élevage de rennes doit faire face à deux menaces aux conséquences
contradictoires : une trop forte dispersion du troupeau entraîne une menace externe venant des
prédateurs et des rennes sauvages, tandis qu’une excessive concentration fait naître la menace
interne des épidémies. Le traitement d’une menace favorise l’émergence de l’autre. Cet article
étudie les équilibres et les techniques en usage chez les Tožu éleveurs de rennes, à travers les
transformations du XXe s. qu’ont entraînées la collectivisation puis la privatisation. Il décrit
un contraste entre un système de cognition distribuée entre hommes et rennes et un système
de division du travail entre hommes assistés par des technologies complexes.
Mots-clés : Élevage de rennes ; maladies ; Sibérie ; Touvas-Tozhu ; politiques soviétiques
Abstract : Any system of reindeer herding faces two threats, with opposite consequences:
scattering of herd entails an external threat, coming from predators and wild reindeer, while
excessive concentration gives rise to the internal threat of epidemics. Treating one threat
contributes to the rising of the other. This article studies the equilibriums and techniques in
use among the Tozhu reindeer herders, throughout the transformations of the 20th
c. due to
collectivization and privatization. It describes a contrast between a system of distributed
cognition between men and reindeer and a system of division of labour between men, assisted
by complex technologies.
Keywords : Reindeer herding ; maladies ; Siberia ; Tuva-Tozhu ; Soviet policy
Biographie: Charles Stépanoff, ethnologue spécialiste des Touvas, est maître de conférences à
la chaire « Religions de l’Asie septentrionale et de l’Arctique » de l’École pratique des hautes
études. Il coordonne depuis 2011 le Groupement de recherche internationale « Nomadisme,
société et environnement en Asie centrale et septentrionale ».
Le renne (rangifer tarandus) est élevé en Asie du nord dans des conditions et selon des
méthodes très contrastées. L’élevage pastoral de la toundra septentrionale rassemble des
troupeaux de plusieurs milliers de têtes, destinés principalement à la production de viande.
Dans les régions de taïga centrales et méridionales, les chasseurs-collecteurs élèvent de petits
troupeaux de quelques dizaines de rennes seulement, dont la fonction première est le
1 Cette étude s’appuie sur deux enquêtes menées chez les Tožu en juillet-août 2008 et en février 2011, grâce au
soutien de la Fondation Fyssen et du Groupe de recherche international « Nomadisme, sociétés et environnement en Asie centrale et septentrionale ». J’exprime ma gratitude à l’administration de la région tožu pour son aide ainsi qu’aux éleveurs qui m’ont accueilli. Je remercie pour leur lecture et leurs remarques pénétrantes Jean-Pierre Digard, Roberte Hamayon, Frédéric Keck et Alexandra Lavrillier.
2
transport. Quel que soit le type d’élevage, la fragilité des pâturages des rennes nécessite des
déplacements réguliers des troupeaux sur de vastes territoires non clôturés. Cette
indispensable mobilité met partout les éleveurs face à une double menace aux conséquences
contradictoires. Trop dispersés, les rennes risquent d’être victimes des prédateurs ou de
rejoindre des troupeaux de rennes sauvages dont ils ne se distinguent guère sur le plan
biologique. Si, en revanche, les rennes restent trop longtemps rassemblés en un lieu, ils
épuiseront rapidement les pâturages, seront affaiblis et stressés, donc plus sujets à contracter
des maladies dont la contagion sera elle-même facilitée par la concentration du troupeau.
Mettre les rennes à l’abri des loups, qui éliminent d’abord les individus malades, c’est
supprimer leur action de nettoyage des troupeaux. Ainsi le meilleur remède aux maladies, qui
est la dispersion du troupeau, expose les rennes à une menace que l’on peut qualifier
d’« externe » représentée par les prédateurs et les rennes sauvages. Inversement, la lutte
contre cette menace externe passe par le maintien des rennes sous surveillance à proximité des
humains, ce qui fait surgir la menace « interne » des épizooties.
Dans les rythmes annuels, c’est surtout l’été que la menace interne est forte, quand les rennes
tendent à se regrouper pour fuir les insectes, alors que l’hiver, lorsque les rennes se dispersent
en quête de nourriture, la menace externe est plus importante. Au-delà de cette rythmicité, il
faut noter que le processus même de l’élevage, qui implique nécessairement de rassembler à
durée et régularité variables des rennes à proximité des humains, constitue en soi un facteur
constant de propagation de maladies. Des maladies infectieuses comme le piétin
(nécrobacillose) et le charbon sont endémiques chez les rennes domestiques. Preuve du rôle
direct de la domestication dans la propagation de ces maladies, les populations de rennes
sauvages sont généralement nettement plus saines que les troupeaux domestiques (Klein
1980, 751 ; Jernsletten & Klokov 2002, 63).
Tout élevage de rennes doit mettre en œuvre des techniques permettant de faire face à ce
paradoxe de deux menaces, l’une interne, émergeant de la pratique même de l’élevage, et
l’autre, externe, issue de l’environnement indispensable à cet élevage. Nous examinerons ici
le cas de l’élevage de rennes chez les Tožu des monts Saïan en Sibérie méridionale, dans la
partie orientale de la république de Touva. L’élevage des Saïan a suscité depuis longtemps
l’intérêt des chercheurs car il est à la fois le plus méridional et l’un des plus anciens connus
puisque ses traces remontent à l’âge du bronze (Kyzlasov 1952). Au cours du XXe siècle
l’élevage de rennes tožu a connu deux crises dramatiques : la collectivisation menée en 1949 à
la suite de l’entrée de Touva dans l’URSS (1944), puis dans les années 1990 la privatisation
qui a vu le cheptel s’effondrer de 90%. Les maladies des rennes étant intimement liées au
mode de vie des éleveurs, elles ont constitué un enjeu politique important pour le pouvoir
soviétique. On examinera dans cet article quelles réponses à la double menace ont été
apportées par les Tožu dans le contexte de ces bouleversements historiques. Par cette
approche, on tentera d’apporter un éclairage sur les origines de la catastrophe récente
traversée par les éleveurs tožu.
Un élevage nomade entre piétin et loups
Aujourd’hui 35 familles d’éleveurs tožu sont enregistrées officiellement, pour un cheptel total
d’environ 1100 rennes. Les éleveurs sont devenus indépendants de fait après la mise en
liquidation des sovkhozes en 1996 : même lorsqu’ils sont enregistrés dans de fantomatiques
coopératives, ils sont libres de choisir leurs itinéraires de nomadisation, d’abattre leurs rennes
quand ils le souhaitent et de tuer les prédateurs qui les menacent. Le service vétérinaire par
hélicoptère qui fonctionnait à l’époque soviétique a disparu, ce dont beaucoup d’éleveurs se
plaignent. Les troupeaux sont aujourd’hui de faible taille, variant pour la majorité entre vingt
3
et cinquante têtes, ce qui correspond aux effectifs antérieurs à la période soviétique
(Vainshtein 1980, 122). Les éleveurs tožu disent connaître individuellement leurs rennes, qui
portent chacun un nom. On les utilise pour le transport, en monte ou en bât. En outre, du
printemps à l’automne, les femelles fournissent du lait dont on fait du beurre et des fromages.
La viande de renne n’est consommée que rarement, les apports en viande étant plutôt fournis
par la chasse. Il en allait de même en 1910 quand D. Carruthers visita les Tožu : « tuer [les
rennes] est considéré comme une extravagance tant qu'il y a du gibier » (Carruthers 1914,
220). À partir des descriptions de Carruthers, Tim Ingold a estimé que les rennes des Touvas
sont « domestiques » au sens fort : ils font partie de la famille. Ingold nomme taming un tel
système de relations « sociales » entre hommes et rennes où ces derniers figurent comme des
« quasi-personnes ». Par opposition au taming, le herding est une relation de production et de
consommation de viande propre aux sociétés pastorales (Ingold 1986, 10).
Les éleveurs contemporains ne visent pas la croissance mais plutôt la stabilité, cependant
beaucoup éprouvent de grandes difficultés à maintenir le niveau de leurs troupeaux. Il n’est
pas rare qu’un éleveur possédant trente rennes en voie dix tués par les loups en un an. En
2010, plusieurs troupeaux ont été divisés par deux, voire par quatre, tandis que les plus
chanceux étaient stables ou augmentaient légèrement.
Sept ou huit éleveurs ont cependant plus de cinquante rennes. Parmi eux, le vieil Oleg Oraj-
ool, particulièrement respecté dans la vallée du haut Iénisséï, est reconnu comme le plus gros
éleveur mais aussi le plus expérimenté. Ayant débuté avec une vingtaine de bêtes après la
chute du sovkhoze dont il était l’employé, il possède aujourd’hui un troupeau stabilisé autour
de cent cinquante têtes. Il affirme que ses rennes sont épargnés par les attaques de loup et que
les maladies connues au temps du sovkhoze ont « disparu ». Pour les Tožu la raison de cette
réussite est évidente : Oleg est un excellent connaisseur des rennes et de la taïga, qui sait
choisir ses pâturages et itinéraires de nomadisation. Il représente pour tous un modèle, et c’est
en tant que tel que nous décrirons ses méthodes. Établi en amont de tous les autres éleveurs, il
ne craint pas de vivre à 150 kilomètres du premier village et d’endurer le climat rigoureux des
montagnes, à 1200 mètres d’altitude au plus bas, pour permettre à ses rennes d’accéder aux
meilleurs pâturages.
Pour éviter le piétin (en touva dujug aaryy « maladie du sabot »), mais aussi pour assurer le
renouvellement des lichens dont se nourrissent les rennes, Oleg nomadise une quinzaine de
fois dans l’année. Outre ces déplacements saisonniers, il modifie son circuit de nomadisation
d’une année sur l’autre afin de ne pas revenir sur le même pâturage deux années de suite. Les
vétérinaires (Rebrov 1962 ; Zhigunov 1968) décrivent le piétin comme une maladie
infectieuse dont les agents se diffusent par les excréments des animaux et se maintiennent
plusieurs années dans le sol, de sorte que sa meilleure prévention et son meilleur remède sont
en effet le changement de pâturage (sur la compréhension évenk de ce processus, voir
Lavrillier 2005). Le piétin est favorisé par un excès de chaleur l’été (Handeland et al. 2010),
tout comme la bronchopneumonie, une maladie non contagieuse (Zhigunov 1968). Les
vétérinaires soviétiques, se souvient Oleg, soignaient la « maladie des poumons », ökpe aaryy
(bronchopneumonie), par une injection de pénicilline qui remettait les animaux d’aplomb en
trois jours. Aujourd’hui que ces traitements ont disparu, Oleg traite les rennes avec des
décoctions d’herbes de la forêt, mais il reconnaît qu’elles ne sont pas toujours efficaces.
Aussi s’efforce-t-il avant tout de prévenir la maladie en choisissant correctement ses estives.
Comme tous les éleveurs tožu, Oleg monte l’été sur les alpages, ce qui lui permet de garantir
la fraîcheur nécessaire à la bonne santé des rennes. « Si tu te mets dans de mauvais endroits,
explique-t-il, les rennes auront tout de suite la maladie des poumons. Ils étoufferont. Il faut
choisir un lieu où il n’y a pas d’arbre, où le vent souffle jour et nuit. » Le vent aère le bétail et
chasse les insectes qui fatiguent considérablement les rennes l’été et provoquent ou propagent
des maladies.
4
Afin de ne pas avoir à surveiller et à rassembler son troupeau trop souvent, ce qui demanderait
des efforts excessifs et augmenterait les risques de maladies, les éleveurs sollicitent
habilement le comportement et l’intelligence des animaux. Oleg a choisi de nomadiser dans la
vallée assez encaissée du Sajlyg, empruntant le même chemin lors de la montée printanière et
lors de la descente automnale. Les montagnes abruptes qui entourent la vallée dissuadent les
rennes de s’éloigner2. « J’ai une seule route ainsi, à l’aller et au retour. C’est mon habitude et
c’est celle des rennes aussi, ils connaissent la route mieux que moi. Je les envoie vers l’estive
et ils y vont, je n’aurai pas besoin de les chercher. » « Les animaux ont appris la route
[öörenip algan] ». Les éleveurs reconnaissent même que les rennes peuvent se mettre en route
sans son intervention dès qu’il fait chaud. C’est alors le troupeau qui donne le signal du départ
de la nomadisation. L’hiver, Oleg alterne entre cinq cabanes qu’il a récemment construites
dans les vallées boisées d’affluents du haut Iénisséï. Connaissant parfaitement les
enneigements relatifs habituels des cinq campements, il choisit l’un ou l’autre en fonction des
chutes de neige afin de garantir une hauteur de neige idéale, aux alentours de 60 cm. La neige
ne doit être ni trop haute afin que les rennes puissent atteindre le lichen en la creusant de leurs
sabots, ni trop basse afin qu’ils ne s’éloignent pas trop rapidement. La région d’altitude où
nomadise Oleg est toujours plus enneigée que celle des autres éleveurs, ce qui explique, selon
lui, l’absence des loups qui sont ici gênés dans leurs déplacements. L’éleveur compte aussi
sur la vigueur des mâles pour défendre les troupeaux contre les loups, ce qui rappelle cette
observation d’Olsen à Touva en 1914 : « même quand ces fauves sont nombreux, on fait peu
de chose pour venir en aide aux rennes qui doivent se débrouiller tous seuls. » (Olsen 1921,
101).
La réponse des éleveurs aux menaces interne et externe consiste donc à utiliser de façon
avisée et efficace sa connaissance de l’environnement et les compétences des animaux eux-
mêmes. Plutôt que de fixer les rennes, clôturer leurs pâturages ou les soigner par des
médicaments, ils préfèrent recourir aux dispositions du relief, aux variations microclimatiques
et à la mémoire animale.
Dans ce type d’élevage, la fonction de « contrôle du troupeau », définie par Dwyer et Istomin
comme le maintien de sa cohésion et de sa maniabilité (Dwyer & Istomin 2008, 529) est
partagée entre les humains et les animaux eux-mêmes. Dès la naissance, on distribue aux
faons sel et sucre à la main, afin qu’ils éprouvent du plaisir au contact des hommes. Adultes,
les rennes parcourent des kilomètres pour revenir au campement goûter le sel qu’on leur offre
dès qu’ils se présentent et lécher l’urine humaine collectée dans des pissotières spécialement
construites pour satisfaire et encourager leur gourmandise. La plupart du temps, les Tožu ne
surveillent pas leurs rennes, mais comptent sur leur capacité à s’orienter dans l’espace, à se
rassembler autour de « meneurs » (baštančy) et à revenir d’eux-mêmes près des campements
pour s’y régaler. Ce type de contrôle partagé qui est au centre de l’élevage de rennes chez les
Tožu implique une autonomie de l’animal. Dans un élevage fondé sur l’autonomie animale,
les éleveurs présument et stimulent chez les animaux des compétences leur permettant
d’exercer un rôle actif dans leurs interactions avec les hommes et le milieu.
2 Cette utilisation de barrières naturelles a aussi été décrite chez les Tofalar au début du XXe siècle (Petri 1927).
5
Distribution de sel, Tožu, 2011. Photo CS.
Ce mode relationnel réapparaît sur le plan rituel. Pour lutter contre les maladies des rennes et
des humains, ou pour s’en prémunir, les éleveurs consacrent dans leur troupeau, avec ou sans
l’aide d’un chamane, un renne particulier appelé ydyk « sacré » (Stépanoff 2011). Son rôle est
de participer activement aux rituels. Supposé « garder » le campement, le renne ydyk, le plus
souvent une femelle ou un mâle castré, est laissé libre, n’est pas utilisé et, point important
pour notre sujet, n’est jamais attaché. Généralement il suffit d’attacher une femelle pour que
ses petits restent à proximité, ainsi que les petits de ses filles si elles ont déjà mis bas.
Maintenir une femelle non attachée ne signifie pas seulement qu’on ne pourra pas la traire,
mais aussi que sa descendance sera difficilement contrôlable. À l’échelle d’un troupeau de
quelques dizaines de bêtes, les conséquences sur le comportement général des rennes peuvent
être sensibles. Il est intéressant de noter que, selon les conclusions d’un vétérinaire soviétique
sur le piétin (nécrobacillose), la meilleure méthode de lutte contre cette maladie chez les
rennes est le « pâturage libre » en troupeau dispersé (Rebrov 1962, 27). Ainsi il n’est pas
impossible que la pratique de la consécration des rennes ait un effet réel sur la santé des
troupeaux. Ce qui est certain, c’est que, sur le plan psychologique, cette tradition contribue
activement à la transmission et la stabilisation chez les éleveurs tožu d’un mode de relation à
l’animal qui lui accorde autonomie et responsabilité.
Collectivisation en pays tožu
6
Par les techniques de gardiennage, la taille des troupeaux et le style de nomadisation, le
système tožu contemporain est très semblable à l’élevage de type Saïan de la période pré-
soviétique (Olsen 1921; Petri 1927; Vajnštejn 1961). D’une façon générale, on peut affirmer
que, pour les éleveurs contemporains comme pour leurs ancêtres, la meilleure réponse aux
menaces internes et externes pesant sur leur bétail est le recours à l’autonomie animale. Cette
continuité ne doit pas cacher des changements radicaux : les nomades vivant en contact avec
les rennes ne sont plus qu’une maigre minorité de la population tožu, gardiens d’un cheptel
divisé par dix par rapport à son niveau de 1931 (Vainshtein 1980, 122).
Tout s’est joué pendant la période intermédiaire, celle de sovkhozes, qui a introduit des
rapports nouveaux aux rennes répondant de façon différente aux menaces interne et externe.
Alors que l’élevage contemporain souffre beaucoup plus des loups que des maladies, les
sovkhoziens tožu retraités assurent au contraire que des épizooties frappaient régulièrement
leurs troupeaux tandis que la menace des loups était bien maîtrisée. Pour comprendre ces
changements, il faut examiner brièvement comment l’élevage de rennes a été réorganisé
durant la période soviétique.
Jeune femme tožu à dos de renne. Photo Ørjan Olsen 1914, Bibliothèque nationale de Norvège.
7
Campement d’été des Tožu, début XXe siècle. Musée national de la république de Touva,
n°1178.
Garçon tožu se rendant à l’école dans un village de sédentarisation, 1944. Musée national de
la république de Touva, n°435.
8
Au printemps 1949 furent formés à Tožu deux kolkhozes (« fermes collectives ») intitulés
« Premier Mai » et « Touva soviétique » (Vajnštejn 1961, 195). De nombreux éleveurs
réfractaires fuirent en Mongolie, de sorte que le cheptel de rennes en pays touva chuta de
8 000 en 1945 à 3 100 en 1950.
Lors d’une expédition en 1951, l’ethnologue russe S. Vajnštejn a rendu visite au campement
d’une toute jeune « brigade » kolkhozienne. Les rennes y étaient désormais considérés comme
une propriété collective, tandis que les humains se trouvaient intégrés à une hiérarchie de type
militaire. Le chef de la brigade expliquait ainsi les changements intervenus dans l’élevage :
« Autrefois, il n’y avait pas de berger pour les garder et de nombreux rennes mouraient du fait
des prédateurs. Trois ou quatre loups pouvaient tuer de nombreux rennes en un an (…).
Maintenant le troupeau est protégé jour et nuit par des bergers qui se relaient. Les loups vont
être furieux ! (…) Nous les castrons différemment, scientifiquement, nous les soignons d’une
façon nouvelle, avec des médicaments. Il y a un vétérinaire. Les troupeaux des campements
étaient petits, rarement une centaine de têtes, maintenant dans notre troupeau il y a plus de
500 rennes. » Mais le brigadier reconnaissait aussi les inconvénients de la nouvelle méthode :
« Pour être sincère, je ne sais pas encore si ce mode de pâturage est meilleur ou moins bon. Il
est plus difficile de changer en permanence de pâturage, or c’est indispensable. » (Vajnštejn
2009, 134). En effet des troupeaux plus nombreux épuisent plus rapidement les pâturages et
exigent donc plus de déplacements. On voit que c’est principalement la lutte contre les loups
qui motivait la nouvelle technique de gardiennage adoptée. La prévention sanitaire
n’intervenait pas à ce niveau car les maladies devaient désormais être traitées par voie
médicamenteuse sous la conduite d’un vétérinaire disposant d’une tente sur le campement.
La surveillance permanente des troupeaux sur pâturage, inspirée des élevages de toundra, fut
une expérience rapidement abandonnée. Dans les souvenirs des anciens sovkhoziens que j’ai
pu recueillir, les rennes paissaient le plus souvent sans surveillance comme avant la
collectivisation et n’étaient recherchés et réunis qu’en cas d’absence prolongée. En revanche
les effectifs des troupeaux restèrent très supérieurs à ceux de l’époque précédente. Dans les
années 1980, chaque brigade se divisait en trois ou quatre « maillons » (zveno) réunissant
chacun six ou sept familles responsables chacune d’un troupeau de 300-400 rennes. Le
troupeau soviétique moyen avait donc la taille des rares troupeaux d’éleveurs riches avant la
collectivisation. L’élevage obéissait à des objectifs planifiés de production de viande destinée
à la vente dans la ville de Krasnoïarsk. À chaque automne les éleveurs menaient les rennes à
l’abattoir, construit à proximité du village. Les itinéraires de nomadisation de chaque famille
étaient décidés tous les ans par la brigade, elle-même soumise à la direction du sovkhoze
située au village. Censés être sédentarisés, les éleveurs devaient fréquemment se rendre au
village dont toute leur activité dépendait. En 1969 les kolkhozes furent transformés en
sovkhozes, « fermes d’État », les rennes devenant propriété d’État et les éleveurs des
employés de l’État.
Cette densification des troupeaux doublée d’une fréquentation régulière des villages s’est
accompagnée d’importantes épidémies. Les anciens éleveurs confirment tous que les maladies
faisaient des ravages en raison de l’importance du cheptel. Oleg se souvient que le piétin
emportait 100 à 120 bêtes chaque année dans le massif d’Ödügen. Après avoir atteint un
maximum de 14 500 têtes en 1981, le cheptel touva retomba à 10 600 têtes en 1984, signe de
l’échec de la densification. Ce recul statistique est certainement l’effet des épidémies de piétin
dont les éleveurs gardent le souvenir3.
3 Les Tožu ayant fui en Mongolie pour échapper à la collectivisation ont, de leur côté, fait l’objet d’une politique
d’assimilation avec les pasteurs mongols, ce qui a entraîné la contamination de leurs rennes par l’anaplasmose, une maladie du mouton inconnue jusque-là chez le renne (Haigh et al. 2008; voir Jernsletten & Klokov 2002, 150).
9
Entre le risque interne du piétin et le risque externe des prédateurs et des fuites, c’est
clairement le second qui semble plus redouté par les organisateurs des kolkhozes et c’est pour
lui faire face que le gardiennage est repensé. L’« extermination des loups » (Zhigunov 1968,
314-325) est en URSS une tâche planifiée, réalisée principalement par le dépôt de grandes
quantité de poisons et par la chasse aérienne. Les éleveurs tožu n’ayant pas à s’en préoccuper
individuellement, on ne leur remettait qu’un fusil pour 6 ou 7 familles. D’après les éleveurs,
les dépôts de poison sont aujourd’hui interdits en raison des contaminations qu’ils
provoquaient dans l’ensemble de la chaîne alimentaire.
Les changements induits par la collectivisation ont été très profonds. Au-delà de la relation de
propriété sur le bétail, furent sapés les rapports personnels par lesquels chaque renne
connaissait son maître et chaque maître ses rennes, les uns et les autres partageant les tâches
du maintien de leur cohabitation. La collectivisation a redistribué non seulement le bétail,
mais aussi les compétences nécessaires à l’activité d’élevage. Réduits à un rôle de berger de
rennes devenus une marchandise, les éleveurs tožu ont été déplacés de leurs territoires de
naissance pour travailler dans d’autres régions qu’ils connaissaient peu, sur des itinéraires
qu’ils n’avaient pas choisis. Le soin des rennes malades est devenu une science appartenant au
vétérinaire. La chasse et la lutte contre les prédateurs ne relevaient plus des compétences des
éleveurs, privés de fusils. Les rennes, écartés de cette redistribution entre humains, passent du
rang d’agents à celui de produits. On constate d’ailleurs que, dans leurs ouvrages, les
théoriciens soviétiques de l’élevage ne prêtent aux rennes ni initiatives, ni intelligence, ni
capacité d’apprentissage, ils indiquent seulement des manières de susciter chez les animaux
des « réflexes conditionnés » d’obéissance à l’audition de cris humains (Borozdin et al. 1990,
138 ; Zhigunov 1968, 80).
En opérant cette réorganisation, les créateurs des sovkhozes à Touva s’efforçaient de faire
passer les Tožu d’un mode de subsistance centré sur la chasse montée à dos de renne à un
élevage pastoral spécialisé dans la production de viande. Ils appliquaient là un modèle conçu
en URSS dès les années 1920 pour les pasteurs nomades de la toundra. Afin de mieux
comprendre l’origine et les enjeux théoriques de ce modèle, il nous faut revenir brièvement
sur cette période déterminante pour les destinées de l’ensemble de l’élevage de rennes en Asie
du nord.
L’industrialisation soviétique : passer de l’élevage « naturel » à l’élevage « culturel »
A partir de 1925, le jeune État bolchévique prend en main la « rationalisation » de l’élevage
de rennes, marquant une rupture avec la politique laxiste antérieure qualifiée de « Laissez
faire, laissez passer » (Dmitriev 1925,105, en français dans le texte). À cette époque, les
théoriciens du changement considéraient en effet que, auparavant, « les Samoyèdes n’ont
jamais mené d’élevage de rennes si peu rationnel que ce soit ; ils ne traitaient pas cette activité
comme l’exige un calcul commercial correct, mais pratiquaient plutôt l’élevage de rennes
sous sa forme naturelle, dans une perspective ‘poético-quotidienne’. » (ibid. 106). Les grands
troupeaux samoyèdes (nénetses) étaient la proie d’épizooties de charbon (sibirskaja jazva) qui
pouvaient emporter jusqu’à 200 000 rennes. Une campagne coûteuse mais nécessaire
d’éradication des maladies permettrait, espéraient les spécialistes, d’envoyer les surplus vers
les villes pionnières et de nourrir ainsi « l’effort de colonisation des toundras du Nord » (ibid.
112). L’élevage ne pourrait devenir « commercial » (tovarnyj) qu’en s’« industrialisant » par
la construction d’abattoirs et de conserveries (ibid. 109). Ainsi s’accomplirait « la transition
d'un élevage de renne primitif et naturel à un élevage de renne culturel et industriel. »
(Grjuner 1926, 49).
10
Cette marche des rennes et de leurs éleveurs de la « nature » vers la « culture » s’est opérée
dans les faits par l’établissement d’un système de contrôle généralisé : à la fois garde jour et
nuit des troupeaux par des bergers, repérage par avion des bergers enregistrés dans des fermes
collectives, contrôle général de l’élevage par des zootechniciens et des vétérinaires et
surveillance des vétérinaires par le pouvoir politique4. La prise de contrôle commençait par le
rassemblement dans des fermes collectives des troupeaux et de leurs éleveurs habituellement
dispersés sur de grandes étendues dans la steppe ou la taïga. La collectivisation commencée
en 1929 suscita une vive résistance. Au total la Russie perdit au tournant des années 1930
700 000 rennes, en grande partie abattus par les éleveurs eux-mêmes (Jernsletten & Klokov
2002, 28). Afin d’améliorer la rentabilité des fermes collectives, on lança dans les années
1950 une campagne de « regroupement » (ukrupnenie). « Plus grands sont les troupeaux,
moins il y a de pertes non productives. » Chez les Nénetses, les kolkhozes furent activement
regroupés, leur nombre étant presque divisé par deux entre 1948 et 1960 (Stammler 2006,
142). Or cette politique connut d’abord des effets inverses à ceux attendus : bien que les
statistiques publiées à ce sujet soient évidemment rares, il apparaît clairement que la création
de très grands troupeaux favorisa une propagation incontrôlée de maladies, en particulier de
piétin. Alors que la lutte contre le charbon, l’une des justifications de la « rationalisation »,
avait été un succès, le piétin demeurait sans remède vétérinaire. Dans la région nationale
nénetse, l’une des plus riches en rennes, le nombre d’animaux tués par la maladie fut multiplié
par douze entre 1950 et 1955 (Rebrov 1962, 3). En 1956, le kolkhoze nénetse « XXIIe
Congrès du PC d’Union soviétique » perdit par le piétin autant de rennes qu’il en fournissait à
l’État pour abattage. Les élevages réorganisés selon les méthodes les plus modernes ne furent
pas épargnés, bien au contraire : un sovkhoze d’« avant-garde » chez les Nénetses du Yamal
perdit en 1956 entre 40 et 50% de ses rennes du fait du piétin, alors que les élevages
tchouktches ordinaires ont une perte annuelle avoisinant 10% (ibid.). De telles pertes
constituent une menace pour la survie même des troupeaux.
Malgré ces difficultés, les gros troupeaux restèrent le modèle donné à imiter par les
théoriciens. Même en région de taïga, comme chez les Tožu, on affirmait que la plus haute
productivité (calculée en jours de travail pour 100 kg de viande) était atteinte avec des
troupeaux de 1500-1800 rennes. Le modèle de gardiennage jugé le plus efficace, le « pâturage
contrôlé » (upravljaemyj vypas), se pratiquait sur des pâtures clôturées permettant d’éviter les
fuites de rennes et les attaques de prédateurs et d’augmenter la productivité du travail en
réduisant le nombre de bergers (Borozdin, et al. 1990, 139-140). Ce type d’élevage ne pouvait
être autonome car il nécessitait un approvisionnement des rennes en fourrage, enrichi
notamment en farines de poisson (ibid. 120). Or à la fin des années 1980, les vétérinaires
soviétiques constataient qu’un nombre excessif de rennes maintenus en enclos entraînait une
brutale augmentation des maladies et des pertes sévères (ibid., 140).
L’expérience des pâturages clôturés n’a pas été tentée à Touva, en revanche d’après les
souvenirs des éleveurs, il est arrivé lors des recensements du cheptel que l’on enferme les
rennes dans des étables. « Les rennes se frappaient la tête contre les murs. Ils devenaient
fous » se souviennent les éleveurs. Traumatisés par cette expérience, les cervidés ne
revenaient plus au campement après avoir été relâchés mais tendaient au contraire à fuir les
humains. Un excès de contrôle avait donc pour conséquence de rendre le troupeau
incontrôlable.
De façon très significative, les théoriciens soviétiques tendaient souvent à attribuer la
responsabilité des épidémies à une contamination des rennes domestiques par des rennes
4 Les exécutions de vétérinaires accusés de propagation d’épizooties ont été massives en URSS dans les années
1930 (Conquest 1995, 261).
11
sauvages et des prédateurs. Pourtant, comme le souligne D. Klein, ces soupçons n’ont guère
de fondement empirique car l’on sait au contraire que ce sont plutôt les rennes domestiques
qui contaminent les rennes sauvages (Klein 1980, 749-752 ; Jernsletten & Klokov 2002, 63).
Il n’en reste pas moins qu’afin d’éviter tout contact avec les rennes sauvages, on alla jusqu’à
recommander de clôturer les réserves naturelles où se trouvaient des populations de rennes
sauvages (Klein ibid., 754). Ainsi, ce que nous avons appelé menace interne était identifié par
les autorités sanitaires comme un effet secondaire d’une menace externe.
Outre le danger infectieux présumé, il est également clair que les échanges entre sauvages et
domestiques ne pouvaient apparaître que comme un frein à la transition d’un élevage
« primitif et naturel » à un élevage « culturel ». La politique gouvernementale visa ainsi à
l’élimination totale des rennes sauvages dans les régions fréquentées par les rennes
domestiques (Klein ibid.). On recommanda aux éleveurs d’éviter les unions entre rennes
sauvages et rennes domestiques, les faons croisés étant réputés incontrôlables (ibid.). Bref
toute une série de mesures devaient établir des frontières nettes et infranchissables à
l’intérieur de cette zone de confusion entre sauvage et domestique qu’est l’élevage de renne
traditionnel.
Alors qu’autrefois les risques liés à la consanguinité étaient évités naturellement grâce aux
unions avec les rennes sauvages, que les Tožu considéraient comme très bénéfiques (Olsen
1921, 90), les autorités organisèrent à l’époque soviétique la venue à Touva de reproducteurs
issus des troupeaux domestiques des Évenks de Iakoutie, mais leur acclimatation fut un échec.
De nos jours les avis sont partagés sur la possibilité de garder des faons issus du croisement
de domestiques et de sauvages. Un éleveur comme Oleg se réjouit de tels cas, car les « petits
de sauvages », quoique farouches, sont plus hauts sur pattes et plus vigoureux.
Conclusion
Les techniques de gardiennage soviétiques visaient à répondre à la menace externe des
attaques de prédateurs et des fuites plutôt qu’à la menace interne des maladies. Le souci
prioritaire de contrôler, de clôturer et d’éviter les contacts avec l’extérieur n’est pas fortuit. Il
est concomitant d’une politique de sédentarisation des éleveurs qui naguère traversaient
librement la frontière mongole. Et si l’on se souvient que l’invention de la surveillance
permanente des troupeaux à Touva en 1949 se produit au moment où l’URSS atteint le
maximum de sa population concentrationnaire avec deux millions et demi de détenus (Werth
1993), on devine qu’il a pu exister en contexte totalitaire un rapport étroit et insoupçonné
entre « domestication des animaux » et « traitement d’autrui », pour reprendre les termes de
Haudricourt (1962).
Les autorités soviétiques sont parvenues à éradiquer les épidémies dévastatrices de charbon et
à mettre les loups provisoirement hors d’état de nuire. Mais ces victoires n’ont été possibles
que par l’édification d’un vaste système d’interdépendances et de contrôle au sein duquel les
éleveurs ont été privés de leur autonomie et de la possibilité d’un rapport personnel aux
animaux. Gestion du croît et des pâtures, défense contre les prédateurs, connaissances
botaniques, zoologiques, climatiques et topographiques, capacités d’analyse et de prise de
décision, toutes ces compétences nécessaires à la préservation des troupeaux ont été réparties
entre divers spécialistes dans un souci de performance. Une cognition distribuée en a évacué
une autre : le partage des compétences entre humains et animaux a fait place à une division du
travail entre humains assistés par diverses technologies : écoles agricoles, livres, cartes
satellitaires, médicaments, hélicoptères, radios. Chez les Tožu, ces technologies ont
aujourd’hui disparu et lorsque le bétail d’État a été privatisé et distribué aux membres des
sovkhozes, la plupart d’entre eux étaient incapables de s’en occuper eux-mêmes. Ainsi
12
s’explique la disparition de 90% des rennes : vendus, mangés par leurs nouveaux maîtres,
emportés par les loups, les rennes sauvages et les maladies (voir Donahoe 2004). Les rares
éleveurs qui parvinrent à maintenir un élevage viable, épargné par les maladies comme par les
prédateurs, sont ceux qui ont su se détacher de l’emprise des villages et créer un équilibre
souple associant intimement leurs compétences cognitives environnementales à celles de leurs
rennes.
Borozdin, E.K. , Vagin, A.S. et Zadrobin V.A. 1990 Severnoe olenevodstvo, Leningrad, Agropromizdat. Carruthers, D. 1914 Unknown Mongolia. A record of travel and exploration in North-West Mongolia and Dzungaria, T.1, London, Hutchinson & Co. Conquest, R. 1995 La Grande Terreur, les purges staliniennes des années 30. Précédé de Sanglantes moissons, la collectivisation des terres en URSS, Trad. M.-A. Revellat & C. Seban, Paris, R. Laffont (Bouquins). Dmitriev, D. 1925 « Severnoe olenevodstvo i ego èkonomika », Severnaja Azija, 5-6 : 105-114. Donahoe, B. 2004 A line in the Sayans: history and divergent perceptions of property among the Tozhu and Tofa of South Siberia, Indiana University, Thèse de doctorat. Dwyer, M. J. et Istomin, K. V. 2008 « Theories of nomadic movement: A new theoretical approach for understanding the movement decisions of Nenets and Komi reindeer herders », Human Ecology, 36 (4) : 521-533. Grjuner, S.A. 1926 « K voprosu o statistike olenevodstva », Severnaja Azija, 4 : 44-60. Haigh, J. C., Gerwing, V., Erdenebaatar, J. et Hill, J. E. 2008 « A novel clinical syndrome and detection of Anaplasma ovis in Mongolian reindeer (Rangifer tarandus) ». Journal of Wildlife Diseases, 44 (3) : 569-577. Handeland, K., Boye, M., Bergsjo, B., Bondal, H., Isaksen, K. etAgerholm, J. S. 2010 « Digital necrobacillosis in Norwegian wild tundra reindeer (Rangifer tarandus tarandus) », Journal of Comparative Pathology, 143 (1) : 29-38. Haudricourt, A. 1962 « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d'autrui », L'Homme, 2 (1) : 40-50. Ingold, T.
13
1986 « Reindeer economies and the origins of pastoralism », Anthropology Today 2(4) : 5-10. Jernsletten, J.-L. et Klokov, K. 2002 Sustainable Reindeer Husbandry, Tromsø, Centre for Saami Studies. Klein, D. R. 1980 « Conflicts between domestic reindeer and their wild counterparts: a review of Eurasian and North Americain experience », Arctic, 4 : 739-756. Kyzlasov, L. R. 1952 « Drevnejšee svidetel'stvo ob olenevodstve », Sovetskaja ètnografija, 2. Lavrillier, A. 2005 Nomadisme et adaptations sédentaires chez les Evenks de Sibérie postsoviétique : « Jouer » pour vivre avec et sans chamanes. Thèse de doctorat, Ecole Pratique des Hautes Etudes. Olsen, Ø.M. 1921 Los Soyotos: un pueblo primitivo, nomades mongoles pastores de renos, Trad. E. M. Nilsen, Madrid, Calpe. Petri, B. È. 1927 Olenevodstvo u karagas, Irkoustk, Vlast’ truda. Rebrov, P.I. 1962 Nekrobacillez severnyh olenej i bor'ba s nim, Magadan, Magadanskoe knižnoe izdatel'stvo. Stammler, Fl. 2006 When reindeer nomads meet the market : culture, property and globalisation at the end of the land, Münster, Lit. Stépanoff, Ch. 2011 « Saillances et essences. Le traitement cognitif de la singularité chez les éleveurs de rennes tožu (Sibérie méridionale) », L'Homme, 200 : 175-202. Vainshtein, S. 1980 Nomads of South Siberia : the pastoral economies of Tuva, Cambridge, Cambridge Univ. Press. Vajnštejn, S. I. 1961 Tuvincy-Todžincy, Moscou, Izd. vost. lit. 2009 Zagadočnaja Tuva, Moscou, Domašnaja gazeta. Werth, N. 1993 « Goulag, les vrais chiffres », L'Histoire, 169 : 38-51.























![[“Questions about Wolves. Fantasy and Reality”], Le Loup en questions. Fantasme et réalité, Paris, ed. Buchet-Chastel, 128 p., May 2015 - ISBN 978-2-283-02791-2](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332a5194e0143040300c4ad/questions-about-wolves-fantasy-and-reality-le-loup-en-questions-fantasme.jpg)