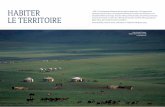Questions du Szélétien supérieur en Moravie. Praehistoria 9-10, (2008-2009), 61-70. Miskolc 2012
Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni (Hauterivien supérieur) dans le domaine...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni (Hauterivien supérieur) dans le domaine...
ISSN 0253-6730
1 Département de Géologie Sédimentaire et CNRS-FR 32, Université Pierre et Marie Curie, case 117, 4 place Jussieu, F-75252 Paris cedex 05, France. E-mail : [email protected]
2 Département des Sciences de la Terre, Université de Lyon, 27-43 bd du 11 Novembre, F-69622 Villeurbanne Cedex, France
3 Département de Géologie et Paléontologie, Université de Genève, 13 rue des Maraîchers, CH-1211 Genève & Muséum dʼHistoire naturelle de la Ville de Genève, 1 route de Malagnou, CH-1211 Genève 6, Suisse
Revue de Paléobiologie, Genève (décembre 2006) 25 (2) : 525-535
Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni (Hauterivien supérieur)dans le domaine ultrahelvétique
François BAUDIN1, Robert BUSNARDO2, Catherine BELTRAN1, Marc de RAFELIS1,Maurice RENARD1, Jean CHAROLLAIS3 & Bernard CLAVEL2
RésuméUn équivalent du Niveau Faraoni, originellement défini dans le bassin dʼOmbrie-Marches (Italie centrale) comme un niveau repère régional fini-Hauterivien, puis retrouvé dans les Alpes italiennes, le bassin du Sud-Est de la France et le bassin subbétique en Espagne est très probablement reconnu dans la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis (Ultrahelvétique des Préalpes externes, canton de Fribourg, Suisse) et dans des lentilles du wildflysch des Voirons (Préalpes chablaisiennes, Haute-Savoie, France). Les arguments fournis par la géochimie et lʼanalyse séquentielle, et dans une moindre mesure, les indices paléontologiques de ce probable niveau Faraoni sont très similaires à ceux des autres bassins, même si certaines différences dans son expression lithologique sont patentes. Ce nouveau jalon permet dʼétendre lʼexpression de lʼévénement anoxique Faraoni à un domaine paléogéographique intermédiaire entre les bassins dʼOmbrie-Marches et vocontien.
Mots-clés Préalpes externes, Crétacé inférieur, Ammonites, Matière organique, δ13C, Eléments traces, Evénement anoxique.
AbstractRecord of the Faraoni Anoxic Event (Late Hauterivian) in the Ultrahelvetic domain.- An equivalent of the Faraoni Level, originally described in the Umbria-Marche Basin (central Italy) as an upper Hauterivian regional marker-bed and then identified in southern Alps (Italy), Vocontian Basin (SE France) and Subbetic Basin (Spain), is probably recognised in the Ultrahelvetic domain along the Veveyse de Châtel-Saint-Denis section (external Prealps, Switzerland), as well as in lenses of the wildflysch from the Voirons (external Prealps, France). Paleontological and geochemical characteristics of this level are very similar compared to those of the Faraoni Level in other basins, although some differences are noted in its lithological expression. This new site allows to extend the distribution of the Late Hauterivian anoxic event in an intermediate paleogeographic domain between the Umbria-Marche and the Vocontian Basins.
Key wordsPrealps, Early Cretaceous, Ammonites, Organic matter, δ13C, Trace elements, Anoxic Event.
I. INTRODUCTION
Un intervalle fini-Hauterivien riche en Corg a été identi-fié il y a une dizaine dʼannées dans la Formation Maio-lica des Apennins dʼOmbrie-Marches en Italie centrale (CECCA et al., 1994 ; COCCIONI et al., 1998 ; BAUDIN et al., 2002a). Ce niveau repère, appelé Niveau Faraoni, est constitué dʼune alternance de black shales et de calcaires (dénommés bancs A à G), dʼune épaisseur totale variant entre 25 et 40 cm. L̓ un des bancs calcaires (banc D ou guide-bed) est caractérisé par une faune dʼammonite, riche et diversifiée, permettant dʼattribuer un âge Haute-rivien terminal à ce niveau (zone à Angulicostata auct. ; CECCA et al., 1994, 1998).
Des équivalents du Niveau Faraoni, présentant les mêmes caractéristiques lithologiques et paléontologiques, ont ensuite été décrits dans les Alpes italiennes (CECCA et al., 1996 ; FARAONI et al., 1997 ; BAUDIN et al., 1998 ; BERZÉ-SIO et al., 2002) et dans le bassin vocontien du Sud-Est de la France (BAUDIN et al., 1999). Plus récemment BAUDIN et al. (2002b) et COMPANY et al. (2003a, 2003b) ont mon-tré que le Niveau Faraoni était également présent dans le domaine subbétique dans le sud de lʼEspagne, alors que BELLANCA et al. (2002) suspectent son enregistrement en Sicile.La vaste répartition du Niveau Faraoni dans la Téthys méditerranéenne et lʼenrichissement en Corg qui lʼaccom-pagne ont incité certains auteurs (BAUDIN et al., 1999 ;
BAUDIN, 2002) à lʼinterpréter comme la signature dʼun événement anoxique de courte durée.Une récente révision (BUSNARDO et al., 2003) de la série crétacée inférieure de la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis (canton de Fribourg, Suisse) a permis de reconnaître dans le domaine ultrahelvétique un niveau comparable au Niveau Faraoni. L̓ objet de cette note est de : (1) compléter les données publiées par BUSNARDO et al. (2003) pour ce qui concerne ce niveau en parti-culier, (2) dʼen décrire les caractéristiques lithologiques, faunistiques et géochimiques et (3) de le comparer à ses homologues téthysiens pour en souligner les similitudes et différences.
II. CADRE GÉOLOGIQUE ET PALÉOGÉOGRA-PHIQUE
Le cours de la Veveyse, rivière torrentueuse prenant sa source dans les « Préalpes médianes » et se jetant dans le Lac Léman à Vevey, recoupe en amont de Châtel-Saint-Denis un chaînon principalement calcaire appartenant à la « nappe des Préalpes externes » romandes (Fig. 1a). Cette nappe est rattachée classiquement au domaine paléogéo-graphique de lʼUltrahelvétique (WEIDMANN et al., 1993). L̓ encaissement de la Veveyse dans ces terrains expose un
excellent profil à travers les couches isoclinales du Juras-sique supérieur et du Crétacé inférieur, qui fut décrit dès 1834 (voir BUSNARDO et al., 2003 pour lʼhistorique des recherches sur cette coupe).Les alternances marno-calcaires du Crétacé inférieur y sont particulièrement bien exposées. Elles ont fait lʼobjet dʼune étude lithologique et paléontologique sur plusieurs années dont les résultats synthétiques ont été publiés récemment (BUSNARDO et al., 2003). La partie sommitale de ces alternances, qui couvre lʼintervalle Hauterivien supérieur à Barrémien basal (zones à Cassida et Hugii), est appelée « Alternances supérieures de marnes et calcai-res tachetés » (CHAROLLAIS et al., 1981, 1993). Ces alter-nances sont visibles, tour à tour en rive droite ou gauche de la Veveyse, le long des affleurements B, C et D décrits en détail par BUSNARDO et al. (2003).Pour ce travail, nous avons échantillonné systématique-ment tous les bancs et interbancs compris entre les cotes 70 et 84 m de lʼaffleurement D (Fig. 1b et 2) ; ce qui cor-respond à lʼintervalle entre les bancs 90 et 93 de la coupe de BUSNARDO et al. (2003). Vingt-trois échantillons de calcaires et 21 de marnes (notées avec le numéro du banc sous-jacent suivi dʼun ʻmʼ) ont été prélevés à lʼautomne 2002. Cette succession dʼune quinzaine de mètres de puissance est entièrement comprise au sein de la zone à Angulicostata auct. (Fig. 2).
Fig. 1 : a. Carte géologique simplifiée des Alpes autour du Lac Léman et localisation des affleurements étudiés (dʼaprès BUSNARDO et al., 2003).
b. Localisation de lʼintervalle étudié au sein des ʻAlternances supérieures de marnes et calcaires tachetés ̓(en gras le long du profil D) en rive droite de la Veveyse (dʼaprès BUSNARDO et al., 2003).
Fig. 1 : a. Simplified map of the Alps around the Geneva Lake and location of studied outcrops (after BUSNARDO et al., 2003). b. Location of the studied interval within the ̒ Alternances supérieures de marnes et calcaires tachetés ̓(in bold along the profile
D) in right side of the Veveyse river (after BUSNARDO et al., 2003).
526 F. BAUDIN et al.
84 80 75 70 m
93 92-9
m
92-9
92-8
m
92-8
92-7
m92
-792
-692
-5
92-4
m92
-492
-3m
92-3
92-2
b92
-2am
92-2
a92
-1m
a92
-192
-m92 91
-3
91-2
91-1
91-1
m
91-1
m
91 90-6
m90
-690
-5m
90-5
90-4
m
90-4
90-3
m
90-3
90-2
m90
-290
-1bm
90-1
b90
-1am
90-1
a90
m90
top
mid
dle
base
3040
5060%
mg
HC
/g C
OT
ppm
ppm
7080
90
2000
6000
1000
0
800
900
1000
1100
1200
1300 12
016
020
024
01000
2000
3000
4000
1,6
%pp
mpp
m0,
80
100
300
500 1
1,2
1,4
1,6
-2,8
-2,4
-2-1
,6
CaC
O3
δ13 C
δ18 O
CO
T
IH
Mg
Sr
Mn
Fe
Fig.
2 :
Succ
essi
on li
thol
ogiq
ue d
e lʼi
nter
valle
étu
dié
et é
volu
tion
des
para
mèt
res
géoc
him
ique
s or
gani
ques
et i
norg
aniq
ues.
La z
one
en g
risé
indi
que
lʼint
erva
lle c
ritiq
ue a
u co
urs
duqu
el
lʼévé
nem
ent F
arao
ni a
dû
sʼex
prim
er.
Fig.
2 :
Lith
olog
ical
succ
essi
on o
f the
stud
ied
inte
rval
and
verti
cal c
hang
es o
f sel
ecte
d in
orga
nic a
nd o
rgan
ic p
aram
eter
s. Th
e gre
y zo
ne in
dica
tes t
he cr
itica
l int
erva
l dur
ing
whi
ch th
e Far
aoni
ev
ent s
houl
d be
exp
ress
ed.
527Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni dans le domaine ultrahelvétique
III. DESCRIPTION DE LʼINTERVALLE ÉTUDIÉ
Cet ensemble est constitué dʼalternances de bancs calcai-res (~ 80 % CaCO3 en moyenne) bioturbés, très légère-ment quartzeux (1 à 3 %), dʼépaisseur décimétrique à plu-ridécimétrique et dʼinterbancs marneux (~ 50 % CaCO3 en moyenne) schistoïdes, souvent un peu plus puissants que les bancs. La pyrite est abondante, tant dans les mar-nes que dans les calcaires. Les radiolaires et les spicules de spongiaires sont assez fréquents, voire abondants par endroit, alors que les foraminifères benthiques sont tou-jours très rares. Dans cet ensemble dʼapparence mono-tone, quelques niveaux remarquables méritent un rappel de leur description par BUSNARDO et al. (2003).A la base de notre coupe, un niveau de marnes schistoïdes de 38 cm dʼépaisseur (interbanc 90-2 m) renferme sur ses 2 cm sommitaux un faciès gréso-glauconieux (30 % de quartz, 25 % de glauconie) et légèrement phosphaté (2 %), dʼorigine probablement turbiditique. Dʼautres épisodes détritiques, moins riches en quartz (10 %), sont observés dans la partie supérieure de notre coupe, notamment dans une biomicrite argileuse correspondant au banc 92-7.Mais le niveau le plus remarquable est la « couche à pois-sons » (niveau 92-2, Fig. 2), de 50 à 60 cm dʼépaisseur, qui livre de nombreuses ammonites, des débris osseux, des écailles isolées et de rares poissons plus ou moins entiers. Quelques-uns dʼentre eux, conservés dans les musées de Genève, Lausanne, Fribourg et Berne, furent déterminés par F.-J. PICTET, et sont cités par FAVRE & SCHARDT (1887). Le faciès, très carbonaté (biomicrite de type wackestone) à la base de la « couche à poissons » est beaucoup plus argileux au sommet (marne schistoïde) et se débite aisément en lamines millimétriques. Il renferme peu de quartz détritique (maximum 2 %) ainsi que des oxydes et hydroxydes de fer provenant de lʼaltération de la pyrite. Les radiolaires et les spicules de spongiaires y sont fréquents.Quelques mètres sous la « couche à poissons », le banc 91-3 et lʼintervalle marneux sous-jacent (91-2 m) pré-sentent un faciès argileux laminé très semblable à celui de la « couche à poissons ». Les ammonites et les débris de poissons que ces niveaux livrent sont également très nombreux. Enfin, le banc 92-4 paraît plus marneux (51 % CaCO3) et fissile que les autres bancs de la coupe.
IV. RÉSULTATS ANALYTIQUES ET INTERPRÉ-TATIONS
IV.1. Matière organique
Tous les échantillons des interbancs marneux et quelques bancs particuliers (91-3 et 92-4) ont été analysés par pyrolyse Rock-Eval selon la méthode décrite par ESPITA-LIÉ et al. (1985-86). Les données analytiques sont repor-tées dans le Tableau 1.Bien quʼappartenant à la nappe des Préalpes externes, la
série du Crétacé inférieur de la coupe de la Veveyse nʼa pas subi de diagenèse thermique très poussée, ce qui est en accord avec les données de KÜBLER et al. (1979, fig. 4). En effet, les valeurs de Tmax atteignent au maximum 438°C (moyenne 435°C), ce qui situe cette série au début de la fenêtre à huile pour les géologues pétroliers. Cette relative immaturité autorise à considérer les paramètres organiques fournis par la pyrolyse Rock-Eval comme reflétant les conditions originelles de la sédimentation à lʼissue de diagenèse précoce.Les teneurs en carbone organique total (COT) sont com-prises entre 0,1 et 0,4 % (avec une moyenne de 0,27 %) dans la plupart des interbancs marneux. Quelques bancs ou interbancs (90-2 m, 90-3, 91-1 m, 91-2 m, 91-3, 92-1 m, 92-3 m et 92-4) ressortent de ce bruit de fond par leur teneur supérieure à 0,5 %, dépassant même 1 % (Tab. 1, Fig. 2). Curieusement, le niveau 92-2 nʼapparaît pas comme particulièrement plus riche en matière organique que les autres.Les valeurs de lʼindex dʼhydrogène varient entre 160 et 461 mg HC/g COT ; les plus fortes valeurs correspondant aux intervalles laminés 91-2 m, 91-3 et au niveau plus argileux 92-3 m et 92-4. Ces valeurs suggèrent que la matière organique contenue dans les marnes correspond principalement à un résidu organique altéré, alors que les niveaux les plus riches en carbone organique contiennent une matière organique phytoplanctonique mieux préser-vée (Fig. 3). Plusieurs facteurs influencent la préservation de la matière organique phytoplanctonique dans les sédiments marins, mais les conditions dʼhyperproductivité et dʼoxy-génation sur le fond sont reconnues pour être parmi les plus importantes (BAUDIN, 1999). Il est très vraisemblable que les eaux de fond du domaine ultrahelvétique étaient déficitaires en oxygène pendant le dépôt des « couches à poissons » et des quelques mètres qui lʼencadrent, depuis lʼinterbanc 91-1 m jusquʼau banc 92-4. Enfin, le lecteur pourra se rapporter au travail de POURTOY (1989), dont un des chapitres porte sur la préservation des kystes de dino-flagellés observés dans le Crétacé inférieur de la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis.
IV. 2. Isotopes stable du carbone et de lʼoxygène
Les dosages du rapport isotopique du carbone δ13C et de lʼoxygène δ18O ont été effectués à lʼaide dʼun spectro-mètre de masse de type SIRA 9/VG 602 sur le carbonate total (ʻbulkʼ) de 20 bancs calcaires de la coupe. Les don-nées (erreurs maximales ±0,05‰) sont reportées dans le Tableau 1 et lʼévolution verticale du δ13C et du δ18O en regard de notre coupe est présentée sur la Figure 2.La courbe dʼévolution du rapport isotopique du carbone débute (bancs 90 à 91-2) par des rapports plutôt constants dʼune valeur moyenne de 1,23 ‰. A partir du banc 91-3m (1,16 ‰), le δ13C augmente presque régulièrement jus-quʼau sommet de la coupe (banc 93, 1,41 ‰).
528 F. BAUDIN et al.
Tableau 1 : Résultats des analyses géochimiques sur les échantillons de la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis : teneurs en carbonates, paramètres Rock-Eval, concentrations en éléments traces et rapport isotopique du car-bone et de lʼoxygène de la fraction carbonatée.
Table 1 : Geochemical results on the selected samples from the Veveyse de Châtel-Saint-Denis section : carbonate con-tent, Rock-Eval pyrolysis data, trace elements content and carbon and oxygen isotopic ratios of the carbonate fraction.
Echantillon CaCO3 COT Tmax S2 IH Mg Sr Mn Fe δ13C δ18O% % °C mg/g mg HC/g
COT ppm ppm ppm ppm‰ ‰
93 82.4 3ʼ347 1ʼ237 176 1ʼ696 1.41 -2.2692-9m 41.2 0.27 437 0.60 222 8ʼ290 1ʼ051 216 2ʼ69492-9 81.0 3ʼ695 1ʼ226 179 2ʼ11092-8m 55.9 0.25 438 0.47 188 5ʼ525 966 195 2ʼ28892-8 78.9 3ʼ315 1ʼ158 176 2ʼ559 1.32 -3.0492-7m 44.0 0.28 437 0.45 161 9ʼ087 933 168 2ʼ31292-7 81.6 3ʼ504 1ʼ097 155 1ʼ73792-6 41.0 0.25 438 0.49 196 10ʼ304 1ʼ013 174 2ʼ62792-5 77.0 3ʼ458 1ʼ060 158 1ʼ790 1.41 -2.5492-4m 57.2 0.20 437 0.32 160 5ʼ940 1ʼ017 170 1ʼ90292-4 50.8 1.45 434 6.68 461 4ʼ419 1ʼ171 193 2ʼ831 1.33 -3.1092-3m 47.0 1.31 434 5.30 405 8ʼ779 962 154 3ʼ28992-3 79.5 3ʼ818 1ʼ110 159 1ʼ901 1.42 -2.5392-2b 80.7 3ʼ720 1ʼ101 147 1ʼ821 1.34 -2.4892-2am 65.3 0.25 437 0.55 220 6ʼ570 1ʼ027 170 2ʼ63692-2a 79.6 3ʼ846 1ʼ111 142 1ʼ762 1.33 -2.5292-1m 50.8 0.60 432 2.28 380 6ʼ705 1ʼ122 130 2ʼ05392-1 69.0 4ʼ473 1ʼ121 152 2ʼ540 1.22 -2.7792m 58.7 0.37 435 1.27 343 5ʼ471 1ʼ146 123 2ʼ65192 86.8 3ʼ604 1ʼ180 129 1ʼ179 1.24 -1.8491-3 top 49.7 0.29 434 0.65 224 12ʼ497 1ʼ154 161 3ʼ93891-3 middle 81.7 0.49 434 2.22 453 3ʼ226 1ʼ197 141 1ʼ425 1.16 -2.4591-3 base 50.0 1.26 433 5.62 446 3ʼ819 1ʼ207 160 1ʼ98091-2 80.9 2ʼ905 1ʼ077 171 1ʼ327 1.26 -2.0091-1m 37.0 0.76 434 2.45 322 6ʼ415 873 153 1ʼ79691-1 79.1 3ʼ099 1ʼ135 195 1ʼ557 1.26 -2.2491m 57.7 0.19 434 0.27 142 4ʼ124 1ʼ098 216 1ʼ83791 81.5 3ʼ086 1ʼ105 167 1ʼ820 1.28 -2.2390-6m 50.2 0.22 433 0.36 164 5ʼ165 977 158 2ʼ06690-6 77.1 3ʼ172 1ʼ035 160 2ʼ160 1.27 -2.5890-5m 61.4 0.27 438 0.52 193 4ʼ874 1ʼ038 162 2ʼ03990-5 79.3 2ʼ805 1ʼ099 159 1ʼ918 1.24 -2.6490-4m 41.1 0.44 436 0.94 214 4ʼ489 868 158 1ʼ85790-4 80.9 2ʼ753 1ʼ144 179 1ʼ881 1.19 -2.5390-3m 42.6 0.49 436 1.08 220 4ʼ255 851 167 1ʼ78490-3 80.5 2ʼ654 1ʼ037 203 1ʼ660 1.22 -2.2690-2m 37.5 0.73 435 2.10 288 4ʼ261 843 153 1ʼ92490-2 81.5 2ʼ871 1ʼ138 204 1ʼ692 1.26 -2.3390-1bm 53.2 0.20 435 0.40 200 4ʼ486 1ʼ038 232 2ʼ21390-1b 78.4 3ʼ107 1ʼ109 194 1ʼ872 1.24 -2.5390-1am 55.9 0.11 433 0.17 155 4ʼ888 1ʼ109 217 2ʼ63590-1a 73.4 3ʼ189 985 197 2ʼ28690m 40.8 0.33 435 0.60 182 5ʼ497 995 177 2ʼ70490 76.1 3ʼ382 1ʼ155 179 1ʼ951 1.21 -2.28
529Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni dans le domaine ultrahelvétique
Les rapports isotopiques de lʼoxygène sont, pour la base de la coupe de la Veveyse (bancs 90 à 91-2), similaires à ceux du carbone cʼest-à-dire peu variables (moyenne -2,36‰). A partir du banc 91-3m, le δ18O décroît jusquʼà -3,04‰ au niveau du banc 92-8 avec des fluctuations de plus grande amplitude. Le sommet de la coupe (banc 93) est caractérisé par un augmentation du rapport isotopique de lʼoxygène (-2,26‰).
IV.3. Eléments traces
Les teneurs en éléments traces (Mg, Sr, Mn et Fe) dans les carbonates des bancs calcaires et des interbancs mar-neux ont été déterminées par spectrométrie dʼabsorption
atomique par flamme sur un appareil HITACHI Z-8100, selon la méthode décrite par RICHEBOIS (1990). Les don-nées sont reportées dans le Tableau 1 et les variations verticales des teneurs en ces quatre éléments le long de notre coupe sont illustrées sur la Figure 2.Les teneurs en Mg des carbonates fluctuent de 2650 ppm à plus de 12500 ppm, la concentration moyenne pour lʼintervalle étudié étant de 4750 ppm. L̓ évolution à long terme des concentrations ne montrent pas de tendance particulière. Seules des fluctuations à haute fréquence liées aux variations lithologiques sont observables, avec des teneurs systématiquement plus fortes dans les niveaux marneux que dans les bancs calcaires (2654 à 4473 ppm pour les calcaires et 3819 à 12497 ppm pour les marnes ; Fig. 2). Les teneurs en Mg les plus fortes mesurées dans les bancs marneux 91-3top, 92-3m, 92-6, 92-7m et 92-9m (respectivement 12497, 8779, 10304, 9087 et 8290 ppm) indiquent probablement la présence de dolomie (voir dʼankérite pour lʼéchantillon 91-3top, 3938 ppm de Fe).Les concentrations en Sr des carbonates fluctuent entre 843 et 1237 ppm ; la tendance générale est très légère-ment à lʼaugmentation, les teneurs les plus élevées se trouvant dans la moitié supérieure de la coupe. De la base de la coupe à lʼéchantillon 91-2 ainsi que de lʼéchantillon 92-3m au sommet de la coupe, la courbe dʼévolution des teneurs en Sr montre, comme pour le Mg, des fluctuations à haute fréquence associées aux variations lithologiques mais avec des teneurs en Sr supérieures dans les bancs calcaires que dans les niveaux marneux. L̓ intervalle compris entre les échantillons 91-3base et 92-3, présente en revanche des teneurs en Sr peu fluctuantes, indépen-dantes de la lithologie et légèrement décroissantes (1207 à 1110 ppm).Les teneurs en Mn sont plutôt faibles (123 à 232 ppm) et les fluctuations clairement indépendantes de la lithologie. Le long de la coupe de la Veveyse, deux ensembles peu-vent être identifiés avec une partie basale où les teneurs sont progressivement décroissantes surmontée dʼune augmentation des concentrations sur la partie haute de la coupe. L̓ inversion de tendance se situe au niveau du banc 92m. La courbe dʼévolution des teneurs en Fe (1179 à 3938 ppm) présente deux ensembles distincts. Un premier allant de la base de la coupe au banc 91-3m où les teneurs sont peu fluctuantes et décroissantes (1951 à 1425 ppm) et un second (banc 91-3m au sommet de la coupe) cor-respondant à des teneurs plus fortes et des fluctuations de fortes amplitudes.
Ces résultats montrent que, mis à part pour le Mg dont les variations semblent totalement dépendantes des con-trastes lithologiques, lʼintervalle 91-1m à 92-4 (caracté-ristique dʼune période déficitaire en oxygène) est le siège de modifications dans lʼenregistrement géochimique : teneurs en Sr constantes entre les bancs 91-3 et 92-3, inversion de tendances dans lʼévolution des teneurs en
Fig. 3 : Localisation des échantillons de la « couche à pois-sons » (très probable équivalent du Niveau Faraoni) des Préalpes externes (coupe de la Veveyse et affleurement des Voirons) dans un diagramme présentant leur index dʼhydrogène (IH) en fonction de leur teneur en carbone organique total (COT). Les plages en pointillés indi-quent les caractéristiques du Niveau Faraoni des autres bassins où son occurrence est avérée.
Fig. 3 : Location of the samples from the Faraoni Level of the external Prealps (Veveyse section and Voirons outcrop) in a diagram showing their hydrogen index (IH) values according to their organic content (COT). Doted areas indicate the characteristics of the Faraoni Level from other basins where its record is clearly established.
0
100
200
300
400
500
600
Indexd’hydrogène(mgHC/gCOT)
Bassind’Ombrie-Marches
Alpesméridionales
Bassin vocontien
Bassin subbétique
Type II
% COT
0 5 10 15 20 25 30
700
Veveyse
Voirons
530 F. BAUDIN et al.
Mn au niveau du banc 92m, modifications dans lʼampli-tude des fluctuations des teneurs en Fe à partir du banc 91-3, augmentation du δ13C et diminution du δ18O à partir du niveau 91-2.Néanmoins, le déficit en oxygène semble restreint puisque (i) le δ13C des carbonates nʼenregistre pas de conditions particulièrement réductrices, (ii) les courbes dʼévolutions des teneurs en fer et en manganèse ne présentent pas de fortes concentrations caractéristiques de la réduction des oxy-hydroxydes potentiellement observées dans ce type dʼenvironnement.
V. CONTENU ORGANIQUE DE LA « COUCHE À POISSONS » DES VOIRONS
Un niveau à poissons contemporain de celui de la coupe de la Veveyse a été signalé par FAVRE (1849) au lieu-dit les Hivernages (aujourdʼhui Hivernanches) sur le flanc occidental du massif des Voirons (Fig. 1a). Ce gisement, étudié par PICTET (1858) et PICTET & DE LORIOL (1858) a livré de nombreux céphalopodes et plusieurs espèces de poissons, dont un spécimen de Spatodactylus neoco-miensis de 73 cm de long exposé au Muséum dʼhistoire naturelle de la Ville de Genève.Les coupes de la région des Voirons ne sont malheureuse-ment pas continues ; la série crétacée inférieure affleurant sous forme de lentilles dans un wildflysch. Cependant la révision des ammonites conservées dans différents musées et de nouvelles récoltes dans les Voirons mon-trent que le niveau à poissons, là aussi, correspond à la zone à Angulicostata auct. (BUSNARDO et al., 2003).Deux échantillons de marnes grises ont été prélevés à quelques centimètres des poissons décrits par PICTET (1858) et aujourdʼhui exposés au Muséum de Genève (n° dʼinventaire 1894). Leur teneur en carbone organique varie entre 1 et 1,5 % pour un index dʼhydrogène compris entre 567 et 675 mg HC/g COT. La « couche à poissons » des Voirons renferme donc une matière organique phy-toplanctonique dont les conditions de préservation sont encore meilleures que dans la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis.
VI. COMPARAISON DES FAUNES DʼAMMONITES DES APENNINS (ITALIE) ET DU DOMAINE ULTRAHELVÉTIQUE
Grâce à lʼétude remarquable de CECCA et al. (1998) tant par les descriptions dʼammonites que par leur dénombre-ment et lʼiconographie, il est possible de comparer les compositions relatives des grands groupes dʼammonites des gisements des Apennins avec ceux du domaine ultra-helvétique. Ces comparaisons restent cependant quelque peu grossières car fondées sur les assemblages dissem-blables suivants.
VI.1. Faune du « Niveau Faraoni » des Apennins
Elle est extraite dʼun seul banc calcaire de faible épais-seur (banc D ou guide-bed dʼune épaisseur de 18 à 20 cm) provenant de plusieurs coupes dans les Apennins et se compose de près de 450 ammonites. Il nʼest fait men-tion que de rares ammonites issues des bancs encadrant le Niveau Faraoni, à savoir :- un Crioceratites gr. duvali associé à un Plesiospiti-
discus, provenant des bancs 264-266 de la coupe de Gorgo à Cerbara (CECCA et al., 1995) et daté selon les auteurs de lʼhorizon à Ligatus ou de la zone à Balea-rites, à environ 5 m sous le Niveau à Faraoni (banc 246) ;
- un Spitidiscus (= Taveraidiscus) récolté dans les bancs 198-200, à quelques 10 m au-dessus du Niveau Faraoni. La limite Hauterivien-Barrémien reste imprécise mais elle se situe en-dessous du banc 200.
Dans cette coupe de Gorgo à Cerbara, ainsi que dans les autres coupes des Apennins, nous ne disposons pas, pour le moment, dʼune aussi riche succession dʼammonites que celle de la coupe de la Veveyse. La comparaison se fera donc uniquement avec la faune du banc guide-bed de la zone à Angulicostata auct. L̓ épaisseur totale de la série dʼalternances appartenant à cette zone est inférieure à 15 m (voir échelle métrique de CECCA et al., 1995 ; fig. 1).
VI. 2. Faune de la Veveyse, zone à Angulicostata auct.
Elle a été récoltée entre les bancs 86.3 et 94.6 de la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis et comprend 415 ammonites réparties sur 38 m dʼalternances (BUSNARDO et al., 2003). Le seul examen de la faune de la « couche à poissons » (33 exemplaires seulement) aurait été insuffi-sant pour ce type de comparaison relative.Notons au passage que la faune de la « couche à pois-sons » est issue dʼun niveau marneux noirâtre à laminites, inclus dans un ensemble dʼalternances classiques calcai-res-marnes de type vocontien. La présence dʼune thanato-cénose riche en ammonites et poissons suggère une mor-talité par anoxie. Alors que le guide-bed des Apennins, également riche en ammonites, est un calcaire micritique très pauvre en carbone qui appartient à une série dʼalter-nances chargées en silice, habituellement significative de milieux profonds.
VI. 3. Faune des Voirons
Cette faune, composée de 73 exemplaires, a été récol-tée par PICTET & de LORIOL (1858) et par certains dʼentre nous (R.B., B.C., J.C.). Bien que provenant de plusieurs olistolithes distincts, elle représente une petite partie de la zone à Angulicostata auct., au niveau de la « couche à poissons ».
531Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni dans le domaine ultrahelvétique
VI. 4. Analyse des faunes dʼammonites
La faune pérenneTypique du milieu téthysien pélagique, la faune pérenne représente 23 % des ammonites, sur les 450 exemplaires dénombrés par CECCA et al. (1995). Elle est composée par les Phyllocératidés, les Lytoceratidés auxquels nous ajoutons les Neolissoceras.Dans la coupe de la Veveyse, la faune pérenne correspond à 23,4 % de lʼensemble (415 exemplaires). On voit que le caractère pélagique est presque identique dans les deux cas. Dans la faune des Voirons, la proportion pérenne est encore plus importante : 31,5 %.
Les PlesiospitidiscusCe genre caractérise assez bien lʼensemble de lʼHaute-rivien supérieur : sommet de la zone à Sayni (= horizon à Ligatus), zone à Balearis et zone à Angulicostata auct. De rares individus peuvent subsister à la base du Barré-mien (zone à Cassida).Les Plesiospitidiscus sont représentés par plusieurs espè-ces : P. ligatus (DʼORBIGNY), P. subdifficilis KARAKACH, P. communis BUSNARDO, P. canalis BUSNARDO, P. bres-kovski CECCA et al. Nous y ajoutons Barremites primiti-vus CECCA et al. En effet, la suture cloisonnaire de cette dernière forme à 4 selles et 4 lobes presque symétriques (CECCA et al., 1998 ; fig. 11g) est bien plus simple que celle des Barremites (BUSNARDO et al., 2003 ; fig. 22). En outre son niveau est plus ancien (vers le milieu de la zone à Angulicostata auct.) que celui des Barremites qui débutent seulement au sommet de la même zone. On peut cependant supposer que P. primitivus CECCA et al. pourrait être lʼancêtre des Barremites, en particulier de B. primarius BUSNARDO, dont il partage le mode dʼorne-mentation.L̓ ensemble des Plesiospitidiscus ainsi défini correspond à 12,8 % de la faune dans la coupe de la Veveyse, et 6,8 % aux Voirons. Par contre ce genre semble exceptionnelle-ment abondant dans le guide-bed du Niveau Faraoni des Apennins (42,7 %), augmentant encore le cachet pélagi-que du milieu.
Le groupe des Pseudothurmannia et genres associésNous incluons ici les genres Parathurmannia, Pseudo-thurmannia, Sornayites et Binelliceras appartenant tous à la zone à Angulicostata auct. Ces formes, à forte diversité, souvent très ornées, prédominent très largement dans les milieux hémipélagiques ; en effet, ce groupe représente 92 % (La Serre [Ardèche]) et 93 % (Vercors) de la faune en milieu hémipélagique. Elles sont moins nombreuses, souvent plus petites, dans les mers pélagiques. Dans lʼUl-trahelvétique de la Veveyse, elles représentent 38 % de la faune, et 21,9 % dans les Voirons. Dans les Apennins, le ratio se réduit à 18,2 %. L̓ importance de ce groupe dʼam-monites semble bien caractériser le milieu plus ou moins pélagique des sites étudiés.L̓ évolution rapide, le polymorphisme souvent adapté
au milieu rendent difficile pour le moment lʼétude de ce groupe, pourtant riche en nombre dʼespèces. Naturelle-ment cʼest au sein de ce groupe quʼont été proposées les espèces zonales ou sous-zonales. Mais le consensus dans ces décisions nʼest pas encore acquis en raison de la com-plexité insuffisamment élucidée de ces ammonites. On notera en particulier lʼutilisation, à notre avis erronée, de lʼespèce Parathurmannia catulloi PARONA, 1897, en tant que marqueur de la partie supérieure de la zone à Angulicostata auct. En effet, le type de cette espèce, pro-bablement perdu, de petite taille, proche des Balearites, cʼest-à-dire dʼaspect assez primitif, appartiendrait plutôt à la partie la plus ancienne de la zone à Angulicostata auct. Suivant les recommandations de BUSNARDO et al. (2003, p. 114), il vaut mieux ne pas utiliser la sous-zone à Catulloi. L̓ ensemble des Pseudothurmannia décrites par CECCA et al. (1995) montre un cachet primitif (tours internes de Balearites), qui semble perdurer jusquʼau sommet de la zone à Angulicostata auct.
Les HétéromorphesIl sʼagit dʼun groupe hétérogène dʼammonites généra-lement de petite taille, très variées (genres Sabaudiella, Leptoceratoides, Hamulina, Hamulinites, Acrioceras, etc.), ayant vécu à lʼHauterivien supérieur et au Barré-mien basal. Habituellement, elles prolifèrent surtout en milieu pélagique ; ainsi elles représentent 15,2 % à la Veveyse de Châtel-Saint-Denis et 35,6 % aux Voirons durant la zone à Angulicostata auct. Cependant, elles sont très rares dans les Apennins : 1,5 %. En outre, on notera que les Sabaudiella, si particulières à la Veveyse de Châtel-Saint-Denis et aux Voirons, nʼexistent pas dans les Apennins.
Les autres genres dʼammonitesCes genres jouent un rôle numérique secondaire : 18,8 % dans les Apennins, 10,6 % dans la Veveyse et 4,1 % aux Voirons. Les Abrytusites, Pseudovaldedorsella, Barremi-tes (?), Paraspiticeras restent rares. On rappellera que les Pseudovaldedorsella, formes proches des Abrytusi-tes, nʼont pas été signalées dans la Veveyse. Enfin, les Pulchellidés (genres Psilotissotia, Discoidellia) existent bien dans les trois domaines, mais en plus grande impor-tance dans les Apennins, probablement pour disposer dʼun milieu océanique plus chaud.
VI. 5. Conclusions
- Les ammonites pérennes (Phylloceras, Lytoceras), auxquelles on ajoutera les Plesiospitidiscus, sʼaccor-dent pour caractériser un milieu hautement pélagique, que nous appellerons ici océanique. Alors que leur pourcentage atteint 61,5 dans les Apennins, il nʼest que de 38,3 aux Voirons et 36,2 dans la Veveyse de Châ-tel.
- A lʼinverse, le groupe des Pseudothurmannia et formes
532 F. BAUDIN et al.
associées sont significatifs de milieux moins profonds. Ces ammonites sont de plus en plus prépondérantes en allant du milieu océanique des Apennins (18 %), pélagique aux Voirons (21,9 %), un peu moins pélagi-que à la Veveyse (38 %) ou dans la coupe de Vergons (46 %) et hémipélagique dans le Vercors ou en Ardèche (92 %). Ce groupe se révèle être un véritable marqueur du milieu, à condition de disposer dʼun nombre signifi-catif dʼammonites génériquement déterminables.
- L̓ examen des compositions génériques et spécifiques montre lʼexistence dʼun particularisme net : cʼest entre autres la présence de Sabaudiella uniquement dans lʼUltrahelvétique ou celle des Pseudovaldedorsella dans les Apennins. Les séries de ces deux domaines, bien que de même âge (zone à Angulicostata auct.) ne sont pas identiques et ne peuvent être comparées banc par banc.
VII. DISCUSSION ET CONCLUSIONS
L̓ évolution des isotopes stables du carbone et de lʼoxy-gène des carbonates et des teneurs en éléments traces (Sr, Mn, Fe) montrent que lʼintervalle compris entre les bancs 91-2 et 92-4 de la coupe de la Veveyse ressort nettement dans lʼévolution générale des courbes comme une période de perturbation importante du chimisme des eaux océaniques. Cet intervalle critique correspond également à un net enrichissement en matière organique qui sʼexprime particulièrement dans les bancs ou inter-bancs 91-3, 92-1m, 92-3m et 92-4. Cette augmentation de la fraction organique du sédiment est imputable à une meilleure préservation de la matière organique dʼorigine phytoplanctonique (IH plus élevés), en relation avec une plus forte productivité et une légère déficience en oxy-gène des eaux de fond.Ces changements intervenant au sein de la zone à Angu-licostata auct., il est tentant de les attribuer à lʼévénement Faraoni (BAUDIN et al., 1999 ; BAUDIN, 2002), même si lʼassociation dʼammonites de lʼHauterivien terminal du domaine ultrahelvétique (BUSNARDO et al., 2003) ne per-met pas une stricte corrélation avec le Niveau Faraoni dʼOmbrie-Marches (CECCA et al., 1994, 1998), du Pla-teau de Trente (CECCA et al., 1996) ou des Monts Lessini (FARAONI et al., 1997). Le spectre faunique présent à ce niveau de la zone à Angulicostata auct. dans la coupe de la Veveyse est plus proche de celui du bassin vocontien que de celui des coupes italiennes (BUSNARDO et al., 2003 et discussion ci-dessus). La singularité de la coupe de la Veveyse de Châtel-Saint-Denis par rapport à toutes celles où le Niveau Faraoni s.s. a été reconnu, réside dans lʼexpression lithologique de cet événement. Alors que dans les bassins dʼOmbrie-Marches, des Alpes méridionales, du SE de la France et du domaine subbétique le Niveau Faraoni sʼexprime par une succession de 3 bancs et 4 interbancs, une telle suc-
cession nʼest pas identifiable dans le domaine ultrahelvé-tique. Nʼayant pu reconnaitre le guide-bed D – qui est le banc repère par excellence du Niveau Faraoni – il est dif-ficile de proposer une corrélation banc par banc comme cela est possible entre les autres bassins. Cette nuance dans lʼexpression lithologique de lʼévénement Faraoni peut sʼexpliquer de plusieurs manières :- soit lʼévénement Faraoni correspond à lʼun des trois
niveaux (91-3, « couche à poissons » ou 92-3 m/92-4) enrichis en matière organique de lʼintervalle critique et alors son expression lithologique ne présente pas la succession des 7 bancs ou interbancs habituels,
- soit il coïncide avec tout lʼintervalle critique et sa durée est alors deux fois plus importante ; si on suppose que chaque doublet marno-calcaire correspond à un cyle de précession (~ 20 000 ans). En effet, entre les bancs 91-3 et 92-4 on dénombre 7 interbancs et 7 bancs (Fig. 2), contre deux fois moins dans le Niveau Faraoni s.s.,
- soit lʼexpression des cycles de précession est oblitérée dans lʼintervalle critique de la coupe de la Veveyse.
Même si la « couche à poissons » correspond bien au Niveau à Faraoni, ce qui ne peut être prouvé formelle-ment par les critères paléontologiques, mais qui sem-ble très probable dʼaprès lʼanalyse séquentielle, il nʼest pas surprenant que le nombre de bancs et interbancs à la Veveyse ne corresponde pas à celui reconnu ailleurs, notamment dans la localité-type. En effet, durant le Cré-tacé inférieur et plus particulièrement à lʼHauterivien, la sédimentation dans le bassin ultrahelvétique a certaine-ment subi des perturbations significatives révélées par :- le caractère lenticulaire des bancs. Les bancs ne gar-
dent pas leur épaisseur sur de grandes distances laté-ralement ; cʼest ce qui explique que lʼon ne retrouve pas exactement le même nombre de bancs sur les deux rives de la Veveyse. Ce phénomène avait déjà été mis en évidence par STRASSER (fig. 34a-b, p. 103-104 in BUSNARDO et al., 2003), qui avait relevé le sommet de la coupe de la Veveyse en grand détail.
- lʼapparition de minces niveaux « turbiditiques » gréso-glauconieux intercalés dans les Alternances supérieures de marnes et de calcaires tachetés. Leur interprétation reste encore énigmatique.
Par contre il faut souligner la remarquable identité de position séquentielle de la « couche à poissons » de la Veveyse, du Niveau Faraoni dʼItalie et de ses équivalents vocontiens, déjà évoquée par BUSNARDO et al. (2003). Ils se situent à la base dʼun cortège transgressif à la partie supérieure de la zone à Angulicostata auct. (CLAVEL et al., 1995). Dans ces régions, les premiers dépôts riches en matière organique sont au contact direct de la surface de transgression (TS) marquant le début de la hausse du niveau marin relatif, au sommet du cortège de bas niveau (LST), notamment marqué dans les Apennins par une série de slumps (CECCA et al., 1994 ; BAUDIN et al., 2002a).
533Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni dans le domaine ultrahelvétique
En dépit de cette différence dʼexpression lithologique, nos résultats suggèrent que le Niveau Faraoni, initiale-ment décrit dans la zone à Angulicostata auct. du bassin dʼOmbrie-Marches puis reconnu dans les Alpes italien-nes, le SE de la France et le bassin subbétique en Espa-gne serait également présent dans le domaine ultrahelvé-tique. Cette nouvelle occurrence démontrerait que lʼévénement Faraoni aurait affecté un domaine paléogéographique bien plus vaste que celui suspecté initialement.
REMERCIEMENTS
Sur le terrain, nous avons bénéficié du précieux concours de Marc WEIDMANN, auteur de la feuille « Châtel-Saint-Denis » et co-auteur du mémoire sur la Veveyse ; nous lui en sommes reconnaissants. Nous remercions cha-leureusement Danielle DECROUEZ et Christian MEISTER, du Muséum dʼhistoire naturelle de la Ville de Genève, de nous avoir permis dʼéchantillonner les gangues des poissons « néocomiens » des Voirons. Nous avons béné-ficié de lʼaide de Florence SAVIGNAC et Nathalie LABOUR-DETTE pour les analyses géochimiques et du savoir-faire dʼAlexandre LETHIERS pour lʼiconographie.
RÉFÉRENCES
BAUDIN F. (1999) - Sédimentologie de la matière organique. Bulletin de lʼassociation géologique auboise, 20 : 49-83.
BAUDIN F. (2002) - Late Hauterivian short-lived anoxic event in the Mediterranean Tethys : the ʻFaraoni Eventʼ. – Organic-carbon burial, climate change and ocean chemistry (Meso-zoic-Paleogene), Londres 9-11 décembre 2002, p. 2.
BAUDIN, F., L.-G. BULOT, F. CECCA, R. COCCIONI, S. GARDIN & M. RENARD (1999) - Un équivalent du « Niveau Faraoni » dans le Bassin du Sud-Est de la France, indice possible dʼun événement anoxique fini-Hauterivien étendu à la Téthys méditerranéenne. Bulletin de la Société géologique de France, 170 : 487-498.
BAUDIN, F., F. CECCA, S. GALEOTTI & R. COCCIONI (2002a) - Pal-aeoenvironmental controls of the distribution of organic matter within a Corg-rich marker bed (Faraoni level, upper-most Hauterivian, central Italy). Eclogae Geologicae Hel-vetiae, Basel, 95 : 1-13.
BAUDIN F., F. CECCA, S. GARDIN, M. DE RAFELIS, M. RENARD & R. COCCIONI (2002b) - L̓ événement anoxique fini-Hauterivien (Niveau Faraoni) est-il enregistré dans la zone sub-bétique et en dehors de la Téthys méditerranéenne ? STRATI 2002, 3e Congrès Français de Stratigraphie, Lyon 8-10 juillet 2002. Documents STU Lyon, 156 : 30-31.
BAUDIN, F., P. FARAONI, A. MARINI & G. PALLINI (1998) - Organic matter characterization of the “Faraoni Level” from North-ern Italy (Lessini Mountains and Trento Plateau). Compar-ison with that from Umbria-Marche Apennines. Palaeope-lagos, Roma, 7 : 41-51.
BELLANCA, A., E. ERBA, R. NERI, I. PREMOLI-SILVA, M. SPROVIERI, F. TREMOLADA & D. VERGA (2002) - Palaeoceanographic significance of the Tethyan ʻLivello Selli ̓ (Early Aptian)
from the Hybla Formation, northwestern Sicily : biostrati-graphy and high-resolution chemostratigraphic records. Palaeogeography, Palaoeoclimatology, Palaeoecology, 185 : 175-196.
BERSEZIO, R., E. ERBA, M. GORZA & A. RIVA (2002) - Berriasian-Aptian black shales of the Maiolica formation (Lombardian Basin, Southern Alps, Northern Italy) : local to global events. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaoeoecology, 180 : 253-275.
BUSNARDO, R., J. CHAROLLAIS, M. WEIDMANN & B. CLAVEL (2003) - Le Crétacé inférieur de la Veveyse de Châtel (Ultrahelvétique des Préalpes externes ; canton de Fri-bourg, Suisse). Revue de Paléobiologie, Genève 22(1) : 1-174.
CECCA, F., G. PALLINI, E. ERBA, I. PREMOLI-SILVA & R. COCCIONI (1995). - Hauterivian-Barremian chronostratigraphy based on ammonites, nannofossils, planktonic foraminifera and magnetic chrons from the Mediterranean domain. Creta-ceous Research, 15 : 457-467.
CECCA, F., P. FARAONI & A. MARINI (1998) - Latest Hauteriv-ian (Early Cretaceous) ammonites from Umbria-Marche Apennines (Central Italy). Palaeontographia Italica, 85 : 61-110.
CECCA, F., S. GALEOTTI, R. COCCIONI & E. ERBA (1996) - The equivalent of the “Faraoni Level” (uppermost Hauterivian, Lower Cretaceous) recorded in the eastern part of Trento Plateau (Venetian Southern Alps, Italy). Rivista Italiana Paleontologia Stratigrafia, 102 : 417-424.
CECCA, F., A. MARINI, G. PALLINI, F. BAUDIN & V. BEGOUËN (1994) - A guide-level of the uppermost Hauterivian (Lower Cretaceous) in the pelagic sucession of Umbria-Marche Apennines (Central Italy) : the Faraoni level. Rivista Italiana Paleontologia Stratigrafia. 99 : 551-568.
CHAROLLAIS, J., A. ATROPS, R. BUSNARDO, L. FONTANNAZ, P. KIN-DLER & R. WERNLI (1993) - Précisions stratigraphiques sur les collines du Faucigny, Préalpes ultrahelvétiques de Haute-Savoie (France). Eclogae Geologicae Helvetiae, Basel, 86 : 397-414.
CHAROLLAIS, J., J. ROSSET, R. BUSNARDO, H. MANIVIT & J. REMANE (1981) - Stratigraphie du Crétacé en relation avec les formations qui lʼencadrent dans lʼunité de Nantbellet (= nappe inférieure sensu lato de la Klippe de Sulens). Haute-Savoie, France. Géologie Alpine, Grenoble, 57 : 15-91.
CLAVEL, B., J. CHAROLLAIS, R. SCHROEDER & R. BUSNARDO (1995) - Réflexion sur la biostratigraphie du Crétacé infé-rieur et sur sa complémentarité avec lʼanalyse séquentielle : exemple de lʼUrgonien jurassien et subalpin. Bulletin de la Société géologique de France, 166 : 663-680.
COCCIONI, R., F. BAUDIN, F. CECCA, M. CHIARI, S. GALEOTTI, S. GARDIN & G. SALVINI (1998) - Integrated stratigraphic, pal-aeontological, and geochemical analysis of the uppermost Hauterivian Faraoni Level in the Fiume Bosso section, Umbria-Marche Apennines, Italy. Cretaceous Research, 19 : 1-23.
COMPANY, M., R. AGUADO, C. JIMENEZ DE CISNEROS, J. SANDOVAL, J.M. TAVERA & J.A. VERA (2003a) - Biotic changes at the Hauterivian/Barremian boundary in the Mediterranean Tethys. In : Field-trip guide to Agost (K/T) and Rio Argos (Hauterivian/Barremian) sections, Bioevents : their strati-graphical records, patterns and causes. Caravaca de la Cruz, 3rd June 2003 : 15-28.
COMPANY, M., J. SANDOVAL & J.M. TAVERA (2003b) - Ammonite biostratigraphy of the uppermost Hauterivian in the Betic Cordillera (SE Spain). Geobios, 36 : 685-694.
534 F. BAUDIN et al.
ESPITALIÉ, J., G. DEROO & F. MARQUIS (1985-86) - La pyrolyse Rock-Eval et ses applications. Revue de lʼInstitut français du Pétrole, 40(5) : 563-579 ; 40(6) : 755-784 ; 41(1) : 73-89.
FARAONI, P., A. MARINI, G. PALLINI & N. PEZZONI (1997) - The Maiolica Fm. of the Lessini Mts and Central Apennines (North Eastern and Central Italy) : a correlation based on new biolithostratigraphical data from the uppermost Hau-terivian. Palaeopelagos, 6 : 249-259.
FAVRE, A. (1849) - Sur la géologie de la montagne des Voirons près de Genève. Archives des sciences Genève, 11 :64-65.
FAVRE, E & H. SCHARDT (1887) - Description géologique des Préalpes du canton de Vaud et du Chalais jusquʼà la Dranse et la chaîne des Dents du Midi, formant la partie nord-ouest de la feuille XVII. Matériaux pour la Carte géologique de Suisse, Zürich, 22 : 1-636.
KÜBLER, B., J.-L. PITTION, Y. HEROUX, J. CHAROLLAIS & M. WEIDMANN (1979) - Sur le pouvoir réflecteur de la vitrinite dans quelques roches du Jura, de la Molasse et des Nappes préalpines, helvétiques et penniques (Suisse occidentale et Savoie). Eclogae Geologicae Helvetiae, 72(2) : 347-373.
PICTET, F.-J. (1858) - Notice sur les poissons des terrains cré-tacés de la Suisse et de la Savoie. Archives des Sciences physiques et naturelles, Genève, nouv. pér., 1 : 228-241.
PICTET, F.-J. & P. DE LORIOL (1858) - Description des fossiles contenus dans le terrain néocomien des Voirons. Seconde partie : description des animaux invertébrés. Matériaux pour la paléontologie suisse, Genève, 2 : 1-64.
POURTOY, D. (1989) - Les kystes des Dinoflagellés du Crétacé inférieur de la Veveyse de Châtel-St-Denis (Suisse) : bios-tratigraphie et stratigraphie séquentielle. Thèse IIIe cycle, Université de Bordeaux I, 2 vol.
RICHEBOIS, G. (1990) - Dosage de quelques éléments traces dans les eaux naturelles et les roches carbonatées. Application à lʼétude géochimique de la coupe du Kef (Tunisie). Mémoi-res de lʼUniversité Pierre et Marie Curie. D.E.S., 90 pp.
WEIDMANN, M., P. HOMEWOOD, R. MOREL et al. (1993) - Atlas géologique de la Suisse au 1 :25ʼ000, feuille 1244 Châtel-St-Denis. Notice explicative par M. WEIDMANN. Service hydrologique et géologique national, Berne : 55 p.
Accepté novembre 2005
535Enregistrement de lʼévénement anoxique Faraoni dans le domaine ultrahelvétique