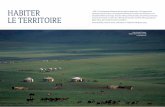Questions du Szélétien supérieur en Moravie. Praehistoria 9-10, (2008-2009), 61-70. Miskolc 2012
Transcript of Questions du Szélétien supérieur en Moravie. Praehistoria 9-10, (2008-2009), 61-70. Miskolc 2012
The publication of this volume was supported by the following institutions:
The Council of the City of MiskolcThe University of Miskolc
A Tudomány Támogatásáért Észak-Magyarországon Alapítvány
Front cover illustration:
The face of a Neanderthal child from Suba-lyuk Cave,Hungarian Natural History Museum. Reconstruction and photograph by Gy. Skultéty.
The cleft of the Bársony house found in 1891, Hungarian National Museum.Photograph by G. Kulcsár.
Back cover illustration:
Photo of Ottokár KadićSzékely K. (szerk.): Kadić Ottokár a magyar barlangkutatás atyja – Önéletrajz
Budapest, Magyar Állami Földtani Intézet, 2010, p. 6.
HU ISSN 1586-7811
Prof. Dr. Gyula Patkó Rector of the University of Miskolc
bears full responsibility for the publication.
2008–2009
Published by the Archaeolingua Foundation & Publishing House on behalf of the Department of Prehistory and Ancient History, University of Miskolc, in collaboration with the
Herman Ottó Museum and the Miskolc Committee of the Hungarian Academy of Sciences.
© ARCHAEOLINGUA Foundation
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, digitised, photo copying,
recording or otherwise without the prior permission of the publisher.
ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNYH-1014 Budapest, Úri u. 49.
Word processing, desktop editing and layout:Rita Kovács and Zsolt Mester
Cover design:Erzsébet Jerem and Gergely Hős
Printed by: Prime Rate, Budapest
CONTENTS
Editorial Preface ..................................................................................................................................... 5
Szeleta Workshop – Commemorating the 100th Anniversary of the Excavation at Szeleta CaveOctober 12–15 2007. Miskolc ......................................................................................................... 7
György LENGYEL, Péter SZOLYÁK & Martina PACHERSzeleta Cave Earliest Occupation Reconsidered ............................................................................. 9
Árpád RINGERNouvelles données sur le Szélétien de Bükk ................................................................................. 21
William DAVIES & Robert HEDGESDating a Type Site: Fitting Szeleta Cave into Its Regional Chronometric Context ....................... 35
Zdeňka NERUDOVÁThe Technology of the Szeletian Lithic Industry in the Context of Moravian EUP Cultures ....... 47
Martin OLIVAQuestions du Szélétien supérieur en Moravie ............................................................................... 61
Viola T. DOBOSILeaf Points in non-Szeletian Context ............................................................................................ 71
Zsolt MESTERLes outils foliacés de la grotte Jankovich : la renaissance d’un problème ancien ......................... 81
Jürgen RICHTERThe Role of Leaf Points in the Late Middle Palaeolithic of Germany .......................................... 99
Agnès LAMOTTE, Gilles HUGUENIN, Georges WILLEMAN, Philippe DUPAS & Jean-Michel PIROT
Les stations de plein air à outils foliacés dans l’Est de la France ................................................. 115
Petr NERUDAMoravia during OIS 3: Cultural Relations ................................................................................... 125
Yuri E. DEMIDENKOEast European Aurignacian and Its Early / Archaic Industry of Krems-Dufour Type in the Great North Black Sea Region .......................................................................................... 149
András MARKÓRaw Material Use at the Middle Palaeolithic Site of Vanyarc (Northern Hungary) ................... 183
Josip KOBAL’The Pioneer of Subcarpathian Palaeolithic Research .................................................................. 195
Árpád RINGER & György LENGYELThe Upper Palaeolithic Site at Budapest Corvin-tér .................................................................... 205
Péter SZOLYÁKNew Radiocarbon Data with Stratigraphical, Climatic and Archaeological Contexts to the Palaeolithic Assemblage of the Herman Ottó Cave, Miskolc-Alsóhámor, Northeast Hungary .......................................... 213
Péter SZOLYÁKUpper Palaeolithic Blade Cores and Flake Cores from the Herman Ottó Cave, Miskolc-Alsóhámor, Northeast Hungary ..................................................................................... 225
György LENGYELRadiocarbon Dates of the “Gravettian Entity” in Hungary ......................................................... 241
Dietrich MANIAGravettien zwischen Elbe und Thüringer Wald ........................................................................... 265
Vasile CHIRICA, Madalin-Cornel VALEANU & Codrin-Valentin CHIRICAL’image de la femme dans l’art et les religions prehistoriques: l’orante .................................... 307
László G. JÓZSADepicted Obesity and Steatopygia on Paleolithic Statues ........................................................... 333
Book Review ...................................................................................................................................... 341
61
PRAEHISTORIA vol. 9–10 (2008–2009)
L’archéologie moderne du Paléolithique s’oriente à bonne raison vers la reconstitution des techniques et du mode de vie des populations préhistoriques. Cependant, cette approche n’est pas possible pour les périodes dont les sources sont restraintes. Là, les recherches se concentrent donc – tout comme dans le passé récent – avant tout sur les questions de la variabilité typologique et celle des matières premières.
La majorité absolue des ensembles szélétiens dans notre région provient des collectes de surface de sorte qu’il est diffi cile de parler des étapes d’évolution de cette culture. Les dates radiométriques n’ont prouvé avec certitude que l’existence du Szélétien inférieur (40 000–35 000 ans BP) Elle proviennent exclusivement de la zone d’exploitation du silexite jurassique dans les environs de Krumlovský les (Fig. 1). Même ici, seulement les dates de Vedrovice V sont acceptables (Valoch 1993), tandis que les données de Moravský Krumlov IV paraissent pour le moment assez discordantes (Neruda et al. 2004). L’âge comparable des sites non datés, dont les assemblages ont été rammassés en surface, est indiqué par la présence de formes bien archaïques, fabriquées en matières premières importées. Les industries de telles zones d’exploitation peuvent cependant conserver longtemps une composante archaïque sous
forme de nombreux semi-produits bifaciaux, outils inachevés, retouches irrégulières et débitage grossier.
Les tendances évolutives des sites non stratifi és peuvent donc être mieux suivies sur les stations qui se situent plus loins des sources des matières premières exploitées. Hélas, aucune de ces stations n’a livrée des données stratigraphiques ou chronologiques. Les ensembles provenant des régions d’approvisionnement présentent vraiment une variabilité beaucoup plus large des matières premières, des technologies utilisées et des spectres typologiques. Ceci est valable même pour les cas où il s’agit des industries d’une même région, c’est-à-dire dans la même position par rapport aux sources exploitées (par ex. les environs du ruisseau Bobrava et le plateau de Drahany). Certaines collections présentent un caractère bien avancé qui se manifeste dans l’application presqu’exclusive de la technique laminaire, le pourcentage élevé de burins, la rarefaction de la retouche bifaciale totale sur les pointes foliacées (et la fabrication de ces dernières à partir des semi-produits laminaires), le haut pourcentage des matières premières importées et l’apparition des matières premières exotiques de provenance parfois lointaine. La plus grande distance d’approvisionnement concerne une pointe foliacée et un fragment de nucléus en rhyolite qui proviennent des
QUESTIONS DU SZÉLÉTIEN SUPÉRIEUR EN MORAVIE
Martin OLIVA*
Résumé
En Moravie, les dates radiométriques n’ont démontré, d’une manière fi able, que la présence du Szélétien ancien, datant de 39 à 34 mille ans avant nos jours. Cependant, le Szélétien évolué est beaucoup plus varié. Nous discutons le problème de son variabilité et son affi nité aux autres groupes culturels contemporains (Bohunicien, Epiaurignacien, type Míškovice). Dans certains assemblages szélétiens, probablement tardifs, les burins peuvent prédominer sur les grattoirs mais il y a également nombreux racloirs et une fréquence élevée des retouches latérales et plates. Les pointes de Jerzmanowice sont souvent plus nombreuses que les pointes foliacées bifaciales, le pourcentage des matières premières importées (entre autres silex du nord, radiolarites et rhyolites de la Hongrie) augmente aussi.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––* Moravian Museum, Anthropos Institute, Zelný trh 6, CZ-659 37 Brno. E-mail : [email protected]
Martin OLIVA
62
montagnes du Bükk de la Hongrie du nord-est (Fig. 2: 1–2). Cette matière lithique apparaît en même temps que le radiolarite hongrois à Ořechov II (Fig. 2: 5–6; Nerudová 1997). Cependant, ce dernier site appartient par son habitus techno- typologique encore dans la phase moyenne du Szélétien, de même que le vaste gisement près de Neslovice d’où provient un racloir en obsidienne de la Hongrie ou de la Slovaquie de l’Est (Fig. 2: 7).
On observe aussi une certaine tendance vers la miniaturisation des outils qui, cependant, dépend fortement de l’accessibilité des
matières premières. Dans d’autres cas, il parraît légitime de se poser la question de la cause du choix délibéré d’une matière première qui ne s’apprêtait pas à la fabrication des pièces plus volumineuses.
Ces ensembles fort variés ont en commun un haut pourcentage des racloirs ou des retouches latérales et plates, ce qui caractérise le Szélétien en général. Ce qui est spécifi que c’est la prédominance des pointes de Jerzmanowice parmi les pointes foliacées et, dans la composante aurignacoïde croissante, la prédominance des grattoirs sur les burins. Nous pouvons
Fig. 1. Les complexes à pointes foliacées en Moravie.Szélétien – 1: Suchohrdly; 2: stations près de Krumlovský les (Jezeřany, Vedrovice, Mor. Krumlov); 3: gisement près de la Porte de Kounice (Dol. Kounice, Trboušany, Pravlov, Mělčany, plus vers le Nord Bratčice); 4: Mohelno, Lhánice a Dukovany; 5: Neslovice; 6: gisements autour du ruisseau de Bobrava (Ořechov, Hajany, Želešice, Modřice); 7: Rozdrojovice; 8: Tišnov; 9: Nuzířov; 10: Strážovice; 11: Opatovice; 12: Drysice et Ondratice; 13: Otaslavice, Vincencov, Myslejovice; 14: Ohrozim, Třebčín; 15: Droždín; 16: Otice?Type Míškovice – 17: Lhota u Lipníka; 18: Pavlovice u Přerova; 19: Přestavlky; 20: Ludslavice; 21: Míškovice; 22: Hostišová?; 23: Topolná; 24: Jarošov; 25: Buchlovice; 26: Stříbrnice; 27: Žeravice (Hostějov).Jezmanowicien – 28: Dubicko et Zadní Újezd.Signes rondes: Szélétien de faciès non-Levallois; carrés: Szélétien de faciès Levallois; triangles: Type de Míškovice; croix: pointes foliacées isolées; x: Jerzmanowicien; gf: limite sud des sources du silex erratique.
Questions du Szélétien supérieur en Moravie
63
également y observer l’importation croissante des matières premières à laquelle on attribue, sur la base des connaissances actuelles et des
lois de l’évolution technologique et sociale, une certaine signifi cation chronologique. La représentation des types particuliers des outils
Fig. 2. Matières lithiques de provenance exotique du Szélétien morave. 1–2, 6: rhyolite des montagnes de Bükk; 3: tuf acide; 4: silexite mésozoïque de Hongrie (?);
5: radiolarite type Sümeg; 7: obsidienne. 1–4: Ondratice I; 5–6: Ořechov II; 7: Neslovice. (Det. A. Přichystal)
Martin OLIVA
64
retouchés est fort variable : d’une part, il y a des industries à une haute proportion de grattoirs aurignaciens (Želešice I, Dobrochov) contenant beaucoup de pointes foliacées (Želešice – Valoch 1956, 1973), d’autre part, les traditions bifaciales se conservent sur d’autres outils, de sorte que l’ensemble a été classifi é comme Aurignacien (Dobrochov – Svoboda & Přichystal 1990). Selon un rapport ancien, il y avait une poite foliacée même ici (Kopecký 1932–1933: 82). Par endroits, les burins prédominent sur les grattoirs (Vincencov – Svoboda & Přichystal 1987; Modřice IV – Oliva 1989: 18; Ondratice VII/Drysice III – Valoch 1967) ou ils sont équilibrés (Želešice I, Rozdrojovice – Valoch 1955), tandis que les grattoirs continuent à prévaloir sur d’autres sites (par ex. Ondratice I, Ia – Oliva 1992, 2004).
Les ensembles dans lesquels la représentation des burins (non aurignaciens) est dominante et la composante bifaciale est prononcée rappellent les industries du type Míškovice où les racloirs sont cependant moins nombreux et les pointes foliacées, souvent de petite taille ou triangulaires, continuent à être bifaciales (Oliva 1988: fi g. 3, 2–7, 2005a: 54–55). En même temps, elles se rapprochent de l’Epiaurignacien (sensu Oliva 1996; 2005b), contenant beaucoup moins de racloirs et par contre beaucoup de pièces aurignacoïdes ou simplement polyédriques parmi les burins, y compris des types spécifi ques (burins transversaux, de type Bassaler, etc.). À la différence du Szélétien tardif, l’Epiaurignacien (riche en burins) n’a livré que de très rares grattoirs aurignaciens (pour la plupart carénés) et parmi les pointes foliacées prédominent les exemplaires à retouche bifaciale recouvrant toute la surface (tout comme dans le type Míškovice). Ces derniers peuvent prendre des formes miniatures inhabituelles (Oliva 1988: fi g. 3). L‘association des pointes à face plane („de Jerzmanowice“) et de la technique Levallois (sur certains sites szélétiens dans la région d’Ondratice – Fig. 3) est typique du Bohunicien récent (Oliva 1984, 1992; Svoboda 1987) où, cependant, les racloirs fortement retouchés et les pointes foliacées bifaciales éventuelles sont toujours confectionnées en matériaux
étrangers (typiquement szélétiens – silexite du type Krumlovský les et spongiolite, etc.). Par ailleurs, on suppose que ce Bohunicien récent, daté à 34 000 ans B.P. à Stránská skála (Svoboda & Bar-Yosef 2003), est antérieur à certaines stations analogues du Szélétien développé. Les ensembles szélétiens, caractérisés par la prédominance des burins sur les grattoirs, manquent déjà la composante Levallois.
Si le Szélétien ancien et moyen constitue des « vases communicants » avec le Bohunicien (voir les industries transitoires, peut-être non-homogènes du type Ořechov et Podolí) et infl uence aussi l’Aurignacien (par ex. la collection de Diváky), alors les industries szélétiennes les plus évoluées présentent de nombreux points communs avec le type Míškovice qui pourrait être considéré comme son faciès tardif de la Moravie de l’est.
Puisque certains chercheurs ont récemment mis en question l’indépendance du Szélétien, il nous paraît utile d’ajouter, en guise de conclusion, quelques remarques sur ce sujet.
La différence du Szélétien par rapport à l’Aurignacien est une question secondaire car il s’agit de deux grands technocomplexes dont l’existence est suffi samment prouvée et qui s’excluent partiellement même du point de vue géographique. Bien plus importante est la question (et la mesure) de l’indépendance du Szélétien par rapport au Bohunicien. D’ailleurs, le site éponyme du Bohunicien était à l’origine désigné comme Szélétien de faciès Levallois (Valoch 1976). La différenciation du Bohunicien en tant que tradition indépendante était due à la reconnaissance de l’exclusivité des matières premières de tous les outils typiques szélétiens (pointes foliacées et racloirs fort retouchés – Oliva 1979: 55). Sans vouloir récapituler toute la discussion ravivée actuellement surtout dans les articles de Z. Nerudová, les faits suivants peuvent être mentionnés en faveur de l’existence indépendante du Bohunicien:
Les deux traditions se diffèrent le plus –dans leurs phases initiales, documentées (exceptionellement) par les méthodes
Questions du Szélétien supérieur en Moravie
65
Fig. 3. Ondratice I, outillage typique du Szélétien supérieur.
Martin OLIVA
66
stratigraphiques et radiométriques. Si les deux traditions s’étaient développées des mêmes bases, cela aurait été le contraire.Les industries « transitoires » proviennent –toujours de collectes de surface (Ořechov I, II et autres stations dans le bassin de la Bobrava, Mohelno, Lhánice I et II, Podolí I et II), tandis que l’attribution culturelle des collections stratifi ées ne pose pas de problème. En plus, il y a des assez riches collections stratifi ées où les formes typiquement szélétiennes n‘apparaissent pas (Brno – Stránská Skála: Valoch et al. 2000; Svoboda & Bar Yosef 2003). Il est vrai qu’à Stránská Skála se trouve un affl eurement de silexite jurassique, matière première la plus largement utilisée au Bohunicien. Cependant, les stations du Bohunicien ne se situent pas directement à la source, mais à 300–1000 m d‘elle. Les matières premières importées y font grosso modo le même pourcentage qu‘à la station éponyme de Brno–Bohunice. Il s’agit des mêmes roches qui ont servi à produire des pointes foliacées à Bohunice et pourtant qui font défaut à Stránská skála.Selon certains auteurs, les ensembles du –Bohunicien peuvent apparaître comme un faciès d’atelier du Szélétien où les supports (mais pas les pointes foliacées, par ex.) ont été fabriqués auprès des sources de matières premières. Or, parmi les stations bohuniciennes, Stránská skála est le seul site qui soit situé tout près de la source des matières premières, tandis que ceux du Szélétien en sont bien nombreux (seulement dans les environs de Krumlovský les et de la porte de Kounice voisine, il y en a plusieurs dizaines). L’apparition des retouches bifaciales, des pointes foliacées et des racloirs prononcés rend leur caractère bien visible. Justement sur le site d’atelier typique in situ à Moravský Krumlov IV, on a fabriqué des pointes foliacées (Neruda et al. 2004). La trouvaille isolée d’une belle feuille à Brno-Líšeň témoigne le fait que les pointes foliacées pouvaient être fabriquées même en silexite de Stránská skála (Nerudová & Přichystal 2001). Le fait que les pointes foliacées bifaciales n’ont
été fabriquées que très rarement dans les industries bohuniciennes (Škrdla & Tostevin 2005) est donc une question de choix et non des obstacles techniques. D’ailleurs, dans le Paléolithique morave les pointes foliacées étaient confectionnées en matières premières les plus variées, souvent de qualité médiocre : différentes variantes du silexite du type Krumlovský les et Troubky-Zdislavice, spongiolite, radiolarite, plasma, silex erratique, etc.Et enfi n, le Bohunicien lui aussi fait partie –d’un grand complexe d’industries datant de la fi n du Paléolithique moyen et du début du Paléolithique supérieur qui s’étend du Proche Orient jusqu’à l’Europe occidentale et la plaine nord-européenne. K. Valoch (1976) était le premier à le constater et depuis les chercheurs ne cessent de le « découvrir ». C’est peut-être à cause du fait que leurs rapports sont diffi ciles à remarquer et à démontrer en conséquence de la faible densité des sites. Il est bien possible que certaines ressemblances entre les industries géographiquement très éloignées sont dues au phénomène de convergence. Il est cependant clair que dans les régions de contact les industries Levallois-leptolithiques adoptent les types des technocomplexes parallèles, notamment ceux qui pouvaient – comme produits de prestige et armes représentatives – devenir objets d’échange et d’immitation. Avant tout, il s’agit bien sûr des pointes foliacées. C’est sous cette optique qu’il faut évaluer la présence occasssionelle de ces armes très élaborées dans le Bohunicien ainsi que dans l’Aurignacien.
Le type d’installation des sites de tous les faciès mentionnés dans le paysage est quasiment identique : on a presque toujours occupé les pentes des collines sans prendre en considération la distance des cours d’eau importants (Oliva 2005b). Cette situation a permis d’avoir accès aux zones écologiques variées offrant des ressources alimentaires au cours de différentes saisons. Dans la région d’affl eurements lithiques autour de Krumlovský les (Fig. 4), la position des sites szélétiens et aurignaciens est presque
Questions du Szélétien supérieur en Moravie
67
Fig. 4. Les sites paléolithiques dans la région de Krumlovský les. I: Ivančice; J: Jezeřany; M: Maršovice; MK: Moravský Krumlov; NB: Nové Bránice; O: Olbramovice; T: Trboušany; V: Vedrovice;
střední paleolit: Paléolithique moyen; pozdní paleolit: Paléolithique tardif.
Martin OLIVA
68
identique, ces derniers sont seulement plus concentrés dans le semi-bassin de Vedrovice.
Il en est tout autrement dans le Gravettien morave. L’emplacement des campements (aussi bien temporaires que permanents) dans la proximité des rivières, typique dans cette culture, était certainement en rapport avec le rôle des vallées en tant que voies de migration des animaux (mammouths notamment) et tracés des groupes de chasseurs alliés au mammouth.
La date de 25 170 ± 130 BP (GrA-34275) récemment acquise pour la station aurignacienne de Vedrovice Ia a prouvé que l’emplacement typique des campements du Paléolithique supérieur ancien reste la même durant ses phases tardives qui sont déjà contemporaines du Gravettien. Ce n’est que certains sites situés dans les zones d’affl eurements lithiques qui nous renseignent sur la structure interne des campements. Comme il était prévu, les amas des déchets de production y alternent avec
les zones cendreuses (foyers non-aménagés) et les espaces pauvres en vestiges. Nous n’avons jamais identifi é de structures d’habitat proprement dites. Une situation étrange a été observée dans la séquence aurignacienne à Milovice au pied des collines de Pavlov. Les accumulations de l’industrie taillée traversaient tous les horizons cendreux ayant des zones horizontales de charbons et du loess brûlé en rouge dont la base a été datée à 32 030 ± 370 ans BP et le niveau superposé de 60 cm à 28 780 ± 230 ans BP. Comme si les foyers restaient aux mêmes endroits pendant 3000 ans, tout en résistant aux sédiments glissant le long de la pente. Dans d’autres cultures, une preuve similaire des retours répétés au même endroit est diffi cile à trouver à cause du manque de sites stratifi és.
Cependant, on peut observer une exclusivité de certains types d’industrie lithique au niveau macrorégional (Fig. 5) (Valoch 1995; Oliva 2007). Dans le Paléolithique supérieur ancien,
Fig. 5. Le Paléolithique supérieur ancien en Moravie.
Questions du Szélétien supérieur en Moravie
69
le Bohunicien se concentre seulement dans le bassin de Brno. Le Szélétien et l’Aurignacien apparaissent ensemble seulement dans la région des sources riches de silexite dans les environs de Krumlovský les. Dans le bassin de Brno, l’Aurignacien succède au Bohunicien (le Szélétien faisant défaut), par contre sur le plateau de Drahany le seul Szélétien est présent, suivi plus tard par les industries tardives à nombreux burins (Epiaurignacien). Sur la côte du bord ouest de la Morava se trouvent de nombreuses stations de caractère aurignacien pur, tandis qu’à l’est de cette rivière et au sud-est du massif de Chřiby n’est constatée que la présence des assemblages du type transitoire de Míškovice. Les différences entre les régions se font donc sentir, malgré que les occupations de longue durée et les fl uctuations des populations les aient considérablement effacées. En plus il s’agit du paysage du même type, de sorte que la variabilité culturelle ne fût pas déterminée par la variabilité écologique.
L’étude de notre Paléolithique supérieur ancien est orientée surtout vers la typologie, technologie et économie des matières premières, ainsi que vers la topographie des occupations. Les approches plus modernes concernant les reconstructions des chaînes opératoires ou l’analyse des sols d’habitat sont assez rares. La cause en est le nombre fort restreint des gisements stratifi és. Les plus nombreux en sont ceux du Bohunicien (20% à peu près). Ceux du Szélétien et de l’Aurignacien sont beaucoup moins fréquents (5%) et ils n’apparaissent point dans le type Míškovice. Les sites stratifi és de l’Aurignacien ancien et du Szélétien évolué font tout à fait défaut. On a vu que l’existence de ce dernier est indiqué seulement par le caractère évolué des industries lithiques et par la prédominance des matières premières importées. Cela ne veut naturellement pas dire que l’étude des ensembles provenant du ramassage contrôlé de surface pourrait être omise. Bien au contraire, sans elle des chapitres importants de l’occupation paléolithique manqueraient et l’image serait fort déformée.
Remerciement
La préparation de cet article a bénéfi cié le support fi nancier du grant n° MK00009486202 du Ministère de la Culture.
Bibliographie
KOPECKÝ, J., 1932–1933. Chronologický přehled nálezů z paleolitu na Prostějovsku. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 23, 80–82.
NERUDA, P., NERUDOVÁ, Z. & OLIVA, M., 2004. Stratigrafi e paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 89, 3–58.
NERUDOVÁ, Z., 1997. K využití cizích surovin v szeletienu na Moravě. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 82, 79–86.
NERUDOVÁ, Z. & PŘICHYSTAL, A., 2001. Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech. Archeologické rozhledy 53, 343–347.
OLIVA, M., 1979. Die Herkunft des Szeletien im Lichte neuer Funde von Jezeřany. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 64, 45–78.
OLIVA, M., 1984. Le Bohunicien, un nouveau groupe culturel en Moravie. Quelques aspects psycho-technologiques du développement des industries paléo-lithiques. L‘Anthropologie 88, 209–220.
OLIVA, M., 1988. Role levalloiské techniky a listovitých hrotů ve starší fázi mladého paleolitu na Moravě. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 73, 3–13.
OLIVA, M., 1989. Paleolit. In: Belcredi, L. (ed.), Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. 8–32. Brno, Okresní muzeum Brno-venkov.
OLIVA, M., 1992. The Szeletian occupation of Moravia, Slovakia and Bohemia. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 77, 35–58.
Martin OLIVA
70
OLIVA, M., 1996. Epiaurignacien en Moravie: le changement économique pendant le deuxième interpléniglaciaire wurmien. In: Palma di Cesnola, A., Montet-White, A. & Valoch, K. (eds), XIII Int. Congress of Prehist. and Protohist. Sciences, Colloquia 6. The Upper Palaeolithic. 69–81. Forlí, A.B.A.C.O.
OLIVA, M., 2004. Vyvinutý szeletien z lokality Ondratice Ia – Malá Začaková. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 89, 59–81.
OLIVA, M., 2005a. Palaeolithic and Mesolithic Moravia. Brno, Moravské Zemské Muzeum.
OLIVA, M., 2005b. L’exploitation du paysage et des ressources lithiques au Paléolithique en République Tchèque. In: Vialou, D., Renault-Miskovsky, J. & Patou-Mathis, M. (eds), Comportements des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en Europe: territoires et milieux. 107–120. ERAUL 111, Liège.
OLIVA, M., 2007. K otázce regionálních projevů a teritoriality v mladém paleolitu Moravy. Archeologické rozhledy 59, 203–218.
SVOBODA, J., 1987. Stránská skála. Bohunický typ v brněnské kotlině. Studie archeol. ústavu ČSAV v Brně 14/1, Praha.
SVOBODA, J. & PŘICHYSTAL, A., 1987. Szeletská industrie z Vincencova. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 72, 5–19.
SVOBODA, J. & PŘICHYSTAL, A., 1990. Aurignacká industrie z Přediny u Dobrochova. Archeologické rozhledy 42, 475–491.
SVOBODA, J. & BAR-YOSEF, O. (eds), 2003. Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Czech Republic. Cambridge, Harvard University Press.
ŠKRDLA, P. & TOSTEVIN, G., 2005. Brno – Bohunice. Analýza materiálu z výzkumu v roce 2002. Přehled výzkumů 46, 35–61.
VALOCH, K., 1955. Výzkum paleolitického naleziště v Rozdrojovicích u Brna. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 40, 5–32.
VALOCH, K., 1956. Paleolitické stanice s listovitými hroty nad údolím Bobravy. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 41, 5–44.
VALOCH, K., 1967. Die altsteinzeitlichen Stationen im Raum von Ondratice in Mähren. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 52, 5–46.
VALOCH, K. 1973. Neslovice, eine bedeutende Oberfl ächenfundstelle des Szeletien in Mähren. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, scientiae sociales 58, 5–76.
VALOCH, K., 1976. Die altsteinzeitliche Fundstelle in Brno-Bohunice. (Mit Beiträgen von W.G. Mook, R. Musil, E. Opravil, L. Smolíková, V.R. Switsur und V.E. Ščelinskij). Studie archeol. ústavu ČSAV Brno 4/1, Brno.
VALOCH, K., 1993. Vedrovice V, eine Siedlung des Szeletien in Südmähren. Mit Beiträgen von A. Kočí, W. G. Mook, E. Opravil, J. van der Plicht, L. Smolíková, Z. Weber. Quartär 43/44, 7–93.
VALOCH, K., 1995. Territoires d´implantation, contacts et diffusion des sociétés du Paléolithique supérieur dans l´ancienne Tchécoslovaquie. L´Anthropologie 99, 593–608.
VALOCH, K., NERUDOVÁ, Z. & NERUDA, P., 2000. Stránská skála III – Ateliers du Bohunicien. Památky archeologické 95, 5–113.