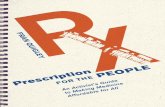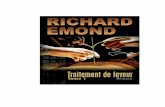ÉDENTEMENT PARTIEL PRESCRIPTION DU TRAITEMENT ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ÉDENTEMENT PARTIEL PRESCRIPTION DU TRAITEMENT ...
MOTS CLESEdentement
LongévitéProthèse
KEY WORDSPartial edentulism
LongevityProsthesis
Jean-Marie CHEYLAN1
MCU-PH
1 Faculté de chirurgie dentaireUniversité Paris Descartes
ÉDENTEMENT PARTIELPRESCRIPTIONDU TRAITEMENTPROTHÉTIQUE
L’édentement partiel présente desformes cliniques innombrables dontles conséquences, présentes ou àvenir, peuvent conduire à prescrire untraitement prothétique. Les motiva-tions des patients sont presque tou-jours liées aux séquelles de l’édente-ment : impotence fonctionnelle, han-dicap esthétique, mal-être psycholo-gique. S’il ne nie pas ces doléances,le regard du praticien évalue d’autresperturbations, silencieuses ou igno-rées du malade : déplacements den-taires, atteintes parodontales, dys-fonctions occlusales, symptômes àdistance tels que myalgies ou cépha-lées. Le prat icien ident ifie les
désordres pathologiques objectifs etévalue les atteintes subjectives révé-lées ou pressenties lors de l’entretienclinique avec le patient. Cette étapediagnostique est capitale. Il y a sou-vent discordance entre les souhaits etles espoirs du patient et les transfor-mations que nous commandent notrecompétence médicale. Qui n’a pasparlementé avec un patient pour leconvaincre du bien-fondé de l’extrac-tion d’une dent égressée ? Ou de lanécessité d’un traitement parodontalavant de réaliser une prothèse fixée ?La confrontation des souhaits et desattentes du patient (compenser unhandicap) aux objectifs du thérapeute
REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3, 2007 pp. 221-233
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 221
(stopper, compenser ou prévenir uneévolution morbide) constitue une pre-mière situation de contingence de laprescription prothétique (41). Le rem-placement de 2 incisives centralesabsentes sur une arcade saine ettotalement dentée par ailleurs est unexemple caricatural d’objectif perti-nent et bien identifié par les deux par-ties. Le non remplacement d’une oudeux molaires, perdues depuis denombreuses années, dans un contex-te occlusal stable et bien toléré peutêtre discuté en termes d’évolution etde service appréciables par le patient.L’identification claire des change-ments souhaités ne constitue qu’unepremière étape. Il faut ensuite laconfronter aux moyens disponibles detraitement : prothèse fixée, amovible ?Nécessité d’intervenir préalablementpar chirurgie, orthodontie ? Nous tou-chons là une deuxième situation decontingence de la prescription prothé-tique : les coûts et les contraintesd’un traitement prothétique doiventêtre évalués et confrontés au bénéfi-ce attendu pour le patient. C’est pro-bablement la difficulté majeure dumédecin prescripteur car elle impliqued’une part une connaissance exhaus-tive des différents types de prothèseayant un recul clinique acceptable(fiabilité), leurs contraintes en termesde coût (biologique, pécuniaire), dedurée et de mise en œuvre (plateautechnique), et d’autre part le pronosticde ces prothèses, évalué par les don-nées de la littérature, l’expériencepersonnelle et les compétences dechacun. A cela s’ajoutent quantité deparamètres propres au patient : moti-vation, disponibilité, possibilités finan-cières, âge, état de santé… qui déter-minent principalement l’acceptationthérapeutique (faisabilité).Il apparaît évident que la prescriptionprothétique est subordonnée à un telnombre de facteurs qu’une systémati-sation relève de la gageure. Dans lecadre de l’édentement partiel, les
contextes cliniques sont si variésqu’ils peuvent presque toujours pré-tendre plusieurs solutions thérapeu-tiques pertinentes (13). Nous aborde-rons ici quelques réf lexions surl’édentement partiel au travers desituations cliniques, sans évoquer lesproblématiques liées à l’édentementsub-total qui font l’objet d’un autrearticle de ce numéro.
LA DEMANDE DU PATIENTLe traitement prothétique répond sou-vent à une demande du patient quimanifeste des doléances en rapportavec la perception d’un handicap oud’un inconfort propre à la sensibilitéde chacun : les exigences esthétiquesne sont pas les mêmes pour tous, leconfort masticatoire non plus. Cer-tains patients édentés n’ont d’ailleursaucune motivation de traitement, etne ressentent pas de « mal-être »pour autant. Ainsi, le thérapeuteadapte sa prescription en évaluant lecoût des transformations souhaitées,ou souhaitables, par rapport auxdoléances du malade. Celui-ci nemesure pas nécessairement l’ampleurdes thérapeut iques à mettre enœuvre, ignorant les coûts biologiquesimposés par la prothèse, d’autant plusinvasive qu’elle doit s’inscrire dans uncontexte occlusal et parodontal per-turbé (40) (fig. 1). L’analyse des anté-cédents ayant conduit à l’édentation(maladie carieuse, parodontale, trau-matisme …) corrélée à l’historiquedes traitements déjà réalisés est sou-vent révélatrice de la motivation dupatient. L’absence de soins est-elleconsécutive à un manque de moyensfinanciers, à une réticence psycholo-gique, ou, tout simplement, à unenégligence face à ses propresbesoins de santé ? Les motifs avan-cés masquent souvent les raisonsvéritables dont le praticien ne doit pasêtre dupe ; et particulièrement lorsqu’ils’agit d’esthétique, de la part de cer-tains patients dont l’amour propre
222 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 222
223JM. CHEYLAN
1 2
rechigne à reconnaître l’importanceimplicite qu’ils accordent à l’image qu’ilsoffrent à autrui ou plus simplement àeux-mêmes (11). Les doléances rela-tives à la fonction masticatrice sontpatentes dès lors qu’il ne subsiste pasplus de quelques couples de dentscuspidées antagonistes. Quel que soitle type de prothèse, la masticationsemble améliorée après une réhabili-tation prothétique, et cela d’autantplus que le nombre de dents rempla-cées est important (20, 21). L’absten-tion thérapeutique peut néanmoinsêtre discutée s’il n’y a pas de pertur-bation fonctionnelle dans la mesureoù la compensation de l’édentementprésenterait plus d’inconvénients quede bénéfice. Ainsi, en présenced’édentements bilatéraux postérieurs,les travaux de Käyser énoncent l’inté-rêt du concept de « l’arcade dentaireraccourcie », en particulier chez lespersonnes âgées. Il apparaît doncque la prise de décision résulted’abord d’une analyse empathique quidépasse le simple constat desdésordres visibles. Un niveau de lan-gage commun qui expose les enjeux,les risques et l’investissement entemps et en argent demandé aupatient est garant d’un engagementréciproque sur des objectifs de traite-ments et sur le choix des moyenspour les atteindre, sans en omettreles conséquences futures en termesde suivi et de maintenance.
CHOIX DES MOYENSTHÉRAPEUTIQUES
L’essor de la prothèse implanto-portée(PIP) a considérablement réduit lesindications de la prothèse amoviblepartielle à châssis métallique (PAP)depuis une quinzaine d’années, e tsensiblement diminué celle de la pro-thèse fixée conventionnelle (PF),puisqu’elle offre une alternative à laréalisation de ponts fixes nécessitantla préparation de dents saines oudéjà convenablement reconstituées(fig. 2, 3a et b). Les thérapeutiquesimplantaires, aujourd’hui bien codi-fiées, prennent une place de plus enplus importante malgré un coût élevéressenti par le patient. C’est le princi-pal obstacle à leur mise en œuvrepour le plus grand nombre au profitdes thérapeutiques conventionnelles(46). Deux autres paramètres peuventen limiter la prescription, qui relèvent,pour l ’un des contraintes anato-miques, pour l ’autre des consé-quences d’un geste chirurgical invasif.A ce titre, les contre-indications abso-lues et relatives à la chirurgie implan-taire sont celles de toute chirurgie,aggravées par certains facteurslocaux tels que le tabagisme (2, 32). Ilfaut tenir compte également d’unecertaine réticence à l’implantologie dela part de certains patients qui redou-tent la chirurgie (47) (fig. 4a et b).Paradoxalement, la plupart despatients rejettent l’idée de la prothèse
Fig. 1 - Moulages d’étude d’une patiente de 28 ans dont la demande est de compenserl’édentement disgracieux dû à l’absence de la premièreprémolaire. La perte précoce de la première molairemandibulaire a entraîné des migrations dentaires et rompul’harmonie occlusale. La proximité de la crête maxillaireavec les prémolaires, la distanceséparant 13 de 15 et l’égressionimportante de 16 nécessitent une réflexion dans le cadre d’une réhabilitation globale.Fig. 2 - Patiente de 41 ans dont la perte de 46 a été compenséepar une couronne implanto-portée.La réalisation d’un bridge de 45 à 47 aurait nécessité la mutilationde 45 et une réintervention sur la couronne de 47 dépulpée. Compte tenu du volume osseuxdisponible, la mise en place d’un implant constitue l’indicationde choix (chirurgie : F. Thomine).
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 223
224 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
3a b
5a b
4a b
Fig. 3a et b - Patiente de 77 ans quiprésente des doléances esthétiques
(visibilité de l’édentement maxillaire),fonctionnelles (mastication unilatérale) et
douloureuses dans la région articulairedroite. La réalisation de couronnes
implanto-portées permet de retrouver uncalage occlusal postérieur et une
mastication bilatérale tout en rétablissant une esthétique satisfaisante. La couronne
sur 16, ancienne mais correctementadaptée,
est légèrement retouchée sur sa facemésiale pour gagner de l’espace
prothétique.Fig. 4a et b - Patiente de 54 ans rétive à
tout traitement invasif. Malgré des conditions anatomiques
osseuses favorables et un bon supportparodontal
des dents bordant les édentements, lapatiente a refusé un traitement
implantaire, et s’est donné le temps de réfléchir avant
d’entreprendre un traitement par prothèsefixée. Un an plus tard, la patiente,satisfaite de sa prothèse amovible, ne souhaite pas envisager d’autre
thérapeutique prothétique.
Fig. 5 -a) Patient de 48 ans, fumeur, présentant trois édentement encastrés depuis une dizaine d’années. L’observation clinique révèle une abrasion
des bords libres des groupes incisivo-canins et l’égression de 44 et 45. Toutes les dents sont pulpées à l’exception de 27.b) Les édentements ont été traités par trois bridges céramo-métalliques. Deux onlays en céramique ont permis d’intégrer 44 et 45 à une courbe
occlusale harmonieuse. Les dents de sagesse, sans antagonistes, ont été extraites pour favoriser le maintien d’un environnement parodontal favorable autour de 17 et
27. Le pronostic des 2 bridges maxillaires dépend beaucoup du devenir des 2 molaires dont les racines sont convergentes et dont le support parodontal est diminué. On peut s’interroger sur la pertinence
d’un traitement implantaire qui aurait permis de préserver l’intégrité coronaire des dents support mais dans un contexte où les conditionsanatomiques n’étaient pas optimales et les facteurs locaux (tabac, parafonctions) défavorables (radiographie de contrôle à 2 ans).
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 224
225
amovible partielle lorsqu’une solutionfixée conventionnelle peut être envi-sagée, même au prix de la mutilationd’organes dentaires sains (fig. 5a etb). La prothèse amovible partielle estgénéralement déconsidérée par lespatients (49). Les raisons en sontmultiples et pour une grande partliées à l’ impact psychologique del’amovibilité, associée au vieillisse-ment, qui rappelle au patient son infir-mité à chaque fois qu’il enlève sa pro-thèse (14). L’altération de l’esthétiqueconstitue également une limite relati-ve à son indication, lorsque des élé-ments métalliques sont visibles, tels
les crochets qui assurent la rétention(fig. 6, 7a, b et c). L’encombrementest également une raison évoquée,compte tenu de la présence de faus-se gencive, d’éléments d’appui métal-liques en surcontour sur les dentssupport et d’éléments de connexionqui relient les selles (barre linguale,plaque palatine). A ces doléancess’ajoutent d’éventuels troubles de laphonation et une perturbation de lasensation gustative. D’un point de vuefonctionnel, il convient de distinguerdeux catégories d’édentements quiconditionnent pour une grande part laperception de stabilité de la prothèse
6
7a b
c
Fig. 6 - Patiente de 58 ans présentantune prothèse amovible compensant unédentement bilatéral postérieur. Lavisibilité des crochets sur les canines lorsdu sourire est rarement tolérée par les patients. Si la restauration dessecteurs postérieurs ne peut êtreenvisagée par de la prothèse implanto-portée, l’alternative esthétique sera deréaliser une prothèse composite en associant des prothèses fixées à dessystèmes d’attachement, ou de prescrireune prothèse complète si les conditionsparodontales et occlusales sontdéfavorables. Il apparaît clairement que les coûts biologiques et financiersvarient considérablement d’une solutionà une autre, bien que d’un point de vueesthétique les trois propositions soientsatisfaisantes.Fig. 7 - a) Patiente de 82 ans, coquette, qui aperdu deux bridges postérieurs enl’espace d’un an. Elle souhaite un traitement rapide et a relativementbien supporté la prothèse amovibletransitoire en résine post-extractionnelle.Elle pense être « trop vieille pour fairedes implants », mais ne veut pas decrochets métalliques visibles.b et c) Compte tenu du supportparodontal très favorable des dentsterminales, une prothèse composite estprescrite qui associe deux couronnesfraisées solidarisées sur 13 et 14 et unecouronne fraisée unitaire sur 23,munies de deux attachements glissière(Mini SG articulé®), à une prothèseamovible à châssis métallique. Malgréles volumineuses restaurations fouléessur les incisives, la patiente n’a passouhaité réaliser d’autres couronnes. Le recouvrement inter-incisif importantcontre-indique la réalisation d’unebarre cingulaire qui estsystématiquement préconisée dans lesédentements postérieurs de grandeétendue. Une attention particulière estapportée au choix de l’attachement quidoit autoriser un léger enfoncementdistal de la selle pour éviter toutetraction distale des dents terminales.
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 225
226 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
10a b
8 9a b
amovible. Les édentements encastréspermettent aux selles prothétiquesd’être en appui sur les dents bor-dantes, par l’intermédiaire d’appuisocclusaux. De ce fait, et grâce auchâssis métallique rigide, les forcesocclusales s’exerçant sur la selle sonttransmises aux dents. La prothèse estessentiellement dento-portée. Enoutre, les seuls mouvements autori-sés à la selle sont les déplacementsverticaux tributaires des axes d’inser-tion/désinsertion (fig. 8). En revanche,les édentements terminaux ne per-mettent pas de s ’aff ranchir desconséquences de la différence decompressibilité des dents d’une partet de la muqueuse alvéolaire d’autrepart. Il existe donc un phénomène derotation des selles prothét iquesautour d’un axe passant par les dents
Fig. 8 - Châssis métallique dont la selle est encastrée. Les dents bordant l’édentementparticipent à la sustentation prothétique par l’intermédiaire du taquet occlusal mésial sur
27 et de l’appui cingulaire sur 23. Un crochet de Bonwill du côté contro-latéral empêchetout risque de rotation de la selle autour d’un axe sagittal. Seul, un mouvement
d’insertion/désinsertion vertical est possible. On peut noter que la nécessité de rechercherune rétention sur 23 oblige à réaliser un crochet qui apparaît sur la face vestibulaire. Ici,
l’édentement est trop étendu pour envisager une restauration fixée conventionnelle.Fig. 9a et b -Châssis métallique destiné à compenser un édentement unilatéral postérieur
chez un patient bruxomane de 68 ans. La liaison de la selle se fait par l’intermédiaire d’une potence située en mésial de la dent bordant l’édentement pour ne pas entraîner une traction distale de celle-ci. La stabilisation et la rétention sont procurées, du côté
contro-latéral, par une barre corono-cingulaire et un crochet anneau sur une couronnefraisée. Compte tenu de l’abrasion importante des prémolaires, il n’a pas été réalisé
d’appuis occlusaux. La sustentation prothétique est essentiellement assurée par la largeplaque palatine et par la selle dont le volume a été appréhendé par une empreinte
fonctionnelle.Fig. 10 a) Patient de 53 ans présentant un édentement maxillaire unilatéral.
Celui-ci s’accompagne de pathologies carieuses, endodontiques et occlusales qu’ilconviendra de traiter dans le cadre d’une thérapeutique globale.
L’examen de la radiographie montre une hauteur osseuse importante dans la régionédentée, qui apparaît favorable, a priori, à la mise en place d’implants.
b) La réalisation prothétique vissée implanto-portée est réalisée après la phased’ostéointégration, de concert avec la reconstruction fixée conventionnelle mandibulaire
pour établir un schéma occlusal favorable. Une désocclusion postérieure immédiate est établie en propulsion et en latéralité
(chirurgie F. Renouard).
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 226
d’appui les plus distales qui peut êtreressenti avec désagrément par lepatient (fig. 9a et b). De plus, lorsquel’édentement est unilatéral, le patienta tendance à mastiquer du côté dentépour rechercher la proprioceptiondesmodontale qui fait défaut du côtéédenté. De fait, le recours à la prothè-se implanto-portée dans ces situa-tions d’édentements terminaux per-met d’éviter la prothèse amovible,seule alternative possible à l’absten-tion thérapeutique. Bien qu’il n’existepas de « proprioception » implantaire,la satisfaction des patients relative àla fonction masticatrice est patente(17) (fig. 10a et b). Il existe néan-moins de nombreuses situations oùles conditions anatomiques ne per-mettent pas la mise en place directed’implants endo-osseux postérieurs,particulièrement dans les secteursmaxillaires en présence d’une hauteurd’os insuff isante et de qualitémédiocre. Les techniques d’élévationosseuse de la région sous-sinusiennesont aujourd’hui fiables et bien docu-mentées (6, 39, 38, 19, 33). Lesméthodes d’élévation du planchersinusien par abord latéral font appel àde l’os autogène ou à des matériauxostéoconducteurs tels que de l’osbovin déprotéinisé ou des mélangesd’hydroxyapatite et de collagène. Sil’os autogène est considéré par cer-tains comme le standard des maté-riaux de comblement (ostéoinduc-
227JM. CHEYLAN
c
Fig. 11 - a) Patient de 56 ans. Toutes les dents cuspidées résiduelles sont perdues aumaxillaire. Le bridge à appui mixte dents/implants dans le secteur mandibulaire droits’est descellé à plusieurs reprises. On note la fracture des deux implants et l’atteintecarieuse de la dernière dent d’appui (48). Le patient est très motivé pour entreprendre untraitement qui lui assure une réhabilitation confortable et esthétique. L’examen de laradiographie contre-indique d’emblée un traitement implantaire au maxillaire sans avoirrecours à une chirurgie d’apposition, à laquelle souscrit le patient. Un plan de traitementest établi, comprenant une phase de temporisation par une prothèse amovible partielle aumaxillaire et la préservation du bridge mandibulaire droit en appui sur 44 et 48. Laprothèse amovible est posée le jour des extractions de 17, 15, 14, 24 et 26. La préservationde 18 et 28 permet d’assurer la rétention de la prothèse partielle qui ainsi ne comporte pasde crochet sur les canines. Les 2 implants fracturés seront déposés.b) Trois mois après les extractions, une xénogreffe d’apposition (Bio-Oss®) par abordlatéral est réalisée dans les 2 sinus maxillaires. Six mois plus tard, six implants de 11,5millimètres au maxillaire et trois implants de 8,5 millimètres à la mandibule sont posés,munis de leur pilier de cicatrisation.c) La prothèse vissée est réalisée cinq mois plus tard. Les dents antéro-supérieures assurentune désocclusion postérieure lors du guidage de la mandibule. La diduction est prise encharge par 13 et 23 sans qu’aucun glissement travaillant sur les bridges n’y participe. Les dents de sagesses sont extraites. Leur préservation, tout au long des phases detemporisation et pendant la phase de réalisation prothétique a plusieurs avantages. D’une part, elles permettent un ancrage postérieur des restaurations provisoires, d’autre part elles assurent un calage postérieur qui donne un repère particulièrement utilelors de l’enregistrement des rapports inter-maxillaires et des montages des modèles de travail en articulateur (chirurgies : F. Renouard).
11a b
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 227
teur), la simplification du geste chi-rurgical, associée aux taux de suc-cès des xénogreffes, font de cesdernières des techniques de choixdans la plupart des situations cli-niques (1, 12, 42). L’abord crestal,décrit par Summers en 1994 (tech-nique des ostéotomes), permet éga-lement l’apport de matériau de com-blement après décollement de lamembrane sinusienne par ballonisa-tion (36) (fig. 11a, b et c).
LONGÉVITÉ DES TRAITEMENTSPROTHÉTIQUESL’évaluation du pronostic des res-taurations prothétiques est difficile(48). Elle dépend d’un tel nombre deparamètres qu’elle relève souventde l’extrapolation à partir de méta-analyses issues de publicationsd’études cliniques. La définition des
taux de succès varie d’un auteur àl’autre : pour certains, la moindreréintervention signe l’échec (traite-ment d’une carie cervicale sur unedent pilier de bridge, par exemple),pour d’autres, au contraire, unemaintenance n’entraîne pas néces-sairement un échec si la prothèsedemeure fonctionnelle (22). En pro-thèse implanto-portée, le succèsprothétique est lui-même subordon-né au succès des implants (ostéoin-tégration), dont les critères d’évalua-tion énoncés par Zarb et Alberkts-son (1990) constituent une référen-ce internationale. Il y a déjà 10 ans,Öwall et coll., à partir d’une compila-tion d’études longitudinales, esti-maient la durée moyenne de survie(50 % de restaurations encore enplace) de différents types de pro-thèses destinées à compenser laperte d’une dent : 3 ans pour uneprothèse amovible partielle en rési-ne, 8 ans pour une prothèse amo-vible à châssis métallique, 10 anspour un bridge collé, une dizained’années pour un bridge céramo-métallique, 20 ans pour une prothè-se implanto-portée. Cet exemplecaricatural a le mérite d’apporterune quantification intéressante,aussi approximative soit-elle. Il appa-raît évident aujourd’hui, à quelquessituations exceptionnelles près, quela prothèse amovible partielle en rési-ne ne doit pas être considéréecomme une prothèse d’usage. Le
Fig 12 - a) Patient de 58 ans qui présenteun édentement antérieur de 5 dents,
consécutif à la perte d’un bridge dont undes piliers (23) s’est fracturé.
La nécessité de reconstruire13, 14, 15, 24,25 et 26 égressée aurait permis
d’envisager un bridge de grande étendue.Néanmoins, le porte-à-faux généré par les
dents intermédiaires était un élément défavorable qui a orienté
la prescription vers une solutionimplantaire pour remplacer les dents
absentes.b et c) Une prothèse plurale vissée sur 3
implants en place de 12, 21 et 23compense l’édentement antérieur. Les
autres dents sont restaurées par des couronnes unitaires, plus
favorables au maintien de la santéparodontale qu’une prothèse
monolithique. Le guidage de la mandibule en diduction gauche est
assuré par une fonction de groupe faisantparticiper la canine implanto-portée et les
prémolaires (chirurgie : F. Renouard).
228 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
12a b
c
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 228
Fig. 13a et b - Echec, après 14 ans,d’un bridge à appui mixtedent/implant. Une carie sur la dentpostérieure a provoqué unaffaissement responsable de lafracture des deux implants en placede 14 et 15, malgré une charnièreruptrice établie dans la construction.La fracture est située au niveau des 2 premières spires des implants. Un dépistage précoce de la lésionaurait vraisemblablement permis deprévenir cet échec.
recouvrement muqueux maximum nepermet pas le maintien de la santéparodontale des dents support,l’absence d’éléments d’appui sur lesdents favorise une compression délé-tère des tissus muqueux et la base enrésine ne procure pas une rigidité suf-fisante à la prothèse pour garantir lemaintien à long terme de la stabilitéocclusale. Ces inconvénients sontévités par la prothèse à châssismétallique dont la rigidité, le décolle-tage et la présence d’appuis métal-liques dentaires constituent des impé-ratifs qui ne sont plus discutésaujourd’hui (3). L’évaluation de la lon-gévité des PAP a fait l’objet de nom-breuses études longitudinales dont ladifficulté ne réside pas tant dansl’appréciation des critères de succès(port ou non de la prothèse, état desdents support, évolution parodonta-le…) que dans la multiplicité desformes d’édentements compensés etdes conceptions choisies pour l’archi-tecture des châssis. En effet, celle-cidépend de nombreux paramètres(classe d’édentement, nombre et étatparodontal des dents restantes, quali-té du support ostéo-muqueux,concept occlusal…) dont l’apprécia-tion n’est pas toujours appréhendéede la même façon par différents prati-
ciens. Il est d’ail leurs à déplorerqu’aujourd’hui encore, un grandnombre de praticiens délègue au pro-thésiste dentaire l’architecture deschâssis métalliques, alors que celui-cin’a aucune connaissance des para-mètres cliniques qui en guident laconception (18). La confrontation dequelques études, aux critères de suc-cès parfois différents, montre destaux de survie des PAP de l’ordre de80 % à 3 ans et 50 % à 10 ans (4, 8,37, 45). Les prothèses mandibulairessemblent présenter p lus dedéfaillances qu’au maxillaire, et lesnécessités de réfection de la résinedes selles dans le cadre de la mainte-nance plus souvent nécessaire pourles prothèses en extension (29, 43,44). Tous les auteurs s’accordent àconsidérer la maintenance prothé-tique comme un facteur clé de ladurabilité. Des contrôles programméspermettent l’interception de lésionsdébutantes et des réfections de baserégulières empêchent l’installation decontraintes mécaniques nocives pourles surfaces d’appui tout en pérenni-sant la stabilité occlusale (5). La lon-gévité des traitements par prothèsefixée conventionnelle a été évaluée à10,3 ans par Schwartz et coll. dansune étude retrospective de 1970.
229JM. CHEYLAN
13a b
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 229
Karlsson (22) donne 93,3 % debridges toujours en place après 10ans, bien que 10 % de dents pilierpulpées au départ donnent dessignes radiologiques de lésions péria-picales. Glantz et coll. (15) rapportent67,5 % de succès de bridges de gran-de étendue à 15 ans, et Creugers (9),dans une méta-analyse, calcule unemoyenne de taux de survie 74 %après 15 ans (fig. 12a, b et c). Lescauses d’échecs sont principalementdues à des caries et à des fracturesradiculaires. Les risques d’échecssont plus importants en présenced’éléments en extensions (cantile-vers) (31, 23). La prothèse implanto-portée apparaît aujourd’hui commeune thérapeutique extrêmement fiableet d’excellent pronostic. Les étudeslongitudinales concernant le traite-ment de l’édenté complet mandibulai-re en font une thérapeutique de réfé-
rence dont le succès à long terme estbien établi (7, 28). Les publications,plus récentes, concernant la prothèseunitaire établissent des taux de suc-cès rarement inférieurs à 90 % après10 ans, mais un peu moindres pour laprothèse partielle plurale (10, 27, 34).Néanmoins, aussi prometteuse soit-elle, la prothèse implanto-portée resteune thérapeutique jeune dont denombreux aspects continuent à susci-ter interrogations et débat passionné,(paramètres biomécaniques, compor-tement biologique, solidarisationdent/implant…(26) (fig. 13a et b) etque les études à venir contribueront àmieux en appréhender les implica-tions chez l’édenté partiel.
CONCLUSIONLa prise de décision en prothèse nousengage ainsi que le patient vers unétat prévisible qui doit être clairementdéfini. Les enjeux, les risques et la pla-nification d’un traitement ne peuventêtre abordés qu’après une synthèsedes désordres biologiques, physiolo-giques et parfois psychiques, dont laperception et l’interprétation que s’enfait le patient constituent le point dedépart. De ce fait, la prescription estsingulière. Elle engage d’abord notresavoir, notre intuition et notre raison.Le savoir-faire ne vient que concrétiserle projet issu de cette réflexion.
RemerciementsRadiologie : R. Cavezian et G. PasquetProthèse fixée : Laboratoires C. Riveron et J. GuerreroProthèse amovible : LaboratoiresPBM 92 et S. Hurtado
230 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
La décision de restauration d’un édentement partiel dépend de :• la demande du patient, exprimée ou non : le handicap, l’esthétisme etle confort sont des notions très subjectives ; il est capital de connaîtreson histoire dentaire afin d’élaborer un plan de traitement parfaitementaccepté par le patient.• les moyens thérapeutiques : le choix dépend de la connaissanceexhaustive des possibilités thérapeutiques, des coûts biologiques etfinanciers, du pronostic, du recul clinique, de la compétence de chacunet du plateau technique. Les patients rejettent majoritairement la prothè-se amovible notamment pour des problèmes d’intégration psycholo-gique, le handicap restant présent.La longévité des restaurations est difficile à estimer. La PAP résine doitêtre considérée comme une prothèse provisoire. 50 % des PA à châssismétalliques sont encore présentes à 10 ans contre près de 90 % des bridgeset implants. A 10 ans, 10 % des dents initialement pulpées support de brid-ge ont une lésion périapicale radiographiquement objectivable.
EN PRAT I Q U E
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 230
231JM. CHEYLAN
1. BACCAR MN, LAURE B, CHABUT A,BONIN B, ROMIEUX G, GOCA D. -Stability of grafts and implants after bonegrafting of the maxillary sinus. Retrospecti-ve analysis of 44 patients. Rev Stomatol ChirMaxillofac. 2005;106:153-156.
2. BAIN CA, MOY PK. - The association bet-ween the failure of dental implants andcigarette smoking. Int J Oral MaxillofacImplants. 1993;8:609-615.
3. BEGIN M, FOUILLOUX I. - La prothèsepartielle amovible. Conception et tracés des châs-sis. Quintessence, Paris. 2004.
4. BERGMAN B, HOGOSON A, OLSSONCO. - Caries, periodontal and prostheticfindings in patients with removable partialdentures. A 10-year longitudinal study. JProsthet Dent. 1982;48:506-514.
5. BERGMAN B, HOGOSON A, OLSSONCO. - 25-year longitudinal study of patientstreated with removable partial dentures. JOral Rehabil. 1995; 22: 595-599.
6. BOYNE PJ, JAMES RA. - Grafting of themaxillary sinus floor with autogenous mar-row and bone. J Oral Surg. 1 9 8 0 ; 3 8 : 6 1 3 - 6 1 6 .
7. BRÅNEMARK PI, ZARB GA,ALBREKTSSON T. - T i s s u e - i n t e g r a t e dprostheses. Osseointegration in clinical dentistry.Chicago, Quintessence book, 1985.
8. COWAN RD, GILBERT JA, ELLEDGEDA, Mc GLYNN FD. - Patient use ofremovable partial dentures: two- and fouryear telephone interviews. J Prosthet Dent.1991;65:668-670.
9. CREUGERS NHJ, KÄYSER AF,VANT’HOF MA. - A meta analysis ofdurability data on conventional f ixedbridges. Community Dent Oral Epidemiol.1994;22:448-452.
10. CREUGERS NH, KREULEN CM,SNOEK PA, De KANTER RJ. - A syste-matic review of single-tooth restorationssupported by implants. J Dent.2000;28:209-217.
11. DECHARRIERE-HAMZAWI H,SAVARD G, TIRLET G, ATTAL JP. -Dentisterie esthétique et santé. Inf Dent.2007;24:1381-1388.
12. Del FABBRO M, TESTORI T, FRAN-CETTI L, WEINSTEIN R. - Systematicreview of survival rates for implants placed
in the grafted maxillary sinus. Int J Perio-dontics Restorative Dent. 2004;24(6):565-577.
13. ELDERTON RJ. - Variation among den-tists in planning treatment. Br Dent J.1983;154:201-206.
14. FISKE J. DAVIS DM. FRANCES C.GELBIER S. - The emotional effects oftooth loss in edentulous people. Br Dent J.1998;184:90-93.
15. GLANTZ PO, NILNER K, JENDRE-SEN MD, SUNDBER H. - Quality offixed prosthodontics after 15 years. A c t aOdontol Scand. 1993;51:247-252.
16. GUNNE H-SJ. - The effect of removablepartial dentures on mastication and dietaryintake. Acta Odontol Scand. 1 9 8 5 b ; 4 3 : 2 6 9 - 2 7 8 .
17. HARALDSON T, ZARB GA. - A 10-yearfollow-up study of the masticatory systemafter treatment with osseointegratedimplant bridges. Scand J Dent Res. 1 9 8 8 ;9:243-252.
18. HOLT RD, RULE DC, BASKER RM,DAVENPORT JC, RALPH JP, MURRAYJJ, EATON KA. The influence on partialdenture design of a teaching video for gene-ral dental practitioners. Br Dent J.1994;176:379-385.
19. JENSEN OT, SHULMAN LB, BLOCKMS, IACONO VJ. - Report of the SinusConsensus Conference of 1996. Int J OralMaxillofac Implants. 1998;13(suppl):11-45.
20. KAPUR KK. - Veterans administrationcooperative dental implant study-Compari-sons between fixed partial dentures suppor-ted by blade-vent implants and removablepartial dentures. Part III: Comparisons ofmasticatory scores between two treatmentm o d a l i t i e s . J Prosthet Dent. 1 9 9 1 ; 6 5 : 2 7 2 - 2 8 3 .
21. KAPUR KK, GARRETT NR, DENT RJ,HASSE AL. - A randomized clinical trial oftwo basic removable partial denture desi-gns. Part II: Comparisons of masticatoryscores. J Prosthet Dent. 1997;78:15-21.
22. KARLSSON S. - A clinical evaluation offixed bridges 10 years following insertion. JOral Rehabil. 1986;13:423-432.
23. KARLSSON S. - Failures and length ofservice in fixed prosthodontics after long-term function. A longitudinal clinical study.Swed Dent J. 1989;13:185-192.
BIBLIOGRAPHIE
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 231
232 REALITES CLINIQUES Vol. 18 n° 3 2007
24. KÄYSER AF. - Shortened dental archesand oral function. J Oral Rehabil.1981;8:457-462.
25. KÄYSER AF. - Limited treatment goals-shortened dental arches. P e r i o d o n t o l o g y2000. 1994;4:7-14.
26. LANG NP, PJETURSSON BE, TAN K,BRAGGER U, EGGER M, ZWAHLENM. - A systematic review of the survival andcomplication rates of fixed partial dentures(FPDs) after an observation period of atleast 5 years. II. Combined tooth-implant-supported FPDs. Clin Oral Implants Res.2004;15(6):643-653.
27. LINDH T, GUNNE J, TILLBERG A,MOLIN M. - Meta-analysis of implants inpartial edentulism. Clin Oral Implants Res.1998;9:80-90.
28. LINDQUIST LW, CARLSSON GE,JEMT T. - A prospective 15-year follow-upstudy of mandibular fixed prosthese suppor-ted by osseointegrated implants. Clinicalresults and marginal bone loss. Clin OralImplants Res. 1996;7(4):329-336.
29. NICHOLSON L, TURCOTTE F. -Caractéristiques cliniques affectant le besoinde regarnissage des pièces de prothèsesamovibles de Classe 1 et 2 à la mandibule. JCan Dent Assoc.1 9 9 2 ; 5 8 ( 1 2 ) : 1 0 1 5 - 1 0 2 4 .
30. ÖWALL B, KÄYSER AF, CARLSSONGE. - Données sur la prothèse dans lemonde. In : Öwall B, Käyser AF, CarlssonGE. Prothèse dentaire. Principes et stratégiesthérapeutiques. Paris, Masson, 1998. pp9-19.
31. RANDOW K, GLANTZ PO, ZÖGER B. -Technical failures and some related clinicalcomplications in extensive fixed prostho-dontics. Acta Odontol Scand. 1986;44:241-55.
32. RENOUARD F, RANGERT B. - Facteursde risque et traitements implantaires. P a r i s ,Quintessence, 1999.
33. ROSEN PS, SUMMERS R, MELLADOJR, SALKIN LM, SHANAMAN RH,MARKS MH, FUGASOTTO PA. - Thebone-added osteotome sinus floor elevationtechnique : multicenter retrospective reportof consecutively treated patients. Int J OralMaxillofac Implants. 1999;14:853-854.
34. SCHOLANDER S. - A retrospective eva-luation of 259 single-tooth replacements bythe use of Bränemark implants. Int J Pros-thodont. 1999;12:483-91.
35. SCHWARTZ NL, WHITSETT LD,BERRY TG, STEWART JL. - Unservi-
ceable crowns and fixed partial dentures:life-span and causes for loss of serviceabili-ty. J Am Dent Assoc. 1970;81:1395-1401.
36. SOLTAN M, SMILER DG. - Antralmembrane balloon elevation. J Oral Implan-tol. 2005;31(2):85-90.
37. STUDER SP, MÄDER C, STAHEL W,SCHÄRER P. - A retrospective study ofcombined fixed-removable reconstructionswith their analysis of failures. J Oral Rehabil.1998;25:513-526.
38. SUMMERS RB. - The osteotome tech-nique: Part 3- Less invasive methods of ele-vating the sinus floor. C o m p e n d i u m .1994;15(6):698-710.
39. TATUM H Jr. - Maxillary and sinusimplant reconstruction. Dent Clin NorthAm. 1986;30:207-229.
40. VALENTIN C, MARTINEAU C. - L aconsultation en odontologie. Paris, SNPMD,1984;130 p., ill.
41. VALENTIN CM. - Du plan au program-me de traitement : méthodes et stratégie.Réal Clin.1995 ;6(1):17-23.
42. VALENTINI P, ABSENSUR D. - Maxilla-ry sinus grafting with anorganic bovine bone:A clinical report of long term results. Int JOral Maxillofac Implants. 2 0 0 3 ; 4 : 5 5 6 - 5 6 0 .
43. VANZEVEREN C, D’HOORE W,BERCY P, LELOUP G. - Treatment withremovable partial dentures: a longitudinalstudy. Part I. J Oral Rehabil. 2 0 0 3 ;30(5):447-458.
44. VANZEVEREN C, D’HOORE W,BERCY P, LELOUP G. - Treatment withremovable partial dentures: a longitudinalstudy. Part II. J Oral Rehabil . 2 0 0 3 ;30(5):459-469.
45. VERMEULEN AH, KELTJENS HM,VAN’T OF MA, KÄYSER AF. - Ten-yearevaluation of removable partial dentures :Survival rates based on retreatment, notwearing and replacement. J Prosthet Dent.1996;76(3):267-272.
46. WALTON JN. MacENTEE MI, HAN-VELT R. - A cost analysis of fabricatingimplant prostheses. Int J Prosthodont.1996;9:271-276.
47. WALTON JN, Mac ENTEE MI. - Choo-sing or refusing oral implants : a retrospec-tive study of edentulous volunteers for a cli-nical trial. Int J Prosthodont. 2005;18:483-88.
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 232
48. WATSON P. - Longevity expectations ofprosthodontic treatments for dentate andedentulous patients. Int J Prosthodont.
2003;16(suppl):66-68.
49. WETHERELL JD, SMALES RJ. - Partialdenture failures : a long-term clinical sur-vey. J Dent. 1980;8:333-340.
50. WÖSTMANN B, MUSHIMOTO E,SOFOU A. - Indications for removable par-tial dentures A literature review. Int J Pros-thodont. 2005; 18:139-145.
51. ZARB GA, ALBERKTSSON T. - Critèresdéterminant le succès clinique des implantsdentaires ostéo-intégrés. Cah Prothese.1990;71:19-26.
233JM. CHEYLAN
RÉSUMÉ
ÉDENTEMENT PARTIEL. PRESCRIPTION DU TRAITEMENT PROTHÉTIQUEL’édentement partiel se présente sous des formes multiples. Sa compensation prothétique tient compte à la fois d’unconstat exhaustif des troubles objectifs répertoriés et des doléances du patient qui consulte. Les moyens detraitement actuels à notre disposition (prothèse amovible partielle, prothèse fixée conventionnelle et prothèseimplanto-portée) sont confrontés aux coûts biologiques et financiers qu’entraînent leur mise en œuvre, aux avantagesqu’ils procurent, ainsi qu’à leur pronostic à long terme pour aboutir à un choix thérapeutique pertinent.
ABSTRACT
PARTIAL EDENTULISM PRESCRIPTION FOR PROSTHETIC TREATMENTPartial edentulism is found in multiple forms. Its prosthetic compensation must take into account an exhaustiveinvestigation of both the objective problems and the complaints of the patient who appears for consultation. Thetreatment approaches presently available to us (partial removable prostheses, conventional fixed prostheses, andimplant-supported prostheses) each have biological and financial costs associated with their placement, certainadvantages which they achieve, and, as well, long term prognoses, all of which should enter into an appropriatetreatment choice.
RESUMEN
DESDENTAMIENTO PARCIAL. PRESCRIPCION DEL TRATAMIENTO PROTESICO El desdentamiento parcial se presenta en múltiples formas. Su compensación protésica toma en cuenta a la vez unaobservación exhaustiva de los trastornos objetivos registrados y de las dolencias del paciente que consulta. Losactuales medios de tratamiento a nuestra disposición (prótesis amovible parcial, prótesis fija convencional y prótesisimplantosoportada), están confrontados a los costes biológicos y financieros, resultado de su aplicación, a lasventajas que aportan, así como a su pronóstico a largo plazo para elegir una opción terapéutica pertinente.
Correspondance :Jean-Marie Cheylan71 rue de Rennes75006 ParisFRANCEemail : [email protected]
RC Cheylan 26/10/07 14:36 Page 233