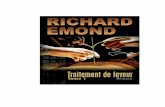Réimaginer des communautés? Le traitement précoce contre le VIH/sida en Côte d'Ivoire
"Les standards indirects de traitement - Traitement de la nation la plus favorisée et traitement...
-
Upload
univ-paris13 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of "Les standards indirects de traitement - Traitement de la nation la plus favorisée et traitement...
DROIT INTERNATIONAL DES INVESTISSEMENTS ET DE L’ARBITRAGE TRANSNATIONAL
PARIS, PEDONE, 2015
CHAPITRE 7
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT : TRAITEMENT DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
ET TRAITEMENT NATIONAL
JULIEN CAZALA
« L’interférence ou l’influence des Etats dans l’activité des investisseurs prend la forme de “mesures” ou de l’absence de mesures, ce qui inclut l’instauration et l’application de lois et de règlements, de pratiques et de toute forme de conduite réglementaire »1. Ce sont ces éléments déterminant le régime applicable à l’investisseur et à l’investissement que l’on désigne sous le terme de traitement dans les instruments internationaux relatifs à l’investissement.
Contrairement au standard du traitement juste et équitable qui, sous réserve d’identification, a un contenu matériel propre, les standards du traitement national et de la nation la plus favorisée reposent sur un système d’indexation sur un régime juridique dicté dans un instrument autre que celui les contenant. En ce sens, ils sont qualifiés de standards indirects, contingents ou relatifs de traitement.
A l’exception des premiers traités bilatéraux de promotion et de protection de l’investissement (TBI) conclus par quelques Etats sud-américains, tous les TBI incluent la clause de la nation la plus favorisée2. Les références au principe du traitement national ne bénéficient pas de la même automaticité. Souvent associés dans un instrument international, les deux standards peuvent voir leur champ d’application respectif varier sensiblement.
Malgré ces variations, les deux principes obéissent à une logique commune. Ainsi, le tribunal arbitral de l’affaire Parkerings-Compagniet explique que « [m]ost-favoured-nation (MFN) clauses are by essence very similar to “National Treatment” clauses. They have similar conditions of application and basically afford indirect advantages to their beneficiaries, namely a treatment no less favourable than the one granted to third parties. Tribunals’ analyses of the
Julien CAZALA, Maître de conférences en droit public, Université d’Orléans, détaché en qualité d’expert technique international du ministère des Affaires étrangères auprès de l’Université Galatasaray (Istanbul). 1 CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, New York/Genève, Nations Unies, 2010, p. 15. 2 R. DOLZER, M. STEVENS, Bilateral Investment Treaties, The Hague/Boston, Martinus Nijhoff, 1995, p. 65.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
278
National Treatment standard will therefore also be useful to discuss the alleged violation of the MFN standard »3.
La définition (I.), les conditions de mise en œuvre (II.), l’étendue des bénéfices pour l’investisseur ou l’investissement (III.) et l’articulation entre ces standards (IV.) seront successivement présentés.
I. DÉFINITION DES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
Le droit des investissements, à l’instar du droit international des échanges, accorde une place privilégiée aux standards permettant d’assurer qu’aucune discrimination ne pourra être imposée, à raison de la nationalité, entre des acteurs placés dans des situations semblables. La clause de la nation la plus favorisée pose un principe d’égalité entre des investisseurs étrangers, en s’alignant sur le régime le plus favorable accordé à l’un d’entre eux. Le principe du traitement national impose, dans la grande majorité des instruments, à l’Etat d’accorder à l’investisseur étranger un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à un investisseur national4. Il n’est donc pas nécessairement question d’égalité entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers, sauf quand, comme c’est le cas dans quelques instruments, est posée une exigence de traitement identique5. Nous définirons successivement la clause de la nation la plus favorisée (A) et le principe du traitement national (B).
A. La clause de la nation la plus favorisée
Très ancienne, la clause de la nation la plus favorisée met en œuvre un jeu à trois6. Le dictionnaire du droit international la présente comme étant une « [d]isposition fréquemment utilisée, spécialement dans les traités de commerce, par laquelle les parties se garantissent le bénéfice d’avantages plus importants que l’une d’entre elles viendrait à accorder ultérieurement à un Etat tiers par un autre traité portant sur la même question »7. La définition, à tiroirs, qu’en donne la Commission du droit international des Nations Unies est plus précise. Il est affirmé qu’une « clause de la nation la plus favorisée est une disposition conventionnelle par laquelle un Etat assume à l’égard d’un autre l’obligation
3 Parkerings-Compagniet AS c. République de Lituanie, ICSID/ARB/05/8, sentence du 11 septembre 2007, § 366. 4 Accord de libre-échange nord-américain, Washington, 17 décembre 1992, art. 1102 ; modèle français de TBI, 2006, art. 5. 5 Community Investment Code of the Economic Community of the Great Lakes Countries (GEPGL), 31 janvier 1982, art. 9. 6 Pour une présentation historique complète de la clause de la nation la plus favorisée : « Premier rapport sur la clause de la nation la plus favorisée, par M. Endre Ustor, rapporteur spécial », Annuaire de la Commission du droit international, 1969, vol. II, pp. 163-193. 7 Dictionnaire de droit international public, J. SALMON (ed.), Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p. 178. Il convient de relever que ce que l’on désigne par l’expression « traité de commerce » va bien au-delà de la question du traitement des commerçants, de sorte que ceux-ci sont fréquemment considérés comme de « véritables chartes des droits des étrangers », B. NOLDE, « Droit et technique des traités de commerce », RCADI 1924-II, t. 3, p. 362.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
279
d’accorder le traitement de la nation la plus favorisée dans un domaine convenu de relations » ; « [l]e traitement de la nation la plus favorisée est le traitement accordé par l’Etat concédant à l’Etat bénéficiaire, ou à des personnes ou à des choses se trouvant dans un rapport déterminé avec cet Etat, non moins favorable que le traitement conféré par l’Etat concédant à un Etat tiers ou à des personnes ou des choses se trouvant dans le même rapport avec cet Etat tiers »8.
Il est fréquent que les accords conclus par les Etats en matière d’investissements se contentent de faire référence au régime de la nation la plus favorisée sans en expliquer le mécanisme. Ainsi, le TBI France – Bahreïn de 2004 indique que « [c]haque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements […] le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée »9.
La présentation la plus claire des effets du mécanisme consiste à dire que la clause peut être présentée « à l’image d’un flotteur, qui permet à son possesseur de se maintenir au niveau le plus élevé des obligations acceptées envers les Etats étrangers par l’Etat concédant ; s’il s’abaisse, le flotteur ne peut se transformer en ballon pour maintenir artificiellement le bénéficiaire de la clause au-dessus du niveau général des droits exercés par les autres Etats »10. La pratique ancienne consistant à conditionner le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée au respect d’un principe de réciprocité a aujourd’hui totalement disparu, mais cela ne signifie pas, comme on le verra, que l’Etat qui consent à cette disposition ne peut pas en moduler les effets (voir infra, III.).
B. Le standard du traitement national
Parfois présenté comme le standard le plus politiquement et économiquement sensible du droit international des investissements, le traitement national concerne les relations entre l’Etat hôte, les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers11. Le traitement national a ses fondements dans la pratique conventionnelle de la Ligue hanséatique au XIIème siècle. Avec le développement du recours aux traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements, le principe du traitement national interdit de traiter l’investisseur étranger d’une manière plus défavorable que l’investisseur national12. Une formulation classique est utilisée à l’article 4 du TBI conclu entre la France et Bahreïn disposant que « [c]haque Partie contractante applique, […] 8 « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa trentième session », Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. II, 2e partie, p. 21 et p. 24. 9 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, Paris, 24 février 2001, art. 4. 10 C. ROSSILLION, « La clause de la nation la plus favorisée dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice », JDI, 1955, p. 106. 11 OECD, National Treatment of International Investment in South East European Countries: Measures Providing Exceptions, Paris, OECD, 2003, p. 1. 12 Certains instruments isolés renvoient à une obligation d’égalité de traitement entre l’investisseur étranger et l’investisseur national : The Community Investment Code of the Economic Community of the Great Lakes Countries, 31 janvier 1982, art. 9.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
280
aux nationaux ou sociétés de l’autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés […] »13.
Si cette disposition est parfois considérée sœur de la clause de la nation la plus favorisée, il est nécessaire de mentionner qu’elle est la moins fréquente des deux clauses indirectes de traitement. Les débats menés au sein de l’Organisation des Nations Unies pour l’élaboration d’un code de conduite des entreprises transnationales furent très largement focalisés sur le refus des pays en développement d’accorder aux investisseurs étrangers le traitement national. Ainsi, bien que celui-ci soit très largement présent dans ces instruments, il existe encore des modèles de TBI qui ne prescrivent pas l’obligation d’accorder à l’investisseur étranger le bénéfice du traitement national14. Encore est-il possible de rencontrer des accords relatifs à l’investissement dans lesquels le principe du traitement national repose, en totalité ou pour certains secteurs économiques, sur une base de réciprocité. Au-delà de son inclusion dans un nombre toujours plus important d’instruments internationaux relatifs à l’investissement, le principe du traitement national est également largement diffusé dans les législations nationales applicables aux investissements étrangers15.
Les Etats étant plus enclins à opérer des discriminations entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers, plutôt qu’au sein de cette dernière catégorie, on comprend leur très grande sensibilité à cette disposition. Il est ainsi exceptionnel, comme nous le verrons (infra, § III), que le principe du traitement national en matière d’investissements soit exprimé sans que de nombreuses limites lui soient apportées.
II. LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée obéissent à deux séries de conditions de mise en œuvre. Une base légitime de comparaison doit exister entre deux investisseurs ou deux investissements (A) et on doit constater que l’un bénéficie d’un traitement plus favorable que l’autre (B).
A. Une base légitime de comparaison
La clause de la nation la plus favorisée ne pourra déployer ses effets qu’à la condition que le régime plus favorable contenu dans un accord conclu avec un tiers intervienne dans le même « domaine » que l’accord porteur de la clause. On 13 Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, Paris, 24 février 2001, art. 4. 14 Malaysia 1998 Model BIT. Les premiers TBI conclus par la République populaire de Chine, la Suède ou la Norvège ne consacraient pas le principe du traitement national. Quelques modèles de TBI limitent le principe du traitement national à la compensation des dommages de guerre : Islamic Republic of Iran 2001 Model BIT, art. 7 ; Kingdom of Cambodia 1998 Model BIT, art. V. 15 World Bank, Legal Framework for the Treatment of Foreign Investments, vol. 1 : Survey of Existing Instruments, Washington, D.C., World Bank, 1992, 229 pages.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
281
parle de règle de l’identité de genre ou ejusdem generis. Elle est si fondamentale qu’il fut affirmé qu’aucun « auteur ne songerait à nier la validité de la règle ejusdem generis, qui découle de la nature même de la clause de la nation la plus favorisée »16.
Il s’agit donc de considérer que la clause de la nation la plus favorisée ne peut établir un pont qu’entre traités dont la matière est identique ou similaire (a). Une fois cette condition propre à la clause de la nation la plus favorisée satisfaite, on pourra rechercher la réalisation de la condition de similarité du bénéficiaire d’un standard indirect de traitement à un bénéficiaire d’un traitement déterminé. Cette dernière condition est commune aux deux standards indirects de traitement (b).
1. La règle ejusdem generis : une condition propre au traitement de la nation la plus favorisée
Pierre Pescatore affirme dans le cadre d’un rapport présenté à l’Institut de droit international que « pour que la clause [de la nation la plus favorisée] puisse produire son effet, il faut qu’il y ait identité d’objet entre la convention qui comporte la clause et celle qui confère l’avantage revendiqué par le bénéficiaire »17. Ainsi, le bénéfice d’une disposition d’un traité de paix ne peut être invoqué par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée insérée dans un traité relatif à l’investissement international.
L’affaire Ambatielos, opposant la Grèce au Royaume-Uni devant une commission d’arbitrage ad hoc, fut l’occasion de préciser la question de l’identité ou de la similarité entre traités dans l’application de la clause de la nation la plus favorisée. La Grèce invoquait, par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée insérée dans un traité conclu avec le Royaume-Uni, le bénéfice de dispositions relatives à la soumission des étrangers aux juridictions internes contenues dans des traités de navigation et de commerce conclus par le Royaume-Uni. La décision pose que « the Commission holds that the most-favoured-nation clause can only attract matters belonging to the same category of subject as that to which the clause itself relates »18. Ainsi, il n’est pas suffisant que les deux traités aient pour objet principal le commerce et la navigation pour que la clause de la nation la plus favorisée puisse pleinement produire ses effets. La commission d’arbitrage exige également que les deux dispositions que l’on entend relier par le jeu de la clause appartiennent à la même catégorie. Ce n’était pas le cas en l’espèce. La clause de la nation la plus favorisée rédigée en des termes très généraux dans le traité Grèce – Royaume-Uni prévoyait qu’elle s’appliquait à toutes les questions relatives au commerce et à la navigation. Or, la Grèce entendait que son ressortissant bénéficie de dispositions, sans lien direct avec le commerce et la navigation, de divers traités conclus par le Royaume-Uni avec des tiers. 16 « Quatrième rapport sur la clause de la nation la plus favorisée, par M. Endre Ustor, rapporteur spécial », Annuaire de la Commission du droit international, 1973, vol. II, p. 105. 17 P. PESCATORE, « La clause de la nation la plus favorisée dans les conventions multilatérales », Annuaire de l’Institut de droit international 1969, vol. 53, tome I, p. 121. 18 The Ambatielos Claim (Greece, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), sentence du 6 mars 1956, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII, p. 107.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
282
La règle ejusdem generis vient significativement limiter les bouleversements potentiellement opérés sous l’action de la clause de la nation la plus favorisée dans la mesure où, malgré l’augmentation du nombre d’instruments juridiques relatifs à l’investissement, les contenus des accords conclus par un même Etat diffèrent rarement d’un traité à l’autre, spécialement pour ceux recourant à des modèles de TBI19. Il est ainsi relativement rare de voir se développer des revendications sur ce point devant les tribunaux compétents en matière de contentieux de l’investissement20.
2. Similarité de la situation des bénéficiaires : une condition commune aux deux standards indirects de traitement
Par les standards indirects de traitement, les Etats parties à un traité visent à se reconnaître mutuellement le traitement plus favorable qu’ils accordent à des tiers (national ou étranger). Le résultat de la mise en œuvre de ces standards est donc au minimum un alignement sur un régime existant. Il ne sera procédé à celui-ci qu’à la condition que des sujets semblables soient placés dans des situations semblables. La Commission du droit international des Nations Unies pose le principe en indiquant que des sujets pourront bénéficier de l’extension par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée s’ils « a) appartiennent à la même catégorie de personnes ou de choses que celles se trouvant dans un rapport déterminé avec un Etat tiers qui bénéficient du traitement qui leur est conféré par l’Etat concédant et b) se trouvent avec l’Etat bénéficiaire dans le même rapport que celui dans lequel les personnes et les choses visées à l’alinéa a) se trouvent avec cet Etat tiers »21. Dans le même sens au sujet de l’application du principe du traitement national, le tribunal arbitral de l’affaire Champion Trading indique que « [t]he national treatment obligation does not generally prohibit a State from adopting measures that constitute a difference of treatment. The obligation only prohibits a State from taking measures resulting in different treatment in like circumstances »22.
C’est le plus souvent la similarité qui est retenue dans la pratique conventionnelle des Etats et non la stricte identité qui viendrait limiter considérablement les vertus recherchées de libéralisation des marchés découlant des standards indirects de traitement. Tout tribunal s’étant prononcé sur une relation de similarité entre deux sujets ou deux situations indique que celle-ci est
19 Le recours aux modèles de TBI est aujourd’hui extrêmement fréquent. Ainsi, la base de données de la CNUCED sur les accords relatifs à l’investissement n’identifie pas moins de 32 modèles nationaux ou régionaux de TBI : [http://www.unctadxi.org/templates/Startpage_718.aspx]. 20 Rumeli Telekom A.S. and Tesim Mobil Telekomikasyon Hizmetleri A.S. c. Kazakhstan, ICSID/ARB/05/16, sentence du 29 juillet 2008. On n’évoque pas ici le contentieux portant sur l’extension du traitement de la nation la plus favorisée aux dispositions concernant l’administration de la justice. 21 « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa trentième session », op. cit., p. 31. 22 Champion Trading Company and Ameritrade International c. Egypte, ICSID/ARB/02/9, sentence du 27 octobre 2006, § 130. Dans le même sens : Antoine Goetz et consorts c. Burundi, CIRDI/ARB/95/3, sentence du 10 février 1999, § 121.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
283
toujours relative et qu’il n’est pas envisageable de procéder à un test purement mécanique pour identifier cette similarité23.
Trois éléments peuvent être mis en lumière : la similarité des bénéficiaires (a), la similarité des circonstances dans lesquelles ils sont placés (b) et les limitations apportées aux conséquences de la similarité (c).
a. Les bénéficiaires similaires
Dans le champ du droit international des investissements, la clause de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national peuvent viser les investisseurs et les investissements24. La pratique conventionnelle la plus fréquente consiste à désigner les investissements comme bénéficiaires des standards indirects de traitement25.
Quelques instruments dissocient les bénéficiaires du traitement de la nation la plus favorisée et du traitement national. Ainsi, le TBI Inde – Colombie de 2009 prévoit la reconnaissance du traitement de la nation la plus favorisée au bénéfice des investisseurs, tandis que le bénéfice du traitement national est réservé aux investissements26. Cette pratique serait la manifestation de la réticence de certains Etats à accorder le bénéfice du traitement national aux personnes physiques27. Une telle dissociation ne semble pas produire de conséquences dans la mesure où, comme le relève le tribunal CIRDI dans l’affaire Siemens A.G., « [f]or purposes of applying the MFN clause there is no special significance to the differential use of the terms investor or investments in the Treaty »28.
Il n’est pas rare que la formulation retenue par les Etats des standards indirects de traitement n’identifie pas les bénéficiaires. Dans un tel cas, le domaine dans lequel le traité est conclu ou pour lequel le standard est spécifiquement prévu dans un traité couvrant plusieurs domaines, l’identification des bénéficiaires peut être implicite29. Quand bien même les bénéficiaires seraient désignés, la détermination de la similarité entre les bénéficiaires du régime le plus favorable sur le fondement du traité et les bénéficiaires de ce régime sur le fondement des standards indirects de traitement peut générer quelques difficultés.
23 S.D. Myers Inc. c. Canada, NAFTA-UNCITRAL, sentence partielle du 13 novembre 2000, § 249. 24 USA 2012 Model BIT, art. 3 et 4. 25 People’s Republic of China 1994 Model BIT, art. 3. 26 Agreement for the Promotion and Protection of Investments between the Republic of Colombia and the Republic of India, New Delhi, 10 novembre 2009, art. 4. 27 Cl. CRÉPET DAIGREMONT, « Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international », in Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement, Ch. LEBEN (dir.), Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2006, p. 114. 28 Siemens A.G. c. Argentine, ICSID/ARB/02/8, décision sur la compétence du 3 août 2004, § 92. La CNUCED relève que, dans certains contextes, le terme investissement peut être interprété comme incluant celui d’investisseur compte tenu des liens inextricables existant entre les deux notions, UNCTAD, International Investment Agreements: Key Issues, Vol. I, New York/Geneva, United Nations, 2004, p. 166. 29 « Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa trentième session », op. cit., p. 35.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
284
Que l’on évoque le principe du traitement national ou la clause de la nation la plus favorisée, l’exigence minimale pour que le standard indirect de traitement puisse produire ses effets est que les deux investisseurs ou investissements que l’on confronte opèrent dans le même secteur d’activité30. Il est parfois procédé de manière contestable à la recherche de l’identité du secteur d’activité des deux investisseurs. L’affaire Methanex est sur ce point exemplaire. Un investisseur canadien opérant sur le marché des Etats-Unis se plaint d’une réglementation défavorable aux producteurs de méthanol. Il considère que le traitement dont bénéficient les producteurs d’éthanol est beaucoup plus favorable et devrait lui être étendu dans la mesure où les deux produits seraient directement substituables sur le marché américain. Tout en relevant qu’il ne doit pas se livrer à un test d’identité entre investisseurs nationaux et investisseurs étrangers, le tribunal va refuser de confronter la réglementation relative au méthanol à celle relative à l’éthanol, considérant que la recherche doit porter sur le traitement reçu par les investisseurs nationaux les plus similaires à l’investisseur canadien. Or, dès lors que producteurs américains et canadiens de méthanol sont placés dans des circonstances et soumis à un traitement identiques, il n’y a pas de violation du principe du traitement national31. Le raisonnement très restrictif du tribunal pourrait être discuté. Affirmer qu’il n’existe pas de producteurs américains semblables au producteur canadien de méthanol n’exclut pas qu’une relation de concurrence puisse exister avec des producteurs américains d’un produit comme l’éthanol. Il eut été possible pour le tribunal arbitral de s’inspirer de ce qui est fait dans le cadre du système de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce en matière de qualification de produits similaires ou directement concurrents ou substituables32, position souple adoptée par quelques tribunaux arbitraux en matière d’investissement33.
b. Les circonstances similaires, analogues ou semblables
Dire que deux investisseurs ou investissements sont similaires ne signifie pas que devra nécessairement être accordé à l’un un régime non moins favorable ou identique à celui accordé à l’autre. Encore faudra-t-il établir que les deux investisseurs ou investissements sont placés dans des circonstances analogues. Cette exigence dépasse l’idée de similarité des investisseurs ou investissements. En effet, il est possible pour des investisseurs nationaux et étrangers d’être confrontés à des situations analogues sans opérer dans le même secteur d’activité. Il en va ainsi des investisseurs étrangers confrontés à une campagne d’expropriation déterminée en fonction de facteurs géographiques et non
30 Sur la question : Pope & Talbot Inc. c. Canada, NAFTA-UNCITRAL, sentence sur le fond de la phase 2 du 10 avril 2001, § 96 ; Marvin Feldman c. Mexique, ICSID/ARB(AF)/99/1, sentence du 16 décembre 2002, § 172 : Parkerings-Compagniet AS c. Lituanie, ICSID/ARB/05/8, sentence du 11 septembre 2007, § 371. 31 Methanex Corporation c. Etats-Unis d’Amérique, NAFTA-UNCITRAL, sentence finale sur la compétence et le fond du 3 août 2005, part. IV, Chapitre B, § 19. 32 Parmi des précédents abondants : Organe d’appel, Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, rapport du 4 octobre 1996, pp. 22-25. 33 S.D. Myers Inc. c. Canada, NAFTA-UNCITRAL, sentence partielle du 13 novembre 2000, § 250.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
285
sectoriels. Les formules utilisées par les différents instruments internationaux relatifs aux investissements peuvent varier. On parlera parfois de circonstances identiques, de situations similaires, analogues ou semblables. Le choix opéré par les Etats traduit la volonté d’étendre ou au contraire de restreindre les effets potentiels des standards indirects de traitement. Si, comme dans le TBI Royaume-Uni – Belize de 1982, il est fait état de l’application du traitement national aux investisseurs se trouvant dans des situations identiques (same circumstances), le champ des investisseurs nationaux inclus dans la comparaison avec l’investisseur étranger sera particulièrement étroit34. Les rédactions de ce type sont très isolées dans la pratique conventionnelle contemporaine. Le spectre de comparaison sera plus étendu si, comme dans les TBI conclus par les Etats-Unis ou dans l’ALENA, il est fait mention d’une application des standards indirects de traitement aux investisseurs placés dans des circonstances semblables (like circumstances)35. Dans la pratique conventionnelle, cette seconde option est la plus répandue. Les formules circonstances ou situations similaires, analogues ou semblables sont aujourd’hui considérées équivalentes et interchangeables36.
Ce type de formulation n’est pas toujours retenu dans les traités relatifs aux investissements. Ainsi, la clause de la nation la plus favorisée inscrite dans les TBI conclus par la France ne fait aucune référence à une exigence de similarité des situations. On peut néanmoins considérer qu’elle est implicite. Un sujet de droit ne peut, sur le fondement de la clause de la nation la plus favorisée, revendiquer l’extension à son profit d’un régime juridique favorable accordé à un tiers dans des circonstances totalement différentes. La logique interne des standards indirects de traitement empêche de nier l’exigence minimale de similarité.
c. Les limitations apportées aux conséquences de la similarité
Un Etat est-il obligé, sur le fondement des principes du traitement national ou de la nation la plus favorisée, de ne pas opérer de discrimination entre investisseurs ? Il est évident que, si les conditions d’application sont réunies, la discrimination constitue un signe de violation de l’un de ces deux principes, mais la jurisprudence arbitrale en matière d’investissements reconnaît que des circonstances particulières peuvent permettre à l’Etat d’opérer des discriminations entre investisseurs. Nous pouvons évoquer l’affaire Parkerings-Compagniet pour illustrer cette possibilité. Un investisseur norvégien estimait avoir reçu de la Lituanie un traitement moins favorable que celui accordé par cette dernière à un investisseur néerlandais. Le tribunal CIRDI saisi de l’affaire 34 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Belize for the Promotion and Protection of Investments, Belmopan, 30 avril 1982, art. 3. 35 Treaty between the United States of America and the Oriental Republic of Uruguay Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, Mar del Plata, novembre 2005 art. 3 et 4.1. Accord de libre-échange nord-américain, Washington, 17 décembre 1992, art. 1102-1 et 1102-1. 36 OECD, National Treatment of International Investment in South East European Countries: Measures Providing Exceptions, op. cit., p. 33.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
286
va indiquer qu’il convient de raisonner en trois temps pour constater une violation de la clause de la nation la plus favorisée (la même analyse est possible en matière de traitement national en substituant la qualité d’investisseur national à celle d’investisseur étranger). Tout d’abord, les deux opérateurs en cause sont des investisseurs étrangers. Ensuite, ces deux investisseurs étrangers interviennent dans le même secteur économique. Enfin, les deux investisseurs sont traités de manières différentes. Le schéma est des plus classiques, mais le tribunal arbitral va plus loin en considérant que la différence de traitement entre les investisseurs étrangers est possible si elle répond à un objectif légitime poursuivi par l’Etat37. Il s’agissait, en l’espèce, d’un contentieux portant sur la réalisation de parcs de stationnement dans le centre historique de Vilnius. Or, le projet qui avait été refusé au demandeur portait atteinte à la vieille ville protégée par l’Unesco, tandis que le projet accepté par les autorités locales était respectueux des richesses historiques et architecturales de ce quartier. Dès lors, selon les arbitres, le traitement différent appliqué aux deux investisseurs est justifié et ne constitue pas une violation de la clause de la nation la plus favorisée38.
Si ce type de raisonnement trouve un appui dans quelques décisions rendues en matière de traitement national39, il n’en reste pas moins surprenant et contestable. En effet, dans cette dernière affaire, les deux investisseurs ont été soumis au même cadre juridique et ont dû prendre en compte les spécificités de la vieille ville de Vilnius. Il n’est pas contestable que l’Etat puisse traiter différemment un projet respectueux des richesses architecturales et historiques de la ville et un projet qui ne le serait pas. Plus qu’une différence de traitement ici, il s’agit d’une différence de projets. Cela signifie que, malgré le rattachement des investisseurs à un même secteur d’activité, les deux projets ne sont tout simplement pas semblables, analogues ou similaires. Différents, ils échappent dès lors à l’application de la clause de la nation la plus favorisée (et du principe du traitement national si l’un des investisseurs est un national). La prise en compte de la légitimité de la mesure prise par l’Etat (protection du patrimoine historique dans l’affaire Compagniet-Parkerings) dans l’évaluation de la relation de similarité est parfaitement défendable, mais elle ne saurait être perçue telle une exception au jeu de la clause de la nation la plus favorisée ou du principe du traitement national. Elle n’est qu’une confirmation de la règle selon laquelle seuls les investissements analogues devront recevoir un traitement dicté par les standards indirects de traitement40.
37 Parkerings-Compagniet AS c. Lituanie, ICSID/ARB/05/8, sentence du 11 septembre 2007, § 371. 38 Ibid., § 392. 39 S.D. Myers Inc. c. Canada, NAFTA-UNCITRAL, sentence partielle du, 13 novembre 2000 ; Pope & Talbot Inc. c. Canada, NAFTA-UNCITRAL, sentence sur le fond de la phase 2 du 10 avril 2001. 40 Dans le même sens : OCDE, Traitement national des entreprises sous contrôle étranger, Paris, OCDE, 2005, p. 118. Contra : Cl. CRÉPET DAIGREMONT, « Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international », op. cit., p. 158.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
287
B. Le caractère plus favorable du régime
Placés dans des circonstances analogues, des investisseurs ou investissements similaires étrangers ne pourront subir une discrimination défavorable vis-à-vis d’un investisseur national (traitement national) ou étranger (traitement de la nation la plus favorisée). Il conviendra donc d’identifier le régime le plus favorable appliqué aux investisseurs et investissements comparables (1) avant de qualifier l’éventuelle discrimination (2).
1. Identification du régime favorable
La recherche de l’existence d’un régime plus favorable conditionne évidemment la mise en œuvre des principes du traitement national et de la nation la plus favorisée. Dans le premier cas, il s’agira de rechercher si l’Etat d’accueil de l’investissement accorde aux investisseurs ou investissements nationaux opérant sur son territoire un régime plus favorable que celui accordé aux investisseurs ou investissements étrangers. S’il existe une telle situation, l’Etat d’accueil de l’investissement sera, si toutes les conditions sont remplies, dans l’obligation d’étendre ce régime plus favorable aux investisseurs ressortissants de l’autre Etat partie au traité. Dans le second cas, il s’agira de rechercher si l’Etat qui s’est engagé à travers la clause de la nation la plus favorisée a accordé un régime plus favorable à un investisseur tiers au traité contenant la clause. Si c’est le cas, et que les autres conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, ce régime devra être étendu à l’investisseur ressortissant de l’autre Etat partie au traité.
Dans les deux cas, il convient de déterminer ce qu’est un traitement plus favorable, or, si l’identification est parfois évidente (délai administratif plus court, exonération ou réduction fiscale, etc.), il est des situations dans lesquelles l’évidence se refuse à l’observateur. La jurisprudence en matière de contentieux de l’investissement ne permet évidemment pas de déterminer de manière abstraite ce qu’est un traitement plus favorable. Il conviendrait toujours d’opérer une comparaison entre deux régimes juridiques appliqués ou applicables à des investisseurs ou investissements placés dans des circonstances analogues ou similaires. Les avantages revendiqués peuvent porter sur des éléments très diversifiés de traitement. Il peut s’agir d’un avantage en matière de règlement des différends, du droit de se voir accorder un permis, une facilité administrative, etc. (voir infra, III.).
On peut s’interroger sur la possibilité d’isoler un élément plus favorable dans un régime juridique qui pourrait être conçu comme constituant un tout indivisible. Le tribunal de l’affaire Siemens A.G. a pu examiner si l’identification d’un élément de traitement plus favorable accordé à un tiers devait entraîner une extension à l’investisseur de l’intégralité du régime juridique appliqué à un autre investisseur, privilégié sur un point spécifique. La position défendue par l’Argentine consistait à affirmer que l’extension du bénéfice d’un avantage entraînait l’application de l’ensemble du régime auquel était rattaché celui-ci. Le tribunal a considéré que cette position n’était défendable que dans la mesure où l’ensemble du régime serait plus favorable au régime appliqué. Il est ainsi possible d’emprunter à un régime tiers des éléments plus favorables sans être
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
288
soumis à l’ensemble de ce régime41. Cela place l’investisseur dans une position très favorable puisque, dans une stratégie de pick and choose, celui-ci peut prendre dans des régimes divers les éléments qui sont favorables sans que lui soient applicables les dispositions qui pourraient équilibrer les positions des parties à la relation d’investissement. Reste que l’on ne pourrait envisager une autre solution dès lors que soumettre l’investisseur à l’ensemble du régime auquel est attaché un avantage particulier reviendrait à insérer un élément de conditionnalité dans la mise en œuvre de la clause de la nation la plus favorisée ou du principe du traitement national.
2. Qualification de la discrimination
Il convient également de s’interroger sur la manière dont on pourra traiter le régime qui est, de fait, plus favorable. Les accords relatifs aux investissements n’envisagent qu’exceptionnellement cette question42. La réponse est simple. Les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national visent à lutter contre les discriminations injustifiées de fait ou de droit. Dès lors que la discrimination existe en fait, le bénéfice du régime le plus favorable doit être étendu. Une telle extension serait logique si l’on considérait que c’est le résultat de la différence de régime qui doit être examiné. En outre, les discriminations sont rarement juridiquement établies, mais reposent surtout sur des situations de fait. On peut ainsi constater une violation de la clause de la nation la plus favorisée ou du principe du traitement national sans que la discrimination soit consacrée par les textes en cause, mais juste par leur application effective. Ce n’est pourtant pas dans cette voie que se développe le contentieux relatif aux investissements internationaux. Ainsi, dans l’affaire ADF Group, l’investisseur canadien contestait l’obligation qui lui était faite de recourir à de l’acier américain pour réaliser son projet aux Etats-Unis. Le tribunal relève que cette obligation pèse sur tous les investisseurs aux Etats-Unis, y compris les investisseurs nationaux ; il ne saurait donc conclure à une discrimination préjudiciable à l’investisseur canadien même si, de fait, cette mesure entraîne une difficulté pour ce dernier43.
La question n’est pas close lorsque le traitement plus favorable résulte expressément d’un acte juridique, c’est-à-dire lorsque la discrimination est juridiquement organisée. On peut en effet se demander si la consécration juridique d’un traitement plus favorable pour les investisseurs nationaux ou pour des investisseurs étrangers, d’une nationalité autre que celle de l’investisseur qui réclame le bénéfice de ces standards, devra automatiquement étendre celui-ci. L’hypothèse dans laquelle le régime plus favorable est certes consacré en droit, mais pas dans les faits, peut poser problème. Le critère d’effectivité permet-il de faire échec à l’extension d’un régime juridique plus favorable, mais non mis en œuvre ? Ici, l’effectivité cède le pas face à l’existence du régime plus favorable.
41 Siemens A.G. c. Argentine, ICSID/ARB/02/8, décision sur la compétence du 3 août 2004, §§ 108-109. 42 En revanche la référence à l’atteinte de jure ou de facto au principe du traitement juste et équitable est fréquente dans les TBI : modèle français de TBI, 2006, art. 4. 43 ADF Group Inc. c. Etats-Unis d’Amérique, ICSID/ARB(AF)/00/1, sentence du 9 janvier 2003, § 157.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
289
L’Etat ne peut se défausser en invoquant sa violation du régime le plus favorable pour refuser d’en étendre le bénéfice à l’investisseur. Ainsi, s’il existe une discrimination reposant en droit sur la nationalité, son existence suffira à établir la violation du standard indirect de traitement ; si en revanche la discrimination n’est pas de droit, la violation ne pourra être constatée qu’en cas de discrimination effective. Dans le même sens, si l’Etat X a accordé par la voie d’un TBI un traitement très favorable à des investisseurs originaires de l’Etat Y, mais qu’aucun investisseur ressortissant de Y n’a mené d’opérations sur le territoire de X, le régime le plus favorable reste une promesse. Mais une promesse dont l’investisseur ressortissant de Z devra bénéficier si l’Etat Z a conclu avec l’Etat X un traité comportant une clause de la nation la plus favorisée.
Enfin, nous pouvons relever qu’il n’existe pas de seuil en-deçà duquel la discrimination fondée sur la nationalité serait tolérée. La moindre différence de traitement, aussi minime soit-elle, sera contraire aux standards indirects de traitement si les conditions de leur application sont réunies.
III. L’ÉTENDUE DU BÉNÉFICE DES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
Les effets des standards indirects de traitement seraient « quasi-miraculeux »44 du fait de leur capacité d’alignement automatique sur un régime déterminé dans un instrument tiers. En outre, les formulations retenues par les Etats sont très générales ; il est ainsi fréquent d’inscrire dans un traité bilatéral de promotion et de protection de l’investissement que le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national doivent être accordés dans tous les cas ou en toutes circonstances45. Les effets de la clause de la nation la plus favorisée et du principe du traitement national peuvent ainsi produire des effets d’alignement très importants sur un régime plus favorable. La question de la possibilité d’étendre le jeu de la clause de la nation la plus favorisée aux dispositions relatives au règlement des différends est l’objet de vifs débats depuis que les arbitres de l’affaire Maffezini en ont accepté, bien qu’avec réserves, la possibilité46. Cette question étant traitée par ailleurs dans cet ouvrage47 ne fera pas l’objet d’une présentation dans nos développements.
Au-delà de cet aspect particulier, on constate que, du fait de leur grande plasticité, les deux standards indirects de traitement sont de formidables outils de politique économique à la disposition des Etats. Plusieurs modulations sont possibles. Sont
44 B. NOLDE, « Droit et technique des traités de commerce », op. cit., p. 411. 45 « Each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of investors of any third state », Kingdom of Cambodia 1998 Model BIT, art. III.2. 46 Emilio Augustin Maffezini c. Espagne, ICSID/ARB/97/7, décision sur la compétence du 25 janvier 2000. 47 Sur cette question, v. le chapitre n° 19 du présent ouvrage, P. MAYER « Le consentement à l’arbitrage ».
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
290
offertes aux Etats les possibilités de moduler dans le temps l’application de ces standards (A), mais aussi d’écarter certaines matières ou certaines personnes du champ d’application des standards indirects de traitement (B).
A. Application dans le temps des standards indirects de traitement
Dès lors que le traité comportant la clause de la nation la plus favorisée est en vigueur entre les deux Etats, les investisseurs ressortissants de l’un pourront demander à l’autre de bénéficier du traitement le plus favorable accordé par celui-ci à un tiers. Les traités actuels sont indifférents au fait que le traitement le plus favorable ait été accordé au tiers avant ou après l’entrée en vigueur du traité comportant la clause de la nation la plus favorisée. L’essentiel est que le traité soit en vigueur, le bénéfice de ce traitement le plus favorable ne cessant que si la norme de référence disparaît ou qu’un régime encore plus favorable est accordé à un tiers par l’Etat48. Il en va de même en matière de législation nationale avec la mise en œuvre du principe du traitement national. Le traitement national peut, en pratique, être neutralisé en cas de relation contractuelle entre l’Etat et l’investisseur, spécialement lorsqu’une clause de stabilisation est insérée dans le contrat49.
B. Limitations matérielles et personnelles au jeu des standards indirects de traitement
Le jeu des standards indirects de traitement n’est évidemment pas neutre pour les Etats. Accorder un avantage à l’un de ses partenaires ou à ses ressortissants et celui-ci est immédiatement étendu à un nombre indéfini de bénéficiaires potentiels. Il est fréquent que les traités bilatéraux de promotion et de protection des investissements intègrent des limites spécifiques aux standards indirects de traitement (1) ou concernant l’ensemble du traité (2).
1. Les limitations spécifiques aux standards indirects de traitement
Le jeu du principe du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée est l’objet de limitations récurrentes dans la quasi-totalité des instruments internationaux relatifs à l’investissement. Traditionnellement plus nombreuses pour le traitement national que pour la clause de la nation la plus favorisée, ces limitations peuvent être matérielles (a) ou personnelles (b).
a. Les limitations matérielles
La détermination du champ d’application des standards indirects de traitement est d’une grande sensibilité, spécialement lorsque l’on aborde le traitement national. Il n’est pas nécessaire de développer ici les controverses entourant la reconnaissance du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée dans la phase préalable à l’investissement (l’établissement ou
48 Siemens A.G. c. Argentine, ICSID/ARB/02/8, décision sur la compétence du 3 août 2004, § 99. 49 P. MAYER, « La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats d’Etat », JDI, 1986, p. 5.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
291
l’admission)50. A l’origine de la conclusion des instruments internationaux relatifs aux investissements, les standards indirects de traitement ne s’appliquaient pas à la phase d’établissement de l’investissement dans la mesure où l’on considérait que l’Etat a constamment un droit souverain de contrôler l’entrée des étrangers sur son territoire. Ce ne sera qu’avec les traités américains d’amitié, de commerce et de navigation que le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée seront progressivement, mais encore de manière très marginale, étendus à la phase d’admission de l’investissement étranger.
La matière fiscale est fréquemment l’objet de dispositions spécifiques dans les accords relatifs aux investissements. La formule retenue par le modèle français de TBI est que les dispositions relatives à la clause de la nation la plus favorisée et au principe du traitement national « ne s’appliquent pas aux questions fiscales »51. La limitation de l’application des principes au domaine fiscal n’est pas toujours envisagée de manière aussi ouverte. Ainsi, l’article 4 du TBI France – Libye, conclu en 2004, dispose que le traitement le plus favorable « ne s’applique pas aux impôts et déductions et exonérations fiscales accordées par l’une des Parties contractantes aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord de double imposition ou d’autres accords en matière fiscale »52. Le champ de la limitation ne saurait donc aller au-delà de ce que prévoit la convention relative à la double imposition. On retrouve les mêmes modulations dans la pratique conventionnelle d’autres Etats. Dans certains modèles de TBI, l’exclusion des questions fiscales ne concerne que la clause de la nation la plus favorisée53, tandis que dans d’autres, moins nombreux, celle-ci s’étend également au principe du traitement national54.
Il est également fréquent que les questions de sécurité ou de santé publiques entretiennent une relation particulière avec les standards indirects de traitement. Ainsi, le TBI conclu entre l’Allemagne et l’Egypte dispose que « [m]easures that have to be taken for reasons of public security and order, public health or morality shall not be deemed ‘‘treatment less favorable’’ within the meaning of this article »55. Il est encore indiqué dans le traité, conclu en 1985, entre la République populaire de Chine et Singapour que « this Agreement shall not in any way limit the right of either Contracting Party to apply prohibitions or restrictions of any kind or take any other action which is directed to the
50 CNUCED, Traitement de la nation la plus favorisée, op. cit., p. 36. Sur cette question, v. le chapitre n° 7 du présent ouvrage, W. BEN HAMIDA « Admission et garantie des investissements : problèmes généraux ». 51 Modèle français de TBI, 2006, art. 5. 52 Accord entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements, Paris, 19 avril 2004, art. 4. 53 Republic of Chile 1994 Model BIT, art. 4 ; People’s Republic of China 1994 Model BIT, art. 3 ; Republic of Croatia 1998 Model BIT, art. 3 ; Kingdom of Thailand 2002 Model BIT, art. 4.3.b. 54 Republic of South Africa 1998 Model BIT, art. 3 ; Kingdom of Cambodia 1998 Model BIT, art. III. 55 Agreement between the Arab Republic Egypt and the Federal Republic of Germany Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, Berlin, 16 juin 2005, art. 3.2.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
292
protection of its essential security interests, or to the protection of public health or the prevention of diseases and pests in animals or plants »56.
Il est fréquemment possible pour les Etats de joindre à leur engagement en matière d’investissements des listes de secteurs ou d’activités économiques pour lesquelles les standards indirects de traitement seront applicables (liste positive) ou inapplicables (liste négative). Il en va ainsi dans le cadre de l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce qui prévoit que le principe du traitement national ne sera applicable que dans les secteurs économiques pour lesquels les Etats parties auront adopté des engagements spécifiques (liste positive)57. La technique de la liste négative est quant à elle récurrente dans la pratique conventionnelle des Etats-Unis. Les listes sont parfois totalement dissymétriques. Les listes jointes au TBI Jamaïque – Etats-Unis de 1994 se présentent de la manière suivante : les Etats-Unis excluent l’application du principe du traitement national et de la clause de la nation la plus favorisée pour respectivement treize et dix-sept secteurs, tandis que la liste d’exclusion jamaïcaine ne concerne pour les mêmes principes qu’un et quatre secteurs58.
Au-delà de ces exemples classiques, on peut trouver dans la pratique conventionnelle de certains Etats des limitations plus originales. Le modèle finlandais de TBI indique que les standards de traitement ne pourront pas avoir pour effet d’étendre à l’investisseur le bénéfice des avantages découlant de traités multilatéraux relatifs à l’investissement59. Des pays en développement sont parfois parvenus à faire inscrire dans les accords relatifs aux investissements des dispositions permettant de prendre en compte les spécificités de leur situation économique. La pratique est limitée, mais on peut évoquer le protocole au TBI Suisse – Indonésie qui autorise l’Indonésie à déroger au principe du traitement national à l’égard des investisseurs suisses « vu le niveau de développement actuel de l’économie nationale indonésienne »60. Peut être mentionné dans le même sens, le TBI Maroc – Italie dont l’article 3.3 dispose que « [l]es investisseurs des deux Parties Contractantes ne peuvent se prévaloir du traitement national pour bénéficier des aides, dons, prêts, assurances et garanties accordés par le Gouvernement de l’une des Parties Contractantes exclusivement à ses propres ressortissants ou sociétés dans le cadre des activités des programmes de développement national »61.
56 Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments, Beijing, 21 novembre 1985, art. 11. 57 Accord général sur le commerce des services, Marrakech, 15 avril 1994, art. XVII. 58 Treaty between the United States of America and Jamaica Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment, with Annex and Protocol, Washington DC, 4 février 1994. 59 Finland 2001 Model BIT, art. 4.c. 60 Convention entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République indonésienne concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, Protocole, Jakarta, 6 février 1974, pt. 2. 61 Accord entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République italienne relatif à la promotion et la protection réciproques des investissements, Rabat, 18 juillet 1990, art. 3.3.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
293
b. Les limitations personnelles
Tous les accords conclus en matière d’investissements incluent une disposition au terme de laquelle le traitement accordé sur le fondement d’un accord de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ne sera pas étendu par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée62. Il convient de ne pas surestimer les conséquences de l’insertion d’une telle disposition dans un TBI. Il est en effet incontestable que les Etats participant à une zone de libre-échange et plus encore les membres d’une union douanière développent entre eux des relations qui ne sont certainement pas assimilables à celles se nouant entre l’un d’eux et un Etat tiers63. Dès lors, un Etat appartenant à une union douanière n’aura pas à étendre à des tiers le bénéfice des concessions accordées dans le cadre de cette union pour défaut de circonstances analogues, semblables ou similaires. Plus délicate serait la question de l’extension des avantages accordés au sein d’une zone de libre-échange ou d’une union douanière à des participants à une autre zone de libre-échange ou union douanière. C’est parce qu’il peut exister des modulations sectorielles au sein d’organisations économiques régionales que ce type de disposition limitative est véritablement pertinente.
Au-delà de la limitation classique relative aux organisations d’intégration ou de coopération régionales, l’accord pour la promotion et la garantie entre les pays membres de l’Organisation de la Conférence islamique pose un système original. Dans cet instrument, la clause de la nation la plus favorisée limite son jeu au régime le plus favorable accordé à des tiers et non à des parties au traité64. L’Etat peut donc discriminer favorablement certains Etats parties au détriment d’autres dès lors qu’il assure à tous un régime au moins aussi favorable que celui accordé au plus favorisé des tiers.
Certaines dispositions sont formulées de manière très ouverte afin de permettre une libéralisation différenciée malgré le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. On peut mentionner l’accord de libre-échange et de partenariat économique conclu en 2009 entre le Japon et la Suisse dont l’article 88.3 dispose que « [s]i une partie accorde un traitement plus favorable aux investisseurs d’une partie tierce et à leurs investissements en concluant ou en amendant un accord de libre-échange, d’union douanière ou un accord similaire prévoyant la libéralisation substantielle des investissements, elle ne sera pas tenue d’accorder ce traitement aux investisseurs de l’autre partie et à leurs investissements »65.
En matière de traitement national, il existe également des hypothèses, plus rares, de limitation du champ d’application personnel. Certains TBI prévoient ainsi la
62 UNCTAD, The REIO Exception in MFN Treatment Clauses, UNCTAD Series on International Investment Polices for Development, New York/Geneva, United Nations, 2004, 84 pages. 63 Contra Cl. CRÉPET DAIGREMONT, La clause de la nation la plus favorisée, Thèse Paris II, 2009, p. 457. 64 Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les Etats membres de la Conférence islamique, Bagdad, 10 juin 1981, art. 8.2.a. 65 Accord de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon, Tokyo, 1er février 2009, art. 88.3, italique ajouté.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
294
possibilité de maintenir ou d’adopter des mesures en faveur de minorités ou de groupes ethniques socialement ou économiquement défavorisés du fait d’une politique menée antérieurement dans l’un des Etats parties au traité. C’est notamment le cas des traités récents conclus par le Pérou66 ou un peu plus anciennement par l’Afrique du sud67. Mais, ici encore, plus que d’une limite à un standard indirect de traitement, on peut parler du constat reconnu convention-nellement de la spécificité de certains investisseurs, spécificité qui ne saurait avoir de similarité parmi les investisseurs ressortissants de l’autre partie au traité.
2. Les limitations générales
On désigne sous le terme de limitations générales les dispositions d’un accord relatif aux investissements énonçant que celui-ci est inapplicable à certaines situations déterminées. Ainsi, il n’est pas rare que soit insérée, dans l’instrument relatif aux investissements, une disposition aux termes de laquelle l’Etat se réserve le droit d’adopter des mesures contrevenant aux dispositions de l’accord pour assurer la préservation des intérêts essentiels de sa sécurité. Le modèle de TBI des Etats-Unis de 2012 prévoit ainsi que « [n]othing in this Treaty shall be construed :[…] 2. to preclude a Party from applying measures that it considers necessary for the fulfillment of its obligations with respect to the maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security interests »68. L’interprétation de cette disposition a donné lieu à des débats importants lors de contentieux opposant l’Argentine à des investisseurs américains. Il s’agissait notamment pour les arbitres de s’interroger sur les liens entre cette disposition et l’état de nécessité du droit international général69.
Le TBI France – Iran de 2004 prévoit qu’aucune « disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant l’une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d’activité desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager sa culture »70. L’accord pour la promotion et la garantie entre les pays membres de l’Organisation de la Conférence islamique, quant à lui, prévoit que l’extension ne pourra porter sur les droits et privilèges accordés à un tiers pour un « projet spécifique en raison de son importance particulière » pour cet Etat partie au traité71. Cette dernière notion est si floue que l’on n’imagine mal que sa mise en œuvre puisse
66 Free Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the Republic of Peru, Beijing, 28 avril 2009, art. 131.3.a. 67 Agreement between the Czech Republic and the Republic of South Africa for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments, Prague, 14 décembre 1998, art. 3.3.c. 68 USA 2012 Model BIT, art. 18. 69 Sur la question, CMS Gas Transmission Company c. Argentine, ICSID/ARB/01/8, sentence du 12 mai 2005. 70 Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d’Iran sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, Téhéran, 12 mai 2003, art. 1.5. Dans une formulation proche : modèle français de TBI, 2006, art. 1.6. 71 Accord sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les Etats membres de la Conférence islamique, Bagdad, 10 juin 1981, art. 8.2.c.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
295
durablement échapper à une mise en cause contentieuse. C’est également dans la catégorie des exceptions générales que l’on regroupe les dispositions traditionnellement insérées dans les TBI pour préserver la compétence de l’Etat en matière de protection de la morale publique, de l’ordre public, de la santé publique, etc. Ainsi, le TBI France – Kenya de 2007 précise qu’aucune « disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme empêchant une Partie contractante de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses intérêts vitaux de sécurité et du maintien de l’ordre public en temps de guerre ou de conflit armé, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées par une Partie contractante d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée à l’investissement »72. Ce type d’exception figure dans une disposition spécifique du traité et s’applique à l’ensemble conventionnel et non aux seuls standards indirects de traitement.
On intègre également, dans la catégorie des exceptions générales, les systèmes de listes par lesquelles les Etats parties à un accord international peuvent échapper à l’application des dispositions de celui-ci dans des domaines limitativement énumérés. L’exemple le plus abouti sur ce point est celui de l’ALENA auquel sont annexées les listes nationales des secteurs non soumis à l’accord. Ainsi, les dispositions de l’accord nord-américain ne s’appliquent pas au secteur énergétique mexicain, au secteur américain des radiocommunications ou à l’industrie culturelle canadienne.
IV. ARTICULATION ENTRE LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
Lorsque, comme c’est le plus souvent le cas, un investissement entre à la fois dans le champ d’application de la clause de la nation la plus favorisée et du principe du traitement national, il conviendra de déterminer quel régime, reposant sur l’un ou l’autre de ces standards indirects de traitement, devra être appliqué à cet investissement. Il est fréquent que la question soit réglée par une disposition conventionnelle (A). L’articulation des standards peut également se manifester pour les investisseurs qui chercheraient à bénéficier du traitement national sur le fondement de la clause de la nation la plus favorisée (B).
A. Les dispositions relatives à l’articulation des standards indirects de traitement
Le contenu du traitement applicable à l’investisseur sur le fondement des deux standards indirects ne pouvant être déterminé de façon définitive, il peut être délicat d’identifier le régime juridique dont pourrait se prévaloir un investisseur. La question est très fréquemment réglée par l’insertion dans l’instrument d’une disposition conformément à laquelle l’investisseur devrait se voir accorder le traitement le plus favorable découlant de l’application de la clause de la nation la plus favorisée et du traitement national. C’est notamment la pratique
72 Accord entre le Gouvernement de la République française et la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, Nairobi, 4 décembre 2007, art. 12.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
296
conventionnelle des Etats-Unis, ainsi, le TBI conclu en 1995 avec l’Albanie dispose que « each Party shall accord treatment no less favorable than it accords, in like situations, to investments in its territory of its own nationals […] or to investments in its territory of nationals or companies of a third country […] whichever is most favorable »73. Certains Etats jugent utile de préciser que le traitement le plus favorable est apprécié du point de vue de l’investisseur74. Dans la pratique, cela conduira le plus souvent à l’application du principe du traitement national. Ainsi, il n’est pas exceptionnel que les Etats mentionnent dans un TBI que le traitement de la nation la plus favorisée ne sera applicable qu’à la condition d’être plus favorable que le traitement national75. Dès lors qu’un investisseur étranger recevrait un traitement plus favorable que les investisseurs nationaux semblables placés dans une situation semblable, ce régime devrait être étendu aux investisseurs pouvant invoquer le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée. La situation n’est pas totalement exceptionnelle. La volonté d’attirer des investisseurs étrangers sur leur territoire conduit régulièrement des Etats à accorder des incitations aux candidats à l’investissement, sans que cette pratique soit étendue au bénéfice des investisseurs locaux. Pour clair que paraisse le principe d’articulation, les conditions de sa mise en œuvre peuvent donner lieu à des difficultés importantes, spécialement quand il conviendra de déterminer quel régime est le plus favorable ou de rechercher s’il est possible d’emprunter à chacun des deux régimes des éléments considérés comme étant les plus favorables en rompant l’équilibre interne de chacun de ces deux régimes de traitement.
On rencontre également des instruments internationaux contenant les deux standards indirects de traitement sans que soit indiqué lequel des deux traitements devra être appliqué à l’investisseur76. Cette situation peut être source d’incertitudes pour l’investisseur. Selon une étude conduite au sein de l’OCDE, ce serait alors à l’Etat d’accueil de déterminer quel standard de traitement sera appliqué sans obligation de se soucier de celui qui serait plus favorable à l’investisseur77.
En toute hypothèse, il est acquis qu’un investisseur ne pourra se voir imposer, sur le fondement du principe du traitement national ou de la clause de la nation la plus favorisée, un traitement qui serait moins favorable que le standard minimum de traitement des étrangers aujourd’hui illustré par la reconnaissance d’un traitement juste et équitable78.
73 Treaty between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Albania Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, Washington, 11 janvier 1995, art. 2.1. 74 Danish 2008 Model BIT, art. 3.1. 75 Accord entre la Confédération suisse et la République du Zaïre relatif à la protection et à l’encouragement des investissements, Kinshasa, 10 mars 1972, art. 2. 76 Indian 2003 Model BIT, art. 4. 77 OECD, National Treatment of International Investment in South East European Countries: Measures Providing Exceptions, op. cit., p. 43. 78 Sur cette question, v. le chapitre n° 12 du présent ouvrage, Y. NOUVEL « Standards de traitement : Traitement juste et équitable, protection et sécurité pleines et entières ».
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
LES STANDARDS INDIRECTS DE TRAITEMENT
297
B. Le bénéfice du traitement national par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée ?
Se pose la question du possible bénéfice du traitement national par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. La question est évidemment sensible. Du point de vue de l’application stricte des principes, on pourrait imaginer qu’un investisseur ressortissant de X revendique auprès de Z, sur le fondement de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité X-Z, le traitement national accordé dans un traité Y-Z à un investisseur ressortissant de Y. La Commission du droit international, qui s’est penchée sur la clause de la nation la plus favorisée, considère que, si l’on se trouve dans une situation où le traitement le plus favorable accordé à un investisseur étranger découle de l’application du principe du traitement national, ce régime le plus favorable devra être accordé aux investisseurs couverts par le traité sur le fondement de la clause de la nation la plus favorisée79. La conformité au droit positif de cette prise de position de la Commission du droit international apparaît aujourd’hui très incertaine.
Si la jurisprudence est encore inexistante sur ce sujet spécifique, le raisonnement tenu par les arbitres dans l’affaire Maffezini peut fournir une grille d’analyse pertinente. On sait que, dans cette dernière affaire, se posait la question de l’extension de la clause de la nation la plus favorisée aux dispositions concernant l’administration de la justice. En acceptant, dans les circonstances de l’espèce, cette possibilité, le tribunal a indiqué que le bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée ne devrait pas être en mesure d’aller à l’encontre des impératifs de l’action publique que les parties au traité pourraient ne pas avoir pris en compte comme étant les conditions essentielles de leur acceptation de l’accord en question80. Quelques tribunaux arbitraux ont eu à se prononcer sur ce qu’il convenait d’insérer dans ces impératifs de l’action publique, conditions essentielles de l’acceptation de l’accord81, et, à condition de s’inscrire dans le prolongement du raisonnement des arbitres de l’affaire Maffezini, il apparaît certain que la question de la reconnaissance du traitement national constitue l’une des limites au jeu de la clause de la nation la plus favorisée.
79 « Projet d’articles sur la clause de la nation la plus favorisée, adopté par la Commission du droit international et transmis à l’Assemblée générale des Nations Unies », Annuaire de la Commission du droit international, 1978, vol. II, 2e partie, p. 57. 80 Emilio Augustin Maffezini c. Espagne, ICSID/ARB/97/7, décision sur la compétence du 25 janvier 2000, § 62. 81 Les conditions d’application du traité dans le temps : Tecnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. Mexique, ICSID/ARB(AF)/00/2, sentence du 29 mai 2003, § 69.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination
PARTIE I – CHAPITRE 7
298
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
BJORKLUND (A. K.), « The National Treatment Obligation », Arbitration Under International Investment Agreements: A Guide to the Key Issues, New-York, Oxford, OUP, 2010, pp. 411-444.
COLE (T.), « The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law », Michigan Journal of International Law, 2012, n° 3, pp. 537-586.
CRÉPET-DAIGREMONT (Cl.), La clause de la nation la plus favorisée, Thèse Paris II, 2009, 792 p.
- « Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée dans la jurisprudence arbitrale récente relative à l’investissement international », Ch. LEBEN (dir.), Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement, Anthémis, Louvain-la-Neuve, 2006, pp. 107-162.
UNCTAD, International Investment Agreements : Key Issues, Vol. I, United Nations, New-York, Geneva, 2004, pp. 161-189.
VERRILL (C. O.), « The National Treatment Obligations : Jurisprudential Uncertainty concerning a Cornerstone of Investement Protection in Bilateral Investment Treaties », I. A. LAIRD, T. J. WEILER (ed.), Investment Treaty Arbitration and International Law, Huntington, New York, vol. 4, 2012, pp. 1-11.
Epreuves du 20 janvier 2015 manuscrit en construction ne pas tenir compte de la pagination