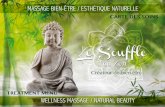D'une épistémologie à une esthétique de la clarté. Notes de cours III. Année 2014. Master 1.
Transcript of D'une épistémologie à une esthétique de la clarté. Notes de cours III. Année 2014. Master 1.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
1
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ.
ASPECTS DE LA FORTUNE DU CONCEPT
DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE.
COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER 1.
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ.
PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
2
I. LA CLARTÉ EN PEINTURE
§ 1. L’ATTICISME FRANÇAIS
L’ATTICISME GREC
L’atticisme désigne initialement un courant rhétorique grec des Ve et IV
e siècles avant
Jésus-Christ, qui est marqué par les grands orateurs attiques (i.e. de la région d’Athènes) de
cette époque qui allient précision, élégance, pureté de la langue et sobriété. Qui en sont les
représentants ? Le plus célèbre et accompli est peut-être l’orateur et homme politique athénien
Démosthène (-384/ -322). Ce courant est repris et prolongé par Cicéron au premier siècle
avant J.-C., qui donne Démosthène en modèle de l’éloquence idéale alliant passion et raison et
en exemple à imiter, puis, toujours à Rome, au premier siècle après J.-C par Quintilien et son
Institution oratoire, qui marquera l’art rhétorique et ses règles pour des siècles. On peut parler
d’un néo-atticisme romain comme retour à l’atticisme grec. L’atticisme s’oppose à
l’asianisme autre courant rhétorique qui avec Sénèque trouvera un prolongement à Rome.
L’asianisme développe l’ornementation, les artifices, des agencements sonores du discours,
l’exagération ou enflure stylistique, le pathos à l’excès aux fins de séduire. L’asianisme doit
son nom au fait de venir d’Asie mineure, notamment d’Ionie, région du monde grec qui se
trouvait sur les côtes de l’actuelle Turquie. L’asianisme se développe, en rupture avec la
tradition attique, au IIIe siècle avant notre ère. C’est par référence à l’atticisme antique que
l’on parle d’atticisme en lettres et en peinture pour évoquer le style classique.
L’ATTICISME PICTURAL
Expression que l’on trouve chez Bernard Dorival, historien et critique d’art, auteur de
La peinture française en deux tomes, en 1942 et chez Jacques Thuillier, historien d’art, lui
auteur d’un ouvrage intitulé La peinture française, en 1964, qui désigne un courant pictural
principalement parisien du milieu du XVIIe siècle sous Mazarin, disons entre 1640 et 1660.
Eustache Lesueur (1616-1655), élève de Simon Vouet, peintre du Roi, comme
Charles Lebrun et Pierre Mignard, et Laurent de La Hyre (1606-1656), d’abord, mais aussi
Jacques Stella (1597-1657) promu par Richelieu, peintre du Roi, Pierre Patel (1604-1676)
paysagiste plus que peintre de scènes religieuses, Henri Mauperché (1602-1686), lui aussi
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
3
paysagiste, en sont les représentants les plus éminents. Charles Le Brun en est proche dans ses
œuvres de jeunesse, Philippe de Champaigne en emprunte certains traits.
L’on ne confondra pas ce courant avec la désignation qui se fait parfois sous le même
terme d’atticisme ou de néo-atticisme pour désigner l’esthétique épurée d’une certaine
sculpture nostalgique de l’époque grecque et hellénistique à Rome au premier siècle avant
notre ère. L’on ne confondra pas non plus avec une statuaire de la première Renaissance sous
François Ier
et Henri II, qui avec des artistes comme Jean Goujon (1510-1566), imite des
modèles grecs.
Pour considérer la place qu’occupe la clarté dans cet art pictural français, parisien,
nous réfèrerons volontiers, en partie, au travail d’Alain Mérot1. Alain Mérot part d’une
analogie qu’il juge déterminante pour comprendre l’atticisme pictural entre peinture et
rhétorique, ce qui justifie le terme même d’atticisme en peinture. La rhétorique classique
héritée de Quintilien, tout particulièrement des livres VIII à X de l’Institution oratoire, fixait
une méthode de l’art d’écrire et de parler, véritable dispositif de construction et de mise en
scène du discours qui comportait cinq phases :
i) l’inventio ou recherche d’arguments,
ii) la dispositio ou la recherche du plan du discours, son agencement en parties,
iii) l’elocutio ou la recherche d’un style et des figures de style qui en sont la
marque (style élevé pour les sujets graves, moyen pour les discours informatifs
et explicatifs, bas ou simple pour les sujets plaisants) adapté au sujet traité et
aux effets que l’on souhaite produire sur l’auditoire. Il est permis et même
recommandé de varier les styles dans un même discours pour ne pas lasser
l’auditoire ou le lecteur ;
iv) la memoria, qui consiste à mettre en œuvre des procédés mnémotechniques et
à apprendre par cœur le discours
v) Enfin, l’actio qui est la récitation en forme de véritable performance physique
alliant expression verbale et gestuelle et mimes destinés à rendre sensible le
discours et à convaincre. Il y a ici une parenté évidente avec le théâtre.
Si on laisse la memoria qui n’a pas lieu d’être dans la peinture Alain Mérot pose une
équivalence ou analogie entre le dessin et l’inventio et la dispositio, le dessin donnant un
contenu représentatif, une composition, un agencement du sujet et des formes, et entre
1 Voir notamment A. MEROT, « La clarification de la forme dans l’“atticisme’’ pictural » E. Bury et C.
Meiner (éds.), La clarté à l’âge classique, Paris, Classiques Garnier [« Lire le XVIIe siècle - Discours
historique, discours philosophique 3 » 24], 2013, pp. 111-125. Voir aussi sur A. MEROT,
« L »atticisme parisien : réflexions sur un style », catalogue de l’exposition Éloge de la clarté. Un
courant artistique au temps de Mazarin, 1640-1660, Dijon, Musée Magnin et Le Mans, Musée de
Tessé, 1998-1999, pp. 13-40.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
4
l’elocutio avec les couleurs, lumières et lignes qui ornent le tableau comme les figures de
style le discours. Enfin, entre l’actio et l’expression des personnages en peinture qui fait
comprendre par les gestes, mimiques, attitudes le sujet. La clarté atticiste est la résultante des
ces quatre facteurs. Mais dans quel sens dont comprendre cette clarté ? C’est la que la notion
de clarté nous semble connaître une nouvelle mutation ou inflexion de sa signification, qui est
celle d’un entreprise de clarification, d’explicitation maximale. Clarification peut-être
excessive, qui nuit même à la clarté, ainsi que le suggère Alain Mérot, comme transparence,
discrète, grâce d’une certaine discrétion des moyens d’incarner dans un discours, des formes,
des couleurs, une pensée.
§ 2. DESSIN, QUADRILLAGE, PERSPECTIVE.
Le dessin est primordial dans l’atticisme pictural, il incarne une pense, il dessine la
pensée qui se clarifie par des tracés successifs. Comme les idées claires et distinctes, et
parfaitement claires parce que distinctes, il délimite, par les contours qu’il leur assigne, des
figures, des groupes. Les figures sont isolées du groupe et reliée à lui, un peu, dirons-nous,
comme les idées claires et distinctes s’intègrent comme ses maillons dans les démonstrations
mathématiques chères à Descartes. Les compositions picturales sont, en quelque façon, aux
figures, ce que les discours de la raison sont aux idées qui les composent et qu’ils mettent en
relation. Mais pour parvenir à l’aisance apparente de la composition picturale, il aura fallu par
exemple à Le Sueur dans une œuvre comme Clio, Euterpe et Thalie2 (vers 1652-1655, huile
sur bois, 130 x 130 cm, Louvre), une suite de dessins préparatoires qui fonctionne comme un
éclaircissement progressif du projet de représenter le groupe des trois muses au prix de
nombreux tâtonnements.
2 Histoire, musique, comédie
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
5
L’effort de clarification par tracés successifs de l’idée de la composition produit un
ensemble qui semble impossible à défaire comme les ensembles que forment les longues
chaînes de raisons des sciences. La clarté résulte d’un effort de clarification. Même chose
dans Saint Paul à Éphèse toujours de Le Sueur (1649, huile sur toile, 394 x 328 cm, Louvre).
Les dessins préparatoires montrent, d’une part la suppression de sujets ou épisodes
secondaires comme une scène d’aumône au second plan et, d’autre part, une mise au net
comportant des annotations de dimensions et de distances pour rationaliser l’espace, une mise
au carreau et une échelle de perspective pour le placement des personnages et la précision des
agrandissements à opérer dans le passage de l’étude préparatoire à la toile. Notons que la
perspective unifiée à point et lignes de fuite uniques, préconisée par Alberti à la Renaissance,
et que l’atticisme (à l’exception des trop grandes surfaces des plafonds peints sans caissons où
le point de vue unique recréerait de la confusion et non la clarté recherchée ) s’ordonne
désormais en France avec une plus grande rigueur et qu’elle rompt avec les procédés plus
empiriques utilisés depuis le Moyen Âge, tel que la construction bifocale. Cette perspective
linéaire, géométrique permet une répartition claire et hiérarchisés des figures dans un espace
qui possède une profondeur ordonnée. En outre l’étude mise au carreau semble pouvoir
renvoyer au second précepte de la méthode cartésienne qui nous invite à diviser chaque
difficulté en autant de parcelles claires et distinctes utiles à sa résolution. Bref, l’on voit à
l’œuvre toute une technique de clarification sensible et de rationalisation qui permet un rendu
clair de l’espace, une distinction des figures, une netteté des compositions. Ces techniques ne
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
6
sont pas empiriques, car elles renvoient à des ouvrages théoriques comme les Sentiments sur
la distinction dans les diverses manières de peindre (1649) d’Abraham Bosse, graveur,
membre de l’Académie royale de peinture, ou la Méthode universelle de mette en perspective
les objets (1636) du mathématicien Girard Desargues, ami de Descartes. Le lien ici entre
clarté intellectuelle et clarté picturale, clarté des idées et clarté en art est manifeste puisque les
beaux-arts tirent leurs techniques de représentation des mathématiques dont le XVIIe siècle est
le grand siècle en France avec Descartes, Pascal, Fermat, Desargues, Roberval…On voit là
encore comment la clarté migre et s’exporte du champ épistémique vers le champ esthétique,
ce qui constitue notre hypothèse de lecture de départ. Les beaux-arts en tirent des préceptes de
division, d’unité reconstruite, d’ordre, de hiérarchie et de distinction des formes qui inscrivent
leur style, celui de l’atticisme français, dans l’histoire de clarté classique.
Bien évidemment, la réalité sensible, ses formes, ses couleurs n’ont jamais la netteté
que leur confèrent les tableaux de l’atticisme français. La clarté en peinture est, ici, l’œuvre
d’un travail savant de clarification, exactement toutefois comme l’est, chez Descartes, le
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
7
décodage du monde physique par la science à l’aide de natures simples innées (nombre,
figures, mouvement, étendue…). Toutefois, la clarté des figures de la peinture résulte de la
clarification obtenue à l’aide des techniques picturales telles que la perspective et la mise au
carreau alors que, dans la nouvelle science physique dont elle est contemporaine, la
clarification des données sensibles est une transcription, un décodage qui résulte de données
intellectuelles, les natures simples et élémentaires (nombres, figures, mouvement, étendue…)
dont dispose naturellement notre esprit, et qui sont déjà claires. La peinture produit une clarté
clarifiée, la science une clarté clarifiante.
§ 3. COULEURS ET LUMIÈRE
L’apport plus spécifique de la peinture, qui ne doit a priori rien aux sciences sur ce
point, vient de son usage des couleurs et de la lumière en un système dégradé. La perspective
géométrique ne suffit plus à produire la clarté recherchée par l’Atticisme pictural. Il faut
encore y adjoindre une perspective aérienne qui contribue à rendre sensibles les distances par
une impression d’éloignement. Cette impression d’éloignement est alors créée au moyen d’un
adoucissement des traits, des couleurs et des ombres au fur et à mesure que le regard s’avance
dans la profondeur du tableau et que nous passons, par des plans successifs d’intensités
dégressives, du premier au dernier plan. Ainsi pour ne prendre qu’un exemple chez Laurent
de La Hyre dans Laban cherchant ses idoles3 (1647, huile sur toile, 0,95 x 1,33 cm, Le
Louvre), l’on voit une diminution graduelle de l’intensité des couleurs qui s’atténuent dans un
fond où le paysage est représenté de manière de plus en plus vaporeuse. A la hiérarchie
géométrique des grandeurs vient s’ajouter ainsi une hiérarchie sensible des intensités
lumineuses. Au devant du tableau sont données les couleurs les plus fortes, les plus pures, les
plus violentes, glacées et éclatantes. Elles donnent, par un effet de contraste, l’impression de
repousser les autres à l’arrière-plan.
3 Le sujet est tiré de la Genèse : las de sa longue servitude chez son oncle Laban, Jacob s'était enfui
avec les troupeaux qui faisaient partie de son salaire et ses deux épouses, Léa et Rachel, filles de
Laban. Celui-ci les rattrapa mais ne retrouva pas ses idoles emportées par Jacob.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
8
Philippe de Champaigne appliquera la même technique, par exemple, dans La
présentation au temple (1642, huile sur toile, 257 x 197 cm, Musée royal des Beaux-arts de
Bruxelles).
Si, dans l’usage des couleurs et dans le rendu de la lumière, la perspective aérienne se
superpose à la perspective géométrique chez les peintres de l’Atticisme parisien, ce n’est pas
là le seul parti qu’ils sauront tirer des couleurs. Clarté d’inventio, clarté de la dispositio, la
clarté atticiste est aussi clarté d’élocutio par comparaison avec les canons de la rhétorique
évoqués de Quintilien ci-avant. En effet, en choisissant des couleurs fraîches et vives,
notamment les trois couleurs primaires que sont le bleu, le rouge, le jaune, les peintres
atticistes obtiennent des contrastes ou des accords contrastés de couleurs d’intensités égales,
situées sur un même plan, qui renforcent la clarté et la distinction des objets ou des
personnages. Les couleurs et teintes se détachent les unes des autres comme les figures. Elles
participent de l’effort de clarification du sujet traité et de la clarté du rendu de l’ensemble.
Nous sommes ici très loin de l’harmonie tonale et des fondus, souvent chauds et bruns, de
vénitiens comme Giorgione, Titien, Tintoret (à l’exception de Véronèse) ou de flamands
comme Rubens, Van Dyck, Rembrandt qui jouent du clair-obscur. L’on notera d’ailleurs que
les contrastes colorés atticistes sont parfois si vifs qu’ils frisent la dissonance comme on
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
9
pourra, par exemple, en juger dans Clélie passant le Tibre avec ses compagnes (vers 1635-
1645, huile sur toile, 137 X 101 cm, Louvre) peint par Jacques Stella.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
10
§4. LEBRUN ET L’ACADÉMIE ROYALE DE 1648.
L. Hourticq (1875-1944), historien d’art, voit dans la création de l’Académie royale de
peinture une entreprise destinée à encadrer la création picturale par une méthode et ses règles,
comme Descartes, le fit auparavant pour la recherche de la vérité dans les sciences. Dès leurs
premières réunions, les peintres et les sculpteurs, en se chargeant de l'instruction des élèves,
s'engagèrent à fonder une doctrine :
L’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, fondée en 1648, et remplacée aujourd'hui par
notre Académie des Beaux-arts, était à la fois une école professionnelle et un corps savant. Les
Académiciens tenaient ateliers et dirigeaient les travaux d'élèves ; ils se préoccupaient aussi de
« résoudre les difficultés de l'art » et s'assemblaient pour se « communiquer les lumières dont
ils étaient éclairés ». Les résultats de ces recherches n'ont pas été perdus. Des comptes rendus
ont été rédigés par les différents secrétaires de l'Académie, Félibien, Guillet de Saint-Georges,
Testelin. Ils sont conservés dans les archives de l'École des Beaux-arts. Ces artistes assemblés
en de solennelles conférences ne discutaient pas seulement parce qu'il est naturel entre gens
d'un même métier de s'entretenir de leurs occupations; ils discutaient pour élaborer une
doctrine de leur art, qui eût la certitude de la science et pût se démontrer comme les vérités
mathématiques4.
Descartes aurait ainsi fournit à l’Académie un modèle qui rapprocherait l’art de la
science dont les académiciens voulait s’inspirer :
Un autre patronage illustre de l'Académie fut celui de Descartes. Quelques historiens de l'art
s'étonnent que l'on puisse déduire une esthétique de la peinture d'une philosophie. C'est parce
qu'on se représente la philosophie comme une denrée de collège et de baccalauréat. La société
française du XVIIe siècle lisait Descartes; on se préoccupait des « tourbillons » chez le
bonhomme Chrysale. Quand une philosophie est acceptée par les hommes d'un temps, ce n'est
pas seulement parce qu'elle les a convertis, mais parce qu'elle leur donne un système où ils
reconnaissent leurs manières de penser. Du moment que les académiciens se mêlaient de
raisonner, ils devaient nécessairement entrer dans les cadres de la pensée cartésienne.
D'ailleurs, ce ne fut pas seulement un instinct obscur qui en fît les disciples inconscients du
philosophe. Le Brun avait en main les œuvres de Descartes; il les lisait et les faisait lire à ses
confrères. Ils ont pratiqué, en particulier, le Traité des Passions, non pas comme un manuel à
qui l'on emprunte quelques définitions, mais pour lui demander cette science des relations
entre l’âme et le corps qui se trouve être à la fois au centre de la doctrine cartésienne et de
l'esthétique académique5.
4 L. Hourticq, De Poussin à Watteau, Paris, Hachette, 1921, p. 42.
5Id., p. 10 ; voir aussi p. 67.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
11
Et encore :
[…] La vue d'un beau tableau doit donner la même satisfaction logique qu'une déduction bien
conduite. Une telle pensée ne pouvait alors choquer aucun esprit. Il paraissait naturel de
transcrire toute chose en langage rationnel, et même Pascal, qui reconnaissait au cœur des
raisons que la raison ne connaît pas, consacrait toutes les forces de son intelligence à pénétrer
ces raisons inconnaissables, en unissant la clarté logique de l'esprit géométrique à l'intuition
sentimentale de l'esprit de finesse. C'est que tous avaient appris à l'école de Descartes, ou
Descartes à l'école de son siècle, que la vérité n'est pas autre chose que la notion évidente, et
c'était pour eux comme un malaise intellectuel de quitter les clartés de l'intelligence, pour
entrer dans l'obscurité trouble et le demi-jour du sentiment […]ce n'est pas seulement l'identité
de la beauté et de la vérité qu'ils ont apprise à cette école : ce sont les notions mêmes et les
raisonnements particuliers du système cartésien qu'ils ont appliqués à leur esthétique. Dans
cette construction d'une science-art, Descartes a donné la forme et la matière. Pour étudier
cette influence cartésienne, il suffit de reprendre, l'une après l'autre, les trois grandes questions
que se posaient les artistes de l'Académie : le dessin et la couleur; l'expression; l'ordonnance6.
Ainsi, la préférence et la primauté accordées par l’Académie au dessein peuvent se
comprendre comme l’importation en peinture d’un précepte cartésien :
Parmi les défenseurs du dessin, voyez au contraire avec quelle force et quelle précision la
pensée cartésienne se manifeste. A leurs yeux, la couleur a contre elle de n'être qu'un accident,
tandis que le dessin est une permanence ; elle est matérielle, tandis que le dessin est spirituel ;
elle dépend du dessin, tandis que le dessin ne dépend pas de la couleur. « La couleur est un
accident tout pur, dit J.-B. Champaigne; la forme est la vérité. » Ouvrez ensuite Descartes : «
Tout ce que d'ailleurs on peut attribuer au corps présuppose de l'étendue et n'est qu'une
dépendance de ce qui est étendu... Ainsi nous ne saurions concevoir par exemple de figure, si
ce n'est en une chose étendue... Les couleurs, les odeurs, les saveurs et autres choses
semblables ne sont rien que des sentiments qui n'ont aucune existence en dehors de ma pensée
et qui ne sont pas moins différents des corps que la couleur diffère de la figure ou le
mouvement de la flèche qui le cause7.
Dans l’élaboration de sa doctrine nouvelle l’Académie a fait une place sans précédent
à l’expression. Elle est si importante qu’elle est détachée des autres parties de la peinture pour
faire l’objet d’une étude à part. Ainsi dans sa conférence intitulée De l’expression générale et
particulière de 1668, véritable physiognomonie (étude du caractère à partir des traits et de
l’apparence physique d’une personne) des passions, Charles Lebrun, premier peintre du roi,
semble vouloir appliquer à la peinture la doctrine et la classification des Passions de l’âme de
6 Id., p. 44-45.
7 La référence qu’Hourticq ne donne pas se trouve chez Descartes dans les Principes de la philosophie,
I, art. 53, AT, IX, 2, p. 48.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
12
Descartes. En réalité, ce texte, s’il est cartésien par certains aspects (sur la glande pinéale, la
circulation des esprits animaux, l’admiration comme passions, les signes extérieurs des
passions et leur manifestations corporelles…), s’en éloigne aussi par bien d’autres,
notamment par la définition qu’il propose de la notion de passion. Celle-ci reste thomiste en
ce qu’elle est considérée comme l’expression d’un appétit qui nous porte vers le bien ou vers
le mal. Notons que chez Descartes le corps n’exprime pas les passions, mais connaît des effets
qui accompagnent les passions comme leurs conséquences physiologiques. Ainsi la tristesse
provoque des larmes. Aussi, le texte de Lebrun n’est pas vraiment cohérent du point de vue
doctrinal, mais plutôt opportuniste, en empruntant, ici où là, des éléments de doctrine et en
visant l’efficacité des préceptes aux fins de produite des effets (surprise, émotion) sur le
spectateur. Doit-on le lui reprocher que cela se fasse au détriment de la cohérence d’une
doctrine? Certainement pas, si l’on veut bien considérer que Lebrun n’est ni physicien ni
philosophe, mais peintre et que son but n’est pas de construire une théorie de la connaissance
des passions mais de donner naissance à des œuvres d’art ? Toutefois, si l’influence
cartésienne sur l’Académie doit être nuancée, elle ne peut être niée, et l’exigence classique de
la clarté explique la recherche par l’Académie d’éléments de doctrine cartésiens qui
permettent de soutenir et d’enseigner cette exigence classique.
II. CONCLUSION :
Si le cartésianisme a eu une influence indéniable sur les arts de l’âge classique qui ont
repris la valeur et la norme de la clarté originellement élaborée dans le domaine des sciences
et de la philosophie, rien n’est moins sûr que de supposer que Descartes se serait reconnu dans
cet héritage et cette paternité qu’on lui attribue si généreusement. Car il s’est souvent refusé à
donner des règles en matière d’esthétique, affirmant que le goût reste subjectif et varie d’un
individu à l’autre. Ainsi dans une lettre à Mersenne de janvier 1630, écrit-il :
Mais pour déterminer ce qui est plus agréable, il faut supposer la capacité de l’auditeur,
laquelle change comme le goût, selon les personnes, ainsi les uns aimeront mieux entendre une
seule voix, les autres un concert, etc. ; de même que l’un aime mieux ce qui est doux, et l’autre
ce qui est un peut aigre ou amer, etc.8
Dans une autre lettre à Mersenne du 4 mars 1630, on lit encore à propos de la musique :
Je vous avais déjà dit que c’est autre chose, de dire qu’une consonance est plus douce qu’une
autre, et autre chose qu’elle est plus agréable. Car tout le monde sait que le miel est plus doux
que les olives, et toutefois force gens aimeront mieux manger des olives que du miel. Ainsi
tout le monde sait que la quinte est douce que la quarte, celle-ci que la tierce majeure, et la
8 AT, I, p. 108.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
13
tierce majeure que la mineure ; et toutefois il y a des endroits où la tierce mineure plaira plus
que la quinte, même où une dissonance se trouvera plus agréable qu’une consonance9.
Dans une autre lettre à Mersenne d’octobre 1631 :
Pour votre question, savoir si on peut établir la raison du beau, c’est tout de même que ce que
vous demandiez auparavant, pourquoi un son est plus agréable que l’autre, sinon que le mot
beau semble plus particulièrement se rapporter au sens de la vue. Mais généralement ni le
beau, ni l’agréable ne signifient rien qu’un rapport de notre jugement à l’objet ; et pour ce que
les jugements des hommes sont différents, on ne peut dire que le beau, ni l’agréable n’aient
aucune mesure déterminée […] la même chose qui fait envie de danser à quelques uns, donne
envie de pleurer aux autres10
.
L’histoire de la clarté et son transfert du champ épistémique vers le champ esthétique
relève d’une annexion par la tradition académique du classicisme français, comme le suggère
Pascal Dumont11
, peut-être autant ou plus que d’une esthétique cartésienne. Mais c’est
certainement le propre des grandes œuvres d’avoir des prolongements inattendus. Ces
prolongements inattendus en excèdent les contours initiaux et leur donnent une postérité que
leurs auteurs n’auraient pas même pu envisager. Le cartésianisme en art invente un Descartes
différent du Descartes réel, de sorte que sous le même nom logent plusieurs Descartes qui en
font une grande figure de l’histoire de la pensée et de l’esthétique, fût-ce, pour ce qui relève
de l’esthétique, en quelque façon malgré lui.
9 AT, I, p. 126.
10 AT, I, pp. 133-134
11
P. Dumont, Descartes et l’esthétique. L’art d’émerveiller, Paris, Presses Universitaires de France,
[« Philosophie aujourd’hui »], 1997, p. 22.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
14
III. ANNEXE
L'arrêt burlesque de Boileau. Éléments tirés de Philippe Albou, Histoire des sciences
médicales, t. 28, n° 1, 1994, pp. 25-32.
Concernant les relations entre la médecine et la littérature, L’arrêt burlesque de Boileau
est une œuvre particulièrement marquante. Les circonstances de sa rédaction permettent
d'évoquer le souvenir de trois personnages célèbres du 17e siècle : bien entendu l'auteur
Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), surnommé « Despréaux » par ses contemporains,
mais aussi Gui Patin (1601-1672) et le premier président Guillaume de Lamoignon (1617-
1677). L'origine de L’Arrêt burlesque, comme nous le dit Boileau en 1701, vient d'une
demande que l'Université voulait faire au Parlement de Paris afin que soit rendu un arrêt
officiel contre l'enseignement dans les Écoles d'autres principes que ceux d'Aristote -
autrement dit contre Descartes -. C'est dans ce contexte et en vue de « prévenir cet arrêt très
sérieux », qu'il rédigea donc son Arrêt burlesque, paru pour la première fois en 1671 de
manière anonyme. Ce texte subira quelques variantes jusqu'en 1701, date de l'édition
définitive des œuvres de Boileau où ce dernier reconnaîtra enfin en être l'auteur.
Dans sa version de 1701, le titre complet était le suivant : Arrêt burlesque, donné en la
grand’ chambre du Parnasse, en faveur des maîtres-es-Arts, médecins et professeurs de V
Université de Stagyre, au pays des Chimères : pour le maintien de la doctrine d'Aristote.
Après avoir exposé, dans les attendus de son jugement factice, les principales nouveautés
concernant la théorie de la circulation du sang et le traitement des fièvres par le quinquina,
Boileau conclut son Arrêt de la manière suivante :
La Cour, ayant égard à ladite requête, a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Aristote en la pleine et
paisible possession et jouissance desdites écoles. Ordonne qu'il sera toujours suivi et enseigné par les
régents, docteurs, maîtres es arts et professeurs de ladite université, sans que pour ce ils soient obligés de le
lire, ni de savoir sa langue et ses sentiments. Et sur le fond de sa doctrine, les renvoie à leurs cahiers.
Enjoint au cœur de continuer d'être le principe des nerfs ; et à toutes personnes, de quelque condition et
profession qu’elles soient, de le croire tel, nonobstant toute expérience à ce contraire. Ordonne pareillement
au chyle d'aller droit au foie, sans plus passer par le cœur, et au foie de le recevoir. Fait défense au sang
d'être plus vagabond, errer ni circuler dans le corps, sous peine d'être entièrement livré et abandonné à la
faculté de médecine. Défend à la Raison et à ses adhérents de plus s'ingérer à l'avenir de guérir les fièvres
tierces, double-tierces, quartes, triple-quartes, ni continues, par mauvais moyens et voies de sortilèges
comme vin pur, écorces de quinquina, et autres drogues non approuvées ni connues des anciens. Et en cas
de guérison irrégulières par icelles drogues, permet aux médecins de ladite faculté de rendre, suivant leur
méthode ordinaire, la fièvre aux malades, avec casse, séné, sirops, juleps, et autres remèdes propres à ce, et
de remettre lesdits malades en tel et semblable état qu'ils étaient auparavant, pour être ensuite traités selon
les règles ; et, s'ils n'en réchappent, conduits du moins dans l'autre monde, suffisamment purgés et évacués.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
15
Ce serait une erreur de considérer que grâce à L’Arrêt burlesque la question de
l'aristotélisme fut définitivement réglée en France ! Après cette requête manquée de 1671, les
adversaires de Descartes demeurèrent encore très actifs : en 1675, l'Université d'Angers, puis
en 1678 celle de Caen s'élevèrent officiellement contre le cartésianisme ; en 1685, soit
quatorze ans après L’Arrêt burlesque et huit ans après la mort de Guillaume de Lamoignon,
Louis XIV décida d'interdire officiellement l'enseignement de la philosophie de Descartes
(après avoir tout de même créé en 1672, au Jardin des Plantes, un enseignement public en
faveur de la circulation du sang) ; et même en 1699, la thèse du cartésien Pourchot, qui fut
recteur de l'Université de Paris entre 1692 et 1694, fut condamnée comme « enseignant une
méchante doctrine ». L'importance des forces en présence sur cette question brûlante aide à
mieux comprendre la décision de Boileau de se cacher pendant trente ans derrière un
anonymat de bon aloi. Mais L’arrêt burlesque présente surtout pour nous une valeur
documentaire. Tout d'abord, les circonstances de sa rédaction nous ont permis de nous
souvenir de l'ambiance qui régnait à cette époque dans la maison de Guillaume de
Lamoignon, où Gui Patin puis Nicolas Boileau furent successivement accueillis de manière
aussi amicale que privilégiée. D'autre part, même si L’Arrêt burlesque peut paraître discutable
sur le plan strictement littéraire (Boileau reconnaîtra lui-même en 1701 que « la plaisanterie y
descend un peu bas »), ce texte a le mérite de nous apporter, sous une forme plaisante, un
témoignage direct sur l'évolution des esprits en France à la fin du XVIIe siècle et surtout de
l’inscription de Boileau dans la lignée intellectuelle de Descartes dont il défend l’héritage.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
16
IV. BIBLIOGRAPHIE.
Amara, Nadia, « Maurice Blanchot : quelques enjeux idéologiques et esthétiques d'une
première époque critique », Revue d'histoire littéraire de la France 3/2005 (Vol. 105),
pp. 607-619. [www.cairn.info/revue-d-histoire-litteraire-de-la-france-2005-3-page-607.htm.]
Azouvi, François, Descartes et la France. Histoire d’une passion nationale, Paris, Fayard
[«L’esprit de la cité »], 2002.
Blanchot, Maurice, « La culture française vue par un Allemand », La Revue française, n° 10,
27 mars 1932.
Bouhours, Dominique, Doutes sur la langue française (1674), Genève, Slatkine, 1972.
Bury, Emmanuel ; Meiner, Carsten, (éds.), La clarté à l’âge classique, Paris, Classiques
Garnier [« Lire le XVIIe siècle - Discours historique, discours philosophique, 3 » 24], 2013.
Cahné, Pierre-Alain, Un autre Descartes. Le philosophe et son langage, Paris, Vrin
[« Bibliothèque d’histoire de la philosophie »], 1980.
Cousin, Victor, Des Pensées de Pascal. Rapport à l’Académie française sur la nécessité d’une
nouvelle édition de cet ouvrage, Paris, Ladrange, 1853.
Cousin, Victor, « L’art français au XVIIe siècle », Revue des Deux Mondes, t. 2, 1853, pp. 865-
893.
Defaux, Gérard, Marot, Rabelais, Montaigne : l’écriture comme présence, Paris-Genève, Champion-
Slatkine [« Études montaignistes » 2], 1987.
Demogeot, Jacques, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1852.
Denis, Delphine (éd.), L’obscurité. Langage et herméneutique sous l’Ancien Régime,
Louvain, Bruylant-Academia, 2007.
Descartes, Œuvres de Descartes, publiées par Ch. Adam et P. Tannery, Paris, Léopold Cerf,
13 vol. 1897-1913 ; rééd, Paris, Vrin-CNRS, 11 tomes (en 13 volumes), 1964-1974 ; tirage en
format réduit, 1996. Cette édition, mentionnée sous le sigle AT, est l’édition de référence.
Descartes, (1963-1973), Œuvres philosophiques, F. Alquié (éd.), 3 vol., Paris, Garnier
[« Classiques Garnier »].
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
17
Dumont, Pascal, Descartes et l’esthétique. L’art d’émerveiller, Paris, Presses Universitaires
de France, [« Philosophie aujourd’hui »], 1997.
Favre de Vaugelas, Claude, Remarques sur la langue française utiles à ceux qui veulent bien
parler et bien écrire (1647), Paris, Champ Libre, 1981.
Faudemay, Alain, La distinction à l’âge classique. Emules et enjeux, Paris, Champion, 1992.
Faudemay, Alain, Le clair et l’obscur à l’âge classique, Genève, Slatkine, 2001.
Fumaroli, Marc, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au
seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 1980 ; 2e édition, Paris, Albin Michel, 1994.
Gauchat, Gabriel, Lettres critiques ou analyse et réfutation de divers écrits modernes contre
la religion, section XIV, Paris, Claude-Herissant, 1759.
Gewirth, Alan, « Clearness and distinctness in Descartes », G. D. J Moyal (éd.), Critical
Assessments, vol. 1, London, Routledge, 1991, pp. 178-203.
Glucksmann, André, Descartes, c’est la France, Paris, Flammarion, 1987.
Helvétius, De l’esprit, Paris, Durand, 1758.
Hourticq, Louis, De Poussin à Watteau, Paris, Hachette, 1921.
Kambouchner, Denis, « Le statut cartésien de la clarté et de la distinction », E. Bury et C.
Meiner (éds.), La clarté à l’âge classique, Paris, Classiques Garnier [« Lire le XVIIe
siècle -
Discours historique, discours philosophique, 3 » 24], 2013, pp. 33-50.
Kambouchner, Denis, Le style de Descartes, Paris, Manucius [« Le philosophe »], 2013.
Krantz, Émile, Essai sur l'esthétique de Descartes étudiée dans les rapports de la doctrine
cartésienne avec la littérature classique française au XVIIe siècle, Paris, Gemmer-Baillère,
1882.
Lanson, Gustave, « L'influence de Descartes dans la littérature française », Revue de
Métaphysique et de morale, t. 4, 1896, pp. 518-550
Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, trad. Paul Schrecker, Paris, Vrin [« Bibliothèque
des textes philosophiques »], 1978.
Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Paris, Garnier Flammarion, 1966
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
18
Marcherey, Pierre, « Descartes, est-ce la France ? », Methodos, textes et savoirs, Esprit.
Mind/Geist, 2002/2 [disponible en ligne].
Methonen, Païvi, Obscure Language, unclear Literature, Theory and Practice from
Quintilian to the Enlightenment, Helsinki, The Finnish Academy of Science and Letters,
2003.
MEROT, Alian, « La clarification de la forme dans l’“atticisme’’ pictural » E. Bury et C.
Meiner (éds.), La clarté à l’âge classique, Paris, Classiques Garnier [« Lire le XVIIe
siècle-
Discours historique, discours philosophique 3 » 24], 2013, pp. 111-125.
MEROT, Alian, « L’Atticisme parisien : réflexions sur un style », catalogue de l’exposition
Éloge de la clarté. Un courant artistique au temps de Mazarin, 1640-1660, Dijon, Musée
Magnin et Le Mans, Musée de Tessé, 1998-1999, pp. 13-40.
Mornet, Daniel, Histoire de la clarté française. Ses origines, son évolution et sa valeur, Paris,
Payot, 1929.
Mortier, Roland, Clartés et ombres du siècle des Lumières, Genève, Droz, 1969.
Mortier, Roland, « Lumière et Lumières- histoire d’une image et d’une idée au XVIIe siècle et
au XVIIIe siècle, in R. Mortier (éd.), Clartés et ombres du siècle des Lumières, Genève, Droz,
1969.
Nisard, Désiré, « Descartes et son influence sur la littérature française », La Revue des Deux
Mondes, octobre-novembre 1844, t. IV, pp. 863-892 ; Histoire de la littérature française, t. II,
Paris, Firmin Didot, 1844, pp. 44-105.
Péguy, Charles, « Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne », in Œuvres
en prose (1909-1914), Paris, Gallimard [« Bibliothèque de la Pléiade »], 1957.
Proust, Marcel, Contre l’obscurité (1986), Toulon, [« La Nerthe-La petite classique »], 2102.
Ricken, Ulrich, Grammaire et philosophie au siècle des Lumières. Controverses sur l’ordre
naturel et la clarté du français, Villeneuve-d’Asq, Publications de l’Université de Lille, 1978.
Rivarol, Antoine, Discours sur l’universalité de la langue française, Paris, Manucius [« Le
philologue »], 2013.
Saint-Paul (de), Eustache, Exercices spirituels, éd. augmentée de Six méditations par l'auteur,
Paris, M. Du Puis, 1640.
D’UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE LA CLARTÉ À UNE ESTHÉTIQUE DE LA CLARTÉ. ASPECTS DE LA FORTUNE DU
CONCEPT DE CLARTÉ À L’ÂGE CLASSIQUE EN FRANCE. COURS DE PHILOSOPHIE DE L’ART. MASTER I. UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE. PREMIER SEMESTRE. ANNÉE UNIVERSITAIRE 2014-2015.
19
Saint-Paul (de), Eustache, Summa philosophiae quadripartita : de rebus dialecticis,
moralibus, physicis et metaphysicis, Paris, Charles Chastelain, 1609.
Siouffi, Gilles, Le génie de la langue française. Études sur les structures imaginaires de la
description linguistique à l’âge classique, Paris, Champion, 2010.
Valéry, Paul, Variété, in Œuvres, vol. 1, Paris, Gallimard [« Bibliothèque de la Pléiade »],
1957.
Valéry, Paul, « Cartesius redivivus », M. Jarrety (éd.), Cahiers Paul Valéry, 4, Paris,
Gallimard, 1986.