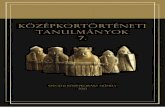Péter Mezei - Dóra Hajdú Textbook Second Edition © Szeged ...
Dumitru Tucan (dir.), Mémoire, histoire, témoignage, Szeged, Jatepress, 2014.
Transcript of Dumitru Tucan (dir.), Mémoire, histoire, témoignage, Szeged, Jatepress, 2014.
MÉMOIRE,HISTOIRE,
TÉMOIGNAGE.
ESSAIS SUR LA LITTÉRATUREDU GOULAG EST-EUROPÉEN
DUMITRU TUCAN(dir.)
Szeged 2014
CE LIVRE EST PARU AVEC LE SUPPORT DE L'AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE.
Dumitru TUCAN enseigne Théorie littéraire, Études culturelles, Littérature desespaces concentrationnaires, Littérature roumaine et Littérature comparée à laFaculté des Lettres de l'Université de l'Ouest de TimiÕoara, Roumanie. Ses intérêts de recherche sont concentrés sur l'histoire des idées littéraires,
l'esthétique de la réception, les reflets de la modernité esthétique dans la littéra-ture roumaine et l'étude des liaisons de la littérature avec l'espace socioculturel.Livres publiés : Eugène Ionesco : théâtre, metathéâtre, authenticité (2006) et
Introduction aux études littéraires (2007) (en roumain). Il a publié aussi desétudes sur la littérature de l'Europe Centrale et la littérature de l'univers concen-trationnaire. Il est membre de l'Association Roumaine de Littérature Comparéeet de NCCS (The Network for Culture and Cultural Studies).
© Dumitru Tucan et les auteurs des études, 2014© JATEPress, 2014
ISBN 978—963—315—188 —4
Sommaire Dumitru TUCAN Avant-propos ..................................................................................... 7 Smaranda VULTUR Mémoire, histoire, témoignage : témoigner sur le passé communiste de la Roumanie dans la Roumanie postcommuniste .............................. 17 Maria Mirela MURĂRESCU La littérature concentrationnaire ....................................................... 27 Dumitru TUCAN Histoire – mémoire – trauma. Témoignages du goulag soviétique ... 45 Maria TERTECI Récits sur l’univers concentrationnaire roumain ................................ 79 Constantin JINGA Nicolae Steinhardt (1912-1989) ...................................................... 105 Florin OPRESCU Alexandre Soljenitsyne et la mémoire du gouffre ............................. 151
5
AVANT-PROPOS
Dumitru TUCAN
Il y a 100 ans, peu avant que la Première Guerre mondiale n’éclate, la paix de l’Europe (et, implicitement, du monde entier) sem-blait indestructible. A tel point qu’au moment où les petits conflits politiques entre les États européens semblaient mener la tension jus-qu’au point explosif des mobilisations des armées, l’optimisme des économistes, des journalistes ou des hommes politiques s`affirmait comme inébranlable lui-même. Dans un livre célèbre paru en 19091, Norman Angell démontrait, au long d’une chaîne des raisonnements qui se réclamait des statistiques et des analyses économiques des pos-sibles failles géopolitiques du temps, la « futilité » d’une guerre européenne dans une époque déjà « globalisée ». « Durant l’été de 1914 l’économie mondiale était florissante d’une manière qui nous est parti-culièrement familière [à nous, qui vivons au XXIe siècle]. La mobilité des biens de consommation, du capital et de la main-d’œuvre avaient atteint un niveau comparable à celui d’aujourd’hui »2, écrira cent ans plus tard l’historien Niall Ferguson, en admettant tout de même que le XXe siècle, malgré son début pacifiste et optimiste, s’est avéré être le
1 Norman Angell, The Great Illusion. A Study of the Relation of Military Power to National Advantage, New York and London, G. P. Putnam's Sons, 1913. 2 Niall Ferguson, The War of the World, New York, Penguin Press, 2006, p. 73 (n.t.).
7
comble de la sauvagerie et de la violence institutionnalisée, un vrai « âge de la haine »1.
Dans son livre de 2006, The War of the World [La guerre du monde], Ferguson réussit à esquisser les vecteurs contradictoires et les mouvements convulsifs de l’histoire tragique du XXe siècle. Il analyse l’assemblage explosif des signes de la désagrégation impériale et de la volatilité économique (y compris la naissance de la culture totalitaire, la popularité des dictateurs psychopathes et, pourrait-on y ajouter, des projections idéologiques coercitives), qui ont conduit à l’institutionnalisation de la violence, de l’exclusion et du crime au nom de la nation, de l’ethnie, de la race ou de la classe sociale. Durant le XXe siècle, la violence identitaire et ses accessoires (l’idéologie, le langage de l’exclusion, l’extrémisme politique, la violence ritualisée ou les liturgies en masse de la haine) ont atteint les coins les plus cachés de l’imaginaire socioculturel, en générant une vraie industrie de la vio-lence, dont les guerres (civiles, régionales ou mondiales) n’ont représenté que la manifestation la plus visible et la moins illégitime. Les formes de surveillance, d’incarcération, de torture et d’exécution arbitraire n’ont jamais été plus déshumanisantes et plus criminelles que pendant le XXe siècle.
Dans ce « contexte de la haine », on peut identifier deux phé-nomènes extrêmes générés par les légiférations de l’exclusion et légitimés idéologiquement par l’obsession irrationnelle de la pureté de la „race” et par celle, utopique, de l’égalité sociale, phénomènes qui sont devenus des vraies métonymies de la cruauté de l’homme envers l’homme. Il s’agit, d’une part, de l’Holocauste, l’effet tragique et ab-surde d’une vraie « industrie du génocide » organisée avec obstination et précision par l’Allemagne nazie et ses alliées. Il s’agit, d’autre part, du Goulag, phénomène carcéral généré par « l’industrie pénitencier »2 soviétique, installé en Russie après la révolution bolchévique et qui a été exporté dans tous les pays de l’est européen après la deuxième Guerre mondiale. Les deux phénomènes concentrationnaires, générant des univers dominés par l’esclavage, la déshumanisation et la mort, représentent pour l’histoire récente non seulement les points de repère
1 Bien que l’historien britannique n’appelle « l’âge de la haine (age of hatred) » que la première moitié (1904 – 1953) du XXe siècle (N. Ferguson, op. cit., p. li), on peut observer que ce siècle a gardé jusqu'à la fin son empreinte violente. 2 L'expression appartient à Soljenitsyne et donne le titre du premier volume de son fameux Archipel Goulag.
8
des manifestations du mal dans ses formes absurdes1, mais aussi les espaces où l’on peut trouver les racines des expériences traumatiques individuelles qui, grâce aux narrations testimoniales de ceux qui ont réussi à y survivre, ont dessiné les contours complexes de la mémoire traumatique du XXe siècle.
Malgré le fait que les premiers signaux traumatiques de ce siècle trouble commencent à se manifester dès les premières décennies après la révolution bolchévique, les données substantielles sur la souf-france humaine proliférée par les ruptures historiques de la première moitié du XXe siècle commenceront à s’accumuler après la deuxième Guerre mondiale, catalysées par la tragédie récente de l’Holocauste. Même si immédiatement après la guerre la plupart des commentateurs ont essayé plutôt d’analyser les significations politiques de l’Holocauste, l’ampleur des témoignages sur les expériences trauma-tiques vécues dans les camps de concentration nazis a rendu possibles des discussions centrées sur l’irrationalisme, la barbarie et l’absurde de l’univers concentrationnaire, quel qu’il soit.
Ces discussions ont réussi à attirer l’attention sur l’analyse du discours idéologique, qui rationalise les formes de l’horreur mise en acte, et de sa capacité de justifier les crimes les plus irrationnels et ab-surdes. Dans ce sens, le plus important témoignage est, peut-être, celui de David Rousset, lui-même détenu dans les camps de concentration nazis. Écrivant, à la fin des années ’40, deux livres importants sur ce sujet (L'Univers concentrationnaire – 1946, Les Jours de notre mort – 19472), Rousset réussit à dénoncer les formes infernales de l’horreur des camps de concentration. L’importance de son témoignage est aug-mentée à l’époque par la vigueur de ses activités visant la conscientisation, par l’opinion publique européenne, du fait paradoxal que, quelques années après la désagrégation de l’univers concentration-naire nazi, un espace d’une inhumanité comparable (i.e. l’univers du Goulag soviétique se trouvant à ce moment-là en pleine expansion dans les pays de l’Europe de l’est) continue à perpétuer des formes gro-tesques de violence, d’esclavage et de crime contre l’humanité. Dans ce contexte, les témoignages de Margarete Buber – Neumann (1946)3, qui
1 Voir Tzvetan Todorov, Face à l’extrême, Seuil 1991. 2 David Rousset, L'Univers concentrationnaire, 1946, Paris, Éditions de Minuit, 1965 ; David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, Paris, Ramsay, 1988. 3 Margarete Buber – Neumann, Prisonnière de Staline et d'Hitler. Tome 1. Déportée en Sibérie, Paris, Seuil, 1949.
9
a survécu aux camps nazis, et aux camps soviétiques également, de V. A. Kravcenko (1947)1 ou de Julius Margolin (1949)2 ne sont pas négli-geables. Ces témoignages ne sont que quelques exemples des écrits qui, à la fin des années ’40, ont commencé à retenir l’attention sur cet uni-vers de l’horreur, négligé jusqu'à ce moment-là.
S’il est vrai que pendant les années ’50 les écrits testimoniaux sur le goulag sont utilisés dans le contexte de la Guerre froide plutôt comme éléments du jeu idéologique, la légitimation de l’intérêt pour l’univers concentrationnaire soviétique viendra justement de l’URSS. La publication, en novembre 1962, du roman Une Journée d’Ivan De-nissovitch d’Alexandre Soljenitsyne et son succès international immédiat seront à l’origine d’une attention exceptionnelle accordée aux réalités du Goulag vers la fin des années ’60. Vu au début comme un texte nécessaire dans le contexte du « dégel idéologique» initié par N. S. Khrouchtchev, le petit roman de Soljenitsyne prouvait que la discus-sion sur l’univers concentrationnaire devait se développer non seulement comme un acte nécessaire de séparation par rapport a l’héritage stalinien, mais aussi comme une prise de conscience concer-nant les racines idéologiques de la terreur, racines qui s’étendent au-delà de l’époque dominée dictatorialement par Staline. Soljenitsyne continuera à affirmer le besoin de briser le silence sur le sujet, poursui-vant la documentation en vue d’écrire son monumental Archipel Goulag qui, une fois publié (19733), va représenter un vrai catalyseur d’une nouvelle dimension artistique et documentaire, « la littérature du goulag soviétique », sous-genre de la littérature concentrationnaire. À partir de la publication de l’Archipel Goulag, la culture européenne va récupérer les grands noms de ce sous-genre. De nouveaux témoignages vont continuer à paraître et à fonctionner comme des instruments mné-motechniques de l’histoire traumatique du XXe siècle et de ses effets tragiques. Ce sous-genre s’amplifiera ultérieurement avec les écrits testimoniaux venus de tout l’espace est-européen, là où le système con-
1 V. A. Kravchenko, J'ai choisi la liberté ! La vie publique et privée d'un haut fonc-tionnaire soviétique, traduit de l'américain par Jean de Kerdélan, Paris, Éditions Self, 1947. 2 Julius Margolin, Voyage au pays des Ze-Ka, trad. de Nina Berberova et Mina Jour-not, révisée et complétée par Luba Jurgenson, Paris, Éditions Le Bruit du temps, 2010. 3 La première édition (en russe) est publiée à Paris, en 1973. Les éditions anglaise et française vont paraître en 1974.
10
centrationnaire soviétique avait été exporté après la deuxième Guerre mondiale.
Effet paradoxal des traumas de l’histoire récente, la littérature concentrationnaire est un phénomène complexe comme nature et am-plitude. Sa nature paradoxale est issue du croisement de l’acte de la remémoration du trauma avec le besoin de témoigner au nom des autres. Post-traumatique et enluminée par les émotions de la remémora-tion des expériences-limites de la vie carcérale, la littérature concentrationnaire a un évident caractère testimonial. Dans tous les textes de ce genre1 on peut surprendre une presque impossible distan-ciation de soi et de la force de l’expérience traumatique. Cette distanciation peut s’accomplir exclusivement par l’acte d’élever au rang de réalité paradigmatique la souffrance et la dégradation de l’individu dans l’univers concentrationnaire. Les souffrances propres, a côté des souffrances des autres, sont narrées, parfois en dépit de l’émotion géné-rée par l’expérience-limite, comme des détails qui s’accumulent dans l’acte d’une documentation nécessaire. C’est pourquoi dans chacun de ces textes on peut déchiffrer, en même temps, une géographie physique et une autre, morale, de l’univers concentrationnaire, toutes les deux révélatrices pour les expériences traumatiques. Et non dernièrement, chacun de ces « documents » a aussi une fonction thaumaturgique. L’acte de la remémoration est un acte de se réconcilier avec soi-même et de se retrouver en tant qu’image se réclamant d’un modèle d’humanité victorieuse dans la lutte avec l’absurde et la terreur.
On peut dire aussi que la littérature concentrationnaire (dans sa variante de littérature du goulag) a une nature complexe du point de vue de son « amplitude ». La richesse quantitative de la littérature du goulag est liée, malheureusement, à la vastitude historique et géogra-phique de « l’Archipel Goulag ». A partir des premières narrations testimoniales qui paraissent après la révolution bolchévique, en parcou-rant les riches témoignages des années ’60 et ’70 sur les camps soviétiques ou la multitude d’écrits sur les camps de l’Europe de l’Est, parus après 1990, et allant jusqu’aux réalités contemporaines du Gou-
1 On peut inclure ici les écrits à caractère fictionnel comme Une journée de la vie d'Ivan Denissovitch (Alexandre Soljenitsyne) ou Les récits de Kolyma (Varlam Cha-lamov).
11
lag nord-coréen1, la littérature de l’univers concentrationnaire commu-niste est abondante et diverse dans ses variantes.
*
Le présent volume est issu d’une collaboration occasionnée
par un projet international financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), projet intitulé « Mise en place du master interdis-ciplinaire : Civilisation Européenne. Les Grands Livres ». Ayant comme but principal l’organisation de deux lignes d’études masterales, l’une à l’Université de l’Ouest de Timișoara et l’autre à l’Université d’Etat de Chișinău, ce projet a concentré les efforts des chercheurs et des enseignants impliqués dans la création des cours universitaires se focalisant sur un noyau canonique représenté par les grands livres de la culture européenne. Il ne pouvait pas manquer de ce tableau panora-mique de la culture européenne un grand nom de la littérature concentrationnaire, Alexandre Soljenitsyne. La présence d’un grand représentant de cette même littérature, venant de l’espace roumain, était également obligatoire : il s’agit de Nicolae Steinhardt. C’est pourquoi ce volume, qui a originellement une utilité pédagogique, s’intéresse premièrement aux écrits et aux personnalités de ces deux écrivains, mais analyse inévitablement le contexte historique, idéologique et do-cumentaire qui encadre les réalités traumatisantes de l’univers concentrationnaire engendré par l’idéologie communiste.
La première étude appartient à l’une des voix les plus autori-sées de l’histoire orale et de l’anthropologie culturelle roumaine. Dans Mémoire, histoire, témoignage : témoigner sur le passé communiste de la Roumanie dans la Roumanie postcommuniste, Smaranda Vultur part des suggestions offertes par Paul Ricœur dans son livre La mémoire, l’histoire, l’oubli, pour analyser la problématique paradoxale de l’acte de la remémoration. Bien que l’auteur se concentre sur les manifesta-tions roumaines du phénomène, la perspective peut être généralisée. Les points de repère sont : la relation avec le contexte de production, la relation entre l’acte de témoigner (vu comme acte de communication /
1 Dans les dernières décennies ont paru quelques narrations sur l'univers concentra-tionnaire nord-coréen qui ont attiré l'attention sur la perpétuation de ces pratiques inhumaines jusqu'à aujourd'hui. Parmi ces narrations-témoignages on peut mention-ner : Kang Chol-hwaun (avec Pierre Rigoulot), Les aquariums de Pyongyang. Dix ans au goulag nord-coréen, Paris, Editions Robert Laffont, 2000 ; Blaine Harden, Escape from Camp 14, London, Mantle, 2012.
12
acte narratif) et le témoignage (comme acte de production mémorielle) et les enjeux identitaires de l’acte testimonial, qui impliquent toujours une négociation entre plusieurs perspectives. Ces paradoxes de la mé-moire vue dans sa triple perspective (acte de remémoration / acte communicationnel / acte de négociation identitaire), sont extrêmement importants pour toute la littérature concentrationnaire, car, selon l’auteur cité, « les témoignages ne sont pas des descriptions ou des nar-rations neutres », mais des « modalités polémiques » d’agir, leur effet étant toujours attitudinal. Nous avons affaire à des suggestions géné-reuses qui mettent en évidence la complexité de la relation entre l’acte de témoigner, son inscription textuelle et la dynamique contradictoire des contextes de sa production.
Dans la deuxième étude, La littérature concentrationnaire, Mirela Murărescu part de la réalité complexe de la littérature concentra-tionnaire (la littérature de l’Holocauste et celle du goulag) pour tenter de décrire et de définir brièvement ce phénomène particulier du XXe siècle. La définition en est simple : la littérature concentrationnaire n’est autre chose que l’écriture qui trouve ses racines dans les expé-riences-limite provoquées par l’univers concentrationnaire. Les choses se compliquent au moment où l’on essaie d’analyser le processus géné-ratif de « l’acte littéraire » qui naît de l’expérience traumatique. Dans ce processus s’entrelacent les limites de l’existence, la tension de l’expérience individuelle, les enjeux de la mémoire, les paradoxes de l’(H)histoire et l’obsession de laisser une trace dans la conscience col-lective. À tout cela s’ajoute le besoin de se confesser, auquel l’auteur attribue des dimensions non seulement thaumaturgiques, mais éthiques aussi.
Dans la troisième étude, Histoire, mémoire, trauma. Témoi-gnages du Goulag soviétique, Dumitru Tucan retrace l’histoire des remémorations de l’univers concentrationnaire soviétique, à partir des témoignages publiés à la fin des années ’20 (S. A. Malsagoff, I. Beszo-nov, T. Tchernavin, Vl. Tchernavin, G. Kitchin, etc.), jusqu’à ceux qui ont paru après les années ‘60 (E. Guinsbourg, V. Shalamov etc.). Le but de cette étude est non seulement de décrire une réalité testimoniale souvent occultée (celle des années d’avant la Deuxième Guerre mon-diale) et le contexte historique spécifique, mais aussi de décrire la préhistoire de la naissance d’un genre particulier, la littérature du gou-lag, et ses dimensions complexes (testimoniales, mémorielles, fictionnelles, politiques – la littérature de la désillusion).
13
Si ce troisième article anticipe l’étude sur Alexandre Soljenit-syne de la fin du volume, le quatrième, Récits sur l’univers concentrationnaire roumain, ayant pour auteur Maria Terteci, a le rôle de décrire le contexte historique particulier où naîtra Le Journal de la Félicité de Nicolae Steinhardt. En s’intéressant, d’une part, au contexte politique, idéologique et institutionnel de l’instauration du commu-nisme en Roumanie et, d’autre part, aux destins individuels qui souffriront la répression, Maria Terteci réussit à faire une esquisse pa-noramique des témoignages de l’univers concentrationnaire roumain (Lena Constante, Annie Samuelli, Ion Ioanid, Nicolae Steinhardt, etc.).
Dans la quatrième étude, amplement documenté, Constantin Jinga se focalise sur la personnalité complexe de Nicolae Steinhardt, l’auteur de la plus élaborée narration testimoniale venue de l’univers concentrationnaire roumain, Le journal de la Félicité. Constantin Jinga est intéressé ici à reconstruire l’image dense de Nicolae Steinhardt, au long d’une cartographie détaillée de son œuvre, doublée par une radio-graphie de l’existence de l’auteur. Nicolae Steinhardt, l’intellectuel « bourgeois » raffiné de la période de l’entre-deux-guerres, le juif margi-nalisé durant les années du totalitarisme roumain d’extrême droite (1940 – 1944), « l’ennemi de classe » arrêté, condamné et incarcéré par les autorités communistes et, après sa libération, converti au christia-nisme orthodoxe, représente pour la culture roumaine une synthèse heureuse entre le théologien raffiné et l’homme de lettres sophistiqué qui a donné, à l’opinion de Monica Lovinescu et de Virgil Ierunca1, l’un des livres fondamentaux de la littérature concentrationnaire du XXe siècle.
En s’appuyant sur les détails de la genèse de ce volume, en le décrivant à l’intérieur de l’œuvre entière et en le liant au contexte histo-rique, Constantin Jinga a raison d’affirmer que le Journal de la félicité représente « le fait d’assumer et de partager un trajet spirituel rédemp-toire personnel », un témoignage, un testament et, en même temps, « la preuve d’une thérapeutique de la mémoire ». À la fin de ces considéra-tions on obtient l’image d’un esprit libre qui peut assumer, pareillement à Soljenitsyne, l’acte de remémoration comme acte fondamental de la liberté individuelle.
La dernière étude, celle de Florin Oprescu – Alexandre Solje-nitsyne ou la mémoire du gouffre, porte son attention sur la personnalité
1 Opinion exprimée au moment de la lecture du Journal de la félicité au poste de radio « Europe Libre ».
14
et l’œuvre de celui qui a rompu le silence sur le sujet du goulag sovié-tique, en provoquant ainsi une rupture qui a rendu possible la récupération mémorielle d’une immense histoire traumatique générée par l’idéologie communiste et, par conséquent, a incité à une discussion nécessaire sur la « misère » de la pensée utopique. Repère important au cours de l’entier volume, Soljenitsyne est analysé dans cette étude comme « la solution créatrice » pour « sortir du chaos entropique du goulag ». Sa biographie, divisée en deux fragments suite à la rupture provoquée par son arrestation et sa condamnation à huit ans dans « l’Archipel Goulag », peut être reconstruite comme le récit extraordi-naire de la vie d’une individualité créatrice unique. Pour Soljenitsyne, l’expérience traumatique de l’incarcération devient le catalyseur d’une œuvre préoccupée obsessivement de l’image de la lutte démesurée entre l’individu et l’histoire.
En analysant Une journée de la vie d’Ivan Denissovitch, Florin Oprescu insiste sur les images lumineuses qui entourent l’esprit indivi-duel luttant avec l’enfer concentrationnaire, en suggérant aussi que derrière les images fictionnelles ou documentaires de l’écriture se trou-vent un vrai hymne dédié à l’humanité et un plaidoyer émouvant pour la dignité humaine, que Soljenitsyne trouve indestructible même dans les plus absurdes situations. Par cette image presque dostoïevskienne de l’auteur de L’Archipel Goulag on voit s’achever le récit simple, mais plein de tension, de l’homme du XXe siècle, assailli moralement et physiquement par l’Histoire. C’est un récit qui ne peut être reconstruit que par fragments, mais, un récit de dimensions épiques de l’expérience traumatique, de la survie, de la difficulté de témoigner, du pouvoir de rester digne et du besoin thérapeutique accompli par l’acte du témoignage.
15
MÉMOIRE, HISTOIRE, TÉMOIGNAGE : TÉMOIGNER SUR LE PASSÉ COMMUNISTE
DE LA ROUMANIE DANS LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE
Smaranda VULTUR
Dans le livre de Paul Ricœur, Mémoire, histoire, oubli (20001) la problématique de la mémoire est analysée en même temps du point de vue historique, philosophique et herméneutique. Cette œuvre est une œuvre de synthèse, l’auteur reprenant ici des thèmes qu’il a développés ailleurs dans une autre perspective que celle de la mémoire : le thème de la représentation et de l’interprétation, de l’histoire et de la fiction, du pouvoir du récit à (re)configurer le passé et de moduler l’identité, celui des relations entre le texte et l’action etc. Par son système compli-qué de renvois et de reprises, situées à des niveaux d’explications et de mises en contexte différentes, cet œuvre nous oblige à un va-et-vient entre des affirmations faites par le philosophe dans un texte ou un autre, dans un chapitre ou un autre de son œuvre, nous permettant de trans-former le travail de citation dans un travail d’élargissement du contexte de référence jusqu’à ce que les sens qu’un thème nous permet d’intégrer tendent à s’épuiser. Ce mouvement intégratif et totalisant met en difficulté toute tendance à isoler un sujet d’un autre, du même
1 Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Editions du Seuil, Points Seuil, Essais, 2000.
17
champ thématique et surtout l’effort d’appliquer les acquis théoriques à de nouveaux contextes.
La question du/des témoignage(s) nous intéresse ici sous plu-sieurs aspects :
- comme relation à un contexte de production et de partage précis, celui de la Roumanie post – communiste ;
- comme relation entre l’acte de témoigner (comme acte de narration, communication et partage mémoriel) et le témoignage en tant que production mémorielle, récit et trace (inscription de la mémoire) ;
- comme enjeu identitaire qui implique la négociation entre des perspectives différentes au cours d’une mise en commun de la mé-moire ;
Cette façon d’articuler la problématique du témoignage sug-
gère du même coup qu’en accord avec Paul Ricœur lui-même, nous considérons « les phénomènes de représentation – parmi lesquels les phénomènes mnémoniques » – « régulièrement associés aux pratiques sociales »1 .
Le témoignage nous intéresse ici comme une de ces pratiques sociales, donc comme une production de sens gouvernée par certaines normes sociales, mais aussi discursives qui tendent à l’institutionnaliser, comme générateur du lien social et comme rapport à soi et aux autres (Ricœur parle dans le contexte d’une analyse des relations entre la mémoire des différentes générations « d’une triple attribution de la mémoire : à soi, aux proches, aux autres »2 .
Ce que fait l’originalité de la pensée de Ricœur c’est de corré-ler le plan de la représentation textuelle au plan discursif ou de la production discursive, ainsi que le plan de l’action par le témoignage au plan d’une progressive structuration des liens, qui donne à la probléma-tique identitaire une « dimension à la fois publique et intime »3 :
« La tendance générale du présent ouvrage est de tenir le couple de l’action et de la représentation – dit Ricœur dans M.H.O – pour la matrice double du lien social et des identités qui instituent ce der-nier »4.
1 Ibid., p. 161. 2 Ibid., p. 163. 3 Ibid., p. 515. 4 Ibid., p. 568.
18
Le rapport à l’autre comme rapport structurant l’identité – rap-port à soi – même et à autrui – est de plus impliqué dans le travail à travers lequel le témoignage s’accomplit comme acte de communica-tion dans son interprétation : c’est-à-dire sa capacité d’interpeller, de demander ou d’offrir une interprétation. C’est Jacques Derrida qui, dans un essai dédié à Paul Ricœur dans le numéro des Cahiers de l’Herne de 2004 (tome I), extrait les passages les plus significatifs dans lesquels, parlant en tant qu’herméneute, Ricœur rappelle que le concept de témoignage « est herméneutique en un double sens. En ce sens d’abord qu’il donne à l’interprétation un contenu à interpréter. En ce sens ensuite qu’il appelle une interprétation »1.
*
En ce qui concerne le contexte de la production des témoi-
gnages dans la Roumanie post communiste nous pouvons remarquer plusieurs aspects qui parlent en même temps de ses constants et de sa dynamique :
Le contexte du processus de partage mémoriel est marqué d’un coté par la libération progressive du dire, ce qui se traduit en fait par une redéfinition des frontières entre ce que peut être dit et ce que ne peux pas (encore ?) être dit. Les censures de la période communiste une fois levées officiellement (« mémoire empêchée » au termes de Ri-cœur) continuent de survivre sous la forme de la peur ou de la prudence intériorisées (un type d’autocensure), ou sous la forme des pressions qui viennent de la part de ceux qui ont l’intérêt de les maintenir ou de les imposer2.
Malgré ces conseils, surtout les premières années d’après 1989 ont été marquées par une riche production de témoignages écrits ou oraux. Mais l’ouverture lente, partielle et tardive des archives concer-nant la période communiste a eu une influence considérable sur la manière dont le passé a été reconstruit et réutilisé sur la scène publique, certains mettant en doute la fiabilité des témoignages ou profitant des faiblesses ou des approximations inhérentes aux discours de mémoire,
1 Jacques Derrida, La parole. Donner, nommer, appeler, chez Revault d’Allonnes & Francois Azouvi (ed.), Cahiers de l’Herne 2, Ricœur, 2004, Paris, Editions de l’Hernes, p. 29. 2 « Intéressez-vous au présent et au futur, ignorez le passé », disait un premier mi-nistre des années 2000-2004 – une sorte de « devoir d’oubli » est souvent invoqué au nom des urgences du présent.
19
pour les contester en bloc. Mais, qu’ils proviennent des acteurs indivi-duels eux-mêmes ou qu’ils soient recueillis sous forme de témoignages oraux par les chercheurs, ces documents offrent des informations pré-cieuses non seulement sur les faits, tels qu’ils sont perçus après un demi-siècle, mais aussi sur les fonctions personnelles et publiques qui leur sont attribuées par ceux qui les produisent, ainsi que par ceux qui les éditent ou qui en sont les destinataires.
Le champ du partage de la mémoire s’est configuré dès le dé-but comme un champ de compétition ou de conflits, les discours se construisant souvent en réplique l’un par rapport à l’autre et impliquant une dimension polémique directe ou implicite, qui devient souvent, comme nous allons le voir, un cadre de la représentation du passé1.
Mais le concurrence entre les mémoires a pris aussi d’autres aspects, tels que l’accès simultané à la scène publique de la parole, des victimes et de bourreaux. L’absence d’une loi de lustration ainsi que de tout procès du communisme jusqu’au 2006 quand formellement et sur-tout symboliquement le président de la Roumanie a condamné le régime communiste et a demandé pardon aux victimes au nom de l’état roumain2 a favorisé, au nom de la démocratie récupérée, la présence
1 Telle fille d’un ancien patron de fabrique de souliers de Timișoara, arrivé dans cette ville en refuge de Cernowitz en 1940 et exproprié en 1948 par le régime communiste évoque l’image de son père non seulement avec beaucoup d’affection, mais évoquant aussi son comportement égalitaire, son attitude de respect et soutien pour ses ouvriers qui à leur tour lui expriment la gratitude et l’aide même quand il devient un simple vendeur de loto ; le portrait ainsi dressé est en parfait contraste avec l’image « d’exploiteur » cynique tel que la propagande du parti présentait tout propriétaire, devenu incarnation du « ennemi de classe » . 2 En ce qui concerne l’ouverture des archives, le moment décisif a été celui de l’élaboration en 2006 du Rapport d’Analyse de la Dictature Communiste par une Commission présidentielle, dirigé par Vladimir Tismăneanu (professeur de sciences politiques à l’Université de Maryland, U.S.A.). C’est à ce moment et tout de suite après que par une décision politique une liberté d’accès sans précédent (bien que pas complète) aux archives de la police secrète et à celles du Comité Central du Parti a vu le jour. L’initiative de l’ouverture des archives, ainsi que celle de la condamnation du régime communiste roumain lors de la séance publique du Parlement du 18 décembre 2006 qui a été formulée sur la base du même Rapport, sont venues de la société civile roumaine qui a exercé des pressions constantes sur les politiciens. Le discours du président en fonction, devant un Parlement fortement divisé sur la question de la con-damnation du communisme, comportait une demande d’excuses adressée aux victimes et à leurs familles, ainsi qu’une déclaration dans laquelle le régime commu-niste roumain était déclaré « illégitime et criminel ». En absence d’une Loi de lustration, cette déclaration est restée formelle, même si elle a été assumée par le président de la Roumanie, au nom de l’état roumain. Une spécificité du contexte rou-
20
simultanée sur la scène publique des responsables du régime et de leurs victimes1.
Les témoignages ne sont pas des descriptions ou de narrations neutres et la construction polémique du discours n’est pas la seule forme à travers lesquels ils deviennent des modalités de l’agir. Témoi-gner ainsi que par exemple commémorer sont des actions qui situent ceux qui les initient autant que les rapports à ceux qui y participent. La position d’où on parle ou agit devient extrêmement importante dans un contexte relativement mobile et qui se laisse facilement remodeler par un type de discours qui revendique non seulement le droit de dire ou de se souvenir, mais aussi l’efficacité du dire . Cette dimension est partie de l’acte même de narrer par exemple sa propre vie, le récit d’une vie étant selon Ricœur une sorte d’histoire fondatrice, impliquant ce qu’il nomme une ascription, c’est-à-dire, « l’assignation d’un agent à une action »2, aspect important de l’identité comme soi (ipséité), de l’exploration de cette identité comme altérité.
Mon terrain d’étude de cette problématique a été surtout le témoignage oral sous forme de récit de vie, qu’il s’agit des témoins qui ont partagé une expérience commune , tel que le déplacement forcé dans les années 50, de 44000 personnes d’une région à l’autre de la Roumanie, installés dans les camps dans la plaine de Bărăgan et consi-gnés à leur nouveau domicile pour cinq ans ou qu’il s’agit des personnes qui ont été plus ou moins exposés à des situations de crises, ayant un trajet de vie plus linéaire, mais qui impliquait de toute façon qu’ils s’adaptent aux conditions de vie sous un régime totalitaire. Nous pouvons remarquer toute de suite des disparités entre ceux qui se si-tuent par rapport à leur histoire vécue et expérimentée comme victimes, parlant surtout de leur souffrance, mais aussi des stratégies de survi-vance et ceux qui se situent par rapport à leur vie comme agents qui se
main est liée à un double et partiel oubli : les victimes de l’Holocauste et les victimes du communisme. Les tentatives de faire dialoguer les deux mémoires ont donné nais-sance à de multiples confusions, à des compétitions faussant les enjeux et amplifiant les frustrations, devenant ainsi souvent une raison pour empêcher la libération de la parole et l’accès aux documents. Précédant de quelques années le Rapport de condamnation du communisme, le Rap-port de condamnation du Holocauste en Roumanie (2001), lui aussi endossé par le Président de l’époque au nom de l’état roumain a servi de modèle a celui-là (à la fois dans la manière d’organiser la documentation et en tant que modalité d’action pu-blique. 1 Par exemple le cas récent Herta Müller. 2 P. Ricœur, op. cit., p. 297.
21
sont réalisés par des stratégies d’adaptation plus ou moins transparentes à travers leurs récits. Ces représentations ne sont pas aussi nettes qu’on pourrait le supposer, il s’agit plutôt d’une variation des registres et d’une échelle de degrés que d’une polarisation nette. Quelques fois des renversements de ces positions sont possibles. Les personnes déplacés au Baragan se présentent ainsi en victimes de ceux qui ont décidé leur déportation, construisant le récit au nom d’un «nous» et se définissant comme objets des actions de ces «ils» qui représentent l’instance puni-tive. Mais, en même temps ils parlent de leur vie dans la plaine de Bărăgan comme d’une action d’apprivoisement d’un lieu hostile, trans-formant le récit de leurs souffrances dans une histoire de survivance qui transforme la victime en héros civilisateur. C’est le mythe du bon co-lon, ainsi que l’éloge des vertus morales ou pratiques des Banatais qui servent d’appui à une telle perspective, impliquant une revendication d’ordre identitaire. Cette revendication est en même temps une façon de plaider non coupable devant une instance imaginée comme jugeant les faits et les événements.
Une telle façon d’envisager les faits nous ouvre l’accès à l’horizon des valeurs, des normes et des croyances des sujets racontant, mais nous dévoile aussi un aspect important de la structure communica-tionnelle du témoignage. Le témoin fait appel par son récit au destinataire réel, présent en chaire et os devant lui et participant à la production du témoignage ou à l’instance d’un tiers, un destinataire absent, mais non moins important, ciblé par le récit en qualité d’auditeur virtuel. C’est clair qu’une telle façon de concevoir le récit de vie - qu’il s’agit d’une auto présentation du témoin dans son histoire en victime innocente ou en héros vainqueur – prend l’aspect d’un débat et utilise le modèle d’un procès juridique ; L’interpellation de l’autre équivaut à une demande de reconnaissance, – dans le sens dans lequel Charles Taylor parle d’une politique de la reconnaissance. Cela ne fait qu’accentuer la dimension actionnelle du récit qu’il s’agit de la mise en place de son pouvoir argumentatif ou d’autres stratégies pour capter l’attention de l’interlocuteur réel ou virtuel. Il nous reste donc à analy-ser la rhétorique mise en place pour convaincre, impressionner, accuser, défendre ou blâmer ou pour négocier une certaine image des choses. C’est à ce niveau que l’armature idéologique du récit se laisse descellée et que le travail de l’imaginaire social se laisse percevoir.
Structuré de cette manière, le témoignage devient d’un autre point de vue, une manière de rationaliser la souffrance, de prendre les
22
distances par rapport à un passé traumatique, mais déjà bien éloigné du moment de sa mise en récit. L’accent se déplace vers une vue rétros-pective de tout le trajet d’une vie, dont le bilan est finalement positif, car le récit semble avoir comme fonction le fait même de réparer les blessures, en inversant le destin des victimes : elles ont tout perdu, mais la vie leur a réservé d’autres récompenses, comme la réussite des en-fants ou la récupération des biens et surtout après 1989 la récupération d’une image identitaire favorable, prestigieuse et compensatrice. Le bilan capte aussi des valeurs morales et didactiques car le récit est tel-lement construit qu’il démontre que « le bien est toujours récompensé et le mal toujours puni ». La liste des maux que le destin a infligés à ceux qui à un moment ou un autre ont agi contre eux, d’une façon in-juste est longue et tellement symétrique a leurs mauvais comportements d’autrefois qu’on puisse douter de leur réalité. Mais l’évocation de telles circonstances sert surtout à rendre, même tardivement, de la co-hérence aux ruptures, de restituer aux fait une logique qui leur manquait – du point de vue des témoins – au moment de leur déroule-ment.
On pourrait dire que le récit corrige d’une certaine manière la réalité, rétablit l’ordre sous ses différentes formes et par son pouvoir re-configuratif – agissant aux différents niveaux de la narration, trans-forme l’histoire de vie dans une histoire exemplaire.
Cet effort de donner aux faits traumatiques du passé commu-niste au niveau d’une mémoire individuelle – même si assumée par la narration comme collective - une intelligibilité et un cadre d’interprétation qui rétablissait la justice allait de pair avec le refus du nouvel pouvoir installé de faire un vrai procès du communisme. Ce que fait problème c’est justement l’impossibilité d’un vrai partage de la mémoire individuelle en dehors des cadres commémoratifs ou de la mémoire des groupes et des associations
La question la plus difficile à trancher reste celle de la culpabi-lité souvent polarisée de manière simpliste : ou bien tout le monde est coupable ou bien personne ne l’est. Cette façon de poser la question masque le vrai problème : qui est responsable de ce que s’est passé pendant un demi-siècle de communisme en Roumanie ?
Une autre façon d’éviter ou de détourner cette question a été de la déplacer vers une autre, concernant la légitimité de celui qui parle et juge : qui a le droit de « dire la vérité », de critiquer ou de contester le régime communiste ? Cette légitimité est devenue à son tour le lieu
23
de conflits acharnés et la contestation menée en son nom, l’arme prin-cipale pour imposer le silence sur le passé (c’est ne pas par hasard que les premiers dossiers rendus publiques par la police secrète étaient ceux qui dévoilaient des actes de collaboration des anciens détenus poli-tiques qui dans leurs mémoires dénonçaient les pratiques criminelles du pouvoir communiste ; il étaient obligés de signer un contrat de collabo-ration à leur sortie des prisons, même si souvent ils refusaient de collaborer après) ;
L’attitude ambigüe du nouveau pouvoir face au passé récent s’est traduite par un message contradictoire au niveau de l’utilisation de la mémoire dans l’espace public.
D’un côté, on pouvait constater une revitalisation du para-digme commémoratif de type héroïsant de l’époque communiste, auquel on ajoutait une dimension sacralisante (« le héros » devenait « le martyr », les prêtres étaient présents à côté des officiels, la céré-monie publique se confondait avec le rituel religieux). Commémorer chaque année les victimes de la révolution de 1989 était une manière de les placer dans la galerie des héros de la nation et de les honorer comme tels, ce qui permettait d’oublier en même temps une question vitale pour leur famille et pour la société : qui les a tués et qui est res-ponsable de leur mort ? La justice a fait traîner les procès, finalement on a trouvé quelques boucs émissaires, et la messe était dite.
Cette attitude va de pair avec la difficulté à accepter au niveau de l’opinion publique l’existence des événements honteux du passé attitude qui est étroitement liée à la façon dont l’historiographie rou-maine, restée fidèle au modèle d’une histoire nationale glorifiante, a présenté le passé pendant le régime communiste. À la manière mani-chéiste de figurer les personnalités politiques et de juger les relations entre ennemis et amis, entre la situation d’avant et celle d’après « l’insurrection armée de 23 août 1944 », s’est ajoutée à l’époque de Ceauşescu une forte tendance à héroïser certains voïévodes roumains, dont le leader communiste se revendiquait pour construire son propre culte. La propagande agressive, xénophobe et nationaliste, qui accom-pagnait sa politique et celle de ses collaborateurs, surtout dans les années ’80, promue par la télé mais aussi par l’école, a créé à travers ce que Ricœur nomme la mémoire historique, telle qu’elle est cons-truite dans cette période, un horizon d’attente très peu favorable à une acceptation critique du passé. Aux distorsions du passé, œuvre de l’historiographie communiste, s’est ajoutée ainsi une manière de se
24
rapporter au passé de laquelle ont surgi beaucoup de malentendus et de distorsions (le cas le plus édifiant, au niveau de la perception publique du passé, étant celui du leader fasciste Ion Antonescu et de Ceauşescu lui-même) qui minent encore actuellement l’espace public du partage de la mémoire. Non moins important pour le fonctionnement de cet espace est l’effet paradoxal qu’une telle situation a eu sur la perception de l’institution qui est censée garantir la production de la vérité sur le passé : l’histoire elle-même, comme lieu de production du discours historiographique. La mise en doute de la crédibilité de cette institution, qui avait tant de prestige auparavant (renforcée par l’Académie rou-maine faisant fonction de garant) a ouvert la porte à une production de discours mémoriels sans précédent, provenant surtout des anciennes victimes, qui revendiquaient la justice, mais aussi comme le l’ai déjà dit, des anciens leaders communistes qui ressentaient le besoin de se justifier ou même de mettre en évidence leur mérite.
*
Nous sommes loin d’un consensus largement partagé et accep-
té par la société. Les raisons en sont multiples : la discordance intergénérationnelle et entre groupes sociaux au niveau de l’expérience vécue et de la mémoire, les pressions du moment (crise économique, scandale de corruption, luttes politiques) qui font oublier ou nier le pas-sé au nom des urgences du présent et du futur, la négation de ce qui est considéré comme honteux dans le passé, l’incapacité d’une analyse lucide de son propre passé et des conséquences de ce passé sur le pré-sent. Les oublis sont à la mesure des peurs encore mal guéries et des responsabilités difficiles à assumer. Bibliographie : Paul Ricoeur, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Editions du Seuil, Points
Seuil, Essais, 2000. Jacques Derrida, La parole. Donner, nommer, appeler, chez Revault
d’Allonnes & Francois Azouvi (ed.), Cahiers de l’Herne 2, Ricœur, 2004, Paris, Editions de l’Hernes.
25
LA LITTÉRATURE CONCENTRATIONNAIRE
Maria Mirela MURĂRESCU La position du critique
La littérature concentrationnaire a une spécificité propre donnée
par le fait que l’objectif proposé est celui de rendre témoignage. Entre l’intention de témoigner et le projet littéraire on aperçoit les embarras d’établir des critères d’évaluation. Lorsque l’historien cherche à inté-grer les confessions, les mémoires, les romans autobiographiques dans la sphère des épreuves historiques, il doit affronter le manque de l’unité, les éléments non pertinents statistiquement et la subjectivité implicite de celui qui écrit. Pour très longtemps, les sceptiques radicaux ont exclus les textes ci-dessus du contour de l’image d’un événement restreint, au fil du temps on a renoncé à une position nette, puisqu’on a compris que l’écriture subjective complète l’image créée à l’aide des documents historiques, changement fait grâce au développement des études anthropologiques mais aussi à la conception qu’on doit renouve-ler le portait de la victime.
La littérature concentrationnaire énonce de nombreuses ques-tions pour le théoricien et le critique littéraire, à cause des outils de la recherche critique. Tout d’abord, le premier ennui est celui d’assumer le point de vue interprétatif qui envisage l’approbation ou le refus du caractère esthétique et la consolidation du discours dans le champ de l’éthique. La véracité est le trait définitoire du document autobiogra-phique, caractérisé par la sobriété du style, les insertions éclairantes, l’accent mis sur le factuel et le démarche de créer une image vraisem-
27
blable pour le récepteur. C’est le cas de certains emprisonnés pour les-quels la déposition se transforme en acte littéraire, fait qui emmène l’analyse de ces textes dans une dimension esthétique.
L’écriture concentrationnaire connaît trois degrés d’ouverture : 1. L’écriture non fictionnelle, y compris les monographies, les
remémorations, des confessions écrites pendant la détention ou ulté-rieurement, lorsque le détenu se sent encore captif dans le camp-goulag ou dans la prison et il enregistre les passages vers le passée;
2. La littérature qui démarre d’un événement-limite, d’un trau-ma, mais grâce à la nécessité de l’organisation du récit cela devient un plan littéraire. Il y a des témoins qui ont osé s’approcher du trauma souffert seulement par le moyen d’un subterfuge1 , cette forme d’écriture qui reconstruit, dans une manière vraisemblable, l’espace de la détention, sans qu’elle soit une transcription exacte d’une expérience personnelle.
3. La plus éloignée est l’écriture qui joue avec la signification, celle-ci coupe le document et le rectifie en suivant un trajet d’une inter-prétation nouvelle. « Les souvenirs de la détention sont frustes et ils détiennent un degré augmenté d’authenticité, la littérature réaliste est plus raffiné esthétiquement; dans les contre-utopies, l’univers concen-trationnaire est envisagé caricaturale, dans une manière grotesque et déraisonnable. Si les souvenirs sur la détention préfèrent la dichotomie entre le blanc et le noir, la contre-utopie utilise l’ambivalence, en étant essentiellement une fiction aliénée, à caractère négatif »2. Le roman
1 «Tout d’abord j’ai essayé de m’enfuir du passé, de vivre une vie qui n’est pas la mienne et de retracer une vie qui n’était pas la mienne. Mais un sentiment caché me disait que c’était défendu de fuir de moi-même et que si je niais les expériences d’enfant pendant l’Holocauste, je deviendrais spirituellement infirme. Seulement lorsque je suis arrivé à l’âge de 30 ans, je me suis senti capable d’affronter cette expé-rience en tant qu’écrivain.» (Aharon Appelfeld en parlant de sa littérature dans un entretien avec Philip Roth, Walking the Way of the survivor; A talk whit Aharon Ap-pelfeld, paru dans The New York Times Book Review, 28 février, 1988, [http://www.nytimes.com/1988/02/28/books/walking-the-way-of-the-survivor-a-talk-with-aharon appelfeld.html?pagewanted=all&src=pm.]. 2 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conştiinţa românească, Memorialistica şi literatu-ra închisorilor şi lagărelor comuniste, Iaşi, Editura Polirom, 2005, p. 10.
28
collage des dernières années1 met en pleine lumière le dialogue entre la singularité et l’uniformité des événements (L’Holocauste, Le Goulag, le génocide des arméniens, la guerre de Bosnie, pour exemplifier à l’aide de quelques thèmes d’écriture.
La deuxième problématique est centrée sur la position de la voix
narrative:
«On a pu délimiter deux voix temporellement séparées; d’un côté, celle du passé, attribuée aux événements et aux faits, de l’autre côté celle du présent, affective et stylistique. Il reste donc que le temps du vécu soumet à l’histoire, à l’aide d’un principe de l’héritage en ayant un contenu objectif, et à la littérature on soumet le temps du témoignage, caractérisé par le filtrage subjectif des événements, et surtout par l’autonomie stylistique du narrateur.»2
Cette hypothèse fonctionne lorsqu’on oppose la déposition au
projet littéraire, mais les textes qui ont attirés l’attention sur la repré-sentation de l’univers concentrationnaire contiennent des limites très faibles entre subjectif et objectif, entre le style naïf et l’« investigation » littéraire. Lorsque le détenu présente l’événement traumatique, il con-fronte un passé incessant, d’où se développe le troisième problématique: le caractère fluide de la mémoire. Peu de textes sont des témoignages directs, des manuscrits écrits pendant la détention, fait pour lequel l’univers concentrationnaire est recréé par le récit. On fait appel au récit pour régler, il y a pas mal de cas ou on avoue la nécessité de simplifier parce que la réalité échappe à la signification donnée par les mots simples de l’univers libre. Olga Lengyel3 soutient que la réali-té ne peut pas être comprise tout le temps dans l’imagination, même si les témoins utilisent la multiplication des détails, aspect rencontré sur-
1Jonathan Littell mélange dans Les Bienveillantes le traumatisme personnel avec l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans un ouvrage qui est proche de mille pages où les frontières entre bourreau et victime ont disparu; Jonathan Safran Foer retrace le chemin de la recherche d'une histoire personnelle, mêlant des faits authen-tiques avec les particularités de réalisme magique dans le roman Tout est illuminé; Philippe Claudel prend l’histoire et la décontextualise jusqu'à obtenir une parabole sur la relation avec l'altérité dans le roman Le rapport du Brodeck; Zlata Filipović, dans Le Journal de Zlata, essaie de réécrire le journal d'Anne Frank. 2 Ruxandra Cesereanu, op.cit., p. 12 3 Survivant de camps de concentration nazis, auteur de Souvenirs de l'au-delà (1946).
29
tout dans les récits sur le Goulag1. L’insistance sur le détail est réalisé principalement en raison de l’absence des textes sur le régime commu-niste, surtout dans l’espace soviétique. Les témoignages d’Holocauste ont connu une exposition de longue durée et généreuse, c’est pour cela que beaucoup de témoins choisissent la suppression de certaines as-pects considérés déjà connus. L’omission de quelques détails devient le dénouement d’une autre conséquence: Imre Kertész affirme qu’il a lais-sé en dehors de ses romans autobiographiques2 des éléments trop choquants pour la consolidation de la vraisemblance du récit.
La littérature tissée autour du trauma, comme on l’a annoncé, établit des coordonnées spécifiques: la participation active de la mé-moire et l’impossibilité d’avoir accès à l’évènement d’origine. Le témoignage a comme substance la mémoire, mais la « littérature » de-vient le messager d’une mémoire seconde, réinterprété d’une manière paradoxale. Le retour vers le passé, à l’aide du discours, historique ou littéraire, est réalisé par l’appel à la mémoire. Celle-ci est le jeu du choix, d’une masse des événements du passée le sujet choisit un «pas-sée reconnu» qu’il impose petit à petit comme « passée perçu ». L’éloignement de l’événement d’origine est inéluctable. L’image va maîtriser le souvenir, et la configuration maîtrise le fait de remémorer. Pour illustrer tous les traits du concept de la mémoire on va suivre Paul Ricœur et sa démarche entreprise dans son œuvre consacré déjà, La Mémoire, L’Histoire, L’Oubli. Le philosophe cherche à établir les traits de la mémoire en commençant à la manière dont Aristote, dans son traité De memoria et reminiscientia, définit et établit des antinomies pour donner une forme intelligible à la perception sur la mémoire. Par conséquence, la mémoire « est caractérisée d'emblée comme affection (pathos), ce qui la distingue précisément du rappel »3. Sur le même trajet ouvert par Aristote, les concepts mnēmē et anamnēsis sont mis en opposition. Mnēmē est une manifestation intérieure pendant qu’anamnēsis englobe un procès de recherche, d’une forme extérieure et consciente. Sur le schéma de cette différence se fonde la distinction entre le souvenir comme évocation, affection et la remémoration qui est rappel et recherche. La littérature concentrationnaire détient à sa base un procès de rappel et il faut établir tout d’abord que:
1A voir: Alexandre Soljenitsyne, L'Archipel du Goulag. 2 Il cherche de ne pas utiliser cette structure dans la définition de son œuvre. 3 Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 18.
30
« Avec la remémoration, l'accent est mis sur le retour à la conscience éveillée d'un événement reconnu comme ayant eu lieu avant le mo-ment où celle-ci déclare l'avoir éprouvé, perçu, appris. La marque temporelle de l'auparavant constitue ainsi le trait distinctif de la re-mémoration, sous la double forme de l'évocation simple et de la reconnaissance concluant le processus de rappel ».1 Le procès du déclanchement de la remémoration dans la cons-
cience collective connait plusieurs étapes, et en analysant les formes de manifestation dans l’espace publique (les témoignages, les procès, les dépositions, les films, la littérature, les espaces de la mémoire) on ob-serve que l’imposition se fait graduellement jusqu’à un point critique de l’oubli et de la platitude. Les événements souffrent un procès qui les transforme en stéréotype et ils ne détiennent plus la signifiance capable à susciter l’action dans la conscience de l’individu. Henry Rousso montre dans ses récits sur le passé du régime de Vichy qui ne se laisse pas emporter2, qu’il y a quatre étapes d’installation d’un événement limite dans la conscience collective. La toute première correspond à un deuil inachevé (Ricœur place cette catégorie dans le cadre des ou-trances de la mémoire au niveau pathologique-thérapeutique), temporellement déterminée par les 1944-1945. Il s’agit de l’étape de refoulement, suivie, comme nous pouvons nous en rendre compte, par la destruction du mythe. La dernière étape décrite par Rousso est celle de l’obsession qui a une liaison directe avec notre thème. Les témoins arrivent et demandent le droit à la parole. En fonction de l’événement limite pris en discussion, il y a la cinquième étape, celle de la représen-tation excessive et vicieuse. La narration cristallisée autour de l’événement limite devient la marque identitaire, « l'identité de telle personne s'étend aussi loin que cette conscience peut atteindre rétros-pectivement toute action ou pensée passée »3. La liaison entre l’identité et la mémoire est le passée, puisque celui-ci est l’objet de la mémoire. A cet égard, l’analyse de la littérature concentrationnaire doit être réali-sée par la prise en charge d’une direction d’interprétation éthique et/ou esthétique, en identifiant la manière où on place la voix narrative dans le cadre du texte et en quêtant d’apprendre comment la mémoire ac-quiert d’autres significations.
1 Ibidem, p. 69. 2 Voir Éric Conan, Henry Rousso, Vichy, un passe qui ne passe pas, Paris, Editions Gallimard, 1996. 3 John Locke, Of Identity and Diversity apud Paul Ricœur, op. cit., p. 126.
31
La littérature du trauma Ces dernières années, la littérature centrée sur les événements
traumatiques a connu un large processus d’épanouissement, grâce à l’acceptation des formes de confession dans l’espace historique. L’histoire a fourni des situations de manifestation agressive, dans les-quelles l’individu ou des groups divers se sont trouvés sous la menace et la destruction, et, de façon implicite, ont dû affronter ultérieurement la symptomatologie du trauma. Dans sa recherche Writing History, Writing Trauma, Dominik La Capra a essayé d’analyser comment le trauma et ses conséquences développent des difficultés dans la compré-hension et la représentation de celui-ci. L’auteur observe que sous l’influence du trauma, les témoignages deviennent des épreuves de consolidation de « l’histoire autosuffisante ». On a accepté comme té-moignages de consolidation d’un point de vue historique seulement ces témoignages qui adhèrent mieux aux événements. Si cette preuve n’existe pas, ils ont juste une importance secondaire. « La fiction pour-rait avoir des notes révérencielles, surtout lorsque le factuel et la fiction se mélangent, mais pour être professionnelle, l’historiographie (même au-delà d’un paradigme de recherche restrictive) doit avoir des notes qui offrent des références pour les affirmations qui fonctionnent d’une manière référentielle et émettre des prétentions sur la vérité »1. L’ennui du chercheur vient du fait que la note, comme indication référentielle (référence documentaire), est utilisée aussi bien dans l’historiographie que dans la littérature, la distinction entre les deux s’établit par un double reflet: «la limite entre l’histoire et le commencement de la fic-tion est probablement la note référentielle (ou l’entrée) qui va au-delà des indications intertextuelles, qui est mis en liaison avec les études découvertes par les historiens, et qui bloque la référence par l’introduction dans le texte des effets labyrinthiques… »2. Lorsque le texte inclut l’affirmation qu’il est un artefact, quand l’auteur prend le chemin des allégories et de la stratification narrative, même si on inclut la note référentielle concernant l’événement, il est accepté le fait que le texte a passé la limite qui sépare la vision documentaire vers la fiction. Par exemple, c’est le cas du roman Tout est illuminé, où c’est une certi-tude que la communauté des juifs de Trochenbrod a existé et que celle-
1 Dominik LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2001, p. 6. 2 Ibid., p. 7
32
ci a été exterminée par Einsatzgruppen, le texte se transforme en littéra-ture et il se ferme devant la vision documentaire par l’insertion des fragments caractéristique au réalisme magique.
On plaide pour l’abandon de la structure duale: l’histoire – la mémoire, la vérité – la fiction, dans l’essai de trouver the middle voice : d’un côté le discours critique doit s’engager « à l’élaboration d’une mémoire correcte, testée d’une manière critique à travers laquelle [l’histoire] apporte sa contribution à une sphère publique responsable de la façon éthique et cognitive ».1 Dominik LaCapra détermine des distinctions importantes sur la représentation de l’événement trauma-tique :
« Dans mes commentaires je soutiens que l’expérience concernant la compréhension historique ne devrait pas être perçue strictement sous un angle cognitif, qui engage juste un procès d’information. Sans di-minuer l’importance de la recherche, la conceptualisation et la reconstruction objective de l’expérience du passé, comme on peut le concevoir, implique l’affectation de celui qui est observé mais aussi de celui qui observe. Le trauma est une expérience perturbante qui di-sloque le moi et crée des ruptures dans l’existence; il y a des effets tardifs, qui sont contrôlés difficilement et, probablement, jamais com-plètement maîtrisables. Ainsi, l’étude des événements traumatiques pose-t-elle des problèmes très difficiles, dans leur représentation et dans l’écriture, autant pour la recherche que pour tout échange dialo-gique avec le passé, cela met un fardeau sur les gens, en touchant le passé et l’avenir. Réceptifs à l’expérience traumatique de certains gens, en particulier aux victimes, ils ne personnalisent pas l’expérience traumatisante des victimes, mais on arrive à ce qu’on peut nommer empathie sans personnalisation (empathic unsettlement – empathie sans les clichés déjà connus), c’est pour cela que la repré-sentation devrait avoir des effets stylistiques qui ne peuvent pas être réduits aux formules ou aux règles de la méthode.»2 L’Holocauste fait partie aujourd’hui du trauma transhistorique,
à cause de la disparition des témoins et se situe dans la post-mémoire ou dans une mémoire acquise. Ce type de mémoire est composée par l’intériorisation du trauma par ceux qui ne l’ont pas véritablement vécu et qui choisissent de définir leur identité à travers une mémoire acquise
1 Dominik LaCapra interrogé par Cristina Chevereșan Istorie, Memorie, Traumă, Dominik LaCapra (I), Orizont, mars 2012, p. 31-32. 2 Dominik LaCapra, Writing History, Writing Trauma, p. 41.
33
grâce à la voie culturelle. Mais, dans le cas du Goulag, on a encore de-vant nous les témoins, qui dialoguent de manière différente avec le passé mais aussi avec le trauma. Le présent apporte à l’avant-scène beaucoup de voix qui intériorisent le trauma dans des représentations déséquilibrées: « De plus, le mélange fait par l’absence et la perte faci-literait l’approche de certains drames particuliers de ceux qui n’ont pas vécu leur expérience, d’habitude dans un mouvement de configuration de l’identité qu’utilise d’une manière offensante et idéologique une série d’événements traumatisés, comme le mythe fondateur ou le capi-tal symbolique »1. En ce moment-là, la représentation du trauma est liée à la série de clichés: « l’inexprimable », « qui ne peut pas être re-présenté », « l’indicible ». Plus ou moins sérieusement ou ironiquement, Martin Amis déclare que « l’écrit est une campagne contre le stéréotype, pas seulement contre le cliché de l’expression écrite mais aussi contre la pensée figée et la perception stéréotypée »2. L’éloignement du cliché est un objectif atteint dans sa représentation sur l’Holocauste, réalisé dans le roman La flèche du temps. Au con-traire, dans les cas de certains livres de fiction, qui portent sur des traumas collectifs qui impactent le développement socioculturel et poli-tique, le résultat de la représentation n’est jamais approprié ou adéquat. La critique a la mission de compléter cette représentation. Dominik LaCapra affirme que la victime n’est pas une catégorie psychologique, à formes divers, la victime est une catégorie sociale, politique et éthique. On considère que cette complexité du statut de la victime doit être incluse aussi dans la représentation. La perspective est créée par le choix d’une certaine image en dépit d’une autre et il glisse vers cer-taines représentations viciées. Le rôle du critique (soit-il historien, philologue, sociologue ou philosophe) est de compléter et restaurer l’objectivité de la représentation. Les représentations littéraires, sont aussi importantes, parce qu’elles fournissent des questions et appro-chent l’événement au lecteur:
«En ce qui concerne l’art, je pense qu’elle ne peut pas être
aperçu comme une sphère distincte, autonome, purement esthétique, située au-delà de toute prétention sur la vérité et la considération éthique. Il existe plutôt une interaction complexe entre l’art, la préten-
1 Ibidem, p. 65 2 Martin Amis, The war against Cliche: Essays and Reviews 1971-2000, Canada, Vintage, 2001, p. XV.
34
tion de la vérité et l’éthique (y compris la sphère étique-politique). Cela ne vise pas la censure d’état mais l’expansion du spectre des dis-cours critiques et la capacité de dialogue critique bi- ou multi- directionnel. L’art peut poser des questions à l’histoire et à l’éthique et réciproquement. »1
La présomption de LaCapra est correcte, l’événement trauma-
tique est traité dans la littérature moderne, mais aussi dans la littérature postmoderne. On peu ajouter que la littérature postmoderne déplace l’imaginaire traumatique vers la catégorie de l’apocalypse désacralisée. C’est plutôt un coup monté de l’apocalypse, d’après Andrei Simuţ2, à cause d’un grave sentiment que, selon les témoins du XXe siècle, l’apocalypse a eu lieu déjà. Dans le dévoiement théorétique et jovial du postmodernisme, la fiction met en scène des formes nouvelles de l’apocalypse, au fur et à mesure du progrès techniques3. Ni à ce mo-ment-là le réel ne reste sans représentation, le quotidien et la problématique de l’actualité environnante attirent le romancier, ce qui conduit les récits vers l’intégration de certains traumas récents dans le roman.4
La littérature concentrationnaire suit la sémiologie du trauma, mais il faut comprendre que cela ne fait pas partie d’une forme d’anéantissement du trauma, c’est impossible de le reduire à cette fonc-tion même si, dans certains cas, cela renvoie à un effet thérapeutique. En outre, une théorie du trauma a été lancée, suivit par toutes les formes de manifestation du survivant sur la base de laquelle des dis-cours de « rédemption » ont été formulés. Cathy Caruth annonce qu’il y a un problème au niveau de la trivialité par représentation, et l’appauvrissement de la signification ne représente pas une forme de manipulation, c’est notre capacité d’arriver à la compréhension de la réelle souffrance: «…comment aider à revivre cette souffrance et com-ment comprendre la nature de la souffrance sans éliminer la force de la vérité contenue dans le trauma du survivant qui essaye de nous la
1 Cristina Chevereșan, « Istorie, Memorie, Traumă, Dominik LaCapra (II) », inter-view avec Dominik LaCapra, Orizont, avril 2012, p. 13. 2 Hypothèse proposée et développée par Andrei Simuț dans sa thèse de doctorat: Le roman apocalyptique après 1945 (thèse non publiée). 3 Les problèmes quotidiens et d'actualité attirent l'attention au romancier qui se inter-roge sur la nature du ces faits, chaque traumatisme récent est inclus dans nouveaux récits. 4 A voir Jonathan Safran Foer, Extrêmement fort et incroyablement près.
35
transmette»1. Nous nous retrouvons dans l’impossibilité d’accéder par la parole à cette expérience, parce que nous ne pouvons pas nous iden-tifier au protagoniste du récit. Nous sommes en dehors de l’expérience racontée et nous ne pouvons prétendre rien d’autre, sans que ce soit une fausseté profonde. Le trauma déclenche une série de paradoxes: l’impossibilité de parler, d’extérioriser entre en contradiction avec la le besoin impérieux de faire connaître son chagrin. En restant dans le pas-sée à travers le souvenir ou par le biais d’une série de modèles qui actualisent toujours l’univers concentrationnaire, le trauma se met en discours, il ne lâche pas prise et il ne se transforme pas en mémoire fonctionnelle. De même, le trauma ne peut pas être le fondement du présent, d’où la circularité du récit. Il est possible d’identifier une somme d’éléments (structuraux) contenus par chaque narration qui a comme thème la détention: (1) une intrique initiale, établie comme la tension entre la vie d’emprisonné et celle d’être libre ; c’est l’étape où le protagoniste est une victime virtuelle, il visualise la détention comme quelque chose de transitoire2 ; (2) une intrigue principale où la victime se rend compte de la structure sociale du camp3 et cherche des moyens pour s’adapter, pour assurer sa survivance ; (3) une intrique finale mais qui n’apporte pas la libération psychologique, le trauma vécu devenant le symbole identitaire. Michel Rinn désigne la structure ci-dessus
1 Cathy Caruth, Trauma: Exploration in Memory, Baltimore, The John Hopkins Uni-versity Press, 1996, p. 33 : « how to help relieve suffering, and how to understand the nature of the suffering, without eliminating the force of the truth of the reality that trauma survivors face and quite often try to transmit to us » . 2 D’après les témoignages, il résulte que dans les camps nazis les survivants ne sa-vaient pas que les prisonniers étaient des gens sans aucune culpabilité, tout comme eux. Il va de même pour le jeune Gyorgy Koves, le caractère du roman Être sans destin, d'Imre Kertesz: « Il ne m'était pas difficile à deviner: des prisonniers y vi-vaient. Seulement maintenant j’ai commencé – peut-être parce tout à l'heure j’ai eu le temps pour eux – d’être intéressé et j'aurais été curieux de savoir ce qu'ils ont péché » (Imre Kertész, În afara destinului, București, Editura EST, 2003, p. 73). 3 Nous validons la thèse de Michael Pollak, qui propose l'hypothèse que la structure interne des camps permet l'identification d'un espace social, thèse développée presque en opposition avec celle de Bruno Bettelheim, promoteur de l'uniformité sociale dans le camp. Nous considérons que la thèse de Betteleheim se concentre sur un nombre de statistiques et sur une thèse morale: la désintégration de la structure individuelle et le grand nombre de décès. La survie est rendue possible à cause de l'existence d'une structure sociale. A voir: Michel Pollak, L’expérience concentrationnaire, Essai sur le maintien de l’identité sociale, Paris, Éditions Métailié, 1990; Bruno Bettelheim, Sur-vivre, traduction: Theo Carlier, Paris, Editions Laffont, 1979.
36
comme « le cycle de la victime »1. Les actualisations subjectives sont apportées sur la structure nommée.
Le réel de l’événement-limite dépasse l’espace de la perception subjective très influencée par le but à atteindre, le dernier critère de la vérité dévoilée étant intersubjectif, et non plus référentiel. Il est triste que dans nombreux cas, la falsification de la mémoire est prise pour la vérité pure, le compromis est majeur, c’est un affront apporté à la mé-moire et aux personnes décédées. Le plus grave est que la mémoire falsifiée s’institue dans la mémoire collective dont le discours évolue dans l’espace publique et influence la manière dont les individus se rapportent directement à l’événement. La mémoire sera toujours le point qui croise deux actions: le souvenir et l’oubli. Le rétablissement intégral du passé est impossible, celui qui fait la reconstruction à l’aide du discours a aussi la dette de la protéger contre la dénaturation. La narration mémorielle centrée sur un thème lié au trauma et avec des implications morales importantes ne peut pas être centrée seulement sur l’histoire héroïque ou sur celle des victimes. Elle a la dette de renoncer à la subjectivité propre à la confession, si elle propose comme fin la restitution de la vérité. « Le mal concentrationnaire, d’après Rousset, n’est pas seulement plus acharné que les autres, sa signification est dif-férente: les tombeaux communs d’Auschwitz et de Kolîma expriment la vérité sur les idéologies est sur des structures politiques totalement nouvelles. »2
L’écriture autobiographique cherche à laisser une trace de l’existence dans la conscience collective. La différence entre le journal et la confession (surtout dans le cas d’Holocauste) ne semble pas très grande. Le deux genres d’écriture superposent le narrateur à l’auteur et dévoilent une expérience personnelle. On les distingue dans dans la façon d’établir la temporalité: la confession est rétrospective tandis que l’écriture du journal intime a toujours devant elle le présent. Pour la confession, le sujet s’aperçoit comme étant un être du passé, il inter-prète les événements et son évolution et il établit à plusieurs reprises une sorte de perte d’identité. Le journal intime, sur son aspect de chro-nique personnelle, chronologique dans la plupart des cas, s’adresse à une audience non spécifiée, sa fonction principale est d’enregistrer des
1 A voir: Michael Rinn, Les Récits du génocide. Sémiotique de l’indicible, Paris, Edi-tions Delachaux et Niestle, 1998. 2 Tzvetan Todorov, Memoria răului, ispita binelui (Mémoire du mal tentation du bien), București, Editura Curtea Veche, 2002, p. 162.
37
aspects de la vie du sujet, et, en ce qui concerne les jeunes, cela com-prend leur évolution. La confession est évidemment écrite pour le public, ce qui n’est pas le cas du journal intime même si les journaux de la détention acquièrent la réorientation vers le public. La vie des pri-sonniers devient ainsi un chapitre de l’histoire. Plus le final est pressen-pressenti, plus apparaît le désir que le journal développer le sujet pour qu’il devienne ainsi une preuve de ce qui est arrivé à son auteur.
Il peut s’établir la distinction entre le journal intime et la con-fession/témoignage post-Holocauste: « Une importante distinction doit être établie entre les confessions post-Holocauste et les confessions durant l’Holocauste. Par la confession post-Holocauste le survivant essaie de revivre l’expérience et d’y revenir en arrière, comme une forme d’exorcisation du passé qui le hante. Dans un moment de souf-france, la victime confesse la cause de la souffrance afin qu’elle s’en éloigne »1. Les implications du témoignage post-Holocauste sont plus complexes: il prédomine la nécessité de devenir le porte-parole d’une expérience qui le définit au-delà de son propre identité, il est en dehors des catégories qui ont été déterminées par lui-même et il obtient l’image publique de témoigne. D’ailleurs, dans le journal intime ainsi que dans la confession il existe une sorte d’appréhension de la fiction, Ana Novac nie que son écriture est un roman2, Etty Hillesum écrit aux amis de Pays-Bas, à Westerbork: « Il ne fallait pas qu’on puisse écrire des contes de fées ici… où la pauvreté est au-dessous des limites de la réalité d’où elle semble irréelle. Des fois je suis allé dans le camp en souriant à l’intérieur à cause des circonstances grotesque »3. Ana No-vac, écrivaine d’origine roumaine, établie ultérieurement en France, problématise l’état de zombie, forme de l’existence pendant le commu-nisme, qui est l’égal du « musulman »4 dans le camp nazi. Le zombie
1 Rachel Feldhay Brenner, Writing as resistance: four women confronting the Holo-caust. Edith Stein, Simone Weil, Anne Frnak, Etty Hillesum, The Pennsylvania State University Press, 1997, p. 131. 2 A voir: Ana Novac, Cele mai frumoase zile ale tinereţii mele (Les beaux jours de ma jeunesse), Cluj Napoca, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004. 3 Etty Hillesum, Letters from Westerbork, traduction: Arnold J. Pomerans, New York: Pantheon Books, 1986, p. 88 (titre en français: Lettres de Westerbork). 4 Le terme utilisé pour définir dans les camps nazis ceux qui ont renoncé à la lutte pour la survie. « ’Muselmann’ : c'est ainsi que les anciens du camp surnommaient, j'ignore pourquoi, les faibles, les inadaptés, ceux qui étaient voués à la sélection » (Primo Levi, Si c’est un homme, Paris, Juliard, 1987, p. 94). « [...]les ’musulmans’, les hommes en voie de désintégration, ceux-là ne valent même pas la peine qu'on leur adresse la parole, puisqu'on sait d'avance qu'ils commenceraient à se plaindre et à
38
est un être inactif qui ne réagit que lorsqu’il entend le mot «passeport», devenu le symbole de la liberté idéale et spirituelle. Il ne s’agit pas de la liberté au sens du concept philosophique mais de la liberté simple, banale, modeste et extrêmement concrète: « La liberté de parler, de se déplacer, d’envoyer une lettre ou de téléphoner sans anxiété, la liberté de changer d’appartement, de lieu de travail, de passer une soirée avec des amis sans se tourmenter, en revenant, pour chercher à se rappeler tout ce qui vous échappe de compromettant et si les enfants de l’ami en question n’étaient pas présents par malheur (idée qui vous mettait en état de catastrophe pour au moins une semaine). »1 Celui-ci est « Le camp de la Paix » gouverné par le totalitarisme communiste. Ana No-vac ose lancer une affirmation que beaucoup de survivants et historiens évitent: « Si un jour, par l’absurde, j’étais placée devant le choix: me retrouver dans le «Camp de la Paix», ou dans le camp de la mort, je crois, je suis presque sûre que je me déciderais pour ce dernier: on y crève plus vite – et on y ment moins »2 : Elle approuve que le système totalitaire de type communiste est une expérience destructive à long terme. Les deux politiques totalitaires ont en commun la transformation de l’individu en « zombie »/« musulman », ils lui coupent la capacité de réfléchir ou de se manifester en dehors d’une idéologie. En ce qui concerne les nazis, elle mentionne qu’elle ne s’est pas donné du mal à les détester. Dans son style ironique caractéristique, elle illustre la dif-férence entre les deux systèmes: « Les S.S. avaient la délicatesse de me mépriser asses pour me ficher la paix. Pendant plus de six moins, j’avais travaillé à mon journal dans plusieurs camps successifs, sans le moindre incident. J’ai souvent essayé de continuer mes notes après la « libération » – ce n’était pas possible, j’étais bloquée, terrorisée par mes propres idées, et finalement j’ai compris: je ne voulais pas savoir, pas
parler de ce qu'ils mangeaient quand ils étaient chez eux. Inutile, à plus forte raison, de s'en faire des amis : ils ne connaissent personne d'important au camp, ils ne man-gent rien en dehors de leur ration, ne travaillent pas dans des Kommandos intéressants et n'ont aucun moyen secret de s'organiser. Enfin, on sait qu'ils sont là de passage, et que d'ici quelques semaines il ne restera d'eux qu'une poignée de cendres dans un des champs voisins, et un numéro matricule coché dans un registre. Bien qu'ils soient ballottés et confondus sans répit dans l'immense foule de leurs semblables, ils souf-frent et avancent dans une solitude intérieure absolue, et c'est encore en solitaires qu'ils meurent ou disparaissent, sans laisser de trace dans la mémoire de personne. » (Ibid., p. 95) 1 Ana Novac (Anna Novak), Les mémoires d'un zombie ou Si j'étais bébé-phoque, paru dans Les Temps Modernes, octobre 1978, p. 465. 2 Ibidem.
39
vraiment, ce que je pensais…»1 Les nazis envisagent la destruction physique de l’individu considéré comme ennemi de la race supérieure, les communistes désirent la subordination par « l’amour » devant les valeurs du parti, la soumission totale, de cette manière on falsifie plus facilement toute forme de valeur et à long terme.
Il y a trois modalités d’échapper au camp: par l’imagination, se cacher dans le baraquement ou passer au-delà du fil barbelé. Aucune d’entre elles ne suppose la conservation de la vie : chercher une place dans l’imagination signifie l’inadaptation au camp et implicitement le passage vers l’état de musulman; se faire pincer dans le baraquement après l’appel attire la punition (cachot, battement); il y a peu des per-sonnes qui ont franchi le fil barbelé, envisager cette possibilité leur permettant la liaison avec la liberté de décision. Le portrait du survivant dans le camp supprime l’image du héros muni de qualités exception-nelles et il montre que seulement la sottise, la duplicité, le courage schizophrène, la lassitude et la folie sont des traits acceptés dans l’univers concentrationnaire. La déposition sur un événement traumati-sant se confronte avec le problème du langage. Une rupture se glisse au niveau de la signification des paroles utilisées à l’intérieure et en dehors du camp. Un problème rencontré dans les camps nazis a été constitué par le chaos linguistique. Il y a un obstacle pour les juifs, les italiens, les yougoslaves, parce qu’ils ne connaissaient pas la langue allemande, l’avantage apporté par l’allemand était que la langue établissait un autre rapport entre le prisonnier et le fonctionnaire: « Avec ceux qui les comprenaient et répondaient d’une façon articulée, une apparence de rapports humains s’instaurait »2. Pour le prisonnier, c’était une bénédic-tion d’avoir à coté quelqu’un pour échanger quelques mots, parce que, autrement, «votre langue se dessèche en quelque jours et, avec la langue, la pensée. »3 Sans comprendre la langue on ne peut concevoir comment le camp fonctionne, cela signifie l’inadaptation et, par consé-quent, la mort. L’allemand né dans le goulag diffère de la langue révélée des poèmes de Rilke ou de Goethe et surtout des cadences de Bach. C’est le jargon du camp, une langue lié au lieu et au contexte, baptisée par Victor Klemperer – Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich, une analyse de la transformation de la langue, de son
1 Ibidem, p. 467. 2 Primo Levi, Les naufragés et les rescapés, Les naufragés et les rescapées, traduit de l’italien par André Maugé, Paris, Editions Gallimard, 1989, p. 90. 3 Ibidem, p. 92.
40
emploi comme moyen de propagande nazie. Cet Allemand déjà dif-forme est influencé par les langues des prisonniers, en particulier par le polonais, l’yiddish, le dialecte silésien, et, vers la fin, par l’hongroise. Ci-dessus on avait signalé qu’avec le renoncement à la communication, le prisonnier renonce aussi à la pensée et cela apporte « l’indifférence proche et définitive ». Le témoignage écrit par Primo Levi après la libé-ration essaie de mettre en paroles une expérience devant laquelle on est ignorants concernant la perception. Une idée sous la forme d’une illu-mination le guide à noter:
« Alors, pour la première fois, nous nous apercevons que notre langue manque de mots pour exprimer cette insulte : la démolition d'un homme. En un instant, dans une intuition quasi prophétique, la réalité nous apparaît : nous avons touché le fond. Il est impossible d'aller plus bas : il n'existe pas, il n'est pas possible de concevoir condition humaine plus misérable que la nôtre. Plus rien ne nous appartient : ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures, et même nos cheveux ; si nous parlons, ils ne nous écouteront pas, et même s'ils nous écou-taient, ils ne nous comprendraient pas. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom : et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste »1. La grande question soulevée par le langage, au moment où l’on
cherche à représenter le camp, a été la disjonction mentionnée ci-dessus et matérialisée dans l’impossibilité du survivant de transmettre au ré-cepteur et de lui faire comprendre le signifié que certains mots ont assimilé pour lui. Tous ceux qui ont écrit à partir de l'expérience con-centrationnaire ont éprouvé le sentiment d'être en face de quelque chose qui remettait en cause la possibilité même d'en parler. Chacun à sa ma-nière a cherché de surmonter le gouffre forgé entre l'expérience vécue et ce qui se donnait d'abord comme une limitation essentielle du lan-gage. On en considère le fragment suivant comme représentatif:
« De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu'on peut avoir quand on a sauté un repas, de même notre façon d'avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons ” faim ”, nous disons ”fatigue ”, ”peur” et ” douleur ”, nous disons ” hiver ”, et en disant cela nous disons autre chose, des choses que ne peuvent
1 Primo Levi, Si c’est un homme, p. 26.
41
exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vi-vent dans leurs maisons et connaissent la joie et la peine. Si les Lager avaient duré plus longtemps, ils auraient donné le jour à un langage d'une âpreté nouvelle ; celui qui nous manque pour expliquer ce que c'est que peiner tout le jour dans le vent, à une température au-dessous de zéro, avec, pour tous vêtements, une chemise, des caleçons, une veste et unpantalon de toile, et dans le corps la faiblesse et la faim, et la conscience que la fin est proche »1.
Conclusions L’incarcération devient une partie élémentaire de l’identité, une
fois l’expérience vécue, elle ne peut pas être repoussée. Nier l’identité n’est pas possible, elle fait partie de l’individu qui l’a partagée et toute forme de dissimulation est un acte de fausseté. La littérature concentra-tionnaire restera toujours un espace contesté, les stratégies de la construction de la fiction sont rejetées, parce qu’elles sont considérées comme une dénaturation mais toutefois elles sont nécessaires grâce au fait qu’elles ordonnent et compensent le manque du témoin, en trans-formant le lecteur d’un sujet passif en témoin. Ce genre de littérature détient des caractéristiques spécifiques qui renvoient à la gravité de l’événement et à la complicité de la mémoire. Il y a un intérêt accru pour ce genre textuel, un processus qui se développe progressivement avec l’accès aux archives. Les témoignages ont une valeur éthique et, de ce point de vue, ils doivent être interrogés. La disparition des témoi-gnages de l'espace public a fait place à la fiction, de telle sorte que l'univers concentrationnaire est devenu un thème romanesque et, le plus souvent, nous lisons ces livres uniquement pour leur dimension esthé-tique, en oubliant la dimension historique et éthique. Pour notre part, nous croyons que l'interprétation doit couvrir à la fois l'intention éthique et aussi esthétique.
1 Ibidem, p. 131-132.
42
Bibliographie Amis, Martin, The war against Cliche: Essays and Reviews 1971-2000, Ca-
nada, Vintage, 2001. Appelfeld, Aharon, Walking the Way of the survivor; A talk whit Aharon Ap-
pelfeld, paru dans The New York Times Book Review, February 28, 1988 (entretien avec Philip Roth).
Caruth, Cathy, Trauma: Exploration in Memory, Baltimore, The John Hop-kins University Press, 1996.
Cesereanu, Ruxandra, Gulagul în conştiinţa românească, Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
Conan, Éric, Rousso, Henry, Vichy, un passe qui ne passe pas, Paris, Editions Gallimard, 1996.
Feldhay Brenner, Rachel, Writing as resistance: four women confronting the Holocaust: Edith Stein, Simone Weil, Anne Frank, Etty Hillesum, The Pennsylvania State University Press, 1997.
Hillesum, Etty, Letters from Westerbork, traduit par Arnold J. Pomerans, New York: Pantheon Books, 1986.
LaCapra, Dominik, Istorie, Memorie, Traumă, Dominik LaCapra (I), Ori-zont, martie 2012, p. 31-32. (entretien avec Cristina Chevereșan).
LaCapra, Dominik, Istorie, Memorie, Traumă, Dominik LaCapra (II), Ori-zont, avril 2012, p. 13, (entretien avec Cristina Chevereșan).
LaCapra, Dominik, Writing History, Writing Trauma, Baltimore and Balti-more, The Johns Hopkins University Press, 2001.
Levi, Primo, Les naufragés et les rescapés, Paris, traduit de l’italien par An-dré Maugé, Editions Gallimard, 1989.
Levi, Primo, Si c’est un homme, Paris, Juliard, 1987. Novac, Ana, Cele mai frumoase zile ale tinereţii mele, Cluj Napoca, traduc-
tion: Anca Dominica Ilea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004. Novak, Anna, Les Memoires d’un Zombiee ou Si j’étais bebe-phoque, paru
dans „Les Temps Modernes”, octobre 1978, p. 465. Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000. Rinn, Michael, Les Récits du génocide, Sémiotique de l’indicible, Paris, Edi-
tions Delachaux et Niestle, 1998. Thibaudet, Albert, Despre sinceritate în Reflecții, traduction: Georgeta
Pădureleanu; avant-propos: Mircea Pădureleanu, București, Editura Minerva, vol II, 1973.
Todorov, Tzvetan, Memoria răului, ispita binelui, traduction: Magdalena și Adrian Boiangiu, București, Editura Curtea Veche, 2002.
43
HISTOIRE – MÉMOIRE – TRAUMA. TÉMOIGNAGES DU GOULAG SOVIÉTIQUE1
Dumitru TUCAN Une journée d’Ivan Denissovitch ou comment briser le
silence La publication, en novembre 1962, du roman Une journée
d’Ivan Denissovitch peut être considérée comme un point crucial dans la reconnaissance explicite d’un fragment important de l’histoire trau-matisante de l’Europe – l’univers concentrationnaire soviétique. C’était pour la première fois qu’un livre publié en U.R.S.S. révélait, dans un esprit d’authenticité, ce que tout citoyen connaissait de par sa propre expérience, des confessions des proches ou, tout simplement, de par la terreur quotidienne. Le livre a été très vite traduit dans la plupart des langues européennes (y compris derrière le rideau de fer), ce qui montre non seulement l’intérêt que ce sujet suscitait déjà dans la culture et la société européenne des années 60, mais aussi la reconnaissance du caractère sensationnel d’un livre qui, publié officiellement en URSS, parle de l’inhumanité du système soviétique.
Une analyse nuancée du contexte historique prouve que la « sensation » provoquée par le petit roman de Soljenitsyne s’explique partiellement par les contradictions politiques soviétiques suivant la
1 Une variante en roumain de cette étude a été publiée dans Andi Mihalache, Adrian Cioflâncă (coordonatori), Istoria recentă altfel: perspective culturale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013.
45
mort de Staline (mars 1953). C’est le moment où Khrouchtchev adopte, comme discours légitimateur de la lutte pour le pouvoir, une critique explicite de ce qui, entre les années 1956 (date de la présentation au XX-ème Congrès du P.C. de l’Union Soviétique du célèbre « discours secret »1) et 1964 (moment où il perd le pouvoir) deviendra un vrai slogan capable de canaliser les énergies négatives accumulées à l’époque: « le culte de la personnalité ». Paru avec l’accord explicite de Khrouchtchev2, le roman a la qualité paradoxale d’être véridique tout en offrant une image paradigmatique du camp3 qui génère des effets de lecture divergents du point de vue fonctionnel. Dès le début, on a mis en évidence ces effets divergents d’un texte dont le ton neutre parvient à reconstruire d’une manière véridique, à travers un processus de su-blimation fictionnelle, la géographie physique et morale de l’univers concentrationnaire. Alexander Tvardovsky, directeur de la revue Novy Mir et le partisan le plus important de Soljenitsyne au début de sa car-rière, mettait en évidence, dans l’avant-propos écrit pour la première apparition du roman, le fait que, loin d’être un document, le roman a sa racine dans des expériences personnelles génératrices d’authenticité, une authenticité bénéficiant, en outre, d’une maîtrise artistique qui transfère les effets du roman dans le champ de l’universalité esthé-tique :
« Une journée d’Ivan Denissovitch ne représente pas des mémoires, ni des notes sur les expériences personnelles de l’auteur, bien que seu-lement une telle expérience ait pu conférer au récit son air d’authenticité spécifique. On parle d’une œuvre d’art et ce n’est que l’interprétation artistique du matériau offert par la vie qui le trans-forme en témoignage d’une valeur particulière, en document artistique qui a eu peu de possibilités de manifestation jusqu’à pré-sent. »4
1 « Le discours secret (Sur le culte de la personnalité et ses conséquences) » ou « Le rapport Khrouchtchev » (février 1956) – v. Zhores A. Medveedev, Roy A. Medvedev, The Unknown Stalin, New York, I. B. Tauris & Co. Ltd, 2003, p. 95 – 111. 2 Voir les mémoires de Nathalia Rechetovskaïa, la première épouse de Soljenitsyne (Natalia Reșetovskaia, Soljenițîn, Iași, Mydo Center, 1995). 3 Cf. Leona Toker, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, Bloomington, Indiana University Press, 2000, p. 188-190. 4 Alexander Tvardovsky, « Forward to A. Solzhenitsyn, One Day in The Life of Ivan Denisovich », dans A. Solzhenitsyn, One Day in The Life of Ivan Denisovich, New York – London, E.P. Dutton, 1963, p. i.
46
En insistant sur la valeur artistique, Tvardovsky essayait, d’une manière évidente, de prévenir les effets radicaux que le roman pouvait avoir sur le lecteur. Ceci peut être observé dans les références histo-riques dissimulées au « culte de la personnalité » considéré comme une « violation de la légalité soviétique »1, tout comme dans la mise en évi-dence du rôle du parti (et de Khrouchtchev) dans la condamnation des souffrances de l’histoire récente2 ou dans l’affirmation de la nécessité de dire la vérité, même si elle est incommode. La combinaison entre le besoin de vérité (historique et artistique) et les directives du parti prouvent que le pouvoir politique est pris, dans la période du dégel idéologique post-stalinien, entre deux desiderata de légitimation : d'une part lé désir de se délimiter de la période stalinienne, et d'autre part le désir de préserver le status quo politique. Cela va canaliser les interpré-tations du roman uniquement dans le sens de la critique de la terreur stalinienne et va exclure toute possibilité d'interprétation du roman comme une critique du système communiste dans son ensemble.
Ces contraintes politiques de l'époque constituent probablement l'explication la plus fiable du ton neutre du roman qui, en focalisant la narration sur l'univers physique du camp, accumule d’une manière con-centrée les détails de la lutte disproportionnée entre l’individu et le système répressif. À travers ces détails, seulement, devient possible, implicitement, l’accusation systématique d'un système politique qui a permis l’existence de cet univers de la déshumanisation. Derrière la simplicité de la construction du récit et la condensation de l’action au-tour d'un personnage focalisateur comme Ivan Denissovitch, on peut deviner le désir de Soljenitsyne de masquer, par les structures du lan-gage artistique, un « document » de la souffrance humaine qui puisse être reconnu comme un échantillon représentatif. Mais ce qui s’avère plus important encore est le besoin de Soljenitsyne de témoigner, un témoignage qui, après avoir revêti l’habit littéraire, devient acceptable dans le contexte politique et idéologique de l'époque.
Les vertus du roman de Soljenitsyne sont en même temps de na-ture artistique, documentaire, culturelle et politique. Les qualités artistiques résident dans les réalisations stylistiques d’une écriture dense, ayant un air évident d'authenticité, dont les éléments les plus saillants sont l’adéquation du langage et des personnages aux nécessités de la construction narrative. Les qualités documentaires sont liées à
1 Ibid., p. ii. 2 Ibid., p. ii.
47
l'image paradigmatique du camp et de la souffrance humaine qui, même si fictionnelle, sera « reconnue » comme « réelle » par les milliers de survivants du camp de concentration1 et non seulement par eux. Mais les plus importantes sont, selon nous, les qualités culturelles et poli-tiques, c’est-à-dire la capacité du texte de provoquer le souvenir et la discussion critique sur l’univers concentrationnaire. Accepté par les officialités soviétiques exclusivement en tant qu’image artistique qui soutienne les efforts visant à légitimer l'action de séparation de l’héritage stalinien, le roman va ouvrir une véritable frénésie des re-mémorations des souffrances provoquées tout au long de l'histoire du système soviétique, derrière laquelle va se frayer chemin une attitude critique généralisée du système communiste dans son ensemble. Et à partir de ce pas autocritique de l'establishment politique soviétique, la culture occidentale sera de plus en plus intéressée à ce sujet, avide d’explorer l’ampleur de la tragédie2. Mais si dans les années 60 le sujet du goulag semblait d'actualité, il faut noter que le phénomène n’est pas du tout nouveau ou inconnu à la culture occidentale. Les témoignages sur la tragédie humaine vécue en l'Union Soviétique à partir des pre-mières années de la « révolution bolchevique» sont accessibles au lecteur occidental dès les années 20 du siècle passé.
Les premiers signes
Les premiers signes de cette histoire tragique apparaissent dans
la période trouble de la révolution bolchevique et de la guerre civile (1917-1921). L'émotion du moment et les choix politiques des gens impliqués finissent presque toujours dans le slogan et le radicalisme de l’action. Le crime, l'assassinat, l'exécution, la torture ou l'emprisonne-
1 Dans ce sens, les lettres reçues par Soljenitsyne les mois suivant l’apparition du roman, citées par Natalia Rechetovskaïa, sa femme, dans ses mémoires (Natalia Reșetovskaia, op. cit.) sont très significatives. Une bonne partie des correspondants croient reconnaître dans le roman leur propre camp et leurs camarades de souffrance, même si, comme Soljenitsyne est obligé de l’affirmer, tout cela n’avait pas de rapport avec les camps où l’auteur avait vécu. 2 Mention significative : l’auteur de la préface à la première édition anglaise du ro-man, Marvin L. Kalb, attire l’attention que les dimensions de la tragédie et les liens avec le système communiste dans leur ensemble restent à découvrir (Marvin L. Kalb, « Introduction to A. Solzhenitsyn, One Day in The Life of Ivan Denisovich », dans A. Solzhenitsyn, One Day in The Life of Ivan Denisovich, New York – London, E.P. Dutton, 1963, p. vii.).
48
ment ne sont que la contrepartie de ce radicalisme doublé toujours par une croyance aussi forte que la foi religieuse. François Furet remarquait très bien que, si avant 1914, le marxisme de Lénine est une « théorie ésotérique » bizarre, celui-ci « devient rapidement un vaste système de croyances, en mobilisant des passions extraordinaires tant chez les par-tisans que chez les adversaires 1 ». Pendant la guerre civile, le crime est justifié par l'idéologie, tout comme par le rythme infernal d'une his-toire qui a changé de cours d’une manière dramatique.
Les arrestations, les déportations arbitraires et les exécutions sommaires deviennent « la normalité » pour toutes les parties impli-quées et le discours justifiant s’amplifie. Les relations faites par les journaux, souvent partisanes les échafaudages idéologiques et les bro-chures de propagande abondent et affichent une rhétorique mobili-satrice. Mais au-delà du langage légitimant le crime, la souffrance de l'individu qui commence à sentir le poids accablant de l’histoire mou-vementée devient visible. La fascination universelle de l’utopie2 commence à avoir pour contrepoids les récits de cette souffrance qui vont se transformer, avec chaque document, en repères d’une mémoire traumatique du XXe siècle.
L’une des premières relations riches en détails est celle d’un emprisonnement arbitraire. Elle date de 1920 et peut être considérée comme une description précoce des mécanismes absurdes du système d’incarcération soviétique, visibles dès le début. Il s’agit du livre d’Andrei Kalpachnikoff J’ai été le prisonnier de Trotski3. Le colonel Kalpachnikoff, en tant que représentant (assistant technique) de la Croix Rouge américaine, se rend à Saint-Pétersbourg en 1917, en au-tomne avec la mission de transférer à Jassy, capitale provisoire de la Roumanie à cette époque-là, 72 ambulances nécessaires à l’effort de guerre. Arrêté en décembre 1917 et accusé d’être officier tsariste, Kal-pachnikoff va passer cinq mois et 17 jours dans la forteresse Saints-Pierre-et-Paul, l'ancienne prison de la Russie impériale, devenue une vraie « Bastille du pouvoir soviétique »4. L’importance documentaire du volume réside surtout dans la présentation des modèles de l'incarcé-ration qui deviendront emblématiques pour tout le goulag soviétique,
1 François Furet, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul XX, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 88. 2 Ibid., chap. « Fascinaţia universală a lui Octombrie », p. 69-108. 3 Andrew Kalpashnikoff, A Prisoner of Trotsky’s, Garden City, New York, Double-day – Page & Company, 1920. 4 Ibid., p. XV.
49
bien qu’à l’époque ils aient semblé absurdes et en dehors de toute lo-gique de la justice moderne : exécutions arbitraires (p. 61), pain noir, à peine cuit, soupe aqueuse (p. 63), dissonance entre l'idée de justice visible et l’arbitraire de la pseudo-justice bolchevique (p. 65-66), accu-sations fantaisistes et absurdes (p. 68)1).
L'auteur a le mérite d’offrir pour la première fois un scénario d’incarcération bien documenté, allant jusqu’au détail, scénario que l’on pourra rencontrer tel quel dans d’autres relations parues à l’époque2 et d’une cruauté croissante au fur et à mesure du développe-ment du système de concentration soviétique.
Le volume, riche d’événements est, dans son intention, une ten-tative de décrire objectivement l’anarchie qui régnait en Russie après la révolution d'Octobre. Mais l’objectivité assumée (p. XVI) tourne en lamentation sur la situation du pays à cette époque-là, qui, dans l’opinion de l'auteur, repose plutôt sur « des illusions et des intérêts personnels » (p. XVI) que sur le réalisme politique et social. L’auteur prend le risque de faire aussi une prophétie, tout à fait plausible dans le contexte incertain de la guerre civile3 : le parti bolchevique est une forme d’ « d'anarchisme extrême » qui disparaîtra rapidement (p. XVIII).
Cette prophétie, nous ne le savons que trop bien, s’avérera fausse. L’échafaudage idéologique qui justifie les actions du pouvoir soviétique et le chaos de la politique du « communisme de guer-re4 » conduiront à une obsession de la lutte de classe, utile non seulement dans les actions nécessaires pour gagner la guerre civile, mais aussi dans la terrorisation de plus en plus « efficace » d’une popu-lation qui finira par abandonner toute illusion de la liberté. L’« ennemi de classe» (avec la variante ambiguë de propagande « ennemi du
1 Nous retenons, à titre d’anecdote, parmi les accusations portées contre Kalpashni-koff –, le fait d’être ami « intime » de la reine de Roumanie, ce qui lui aurait permis de la convaincre d’exercer son influence auprès du roi pour que celui-ci déclare la guerre aux « bolchéviks »(Ibid., p. 68). 2 Cf. le récit de Ludovic Naudeau, « Five months in Moscow prisons », dans Current History Magazine of the New York Times, 1919, Octobre, p. 127-136 et Novembre, p. 318-321. L. Naudeau, journaliste français à Moscou, est arrêté pour « activité contre-révolutionnaire » en juillet 1918. Une version plus ample de ses expériences sera publiée dans le volume En prison sous la terreur russe, Paris, Librairie Hachette, 1920. 3 Le livre de Kalpashnikoff est écrit à la fin de 1919. 4 Sur le communisme de guerre, voir Nicolas Werth, Histoire de l'Union soviétique de Lénine à Staline : 1917-1953, Paris, PUF, 1995.
50
peuple ») devient dès les premiers jours de la Révolution d'Octobre une catégorie juridique1 si imprécise qu’elle pourra justifier tout besoin répressif du nouveau pouvoir2, dont le bras tout-puissant – la célèbre Tchéka – s’organise officiellement dès le mois de décembre 1917 sous la direction de Felix Dzerjinski3.
Pas étonnant, donc, que les prisons existantes ou créées ad-hoc, sont surpeuplées, surtout lorsque la police secrète nouvellement créée sera habilitée à orchestrer la politique de « terreur révolutionnaire » (« la terreur rouge ») immédiatement après l'attentat contre Lénine du 30 août 19184. Dans ce contexte de répression de masse apparaissent les premiers camps de concentration dont le statut est au début ambigu et improvisé5, mais qui vont commencer à canaliser un taux important de la population se trouvant dans le territoire contrôlé par le pouvoir soviétique et classée comme faisant partie des « ennemis du peuple » : prêtres, officiers et fonctionnaires tsaristes, entrepreneurs (étiquetés comme spéculateurs), ennemis déclarés du nouvel ordre politique (poli-ticiens de droite, intellectuels libéraux ou socialistes « hérétiques » du point de vue des bolcheviks) ou même des personnes simplement soup-çonnées d’aversion contre le pouvoir.
1 Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean Louis Margolin, Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, Paris, Éditions Robert Laffont, 1997, p. 66 et suiv. 2 V. A. Apllebaum, op. cit., p. 42 : « Malheureusement, personne n’a jamais décrit le portrait clair d’un ‘ennemi de classe’. Par conséquent, les arrestations de toutes sortes se sont multipliées d’une manière spectaculaire après le coup d’Etat bolchévique. À partir de novembre 1917, les tribunaux révolutionnaires formés de ‘souteneurs’ de la révolution élus au hasard, ont commencé à condamner des ‘ennemis’ de la révolution élus au hasard. Des condamnations à la prison, au travail forcé et même des sentences capitales ont été prononcées contre les banquiers, les femmes des commerçants, les spéculateurs (c’est à dire contre toute personne exerçant une activité économique), contre les gardiens de prison du temps des tsars et contre toute autre personne qui semblait suspecte. » 3 Le livre noir du communisme, éd. cit., p. 67. Voir aussi George Leggett, The Cheka : Lenin’s Political Police, Oxford, Oxford University Press, 1987. Tchéka (CEKA) est un acronyme pour La commission extrordinaire panrusse pour combattre la contre-révolution, la spéculation et le sabotage (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем). Comme le remarque A. Applebaum (op. cit., p. 44-45), le caractère « extraordinaire” de cette ‘organisation’ réside dans le fait qu’elle se place en dehors de ‘toute légalité normale’. » 4 V. Le livre noir du communisme, éd. cit., p. 70 et suiv., surtout le chapitre 3 « La terreur rouge », p. 83-93, et A. Applebaum, op. cit., p. 45 et suiv. 5 V. A. Applebaum, op. cit., p. 45 et suiv.
51
La surpopulation des camps dans le chaos de la Guerre Civile, le manque de ressources nécessaires à l'administration, l’approche des grandes villes et le besoin du nouveau pouvoir d’endurcir le régime d’emprisonnement conduisent à la création d’un système de camps à destination spéciale au nord de la Russie Européenne1. C’est ainsi qu’on aboutit à l’organisation, en 1923, du camp de l’archipel Solovki, considéré aujourd'hui sinon la première île de l’Archipel du Goulag, au moins son prototype générateur2 en ce qui concerne non seulement l’administration et la structure, mais aussi l'isolement, les conditions de vie précaires des prisonniers, la torture systématique, l’épuisement à mort ou la transformation des prisonniers en esclaves.
L’époque des évasions et l’expansion du goulag (les « récits » de Solovki)
L’académicien Dmitri Likhatchev, en racontant son chemin vers
Solovki comme prisonnier, se rappelait, dans les années 80 que, à l'ar-rivée au camp de transit de Kem (en février 1928), les gardiens avaient accueilli les condamnés avec la réplique suivante : « Ici, il n'y a pas de pouvoir soviétique, il y a seulement le pouvoir de Solovki! »3. Ces mots sont fondamentaux pour comprendre ce que le système des camps so-viétiques, dont le prototype générateur est Solovki, était en train de devenir à la fin des années 20: un univers infernal, dépourvu de toute règle, même si on se rapportait aux normes soviétiques de l'époque. Ce n’est donc pas par hasard que les premières relations proviennent de Solovki, à l’occasion des évasions des années 20.
Mais le document le plus important de l’époque, au moins dans l’ordre de l’apparition, est le livre de Soserko A. Malsagoff, L’Ile de l’Enfer. Un prison soviétique du nord éloigné, paru à Londres en 19264.
1 V. A. Applebaum, op. cit., p. 55; A. Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag, 3 volume, tra-ducere şi note de Nicolae Iliescu (vol. I şi III) şi Ion Covaci (vol. II), Bucureşti, Univers, 2008, II, p. 25. 2 V. A. Applebaum, op. cit., p. 55. 3 En russe: « Здесь власть не Советская, здесь власть Соловецкая! ». La remémo-ration est faite dans le documentaire de Marina Goldovskaia, Власть Соловецкая, 1989 (cf. Nick Baron, « Conflict and Complicity: The expansion of the Karelian Gu-lag, 1923-1933 », Cahiers du monde russe, 2001/2-3-4, Vol 22, p. 615). 4 S. A. Malsagoff, An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North, Translated by F. H. Lyon, London, A. M. Philpot LTD, 1926.
52
L’auteur, combattant dans la Guerre Civile du côté des Blancs, se rend en avril 1923 aux officiers de la Tchéka suite à une annonce qui promettait l’amnistie générale pour tous les adversaires du pouvoir so-viétique. La promesse n’est pas respectée, Malsagoff est emprisonné et plus tard (le 30 novembre 1923), il est condamné à trois ans de déporta-tion à Solovki pour « terrorisme » et « espionnage au bénéfice de la bourgeoisie internationale »1. Il arrive à Solvki au début de 1924 et pour plus d'un an il vit à côté des milliers de prisonniers les horreurs de cette expérience concentrationnaire. En février 1925 arrive dans le camp le capitaine Youri Bezsonov2, ancien officier tsariste. Ensemble, ils conçoivent un plan d’évasion qu'ils vont mettre en œuvre en 1925. Après une marche forcée de centaines de kilomètres durant plus d'un mois, ils arrivent le 23 juin 1925 en Finlande, et de là dans le monde « libre ».
L'importance du récit de Malsagoff réside principalement dans son caractère direct et factuel. La prose de l'auteur se déroule d’une manière froide et objective et dépasse la simple description d'une ex-périence personnelle. Les parties I et III, racontant des détails purement autobiographiques (l’arrestation, les expériences personnelles dans le camp et l’évasion) ne sont que des éléments qui renforcent et authenti-fient la description systématique3 des réalités du camp des îles Solovki (la IIe partie) ; celle-ci constitue la partie la plus importante du volume.
La géographie du camp (p. 43-60), la dureté de la nature pour la plupart du temps (p.74), le froid, la faim, le travail épuisant (p. 152-153), la brutalité sadique et meurtrière des gardiens (p. 61 et suiv.) et des prisonniers de droit commun (p. 83 et suiv.), la liste im-pressionnante des innocents emprisonnés (p. 102 et suiv.) sont les points de repère les plus importants du rapport sur l'horreur faite au nom des survivants. L'auteur est conscient que son témoignage fait partie d’un « ample réquisitoire que la nation russe, toute l'humanité,
1 Ibid., p. 33. 2 Youri Bezsonov écrira lui-même un témoignage de ses expériences de prison : Youri Bezsonov, Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki, traduit du russe par E. Semenoff, Paris, Payot, 1928 (cf. Leona Toker, « Les mémoires tardifs du Goulag ou l’amendement de contextes historiques », dans Anne-Marie Pailhès [éd.], Mé-moires du Goulag, Paris, Editions Le Manuscrit, 2004, p. 98). 3 cf. Leona Toker, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, Bloomington, Indiana University Press, 2000, p. 30.
53
l'histoire et Dieu feront au pouvoir soviétique »1 et il le déclare dans l’avant-propos.
Mais cet ample réquisitoire n’est qu’à ses débuts. La relation de Malsagoff sera l'une des éléments de référence du livre de Raymond Duguet, Un bagne en Russie rouge : Solovki, l’île de la faim, des sup-plices, de la mort publié à Paris en 19272. Construit à partir des témoignages de quelques survivants, surtout des évadés, le livre est le premier récit strictement documentaire sur le goulag soviétique. R. Du-guet analyse l’administration du camp Solovki, sa structure fonctionnelle et le mélange de règles absurdes et d’improvisation qui déterminent la vie quotidienne. Il décrit également la typologie des pri-sonniers, les conditions de vie sordides, la famine et l'épuisement inévitables causés par le travail d’esclave fait dans des conditions ex-trêmes et sous la menace de sanctions arbitraires et d'exécutions sommaires.
L'une des observations les plus intéressantes sur la typologie des prisonniers est que les paysans et les travailleurs représentent la majori-té de la population des camps. Le livre met très bien en relief les caractéristiques du système concentrationnaire soviétique : les arresta-tions arbitraires, les accusations inventées, la pseudo-justice, la brutalité de la police politique qui va parfois jusqu’à la torture, les arrestations et la persécution des membres de la famille du prisonnier, le prolonge-ment arbitraire de la peine.
L'auteur, un anti-communiste acharné, mais inconnu à l'époque, présente un enregistrement cohérent et méticuleux3 des réalités solov-kiennes, qui ne provoque, néanmoins, aucune réaction en France, où se manifeste une présence socialiste extrêmement agressive qui sympa-thise avec le nouveau pouvoir de Moscou. Ainsi explique-t-on, la rareté des documents publiés dans l'espace français entre les deux guerres mondiales4.
1 S. A. Malsagoff, op. cit., p. 11. 2 Raymond Duguet, Un bagne en Russie rouge : Solovki, l’île de la faim, des sup-plices, de la mort, Paris, J. Tallandier, 1927 (réédité par Nicolas Werth dans 2004 : Un bagne en Russie rouge, Paris, Balland, 2004). 3 Cf. Applebaum, op. cit., p. 92: « un livre très exact sur Solovetski »; Comme Nico-las Werth le remarque lui-même dans la préface de l’édition de 2004, la valeur documentaire de ce volume sera confirmée par des recherches d’archives récentes. 4 Il est vrai que dans les cercles de l’émigration russe circulent des mémoires plus nombreux écrits en russe. Nous rapellons ici, par exemple, les écrits de Zaïtsev, So-lovki : Un bagne communiste ou un lieu de la torture et de la mort (Соловки: Коммунистическая каторга, или место пыток и смерти) et Quatre années dans le
54
Sauf le livre de R. Duguet et celui de I. Bezsonov, jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale paraissent seulement deux ouvrages. Le premier est un livre de Iulia Danzas, toujours sur Solovki : Bagne rouge : Souvenirs d'une prisonnière au pays des Soviets1. Le récit de Iulia Danzas, de seulement 57 pages, ressemble, comme structure et tonalité, à celui de Malsagoff : il est objectif, froid, ayant un rôle documentaire. Le second, à enjeu anticommuniste, est celui du croate Ante Ciliga, Au pays du grand mensonge2, publié pour la première fois à Paris en 1938. Le volume, plutôt politique qu’autobiographique, représente l’histoire de la perte des illusions dans l’utopie communiste :
« Ceux qui n’ont pas passé par les prisons, les camps de concen-tration et l'exil, là où vivent maintenant plus de cinq millions d'esclaves, ceux qui ne connaissent pas les plus grands camps de travail qui aient existé le long de l'histoire et où les gens meurent comme des mouches, sont battus comme des chiens et travaillent comme des esclaves, ceux-là n'ont aucune idée de la Russie Sovié-tique et de la société sans classes de Staline. » 3
En revanche, dans l’espace anglo-saxon, les documents et les
témoignages sont plus nombreux et plus consistants. Dans son volume En proie à Tchéka de 19294, Boris Tchederholm se rapporte toujours au camp Solovki. Arrêté en 1924 et condamné à trois ans de camp, Tchederholm va y passer seulement six semaines avant d'être libéré à la suite des interventions diplomatiques du gouvernement finlandais. La typologie de la souffrance humaine est la même que dans le récit de Malsagoff, et le choc des six semaines passées à Solovki a pour résul-tat une narration extrêmement tendue et détaillée.
pays de la mort (Четыре года в стране смерти), parus à Shanghai, le premier en 1931, le second en 1936 (cf. Leona Toker, Les mémoires tardifs du Goulag ou l’amendement de contextes historiques, loc. cit., p. 99). 1 Iulia Danzas, Bagne rouge : Souvenirs d'une prisonnière au pays des Soviets, Juvi-zy, Les Éd. du Cerf (Centre dominicain d'études russes), 1935. 2 Au pays du grand mensonge, Paris, Gallimard, 1938. Une variante plus complète sera publiée sous le titre Dix ans au pays du mensonge déconcertant à la Maison d’Edition Champ Libre en 1977. Une édition anglaise va paraître en 1940 : Ante Cili-ga, The Russian Enigma, London, Labour Book Service, 1940. 3 Ante Ciliga, The Russian Enigma, 1940, p. 136 (apud Michael Fox, « Ante Ciliga, Trotskii, and State Capitalism: Theory, Tactics, and Reevaluation during the Purge Era, 1935-1939 », dans Slavic Review, Spring 1991, Vol. 50, Issue 1, p. 136). 4 Boris Cederholm, In he Clutches of Tcheka, New York, Houghton, 1929.
55
Mais deux des plus émouvants récits sont ceux des époux Tchernavin : Tatiana Tchernavin, Évasion du pays des Soviets (1934) et Vladimir Tchernavin Je parle au nom de ceux qui se taisent (1936) tous les deux publiées aux États-Unis1. La tragédie familiale des Tcherna-vin, pas très différente des tragédies vécues par des dizaines de milliers d'autres familles à l’époque, commence lorsque le père, un spécialiste en ichtyologie, est arrêté en 1930 pour une accusation de sabotage inexistant. L'accusation de sabotage était à l’époque tant un moyen du nouveau pouvoir de se débarrasser des personnes indésirables, apparte-nant à la catégorie des intellectuels instruits avant la révolution, qu’une méthode efficace d’employer, pour la réalisation des grands projets de l’économie planifiée, de la main d’œuvre docile et, le plus important, gratuite.
Tatiana Tchernavin, spécialiste de l'art français des XVIIe et XVIIIe siècles et conservateur de l'Hermitage, sera arrêtée elle-même bientôt et leur fils de 12 ans Andrei, restera seul, obligé de vendre les meubles de l’appartement pour survivre. Tatiana sera libérée par la suite, mais Vladimir est condamné à cinq ans de camp à Solovki où il vit pleinement la faim, le froid et le travail épuisant devenus la règle. Il est transféré comme spécialiste ichtyologiste à Kem, où il gagne la con-fiance des responsables du camp et le droit d'être visité par les siens. Pendant les voyages de documentation il prépare son évasion et celle de sa famille. En août 1932, après une marche épuisante à travers un pay-sage hostile, il arrive, à la limite de la survie, en Finlande, et de là, en 1934, en Angleterre.
Les livres des époux Tchernavin sont complémentaires sur le plan des événements racontés et leur ton sombre est similaire. À partir de ses expériences, Vladimir Tchernavin met l’accent sur l’absurdité d'un système totalement coupé de la réalité pratique et dont les projec-tions utopiques se transforment en folie destructrice. Ses considérations sur l’innocence des détenus et l’absurdité des accusations (p. 7-8, p 77-78), sur les arrestations en masse (p. 59), les aveux obtenus par la force (p. 178-179)2, le mensonge généralisé (p. 67) ou sur l’abrutissement de
1 Tatiana Tchernavin, Escape from the Soviets, New York, E. P. Dutton & CO, Inc., 1934; Vladimir V. Tchernavin, I Speak for the Silent (Prisoners of the Soviets), Bos-ton - New York, Hale, Cushman & Flint, 1936. 2 Vl. Tchernavin les appelle « romans », et il appelle « romanciers » les pauvres au-teurs (Chap. XXIII, « Les romanciers », p. 178 – 185).
56
toute une population (p. 141-142), le conduisent à une conclusion lo-gique - les vrais « saboteurs » du pays sont les dirigeants du moment :
« Les bolcheviks transforment un pays riche et prospère en un pays ou la pauvreté est extrême et la faim horrible. ‘Le sabotage’ existe, en effet, mais il s'agit d'un sabotage de proportions incroyables pla-nifié par l'organisation dirigée par Staline, le Bureau Politique et le OGPU1, avec ses milliers de branches appelées organisations de par-ti. » (p. 88)
Il ne s’agit pas là d’une simple rhétorique amère de V. Tcherna-
vin. Cette conclusion extrême qui se retrouve tout au long du volume est amplement argumentée par des références ponctuelles à son do-maine de spécialisation. La narration dégage une impression de respectabilité et d’objectivité qui la transforme dans un vrai document2. C’est ainsi que le volume réussit à reconstruire d’une manière crédible l’atmosphère des années ’30 tant en ce qui concerne l’état de terreur généralisée de toute l’Union Soviétique, que les aspects de l’univers carcéral proprement-dit. La prison, quelque dégradante qu’elle soit du point de vue spirituel et physique, n’est que l’antichambre de l’esclavage des camps de travail forcé :
« J'avais entendu des rumeurs comme quoi le OGPU vendait des ex-perts, étant donné qu'un grand nombre d'ingénieurs de différentes spécialités se trouvaient entre leurs mains, mais cela semblait pour-tant peu crédible. Le communiste Bagdanoff, le directeur de notre compagnie, a été prié de se renseigner. Les rumeurs ont été confir-mées et il est allé à Kem, le centre administratif du camp Solovki pour acheter toute une équipe. Il est revenu en quelques jours, mission accomplie, mais ses impressions sur Kem était trop fortes, même pour un communiste, il ne put donc pas s'empêcher de se confesser devant nous : ’Pouvez-vous imaginer que là-bas (à l'administration du camp de Solovki) les expressions suivantes sont utilisées avec nonchalance : On vend ! Nous faisons des réductions pour les grandes quantités ! Marchandise de première qualité ! La ville d’Arkhangelsk offre 800 roubles par mois pour X et vous pro-posez seulement 600 ? Quelle marchandise! Il a été formé à l'Université, il est l'auteur de nombreux articles scientifiques, il a été le directeur d'une grande usine, avant la guerre il était considéré
1 (O)GPU est l’avatar des années ’30 de Tchéka. 2 Cf. Leona Toker, Return from the Archipelago, ed. cit., p. 30.
57
comme un ingénieur de première classe ; maintenant il doit faire dix années de travail forcé pour sabotage ; cela signifie qu’il va faire toute activité sollicitée et vous négociez pour 200 roubles ?’ » (p. 38-39)
La relation de Tatiana Tchernavin complète la narration de son
mari par la référence à la souffrance de ceux qui restaient à la maison après l’emprisonnement de leurs parents : épouses, enfants, mères. Elle est emprisonnée elle-même pour 5 mois en vue de la déterminer à dé-noncer son mari, mais elle est libérée après la condamnation de Vladimir. La force de son témoignage provient de sa capacité de dé-crire, à partir de sa propre souffrance, l’image de la misère et de la pauvreté généralisée qui touche tout le pays transformé dans une géante prison :
« En U.R.S.S. tout a été détruit : les rues sont sales, les maisons ont besoin de réparations, les chambres sont humides et sordides ; les hommes sont affaiblis, les chiens faméliques, les chats crasseux, les pigeons qui n’ont pas encore été mangés ont les ailes et les jambes cassées. La saleté, la faim et la misère règnent partout ». (p. 275)
Mais l’image la plus choquante et la plus suggestive du livre
semble celle de l’étonnement de leur fils, Andrei (né en 1918, ayant donc une certaine expérience de vie dans la réalité soviétique), qui, une fois arrivé en Finlande, est choqué par la prospérité qui régnait ici, pas du tout extraordinaire d’ailleurs (p. 313 et suiv.). Les années d’endoctrinement dans les écoles du « paradis des ouvriers et des pay-sans » « fondent » aussi vite que le beurre mis dans les macaronis « blancs » préparés pour le dîner :
« J’étais assise à la table en sirotant du café véritable, d’une odeur merveilleuse, pendant que la cuisinière mélangeait quelque chose dans une grande casserole et, gaie, nous parlait dans une langue qui nous était inconnue. ‘Qu’est-ce que c’est que ça, maman ?’ ‘Des macaronis.’ ‘Et pourquoi ils sont si blancs ?’. Les macaronis sovié-tiques sont gris parce qu’ils sont fait de farine non tamisée, c’est pourquoi il était si étonné. [...] Sais –tu ce qu’ils ont fait avec le beurre ? Tu ne peux pas t’imaginer : ils l’ont mis dans les macaronis! Eh bien, je ne crois pas que les gens meurent de faim en Finlande. Tu sais, ils ont écrit dans
58
le journal L’étincelle de Lénine que les paysans d’ici n’ont pas de pain et se refugient en URSS. Tu parles ! » (p. 314)
Les deux volumes des époux Tchernavin constituent le témoi-
gnage de la grande odyssée de l’intellectualité russe dans un monde qui lui est hostile par principe idéologique. D'une part, la dégradation phy-sique, de l'autre l'humiliation et la terreur provoquées par les autorités amputent la conscience de son côté moral et projettent les destins dans un cercle vicieux de la criminalité, de la délation et de l'esclavage sur lequel se fonde la « nouvelle société ». L'avenir de tout intellectuel, note Tatiana Tchernavin, est l'emprisonnement (p. 278). Le seul espoir est la fuite. C'est pourquoi, peut-être, l’«évasion» est la seule solution dans la vision des deux. Et par ce détail les deux volumes semblent faire appel à une morale de l’action. S'exprimant au « nom de ceux qui se taisent » les époux Tchernavin, parlent au nom de l'humanité et, même s'ils ne s’adressent pas directement, leur narration essaie, en ac-cumulant des détails sur la souffrance collective, de mobiliser l'opinion publique occidentale contre le régime soviétique1.
*
À ce vrai dossier du système de concentration soviétique des
années précédant la deuxième guerre mondiale on pourrait ajouter quelques pièces, chacune représentant un document important sur l’époque.
En 1935 paraît le récit de George Kitchin, Prisonnier de l’OGPU2. Kitchin, anglais et citoyen finlandais, homme d’affaire attiré par les opportunités offertes par la Nouvelle Politique Economique, est arrêté en 1928 et va passer quatre ans dans la prison et dans l’un des camps situés près de Kotlas, construits selon le modèle Solovki. La narration de Kitchin, qui allait mourir, sa santé étant ruinée par la dé-tention, juste au moment où son livre était sous presse (1935), se focalise surtout sur les souffrances subies dans le camp et constitue l’une des premières relations faites par un prisonnier victime de l’expansion du système des camps de travail. Les marches forcées dans une nature glacée et à des températures arctiques, les abris improvisés,
1 Ibid., p. 31. 2 G. Kitchin, Prisoner of the OGPU, London – New York – Toronto, Longmans, 1935.
59
le travail exténuant et inutile ou les improvisations administratives ne sont que quelques exemples des nouvelles réalités du goulag mises en évidence dans cette œuvre.
Le récit d’Ivan Solonévitch de 1936, La Russie dans le camp de concentration1, est la plus « littératurisée » relation sur le goulag des années précédant la deuxième guerre mondiale. Dans un style flam-boyant, radicale comme attitude et hollywoodienne quant à la forme en série de la narration2, la prose de Solonévitch s’adresse surtout à l’émigration russe comme un avertissement pour ceux qui pourraient se laisser en proie à la nostalgie d’un possible retour. À part les aventures racontées (l’essai de traverser la frontière, l’arrestation, les mois de travail exténuant au canal Belomor, l’évasion), le livre de Solonévitch réussit à présenter une image dynamique de l’expansion des camps de concentration soviétiques des années ’30 et de ses relations avec les projets irréalistes d’industrialisation du pouvoir soviétique. Une justice sommaire et arbitraire qui assure un très grand nombre d'esclaves pour le système concentrationnaire (le Goulag) au service des projets pha-raoniques représente déjà la triade dominante de toute la société soviétique, non seulement du système des camps. Après une telle des-cription de l'ensemble de la société soviétique des années 30, la conclusion et l’enjeu du livre sont logiques : la Russie soviétique est un immense camp de concentration.
La crédibilité d’Ivan Solonévitch est problématique. L’historiographie confirme, post factum, ses affirmations, au moins en ce qui concerne la vision globale et la conclusion finale. Il y a dans la narration de Solonévitch une rhétorique émotionnelle et une figure au-tobiographique histrionique, à la limite de l’opportunisme et du collaborationnisme, ce qui suscite des doutes quant aux détails de la narration et aux motivations profondes de l'auteur. Sa crédibilité sera d’ailleurs minée ultérieurement par les choix politiques de l'auteur qui, établi dans l'Allemagne d'Hitler, deviendra un adepte du nazisme, de l'antisémitisme et du nationalisme extrême3.
1 En russe: Россия в концлагере. Paru en série (1936) dans la revue de l’émigration russe de Paris, Poslednie Novosti (cf. Leona Toker, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, éd. cit., p. 31). La version anglaise Russia in Chains : A Record of Unspeakable Suffering paraîtra en 1938, en deux volumes à Londres, Williams and Norgate Ltd., dans la traduction de Warren Harrow. 2 Leona Toker, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, éd. cit., p. 30 – 32. 3 Ibid., p. 32.
60
En 1938, nous pouvons enregistrer encore un élément du dossier public du goulag : le livre de Iulia de Beausobre, La femme qui ne pou-vait pas mourir1. Iulia de Beausobre, membre de l'aristocratie russe, est libérée du camp en 1934, étant rachetée par son ancienne gouvernante, citoyenne britannique. Son histoire est intéressante surtout grâce à la perspective religieuse, la foi étant l’un des moyens de salut de l'enfer concentrationnaire, voie que l’on rencontrera ultérieurement dans d’autres récits sur le goulag.
Souffrance, déshumanisation, esclavage Chacun des auteurs de ces narrations rassemble les éléments
particuliers du phénomène concentrationnaire, à partir de ses propres expériences et de ce que les camarades de détention leur en avaient relaté. Dans chacune d’entre elles, la dimension autobiographique, iné-vitablement émotionnelle, est mise au service d’une tentative d’objectiver la réalité extérieure au moi du narrateur. La tâche en est difficile, si l’on tient compte de l’expression de la souffrance qui est dominante dans presque tous les épisodes de la narration. Cependant, l’émotion, quelque transparente qu’elle soit, comme dans le cas de Ta-tiana Tchernavin, par exemple, laisse de la place tant à la réflexion amère qu’aux observations ponctuelles susceptibles d’étayer la valeur de vérité des faits relatés. Et ce processus, à « chimie » variable, est présent chez tous les auteurs. Même quand la trame narrative semble soit s’imprégner de la rhétorique de l’aphorisme (chez I. Solonévitch) ou de l’effusion mystique (chez Iulia de Beausobre), soit étaler le détail économique (chez V. Tchernavin), l’appel récurrent à la description ou à l’expression événementielle font que la « réalité » du camp de travail forcé ou de la prison soit directe et accablante. C’est moins l’effet du talent des auteurs, que de l’image extrême du destin individuel brisé à l’intérieur de l’univers du mal absolu2 .
1 Iulia de Beausobre, The Woman Who Could Not Die, London, Chatto and Windus, 1938 (cf. Leona Toker, Return from the Archipelago, éd. cit., p. 30). 2 D’ailleurs, comme Tzvetan Todorov le dit si bien, le personnage principal du camp est « le mal », dont l’invasion a une force hors du commun et se passe à un niveau inconnu jusqu’alors (Confruntarea cu extrema. Victime şi torţionari în secolul XX, Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 117).
61
Le contact avec cet univers du mal commence bien avant l’incarcération proprement dite, puisque le futur prisonnier est déjà ar-rivé à la pleine conscience du fait que l’arbitraire, la coercition et le crime sont à l’ordre du jour et que n’importe qui peut leur tomber vic-time :
« À la fin du mois de mars, j’ai reçu un billet de mon mari, billet qui n’avait pas été envoyé par la poste : ‘S. et K. sont arrêtés. Ma chambre vient d’être perquisitionnée. Je ne sais pas ce que l’on cherche. Brûle tout’. Comment cela ? Brûler tout ? Pourquoi ? Se-rions-nous des conspirateurs ou des criminels ? Brûler tout : qu’est-ce que cela veut dire ? […] Bon, je vais tout brûler, même les livres ayant des dédicaces de la part de leurs auteurs, pour qu’il n’y ait pas la moindre chance de compromettre quelqu’un. Si je n’avais pas eu mon fils à côté de moi, lui qui aimait tant sa maison, je l’aurais dé-truite elle aussi, tellement j’étouffais à cause de la haine que j’éprouvais quand je pensais que les agents OGPU pouvaient venir d’un moment à l’autre pour fouiller parmi toutes sortes de choses in-times et personnelles ».1
Pourtant, l’imminence de l’arrestation ne diminue pas le choc ressenti au moment où elle se produit. Les arrestations en masse pré-parent moralement V. Tchernavin pour son propre emprisonnement2, mais ce moment venu, il est déjà vécu comme une confrontation avec la mort :
« On a sonné à la porte. J’ai ouvert et j’ai vu l’administrateur accom-pagné d’un inconnu habillé en civil. J’ai compris tout de suite. L’inconnu m’a montré l’ordre de perquisition et d’arrestation. Je l’ai laissé entrer. […] J’ai fait les préparatifs de ‘voyage’ : deux trous-seaux de linge de corps, un oreiller, une couverture, quelques morceaux de sucre et quelques pommes. C’était tout ce que j’avais à manger. J’ai changé de vêtements. ‘Je suis prêt’, ai-je dit à l’agent GPU, mais dans mon for intérieur je me disais ‘prêt pour la mort’ ».3 Dès son arrestation, le détenu suivra un véritable trajet de dés-
humanisation comme s’il se trouvait dans un moulin qui moud le corps et l’âme de la même manière. Devenus de simples objets mis à la dis-position de quelques maîtres aux pouvoirs discrétionnaires, qui ne se
1 T. Tchernavin, op. cit., p. 92-93 2 V. Tchernavin, op. cit., p. 59-60. 3 Ibid., p. 92-93.
62
sentent limités par aucune règle, chacun des détenus va enregistrer, terrifié, les expériences sadiques destinées, semble-t-il, à reformuler les lois de la résistance humaine à la misère, à la faim, à la torture physique et psychique. Première étape : la prison. Le même V. Tchernavin, se rappelant sa première nuit en prison, relate dans sa narration le choc de son entrée dans l’univers de la misère et de la déshumanisation :
« Une odeur lourde et dégoûtante traînait le long du plancher : elle venait du seau de toilette qui se trouvait à moins d’un mètre de ma tête ; un amas de copeaux de bois qui puait touchait presque mon oreiller. Plusieurs hommes attendaient leur tour aux chiottes. Je me sentais à bout de forces, accablé par un sentiment humiliant d’impuissance. Il m’était impossible de dormir, impossible de me lever ou de m’asseoir et je ne pouvais pas quitter mon endroit, parce que le plancher était entièrement couvert par les corps de ceux qui dormaient. Pour ne pas perdre mon oreiller, je l’ai mis sur les ge-noux, et, en m’appuyant des épaules contre le mur, je me suis figé sur place, la tête entre deux lits. Des points noirs bougeaient sur l’oreiller dans toutes les directions. Et c’est comme ça qu’a débuté mon éducation dans la prison. Pour un novice, c’en était assez »1.
Mais, par exemple, S.A. Malsagoff ne se rappelle pas tant la mi-
sère de la prison de Tbilissi, où il avait passé ses premières semaines d’incarcération et où il avait acquis son expérience d’incarcéré, que les exécutions sommaires et arbitraires ainsi que la tension extrême des moments passés dans l’antichambre de la mort :
« Chaque semaine, le mardi, pendant la nuit, on fusillait 60 à 300 personnes dans la prison Meteh. Cette nuit-là était un vrai enfer pour toute la population de la prison. Nous ne savions pas qui parmi nous avait été désigné pour l’exécution, de sorte que chacun de nous s’attendait à ce qu’il fût fusillé. Personne ne pouvait fermer l’œil jusqu’au petit matin »2.
La torture, la misère et la pression psychique, que nous allons
rencontrer ultérieurement, après les années ’50, dans tout ce qu’avaient relaté A. Soljenitsyne, A. Dolgun, E. Guinzbourg, V. Chalamov et beaucoup d’autres, peuvent être observées dans leurs repères essentiels,
1 Ibid., p. 98. 2 S.A. Malsagoff, op. cit., p. 30-31.
63
dès cette période ; elles sont amplifiées parfois par l’état d’improvisation du système en plein expansion. Si la prison est un « en-fer », c’est pourtant un « enfer » organisé. En revanche, le camp de travail forcé, surtout dans cette période d’expansion, représente la cruauté, la torture, la famine et la misère, rendues encore plus intenses par des improvisations criminelles. L’éloignement par rapport aux centres du pouvoir du monde soviétique et les ordres ambitieux qui en émanent vont pousser des milliers de gens dans des espaces improvisés où le manque de provisions, la brutalité des gardiens et les normes de travail totalement irréalistes tuent les gens par milliers. G. Kitchin sur-prend très bien dans sa narration l’amplitude de cette situation, en évoquant des scènes dignes d’une anthologie des horreurs. En voilà un exemple :
« Les bottes et les vêtements furent arrachés du corps de Seryozha, encore évanoui. Il gisait dans la neige, ayant sur lui seulement son linge de corps ; il gémissait tandis qu’il reprenait conscience lente-ment. Deux gardiens s’approchèrent, tenant à la main des seaux d’eau. Quel cauchemar ! Comment cela était-il possible ? Et le prêtre qui ne cessait de se lamenter : Seryozha, Seryozha … Ils versèrent de l’eau sur Seryozha qu’ils obligèrent à se tenir pieds nus, dans la neige. Autour de lui, les gardiens, les fusils dirigés dans sa direction. Nous en étions tous terrifiés. Le vent mordant soufflait de plus en plus fort ; il neigeait. Une foule de corbeaux voltigeait au-dessus de nous, luttant contre le vent. Pourquoi étaient-ils venus juste à ce moment-là ? »1.
Nombreuses sont de telles scènes dans les relations des survi-
vants du goulag. En fait, l’attitude brutale des gardiens et des commandants du camp doit briser toute trace de dignité chez les déte-nus. Mais l’horreur devient plus grande encore si, à cela, vient s’ajouter le sadisme des gardiens. Le but principal était la transformation des individus en esclaves dociles. Esclaves, du sort desquels les maîtres n’en avaient cure, tant que la machine répressive était capable d’en produire sans cesse d’autres. Chacun des auteurs de ces remémorations carcérales précoces a la conscience de ce statut d’ « esclave ». La per-sonnalité et l’individualité mises en doute dès la période d’apparente « liberté » sont brutalement niées par une succession d’actes symbo-
1 G. Kitchin, op. cit., p. 54.
64
liques des « maîtres » qui bénéficient d’un pouvoir vraiment discré-tionnaire sur l’homme devenu simple « objet » :
« Vous êtes arrivés dans le Camp de punition de l’OGPU de la Ré-gion Nord. Ici, il n’y a ni juges, ni avocats, ni procureurs. Vous ne pouvez donc vous plaindre à personne. Je vous conseille de travail-ler consciencieusement sans commentaires ni révoltes. Ici vous n’allez plus faire une contre-révolution. Ceux qui manifestent une attitude contre-révolutionnaire, nous les mettons contre le mur pour les fusiller. Pareillement, ceux qui se plaignent, qui volent ou qui se rendent coupables d’insubordination auront le même sort. Je vous conseille d’en devenir conscients et de vous en souvenir sans cesse. Ici, personne n’est en visite chez sa chère petite tante, vous vous trouvez dans un camp de punition. Oubliez vos mécontentements d’intellectuels et d’autres trucs pareils, autrement, vous, les intellos, c’est fini. Beaucoup des vôtres se trouvent déjà dans un monde meil-leur. Vous refusez de travailler – la geôle, et, si vous vous entêtez – la balle. Compris ? »1
On a beaucoup discuté dans l’historiographie récente les aspects
économiques du goulag et les raisons politiques du pouvoir bolché-vique de créer cet univers de la terreur2. Mais, en dernière instance, la répression politique des années de début de l’Union Soviétique et la lutte de Staline des années ’30 pour s’emparer du pouvoir, donc, ré-pression et lutte combinées avec l’obsession de l’ingénierie sociale spécifique au léninisme ont eu pour conséquence logique la transforma-tion des camps dans d’immenses « usines » mises en fonctionnement par une armée gigantesque d’esclaves, au sens le plus direct et le plus cruel du mot. Si on laisse de côté les excès paranoïaques des moments de terreur extrême, comme ceux des années 1936 à 1938, qui ont abouti à un nombre élevé d’exécutions sommaires, du jamais vu depuis la Guerre Civile, le but ultime du système concentrationnaire soviétique était d’abord de faire augmenter cette armée d’esclaves et, par la terreur générale, de préparer ensuite toute la population pour un sort similaire. Les survivants du goulag des années d’avant la Seconde Guerre Mon-diale ont enregistré avec horreur ce phénomène par leurs propres
1 Ibid., p. 46. 2 Voir, par exemple, Paul R. Gregory, Valery Lazarev (ed), The Economics of Forced Labor : The soviet Gulag, Standford Hoover Institution Press – Standford University, 2003, ou Jean-Jacques Marie, Le Goulag, Paris, PUF, 1989.
65
expériences, mais leur incarcération et puis leur salut (par évasion, par rachat ou par purgation de la peine) les privent de perspective sur une époque où l’on va assister à une véritable évolution de l’horreur et du crime ; alors, il faudra attendre les années d’après-guerre pour que les événements de cette époque-là soient relatés.
J’affirme cela parce que toutes les relations précoces sur le gou-lag ne réussissent à reconstruire qu’un petit fragment de l’immense industrie concentrationnaire soviétique des années de son expansion. À la réalité infernale des camps de travail forcé vient s’ajouter une autre réalité, tout aussi infernale, celle des déportations en masse ou de l’exil forcé. Aux arrestations massives des « spécialistes » accusés de sabo-tage (tel V. Tchernavin) ou des petits entrepreneurs, attirés par la Nouvelle Politique Economique des années ’20 (tels G. Kitchin ou B. Cederholm), à partir de 1928, les vagues des déportations sont aussi cruelles et destructives que les vagues d’arrestations en masse. La dé-portation des « koulaks » (sous-catégorie de la grande catégorie des « ennemis de classe », les deux tout aussi vagues) et des « éléments indésirables » mènera, au début des années ’30, à des épisodes encore plus cruels que ceux qui sont relatés de l’intérieur des prisons et des camps de travail forcé. Des familles entières, intégrées à la catégorie des koulaks parce qu’elles étaient tant soit peu riches, sont exilées dans des zones au climat hostile de la Sibérie ou du sud désertique (en Ka-zakhstan) et transformées, comme dans le cas des détenus des camps de concentration, en esclaves1. La tragédie des plus de deux millions de paysans, soldée avec des centaines de milliers de morts, des familles séparées et des enfants orphelins ou traumatisés pour toute la vie, reste presque inconnue à l’époque. Il est vrai qu’en 1933 paraît à Londres un volume ayant environ cent pages où sont rassemblées quelques dizaines de lettres envoyées depuis les territoires de la faim, du froid et du dé-sespoir2, là où les déportés, en commençant par les enfants de 12 ans jusqu’aux vieillards de plus de 70 ans, travaillent jour et nuit, dans des
1 Voir Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, éd. cit ., p. 164-177 ; Orlando Figes va entreprendre une analyse intéressante de cette période et de son impact sur le destin des gens simples dans son livre The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia, London, Penguin, 2007 ; voir spécialement le chapitre 2, « The Great Break » (1928-1932), p. 76-147. 2 Out of the deep ; letters from soviet timber camps, London, G. Bles, 1933 (On peut trouver des fragments de ce volume dans Julien Steinberg, Verdict of Three Decades: from the Literature of Individual Revolt against Soviet Communism : 1917-1950, Ayer Publishing, 1971, p. 281-287).
66
conditions extrêmes et pour une nourriture précaire. Mais ce n’est qu’une goutte de cet océan de souffrances, un petit fragment d’une his-toire qui attendra d’être racontée et qui ne pourra être entièrement relatée que beaucoup d’années après, lorsque le pouvoir soviétique même n’existera plus. Les tragédies des déportations des années ’30 restent presque inconnues à l’époque surtout parce que les personnes déportées sont, pour la plupart, des gens simples. Leurs histoires seront relatées des années après, par leurs enfants et aussi par l’effroyable « cavalcade » des chiffres des archives. Mais comme les déportations des années ’30 ne sont qu’un préambule à la vague encore plus grande des déportations des nationalités pendant la Seconde Guerre mondiale (les Allemands de la Volga, les Polonais des régions de l’Est, les Rou-mains de Bessarabie, les Tatars de Crimée, les Tchétchènes du Caucase, etc.), l’histoire des souffrances va se poursuivre, et le corpus des témoignages qui en seront faits va s’agrandir après-guerre. Quoi qu’il en soit, dans les années ’30, le système des camps de concentra-tion va se « dilater » et il « s’enrichira » de nouveaux territoires. L’archipel du Goulag se déplacera implacablement vers le nord-est, intégrant des espaces nouveaux, autant de repères de la terreur concen-trationnaire soviétique. Petchora, Vorkouta, Norilsk, Kolyma, noms inconnus dans les années ’30, deviendront, après-guerre, d’importants symboles de l’horreur, dont ceux qui réussiront à y survivre et à se sau-ver après la fin de la Guerre vont faire des relations troublantes.
Naissance d’un genre littéraire distinct : la littérature
du goulag Si l’on jette un regard d’ensemble sur l’univers concentration-
naire soviétique jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, on peut constater que l’on dispose d’un important nombre de documents, mais qui n’ont qu’un écho limité dans l’opinion publique européenne démocratique. Il est vrai que les relations de Malsagoff et le livre de Raymond Duguet ont fait naître une certaine préoccupation, surtout dans les milieux de la gauche américaine et britannique, soucieuse du sort des socialistes et des socio-démocrates russes, qui avaient été incarcérés comme des « hérétiques » par les bolchéviques. On a commencé même de timides
67
investigations des accusations1. Mais ce n’est qu’après l’expansion du système des camps de travail forcé et après son implication grandis-sante dans les projets économiques des années ’30 que des soucis d’ordre économique font leur apparition. Les témoignages dont nous venons de parler plus haut, par exemple celui de V. Tchernavin2 décri-vent en détail les « bénéfices » tirés par l’État soviétique à la suite de l’exploitation du travail des détenus-esclaves. Les compagnies occiden-tales, menacées par la concurrence des produits soviétiques bon marché, ont essayé d’imposer un boycott économique sur les biens supposés à l’époque comme étant produits par le travail forcé (surtout dans l’industrie du bois). On a fait même des investigations sur place qui vont échouer devant l’habileté des autorités soviétiques à dissimuler l’emploi du travail des détenus dans les industries visées par les inspec-tions internationales. G. Kitchin raconte, par exemple, comment, juste avant la visite, dans la région, d’une délégation étrangère, son camp est liquidé, les clôtures de barbelés et les miradors sont démolis et les déte-nus sont évacués en hâte dans la forêt, à l’abri de tout regard indiscret3. Le souci des autorités pour l’image du pays à l’étranger les pousse à reprendre, chaque fois qu’un personnage important de l’étranger vient visiter le pays, la tradition des villages Potemkine4, héritée du temps de Catherine II.
Mais ces relations précoces sur le goulag et son expansion n’ont qu’une audience réduite, parce que leurs auteurs (surtout ceux qui fai-saient partie des cercles de l’émigration ou des rangs des opposants socialistes) se trouvaient à l’opposé de l’idéologie coupable de cette métastase sociale. Cette situation a facilité la propagande soviétique qui
1 Anne Applebaum, op. cit., p. 93-96. Le sénateur français Frédéric Eccard rassemble en 1931, pour l’opinion publique française, des documents dans le but de réaliser un petit dossier sur le travail forcé en Union Soviétique dont le titre est : « Le travail forcé en Union Soviétique ». Ce dossier, réalisé à partir des relations des marins nor-végiens et anglais et des lettres des détenus, est publié dans La revue hebdomadaire, avril 1931, p. 457-472 (cf. Willemina Kloosterboer, Involuntary labour since the abolition of sclavery, Leiden, E.J. Brill, 1960, p. 176). 2 V. Tchernavin , op. cit., p. 280 et suiv. 3 G. Kitchin, op. cit., p. 267-270. 4 Voir, par exemple, le cas de la visite du radical français Édouard Herriot dans l’Ukraine Soviétique saisie par la famine, en 1932 (cf. François Furet, op. cit., p. 160-162). On pourra trouver une image littéraire intéressante de cette visite, doublée d’une exemplification imaginaire bien suggestive des villages Potemkine chez Danilo Kiš dans son livre Un tombeau pour Boris Davidovich, Paris, Gallimard, 1979, le récit intitulé « Les Lions mécaniques ».
68
voulait contrecarrer publiquement les relations précoces sur le goulag. De plus, l’intellectualité européenne de gauche avec son obsession de l’utopie sociale ou le simple opportunisme vont contribuer à cette ac-tion de mise entre parenthèses de la misère et même des crimes du présent1. N’oublions pas que, durant les années où les époux Tcherna-vin et des centaines de milliers d’autres innocents sont réduits à l’état d’esclaves dans les prisons et les camps, Louis Aragon par exemple, dédiait des odes directes aux bourreaux du GPU2.
Quoi qu’il en soit, les problèmes politiques de l’Europe sont dif-férents, pendant ces années d’avant la Seconde Guerre mondiale. La poursuite d’une politique pragmatique au cadre du système fragile d’alliances européennes, érodé par des tensions de plus en plus grandes, laisse trop peu de place, dans l’espace publique occidental, pour une discussion sur les événements de l’Union Soviétique. La campagne d’épurations politiques3 orchestrée par Staline entre 1936-1938 retient l’attention de l’opinion publique occidentale seulement par le caractère spectaculaire des accusations et de la célébrité des accusés, membres de premier rang de la nouvelle classe dirigeante de l’Union Soviétique. Pendant ce temps-là, des millions de gens anonymes sont exécutés sommairement ou déportés dans des camps de travail forcé, qui s’étendent maintenant à l’échelle de tout ce territoire soviétique im-mense, de Mourmansk à Magadan, de Vorkouta au Kazakhstan.
La seconde moitié des années ‘30 représente l’époque pendant laquelle vont commencer leur expérience carcérale une partie de ceux qui, après la Seconde Guerre mondiale, deviendront, par la remémora-tion de ces expériences extrêmes, les noms les plus importants de la littérature du goulag. Varlam Chalamov, auteur des Récits de la Koly-
1 Pour comprendre les relations compliquées entre l’intellectualité occidentale et la propagande stalinienne, voir le livre de Stephen Koch, La fin de l’innocence : Les intellectuels d’occident et la tentation stalinienne : 30 ans de guerre secrète, Paris, Grasser, 1995. 2 Il s’agit du « poème » Prélude au temps des cerises du volume Persécuté-Persécuteur, 1931. En 1935, c’était toujours Aragon qui parlait de « la prodigieuse science de rééducation de l’homme » consolidée par « l’extraordinaire expérience du canal Belomor » à l’aide des « tchékistes » (Pour un réalisme socialiste, Éd. Denoël et Steele, Paris, 1935). 3 Sur les « Grandes Purges » (ou la « Grande Terreur ») des années 1936-1938, voir Robert Conquest, Marea teroare, Bucureşti, Humanitas, 1998.
69
ma1 est arrêté en janvier 1937 et va passer plus d’une décennie dans les camps de la région de la Kolyma (il sera mis en liberté en 1951). Ev-guénia S. Guinzbourg, auteure de deux amples volumes de mémoires2, arrêtée en février 1937, va passer presque deux décennies dans la même région très rude du nord-est arctique sibérien (elle sera mise en liberté en 1955). Leurs volumes rédigés après leur libération vont circuler à partir de la fin des années ’60, à côté des mémoires écrits par tant d’autres camarades de souffrance, emprisonnés pendant les mêmes an-nées3. De ces sombres années ’30, peu de témoignages sur le goulag vont voir le jour à l’époque même, à cause du fonctionnement presque parfait du mécanisme répressif soviétique et de la fermeture hermétique des frontières. Les témoignages précoces seront aussi mis dans un cône d’ombre par les tensions de la Seconde Guerre mondiale qui, à partir de 1941, fera entrer l’Union Soviétique dans le camp des alliés occiden-taux.
Pourtant, vers la fin des années ’30, peut-être aussi grâce à ces témoignages précoces sur les camps, commence à se manifester dans l’Occident ce que le philosophe et politologue américain Sidney Hook appelait dès 1949 la « littérature de la désillusion »4, un corpus de textes de toutes sortes dans lesquels l’image centrale est celle de la dé-sillusion envers l’expérience utopique soviétique. Les auteurs proviennent de diverses cultures et leur déception prend sa source d’une série d’expériences intellectuelles et politiques variées. Parmi les plus importants, il y a Bertrand Russell, Stephen Spender ou Georges Orwell en Grande Bretagne, André Gide et Boris Souvarine en France, John Dos Passos aux États-Unis, Panait Istrati, Arthur Koestler, Ante Ciliga, dans l’Europe centrale et de sud-est. Il s’agit des figures enthou-
1 Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, nouvelle édition intégrale, traduit par Ca-therine Fournier, Sophie Benech et Luba Jurgenson, préface de Luba Jurgenson, postface de Michel Heller, Éditions Verdier, 2003. 2 Evguénia S. Guinzbourg, Le vertige, Paris, Seuil, 1997 ; Evguénia S. Guinzbourg, Le Ciel de la Kolyma, Paris, Seuil, 1997. Les deux volumes que nous citons ici repré-sentent la traduction française du volume original russe Kpymoй мapшpym (I, II), qui circulait dans le samizdat depuis 1967 et qui paraîtra pour la première fois en 1979, en Italie, aux Éditions Mondadori. 3 Voir Anne Applebaum (éd.), Gulag Voices, New Haven, Yale University Press, 2011 et Simeon Vilensky, John Crowfoot, Zayara Vesyolaya (éd.), Till me tale is told : women’s memoirs of the Gulag, Bloomington : Indiana University Press, 1999. 4 Sidney Hook, « The Literature of disillusionment », dans Julien Steiberg (éd.), Ver-dict of Three Decades : from the Literature of Individual Revolt against Soviet Communism : 1917-1950, Ayer Publishing, 1971, p. 604-621.
70
siastes de certains esprits rêveurs séduits par l’image de la justice so-ciale et la révolte contre la tradition. Il s’agit de ceux qui, initialement, saluaient avec optimisme, au nom de l’avenir, le nouvel échafaudage politique, la volonté souveraine de l’élite révolutionnaire et la soumis-sion de « la réalité » par le langage théorique d’une philosophie de l’action. Ils sont eux-mêmes des « esprits révolutionnaires » dans l’art et la pensée. Certains d’entre eux vont s’impliquer directement dans la nouvelle manière de faire de la politique, d’autres vont militer par leurs écrits en faveur de l’Union Soviétique. Mais la désillusion ne tardera pas longtemps. Les bruits sur les horreurs qui se passent dans le pays du « rêve d’or de l’humanité » recevront bientôt une confirmation sure. Une partie de ces écrivains militants sont déçus d’abord aux contacts directs avec le « pouvoir soviétique », contacts qu’ils ont pendant la Guerre Civile espagnole (Spender, Orwell, Dos Passos). D’autres, tels Gide et Istrati, ne se laissent pas séduire par les images de carton du « bien-être » et de la « liberté » de l’Union Soviétique. D’autres sont condamnés à supporter directement la répression (Ciliga). Mais tous finissent par devenir conscients de la « misère de l’utopie »1 et ils ex-priment ouvertement leur déception.
Au cadre de ces multiples dissonances entre la projection uto-pique et la réalité cruelle, entre la rhétorique de l’idéal et la pauvreté bien palpable, entre les images abstraites du bonheur et l’horreur con-crète de la peur qui terrorise l’individu naissent les premières images « littéraires » de l’univers concentrationnaire soviétique, qui vont deve-nir les éléments d’impact d’une conscience critique en rapport avec cette réalité historique. Des romans comme Le Zéro et l’Infini [Dark-ness at Noon] (1940) d’A. Koestler ou La Ferme des animaux (1945) de G. Orwell deviendront, par leurs qualités littéraires et l’habileté de leurs auteurs à reconstituer les vérités choquantes de l’univers du men-songe, la voix d’une conscience critique européenne, laquelle sera capable d’ajouter une force d’impact à toutes les relations précoces sur le goulag soviétique ; ainsi ces romans pourront-ils maintenir éveillée la conscience occidentale sur ce phénomène.
C’est ainsi que, si la guerre et, à sa fin, les horreurs intensément médiatisées de l’holocauste semblent avoir éliminé de l’agenda pu-blique les soucis occidentaux concernant le goulag soviétique, ce silence na va pas durer longtemps. Peu après la fin de la guerre, avec
1 Cf. Vladimir Tismăneanu, Mizeria utopiei : criza ideologiei marxiste în Europa Răsăriteană, Iaşi, Polirom, 1997.
71
les premiers signes de la « guerre froide », on commence à rassembler de nouveaux détails du dossier de l’univers carcéral soviétique. Les premiers témoignages apparaissent avec ce que l’on pourrait appeler « la vague polonaise ». Il s’agit des Polonais arrêtés ou déportés d’abord, après l’invasion soviétique en Pologne (en septembre 1939) et libérés ensuite pour qu’ils puissent se faire enrôler dans l’armée du gé-néral Władysław Anders, qui a lutté à côté des troupes alliées. Les témoignages de certains déportés et/ou incarcérés seront recueillis par Zoe Zajdlerowa, dans le volume préfacé par T.S. Eliot en 1946, intitulé The Dark Side of the Moon1. Les narrations des anciens déportés en-voyées au Bureau de documentation de l’armée du général Anders seront aussi intégrées dans le volume La justice soviétique2, paru à Rome en 1945, ou dans le volume de D. J. Dallin et B. Nicolaevski, Forced Labour in Soviet Russia3, paru en 1947 aux États-Unis. Le phé-nomène appelé métaphoriquement « la vague polonaise » atteint son point culminant par la parution en 1951 du livre de Gustaw Herling-Grudziński intitulé A World Apart4, qui est non seulement le témoi-gnage d’un survivant de l’univers concentrationnaire soviétique, mai aussi un plaidoyer contre toute forme de compromis devant un système corrompu. La personnalité puissante de cet écrivain, son appel à une morale de la liberté de l’individu et sa prose où les figures lumineuses dominent les personnages ténébreux transforment son livre en un point de départ dans le processus de reprise et récupération de l’ample dos-sier qui s’opposait à un système criminel et qui paraissait avoir été oublié pendant la guerre.
D’autres remémorations de l’expérience carcérale viennent af-fermir les témoignages des écrivains de la « vague polonaise » pendant
1 Le volume de 1946 paraîtra comme un corpus de relations anonymes, sans porter, au moins, le nom de l’auteure. C’est en 1990 que va paraître une édition plus récente : Zoe Zajdłerowa, The Dark Side of the Moon, Prentice Hall – Harvester Wheatsheaf, 1990. Il y a dans ce volume des documents sur les vagues des déportations des Polo-nais ; on y trouve aussi la présentation des éléments, devenus typiques, du monde concentrationnaire : le calvaire du voyage, la faim, le froid, les exécutions et les tenta-tives d’endoctrinement. 2 Kazimierz Zamorski, Pietro Zwierniak, La justice soviétique, Rome, Magi-Spinetti, 1945. 3 David J. Dallin, Boris I. Nikolaevsky, Forced Labour in Soviet Russia, New Haven, Yale University Press, 1947. 4 Gustaw Herling-Grudziński, A World Apart : Imprisonment in a Soviet Labor Camp During World War II, Penguin Books, 1996. Le volume de 1951 bénéficie de la pré-face de Bertrand Russel.
72
les années d’après-guerre. Julius Margolin, Juif russe émigré en Pales-tine, se trouvait en Pologne pour rendre visite chez des parents, quand la guerre avait éclaté. Réfugié dans la partie « soviétique » de la Po-logne, il est arrêté pour espionnage et passe cinq ans de détention dans l’Union Soviétique, période dont il fait une relation troublante dans le volume La condition inhumaine1, paru en 1949 à Paris et rédigé dans la tonalité de celui qui demande désespérément de l’aide au nom des sur-vivants. Margarete Buber-Neumann, épouse d’un communiste allemand réfugié dans l’Union Soviétique en 1933, sera arrêtée en 1937, pendant la « grande terreur ». Son mari est fusillé. Détenue dans un camp de Karaganda, elle sera rendue aux autorités nazies en 1940, avec un grand nombre de communistes allemands, à la suite du pacte Ribbentrop – Molotov. À la fin de la guerre, elle se trouvait dans le camp nazi de Ravensbrück. Les expériences vécues à l’intérieur des systèmes concentrationnaires des deux régimes totalitaires du siècle passé seront relatées dans le volume Als gefangene bei Stalin und Hi-tler2, paru en 1948 en Allemagne. Julius Margolin, Margarete Buber-Neumann et beaucoup d’autres voix3 feront renaître l’intérêt de l’opinion publique occidentale pour la réalité concentrationnaire sovié-tique, intérêt doublé par une perspective critique sur l’idéologie totalitaire qui l’avait engendrée.
La même perspective critique donnera naissance, tout de suite après la seconde guerre, à un phénomène important : l’inauguration d’une lignée de pensée qui va soumettre à l’analyse l’univers concen-trationnaire au XXe siècle suivant une dimension transversale, à savoir l’étude parallèle des deux idéologies extrêmes, le nazisme et le com-
1 Le livre est écrit en 1947, mais il est publié en traduction française en 1949 : La condition inhumaine. Cinq ans dans les camps de concentration soviétiques, Calman Lévy. Une édition complète va paraître en 2010 : Julius Margolin, Voyage au pays des Ze-Ka, traduit du russe par Nina Berberova, Mina Journot, révisée et complétée par Luba Jurgenson, Paris, Éd. Le bruit du temps, 2010. 2 Margarete Buber-Neumann, Als gefangene bei Stalin und Hitler. La traduction en anglais (Under two Dictators) et en français (Déportée en Sibérie) paraissent en 1949 (cf. Margarete Buber-Neumann, Under Two Dictators. Prisoner of Stalin and Hitler, London, Pimlico, 2008). 3 Victor Kravchenko, I Choose Freedom (1946), Jerzy Gliksman, Tell the West : An Account of his Experiences as a Slave Laborer in the Union of Soviet Socialist Repu-blics (1948), El Campesino (Valentín González), Listen Comrades : Life and Death in the Soviet Union (1952), Vladimir Petrov, Soviet Gold (1949) şi My Retreat from Russia (1950), Nicholas Prychodko, One of the Fifteen Millions (1952) (v. Leona Toker, Return from the Archipelago, éd. cit., p. 37-45).
73
munisme1. La voix accusatrice de cette perspective, intensifiée par la rhétorique tranchante spécifique aux débuts de la guerre froide, ainsi que la vague de plus en plus grande de témoignages et d’analyses du phénomène concentrationnaire soviétique représentent le contexte dans lequel, après la mort de Staline (mars 1953), les officialités soviétiques se sentiront obligées d’agir pour réparer en quelque sorte l’image inter-nationale négative de leur pays. On assiste ainsi à l’inauguration d’un processus de déstalinisation qui mènera à un « dégel » dans la politique interne soviétique, dont l’apogée sera le célèbre « Discours secret (Sur le culte de la personnalité et ses conséquences) » ou « Le Rapport Khroutchev » (février 1956). La conséquence la plus importante du processus de déstalinisation sera, bien sûr, la mise en liberté des déte-nus qui se trouvaient encore dans les camps, la réhabilitation politique de la plupart d’entre eux et le démantèlement en grande partie de la machinerie concentrationnaire. « Le dégel » de l’époque Khroutchev permettra la publication, en 1962, du roman Une journée d’Ivan Denis-sovitch d’Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne, ouvrage qui donnera une image artistique sublimée du monde du goulag, en présentant la lutte pour survivre du personnage central, Ivan Denissovitch Choukhov. Par ses détails minutieux et par la précision de la construction romanesque, l’expression artistique de cette lutte porte l’empreinte d’un vrai hymne dédié à l’humanité, dans sa lutte disproportionnée avec le mal représen-té par les mécanismes de l’univers concentrationnaire. Le roman de Soljenitsyne est tout de suite traduit et publié dans presque toutes les langues de l’Europe, y compris une grande partie des langues des na-tions est-européennes2. Ce roman donnera ainsi une véritable impulsion au besoin de nombreux survivants d’exorciser leurs souffrances.
La mise en liberté de la majorité des victimes du goulag vers la fin des années ’50, citoyens soviétiques ou étrangers, aura pour résultat, dans la période suivant la parution du roman de Soljenitsyne, une acti-vité de plus en plus ample de publication de mémoires, activité qui ne pourra pas être interrompue par la disparition de l’attitude « libérale » des autorités soviétiques après l’élimination de Khroutchev du pouvoir (en 1964). Si officiellement le sujet du goulag cesse d’exister en Union
1 Voir, par exemple, le livre de 1951 d’Hanna Arendt, Les origines du totalitarisme (trad. roumaine : Originile totalitarismului, Bucureşti, Humanitas, 1994, v. tout spé-cialement la IIIe partie, « Totalitarismul », p. 403-621). 2 À l’exception de la Roumanie et de l’Allemagne de l’Est, le roman est publié dans toutes les langues du bloc communiste.
74
Soviétique après 1964, les publications clandestines de la « sous-terraine intellectuelle » (samizdat)1 et leurs réflexes dans l’espace pu-blique occidental (tamizdat)2 vont permettre la recomposition documentaire des repères de la mémoire traumatisée, repères engendrés par les souffrances des rescapés du goulag soviétique. L’Archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne3, première synthèse ample du goulag, combinant les réflexes de la mémoire traumatisée et les expériences de l’auteur et de ses 227 camarades de souffrance, dont les témoignages offriront du matériau documentaire, sera écrite entre 1958 et 1968 et elle sera publiée pour la première fois en traduction anglaise, en 1973. Cette vaste remémoration des réalités du goulag, aux accents émotion-nels troublants, issus d’expériences personnelles ou collectives, nourris par la documentation et transfigurés par un grand talent littéraire repré-sentera un véritable tournant dans la conscience publique européenne par rapport au phénomène concentrationnaire soviétique et suscitera, en même temps, un immense intérêt documentaire pour le vaste domaine des mémoires, qui reste encore à décrire et à analyser. Textes de reference: ***, Out of the deep; letters from soviet timber camps, London, G. Bles,
1933. Iulia de Beausobre, The Woman Who Could Not Die, London, Chatto and
Windus, 1938. Youri Bezsonov, Mes vingt-six prisons et mon évasion de Solovki, traduit du
russe par E. Semenoff, Paris, Payot, 1928. Margarete Buber-Neumann, Under Two Dictators. Prisoner of Stalin and
Hitler, London, Pimlico, 2008. Boris Cederholm, In the Clutches of Tcheka, New York, Houghton, 1929. Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, nouvelle édition intégrale, traduit par
Catherine Fournier, Sophie Benech et Luba Jurgenson, préface de Luba Jurgenson, postface de Michel Heller, Éditions Verdier, 2003.
Ante Ciliga, The Russian Enigma, London, Labour Book Service, 1940. Iulia Danzas, Bagne rouge: Souvenirs d'une prisonnière au pays des Soviets,
Juvizy, Les Éd. du Cerf (Centre dominicain d'études russes), 1935.
1 « Œuvres » reproduites à la main et diffusées clandestinement (« auto-publiées »). 2 Publication de certains textes samizdat en Occident (« publication là/au-delà »). 3 Alexandre Soljénitsyne, L'Archipel du Goulag 1918-1956 : essai d'investigation littéraire, traduit par Geneviève Johannet t. I-II, Paris, Fayard, 2010-2011.
75
Alexander Dolgun (with Patrick Watson), Alexander Dolgun’s Story: An American in the Gulag, New York, Ballantine, 1976.
Raymond Duguet, Un bagne en Russie rouge, Paris, Balland, 2004. Evguénia S. Guinzbourg, Le vertige, Traduit du russe par Bernard Abbots,
Paris, Seuil, 1997; Evguénia S. Guinzbourg, Le Ciel de la Kolyma, Traduit du russe par Gene-
vieve Johannet, Paris, Seuil, 1997. Gustaw Herling-Grudziński, A World Apart: Imprisonment in a Soviet Labor
Camp During World War II, Penguin Books, 1996. Andrew Kalpashnikoff, A Prisoner of Trotsky’s, Garden City, New York,
Doubleday – Page & Company, 1920. G. Kitchin, Prisoner of the OGPU, London – New York – Toronto, Long-
mans, 1935. S. A. Malsagoff, An Island Hell: A Soviet Prison in the Far North, Translated
by F. H. Lyon, London, A. M. Philpot LTD, 1926. Julius Margolin, Voyage au pays des Ze-Ka, traduit du russe par Nina Berbe-
rova, Mina Journot, révisée et complétée par Luba Jurgenson, Paris, Ed. Le bruit du temps, 2010.
Ludovic Naudeau, En prison sous la terreur russe, Paris, Librairie Hachette, 1920.
Ivan Solonevich, Russia in Chains: A Record of Unspeakable Suffering, Lon-don, Williams and Norgate Ltd., 1938.
Tatiana Tchernavin, Escape from the Soviets, New York, E. P. Dutton & CO, Inc., 1934.
Vladimir V. Tchernavin, I Speak for the Silent (Prisoners of the Soviets), Bos-ton - New York, Hale, Cushman & Flint, 1936.
Bibliographie: Anne Applebaum, Gulagul. O istorie, traducere de Simona-Gabriela Vărzan şi
Vlad Octavian Palcu, Bucureşti, Humanitas, 2011. Anne Applebaum (ed.), Gulag Voices, New Haven, Yale University Press,
2011; Louis Aragon, Pour un réalisme socialiste, Paris, Ed Denoël et Steele, 1935. Hanna Arendt, Originile totalitarismului, traducere de Ion Dur şi Mircea
Ivănescu, Bucureşti, Humanitas, 1994. Nick Baron, « Conflict and Complicity: The expansion of the Karelian Gulag,
1923-1933 », Cahiers du monde russe, 2001/2-3-4, Vol 22, p. 615-648.
Robert Conquest, Marea teroare, traducere de Marilena Dumitrescu, Bucureşti, Humanitas, 1998.
76
Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean Louis Margolin, Le livre noir du communisme. Crimes, terreur et répression, Paris, Éditions Robert Laffont, 1997.
David J. Dallin, Boris I. Nikolaevsky, Forced Labour in Soviet Russia, New Haven, Yale University Press, 1947.
Orlando Figes, The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia, London, Pen-guin, 2007.
Michael Fox, « Ante Ciliga, Trotskii, and State Capitalism: Theory, Tactics, and Reevaluation during the Purge Era, 1935-1939 », in Slavic Re-view, Spring 1991, Vol. 50, Issue 1, p. 127-143.
François Furet, Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunistă în secolul XX, traducere de Emanoil Marcu şi Vlad Russo, Bucureşti, Humani-tas, 1996.
Paul R. Gregory, Valery Lazarev (ed.), The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag, Hoover Institution Press Stanford University, Stan-ford, 2003.
Danilo Kiš, Un tombeau pour Boris Davidovich, Paris, Gallimard, 1979. Willemina Kloosterboer, Involuntary labour since the abolition of slavery,
Leiden, E.J. Brill, 1960. Stephen Koch, La fin de l’innocence : Les intellectuels d’occident et la tenta-
tion stalinienne : 30 ans de guerre secrète, Paris, Grasser, 1995. George Leggett, The Cheka : Lenin’s Political Police, Oxford University
Press, 1987. Jean-Jacques Marie, Le Goulag, Paris, PUF, 1989. Alexandre Soljénitsyne, L'Archipel du Goulag 1918-1956 : essai d'investiga-
tion littéraire, traduit par Geneviève Johannet t. I-II, Paris, Fayard, 2010-2011.
Alexandr Soljeniţîn, Arhipelagul Gulag, 3 volume, traducere şi note de Nico-lae Iliescu (vol. I şi III) şi Ion Covaci (vol. II), Bucureşti, Univers, 2008.
Julien Steinberg (ed.), Verdict of Three Decades: from the Literature of Indi-vidual Revolt against Soviet Communism: 1917-1950, Ayer Publishing, 1971.
Vladimir Tismăneanu, Mizeria utopiei: criza ideologiei marxiste în Europa Răsăriteană, Iaşi, Polirom, 1997.
Leona Toker, Les mémoires tardifs du Goulag ou l’amendement de contextes historiques, în Anne-Marie Pailhès (éd.), Mémoires du Goulag, Pa-ris, Editions Le Manuscrit, 2004, p. 97-130.
Leona Toker, Return from the Archipelago: Narratives of Gulag Survivors, Bloomington, Indiana University Press, 2000.
Tzvetan Todorov, Confruntarea cu extrema : victime şi torţionari în secolul XX, traducere de Traian Nica, Bucureşti, Humanitas, 1996.
77
Simeon Vilensky, John Crowfoot, Zayara Vesyolaya (éd.), Till my tale is told: women's memoirs of the Gulag, Bloomington: Indiana University Press, 1999.
Nicolas Werth, Histoire de l'Union soviétique de Lénine à Staline, 1917-1953, Paris, PUF, 1995.
Zoe Zajdlerowa, The Dark Side of the Moon, Prentice Hall - Harvester Wheatsheaf, 1990.
Kazimierz Zamorski, Pietro Zwierniak, La justice soviétique, Rome, Magi-Spinetti, 1945.
78
RÉCITS SUR L’UNIVERS CONCENTRATIONNAIRE ROUMAIN
Maria TERTECI
L'expansion du communisme. L’instauration du ré-gime communiste en Roumanie
Les circonstances de la Seconde Guerre Mondiale offrent à l’URSS, par les situations créées, la possibilité de son extension géopo-litique. Staline commence une politique agressive d’expansion dans les états voisins. Le Parti Communiste Roumain arrive dans ces circons-tances sur la scène politique, en sortant « de la périphérie de la vie politique roumaine»1 où il avait stagné depuis l’interdiction imposée par le gouvernement le 11 avril 1924.
« [Le Parti Communiste Roumain] est sorti de l’illégalité en 1944, ayant un minuscule nombre d’adeptes, et encore il a réussi, après 1945, par fraude et manipulation, derrière le bouclier protecteur de l’Armée Rouge, à devenir de plus en plus influent, en éliminant ses rivales politiques lentement, mais surement. »2
1 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghe Georghiu Dej și statul polițienesc, 1948-1965, [La terreur communiste en Roumanie. Gheorghe Dej Georghiu et l'état policière, 1948-1965], Iași, Polirom, 2001, p. 15. 2 Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Raport final, Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, [Rapport final de la Commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste en Roumanie], București, Humanitas, 2007, p.55 (n.t.).
79
Par le biais des organisations de façade (comme le Bloc Ouvrier Paysan) le parti attire de plus en plus de membres et les changements apportés par cette deuxième conflagration mondiale le propulsent non seulement sur la scène politique, mais aussi dans la vie sociale. Beau-coup de citoyens sont captivés par les grands idéaux que ce projet politique véhicule. Ainsi, à partir de seulement 1000 membres qu'il comptait dans tout le pays en août 1944, « en trois mois, jusqu’en oc-tobre 1944, le PCR avait déjà atteint 15000 membres, et jusqu'au 23 avril 1945 leur nombre était monté à 42.653 »1. Le régime communiste, comme tout mouvement totalitaire s’appuie sur les masses : « Les mouvements totalitaires sont possibles partout où il y a des masses qui, pour une raison ou pour une autre, ont développé le goût pour l’organisation politique »2. Le Parti Communiste Roumain réussit à attirer les masses, qu’il utilisera à l’appui de ses actions.
Une série de changements politiques a lieu et au gouvernement du pays alternent différentes formations politiques, ce qui a comme résultat un climat d’instabilité et d'incertitude. Dans la conception géné-rale des politiciens roumains, peu importait le moyen par lequel on obtenait le pouvoir, l'important était de le détenir.
Le coup d’état du 23 août 1944 a comme conséquence le ren-versement du gouvernement conduit par le général Antonescu. À ce renversement politique participent le roi Mihai I de Hohenzollern, les partis démocratiques de l’entre-deux-guerres et aussi les communistes. Le ralliement de la Roumanie aux Alliés, même si souhaité, n’a été réalisé que le 12 septembre. Pendant cet intervalle de trois semaines, la Roumanie était encore resté un ennemi pour les Alliés et, d’autre part, elle était déjà considérée comme un adversaire par l’Allemagne, parce qu’elle avait retourné les armes contre son ancien camp. Cette situation d’incertitude attire de graves conséquences pour la Roumanie, particu-lièrement par rapport à l’URSS, qui exprime des prétentions non seulement matérielles, mais aussi politiques.
Pendant les huit mois qui suivent le renversement du général Antonescu, trois gouvernements se succèdent : Le Gouvernement Constantin Sănătescu (23 août - 2 novembre 1944), le second Gouver-nement Sănătescu (4 novembre - 2 décembre 1944) et le Gouvernement dirigé par le général Nicolae Rădescu (6 décembre 1944 - 28 février 1945). Ce dernier gouvernement était composé par le Vice-président du
1 Idem, Ibidem, p.56. 2 Hannah Arendt, L’origine du totalitarisme, Humanitas, București, 1994, p.411.
80
Conseil des Ministres, Petru Groza, le ministre de la Justice, Lucrețiu Pătrășcanu, le Ministre de la Production de Guerre, Constantin C. Brătianu, le Ministre des Communications, Gheorghe Gheorghiu-Dej et bien d'autres. Ces noms auront des résonances dans les années sui-vantes sur la scène politique roumaine.
Le Ministère Nicolae Rădescu, ayant pour secrétaire Adriana Georgescu, est écarté du pouvoir, et le 6 mars 1945 le Gouvernement Groza (6 mars 1945 - 30 décembre 1947) « est imposé sous la pression directe d'A. I. Vîșinski, l'ambassadeur soviétique à Bucarest »1. En 1948 sera instaurée la dictature de Gheorghe Gheorghiu Dej.
Après que la Roumanie a renoncé à son alliance avec les puis-sances de l'Axe, un moment important est l’entrée officielle des troupes soviétiques dans Bucarest, le 30 août 1944. Nicolae Ceaușescu leur souhaitera la bienvenue, tandis que le groupe d'Antonescu sera expatrié et mené en prison à Loubianka.
Une fois arrivés au pouvoir, les communistes vont occuper les postes de décision dans le pays entier et, à la demande du PCR, des syndicats communistes sont constitués pour chaque fabrique ou institu-tion. On établit le contrôle des publications, de la culture et de la correspondance. Le 21 septembre est lancé le journal « Scânteia », or-gane de propagande et de support du PCR. La législation de la Roumanie est elle aussi lentement changée pour que les représentants du pouvoir puissent justifier leurs actions de répression sur la popula-tion.
La Roumanie devient une copie fidèle de l'URSS, la modalité d'instauration de la dictature communiste respecte exactement le mo-dèle soviétique : on interdit des auteurs, des journaux, de nombreux intellectuels sont épurés des institutions, on essaye de supprimer le Par-ti National Paysan et le Parti National Libéral afin de concentrer le pouvoir tout entier dans les mains des communistes qui commencent déjà à s'imposer dans la plupart des mairies et des préfectures du pays. Dans le même temps, est créé à Târgu-Jiu un camp de concentration destiné aux représentants de l'opposition. Après la création des forma-tions syndicales des travailleurs on organise des meetings procommunistes pour agiter la scène politique et sociale et pour déter-
1 Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Raport final, Comisia prezidențială pentru analiza dictaturii comuniste din România, [Rapport final de la Commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste en Roumanie], București, Humanitas, 2007, p.58.
81
miner des changements gouvernementaux. On souhaitait, en fait, le licenciement du gouvernement et la réorganisation des ministères afin d'obtenir une majorité communiste. Ainsi, le 4 novembre, est créé à Bucarest un nouveau gouvernement Sănătescu qui, malgré l'opposition de Sănătescu lui-même, aura encore plus de communistes dans sa struc-ture.
Le 6 décembre un nouveau gouvernement est formé, le gouver-nement Rădescu. Tout de suite après, arrivera en Roumanie Alexandru Vîșinski, mécontent des changements en cours, que l'URSS voulait encore plus radicaux. Son arrivée dans le pays provoque des actes de violence contre la population : on crée des tribunaux populaires qui jugeront les personnes arrêtées pour tout délit, quelle qu'en soit la gra-vité. Iuliu Maniu et Dinu Brătianu s'opposent aux actions dictées par le PCR, c'est la raison pour laquelle ils seront finalement condamnés et mourront dans la prison de Sighet: « Le matelas sur lequel il dormait (Iuliu Maniu) avait pourri ; tout comme ses vêtements et comme sa peau qui recouvrait à peine ses os. Je l’ai levé un peu. Sous lui grouil-laient des vers blancs. Ils sont restés accrochés à la plaie de la hanche, grands, gras, côte à côte, suçant le peu sang qui lui restait encore. »1
Au début de février 1945, les communistes commencent des campagnes contre le gouvernement Rădescu, par la préparation des meetings et par la formation des agitateurs. Le 24 février, le siège du Ministère de l'Intérieur est pris d'assaut par des manifestants furieux, membres des syndicats du PCR, dirigés par Gheorghe Gheorghiu Dej et Theohari Georgescu. Une diversion est créée, on tire sur le ministre et puis un autre groupe de communistes tirent sur les manifestants. Ces actions sont censées permettre d’accuser Rădescu d'avoir ouvert le feu sur de simples manifestants.
Le 1er mars 1945, Vîșinski, l'adjoint du ministre soviétique des Affaires étrangères, revient à Bucarest pour demander au roi Mihai I la destitution de Rădescu. Le roi est menacé avec la suppression de l'indé-pendance en cas d'opposition ; ainsi, le gouvernement Rădescu est remplacé par un nouveau gouvernement dirigé par Petru Groza, en con-formité avec la volonté des Soviétiques. Le désir de l’URSS de s’imposer comme unique décideur sur la scène politique roumaine se réalise grâce aux membres du Parti Communiste Roumain, qui sont
1 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conștiința românească : memorialistica și literatu-ra închisorilor și lagărelor, [Le Goulag dans la conscience roumaine. Les mémoires et la littérature des prisons et des camps communistes], Iași Polirom, 2005, p.194.
82
prêts à recourir à tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Ainsi, le 19 novembre 1946, les élections sont fraudées, mais le gouvernement résultant des élections est accepté sur la scène internationale, y compris par les États-Unis et le Royaume-Uni.
Après ces changements radicaux effectués dans la politique in-terne, Ana Pauker (PCR) et Evgueni Suhalov (PC URSS) se rencontrent à Bucarest afin d'établir un avenir sombre pour la Rouma-nie : l'interdiction des étrangers qui ne font pas partie du grand groupe soviétique sur le territoire de la Roumanie, l'expropriation des proprié-taires, l'abdication forcée et l'exil du roi, la liquidation des banques privées, l'abolition de la structure traditionnelle de l’armée et aussi l'in-dustrialisation forcée de l'économie.
L'une des figures centrales du communisme roumain, Gheorghe Gheorghiu-Dej, s’impose sur la scène politique roumaine après une période assez tumultueuse. Dans l’année 1933 il était arrêté et condam-né à la prison, à cause de sa participation aux grèves de cette année-là. Il expie sa peine dans la prison de Doftana. Il est élu membre du CC du PCR, devenant le chef du PCR en prison. Étant leader communiste, il est transféré au camp de Târgu Jiu pendant le régime d'Antonescu. En août 1944, à l'aide de Gheorghe Maurer, Gheorghe Gheorghiu-Dej s'échappe de prison et, en 1945, il est élu Secrétaire général du Parti Communiste Roumain. Pour consolider son pouvoir, Dej éliminera les opposants politiques, parmi lesquels se trouvaient Ștefan Foriș et Lucrețiu Pătrășcanu1.
Dans une période d'incertitude du point de vue politique, lors-que les détenteurs du pouvoir ne cessent pas de se relayer, toute action, tout geste peut recevoir des interprétations négatives, et le simple fait d'être vu près d'un politicien fait qu'on soit classé dans une certaine catégorie politique, ce qui peut attirer à l'intéressé des années d'empri-sonnement. La plupart des politiciens de l'époque considéraient que, pour arriver au pouvoir, ils devaient éliminer les leaders précédents, ainsi que leurs adversaires compétents, qui pouvaient constituer une forte concurrence. En suivant le plan proposé par les soviétiques, le 30 décembre 1947, Petru Groza et Gheorghe Gheorghiu-Dej demandent l'abdication du roi Michel Ier, au cas contraire menaçant de déclencher
1 À cause des relations de collaboration professionnelle, mais aussi d'amitié, entrete-nues avec la famille Pătrășcanu, Lena Constante et Harry Brauner, dont on parlera dans les pages suivantes, seront arrêtés et condamnés.
83
une guerre civile. Le roi accepte d'abdiquer et ainsi la Roumanie de-vient la République Populaire de Roumaine.
Les partis politiques de l'opposition, le Parti National Paysan et le Parti National Libéral, sont dissous. L’année 1947 est marquée, en effet, par des actions censées intimider l'opposition, par de faux procès, par la terreur ; suivra, aussi, une oppression cruelle des citoyens : on inflige à la population un sentiment de terreur suprême, d'oppression, en opérant des arrestations massives parmi les jeunes intellectuels, membres des organisations anticommunistes.
Le 30 Août 1948, par le décret numéro 221 de 1948, on crée la Securitate, la Direction Générale de la Sécurité du peuple, dirigée par Gheorghe Pintilie (de son vrai nom Panteleimon Bodnarenco), et ayant comme adjoints Vladimir et Alexander Nicolski Mazuru ; celui-ci re-présentant le véritable instrument par lequel le Parti Communiste Roumain a exercé la terreur. La Securitate avait plusieurs directions par lesquelles elle réalisait la surveillance stricte des citoyens pour mainte-nir le contrôle absolu dans le pays. Les employés de la Sécurité étaient, d'abord, strictement supervisés par des conseillers soviétiques qui avaient le rôle de les instruire.
Après cette période d'instauration du communisme, suivra, pen-dant environ une vingtaine d'années, une étape de renforcement législatif du système, réalisée par l'émission d'ordres et de décrets cen-sés permettre aux représentants du pouvoir de générer le cadre d'application de la répression. La loi principale qui justifiait les crimes du régime était la loi numéro 16/1949. On réintroduisait ainsi la peine capitale pour ceux qui mettaient en danger la sécurité intérieure de l'état. Dorin Dobrincu souligne le fait que le système ne se limitait pas à respecter les lois. Ainsi, souvent, les principales lois étaient complétées par des sous-articles spéciaux, dont la plupart secrets, par lesquels on légalisait les abus de la part du pouvoir politique contre ses citoyens1.
La plupart du temps, ces abus visaient toute une catégorie hu-maine et non seulement certaines personnalités. Après 1948, l’institution qui s'occupait de la mise en œuvre de la nouvelle loi était la Direction Générale de la Sécurité du Peuple. Son rôle était « la défense des acquis démocratiques et l'assurance de la sécurité de la RPR contre
1 Dorin Dobrincu (editor), Listele morții. Deținuți politici decedați în sistemul carce-ral din România potrivit documentelor Securității, 1945-1958, [Les listes de la mort. Les prisonniers politiques qui sont morts dans le système pénitentiaire de la Rouma-nie selon les documents de la sécurité 1945-1958], Iași, Polirom, 2008, p. 14.
84
l'ennemi interne et externe. »1 Ainsi, le Parti Communiste Roumain, coordonné par les Soviétiques, qui resteraient dans le pays jusqu'en 1958, préparait une forte répression contre tous ceux qui constitueraient un potentiel danger.
Parmi les catégories soumises à la répression, il y avait, en par-ticulier, la résistance antisoviétique organisée dans les montagnes, les paysans qui essayaient de s'opposer à la collectivisation, les intellec-tuels, les propriétaires de toute sorte, les différents groupes ethniques et aussi les membres du clergé orthodoxe et catholique. Tous ces « élé-ments dangereux » seront placés dans le vaste goulag roumain, selon le bon vouloir des autorités.
*
À la création du système des camps soviétiques, « le mot Gou-
lag était l'acronyme du syntagme Glavnoie Upravlenie Lagerei, c'est-à-dire l'Administration Générale des Camps. » Au fil du temps, le mot a spécialisé son sens, lui adjoignant l'idée de travail forcé, et aussi celle d'actions répressives du régime soviétique contre les détenus. Le Gou-lag est devenu un système de plus en plus développé et complexe, ayant beaucoup de lotissements et de secteurs pour permettre de mieux ex-ploiter la main-d'œuvre des prisonniers disponibles. Grâce à cette politique d'exploitation, on a réussi, en quelques années, à en faire une importante composante de l'économie. Le Goulag devient un univers parallèle à celui de la vie courante, un univers des personnes marginali-sées du point de vue social et spatial, un monde des individus qui sont eux-mêmes conscients du processus de déshumanisation auquel ils sont soumis. Ce caractère marginal attribué aux camps impose des règles différentes de celles qui régissent la vie quotidienne : des règles inhu-maines appliquées aux détenus surexploités, qui vivent dans des conditions inadéquates, et qui subissent une violence exagérée compa-rativement à celle que l'on applique au reste de la société.
Le Goulag produit un nouveau type humain : l'individu désespé-ré et accablé par la douleur qui, pour se sauver, fait appel soit à une violence gratuite pratiquée envers tous, sans destination précise, soit à une forme d'évasion mentale dans un univers parallèle, utopique. Par
1 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, [Archives du Conseil national pour l'étude de la Securité] fond d'archives documentaires, dossier 55, vol.51, ff. 70-71., apud Dorin Dobrincu, op.cit, p.14.
85
son extension, le goulag roumain se compose de prisons, de camps de travail, de centres de déportation, de lieux de détention, d'enquête ou de torture, ou d'hôpitaux psychiatriques au caractère politique. Il faut re-marquer le fait qu'en Roumanie il n'y a pas de camps de travail, dans le vrai sens du mot, mais des colonies de travail.1 Les colonies de travail ont pour objectif « l'éducation » des détenus par le travail ; dans les colonies de travail, ainsi que dans les prisons, se retrouvent souvent des citoyens dont la peine a expiré, mais qui sont encore soumis à des abus, ce fait-ci reflétant la mauvaise organisation de la Direction générale des prisons, la DGP. En 1951, la DGP a changé son nom en « Direction Générale des Prisons, Colonies et Unités de travail », ultérieurement en « Direction Générale des Prisons et des Colonies de travail », ce qui atteste la diversité du système concentrationnaire en Roumanie.
Les prisons comportaient les départements suivants : « le bureau d'inspection, le corps de sécurité, le bureau des cadres, le bureau de comptabilité, le bureau administratif, l'infirmerie et le secrétariat. »2 ; les colonies de travail, les unités de travail et les unités de production étaient considérés comme des organismes externes et avaient presque la même structure que les prisons, avec, en plus, quelques départements au rôle économique et non seulement punitif.
Au cours des années, les prisons ont été classées selon les cri-tères et les besoins du système communiste. Le Rapport final sur la dictature communiste présente lui aussi une classification des prisons en fonction de la période de détention appliquée ; les détenus de droit commun étaient emprisonnés à Aiud et à Satu Mare ; les condamnés aux travaux forcés pour une durée limitée étaient reclus à Caransebeș, Sighet, Oradea et Craiova ; ceux qui étaient condamnés à une lourde peine de prison étaient emprisonnés à Arad et Alba Iulia ; les détenus ayant à purger des peines correctionnelles de moins de six mois se trouvaient emprisonnés à Abrud, Baia, Bârlad, Beiuș, Bistrița, Botoșani, Brașov, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Muscel, Do-rohoi, Făgăraș, Hațeg, Miercurea Ciuc, Odorhei, Oravița, Piatra Neamț,
1 Andrei Muraru dans «Au lieu de préface » au Dicționarul Penitenciarelor din Ro-mânia Comunistă (1945-1967), [Dictionnaire de penitenciaires communistes en Roumanie] Andrei Muraru (coordonateur), Clara Mareș, Dumitru Lăcătușu, Cristina Roman, Marius Stan, Constantin Petre, Sorin Cucerai, L’institut pour l'investigation des crimes communistes en Roumanie , Iași, Polirom, 2008. 2 Radu Ciuceanu (coordonateur), Regimul Penitenciar din România (1940-1962), [Le régime de détention en Roumanie (1940-1962) ], l'Institut national pour l'étude de totalitarisme , București, 2001, p.185 apud Andrei Muraru, op. cit., p. 33.
86
Râmnicu Sărat, Rădăuți, Roman, Sighișoara, Slatina, Sfântu Gheorghe, Târgoviște, Tecuci, Tulcea, Turda și Vaslui ; les détenus ayant reçu des peines correctionnelles de moins de 2 ans étaient emprisonnés à Brăila, Călărași, Caracal, Cluj Tribunal, Dej, Focșani, Giurgiu, Huși, Lugoj, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Târgu, Mureș et Turnu Severin ; ceux ayant à exécuter des peines correctionnelles de 2 à 12 ans étaient emprisonnés à Buzău, Brăila, Constanța, Deva, Galați, Ocnele Mari, Pitești, Sibiu, Timișoara și Văcărești ; la prison Dumbrăveni était destinée aux crimi-nels de guerre, celle de Zalău était réservée aux prisonniers politiques et Mislea était une prison spéciale pour les femmes. 1
On constate non seulement la complexité de ces espaces carcé-raux, mais aussi leur grand nombre, et la volonté des autorités de multiplier continûment ces espaces, pour augmenter la répression sur la population. Ainsi, les prisons communistes de l'époque stalinienne sont transformées en établissements carcéraux spécialisés pour offrir au sys-tème le contrôle sur les détenus.
Une autre classification est celle qui tient compte des effectifs de détenus et aussi de leur peine. Ainsi, il y a quatre catégories de péni-tenciers. La première catégorie de pénitenciers, parmi lesquels Aiud, Gherla et Jilava, est celle qui rassemble les détenus politiques les plus dangereux. La deuxième et la troisième catégorie sont destinées aussi aux détenus politiques, mais elles sont réduites comme surface et capa-cité : Galați, Târgșor, Mărgineni, Dumbrăveni et Mislea pour les femmes, Pitești pour les étudiants, Târgu Ocna et Văcărești qui fonc-tionnent comme des pénitenciers-hôpitaux. La quatrième catégorie contient la plupart des pénitenciers, ayant un effectif total de prison-niers plus réduit, et peu de détenus politiques.
Dans l’étude approfondie coordonnée par Andrei Muraru2, Dicționarul Penitenciarelor din România Comunistă (1945-1967), outre les prisons et les colonies de travail, très nombreuses, pour les hommes et aussi pour les femmes, on cite encore la catégorie de colo-nies réservées aux mineurs.
1 Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, [Commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste en Rou-manie. Le raport final], p. 564, nota 1. 2 Andrei Muraru (coordonateur), Clara Mareș, Dumitru Lăcătușu, Cristina Roman, Marius Stan, Constantin Petre, Sorin Cucerai, Dicționarul Penitenciarelor din Româ-nia Comunistă (1945-1967,) [Le Dictionnaire des prisons communistes en Roumanie (1945-1967)], L’institut pour l'investigation des crimes communistes en Roumanie, Iași, Polirom, 2008.
87
Ces colonies pour mineurs internaient des orphelins, des vaga-bonds et des mendiants, ainsi que des étudiants qui avaient violé les règlements de l'école. Ces colonies étaient structurées en conformité avec la décision numéro 1240 de 1951, selon l'âge et le sexe des en-fants.
Les jeunes prisonniers sont soumis aux mêmes traitements que les détenus adultes : la faim, la misère, la violence et aussi l'application des châtiments corporels pratiqués par d'autres mineurs condamnés, - une sorte de rééducation précoce. Des colonies des mineurs se trouvent à Bucarest, Dej, Târgu Ocna, Budila, Roșu, Arad, Brâncovenești, Iași, Alexandria, Slatina.1 L'existence des colonies pour mineurs en Rouma-nie suit le modèle soviétique en matière de centres de destruction de l'humanité, raconte Evguenia Guinzbourg dans ses mémoires2.
Les images décrites par ceux qui ont vécu de telles expériences sont également sinistres dans les deux espaces (russe et roumain) : l’absence d'affection, l'incapacité de ressentir et d'éprouver de l'empa-thie, et aussi les privations de nourriture, transforment ces petits en créatures égoïstes, qui s'accrochent fortement à leur gamelle et qui mangent dans une position offensive chaque morceau de nourriture reçu, en utilisant de pain pour effacer la gamelle ou, souvent, lécher avec ferveur toute la nourriture. Ce comportement extrême est le pro-duit de l'espace angoissant de la prison vaste et cruelle, représentée par tout l'espace soviétique. Sur les caractéristiques de cet espace et sur les traumatismes des victimes incarcérées entre les murs effrayants des prisons, mais aussi sur les victimes situées entre les barrières des camps, on a des informations détaillées, en particulier, grâce aux té-moignages écrits par des survivants.
Dans l'espace roumain, comme résultat de la terreur commu-niste, un grand nombre de citoyens ont été arrêtés et emprisonnés abusivment, en tant qu'« ennemis du peuple » ; sans aucun droit d’appel, ils ont été agenouillés par la violence, la faim, la misère et le froid. Des prisons ou des camps de travail, ces espaces placent le pri-sonnier en dehors de la société humaine, en les privant de tous les droits.
1. Arhivele Naționale Istorice Centrale, [Les Archives Nationale Centrale d’histoire] fond CC al PCR-dossier nr. 264 /1972, vol. IV, f. 335, apud Andrei Muraru, op. cit. p. 67. 2 Evguenia Guinzbourg, Le ciel de la Kolyma, Le vertige-Tome 2, Paris, Editions du Seuil, 1980.
88
Dans Dicționarul închisorilor comuniste din România (1945-1967), [Le Dictionnaire des prisons communistes en Roumanie (1945-1967)], les auteurs ont enregistré et décrit en détail quelque 140 prisons roumaines, colonies de travail, unités de travail et unités d'enquête. En y ajoutant les asiles psychiatriques de nature politique et les centres de déportation, les auteurs du livre Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune [Le livre noir du communisme] offrent, à la fin de cette recherche approfondie, une carte du Goulag roumain, réalisée par Eugen Șahan, qui compte environ 80 centres de détention auxquels on ajoute Bucarest et ses environs (30 sites), Le grand marais de Brăila et le Bărăgan (67 sites), la Dobrogea – Constanța et Le Canal, Tulcea (44 sites). On observe le désir du système de détenir le contrôle absolu en plaçant des centres de détention partout en Roumanie. Le grand nombre de ces pénitenciers signifie implicitement un grand nombre de victimes.
Le plus souvent, les arrestations se faisaient en masse. Elles vi-saient une catégorie entière ; par exemple le Ministère des Affaires de l'Interieur présentait « le 1er septembre 1961, un rapport sur les arresta-tions parmi les paysans dans les années 1951-1952. Le nombre total était de 34 738 paysans arrêtés. »1 La situation était donc alarmante, si l'on considère qu'en l'espace d'une année, on avait arrêté un nombre si important de personnes, toutes issues de la même catégorie sociale. À celles-ci s'ajoutent les membres des autres niveaux-cible de la répres-sion ; les intellectuels, les groupes ethniques, les membres du clergé ou la vaste catégorie des personnes accusées de « crimes et délits contre la sécurité intérieure de l'État ». Le processus de « rééducation » auquel ils ont été soumis par la privation de liberté, soit dans des prisons, soit dans les colonies de travail, a été axé sur la déshumanisation des pri-sonniers, par la terreur physique et psychique. D'après les témoignages des prisonniers survivants on constate la même chose : la volonté des autorités de conformer les prisonniers au modèle demandé par le ré-gime soviétique, en annulant leur pensée individuelle et en les
1 ASRI, Fond D, dosar nr. 778, vol. 27, f. 1-11 apud Ștefan Marițiu, «La répression de la Roumanie communiste et ses dimensions officielles», dans Stéphane Courtois în Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowsk, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, re-presiune, [Livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression], avec la collaboration de Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves Santamaria et Sylvain Boulouque, București, Humanitas et Fundația Academia Civică, 1988, 1988, p.761.
89
encadrant dans la masse amorphe des personnes soumises au commu-nisme.
De plus, dans la catégorie de l’homme nouveau créé par les communistes s’inscrit aussi la sous-catégorie du tortionnaire, l'individu cruel qui, pour prouver son allégeance au système, est capable de commettre une large gamme d'atrocités sur la sous-catégorie du prison-nier. Il y a de nombreux témoignages des victimes du régime communiste qui accordent une attention particulière à cette sous-catégorie du tortionnaire. Il est intéressant de connaître la classification des gardiens qu'établit Nicolae Steinhardt : ils sont « zélés et modérés, cruels-inventifs et humains »1.
Il y a aussi beaucoup de livres qui décrivent cette typologie d’une manière implicite. Dans les récits de George Coposu ou dans ceux de Ion Ioanid, ainsi que dans les témoignages des femmes-prisonnières (Oana Orlea, Lena Constante), le gardien représente une typologie particulière, opposée à l'être humain. Annie Samuelli affirme même que, pour elles (les femmes détenues) le terme « garçons » ne désignait que les hommes prisonniers, les gardiens appartenant au genre neutre.
La rédaction des témoignages sur l’univers concentra-
tionnaire roumain Après la chute du régime communiste, la plupart de ceux qui
avaient connu le Goulag roumain ont écrit des récits sur les expériences vécues dans l’univers concentrationnaire roumain, d'une manière plus ou moins subjective, et plus ou moins esthétique. Ces témoignages constituent un élément essentiel dans le processus de reconstruction de l’histoire, même s’ils ne révèlent pas toujours des aspects exacts et que leur degré d’objectivité soit discutable ; ils représentent toutefois une preuve qui atteste l'existence de cet odieux phénomène appelé l'univers concentrationnaire généré par l’idéologie communiste. Témoignant par l’écriture des expériences vécues, les victimes du communisme confir-ment la véracité des documents historiques et, dans le même temps, les complètent. L’acte de remémorer est un processus très complexe pour
1 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conștiința românească : memorialistica și literatu-ra închisorilor și lagărelor, Iași Polirom, [Le Goulag dans la conscience roumaine. Les mémoires et la littérature des prisons et des camps communistes], 2005, p.165.
90
l’auteur qui doit se replacer dans les différentes périodes de son exis-tence. De surcroît, ce regard rétrospectif implique la sélection des éléments essentiels parmi un flot d’informations devenues plus ou moins vagues avec le temps qui passe.
Ruxandra Cesereanu reconnaît, à juste titre, l’aspect littéraire prédominant de ces écrits au détriment de leur valeur historique : « les souvenirs sur la période de détention, les journaux post-pénitentiaires et les romans-document sont situés, comme espèce, quelque part entre l’histoire et la littérature. De toute façon ils appartiennent plus à la litté-rature qu’à l’historiographie. »1. On prend comme exemple, dans ce cas-ci, les aspects retenus d'une manière subjective par chaque auteur, au détriment des événements strictement historiques, qui, eux, n’ont pas d'écho sur l'individu, un peu comme si c'étaient des documents scientifiques. Les écrits qui contiennent des récits sur l'univers concen-trationnaire roumain commencent généralement par la question « Pourquoi ai-je choisi d’écrire mes souvenirs? ». Les réponses sont dif-férentes, mais parmi les motivations les plus fréquentes il y a celles d’ordre moral ; par dette envers ceux qui sont morts en prison ou envers ceux qui ne peuvent pas écrire leur passé à cause de leur situation so-ciale ou culturelle (il s'agit ici des personnes qui ne savent pas écrire). Une autre catégorie est constituée par ceux qui considèrent qu’ils peu-vent soulager leur âme par l’écriture, une écriture qui partage leurs expériences et qui les aide à faire passer la souffrance aux autres.
Le témoignage des expériences vécues est une preuve que le passé a été accepté, une preuve de réconciliation avec soi-même malgré tous les traumatismes vécus. Mais le témoignage peut constituer aussi un acte d’accusation à l'adresse des coupables. Paul Ricoeur parle, dans une interview accordée à Sorin Antiohi, de la modalité de raconter le passé sans blâmer exagérément les tortionnaires et de la capacité de se positionner entre le détachement absolu et le pathétisme profond, de cette forme de « Mémoire réconciliée qui ne signifie pas oublier le mal souffert ou commis, mais en parler sans colère »2.
L’acte de témoignage implique un certain nombre de questions qui doivent être observées par ceux qui étudient le discours des prison-niers. Parmi les plus importants on peut mentionner : le moment du
1Idem, p. 11. 2 Sorin Antiohi, Interviu cu Paul Ricoeur, Istorie, memorie, iertare, Interview avec Paul Ricoeur, Histoire, mémoire, rémission, dans „Timpul”, nr. 9, 2006, consultée le 20 Février 2012. http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7619 .
91
témoignage, par rapport au moment où on a vécu les événements ; les raisons pour lesquelles on raconte ; le registre prédominant des événe-ments relatés : social-quotidien, culturel, ou politique ; le ton choisi par le narrateur : moralisateur, détaché ou profondément affecté par ce qu’il raconte ; et, finalement, le degré de véridicité des événements présen-tés. En répondant à ces questions, on peut observer beaucoup de différences qui aident à définir la spécificité discursive de chaque té-moignage.
La plupart des mémoires sur la période communiste sont rédigés par les victimes directes du régime concentrationnaire, mais il y a aussi des exceptions. On parle ici des cas où les expériences des certaines victimes du système concentrationnaire sont analysées par leurs pa-rents : Ioan Holban, Tata în cămașa de oțel, [Mon père en chemise d’acier], ou le cas où la rédaction des témoignages prend la forme d'une interview : Ioana Berindei, Am făcut Jilava în pantofi de vară (Convorbiri cu Ioana Berindei); [J’ai fait Jilava en chaussures d’été. Des conversations avec Ioana Berindei] ou Oana Orlea, Ia-ți boarfele și mișcă! Interviu realizat de Mariana Marin [Prends tes frusques et avance! Une interview réalisée par Mariana Marin]. Une autre carac-téristique de ces écrits est le fait qu’ils ont été rédigés et publiés après la chute du régime communiste en Roumanie. Bien sûr, cette caractéris-tique s’applique principalement aux écrits parus dans l'espace roumain. Mais il y a aussi des victimes qui, après avoir réussi à échapper à la grande prison qu'était la Roumanie communiste, ont publié leurs expé-riences carcérales vécues dans leur pays, choquant ainsi monde occidental tout entier. Cet aspect n’est pas toujours valable parce que beaucoup de ceux qui ont retrouvé la liberté, ont essayé de garder le silence pour protéger leur famille restée dans le pays.
En signe de solidarité avec ceux qui se trouvaient encore dans les prisons de Roumanie, mais aussi comme un appel au secours adres-sé à l’humanité, Adriana Georgescu écrit ses témoignages avec l’aide de Monica Lovinescu, en France, à Paris. Adriana Georgescu appartient au premier lot de victimes du régime nouvellement installé à Bucarest en 1945 ; journaliste et rédacteur du journal « Viitorul », diplômée en Droit et, surtout, chef du cabinet du général Rădescu, elle a toutes les caractéristiques pour apparaître comme un « ennemi du peuple ». Même si profondément affectée par l’expérience vécue dans le pays, Adriana Georgescu dénonce d’une manière claire et saccadée toutes les atrocités souffertes, mais le style de son récit est fragmenté et divisé par
92
les spasmes et les tremblements convulsifs et obsessionnels qu’elle ressent lorsqu’elle pense au passé et qu'elle en parle. Monica Lovinescu participe directement à l’acte de témoignage « Adriana écrira un témoi-gnage que je vais traduire. Le plus rapidement possible. Aussi rapide que le rythme dans lequel on remplissait les prisons du pays ».1 Quoique l’acte de témoigner soit très douloureux pour Adriana Geor-gescu, elle doit faire ce difficile effort de dire et d’écrire tout ce qu’elle a vécu pour essayer d’arrêter ce qui se passe dans les pays commu-nistes, pour essayer d’adoucir la souffrance des détenus qui se trouvent encore dans le pays. Le livre est publié en 1951, en français, sous le titre Au commencement était la fin, et signé par un pseudonyme pour protéger la famille de l'auteur, restée dans son pays. Adriana Georgescu est l’un des premiers initiateurs de ce grand projet qui démasque la pé-riode communiste depuis son instauration en Roumanie et jusqu'à son apogée.
Plus tard elle est rejointe par le grand nombre de ceux qui atten-dent le bon moment pour écrire ou pour publier leur passé. C’est le cas d’une autre victime, Lena Constante, arrêtée parce qu’elle faisait partie de l’entourage de la famille Pătrășcanu ; aux côtés d'Elena Pătrăşcanu, elle avait fondé le théâtre Țăndărică. Elle est condamnée à 15 ans de prison dont elle fait 12, avant d'être libérée en 1963. Elle dépose, en avril 1990, son premier volume de mémoires sur la détention solitaire, Evasion silencieuse, au secrétariat de la maison d'édition française „La Découverte”. Le 1er septembre 1990, le livre paraît déjà en librairie. Le manuscrit avait été finalisé avant la chute du régime communiste, en 1973, mais il était resté, pour des raisons évidentes, bien gardé au fond d'un tiroir. L'événement tant attendu de la libération complète a déter-miné Lena Constante à le publier. L'auteure reconnaît que le passage du temps a effacé certains détails de sa mémoire. Dans ce premier volume, elle raconte les trois mille jours de solitude qu’elle avait vécus dans la cellule d’isolement, une expérience particulièrement marquante par le silence pesant. Le témoignage vient comme une libération qui brisera le silence de huit ans de non-communication humaine.
Le sujet de son deuxième livre, Evadare imposibilă [Évasion impossible], écrit, cette fois-ci, en roumain, et publié en 1993, est con-sidéré par Lena Constante moins important parce que l’expérience carcérale d’une cellule commune était l'expérience des milliers de
1 Adriana Georgescu, La început a fost sfârșitul, [Au commencement était la fin], București, La Fondation culturelle « La mémoire », 1999, p.7.
93
femmes en Roumanie, tandis que celle de la solitude la différencie. Elle décide d’écrire ce deuxième volume pour faire connaître à la population d’Europe cette expérience, mais aussi pour donner une voix aux his-toires de la vie des paysannes enfermées pendant une longue période pour avoir refusé de céder à l'état leur morceau de terre, des histoires qui, autrement, auraient été ignorées.
Comme survivante de cette expérience de détention, elle assume l’obligation de témoigner au nom de tous ceux qui ne peuvent pas le faire ; ce qu'elle trouvait banal, par rapport à la souffrance des huit premières années, a, en échange, une grande importance pour ses com-pagnons de cellule. Elle pouvait se taire ou elle pouvait rompre, enfin, les murs du silence. Elle a choisi la deuxième solution, la plus digne, même si elle savait qu’il serait difficile de décrire un passé lointain. Elle mettrait au travail sa mémoire pour pouvoir détailler les souvenirs communs de détention « Nous, ceux qui avons atteint la rive, nous, les survivants de la prison, nous sommes aujourd’hui tous vieux. Il n’est pas juste que la mort, en nous prenant, l'un après l'autre, puisse effacer de la mémoire collective cette époque inhumaine de notre histoire. »1
Les études et les volumes de mémoires sur le Goulag roumain deviennent extrêmement nombreux après la chute du communisme. Ruxandra Cesereanu fait une énumération minutieuse des écrits sur le Goulag roumain. Elle arrive à classer ce riche matériau ainsi : d’un côté les mémoires roumaines sur la détention, et de l’autre la prose sur le Goulag roumain qui est divisée, à son tour, en trois sous-catégories : les volumes construits sur le modèle du roman spécifique pour « l’obsédante décennie », les anti-utopies et les allégories, ou la littéra-ture roumaine postcommuniste. La période communiste a représenté une source d’écriture pour les mémoires, mais aussi un point de départ pour les œuvres de fiction. Souvent, le thème du communisme est insé-ré dans ces œuvres d'une manière plus ou moins appuyée. Cette forme de littérature a été pratiquée après la chute du régime communiste, comme un prolongement des écrits antérieurs à cet événement, La dif-férence est qu'on lui a parfois donné une forme abstraite, par exemple dans Cel mai iubit dintre pământeni [Le plus aimé de terriens] de Ma-rin Preda, ou Perimetrul Zero [Le périmètre zéro] de Oana Orlea.
1 Lena Constante, Evadare imposibilă: penitenciarul politic de femei Miercurea Ciuc 1957-1961, [Évasion impossible: prison politique des femmes Miercurea Ciuc [1957-1961], București, L’édition Florile Dalbe, 1996, p.6.
94
En ce qui concerne les mémoires de détention, racontés cette fois-ci par des voix masculines, on doit évoquer quelques volumes comme le livre de Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii [Le journal de la félicité], et aussi celui de Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele [Notre prison de tous les jours]. Les deux volumes, très rigoureusement réalisés, sont centrés tant sur l’élément descriptif, que sur l'aspect analytique, réussissant à captiver le lecteur autrement que par la simple gravité des faits énoncés. Ruxandra Cesereanu oppose à ces deux « croisés absolus » deux autres auteurs mémorialistes : Cons-tantin Noica, Rugați-vă pentru fratele Alexandru [Priez pour le frère Alexandre!] et Zilber Herbert, Actor în procesul Pătrășcanu. Prima versiune a memoriilor lui Belu Zilber, [Un acteur dans le processus Pătrășcanu. La première version des mémoires de Belu Zilber]. La théoricienne les situe dans la catégorie des amoraux, déchus par les erreurs faites dans la lutte contre la fiabilité du système : « l’erreur de Noica est celle d’avoir vu dans le bourreau communiste un frère Alexandre, un gagnant pieux et non pas ce qu’il était vraiment, c’est-à-dire un tortionnaire et une brute.»1 Il est certain que les détenus qui ont cédé au régime communiste l'ont fait sous l’influence de la terreur à laquelle ils avaient été soumis. Cela absout la plupart d’entre eux, mais une question de moralité intervient lorsque le compromis de la victime implique « la chute immédiate dans l’enfer concentrationnaire » des autres détenus.
Pour celui qui a été soumis à l’humiliation par la terreur, il est toujours très difficile de témoigner contre le système qui a nié son hu-manité. Cette impuissance de l’énonciation est générée, le plus souvent, par la honte que la victime ressent en remémorant les atrocités aux-quelles elle a été soumise et aussi par la prise de conscience quant au degré de déshumanisation auquel elle a été soumise ; l’impossibilité d’accepter l'accomplissement de certains actes moralement dégradants (manger ses propres excréments ou des rongeurs, avoir des poux, de la gale ou d’autres signes de la misère absolue). C'est pour ces raisons que, parfois, la littérature de mémoires peut fausser la réalité.
1 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conștiința românească. Memorialistica și literatu-ra închisorilor și lagărelor comuniste, [Le Goulag dans la conscience roumaine. Les mémoires et la littérature des prisons et des camps communistes], Iași, Polirom, 2005, p. 135.
95
La déshumanisation du détenu par la torture Dans tous les récits sur l'univers concentrationnaire roumain, on
retrouve le problème de l'arrachement forcé et déchirant du détenu, isolé de la normalité sociale, l’annulation de son existence par sa trans-formation progressive dans un non-être, ou plutôt l’annulation de la vie qu'il avait eue, comme si on le transformait en mort-vivant. Les mé-thodes auxquelles les autorités font appel sont multiples et attestent tant une cruauté absolue qu'une planification acerbe. Selon les témoignages des détenus, la personne condamnée était soumise à la torture non seu-lement pendant l’enquête, mais aussi pendant toute la période de sa détention. La plupart des méthodes utilisées par le système visaient la corporalité du prisonnier comme une modalité de toucher à son psy-chisme.
Parmi les formes de torture continue se trouve aussi l’alimentation insuffisante et précaire, une méthode de torture sûre ap-pliquée chaque jour et ayant les effets escomptés.
La nourriture n'est pas seulement insuffisante quantitativement, mais elle est aussi détestable du point de vue qualitatif. Cependant, faute d'autre chose, tous les prisonniers commencent la journée avec l’humiliante attente du petit déjeuner, avec « deux doigts d'un liquide brun au fond d’une gamelle. Avec une très fine tranche de pain noir. Et aussi une petite gamelle contenant de la marmelade. »1. La faim devient un poids quotidien parce que ces aliments insuffisants du point de vue calorique, et insipides aussi, ne peuvent pas offrir l’apport nutritif né-cessaire, et que le corps subit une forte détérioration. Les effets de la privation de nourriture sont majeurs ; à cause de la malnutrition la plu-part des prisonniers sont émaciés, anémiques, leurs cheveux tombent excessivement, ils perdent leurs dents qu'ils gardent précieusement dans leur poche, espérant puérilement que, par un miracle de la stomatolo-gie, ils pourront les remettre en place.
L’alimentation est l'un des problèmes qui apparaissent le plus souvent dans les témoignages des prisonniers politiques ; ceux-ci sont tous marqués définitivement par cette polenta préparée avec du maïs moisi, de l'orge perlé à l'odeur de DDT, du fromage indigeste et au goût de caoutchouc, par la soupe à la choucroute et aux cornichons. Les ef-
1 Lena Constante, Evadare tăcută: 3000 de zile singură în închisorile din România, [Evasion silencieuse], la deuxième édition, București, L’édition Humanitas, 1992, p.32.
96
fets de la malnutrition affectent de nombreux prisonniers, non seule-ment du point de vue physique, mais aussi psychique : souvent les femmes son sujettes aux crises nerveuses causées par la faim. Dans son livre de mémoires intitulé Zidul despărțitor [La cloison de séparation], Annie Samuelli raconte l'histoire d'une collègue de cellule qui séchait les morceaux de pain et puis les suçait pour oublier la faim et pour ré-primer l'agitation, parce que, avoue Lena Constante, « la faim était un dictateur implacable et que nous avions faim depuis neuf ans. »1
À la dégradation des prisonniers contribuent aussi le manque d'hygiène corporelle, l'eau insuffisante, les conditions défavorables et les vêtements en lambeaux ; tous ces éléments transforment les prison-niers dans de sinistres images humaines. Ils portent leurs cheveux en désordre, ni lavés, ni peignés, émanant une puanteur malgré le fait que la plupart (des femmes) se lavent quotidiennement avec cette eau crou-pie et sale et avec un savon sentant le poisson, et qui ne mousse pas.
L’importance des vêtements devient primordiale parce qu'ils placent les détenu(e)s à la limite de la société normale, les renvoient dans la catégorie des indésirables, de ceux qui se font rebuter par les autres à cause de leur aspect, de leur odeur effrayante. Ainsi, lorsqu’ils voyagent par le train d'une prison à une autre, leur apparence grotesque attire non seulement la pitié, mais aussi le dégoût des voyageurs, accen-tuant la destruction de leur estime de soi. De plus, ces vieux vêtements rapiécés ne les protègent plus contre le froid, autre ennemi redouté des personnes incarcérées. Les prisonniers parlent, dans leurs témoignages, des chambres non chauffées, des lits sans matelas ou des vieilles cou-vertures déchirées. Faisant contre mauvaise fortune bon coeur, Annie Samuelli raconte avec humour comment, par un jour d'été très chaud, elle avait été transférée de Jilava par le train. Dans un compartiment bondé comme une cage surpeuplée, elle avait été cruellement humiliée à cause de ses guenilles : les détenues, n'ayant pas de jupes, s'éver-tuaient à se confectionner des pantalons à partir de tout petits morceaux de tissu cousus ensemble. C'était le seul moyen pour se vêtir, puisque les prisonniers n'étaient pas autorisés à recevoir des paquets de l'exté-rieur et qu'ils ne pouvaient attendre rien de bon de la part du personnel de la prison, non plus. « Il [le pantalon] devient la pièce d'habillement la plus importante. Pour conserver la chaleur du corps, leur toile rare
1 Lena Constante, Evadare tăcută: 3000 de zile singură în închisorile din România, [Evasion silencieuse], la deuxième édition, București, L’édition Humanitas 1992, p 220.
97
est doublée de matériaux épais, qui dépassent par le bas. Les accrocs et les déchirures apparus au fil du temps sont couverts de nombreux lam-beaux de toutes les couleurs et de toutes les natures. »1
L'atteinte à l'hygiène individuelle est une autre façon à laquelle le système fait appel pour s'attaquer à la dignité humaine. La violence pénètre les corps par tous les sens : la puanteur du seau toujours plein et de la transpiration de chacun, mélangée à celle des autres, le sentiment de claustrophobie provoqué par une cellule comble, dans laquelle plus de soixante détenus coexistent, bien qu'il n'y ait que vingt-cinq lits. Tous ces corps disposés d'une manière inégale, dormant tête-bêche ; tout, mais absolument tout évoque le chaos absolu, la misère acca-blante, les corps punis dix mille fois plus cruellement que personne ne pourrait l'imaginer aujourd'hui.
Se soulager de ses déjections corporelles sans même bénéficier d'un morceau de papier, être rasé avec le même rasoir que des milliers d'autres prisonniers, après que les gardiens leur mouillent la barbe avec la salive qu'ils crachent sur leur visage, être une femme et ne pas avoir les ressources nécessaires pour arrêter le sang qui coule et qui pénètre dans le mince matelas de paille, dégoulinant ensuite lentement sur le lit de la camarade du dessous, sentir ses cheveux tellement gras qu’ils col-lent en mèches misérables, vivre dans de telles conditions et toujours avoir comme but principal de sa vie larvaire celui de se laver tous les jours, malgré le froid et les nombreuses paires d'yeux curieux qui re-gardent son corps faible et vieilli prématurément, voilà de quoi le quotidien de ces prisonnier est fait. La question qui s'impose est celle-ci : peut-on parler d'hygiène dans de telles conditions ? Certainement pas, mais il est admirabile, le désir de ces détenus de continuer comme des êtres humains et non comme une masse amorphe, larvaire.
Les coups constituent la forme extrême de torture corporelle des détenus, appliquée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ils sont dis-tribués d'après un plan diabolique bien établi. La répression varie d'une étape à l'autre, au cours de la période de détention. Dans les cellules d'isolement les prisonniers sont durement battus, en l'absence de té-moins, mais dans les cellules communes, les punitions, bien que très douloureuses, sont appliquées d'une autre manière : les coups sont por-tés brutalement, souvent les prisonniers mourant à cause des blessures survenues. Frappés avec un boyau ou une manche de veston remplie de
1 Annie Samuelli, Zidul despărțitor, [La cloison de séparation] Timișoara, Maison d'édition de l'Université de l’ouest, 1993, p.116.
98
sable, ou tout simplement battus à coups de poings et de pieds, les pri-sonniers sont transformés en tas de chair gonflée, recouverts de plaies non cicatrisées, en êtres pressés par les sentiment de panique et de peur.
Un châtiment extrêmement maléfique est celui que l'on connaît sous le nom de rééducation, appliqué pendant la période 1948-1951 aux détenus dans les prisons et les camps de travail comme ceux de Pitești, Suceava, Târgșor, Brașov, Târgu Ocna, Peninsula, Gherla. Ayant connu sa plus grande ampleur dans la prison de Piteşti, ce phé-nomène est aussi appelé « l'expérience, ou le phénomène Pitești ». Il montre bien les innovations diaboliques que le système concentration-naire utilisait pour semer la terreur parmi les détenus. Il s'agit ici d'une forme de violence par laquelle on visait, en fait, à infliger la terreur aux prisonniers par les coups appliqués en chaque moment de la journée, non par les gardiens, mais par d'autres détenus, avec l'accord de l'admi-nistration des prisons. L'impact est encore plus douloureux parce que la victime fait face non seulement à la douleur physique, mais aussi à la perplexité d'être soudainement battu par les compagnons de cellule, sans être en mesure de demander l'aide de personne, parce que tout est fait avec l'accord des autorités. À propos de cette expérience on trouve des informations dans le livre Fenomenul Pitești [Le phénomène Pites-ti] de Virgil Ierunca, et plus récemment dans la recherche analytique Pitești. Cronica unei sinucideri asistate [Pitesti. La chronique d'un suicide assisté], écrit par Alin Mureșan. Ce dernier écrit exploite des documents et utilise de nombreux témoignages sur cette expérience, la plupart sous la forme des entretiens réalisées par l'auteur avec les survi-vants de cette étape définie par la terreur et l'horreur suprême. Alin Mureșan énumère cinq étapes de rééducation, auxquelles ont été sou-mis les prisonniers : « I. l'obtention de la confiance et des informations sur l'activité politique ; II. les actes de torture ; III. l’autodénonciation pour les actions anticommunistes de l'extérieur et de l’intérieur des pri-sons ; IV. l'autoflagellation morale ; V. la conversion forcée en agresseur »1
« Quant à l’acte de violence, la première phase était celle de la punition physique commune avec le poing, la main, le pied ou la mas-sue, dans n'importe quelle zone du corps ou de la tête. Quand les
1 Alin Mureșan, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, [Pitesti. La chronique d'un suicide assisté] La seconde édition revue et augmentée, L’Institut pour l'investigation des crimes communistes en Roumanie et la Mémoire de l'exil roumain, Iași, Polirom, 2010, p.53.
99
victimes étaient anéanties et paralysées par le choc et la douleur phy-sique, les tortionnaires utilisaient la torture individuelle, alors que le reste des prisonniers regardaient terrifiés le supplice de leurs collègues et de leurs amis. »1 La faim, la misère et la violence avaient toutes comme but la dénigration de l'individu et sa soumission totale, sous l'effet de la terreur.
Les principaux volumes de mémoires sur l'expérience de la pri-son suivent généralement la même structure, présentant les faits d'une manière à peu près chronologique : la vie précédant l’arrestation, l’arrestation même, la période de l’enquête, la condamnation, le choc de la rencontre avec le nouveau micro-univers, les activités quoti-diennes des prisonniers, la description des différents établissements pénitentiaires, la figure de l'autre (le gardien / le camarade de cellule), la libération. Parfois, certains de ces aspects sont absents de la narra-tion, d'autres fois, l’auteur insiste davantage sur quelques autres aspects. Il y a des auteurs qui filtrent dans leurs histoires non pas ce qu'ils ont vécu en prison ou dans le camp, mais ce qu'ils ont découvert à la suite de cette expérience déterminante, mettant ainsi en évidence la vie après la libération.
Aussi, quoiqu'ils soient écrits souvent par un seul auteur, ces mémoires ne représentent pas des témoignages individuels, mais des histoires collectives, parce que les murs de la prison favorisent la créa-tion des fortes relations humaines entre ceux que l'on place dans la même catégorie : des marginaux, des privés de droits. Dans la prison, l'individu perd son individualité corporelle, son corps s'unissant avec la masse informe des autres prisonniers, car ici tout se passe sous les yeux des autres : on n’est plus seul(e), on est défini comme entité à part en-tière par le regard des autres. Ici on partage les charges et les joies avec les autes. Ici on doit son corps entier à ces autres, parce que sans eux on ne peut pas survivre. Ici tout est pour tous et, en même temps, personne ne possède rien. On est tout seul, mais on compte sur les autres ; sans le couteau de son collègue on ne peut pas survivre, tout comme lui, il ne pourrait pas se débrouiller sans l'aiguille à coudre de son camarade. Des relations d'interdépendance entre les membres d'une cellule sont ainsi créées. Dans la prison et « dans le camp tout est collectif et on ne peut
1 Alin Mureșan, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, [Pitesti. La chronique d'un suicide assisté] La seconde édition revue et augmentée, L’Institut pour l'investigation des crimes communistes en Roumanie et la Mémoire de l'exil roumain, Iași, Polirom, 2010, p.49.
100
être seul, ni pour dormir, ni pour travailler, ni pour satisfaire une néces-sité de son corps ; on est toujours dans un groupe, et toujours sous le regard des autres - promiscuité et attentat à la pudeur -, partageant des odeurs et des cris sous la pluie de coups »1.
Les récits sur l’univers concentrationnaire roumain sont de vraies preuves de l'héroïsme et de l'humanité des victimes de cette ter-rible période de l'histoire. En outre, ces histoires sont aussi des éléments précieux qui aident à décrire dans le détail, bien que parfois d'une manière fragmentaire, certains aspects que les autorités commu-nistes ont essayé de garder secrets. Des nombreux mémoires écrits, des romans sur le communisme, et des innombrables interviews réalisées ces derniers temps par Les Instituts de Recherche sur ce phénomène odieux appelé communisme, on retient le fait que les États commu-nistes fonctionnaient comme une immense prison ; une prison dans les profondeurs de laquelle se trouvaient des espaces ténébreux où des condamnés à l'anéantissement physique et mental étaient cachés aux regards de l'Ouest. Par ces filtrages de la mémoire on construit un profil du système qui s'était proposé d'annuler l’humanité de ses citoyens. Ainsi, tout témoignage constitue un avantage dans la reconstruction de l'identité du peuple roumain, la reconnaissance d’une étape triste, mais malheureusement réelle. En conséquence, la valeur de ces témoignages est unique, quelle que soit la forme de l'écriture et la capacité esthétisa-tion de chaque auteur.
Bien sûr, ces écrits attirent l'attention des historiens et des cher-cheurs, mais aussi celle des lecteurs avides de littérature vivante. Les volumes de mémoires sont nombreux, mais parmi ceux qui se sont im-posés il y a ceux de Nicolae Steinhardt, Paul Goma, Ion Ioanid, Adriana Georgesu, Oana Orlea, Lena Constante, Ioana Berindei, Annie Samuelli, Anita Nandriș-Cudlea et la liste peut continuer. Il est certain, aussi, que dans l’avenir la liste sera complétée par d'autres fragments d’histoire orale grâce auxquels l’univers roumain concentrationnaire sera reconstruit étape par étape.
1 Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello(coord.), Istoria corpului, III. Mutațiile privirii. Secolul XX, [Histoire du corps, III. Les mutations du regard. Le XXsiècle], București, Maison d'édition Art, 2009, p.382.
101
Bibliographie:
Antohi, Sorin, Interviu cu Paul Ricoeur, Istorie, memorie, iertare, [Interview avec Paul Ricoeur, Histoire, mémoire, rémission], dans „Timpul”, no. 9, 2006., consultée le 20 Février 2012, http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7619
Applebaum, Anne, Gulagul. O istorie [Le Goulag. Une histoire], București, Humanitas, 2011.
Arendt, Hannah, Originile totalitarismului [Les origines du totalitarisme], București, Humanitas, 1994.
Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, [Archives du Conseil national pour l'étude de la Securité], fond arhive docu-mentare, dosar 55, vol.51, ff. 70-71.
Arhivele Naționale Istorice Centrale, [Centre historique des Archives natio-nales] fond CC al PCR- Cancelarie, dosar nr. 264 /1972, vol. IV, f. 335, apud Andrei Muraru, op. cit., p. 67.
Cesereanu, Ruxandra(coord.), Comunism și represiune în România, Istoria tematică a unui fratricid național, [Le communisme et la répression en Roumanie, l'histoire thématique d'un fratricide national], Iași, Polirom, 2006.
Cesereanu, Ruxandra, Gulagul în conștiința românească. Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor comuniste [Le Goulag dans la conscience roumaine. Les mémoires et la littérature des prisons et des camps communistes], Iași, Polirom, 2005.
Constante, Lena, Evadare imposibilă: penitenciarul politic de femei Miercu-rea Ciuc 1957-1961, [Évasion impossible: prison politique des femmes Miercurea Ciuc 1957-1961], București, Editura Florile Dalbe, 1996.
Constante, Lena, Evadare tăcută: 3000 de zile singură în închisorile din Român [Evasion silencieuse], a doua ediție, București, Humanitas, 1992.
Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques, Vigarello, Georges(sous la direction de), Istoria corpului, III. Mutațiile privirii. Secolul XX [Histoire du corps, III. Les mutations du regard. Le XXsiècle], București, Editura Art, 2009.
Courtois, Stéphane, Werth, Nicolas, Panné, Jean-Louis, Paczkowsk, Andrzej, Bartosek, Karel, Margolin, Jean-Louis, Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, [Livre noir du commu-nisme. Crimes, terreur, répression], avec la collaboration de Rémi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves Santamaria et Syl-vain Boulouque, București, Humanitas et Fundația Academia Civică, 1998.
102
Deletant, Dennis, Teroarea comunistă în România. Gheorghe Georghiu Dej și statul polițienesc, [La terreur communiste en Roumanie. Gheorghe Dej Georghiu et l'état policier,1948-1965], Iași, Polirom, 2001.
Dobrincu, Dorin (editor), Listele morții. Deținuți politici decedați în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securității, 1945-1958, [Les listes la mort. Les prisonniers politiques qui sont morts dans le système pénitentiaire de la Roumanie selon les documents de la sé-curité 1945-1958], Iași, Polirom, 2008.
Georgescu, Adriana, La început a fost sfârșitul, [Au commencement était la fin], București, Fundația Culturală Memoria, 1999.
Guinzbourg, Evguenia, Le ciel de la Kolyma, Le vertige-Tome 2, Paris, Edi-tions du Seuil, 1980.
Muraru, Andrei (coord.), Mareș, Clara, Lăcătușu, Dumitru, Roman, Cristina, Stan, Marius, Petre, Constantin, Cucerai, Sorin, Dicționarul Peni-tenciarelor din România Comunistă (1945-1967) [Le Dictionnaire des prisons communistes en Roumanie (1945-1967)], Institutul pen-tru investigarea crimelor comunismului, Iași, Polirom, 2008.
Mureșan, Alin, Pitești. Cronica unei sinucideri asistate, [Pitesti. La chro-nique d'un suicide assisté], a doua ediție revizuită și adăugită, Institutul pentru investigarea crimelor comunismului, Iași, Polirom, 2010.
Samuelli, Annie, Zidul despărțitor[La cloison de séparation], Timișoara, Editura Universității de Vest, 1993.
Tismăneanu, Vladimir, Dobrincu, Dorin, Vasile, Cristian, Raport final. Co-misia pentru analiza dictaturii comuniste în România, [Rapport final de la Commission présidentielle pour l'analyse de la dictature communiste en Roumanie], București, Humanitas, 2007.
103
NICOLAE STEINHARDT (1912-1989)
Constantin JINGA
Nicolae (Nicu-Aurelian) Steinhardt a vécu de 1912 à 1989, en Roumanie. A présent, son œuvre publiée comprend des essais dans le domaine de la théologie politique, des pages de critique littéraire et d’art, des tentatives de roman, des mémoires en prose, des méditations sur des thèmes religieux, des sermons, de la correspondance, des inter-views. La dynamique de l’œuvre de Steinhardt tient, dans une mesure considérable, des conditionnements souvent dramatiques de l’histoire et, en même temps, de toute une série de rencontres providentielles, qui ont eu le don de transformer les conjonctures moins fastes de la réalité, dans des circonstances salvatrices et transfiguratrices pour l’auteur.
On peut parler de trois étapes da la création de Nicolae Stein-hardt, entrelacées avec sa biographie et très bien délimitées par les failles qui marquent l’histoire du XXème siècle. La première étape serait celle de ses débuts, dans la période d’entre les deux guerres, quand il a publié quelques études dans le domaine de la théologie, du droit et de la politique, ainsi que quelques essais littéraires. Pendant le régime com-muniste de Roumanie, il sera arrêté et condamné pour des raisons politiques. Pendant la détention, il reçoit le baptême chrétien. La deu-xième étape commence après la libération de la prison, quand, à 64 ans, il revient sur la scène littéraire, avec un volume d’essais et de commen-taires. Cette période est suivie par une importante activité d'édition:
105
dépassant les rigueurs de la censure communiste et des pressions pro-pagandistes, il s’impose comme une autorité de référence dans les milieux artistiques et littéraires hors du canon littéraire officiel de l’époque – canon profondément marqué idéologiquement et brutale-ment circonscrit politiquement. Pendant les années ’80 il devient moine et commence à publier des essais religieux, des commentaires bi-bliques, des sermons, qui paraîtront dans des périodiques de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, avec un circuit relativement fermé, étant signés avec un pseudonyme : Nicolae Delarohia1. Ses écrits resteront ainsi, relativement à l’abri des yeux parcimonieux de la censure communiste ; même au sein des communautés ecclésiastiques, seule une minorité fera le rapport entre le pseudonyme et l’identité de l’auteur. Nicolae Stein-hardt trouve sa vraie mesure dans la troisième étape de son œuvre : l’étape posthume. En 1991 est publié Jurnalul fericirii (Le Journal de la félicité). Le livre, lu sur le poste de radio « L’Europe Libre » entre 1988-1989, sera accueilli par le large public comme l’un des livres fon-damentaux de la littérature roumaine et de la littérature concentrationnaire en général, apportant à Nicolae Steinhardt la noto-riété absolue.
Dans une proportion importante, les volumes de Steinhardt ont été republiés après 1989, même si certains d’entre eux étaient connus auparavant, dans les milieux littéraires de l’époque. Les œuvres parues après 1989 sont le fruit de quelques initiatives enthousiastes, mais dis-parates, ce qui soulève des difficultés pour quelqu’un souhaitant étudier profondément les textes steinhardtiens. Nous pouvons parler d’initiatives cohérentes et spécialisées d’édition de l’œuvre de Nicolae Steinhardt uniquement une décennie plus tard : dans ce sens, un projet d’édition critique est maintenant en train de se dérouler2. Il s’agit d’un
1 Florian Razmos montre que Steinhardt n’aurait jamais signé sous ce nom, le pseu-donyme lui ayant été attribué par le Métropolite Nicolae Corneanu, pour pouvoir publier ses esais religieux signés « N. Steinhardt ». Voir Florian Razmos, Jurnalul fericirii: avataruri politice, metamorfoze ale scriiturii (Le Journal de la félicité : avatares politiques, métamorphoses de l’écriture), dans la revue « Observatorul cultu-ral », n°48 (305) / 26.01 – 1.02.2006, [http://www.observatorcultural.ro/Jurnalul-fericirii-avataruri-politice-metamorfoze-ale-scriiturii*articleID_14697-articles_details.html]. 2 Nous faisons référence à Integrala N. Steinhardt (L’In Steinhardt), un projet initié par l’évêque P.S. Justin Hodea Sigheteanul, Président de la Fondation « N. Stein-hardt », et mis en oeuvre par un collectif rédactionnel dont font partie George Ardeleanu, Florian Roatiş, Ştefan Iloaie, Pr. Arhim. Macarie Motogna, Nicolae Mecu et Viorica Nişcov. De ce collectif a également fait partie, jusqu’en 2010, le regretté
106
projet qui, en dehors du mérite de soumettre à l’attention du lecteur des textes écrits pendant la période d’entre les deux guerres, est en même temps révélateur pour les fragments et les manuscrits jusqu’ici inédits. Ce sont des découvertes très importantes, surtout parce que certaines d’entre elles ont le don d’apporter un nouvel éclairage, souvent surpre-nant, sur les œuvres déjà connues. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous pouvons affirmer qu’à l’heure actuelle, Nicolae Stein-hardt doit être perçu comme un auteur en train d’être découvert, même si une partie de son œuvre est déjà consacrée.
Nous nous proposons, par la suite, de parcourir quelques dates importantes de la biographie de Nicolae Steinhardt. Ultérieurement, nous allons passer en revue les plus importants titres de sa bibliogra-phie, examinant en même temps quelques uns des thèmes de méditation favoris de l’auteur, qui se rencontrent de façon féconde dans Jurnalul fericirii (Le Journal de la félicité) – livre que nous allons présenter à la fin.
Quelques éléments biographiques Nicolae Steinhardt est né le 29 juillet (style ancien) 1912, à
Bucarest1. La même année, la famille déménage dans le quartier de Pantelimon, qui peu de temps avant était un village, dans la banlieue NE de la capitale. Le nom reçu à la naissance sera : Nicu-Aurelian.
Son père, Oscar Steinhardt (qui initialement s’appelait Saia Steinhardt), était originaire de la ville de Buzău. Il avait étudié à la Po-lytechnique de Zürich, où, paraît-il, il avait été collègue avec Albert Einstein. Au début du XXème siècle, Oscar était ingénieur dans une usine à fabriquer le verre, en Autriche. En 1907, il rentre en Roumanie, et en 1911 il épouse Antoinette (Tony, Antoaneta), née Neuman. Il est
Virgil Bulat (1940-2010). Les volumes sont publiés en partenariat, sous les auspices du Monastère « Sainte Anna » de Rohia et des Editions Polirom. 1 Apud Viorica Nişcov, dans le vol. N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseuri despre iu-daism (Des Essais sur le Judaïsme), traduction du français, chronologie et index de noms par Viorica Nişcov, préface écrite par Toader Paleologu, Ed. Humanitas, Buca-rest, 2006, p. 7. De la note explicative de la page 15 on peut comprendre que les dates concernant la naissance de Nicolae Steinhardt sont prises dans les Archives de la Mairie du 1er arrondissement de la ville de Bucarest. Elles sont contraires à d’autres sources, qui indiquent le 12 juillet 1912 comme date de naissance de Steinhardt et le village de Pantelimon comme endroit.
107
regrettable que les informations sur Antoinette, la mère de Nicolae Steinhardt, soient très pauvres. Elle semble avoir fait partie de la même famille que Sigmund Freud: dans Critică la persoana întâi (Critique à la première personne) et dans Jurnalul fericirii (Journal de la félicité), Nicolae Steinhardt raconte une ou même deux visites chez ce dernier. En 1912, l’année de naissance de Nicu-Aurelian, Oscar devient direc-teur de l’usine „Sylva”, qui s’occupait de la fabrication des planches en bois. Celle-ci se trouvait à Pantelimon – ce fut, d’ailleurs, la raison pour laquelle la famille Steinhardt déménage dans ce quartier, quittant leur résidence de Calea Moşilor 208, dès que l’état du nouveau-né le permit. Oscar Steinhardt reste l’un des personnages les plus clairement profilés dans les textes steinhardtiens. En 1913, il reçoit la citoyenneté rou-maine, étant également gratifié par décret royal, avec l’ordre « La Couronne de la Roumanie », en degré de chevalier – car il semble avoir participé à la guerre balkanique1. De la même façon, pendant la Pre-mière Guerre Mondiale, il est décoré avec « La Vertu Militaire », suite aux blessures reçues sur le front2. L’une des suites de sa participation aux luttes déroulées sur le théâtre de guerre est également le fait que, une fois établi dans le quartier de Pantelimon, une très proche amitié se lie entre Oscar et le curé Mărculescu, de la paroisse orthodoxe « Ca-pra ». A son tour, le prêtre avait été combattant dans l’armée roumaine, étant fait prisonnier dans les confrontations de la Vallée du Jiu, étant également décoré. Voici que, même si la famille Steinhardt se présente comme une famille typique pour la bourgeoisie juive de cette période, elle fréquente régulièrement non seulement la famille du prêtre Mărculescu, mais également les offices célébrés par ce dernier, à l’église.
Une fois que sa famille revient à sa résidence de Bucarest, à l’âge de 7 ans, Nicolae Steinhardt va à l’école « Clemenţa », dont il suit les cours de 1917 à 1922, quand il ira au lycée « Spiru Haret », où il aura comme collègues Constantin Noica, Dinu Pillat, Alexandru Paleo-logu, Mircea Eliade, Arşavir Acterian. Dans ses souvenirs concernant cette période, apparaît le prêtre Gheorghe Georgescu (de l’église Saint Sylvestre), dont Steinhardt fréquente régulièrement les cours de reli-
1 Viorica Petrescu, Nicolae Steinhardt între Capra şi Fundeni (Nicolae Steihardt entre Capra et Fundeni), [http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/12/nicolae-steinhardt-intre-capra-si-fundeni/]. 2 Voir George Ardeleanu, Istorie Literară: Acasă la Sigmund Freud (Histoire litté-raire: Chez Sigmund Freud) dans « România literară » n°5, 2008, [http://www.romlit.ro/acas_la_sigmund_freud].
108
gion chrétienne, même s’il appartenait au culte mosaïque. Il paraît que le prêtre l’ait traité avec beaucoup de respect et de sympathie, appré-ciant ses lectures et son ouverture intellectuelle. Baccalauréat en 1929, il suivra les cours de la Faculté de Droit et de Lettres de Bucarest, qu’il finit en 1934, quand il s’inscrit dans le barreau du département d’Ilfov. Le jeune Nicu-Aurelian bénéficie, pendant sa période de formation, d’un milieu aisé, bourgeois, cosmopolite, que nous retrouvons illustré, avec beaucoup de candeur, dans Călătoria unui fiu risipitor (Le voyage du fils prodigue), mais également dans l’appétit de Steinhardt pour des auteurs comme Mateiu Caragiale, ou pour une perception raisonnée de la métaphysique, pour un rapport calme et posé avec les grands prin-cipes. Il est fort possible qu’à tout cela ait contribué également les personnalités bonhommes et raisonnées des prêtres Mărculescu de Ca-pra et Georgescu de Saint Sylvestre.
D’ailleurs, pendant les années de lycée et d’université, les ren-contres formatrices de la vie de Nicolae Steinhardt suivent leur cours : il avait environ 17 ans quand il a commencé à fréquenter le cénacle « Sburătorul », où il a connu Eugen Lovinescu et sa fille, Monica Lovi-nescu, à qui il sera attaché par une solide amitié, dont les fruits apparaîtront pendant la période de la persécution communiste. A l’Université, il est également collègue avec Emanuel Neuman, son cou-sin maternel, qui deviendra son ami proche et son mentor. Avec ce dernier, Steinhardt publiera un volume d’essais – Essai sur une concep-tion catholique du Judaïsme. Rédigé en français, le livre apparaît à Bucarest, en 1935, aux éditions « Cultura românească ».
Ses préoccupations littéraires sont visibles très tôt : en 1934, à la fin de ses études, il débute sur la scène littéraire. Dans la même an-née, apparaît le volume În genul… tinerilor (Dans le style des... jeunes), qu’il signe sous le pseudonyme Antisthius. L’apparition de ce volume est remarquée par Eugen Lovinescu dans le numéro du 16 no-vembre de l’« Agenda literară (Agenda littéraire) ». La participation de Steinhardt au cénacle littéraire « Sburătorul » ne passe pas inaperçue. Il connaît ici d’autres personnalités, telles que : Hortensia Papadat-Bengescu, Dinu Nicodin et autres, se faisant souvent remarquer. Il commence à collaborer également avec « Revista burgheză (La Revue bourgeoise) ».
En 1936, il était déjà docteur en droit constitutionnel, à Buca-rest. Sa thèse, intitulée Les principes classiques et les nouvelles tendances du droit constitutionnel. Critique de l’œuvre de Léon Duguit,
109
sera publiée à côté d’un essai sur des thèmes juridiques, sur le droit social. En même temps, il commence à collaborer avec « Revista Fundaţiilor Regale » (Revue des Fondations Royales): son premier es-sai, intitulé Eléments de l’œuvre de Proust, apparaît dans le numéro 8 de la revue, celui du 1er août 1936. Parallèlement, il publie également dans « Libertatea » (La Liberté) – journal dont le directeur était l’un de ses anciens professeurs en Droit –, mais également dans « Universul literar » (L’Univers littéraire) ou dans « Viaţa Românească » (La vie roumaine). De 1937 à 1939 il fait quelques voyages à caractère forma-teur, en Europe. A Paris, il publie son deuxième livre : Illusions et réalités juives, ayant comme co-auteur son proche ami, Emanuel Neu-man.
Il revient en Roumanie en 1939, quand la guerre était en train de toucher à toute l’Europe, et l’atmosphère antisémite devenait endé-mique. La même année, à la recommandation de Camil Petrescu, il devient membre de la rédaction de « Revista Fundaţiilor Regale » (La Revue des Fondations Royales). Il occupera ce poste uniquement une année, car durant l’année 1940, le gouvernement de Bucarest adopte environ 24 lois antijuives. Dans le collège de rédaction de la « RFR » sont affectés directement Nicolae Steinhardt et Vladimir Streinu, qui seront obligés de partir. La nationalité roumaine et les honneurs mili-taires obtenus par Oscar Steinhardt ne sont pas pris en compte dans ce cas, comme conséquence des prévisions du décret-loi n°2650 du 8 août 1940, concernant l’état juridique des Juifs en Roumanie, qui impose le principe de la distinction juridique et politique entre « les Roumains de sang » et « les citoyens roumains »1. Conformément à ce décret, Oscar Steinhardt est déclaré Juif de la IIème catégorie2. En octobre 1941, le même gouvernement émet la loi 3847, qui imposait aux avocats d’origine juive toute une série de restrictions. En tant que Juif apparte-nant à la IIème catégorie, il semble que Steinhardt allait, cependant, rester dans le barreau. Même si « dans des conditions d’opérette », comme il allait le montrer dans une autobiographie, en 1987, les deux Steinhardt subissent des mesures antisémites vexatoires3. Cependant, il revient à la « RFR » en 1944, moment suivi par une période de féconde
1 Lucy S. Dawidowicz, Războiul împotriva evreilor. 1933-1945 (La guerre contre les Juifs. 1933-1945), trad. par Carmen Paţac, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 83. 2N. Steinhardt - inedit: Autobiografie (N. Steinhardt - inédite: Autobiographie), dans la revue « România literară », n°46, 19 novembre 1997, [http://old.romlit.ro/www/html/rl746.htm]. 3 Idem.
110
activité éditoriale: il va collaborer à d’autres périodiques littéraires et culturels de l’époque, tels que « Tribuna poporului » (La Tribune du peuple) ou « Universul literar » (L’Univers littéraire).
Une fois le régime totalitaire communiste installé en Rouma-nie, Nicolae Steinhardt est à nouveau éloigné de la « RFR ». En mai 1945, sous l’occupation soviétique, les autorités roumaines vont donner le décret-loi n°364, qui a pour effet l’épuration des livres et des impres-sions de tout genre. Cet acte donnera naissance à une campagne sans précédent de proscription de certaines personnalités, déjà consacrées. En juin 1948 sera publié par le Ministère des Arts et des Informations un volume intitulé Publications interdites jusqu’au 1er mai, qui com-prenait environ 8000 titres. De 1945 à 1948, dans les journaux de gauche et dans ceux qui essayaient d’entrer dans les grâces du nouveau régime, sont publiées, souvent sous des signatures illustres, des listes de noms d’écrivains et journalistes qui, dans l’opinion des signataires, devaient être mis à l’index. Nombre d’entre eux seront amenés, les an-nées suivantes, devant des instances de jugement, on ouvrira pour beaucoup d’entre eux des procès politiques qui mèneront à des empri-sonnements répétés et souvent ils y trouveront la mort. Le phénomène des accusations réciproques prend de l’ampleur et, pendant l’été 1947, sur une telle liste, se retrouve également le nom de Nicolae Steinhardt, à côté de ceux de Şerban Cioculescu et Vladimir Streinu. Tous les trois sont contraints à partir de la rédaction. La liste avait été publiée dans un article très virulent du journal « Naţiunea » (La Nation), signé par George Călinescu1. D’ailleurs, jusqu’à la fin de l’année 1947, l’apparition de la prestigieuse revue sera arrêtée définitivement par les autorités, en même temps que la suspension de toutes les publications non agréées par le régime communiste.
Par rapport à la période 1940-1944, les actions d’ostracisme d’après 1947 sont beaucoup plus sévères : Steinhardt est éliminé du barreau et la publication de ses textes est interdite. Mis dehors de sa propre maison, il est obligé de gagner son pain journalier par du travail non qualifié. En 1949 il lui est intenté un premier procès : il est accusé
1 Voir George Ardeleanu, În jurul unui „denunţ” al lui G. Călinescu (Autour d’une « dénonciation » de G. Călinescu), dans la revue « România literară », n°45, 2003 [http://www.romlit.ro/n_jurul_unui_denun_al_lui_g._clinescu] . Voir également George Neagoe, 1948: George Călinescu în defensivă (1948: George Călinescu en défensive), dans la revue « Caiete Critice », pp. 17 sq.; Pavel Ţugui, G. Călinescu – un text cenzurat: Denunţurile (G. Călinescu – un texte censuré: Les dénonciations), dans la revue « Caiete Critice » (n°1-2-3, 2009, pp. 46 sq).
111
d’ « inversion sexuelle », acte qui à l’époque aurait pu déterminer une punition de 3 à 10 ans de prison1. Il est acquitté, par manque de preuves. Virgil Cândea, un ami très proche de Steihardt pendant cette période, voit dans cet épisode un acte typique de persécution politique : « qu’est-ce qu’ils auraient pu te mettre sur le dos? Que tu rencontrais un ami, soit pour une conspiration, soit pour des pratiques sexuelles. »2
Cette période dure jusqu’en 1959 et, considérée de façon ré-trospective, elle semble avoir été un temps de préparation pour les grandes épreuves qui allaient arriver. Une étroite amitié lie maintenant Steinhardt à Viorica Constantinide, Paul Simionescu, et Virgil Cândea aux côtés desquels il découvre la littérature patristique, il s’approche de la philosophie chrétienne et il explore de différentes églises et monas-tères, connaissant de près des gens avec une vie spirituelle intense.3 A l’automne 1953, il commence à fréquenter régulièrement Constantin Noica, à Câmpulung-Muscel. Le philosophe s’y trouvait à partir de 1949, en régime de domicile forcé, suite à l’application du décret n°83, du 2 mars 1949, d’expropriation des anciens bourgeois et propriétaires de terrains. Chez C. Noica, Steinhardt retrouve Alexandru Paleologu, son ancien collègue du lycée « Spiru Haret », avec qui il devient ami. Il commence une longue et illicite correspondance avec Noica et Paleolo-gu, correspondance attentivement observée par la « Securitate », car la résidence de Constantin Noica était un lieu de rencontre pour de nom-breux intellectuels qui cherchaient des modalités pour comprendre les nouvelles réalités politiques et pour leur faire face.4
1 Decretul nr. 272/1948 pentru modificarea art. 431, 432 şi 433 din Codul Penal, dans « Monitorul Oficial », I, n° 233, 07.10.1948 [http://lege5.ro/Gratuit/g42donzw/decretul-nr-272-1948-pentru-modificarea-art-431-432-si-433-din-codul-penal?pId=38171363#p-38171363]. 2 Diana Şimonca-Opriţa, ... ne întâlneam din când în când, pentru că el venea la bise-rica Sf. Silvestru să-l vadă pe părintele Galeriu, interviu cu Virgil Cândea (... nous nous rencontrions de temps en temps, car il venait à l’église Sf. Silvestru, pour voir Père Galeriu, interview avec Virgil Cândea), paru dans « Caiete critice », nr. 4, 2009, p. 19 sq. [http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/4-2009.pdf]. Le régime communiste a souvent utilisé la législation qui condamnait l’homosexualité comme moyen d’intimidation et de discréditation des personnes incommodes du point de vue politique. Voir également Stelian Tănase, Anatomia mistificării. 1944-1989 (L’anatomie de la mystification. 1944-1989), Humanitas, 1997, p. 240. 3 Voir Diana Şimonca-Opriţa, Oeuvre citée, pp. 15 sq. 4 Diana Şimonca Opriţa, « Când l-am văzut acolo, la Câmpulung, ne-am împrietenit din primele cinci minute ». Cu Alexandru Paleologu despe N. Steinhardt (« Quand je l’ai vu à Câmpulung, nous sommes devenus amis dès premières minutes. Avec
112
A partir de 1957, plusieurs intellectuels, considérés indési-rables, sont arrêtés. Le plus souvent, ils sont accusés d’actions subversives ou de propagande mystico-légionnaire. Le 1er décembre 1958 est arrêté Constantin Noica, et, durant 1959, auront le même sort encore 25 intellectuels, dont Sergiu Al-George, Dinu Pillat, Sandu Lăzărescu, Sanda Simina Mironescu (Mezincescu), Al. Paleologu, Emanoil Vidrașcu, Arșavir Acterian, Vladimir Streinu, Păstorel Teodo-reanu, Marietta Sadova, Dinu Ranetti, Nicolae Răileanu, Remus Niculescu, Beatrice Strelisker. Ils deviendront, pour les autorités com-munistes, « le lot des intellectuels mystico-légionnaires ». Du lot, qui, dans les archives, s’appellera « Noica-Pillat », feront partie également deux Juifs : Beatrice Strelisker et Nicolae Steinhardt.
Le 31 décembre 1959, Nicolae Steinhardt est convoqué au siège de la « Securitate », où on lui propose d’être témoin à charge contre Constantin Noica et les autres détenus. Il est soumis à un inter-rogatoire et à des pressions. Il est menacé : un éventuel refus de sa part attirera son arrestation et son implication dans le procès, avec les autres. Steinhardt refuse le pacte. Le 4 janvier 1960, il est mis en arres-tation préventive et on lui fait une perquisition au domicile; le 8 janvier il est mis sous accusation pénale, pour activité subversive de propa-gande et dépréciation de l’ordre social1. Il est interrogé les 6, 11, et 12 janvier 1960. Le 12 janvier son dossier d’enquête pénale est achevé. L’enquête, les interrogatoires et le régime des détenus pendant la pé-riode d’arrestation préventive étaient tellement durs, que deux des accusés ne résisteront pas jusqu’au procès. Il s’agit de Mihai Rădulescu et Barbu Slătineanu.
Le procès commence le 24 février 1960 et se déroule rapide-ment, laissant l’impression que les choses avaient déjà été établies, et que le procès en soi n’était plus que le dernier acte d’une pièce de théâtre jouée selon un scénario bien connu. Même s’il s’agit de 25 per-sonnes mises sous accusation, le 1er mars 1960, les sentences étaient déjà promulguées.2 Steinhardt sera condamné pour « l’infraction de conspiration contre l’ordre social de l’Etat ». La sentence n°24/1er mars 1960 du Tribunal Militaire de Bucarest prévoit : 12 ans de travail forcé,
Alexandru Paleologu sur N. Steinhardt »), dans « Caiete critice », n°1-2-3, 2009, pp. 40 sq. 1 L’acte complet est disponible sur [http://www.fericiticeiprigoniti.net/nicolae-steinhardt/1295-ordonanta-de-punere-sub-invinuire-a-lui-nicu-steinhardt-8-ianuarie-1960]. 2 Voir, en détail, Stelian Tănase, Oeuvre citée.
113
confiscation totale des avoirs et le paiement des dépenses de jugement en somme de 1000 lei.1 La punition est mise en œuvre le 4 janvier 1960, devant cesser le 31 décembre 1971. Steinhardt avait déjà 46-47 ans et sa santé était assez précaire. Il sera emprisonné à Jilava, Aiud, Gherla.
Ultérieurement, il avouera que, au moment de l’incarcération, il était persuadé qu’il n’allait pas survivre aux 12 années de prison. Cette perspective tant réaliste que possible catalyse ses recherches des années antérieures, et son trajet existentiel est dessiné autour d’une exi-gence qu’il formule de façon claire et concise : « Je ne voulais pas mourir sans être baptisé. »2 Il reçoit, par conséquent, le sacrement du Baptême le 15 mars 1960, à Jilava, dans la chambre 18, IIème section. Le prêtre qui a célébré le baptême a été l’hiéromoine Mina Dobzeu, de Bessarabie. Emanuel Vidraşcu, détenu du même lot, et ancien directeur de cabinet d’Ion Antonescu, en a été témoin. Au baptême ont assisté également deux prêtres gréco-catholiques, prisonniers dans la même cellule. Il paraît que, par une miraculeuse intendance spirituelle, l’hiéromoine Mina Dobzeu a été la première personne rencontrée par Steinhardt, quand il est entré pour la première fois dans la cellule nu-méro 18. La présence, en qualité de témoin, d’Emmanuel Vidraşcu, ancien directeur de cabinet dans un gouvernement qui a causé à Stein-hardt plusieurs ennuis, ainsi que la présence des prêtres gréco-catholiques, à côté du caractère devenu clandestin du baptême, donnent un plus d’authenticité édénique à cette conversion qui, malgré son as-pect de hold up3, n’a, en réalité, rien de spectaculaire. Il ne s’agit pas d’une conversion formelle, survenant suite à des contraintes exté-rieures, ou apportant des avantages matériels immédiats au novice, bien au contraire. En même temps, même si Steinhardt décrit cet épisode dans un style de véritable policier, son témoignage dégage une éton-
1 ***, Prigoana. Documente ale procesului C. Noica, C. Pillat, S. Lazarescu, A. Acte-rian, Vl. Streinu, Al. Paleologu, N. Steinhardt, T. Enescu, S. Al-George, Al. O. Teodoreanu şi alţii (La persécution. Documents du procès Noica, Pillat, Lazarescu, Acterian, Vl. Streinu, Al. Paleologu, N. Steinhardt, T. Enescu, S. Al-George, Al. O. Teodoreanu et autres), Ed. Vremea, coll. « Faits. Idées. Documents », 1996, pp. 432 sq. Voir également CNSAS, Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989) (Nicu Steinhardt dans les dossiers de la Securitate. 1959-1989), Sélection des docu-ments: Clara Cosmineanu et Silviu B. Moldovan; préface: Toader Paleologu, Etude introductive: Clara Cosmineanu, Ed. Nemira, 2005. 2 N. Steinhardt - inedit: Autobiografie, ed. cit. (N. Steinhardt - inédite: Autobiogra-phie), éd. cit. 3 Idem.
114
nante sérénité, manquant complètement de dramatisme, car le baptême ne se passe pas brusquement, et il ne s’impose pas comme une solution de compromis, in extremis, mais il est plutôt un point de frontière, dont Steinhardt s’approche tantôt de façon sinueuse, tantôt tout droit, suivant un trajet qui commence, probablement, à l’église orthodoxe “Capra”, de Pantelimon, devenant de plus en plus limpide dans la période 1937-1960. Il ne s’agit donc pas d’une conversion spontanée. Après la libéra-tion de la prison, il recevra la Chrismation et la Sainte Eucharistie, à l’hermitage Darvari, de Bucarest, où officiait prêtre George Teodores-cu. C’était à l’automne 1964, à l’occasion de la Fête de la Croix: « à la sortie, évoque Steinhardt dans le Journal de la Félicité, m’accueillaient le parfum du jardin et le ciel d’une journée royale de Septembre. »1
Steinhardt tombe malade suite au régime pénitentiaire, caracté-risé ultérieurement comme un régime d’extermination. Sa santé, de toute façon précaire et beaucoup affaiblie pendant la dernière période de prison, se dégrade de façon accentuée. Si, en 1960, Steinhardt pesait 53 kg et mesurait 1,71 m, en 1963 il était arrivé à 45 kg. Atteint par la dysenterie, il a de sérieux problèmes gastro-intestinaux répétés, il fait une congestion pulmonaire, il attrape une T.B.C. qui, en absence de soins adéquats, tend à se généraliser. En 1964, on lui met un diagnos-tique d’entérocolite chronique, auquel se rajoute un état de faiblesse physique et un rhumatisme chronique déformant2. Il est humilié, battu, affamé, on exploite ses origines juives afin de le mettre dans des situa-tions difficiles pour lui, mais aussi pour les autres détenus. Au-delà des conditions misérables, Steinhardt est en train de vivre, maintenant, une expérience spirituelle transfiguratrice. Il en parlera dans le livre qui, au moins dans la Roumanie d’après 1989, a marqué de nombreuses cons-ciences : Jurnalul fericirii (Le Journal de la félicité).
Pendant tout ce temps, son père, Oscar Steinhardt, envoie aux autorités quelques mémoires, dans l’espoir d’obtenir la grâce de son fils. Sans succès. Il fait appel, par conséquent, à des officiels qui, en
1 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii (Le Journal de la félicité), éd. Virgil Ciomoş, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1994, p. 181. 2 Ioana Diaconescu, Scriitori în arhiva CNSAS: N. Steinhard – deţinutul nr. 13/1960 – „Un element duşmănos al regimului democrat-popular”, (Des écrivains dans les archives du CNSAS : N. Steinhard – le détenu n° 13/1960 – « Un élément hostile du régime démocrate-populaire ») article paru dans la revue « România literară », n°36/2006, http://www.romlit.ro/n._steinhard_-_deinutul_nr._13/1960_-_un_element_dumnos_al_regimului_democrat-popular].
115
échange de certaines sommes d’argent, lui promettent la libération de ce dernier. Ceci ne se passe pourtant pas1, mais, entre avril et juillet 1964, comme réponse aux pressions de l’Occident, les autorités de Bu-carest promulguent trois actes de grâce des détenus politiques : les décrets n° 176, 310 et 411. Jusqu’à la fin 1964, environ 20.000 per-sonnes sont sorties des prisons. Le 3 mars 1964 est également gracié et libéré Nicolae Steinhardt.
Ceci ne signifiait pas, en revanche, la fin du calvaire. La Secu-ritate va déclencher et institutionnaliser à l’adresse des anciens détenus politiques et non seulement de ces derniers, un vrai appareil de surveil-lance informative, d’intimidation et de répression au niveau national (violation de la correspondance, chantage, écoute des conversation té-léphoniques, le domicile obligatoire, l’internement obligatoire dans des hôpitaux de psychiatrie, l’enquête sous des prétextes de droit commun, etc.). Tout comme d’autres personnes qui avaient été des détenus poli-tiques, Steinhardt rencontre de grandes difficultés de réintégration. A cause de son passé politique, il est obligé de faire des travaux non qua-lifiés et épuisants (chargeur et déchargeur, entre autres). Il entre dans l’attention de la Securitate, qui lui dresse « un dossier de vérification », et, le 28 février 1966, est fait un plan de mesures concernant l’ « Orthodoxe » (nom codé, utilisé pour Nicolae Steinhardt).2 Il paraît que plus de 70 informateurs ont été recrutés pour tenir ce dernier sous observation. Une note informative du 16 novembre 1966, trouvée dans son dossier, montre qu’il « avait un travail très difficile, dans une coo-pérative, en dehors de la ville, où il faisait du travail physique […], pour un petit salaire, et ayant, avec les déplacements et l’horaire, un grand nombre d’heures supplémentaires, pour s’occuper de son père, très vieux et affaibli. Pour gagner un peu plus, il donnait des cours d’anglais ou il faisait des traductions. Le peu d’heures libres dont il disposait, il les utilisait pour lire (il était au courant de tout le mouve-ment littéraire et scientifique) »3. A l’époque, Steinhardt travaillait en tant qu’ouvrier non qualifié à l’usine « Stăruinţa », du quartier Vitan.
Nicolae Steinhardt se sent de plus en plus attiré par l’idée d’embrasser la vie monacale. En 1967, à la mort de son père âgé de 90
1 Stelian Tanase, Oeuvre citée, p. 402. 2 Texte complet du plan de mesures, dans les volumes du CNSAS, Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), (Nicu Steinhardt dans les dossiers de la Securitate. 1959-1989) éd. cit., pp. 111-112. 3 Oeuvre citée, pp. 117-121.
116
ans, cette pensée devient de plus en plus claire. Un an plus tard, il est victime d’un accident de circulation, avec des suites graves. Il vit une longue convalescence, suite à laquelle il prend sa retraite pour des rai-sons médicales, à partir du 1er février 1969. De nombreux amis lui rendent visite, et les plus proches insistent pour qu’il recommence à écrire. Steinhardt rend visite au Père Mina Dobzeu, au monastère des saints Apôtres Pierre et Paul de Huşi, avec l’intention de rester à côté de lui. Ultérieurement, Steinhardt montre que la vie dans ce monastère lui avait paru trop agitée, à cause des nombreux touristes. Le monastère des Saints Apôtres était cathédrale épiscopale, mais également monu-ment historique, étant fondé par Ştefan cel Mare, en 1494, et inclus, donc, dans un circuit touristique. Steinhardt revient alors dans la capi-tale. D’un autre côté, il semble qu’une contribution assez importante à sa décision de ne pas rester à côté du Père Mina avait été également l’attitude pleine de précaution de l’évêque Ciopron, ancien évêque mili-taire pendant les années ’40‚ lui-même à l’époque sous la stricte surveillance de la Securitate1.
Steinhardt recommence à écrire à peu près en 1969: des tra-ductions, de petits essais publiés dans des revues telles que « Secolul XX » (Le XXème Siècle) ou « Viaţa Românească » (La Vie Roumaine). En Roumanie, suit une période de dégel culturel, qui a marqué le début du régime Ceauşescu. En 1976, quand il avait déjà 64 ans, apparaît son volume de commentaires et de critique littéraire, Între viaţă şi cărţi (Entre vie et livres). Dans les conditions de l’époque, ce volume peut être vu aujourd’hui comme un deuxième début de Steinhardt. Ce vo-lume est suivi par Incertitudini literare (Incertitudes littéraires) – réédité en 1980 et lauréat du Prix de l’Union des Ecrivains. En 1978, encouragé par Constantin Noica, Nicolae Steinhardt passera l’été au Monastère Sainte Anne, à Rohia (qui se trouve à 50 km SE de Baia Mare, dans le Maramureş, en Roumanie). Il y est impressionné par la bibliothèque, par le paysage, par les gens. Il deviendra moine le 16 août 1980, dans le cadre d’une messe officiée par l’archevêque Teofil Heri-neanu et l’évêque Justinian Chira, entrant sous l’obéissance de l’archimandrite Serafim Man. Il entre dans le monastère de Rohia, étant chargé de s’occuper de la bibliothèque. En même temps, on lui permet
1 Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 1945-1958 (L’Eglise Orthodoxe Roumaine sous le régime communiste 1945-1958), I, l’Académie Roumaine; l’Institut National pour l’Etude du Totalitarisme, Bucarest, 2001, pp. 300 sq.
117
de garder une résidence modeste à Bucarest, et on lui recommande de continuer son activité littéraire.
Il écrit, collaborant régulièrement aux revues de l’époque, et participant à des colloques et à des symposiums. Il tient des sermons, il voyage en Roumanie, et même à l’étranger deux fois : à Paris, où il sera accueilli dans la maison de la famille de Mircea Eliade, et en Belgique, où il passe des moments merveilleux au monastère bénédictin de Che-vetogne. En 1986, paraîtra ici le volume Vies des moines de Moldavie – comme version en langue française du livre Convorbiri duhovniceşti (Conversations spirituelles), écrit par le prêtre Ioanichie Bălan, et tra-duit par Nicolae Steinhardt. Dès son retour en Roumanie, pendant les années ’80, plusieurs de ses volumes paraissent, tels que : Critică la persoana întâi (Critique à la première personne), Escale în timp şi spaţiu (Escales dans le temps et dans l’espace), Dincolo şi dincoace de texte (En deçà et au-delà des textes), Prin alţii spre sine (Vers soi-même par les autres) etc., ainsi que des sermons et des méditations re-ligieuses, parus dans les publications de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, et signés avec le pseudonyme « Nicolae Delarohia ». Toujours pendant ce temps, il élabore plusieurs versions du Jurnalul fericirii (Journal de la Félicité) – auquel il travaillait déjà depuis 1971. Le manuscrit lui avait été confisqué par la « Securitate » à plusieurs reprises, avec d’autres textes qu’il avait sur sa table de travail.
Steinhardt se trouvait encore dans l’objectif de la « Securi-tate ». En novembre 1972, il était attentivement surveillé, on interceptait sa correspondance, et de différents agents de la « Securi-tate » dressaient régulièrement des rapports concernant ses rencontres, ses manuscrits confisqués, et même ses livres déjà publiés.1 Il sera tra-qué, soumis à des intimidations, et surveillé jusqu’à la fin de sa vie. Cependant, ses manuscrits sauvés ou réécrits arrivent partiellement en France. Parmi ces manuscrits, il y avait une version du Journal de la Félicité. Monica Lovinescu et Virgil Ierunca la liront, en feuilleton, sur le poste de radio L’Europe Libre : c’est le premier contact du Journal de la Félicité avec le public de Roumanie et de la diaspora roumaine.
Pendant l’hiver 1988, son état de santé s’aggrave de façon considérable, et au printemps 1989, l’angine pectorale devient de plus en plus accentuée. Il est obligé de se faire interner à l’hôpital de Baia Mare. A ses côtés étaient Ioan Pintea et Virgil Ciomoş. La veille du 29
1 CNSAS, Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), Nicu Steinhardt dans les dossiers de la Securitate (1959-1989), éd. cit., pp. 147-151
118
mars, Steinhardt leur demande d’aller dans sa chambre de Rohia, et de prendre tous les manuscrits, inquiété par la possibilité de perquisition de la Securitate. C’est ainsi qu’une grande partie des textes qui s’y trouvaient encore ont pu être sauvés. Le 30 mars 1989, il demande à un proche de lui lire, du livre de prières qu’il avait avec lui, La prière du mourant. Quand la lecture eût été finie, Nicolae Steinhardt a dit: « Maintenant, ferme le livre ». Il semble que ce furent ses derniers mots1, avant de commencer à se réjouir, à 77 ans de sa naissance dans le monde de la lumière éternelle.
Son œuvre Les écrits de jeunesse – un début ... manqué ? Nicolae Steinhardt débute en 1934, à l’âge de 22 ans, avec un
volume de parodies intitulé În genul … tinerilor (Dans le genre des … jeunes). Le livre apparaît aux éditions « Cultura Poporului » de Buca-rest, étant salué par Eugen Lovinescu. Il est important de signaler que, tel que nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, Steinhardt fréquentait à l’époque le cénacle “Sburătorul”, où il semble avoir été une présence assez familière et remarquée dans les milieux littéraires de l’époque. Cependant, à l’exception de Lovinescu, son début est à peine signalé dans les périodiques de l’époque. Le livre a été découvert en 1993, quand il a été réédité. Une édition anastatique paraîtra en 1996, avec le titre légèrement modifié : În genul lui … Cioran, Noica, Eliade (Dans le genre de… Cioran, Noica, Eliade). L’édition critique sera publiée uni-quement en 20082.
Le volume est signé avec un pseudonyme : Antisthius – il s’agit d’un personnage des Caractères de La Bruyère, à qui Steinhardt copie une phrase, en la transformant en motto: « Je pardonne à tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes ». La citation est censée révéler la perspective critique appliquée par l’auteur,
1 Răzvan Ionescu, Amintiri despre taina libertăţii sau „De te voi uita Ierusalime”, dans « Tabor », n° 8, novembre 2012, p. 38. 2 L’édition de 1993 paraît aux éditions Pan; la deuxième édition : În genul lui Cioran, Noica, Eliade … , postface de Dan C. Mihăilescu, éd. Humanitas, 1996; l’édition critique: În genul ... tinerilor, édition soignée, notes et étude introductive, références critiques et indices de George Ardeleanu, repères biobibliographiques par Virgil Bu-lat, Monastère de Rohia et les Editions Polirom, Iaşi, 2008.
119
qui vise la correction des vices éthiques et esthétiques en même temps, sans apporter aucune atteinte à la personne. Steinhardt restera fidèle jusqu’au bout à cette modalité de peser la personne et son œuvre, une modalité redevable, en dernière instance, à la croyance que le mal est fondamentalement étranger à la nature humaine, l’homme étant par excellence une icône du bien. L’homme est bon par définition, le mal est une inadvertance accidentelle, qui ne le caractérise pas. Par consé-quent, l’attaque des vices n’apporte pas d’offense à la personne, mais c’est un acte purificateur, censé redonner à la personne la brillance que les vices cachaient. Nous retrouverons cette perspective dans plusieurs textes de critique littéraire de Steinhardt, mais aussi dans sa façon de regarder les tortionnaires, de peser leurs mots et leurs faits ; nous la retrouverons également dans sa capacité à pardonner et à racheter une expérience qui autrement serait restée traumatisante. Nous la retrouve-rons également affirmée comme principe de vie, même si, dans son volume de début, ces principes sont pourtant exprimés dans une forme plutôt déconcertante.
La première partie du livre est un exposé théorique, intitulé Beţia de cuvinte 1934 (L’ivresse des mots 1934), faisant référence au texte de Titu Maiorescu (celui de 1873, paru dans « Revista contemporană », La Revue contemporaine), qu’il évoque; ici, Stein-hardt traite de façon critique toute une série de tendances présentes dans les créations de certains auteurs en train de s’affirmer ou qui se réjouissaient d’une certaine notoriété. La deuxième partie comprend une série de pastiches écrits avec ironie, afin de dévoiler les efforts de “brûler les étapes” et de “se synchroniser” avec les nouvelles directions de la littérature européenne, dont plusieurs n’avaient pas de support dans la culture autochtone. Le style est acide, l’ironie devient mordante. En vérité, le résultat est, d’un côté, une véritable commédia, non pas seulement de la littérature, mais également de la société roumaine con-temporaine. D’un autre côté, ces écrits peuvent être lus comme un manifeste programmatique pour l’appréciation et la valorisation des principes bourgeois et libéraux.1
D’ailleurs, les textes publiés par Steinhardt dans cette période se trouvent tous sous le signe d’une pensée libérale-conservatrice et sous celui des valeurs bourgeoises. Leur auteur n’apprécie point le glis-
1 Nicolae Mecu, Portretul înţeleptului la tinereţe (Le portrait du sage pendant sa jeunesse), dans « Revista de istorie şi teorie literară » (« Revue d’histoire et de théorie littéraire »), XL, n° 1-2, 1992, p. 122.
120
sement de ses co-nationaux vers le socialisme, et il regarde avec préoc-cupation la recrudescence de la droite, tout en découvrant le caractère inauthentique ou même faussaire des deux.1. Les articles publiés dans la presse de l’époque, surtout ceux parus dans la « Revista burgheză » (La Revue bourgeoise)2 sont autant de témoignages, à côté de sa thèse de doctorat et de ses deux essais en français, écrits avec Emanuel Neu-man: Les principes classiques et les nouvelles tendances du droit consitutionnel. La critique de l’œuvre de Léon Duguit (1934); Essai sur la conception catholique du Judaisme (1935); Illusion et réalités juives (1937).
Il y a une certaine distance entre ces productions et În genul… tinerilor qui vient de la dureté des jugements de valeur et de la posture supposée par l’appréciation d’un acte culturel, vu d’une perspective ironique. Le placement du texte sous les auspices d’Antisthius et le fait que Steinhardt se révèle être un fin connaisseur de la littérature, un es-prit ludique, attentivement cultivé et gardant dans son regard une bonne partie du ciel de son enfance – ne semblent pas être suffisants pour ra-cheter cette perspective. En revanche, ce pourrait être pour le jeune Steinhardt, celui dont Alexandru Paleologu se souvient comme d’ « un jeune cynique, individualiste, critique, hédoniste etc. [...] Je l’ai connu comme un esprit voltairien, ironique et extrêmement spirituel, qui soit disant, n’avait rien de saint, mais l’irrévérence pulsait dans sa con-duite. »3 Et voici comment Steinhardt même s’auto-caractérise, dans Le Journal de la félicité: « un bucarestois gâté [...], un fils à papa ... »4.
D’ailleurs, vers la fin de sa vie, Père Nicolae parle des aspéri-tés de ces débuts dans les termes d’une confession : « J’avais trop fait mon entrée dans la littérature, à 22 ans, avec le bâton ! – avoue-t-il. [...] Non! Je ne ferai plus jamais mon début avec le même livre, un livre
1 George Ardeleanu, N. Steinhardt şi refuzul „opiumului” (Nicolae Steinhardt et le refus de l’ « opium »), dans la revue « Tabor », n°8, novembre 2012, pp. 66-67. 2 Une partie de ces textes, à côté d’autres, publiés pendant cette période et révélateurs pour cette étape de la littérature de Steinhardt, dans l’anthologie de N. Steinhardt, Articole burgheze (Articles bourgeois), éd. Viorica Nişcov, et introduction par Nico-lae Mecu, éd. du Monastère Rohia & Polirom, Iaşi, 2008. 3 Voir ***, N. Steinhardt. Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Băciuţ, (***, N. Stein-hardt, Entre les mondes. Conversations avec Nicolae Băciuţ), Editura Nico, Târgu Mureş, 2009, pp. 127-128. 4 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, éd. cit., p. 28.
121
dans lequel j’ai été injuste et violent avec Eliade, Cioran, Noica. Je n’ai pas eu raison. »1
La période « intertestamentaire » – littérature de tiroir? Dans le domaine des études bibliques, la « période intertesta-
mentaire » fait référence à l’intervalle de temps qui correspond à l’activité du prophète Maleahi (environ 420 av. J. Ch.), le dernier des prophètes du Vieux Testament, jusqu’à l’apparition de Saint Jean Bap-tiste (au début du Ier siècle après J. Ch.). Le terme a une nuance chrétienne, car il atteste l’existence de deux « testaments ». L’exégèse judaïque fait référence au même intervalle approximativement, par le syntagme: « la période du deuxième Temple » (environ 530 av. J. Ch . – 70 après J. Ch.). C’est une période considérée longtemps comme comprenant « 400 ans de silence », car aucun texte canonique n’est élaboré pendant cet intervalle de temps. Cependant, durant cette époque apparaissent divers écrits, auxquels l’exégèse chrétienne attribue un caractère deutérocanonique, en les considérants essentiels pour la com-préhension adéquate du milieu et du contexte dans lequel sont apparus les écrits du Nouveau Testament. 2.
Dans la vie de Steinhardt, il y a environ deux décennies d’apparent « silence »: les années ’50-’70. Une syncope imposée par les difficultés de l’histoire, quand il paraît que Steinhardt aurait totale-ment renoncé à l’écriture. Cependant, aujourd’hui on connaît deux textes représentatifs pour le positionnement libéral-conservateur, et, déjà, totalement chrétien de Steinhardt, qui semblent l’avoir préoccupé exactement à cette époque : Călătoria fiului rătăcitor (Le voyage du fils prodigue ) et, respectivement, Eseu romanţat asupra neizbânzii (Essai romancé sur l’échec).
Grâce à ce qu’aurait pu être un étrange jeu du destin, les deux sont restés non publiés jusqu’après la mort de l’auteur. Initialement, on a supposé que Steinhardt les avait conçus pendant sa jeunesse, et qu’il les avait gardés dans son tiroir. L’évocation de l’atmosphère d’entre les deux guerres et d’un contexte social spécifique à cette période semblent soutenir cette hypothèse. D’un autre côté, la lumière nostalgique de
1 ***, N. Steinhardt. Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Băciuţ (***, N. Steinhardt, Entre les mondes. Conversations avec Nicolae Băciuţ ) éd. cit., pp. 52-53. 2 Les canons 59-60 du synode de Laodiceea (363 d.Hr.); St. Athanasie le Grand, Epitre 39 « Festive », 367 après J. Ch.
122
l’évocation, la perspective caractérisée par l’empreinte de certaines lectures, profondément assimilées et ne faisant pas forcément partie de la littérature séculaire, mais également des grands auteurs du christia-nisme, comme marques de quelques expériences fondamentales de vie, auxquelles se rajoutent certaines références culturelles, qui ne corres-pondent pas à la période de jeunesse, pourraient suggérer autre chose.
Călătoria fiului rătăcitor, est paru pour la première fois en 1995. Inspiré de façon évidente de la parabole biblique de l’Evangile selon Saint Luc 15:11-32, le roman raconte les pérégrinations d’un jeune juif de bonne famille, qui décide de quitter ses parents, afin de trouver son sens dans la vie à son propre compte. C’est un personnage typiquement moderne. Le trajet du jeune dans la société bourgeoise de Bucarest des années ’20-’30 devient une occasion de dessiner plusieurs tableaux, présentant des scènes de salon qui reconstituent l’univers du monde bourgeois d’entre les deux guerres et, en même temps, une oc-casion de méditer sur la condition humaine. A la fin de ses pérégrinations, le jeune homme se découvre lui-même et revient natu-rellement chez son père, métamorphosé : il se sent accompli et prêt à assumer, en pleine liberté, un autre niveau de l’existence. Le style res-semble à certains passages de Mateiu I. Caragiale, Ionel Teodoreanu, André Gide ou Roger Martin du Gard1. En partie essai, en partie ro-man, Eseu romanţat asupra neizbânzii, non publié jusqu’en 2003, contient des notes et des fragments d’un journal imaginaire, qui ras-semble des méditations graves sur les grands problèmes philosophiques de la vie, avec des notes gaies, de la réalité évoquée. Les deux seront réunis dans un volume et republiés dans une édition critique, en 2013, édition qui relève du style et des thèmes steinhardtiens majeurs de mé-ditation2.
Les deux textes se retrouvent dans un accord assez harmo-nieux avec les articles de la « Revue bourgeoise », mais également avec la perspective que nous pourrions appeler aujourd’hui « steinhard-tienne » sur le monde. Dans la critique récente, on accrédite l’idée qu’il pourrait vraiment s’agir de textes qui ne sont pas finis, auxquels
1 N. Steinhardt, Călătoria unui fiu risipitor, éd. soignée par Ioan Pintea, Ed. Adonai, 1995, p. 10. 2 Călătoria unui fiu risipitor, roman, texte revu, édition soignée et préface par Ioan Pintea, Ed. Adonai, 1995; Eseu romanţat asupra neizbânzii; Ed. Timpul, Iaşi, 2003; éd. critique: Călătoria unui fiu risipitor, texte revu, édition soignée, étude introduc-tive, notes et références critiques par Adrian Mureşan; repères biobibliographiques par Virgil Bulat, Polirom, Iaşi, 2013.
123
l’auteur a travaillé pendant la période ’50-’60, quand il semble avoir disparu complètement de la vie littéraire, obnubilé dans une réclusion partiellement forcée, mais profondément assumée comme gestation spirituelle et de toutes façons essentielle pour le trajet qui nous conduit vers les créations ultérieures et surtout vers le Journal de la félicité1.
Pendant le communisme Nicolae Steinhardt revient dans la vie littéraire avec un volume
d’auteur, en 1976, quand paraît Între viaţă şi cărţi (Entre la vie et les livres), qui réunit une série de commentaires littéraires. Entre temps, il avait publié quelques traductions de l’anglais (des textes de James Bar-low, David Storey, Rudyard Kipling, etc.). Un peu plus tard, paraît le volume Incertitudini literare (Incertitudes littéraires), qui, en 1980 est lauréat par l’Union des Ecrivains. L’activité éditoriale lui prend de plus en plus de temps. Sa signature peut être retrouvée dans des revues im-portantes de l’époque, telles que « Secolul XX », « Viaţa Românească », « Opinia studenţească », « Echinox », « Vatra », « Fa-milia », « Steaua »2. Souvent, la censure l’obstrue : on lui refuse les manuscrits, d’autres lui sont publiés tronqués. Il se voit obligé d’errer d’une revue à l’autre, d’une maison d’édition à l’autre. En même temps, il participe à des vernissages, à des lancements de livres, à des symposiums. Ses préoccupations sont généreuses – à part les essais et les textes critiques, il est également un cinéphile avisé : il apprécie Fel-lini, Antonioni, Buñuel, et, un peu plus tard, les metteurs en scène roumains Dan Piţa ou Mircea Daneliuc3.
1 George Ardeleanu l’appelle « la période de mare » – voir N. Steinhardt şi paradoxu-rile libertăţii: o perpectivă monografică (N. Steinhardt et les paradoxes de la liberté : une perspective monographique), Humanitas, 2009, p. 148. Une perspective un peu différente, chez Adrian Mureşan, Veriga - lipsă a biografiei literare steinhardtiene (Le Maillon manquant de la biographie littéraire steinhardtienne), dans la revue « La Punkt », [http://www.lapunkt.ro/2013/03/26/veriga-lipsa-a-biografiei-literare-steinhardtiene/] – fragment de l’étude introductive à N. Steinhardt, Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanţat asupra neizbânzii (Le voyage d’un fils prodigue. Essai ro-mancé sur l’échec), 2013. 2 « Le XXème Siècle », « La Vie Roumaine », « L’opinion estudiantine », « L’Equinoxe », « L’âtre », « La famille », « L’étoile ». 3 Marian Rădulescu, Monahul cinefil – Nicolae Steinhardt (Le moine cinéphile – Ni-colae Steinhardt), dans « agenda.liternet.ro », septembre 2009 [http://agenda.liternet.ro/articol/9644/Marian-Radulescu/Monahul-cinefil-Nicolae-Steinhardt.html].
124
Son aire de préoccupations est très vaste et diverse. En 1982, il publie une œuvre importante sur Geo Bogza: Geo Bogza, un poet al Efectelor, al Exaltării, Grandiosului, Solemnităţii, Exuberanţei şi Pate-tismului (Geo Bogza, un poète des Effets, de l’Exaltation, du Grandiose, de la Solemnité, de l’Exubérance, et du Pathétisme). Ulté-rieurement, il appelera ce livre « une petite et moche brochure » et avouera l’avoir réalisé dans un but expiatoire, parce que, dans sa jeu-nesse, il avait violemment et d’une manière juvénile attaqué Geo Bogza, l’avant-gardiste1. Cependant, son œuvre reste « une protestation contre le puritanisme officiel et contre la bêtise triomphante », tel que l’auteur le souhaite, mais également une monographie, importante pour la compréhension de l’œuvre de Geo Bogza.
Par Critică la persoana întâi (Critique à la première personne - 1983) et Escale în timp şi în spaţiu (Escales dans le temps et dans l’espace - 1987), Steinhardt s’impose comme un essayiste de marque de la littérature roumaine. Il écrit des lignes mémorables sur Brătescu-Voineşti ou sur Mateiu Caragiale, et il accueille avec des textes pro-fonds les poésies appartenant à Ioan Alexandru. Il écrit également sur Proust, cite Péguy, pendant que Charles Dickens et Alphonse Daudet comptent parmi ses préférés. En même temps, Thomas Mann et Dos-toïevski représentent pour lui des repères incontestables. Il écrit sur Albert Camus, mais également sur Romain Rolland ou Louis Ferdinand Céline, pendant que Jean Paul Sartre et André Gide semblent l’influencer par ailleurs.
Pour Steinhardt, la littérature et l’art, en général, représentent des formes de connaissance. Dans ses analyses, il cherche avant tout à mettre en valeur les vertus du texte, et sa capacité de communiquer le bien, ainsi que découvrir des modalités pour partager la vérité, car il était convaincu que la vérité et la liberté sont liées par une étroite inter-dépendance. Nombreux de ses textes sont, sinon des exercices d’admiration, tout autant d’occasions de méditer sur la condition hu-maine et sur les grandes questions. En 1988, quand voit la lumière du jour Prin alţii spre sine. Eseuri vechi si noi (Vers soi-même à l’aide des autres. Des essais anciens et nouveaux), nous découvrons un Steinhardt
1 Voir Balada celor trei smintiţi şi a altor mulţi pârliţi ( La ballade des trois fous et de beaucoup d’autres misérables) qui parodie Poemul invectivă (Le Poème invective), de Geo Bogza (1933), dans le vol. N. Steinhardt (Antisthius), În genul lui Cioran, Noica, Eliade… (Dans le genre de... Cioran, Noica, Eliade…), postface de Dan C. Mihăilescu, Editions Humanitas, Bucarest, 1996, pp. 66-67.
125
qui comprend très bien la spiritualité traditionnelle, reflétée dans les mythes roumains fondamentaux, qu’il interprète dans la perspective de quelques lectures théologiques. Il s’approche aussi des auteurs tels que Mircea Eliade, Eugen Ionescu (Eugène Ionesco) ou Emil Cioran avec un courage et une sérénité remarquables, si nous tenons compte du con-texte politique de l’époque.
On a remarqué, probablement à forte raison, que les textes cri-tiques de Steinhardt sont difficiles à encadrer dans la catégorie d’une analyse littéraire conventionnelle. Les associations et les connexions qu’il fait sont souvent surprenantes et mènent vers d’autres univers et domaines. Il propose au lecteur des conclusions qui ne semblent pas forcément être en rapport avec l’œuvre discutée initialement. D’un cô-té, ceci est à cause du fait que nous avons à faire à un analyste caractérisé par une érudition et une ouverture particulières, dans des domaines quelque part insolites pour cette époque-là. Peu d’intellectuels avaient, dans la Roumanie communiste, des lectures aus-si appliquées dans des domaines si divers, comme Nicolae Steinhardt. Et encore moins avaient le courage de faire des connexions aussi expli-cites entre le monde des lettres et des domaines de la spiritualité et de la culture, considérés quasi tabous à l’époque, tels que la littérature bi-blique, celle des Saints Pères, ou la théologie.
Sont ceux-ci des résultats de l’expérience concentrationnaire ? Ou de son évolution spirituelle ? Eugen Simion observait très bien que la valeur des textes de Steinhardt doit être cherchée dans « la littérature d’essais d’intérieur ». Il soulignait aussi justement qu’ils vivent « par l’imagination des idées et par la finesse du portrait moral »1. Ce que Steinhardt dit sur les livres analysés est important, mais ce qui l’est encore plus c’est de découvrir ses méditations et ses conclusions, qui souvent sont très éloignées de l’auteur ou du livre de départ. Ceci parce que, dans le cas de Steinhardt, nous avons à faire, selon Nicolae Morar, à un « critique théologue », à un « intellectuel moine », et à un « moine homme de lettres »2. Pour lui, la littérature suit la révélation de l’humain par la redécouverte de l’homme mythique, archétypal, qui « lutte avec les mystères »3 – tout comme Jacob avec l’ange, pourrait-
1 Eugen Simion, Nicolae Steinhardt, dans la revue « Caiete critice », n° 1-2, 2007, p. 9. 2 Nicolae Morar, Dimensiunea creştină a operei lui Nicolae Steinhardt (La dimension chrétienne de l’œuvre de Nicolae Steinhardt), Paideia, Bucureşi, 2004, pp. 168 pas-sim. 3 N. Steinhardt, Monologul polifonic (Le monologue polyphonique.), p. 321.
126
on ajouter1. C’est la raison pour laquelle sa critique se sent appelée à s’impliquer dans une relation de solidarité avec l’auteur et avec l’œuvre analysés, afin de guider le lecteur vers les valeurs découvertes à travers l’œuvre littéraire, pour façonner l’écrivain et le lecteur en même temps.2 La critique, chez Steinhardt, tout comme la littérature et l’art en général, n’a pas de but en soi : elle nous mène vers quelque chose. Et, dans le cas de Steinhardt, ce quelque chose est très important.
Post-comunisme: Dăruind vei dobândi3 - (re)découvertes C’est sur cette chose-là que Steinhardt écrit, sans détours, une
fois devenu moine. Les textes publiés en qualité de moine sont signés, en grande partie, sous le pseudonyme de Nicolae Delarohia – avec une référence évidente à son monastère d’accueil. Pendant les années ’80, ces productions apparaissent dans des publications de l’Eglise Ortho-doxe Roumaine, surtout dans les revues de la Métropole du Banat, à Timişoara. Beaucoup d’entre elles seront republiées après 1989, dans l’anthologie intitulée Dăruind vei dobândi (1992), dévoilant un lecteur attentif et cultivé des Ecritures Saintes et un esprit préoccupé par la transfiguration totale de l’homme à travers le Christ.
Dăruind vei dobândi est un livre extrêmement important qui, tel qu’Adrian Mureşan le remarquait, en plus de sa valeur homilétique, parle de l’inquiétude née de la foi. L’une des idées préconçues et, d’ailleurs, confortables est celle que la vie et la foi chassent l’anxiété et procurent une paix intérieure, une placide et superficielle relation avec le monde et la vie. Autrement dit, la vie dramatique et la profondeur sont réservées à l’homme pour qui la religion est tout au plus un phé-nomène social. Les sermons steinhardtiens, observe Mureşan, découvrent « l’inquiétude donnée par la foi [...], l’incertitude née de la mortification de l’orgueil, [...] secondée par l’espoir dans le pouvoir du Christ »4.
Les enseignements du moine Nicolae se trouvent en dehors des chemins beaucoup trop battus de l’homilétique, tout comme ses
1 Génèse 32:24-30. 2 Nicolae Morar, Oeuvre citée, pp. 168, 172. 3 Literalement « Donne, tu recevras ». Equivalent au proverbe français « Donnant donnant ». 4 Adrian Mureşan, Recenzie la N. Steinhardt – Dăruind vei dobândi (éd. 2006), (Ana-lyse de N. Steinhardt – Donnant donnant) dans la revue « Tabor », nr. 2, mai 2007, pp. 99, 101.
127
textes de critique littéraire, non conventionnels. Il est évident que le moine de Rohia ne cherche pas à gagner la bienveillance du lecteur, il n’est pas préoccupé par le succès oratoire et n’attend pas d’être félicité à la fin de son texte. Les yeux en larmes ou les regards hostiles ou mé-fiants ne lui font pas peur: sa cible n’est pas tellement un inexorable dévoilement des défauts, mais la remise en bonne et due forme des fa-cultés de l’esprit, pour que l’âme humaine puisse revenir à sa beauté primordiale. Dans ses textes homilétiques, Père Nicolae dévoile deux des traits fondamentaux du christianisme : la simplicité et le paradoxe. Il s’agit de la simplicité de donner ce que l’on n’a pas, et respective-ment le naturel d’acquérir, en donnant, ce qui te manquait, afin de pouvoir être, tout simplement.
Nous retrouvons, dans l’imagerie des textes steinhardtiens, des nuances des psaumes de Dosoftei, car il essaie de représenter Jésus Christ comme un bourgeois, ayant le cœur et la bourse larges, discret, et laissant l’homme Le découvrir en pleine liberté. Les gestes sotériolo-giques de Christ correspondent aux besoins de chacun : tantôt chaleureux, tantôt durs, tantôt provocateurs de scandale. Épater le bourgeois devient ici une indignation contre celui qui est trop conforta-blement assis dans un système qui lui suffit pour motiver son acte de se donner raison. C’est le cas du figuier stérile, mais aussi des clercs et des pharisiens. C’est aussi le cas, de ceux qui se construisent des images fausses, mais convenables sur la foi, afin d’essayer de l’éluder. C’est aussi le cas de ceux qui confondent la vie en Christ, l’effort de déifica-tion de l’homme, avec un jeu d’idées ou de pratiques qui procurent « une sécurisation du soi »1. Ce sont toutes les postures qui, soit de fa-çon placide, soit de façon forcée, camisolent l’esprit, tout en limitant sa possibilité de se réjouir de la liberté en Christ, qui est grâce et liberté assumée par la connaissance de la Vérité.2
Ce n’est donc pas du tout par hasard que les sermons du moine de Rohia ont été remarqués immédiatement après leur publication, en 1992. Ils ont produit une onde de choc dans les milieux ecclésiastiques des années ’90, pour que, ultérieurement, on leur dédie des chapitres entiers dans les manuels académiques, Steinhardt devenant ainsi un auteur étudié non pas seulement dans les manuels de littérature rou-
1 Christos Yannaras, Contra religiei (Contre la religion), Editions Anastasia, Buca-rest, 2011, pp. 172 sq. 2 Jean 1:17; 3:21; 8:32.
128
maine, mais également dans ceux d’homilétique, destinés aux étudiants en théologie1.
Ecrits tantôt occasionnellement et tantôt à de grands intervalles de temps les uns par rapport aux autres, les textes homilétiques synthé-tisent la pensée théologique de Nicolae Steinhardt et, en même temps, apportent un éclairage sur ses essais de critique littéraire. Dans l’homilétique, sa voix atypique attire l’attention par la fraîcheur et par la façon de mettre en valeur, théologiquement parlant, des éléments de culture et de littérature séculaires, universels et autochtones, prouvant en même temps une très bonne connaissance de la Bible2.
Dans un premier temps, on peut avoir l’impression que Stein-hardt illustre de façon éloquente la modalité d’utiliser les arts et la littérature comme des arguments persuasifs pour la formation, la com-préhension et la consolidation de certaines convictions religieuses. Autrement dit, pour lui, la littérature séculaire serait ce que Wordsworth appelait, au XIXème siècle, « a handmaid of Truth »3. Il est vrai que pour Steinhardt la littérature a un statut à part, car ce dernier l’apprécie et la goûte de façon évidente. Cependant, chez le moine – homme des lettres, le romantisme de Wordsworth est traduit dans des termes très post-modernes, et la littérature est regardée, analysée et uti-lisée en tant qu’un tout unitaire, comme un langage qui exprime et partage par une multitude de moyens, d’un côté les sens et l’essentiel de la Parole, et, d’un autre côté, la soif pour l’absolu de l’homme4.
Il est fort visible que Steinhardt comprend la littérature par analogie avec le texte biblique et, par conséquent, ses écrits critiques laissent souvent l’impression d’être réalisés selon un modèle homilé-tique : ils partent tous d’un texte qu’ils exposent de façon analytique,
1 Voir, par exemple, Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Introducere în omiletică (Introduc-tion dans l’homilétique), Editions de l’Université de Bucarest, 2001, pp. 189 sq. 2 Une étude très appliquée dans ce sens, chez Vasile Gordon, Loc de cinste pentru monahul Nicolae Steinhardt în omiletica românească (Une place d’honneur pour le moine Nicolae Steihardt dans l’homilétique roumaine), dans la revue « Tabor », n° 8, novembre 2012, p. 27. 3 William Wordsworth, Essays on Epitaphs (1810), dans le vol. The Prose Works of William Wordworth, vol. II, Aesthetical and Literary, Rev. Alexander B. Grosart (edit.), Edward Moxon & Son, London, 1876 – édition anastatique AMS Press, New York, 1967, p. 59. 4 Voir N. Steinhardt, “O nouă interpretare a Luceafărului” (« Une nouvelle interpréta-tion du poème Luceafărul »), dans le vol. N. Steinhardt, Drumul către isihie. Inedite (La voie vers l’hésychia. Ecrits inédits), IIème édition, Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 112-114.
129
choisissent quelques éléments, qui deviennent après des points de dé-part et des fils rouges pour une démarche exégétique. Nous le constatons dans les livres publiés après 1989, dont certains contiennent des pièces inédites. D’autres – republiés et redécouverts aujourd’hui, tout comme les essais de Tentaţia lecturii (La tentation de la lecture - éd. 2000) ou les volumes de dialogues avec Ioan Pintea, Zaharia Sân-georzan, et Nicolae Băciuţ1, entre autres – pourraient être illustratifs dans ce sens. La même situation se présente également dans le Mono-logul polifonic (Le monologue polyphonique), qui apparaît pour la première fois en 1991, presqu’en même temps que Le Journal de la félicité.
Vers un nouveau covenant : Le Journal de la félicité (Jurnalul
fericirii) A l’automne 1997, Le Journal de la félicité était un livre qui se
réjouissait non seulement d’une remarquable notoriété, mais également des honneurs du monde littéraire : la première édition, soignée par Vir-gil Ciomoş, avait reçu des prix en 1992, étant republiée en 1994, réimprimée à plusieurs reprises, et traduite en italien et en français. La version en français a bénéficié d’une préface écrite par l’un des plus importants théologues du XXème siècle : Olivier Clément. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, Le Journal de la félicité semble être l’un des plus pu-bliés, mais également des plus traduits livres de la littérature roumaine contemporaine.2 Enfin, ce n’est pas en dernier lieu que Le Journal… est
1 Zaharia Sângeorzan, Monahul de la Rohia – Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări (Le moine de Rohia – Nicolae Steinhardt répond à 365 questions), 1992, 1998 ; ***, Primejdia mărturisirii. N. Steinhardt în dialog cu Ioan Pintea (Le danger de l’aveu. N. Steinhardt en dialogue avec Ioan Pintea), 1993, 2000; ***, Între lumi – Convorbiri cu Nicolae Băciuţ (Entre les mondes – Conversations avec Nicolae Băciuţ), 1994, 2001, etc. 2 Le Journal de la félicité, editions en langue roumaine: éd. I – soignée et avec une préface par Virgil Ciomoş, parue aux Editions Dacia, Cluj-Napoca, 1991 (imprimée à deux reprises); IIème édition, soignée, avec des notes par Virgil Ciomoş, préface et repères biobibliographiques par Virgil Bulat, Editions Dacia, Cluj-Napoca, 1994 (imprimée à deux reprises); IIIème édition, – postface et repères biobibliographiques par Virgil Bulat, Editions du Monastère de Rohia, Rohia, 2005; les éditions critiques apparaissent ultérieurement, avec la publications d’une version inédite après le dacty-logramme découvert dans les archives du Monastère de Rohia. Le Journal de la félicité est publié en français – trad. Marily Le Nir, avec une préface d’Olivier Clé-ment, Paris, 1996 (IIème édition en 1999); en italien – trad. Gabriella Bertini Carageani, Bologna, 1996; hébreu – trad. Yotam Reuveny, 2006; néogrec – trad.
130
un livre avec une histoire propre, une histoire importante en soi, parce qu’elle nous aide à comprendre la condition de l’auteur et du texte dans une société concentrationnaire.
Nicolae Steinhardt avait avoué à Virgil Ciomoş qu’une pre-mière version du Journal... était déjà finie en 1970, et que cette version avait fait l’objet de quelques actions brutales de la part de la « Securi-tate ». Ce témoignage oral est consigné dans la préface des premières éditions du livre1. Quelques années plus tard, verra également la lu-mière du jour un document très intéressant, dans ce sens. En octobre 1997, à l’occasion d’une visite au Monastère de Rohia, Tatiana Slama-Cazacu reçoit de la part du Père Serafim Man, le dactylogramme d’une autobiographie, que Steinhardt avait rédigée à la demande de l’Archévêque Teofil Herineanu. A la fin de ce document, il écrivait : « Ce que j’ai écrit ci-dessus, je l’ai relaté en détail aussi dans une forme littéraire, dans une narration intitulée Le Journal de la félicité, qui va jusqu’en 1971. Le manuscrit dactylographié m’a été confisqué par la Securitate en 1972, restitué en 1975, après l’intervention de l’Union des Ecrivains, et puis confisqué à nouveau, en 1984 et déposé dans le dé-partement secret, aux Archives de l’Etat»2.
Il y a trois phrases qui synthétisent l’histoire des efforts pour parcourir l’atmosphère étouffante des décennies de dictature commu-niste en Roumanie.
Les moments importants de cette histoire commencent pendant la période 1969-1971, quand Nicolae Steinhardt rédige Le Journal ... Il commence déjà à en parler avec ses proches, de façon à ce qu’en 1972, le texte eût déjà été connu dans les milieux littéraires. A l’automne de la même année, les autorités le transforment avec promptitude dans un cas. Le 28 novembre 1972, un fonctionnaire de la « Securitate » dres-sait une note-synthèse, en base d’une photocopie qui lui avait déjà été
Nectarios Koukobinos, 2007; hongrois – trad. Fordídota Dankuly Csaba, Dabkuly Levente, 2007; espagnol – éd. et trad. Viorica Pâtea, Francesco Sáncez Miret, George Ardeleanu, 2007; etc. 1 Voir « Nota asupra ediţiei » (« Note sur l’édition présente ») au Jurnalul fericirii (Journal de la félicité), éd. 1994, p. 5. 2 Le texte complet a été publié avec les précisions de Tatiana Slama-Cazacu, et avec un commentaire de l’Archimandrite Serafim Man, sous le titre de N. Steinhardt - inedit: Autobiografie (N. Steinhardt - inédit: Autobiographie), dans la revue « Româ-nia literară », n°46, le 19 novembre 1997 [http://old.romlit.ro/www/html/rl746.htm]. Ultérieurement, a été repris, dans l’anthologie de textes inédits Nicolae Steinhardt. Ispita lecturii (Nicolae Steinhardt. La tentation de la lecture), avec une préface par Ioan Pintea, Dacia, Cluj Napoca, 2000.
131
mise à disposition le 30 octobre 1972 – « grâce aux possibilités d’information de la Direction I », tel qu’il l’écrit. La note-synthèse en-registre avec exactitude le fait que le livre contient 532 pages dactylographiées et retient que « en traitant le christianisme comme unique croyance qui puisse apporter le bonheur à une personne, l’auteur apporte toute une série de calomnies à l’encontre de la société socia-liste ; il fait l’apologie de l’organisation légionnaire ; il commente de façon hostile le jugement des procès des détenus politiques, ainsi que le traitement qui leur a été appliqué dans la prison ; il présente tendan-cieusement la réalité existante à la date de sa libération et commente défavorablement les mesures prises par le Parti (Communiste Roumain – n.n.) et par l’Etat dans le domaine de l’activité idéologique ; il énonce des concepts hostiles concernant l’idéologie marxiste et l’essence de l’ordre. » Comme dans une véritable analyse, à la suite du rapport, le fonctionnaire offre des citations éloquentes à l’appui des affirmations déjà énoncées. Par ailleurs, vers la fin, il tient à rajouter sur Père Nico-lae que, « dans le cadre de la surveillance informative, ont été obtenues des données qui mèneraient à la conclusion qu’il était un religieux fana-tique »; il fait, après, toute une série de recommandations : « il est obligatoire, et ceci urgemment, de vérifier si le travail n’a pas été sorti illégalement du pays»1. Pour toute éventualité, le 14 décembre 1972, le dactylogramme est confisqué, suite à une perquisition.
Steinhardt essaiera de reconstituer le Journal..., en le réécri-vant de mémoire. Il écrit ainsi environ 720 pages dactylographiées. Jusqu’à présent, nous n’avons pas d’information comme quoi cette ver-sion ait déjà été identifiée. En même temps, il tente plusieurs fois de récupérer sa première version. En 1975, il rédige un mémoire et, avec l’appui de l’Union des Ecrivains et, paraît-il, suite aux pressions de son président de l’époque, Dumitru Radu Popescu, le dactylogramme lui est restitué. Tenant compte des circonstances, Steinhardt commence à le multiplier et à le distribuer à ses amis. Il est fort probable que, toujours dans cette période, il ait fait une synthèse des deux versions. Les cher-cheurs parlent de l’existence d’un dactylogramme de 480 pages, qui, en 1979-1980 serait arrivé en France, chez Virgil Ierunca et Monica Lovi-nescu. Les deux proposent à Steinhardt la publication du Journal… en
1 Voir CNSAS, Fonds informatifs, dossier n°207, vol.4, ff. 268-273, dans les vol. Nicu Steinhardt în dosarele Securității 1959-1989 (Nicu Steinhardt dans les dossiers de la Sécurité 1959-1989), pp. 147-151.
132
Europe de l’Ouest, et ceci en deux versions: une en roumain, et une autre en français.
Dans tous les cas, il s’agit d’une période très ambigüe : la cor-respondance de Steinhardt avec Monica Lovinescu et Virgil Ierunca est interceptée par la Securitate, et, par conséquent, Père Nicolae est à nou-veau appelé pour des interrogatoires et, même si pas aussi brutalement qu’auparavant, des mesures d’intimidation sont prises contre lui. Ce-pendant, on lui accorde la permission de voyager à l’Ouest. Il le fera, à deux reprises, du 1er avril au 1er septembre 1978, et, respectivement, du 29 septembre 1979 au 1er mars 1980. Il visite ses amis et ses connais-sances de France, Belgique et Suisse, il correspond librement et prodigieusement avec des personnalités de l’exile roumain de tous les méridiens ; il habite, chaque fois, longtemps, au monastère bénédictin de Chevetogne. C’est ici qu’il traduit du roumain en français1 et, pen-dant les deux séjours, il travaille intensément au manuscrit du Journal ... qui allait être publié en Europe de l’Ouest. Cependant, à son retour en Roumanie, il est à nouveau interrogé par la Securitate et mis sous une attentive surveillance. En même temps, il décide de mettre en-semble les deux versions existantes et se met au travail, reportant ainsi sine die la publication du manuscrit à l’Occident.
A un moment donné – après la visite, à Rohia, de quelques écrivains de Bucarest, qui avaient vu dans la bibliothèque du Père Ni-colae et dans celle du monastère des livres avec autographe, reçus, entre autres, de Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionesco – l’activité de la Securitate le concernant devient de plus en plus rude. Prudent, Steinhardt fait appel à Virgil Ciomoş, à qui il confie une partie des ma-nuscrits. Le 14 mai 1984 une nouvelle perquisition a lieu, et le dactylogramme de 1971 est à nouveau confisqué, avec de nombreux autres documents. C’était, pourtant, trop tard : les dactylogrammes du Journal… se trouvaient déjà partout en Roumanie, et également en Europe Occidentale. Jusqu’en 1989, le texte est diffusé sur le poste de radio Europe Libre, dans le cadre de l’émission « Le livre sur les ondes ». Monica Lovinescu et Virgil Ierunca vont commenter ce livre en détail, tout en le présentant chaque fois comme l’un des livres fon-damentax de la littérature concentrationnaire du XXème siècle.
1 Le fruit de son séjour ici sera le volume : Pr. Ioanichie Bălan, Vies des moines de Moldavie. Enseignements et apophtegmes des grands spirituels de l'Eglise Orthodoxe de Roumanie aux 19e et 20e siècles, Monastère de Chevetogne, 1986.
133
Cependant, la première édition imprimée paraîtra, comme nous l’avons également noté ci-dessus, en Roumanie. Mais ce sera une publication posthume. Soignée par Virgil Ciomoş, celle-ci sera publiée en 1991 et rendra, tout comme la deuxième édition, celle de 1994, le dactylogramme de 1971. Environ 10 ans après, en 2002, George Arde-leanu découvrira dans les archives du monastère de Rohia un autre manuscrit, qu’il publie en 2012. D’ailleurs, George Ardeleanu est éga-lement l’auteur d’une recherche systématique et minutieuse concernant l’histoire et la transmission du texte du Journal de la félicité, recherche qui nous a été fort utile dans la réalisation de la synthèse ci-dessus1.
Tout comme nous avons pu remarquer jusqu’ici, Le Journal... est reçu comme un livre important depuis le début. Alexandru Paleolo-gu, probablement l’un des premiers lecteurs du dactylogramme de 1971, évoque, dans une interview, en 2004, le moment où Steinhardt lui confie « un dactylogramme compacte, très bien mis au point ». Paleo-logu affirme: « Ce manuscrit m’a tellement passionné, que je n’ai pas arrêté de le lire, toute la journée et toute la nuit. Peu de temps après que je l’ai fini, je l’ai repris. [...]. J’ai lu ce journal deux fois, et encore une fois après [...]. Je suis resté avec l’idée que Steinhardt a été un grand écrivain, pendant que nous, nous ne sommes que des publicistes. Il a été vraiment un grand écrivain, et Le Journal de la félicité me semble extraordinaire. Et je crois qu’en assistant à sa gloire posthume, Dieu m’a privilégié »2.
Le livre est, en réalité, un « faux journal », car les événements sont consignés après coup, et les fragments narratifs sont intercalés avec des bribes de pensées et de méditations de l’auteur, pendant que, par ailleurs, apparaissent des commentaires sur des textes religieux, des conceptions philosophiques, ou des actes artistiques.
« L’action » du Journal ... est très simple: l’auteur raconte le fait d’avoir été appelé à la Securitate, pour lui demander de devenir
1 George Ardeleanu, « Un dosar al memoriei arestate » (« Un dossier de la mémoire arrêtée »), dans N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, Monastère de Rohia & Poli-rom, Iaşi, pp. 663-704. Fragments amples et bien documentés de la recherche de George Ardeleanu sont également accessibles on line: George Ardeleanu, Strategii de supravieţuire a memoriei istorice (Stratégies de survie de la mémoire historique), dans la revue « Dilemateca », VII, n° 75, août 2012, pp. 8 sq., [http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/Dilemateca_p.8-11.pdf]. 2 Diana Şimonca Opriţa, Când l-am văzut … ne-am împrietenit din primele cinci mi-nute. Cu Alexandru Paleologu despre N. Steinhardt (Quand je l’ai vu... nous sommes devenus amis dès les premières cinq minutes. Avec Alexandru Paleologu sur N. Stei-hardt), dans la rev. « Caiete critice », n°. 1-2-3, 2009, p. 44.
134
témoin de l’accusation dans le procès « Noica-Pillat ». Comme il re-fuse, il se retrouve ultérieurement dans le boxe des accusés, étant jugé de façon sommaire, condamné, comme tous les autres, et arrivant, ainsi, en prison. Cependant, par un jeu des associations, sont évoqués des moments de la période d’entre les deux guerres, ou bien de l’instauration de la dictature communiste en Roumanie, des souvenirs de prison et d’après la libération. Leur succession respecte la logique d’une mémoire littérarisée : nous sommes dans une rêverie apparente, parce que le passage d’un souvenir à l’autre, filtré parfois par les pas-sages intitulés BUGHI MAMBO RAG, n’est jamais dû au hasard. L’auteur laisse toujours au lecteur la liberté de se réjouir chaque fois qu’il découvre dans le texte la madeleine proustienne, qui ouvre la voie vers le passage suivant. Les madeleines se révèlent constituer la struc-ture narrative du texte, mais aussi celle de la mémoire.
Le Journal ... est plus qu’une chronique de ces années là, car il transgresse les canons de la littérature confessionnelle. La critique a nommé ce livre « un mémoria »1, « une fresque polyphonique »2, dont l’enjeu n’est pas uniquement la récupération, dans le sens proustien, du « temps perdu » en prison ou avant sa conversion, mais surtout le fait d’assumer et de partager un trajet spirituel rédemptoire personnel et généralement humain en même temps, dans le sens christologique du terme. Par conséquent, même s’il peut laisser l’impression d’être le mémorial d’une conversion religieuse, c’est exactement cela que Le Journal de la félicité ne peut essentiellement l’être3. La conversion ne représente ni le dénouement, ni le point terminus de la narration. D’ailleurs, dans une note associée au jour du 28 août 1964, qui apparaît au début du livre, Steinhardt montre que « personne ne se fait chrétien, même s’il reçoit le baptême comme moi, tard dans la vie »4 . La scène du baptême est aussi relatée, déjà, aux pages 83-84, mais l’intention de se faire baptiser est consignée déjà dans les premières pages5. Bien évi-demment, c’est comme dans un roman policier, où l’événement du début génère l’enquête, la quaesta. Chez Steinhardt, la quaesta semble commencer uniquement avec le baptême, car son devenir démarre uni-
1 Eugen Simion, Oeuvre citée, page 9. 2 Ioan Stanomir, Misterul Jurnalului Fericirii (Le Mystère du Journal de la félicité), dans la revue « 22 », 08.08.2012, [http://www.revista22.ro/misterul-jurnalului-fericirii-16947.html]. 3 Cf. Eugen Simion, Oeuvre citée, page 9. 4 N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. 1994, p. 17. 5 Voir éd. 1994.
135
quement à ce moment-là. L’analyse d’un fragment particulièrement important pour ce que nous pourrions appeler, extrapolant l’expression « littérature d’essais d’intérieur », très bien trouvée par Eugen Simion, que nous avons déjà cité – pourrait prouver ceci:
Grâce aux jeux de la mémoire, des « madeleines » placées dans le texte, tout comme les œufs traditionnelles de Pâques, cachés dans l’herbe par les parents qui se réjouissent après à entendre les ac-clamations des enfants qui les trouvent, Steinhardt invite le lecteur à se prêter au jeu, afin de devenir témoin d’une vision du Paradis, indépen-damment du contingent et de l’avancement de l’histoire, une vision unique par la simplicité, la candeur et la profondeur avec lesquelles elle exprime une réalité ontologique et cardinale : le Paradis, le septième ciel, peint comme :
« un endroit de lumière et de verdure, le champ fleuri, plein de chiots potelés et de petits chat à nœud papillon, l’endroit où réson-nent les accords des divertissements de Mozart et où les anges ailés de Liliom se donnent de la peine pour proposer sans arrêt de la con-fiture et du sorbet, l’endroit où se trouve le vrai Dieu, celui des fils et filles laissés, enfin, ouvrir les yeux, quelque vieux ou quel-qu’accablés par de lourds souvenirs seraient-ils. »1 Ces lignes sur le Paradis sont associées, dans Le Journal de la
félicité, avec un après-midi triste du mois de mars 1962, passé dans la prison de Gherla. Le fragment, dont le point central est le passage cité ci-dessus, débute ainsi :
« A travers les interstices des planches de bois nous devinons que le temps serait apporteur de pluie menue et froide. Je me laisse prendre par la nostalgie et la somnolence. J’aimerais pouvoir me blottir comme un enfant, comme un chat sur le poêle. [...] Je me recroque-ville – tant que possible – sous la fenêtre de la cellule, couverte par des planches : à travers les interstices, j’arrive à entrevoir une ligne vague de colline – et, tout comme un enfant qui se raconte des his-toires qu’il connaît depuis longtemps, je répète et systématise la théorie des sept cieux que je n’arrête pas de remuer et qui me con-sole depuis un certain temps. »2
1 N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. 1994, p. 163. 2 N. Steinhardt, Oeuvre citée, p. 161.
136
Les références à une enfance révolue sont disséminées de temps en temps, pendant l’évocation, comme au hasard, comme dans une rêverie. Leur présence, évidemment nostalgique au début, risque-rait de devenir accablante, tout au long du fragment. A la première vue, elles semblent avoir le rôle d’ajouter au portrait du détenu une touche destinée à accentuer définitivement son état de misère. Touché par la nostalgie et par la somnolence, il lutte avec ses propres souvenirs et essaie de toutes ses forces de sauver sa lucidité, par une gymnastique du cerveau à but thérapeutique : le présent est désolant – l’auteur gît, enfermé dans une cellule, sans même la liberté de se recroqueviller comme il veut ; la fenêtre, fixée avec des planches, lui obture la pers-pective ; dehors, vit un printemps qui semble déprimant. Dans ce cadre, les souvenirs involontaires d’enfance sont insinués, malgré son aspect palliatif, en tant que moments de début d’une aliénation inévitable et, psychologiquement parlant, sont à combattre tels quels. Il y a, bien évi-demment, une dialectique des souvenirs, de la mémoire. Mais son sens dépasse le psychologique.
Cette conclusion est générée par la façon de Steinhardt d’évoquer son enfance, loin d’être pesante, n’amplifiant pas le drama-tisme de la scène et ne contribuant pas au soulignement de l’état déplorable du personnage. Encore plus, ces souvenirs ne sont pas dans un rapport antinomique avec les méditations théologiques, et une dia-lectique du genre rêverie vs. évocation volontaire manque complètement. Il est clair qu’ils ont un autre rôle, et les occurrences ne sont pas arbitraires, tout comme il est clair aussi que Steinhardt fait une référence à ... Haydn1. J’assume le risque de croire que, pendant qu’il travaillait ce fragment, Steinhardt fredonnait tout seul, « tout comme un enfant qui se raconte des histoires qu’il connaît depuis longtemps », la deuxième partie de la Symphonie n° 94 en Sol majeur, « La Sur-prise ». Père Nicolae s’avère être très proche de Haydn, dont il note le témoignage avec beaucoup de sagesse : « chaque fois que je pense à Dieu je deviens gai. »2 Tout comme la Symphonie n°94 de Haydn, le texte de Steinhardt a un caractère ludique, que nous découvrons dès que nous percevons les références à l’enfance comme des « madeleines », comme des œufs de Pâques cachés dans l’herbe, comme des évoca-tions... mit dem Paukenschlag – mais très bien enrobés dans la délicatesse de la symphonie, qui devrait nous réveiller doucement, mais
1 Idem, Oeuvre citée, p. 166. 2 Idem, loc. cité.
137
vivement de notre propre torpeur. D’ailleurs, Steinhardt avoue lui-même à un moment donné :
« Si l’on me permet de parler d’une barbe blanche, de confitures et de fleurs, au septième ciel, je ne le ferai pas d’un anthropomor-phisme extrême, qui ne peut pas être deviné, mais parce que je pense à des états spirituels dont l’équivalence métaphorique est très bien rendue par des chiens, des chats, etc. [...] »1 Par conséquent, qu’est-ce que nous découvririons, si nous nous
prêtions à une telle Easter egg hunt, si ce n’est pas la joie de la Résur-rection ? Et quels sens acquiert alors la dialectique de la mémoire ?
Si l’image du début du fragment offre la clé de lecture, serait-il possible que l’espace dans lequel se trouve le personnage, la cellule, soit une imago mundi, d’un monde accablé par les ambiguïtés, limitées et contraignantes ? Et le fait qu’à travers les interstices des planches qui couvrent la fenêtre, au début nous « devinons » que dehors il tombe une pluie menue et froide (donc rien de clair), après « s’entrevoit » partiel-lement et imprécis une cime de colline – pourrait être une référence aux paroles du Saint Apôtre Paul : « Présentement, nous regardons dans un miroir, confusément ; mais alors ce sera face à face. Présentement je connais partiellement ; alors je connaîtrai de la même manière que je suis connu » (1 Corinthiens 13:12).
Considérées parallèlement, les deux côtés offrent le spectacle d’une intéressante réflexion: dans un monde carcéral, accablé par les ambigüités, nous pouvons deviner ensemble (le verbe apparaît à la première personne du pluriel: nous devinons), mais l’expérience de la vue, qui ne peut être une réalité personnelle, subjective, se généralise par objectivisation, par l’appel à la neutralité du verbe impersonnel (on aperçoit). Par contraste, dans le texte de Saint Paul, le passage se fait de la première personne du pluriel (nous regardons), à la première per-sonne du singulier (je connaîtrai), car ici l’expérience de la vue, même en devinant, est personnelle en premier lieu, mais avec une ouverture catholique2, surtout en vertu de son caractère conciliaire, qui a pour effet l’accomplissement de la personne, où même le terme « personne » est à comprendre dans un sens théologique : la personne est toujours
1 Idem, p. 165. 2 Catholique : un des quatre attributs de l’Eglise, qui, ensemble, expriment la pléni-tude de son être.
138
unique et irrépétable, elle échappe à toute définition et peut être com-prise uniquement dans la relation avec une autre personne – comme le montre Vladimir Lossky1. C’est toujours Lossky, synthétisant la con-ception patristique concernant l’état de communion réalisé par cette relation entre les personnes, qui la décrit ainsi :
« dans cette communion [...] chaque personne, sans confrontation, participe intégralement dans toutes les autres personnes ; plus les personnes s’identifient en une seule, plus elles sont différentes, car rien de la nature commune ne leur échappe ; et plus elles sont diffé-rentes, plus elles sont un tout unitaire, car leur unité n’est pas une uniformité impersonnelle, mais une tension féconde d’une diversité irréductible, une abondance de la périchorèse sans mélange ou con-frontation (Saint Jean Damasquin) »2. Lossky précise : “la personne humaine ne se dissout pas, mais
elle a la chance de la rencontre face à face avec Dieu”3. Dans le texte qui évoque l’atmosphère carcérale, le passage se
fait de la première personne du pluriel vers un état neutre, impersonnel. Dans le texte de Saint Paul, le passage de la première personne du plu-riel au singulier signifie exactement l’accentuation de la personne dans le sens de son accomplissement, par la communion. La tension du texte réside donc dans la réduction de la personne au stade d’individu vs. l’accomplissement de la personne.4 C’est d’ici qu’il faut démarrer dans la compréhension de la dialectique de la mémoire, chez Steinhardt.
Est-ce surprenant que Saint Paul parle de l’enfance, quand il aborde toutes ces choses ? Voici :
« Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant ; mais quand je suis devenu un homme, j’ai aboli ce qui était de l’enfant. Présente-
1 Vladimir Lossky, Introducere în teologia ortodoxă (Introduction dans la théologie orthodoxe), trad. Par Lidia et Remus Rus, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, pp. 20 sq.; voir également Panayotis Nellas, Omul, animal îndumnezeit (L’homme, animal déifié), Sibiu, Deisis, 1994, pp. 7-8; Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă (Théologie Dogmatique Orthodoxe, vol. 1, IIème éd., Editions de l’Institut Biblique et de Mission de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, Bucarest, 1996, pp. 274, 277-279, 284. 2 Vladimir Lossky, Oeuvre citée, pp. 19-20. 3 Idem, Oeuvre citée, p. 14. 4 Référence à la problématique de la personne dans les préoccupations steinhard-tiennes, voir Nicolae Morar, Oeuvre citée, pp. 87-88.
139
ment nous regardons dans un miroir, confusément ; mais alors ce se-ra face à face. Présentement je connais partiellement ; alors je connaîtrai de la même manière que je suis connu. Maintenant la foi, l’espérance, la charité demeurent toutes trois, mais la plus grande des trois, c’est la charité. » (Corinthiens 13:11-13) Chez Steinhardt, l’enfance suggère par chaque occurrence le
passage d’un niveau à un autre, d’un ciel à un autre : l’enfant qui se blottit sur le four, « comme un chat » se retrouve dans le détenu qui se blottit sous la fenêtre de la cellule et les deux s’harmonisent dans l’enfant détenu qui « se raconte à soi-même … la théorie des sept cieux » – théorie qui devient, mystérieusement, une véritable contem-plation. C’est ainsi que, quand l’exposition arrive au septième ciel, l’auteur semble ne plus raconter, mais contempler, à partir de ce mo-ment, « Dieu, avec sa barbe blanche, doux et bon. Le Dieu de sa plus lointaine enfance, des cantiques de Noël et des brioches »1. Quelques lignes plus bas, la tonalité du narrateur change : « je parie que, dans le ciel, il n’y a plus que de l’enjouement. Comment se pourrait-être, au-trement, si le Christ nous dit clairement que l’on ne peut pas y entrer si l’on n’est pas comme les enfants. Comment les enfants, sont-ils ? Sé-rieux, ou d’une espiègle gaité ? »2 Nous remarquons la tonalité apparemment dubitative, plutôt joviale de la phrase : je parie que c’est comme ça – comment cela pourrait être, sinon ? Cette tonalité renvoie, en fait, à l’une des paroles favorites de Steinhardt, du Nouveau Testa-ment: « je crois, aide mon incrédulité ! » (Marc 9:24). C’est un appel à la foi, comme moyen de connaître. Le passage est de la théorie, comme une connaissance « dans un miroir, confusément, dans une devinette » (nous devinons que dehors il tombe une pluie menue et froide et aper-cevons « un lopin vague de colline »), vers la contemplation et vers la foi: « mais alors ce sera face à face [...] ».
La vision du Paradis semble clôturer la démarche de systéma-tisation de la théorie des sept cieux : ici, l’enfant qui s’entortillait « comme un chat » se réjouit à la vue lumineuse des chiots potelés, des chatons blancs, à nœud papillon. Mais Steinhardt continue sur un ton parénétique: « Prenons garde, le christianisme n’est pas une simple école de l’honnêteté, de la pureté et de la justice, une noble et raison-nable explication de la vie [...]; ou bien un haut code des bonnes
1 N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. 1994, p. 161. 2 Idem, loc. cit..
140
manières [...]; ou bien une thérapeutique [...]; ou bien un jeu de ques-tions [...]; ou un acte de soumission devant l’Unique [...]. Il est beaucoup plus, et beaucoup plus différent : c’est l’enseignement du Christ, c'est-à-dire de l’amour et de la salvatrice puissance de pardon-ner. Aucune religion ne conçoit le pardon des péchés autrement que sur le chemin logique de la compensation [...]; ce n’est que dans la religion où Dieu ne reçoit pas d’offrande, mais il s’offre Lui-Même comme of-frande que l’espoir de l’effacement total et instantané des péchés est apparu, par le plus épouvantable et plus anti-comptable et scandaleux acte ... »1 Le pardon: Paukenschlag.
Dans la spiritualité chrétienne, le pardon est pensé en rapport avec l’amour, la liberté et la mémoire en même temps. Par le pardon, ce n’est pas seulement l’âme du pardonné qui se décharge, mais aussi l’âme de celui qui pardonne. L’âme du pardonné se libère du poids de la faute, et l’âme de celui qui pardonne se libère de l’esclavage de la « mémoire du mal » (Avva Dorotei), pouvant communier librement à travers l’amour. Steinhardt montre que la mémoire du mal fausse la perception de la réalité, tenant l’homme attaché à la « stupide maya », pendant que le pardon ouvre la voie vers la Vérité qui « nous libère »2. L’absence du pardon provoque, par conséquent, une altération de la perception et conduit à une connaissance partielle et faussée de la réali-té et du prochain, rendant impossible la communion entre les personnes ; la présence du prochain est perçue comme pesante et op-pressive – voici l’univers carcéral. Quant à l’univers paradisiaque, celui-ci est peuplé par les enfants – et il est significatif que Steinhardt utilise le terme de petits enfants, même si jusqu’ici il utilise le mot en-fants, ce qui renvoie à l’exhortation évangélique : « Si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux » (Matthieu 18:3). Et ces enfants sont – enfin, lais-sés venir, « indépendamment de leur âge où de combien ils sont accablés par de lourds souvenirs… »3
“Être une personne signifie être libre » – montre Vladimir Lossky; « [...] la personne élude tout conditionnement”4 – celui du pré-sent, mais aussi celui qui est imposé par le poids des lourds souvenirs. Sur la dernière page du Journal..., Steinhardt parle d’un côté avec tris-
1 Idem, Oeuvre citée, p. 163. 2 Idem, Oeuvre citée, pp. 276, 325, 379-380 etc. 3 Idem, Oeuvre citée, p. 163. 4 Vladimir Lossky, Oeuvre citée, p. 20.
141
tesse sur comment « se sont décomposés si visiblement ceux qui sont marqués par les remords ou par les désillusions », et, d’un autre côté, il avoue sur lui-même qu’il aurait sans doute eu un trajet bien plus déplo-rable – s’il n’avait pas été chrétien. Etant chrétien, en revanche, l’espace proustien décomposé devient, pour lui, un endroit de la con-naissance, où l’homme a accès par les autres, vers soi-même et vers l’absolu.1 De cette perspective, la dialectique de la mémoire s’avère être étroitement liée à la joie de la Résurrection : la mémoire du mal surcharge, accable et limite, pendant que le pardon et la mémoire du bien guérissent et libèrent, rendant possible la responsabilité d’une vie transfigurée, dans l’amour.
Le Journal de la félicité est, selon la très juste opinion de Ma-rian Rădulescu, un livre sur « l’introduction de la raison dans l’église »2. Une raison « introduite dans l’église », libre et guérie, qui peut mettre à côté Joseph Haydn, avec sa Symphonie n°94 en Sol ma-jeur, « La Surprise »; le synode des Saints Pères et de tous les penseurs qui ont déchiffré de façon théologique le concept de personne; et Saint Apôtre Paul, avec son I Corinthiens 13:11-13 – constituant, dans une merveilleuse et mystérieuse illustration (livresque, mais pas seulement livresque) du Paradis, l’infrastructure de ce texte fondamental dans la compréhension du Journal de la félicité.
Le livre, nous le comprenons mieux maintenant, n’est pas tel-lement confessionnel, comme style littéraire, style qui mène vers un très haut niveau de l’écriture, jusqu’au point où la confession et le plai-sir du texte deviennent témoignages ; dans une épître rédigée à l’automne 1979 et envoyée à Virgil Ierunca, de la paix du monastère de Chevetogne, Steinhardt écrit : « Je ne vois pas mon livre [Le Journal de la félicité – n.n.] comme un travail `moderniste`, plein de sensationnel, mais uniquement comme une profession de foi : celle d’un juif qui – dans certaines circonstances, fort difficiles – a aimé le Christ et le peuple roumain. C’est tout, rien d’autre »3. Après la lutte avec l’ange, à la rivière de Jaboc, le patriarche Jacob exclame: « J’ai vu Dieu face à face et pourtant ma vie est sauve! » (Génèse 32:30). Les enfants du Paradis décrit par Steinhardt sont pareils : « ils sont – enfin, laissés –
1 N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. 1994, p. 409. 2 Marian Rădulescu, Le Journal de la félicité, 12 martie 2012, [http://hyperliteratura.ro/jurnalul-fericirii-de-nicolae-steinhardt/]. 3 N. Steinhardt, Dumnezeu în care spui că nu crezi… Scrisori către Virgil Ierunca (1967-1983), [Dieu dans lequel tu affirmes ne pas croire... Lettres à Virgil Ierunca (1967-1983)], Editions Humanitas, 2000, pag. 252.
142
[...] voir », tout comme, dans les années ’90, les générations sorties du communisme, qui ont appris, dans les pages de ce livre, une leçon sur la foi, sur la vie, sur l’authenticité1. Pareil à ces générations est égale-ment ce nouveau « Antistihus », transfiguré dans le moine Nicolae, devenu l’auteur d’un témoignage sur la puissance de l’homme à ac-complir sa condition sans éluder l’histoire, mais en se l’assumant, personnellement et sotériologiquement.
Ce que l’on a considéré être la « gloire posthume » du Journal de la félicité, surtout aux années ’90, tient exactement à cette ouverture arborescente et à sa capacité de mettre ensemble et en bon ordre des éléments apparemment disparates, dans un monde en train d’être recon-figuré, après la chute des régimes totalitaires dans l’Est de l’Europe. L’enjeu du livre n’est pourtant pas en premier lieu culturel, politique, ou livresque, car le Journal de la félicité, par son caractère de témoi-gnage et par le fait d’être arrivé dans l’attention du public après la mort de l’auteur, devient un véritable testament, un engagement qui, une fois assumé, ouvre l’ample horizon où la parole, la grâce et la liberté se dé-clinent ensemble, sous le ciel de la foi et de l’amour (1 Corinthiens 13:13), selon un scénario ancestral : à la rivière de Jaboc, le nom du patriarche Jacob devient Israel: « l’homme qui a vu Dieu » (Génèse 32:28). Et Israel deviendra le père de Joseph (Génèse 30:22-24) – celui qui, trouvant la capacité de pardonner à ses frères, coupables de l’avoir vendu auparavant, a sauvé le peuple de Dieu (Génèse 37-50), devenant ainsi un prototype messianique – qui a inspiré également Steinhardt, à la fin de son livre : « celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit »2.
*
Nicolae Steinhardt demeure, par conséquent, un auteur qui,
même s’il est actuellement étudié dans des manuels de littérature et dans des traités d’homilétique religieuse, et son nom est donné à diffé-rentes institutions d’enseignement, à des fondations et à des associations de toutes sortes, reste cependant en train d’être découvert.
1 Mirel Bănică, Jurnalul fericirii – Sau cartea convertirii unei generaţii (Le Journal de la félicité ou le livre de la conversion d’une génération), dans la revue “Tabor”, nr. 8, novembre 2012, p. 80. 2 F.A. 20:35, apud N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. 1994, p. 409.
143
Nous pouvons, par exemple, radiographier, dans ses textes, les tensions entre les courants autochtones et modernes de la Roumanie d’entre les deux guerres : bourgeois indubitable, Steinhardt ne peut pas être séduit par la gauche progressiste – Juif d’origine, il ne glisse pas dans les extrêmes de l’autochtonisme. Son équilibre aurait pu représen-ter une variante viable pour la culture roumaine de l’époque ? Ou un modèle à prendre en compte aujourd’hui ?
En même temps, la vie, tout comme son œuvre peuvent servir très bien à une étude comparée des systèmes totalitaires de l’Europe du XXème siècle, dans leurs façons de se manifester. D’un bout à l’autre, ses livres et ses souvenirs, avec l’histoire propre de chacun d’entre eux, représente de façon presque synoptique tout le siècle XX. L’avantage majeur de l’œuvre de Nicolae Steinhardt dans l’étude des systèmes to-talitaires du XXème siècle, est celui d’une rétrospective qui manque de toute revendication justicière, étant fondée sur l’objectivité caractéris-tique de l’homme qui a connu les diverses faces de l’Enfer, comprenant que, tout comme Avva Dorotei le disait aussi, il y a peu de choses qui avarient plus la raison et l’âme, que la mémoire du mal (gr. μνησικακία)1.
Dans le prolongement de tout ce qui a été dit ci-dessus, les écrits steinhardtiens s’avèrent intéressants aussi par la perspective qu’ils ouvrent sur une thérapeutique de la mémoire. La mémoire du mal, si elle arrive à se métamorphoser en ressentiment, se grippe dans ses propres appels justiciers et dans un discours de l’autojustification, intériorisant ainsi l’état carcéral: la prison de dehors devient la prison de dedans; la mémoire arrêtée produit une pensée arrêtée2 – c'est-à-dire exactement l’univers concentrationnaire dont on parle dans les pre-mières lignes du Testament politique, au début du Journal de la félicité. La mémoire vindicative ne figure pas entre les solutions proposées, et l’oubli d’autant moins. Steinhardt invite à une nouvelle discussion du problème, dans d’autres termes: la mémoire du mal est un péché, et le contraire du péché – souligne Steinhardt, en se basant sur les mots de Kierkegaard3 – c’est la foi, la liberté. Le rapport entre la mémoire, la
1 Avva Dorotei, Felurite învăţături ... VIII: Despre ţinerea de minte a răului (Toutes sortes d’enseignements... VIII: Sur la mémoire du mal), 6, dans la Philocalie vol. IX, trad. par Pr. Dumitru Stăniloae, Editions de l’Institut Biblique et de Mission de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, Bucarest, 1980, pp. 565-566. Voir également le com-mentaire de Pr. Dumitru Stăniloae, note 1116, pp. 565 sq. 2 Albert Camus, L’Homme révolté, Gallimard, Paris, 1951, pp. 30-31. 3 N. Steinhardt, Le Journal de la félicité, éd. citée, p. 170.
144
foi et la liberté s’avère être essentiel pour l’être humain, et l’œuvre de Steinhardt peut encore être explorée dans ce sens.
Il est probable, aussi, que l’un des aspects importants qu’une telle démarche pourrait conduire vers la reconsidération du rôle de la littérature et des arts chez Steinhardt, toujours d’une manière générale. Nous pouvons comprendre, de ses essais et de ses commentaires cri-tiques que, pour Nicolae Steinhardt, l’art est en premier lieu un exercice de liberté. Nous pourrions alors dire que l’art serait au service de la vérité, non seulement dans un sens didactique, mais aussi purificateur? Comment lire, par conséquent, ses fragments critiques? Et, par consé-quent, quelle signification dévoilerait l’appel constant au livresque, les citations, les allusions, les références érudites – toute l’atmosphère cul-tivée, pleine de raffinement, spécifique à ses textes littéraires ? L’art comme milieu de purification de la mémoire, l’art comme instrument de dépressurisation de la pensée ? L’art comme ennoblissement ? Et quel sens acquiert tout cela, quand nous réfléchissons, comme Stein-hardt nous conseille, dans l’horizon de la foi ?
Mais comment Steinhardt, lisait-il la littérature ? Et quand il place son scandaleux volume de début sous le signe d’Antisthius et il choisit comme motto la phrase : « Je pardonne à tous ceux dont j’ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes » – pourquoi la cite-t-il de façon tronquée ? La citation complète, dans Les Caractères de La Bruyère, est: “Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j'ai loués dans mon ouvrage s'ils m'oublient: qu'ai-je fait pour eux ? Ils étaient louables. Je le pardonnerais moins à tous ceux dont j'ai attaqué les vices sans toucher à leurs personnes, s'ils me devaient un aussi grand bien que celui d'être corrigés; mais comme c'est un événement qu'on ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les autres ne sont tenus de me faire du bien. »1 Le fait-il de façon ironique ? Avec malice ? Pose-t-il en personnage cynique ? Fait-il une farce de polisson? Ou bien il joue, purement et simplement? Evidemment, c’est une coupure, faite dans l’esprit de cette période-là. Mais combien il est intéressant de pouvoir constater qu’à la maturité, probablement il aurait fait le même choix !
Et qui sait si c’est complètement par hasard que, voici, Stein-hardt débute dans la littérature avec un motto tronqué, de façon à ce que
1 La Bruyère, Les Caractères, chap. Des Jugements, 67, dans le vol. Jean de La Bruyère, Oeuvres, Belin, Paris, 1820, page 185. Voir également la note explicative n. 23, op. cit., pag. 262 – en gras, ce qui manque dans le motto choisi par Steinhardt.
145
de la citation choisie ressorte l’idée du pardon – pendant que sur la der-nière page de son chef d’œuvre il parle exactement du pardon, comme d’une voie de dépressurisation de l’homme et de communion du bon-heur par excellence. Le Journal de la félicité est un livre qui ne se ferme jamais.
Textes de reference: ***, Integrala N. Steinhardt, un projet initié par l’évêque P.S. Justin Hodea
Sigheteanul, Président de la Fondation « N. Steinhardt » ; collectif ré-dactionnel : Virgil Bulat (†), George Ardeleanu, Florian Roatiş, Ştefan Iloaie, Pr. Arhim. Macarie Motogna, Nicolae Mecu et Viorica Nişcov, Ed. Monastère « Sainte Anna » de Rohia et les Editions Poli-rom, Iaşi
Elementele operei lui Proust, dans « Revista Fundaţiilor Regale », III, no. 8 /
aug. 1936. La Bruyére (1645-1696), dans « Revista Fundaţiilor Regale », XII, no. 4 / dec.
1945. Incertitudini literare, Editura Dacia, Colecția Discobolul, Cluj-Napoca, 1980. Geo Bogza, un poet al Efectelor, Exaltării, Grandiosului, Solemnității,
Exuberanței și Patetismului, Ed. Albatros, București, 1982. Critică la persoana întîi, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1983. (trad.), Vies des moines de Moldavie. Enseignements et apophtegmes des
grands spirituels de l'Eglise Orthodoxe de Roumanie aux 19e et 20e siècles par le Père Ioanichie Bălan – Traduction du texte roumain par le Père Nicolas Steinhardt. Monastère de Chevetogne, 1986.
Prin alții spre sine. Eseuri vechi și noi, Ed. Eminescu, București, 1988. Jurnalul fericirii, éd. Virgil Ciomoş, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991 [trad. fr.:
Journal de la félicité, trad. Marily Le Nir, pref. Olivier Clément, Ar-cantère Éditions / Éditions UNESCO, 1996, 1999]
Monologul polifonic, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991. Dăruind vei dobîndi – Cuvinte de credință, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române
a Maramureșului și Sătmarului, Baia Mare, 1992. Monahul de la Rohia – Nicolae Steinhardt răspunde la 365 de întrebări in-
comode adresate de Zaharia Sângeorzan, Ed. Revistei Literatorul, Bucureşti, 1992.
Între lumi - Convorbiri cu Nicolae Băciuț, Ed. Tipomur, Târgu-Mureș, 1994. Călătoria unui fiu risipitor, éd. Ioan Pintea, Ed. Adonai, 1995. N. Steinhardt (Antisthius), În genul lui Cioran, Noica, Eliade…, postface de
Dan C. Mihăilescu, Ed. Humanitas, Bucarest, 1996.
146
N. Steinhardt – inedit: Autobiografie (N. Steinhardt - inédite: Autobiogra-phie), dans la revue « România literară », n°46, 19 novembre 1997 [http://old.romlit.ro/www/html/rl746.htm].
Primejdia mărturisirii. N. Steinhardt în dialog cu Ioan Pintea, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
Ispita lecturii, préf. Ioan Pintea, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 2000. Dumnezeu în care spui că nu crezi… Scrisori către Virgil Ierunca (1967-
1983), Ed. Humanitas, 2000 Drumul către isihie. Inedite, IIème édition, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 4 scrisori inedite din Epistolarul confiscat de Securitate al lui Constantin
Noica adresate între 1955-1957 lui Nicolae Steinhardt, dans « Ziua », 27 jul. 2002.
Eseu romanţat asupra neizbânzii, Ed. Timpul, Iaşi, 2003. N. Steinhardt, Em. Neuman, Eseuri despre iudaism, trad. etc. Viorica Nişcov,
préf. Toader Paleologu, Ed. Humanitas, Bucarest, 2006. În genul ... tinerilor, éd. George Ardeleanu, Virgil Bulat, Monastère de Rohia
et les Editions Polirom, Iaşi, 2008. Articole burgheze, éd. Viorica Nişcov, et introduction par Nicolae Mecu, Mo-
nastère Rohia et les Editions Polirom, Iaşi, 2008. ***, N. Steinhardt. Între lumi. Convorbiri cu Nicolae Băciuţ, Ed. Nico, Târgu
Mureş, 2009. Călătoria unui fiu risipitor, éd. Adrian Mureşan, Virgil Bulat, Ed. Polirom,
Iaşi, 2013. Bibliographie: ***, Prigoana. Documente ale procesului C. Noica, C. Pillat, S. Lazarescu,
A. Acterian, Vl. Streinu, Al. Paleologu, N. Steinhardt, T. Enescu, S. Al-George, Al. O. Teodoreanu şi alţii, Ed. Vremea, coll. « Faits. Idées. Documents », 1996.
Arșavir Acterian, Amintiri despre Nicolae Steinhardt. Crestomație, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002
George Ardeleanu, Nicolae Steinhardt. Monografie, antologie comentată, receptare critică, Ed. Aula, Brașov, 2000.
George Ardeleanu, În jurul unui „denunţ” al lui G. Călinescu, dans la revue « România literară », n°45, 2003 [http://www.romlit.ro/n_jurul_unui_denun_al_lui_g._clinescu].
George Ardeleanu, Istorie Literară: Acasă la Sigmund Freud dans « România literară » n°5, 2008, [http://www.romlit.ro/acas_la_sigmund_freud].
George Ardeleanu, N. Steinhardt şi paradoxurile libertăţii: o perpectivă monografică, Humanitas, 2009.
George Ardeleanu, Strategii de supravieţuire a memoriei istorice, dans la revue « Dilemateca », VII, n° 75, août 2012,
147
[http://www.romaniaculturala.ro/images/articole/Dilemateca_p.8-11.pdf].
George Ardeleanu, N. Steinhardt şi refuzul „opiumului”, dans la revue « Ta-bor », n°8, novembre 2012, pp. 66 sq.
Izabella Badiu, Métamorphoses de l'écriture diariste à l'âge contemporain. Julien Green, Albert Cohen, Claude Roy, N. Steinhardt, I.D.Sârbu, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005.
Mirel Bănică, Jurnalul fericirii – Sau cartea convertirii unei generaţii, dans la revue « Tabor », nr. 8, novembre 2012.
Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate, éd. II-ème, Polirom, Iaşi, 2005.
CNSAS, Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii (1959-1989), Sélection des documents: Clara Cosmineanu et Silviu B. Moldovan; préface: Toa-der Paleologu, Etude introductive: Clara Cosmineanu, Ed. Nemira, 2005.
Ioana Diaconescu, Scriitori în arhiva CNSAS: N. Steinhard – deţinutul nr. 13/1960 – „Un element duşmănos al regimului democrat-popular”, article paru dans la revue « România literară », n°36/2006, http://www.romlit.ro/n._steinhard_-_deinutul_nr._13/1960_-_un_element_dumnos_al_regimului_democrat-popular].
Lucy S. Dawidowicz, Războiul împotriva evreilor. 1933-1945, trad. Carmen Paţac, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1999.
Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Introducere în omiletică, Editions de l’Université de Bucarest, 2001, pp. 189 sq.
Vasile Gordon, Loc de cinste pentru monahul Nicolae Steinhardt în omiletica românească, dans la revue « Tabor », n° 8, novembre 2012, p. 27.
Răzvan Ionescu, Amintiri despre taina libertăţii sau „De te voi uita Ierusa-lime”, dans « Tabor », n° 8, novembre 2012, p. 38.
Ion Manolescu, Literatura memorialistică. Radu Petrescu. Ion D. Sîrbu. N. Steinhardt, Humanitas, Bucureşti, 1996.
Nicolae Morar, Dimensiunea creştină a operei lui Nicolae Steinhardt, Paideia, Bucureşi, 2004.
Arhimandrit Serafim Man, N. Steinhardt, intelectualul-monah, dans la revue « Limba și literatura română », an XXV, nr. 1 / 1996, București, 1996.
Archimandrit Serafim Man, N. Steinhardt – inedit: Autobiografie, dans la revue « România literară », n°46, le 19 novembre 1997 [http://old.romlit.ro/www/html/rl746.htm].
Adrian Mureșan, Hristos nu trage cu ochiul. N.Steinhardt&generația '27, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006.
Adrian Mureşan, Veriga-lipsă a biografiei literare steinhardtiene, dans la revue « La Punkt », [http://www.lapunkt.ro/2013/03/26/veriga-lipsa-a-biografiei-literare-steinhardtiene/].
148
Toma Pavel, Jurnalul lui Nicu Steinhardt, dans « 22 », III, no.41(142), 15-21 oct. 1992.
Cristina Păiuşan, Radu Ciuceanu, Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 1945-1958, I, l’Académie Roumaine; l’Institut National pour l’Etude du Totalitarisme, Bucarest, 2001.
Viorica Petrescu, Nicolae Steinhardt între Capra şi Fundeni, [http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2011/12/nicolae-steinhardt-intre-capra-si-fundeni/].
Monica Pillat, Jurnalul fericirii, dans « Revista de istorie și teorie literară », an XL, nr. 1-2/1992, Editura Academiei Române, 1992.
Monica Pillat, « Hamlet şi Jurnalul fericirii », dans vol. Cultura ca interior, Ed. Vremea, Bucureşti, 2004.
Ioan Pintea, Jurnal discontinuu cu N. Steinhardt. Însemnările unui preot de ţară, Ed. Ed. Paralela 45, Piteşti, 2007.
Florian Razmos, Jurnalul fericirii: avataruri politice, metamorfoze ale scrii-turii, dans la revue « Observatorul cultural », n°48 (305) / 26.01 – 1.02.2006, [http://www.observatorcultural.ro/Jurnalul-fericirii-avataruri-politice-metamorfoze-ale-scriiturii*articleID_14697-articles_details.html].
Marian Rădulescu, Monahul cinefil – Nicolae Steinhardt, dans « agen-da.liternet.ro », septembre 2009 [http://agenda.liternet.ro/articol/9644/Marian-Radulescu/Monahul-cinefil-Nicolae-Steinhardt.html].
Eugen Simion, « N. Steinhardt », dans Scriitori români de azi, vol.3, Ed. Car-tea Româneasca, Bucureşti, 1984
Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim I. Există o poetică a jurnalului, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005.
Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim III. Diarismul românesc, Ed. Uni-vers Enciclopedic, Bucuresti, 2005.
Eugen Simion, Nicolae Steinhardt, dans la revue « Caiete critice », n° 1-2, 2007, p. 9.
Teşu Solomovici, România Judaică. O istorie neconvenţională a evreilor din România. 2000 de ani de existenţă continuă, vol.I ( De la începuturi şi până la 23 august 1944 ), Ed. Tesu, Bucureşti, 2001.
Ioan Stanomir, Misterul Jurnalului Fericirii, dans la revue « 22 », 08.08.2012, [http://www.revista22.ro/misterul-jurnalului-fericirii-16947.html].
Diana Şimonca Opriţa, « Când l-am văzut acolo, la Câmpulung, ne-am îm-prietenit din primele cinci minute ». Cu Alexandru Paleologu despe N. Steinhardt, dans « Caiete critice », n°1-2-3, 2009, pp. 40 sq.
Diana Şimonca-Opriţa, ... ne întâlneam din când în când, pentru că el venea la biserica Sf. Silvestru să-l vadă pe părintele Galeriu, interviu cu Virgil Cândea, paru dans « Caiete critice », nr. 4, 2009, pp. 19 sq.
149
[http://caietecritice.fnsa.ro/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/4-2009.pdf]. Stelian Tănase, Anatomia mistificării. 1944-1989, Humanitas, 2009.
150
ALEXANDRE SOLJENITSYNE ET LA
MÉMOIRE DU GOUFFRE
Florin OPRESCU
« Et maintenant, le rond de saucisson dans la gueule ! A coup de dents ! A pleines dents ! Oh l’âme de la viande ! Oh, le jus de la viande ! Ça, c’est du vrai, et qui vous descend droit dans les tripes… Une journée est passée. Sans seulement un nuage. Presque de bon-heur. »1
Avant-propos : le besoin de la Mémoire Dans son roman, La musique d’une vie (2001), Andreï Makine
reprend l’expression critique « homo sovieticus », popularisée dans les années '80 par Alexandre Zinoviev, pour rendre une image négative des résultats des années d’oppressions soviétiques en U.R.S.S. L’indifférence, la passivité, la peur obtenues comme résultats de l’oppression, l’obéissance et l’isolement et la permanente méfiance des goulags d’extermination, voilà des traits qui rendaient la vraie image de l’homme nouveau par rapport à la souterraine communiste, contraire au projet stalinien de « homme nouveau soviétique ».
1 Alexandre Soljénitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch, Roman traduit du russe par Lucia et Jean Cathala, Préface de Jean Cathala, Julliard, 1975, p. 189.
151
Le monde du narrateur de Makine, dans la gare glaciale et en-neigée de la désolante steppe russe, est peuplé par des personnages vidés d’âme qui attendent comme dans l’absurde beckettien un train qui est toujours en retard. L’image de l’ancien pianiste Alexis Berg est ex-ponentielle pour l’homme qui essaye à survivre à l’entropie staliniste. Dans cette désolation il couvre avec sa musique bizarre cette masse amorphe de vie uniformisée dans l’isolement désespéré. L’histoire stoïque de sa vie pendant la guerre, en essayant de s’échapper au gou-lag, en renonçant à sa propre identité d’artiste, en acceptant lui-aussi de devenir petit à petit « homo sovieticus », est l’histoire d’une résistance en silence, d’une identité perdue pour toujours. La dépersonnalisation de Berg est le but du projet totalitaire de cet homme nouveau soviétique et ce procédé d’extirpation de l’âme a été le thème essentiel de la litté-rature qui a témoigné de cette affreuse deshumanisation d’un régime concentrationnaire. En perdant son identité, Berg, l’ancien homme d’esprit, devient lui-aussi un chiffre, comme « CH-854 », Choukhov, le personnage Ivan Denissovitch, d'Alexandre Soljénitsyne. De ce point de vue, la tradition de Makine, et de toute littérature qui envisage ce thème de représentation de la vie sous un régime totalitaire staliniste est sans doute la littérature d’Alexandre Soljénitsyne.
Mais l’impact de Soljénitsyne dans la dénonciation des crimes stalinistes semble plus ample qu’une « tradition » littéraire. En dehors de la littérature, la personnalité de l’auteur était doublée par son autori-té morale. Dans une étude intitulée « The Solzhenitsyn Effect": East European Dissidents and the Demise of the Revolutionary Privilege », Robert Horvath affirmait que : « Soljénitsyne a parlé non seulement en tant qu’écrivain, mais aussi comme survivant et témoin de L'Archipel du Goulag, accompagné par les spectres des écrivains morts, une en-tière littérature nationale. »1 Pendant toute son activité, celle littéraire et celle d’activisme dissident, il a été un porte-parole des milliers d’hommes qui, d’après son discours du prix Nobel, ont été« jetés dans l’oubli, non seulement sans tombeau, mais sans habit, nus, avec un nu-méro à l’orteil. »2Il s’agit sans doute d’un terrible assassinat, car le premier, selon l’expression de H. Arendt, c’était d’« assassiner la no-
1 Robert Horvath, « The Solzhenitsyn Effect: East European Dissidents and the De-mise of the Revolutionary Privilege », dans “Human Rights Quarterly”, Volume 29, Number 4, November 2007, p. 896. 2 AleksandrIsaevich Solzhenitsyn, Nobel Lecture, in Solzhenitsyn: A Documentary Record 308 (2d ed. Harmondsworth, Penguin, 1974), apud Robert Horvath, op. cit., p. 896.
152
tion même d’individualité »1. L’autorité morale en ce qui concerne le goulag soviétique et celle littéraire, d’écrivain qui a témoigné les hor-reurs des camps de travail sibériens sont unanimement reconnues. En effet, la vie, les actions, en URSS et en exil, et la littérature de Soljénit-syne nous semble un permanent effort à contredire l’idée de l’homme soviétique de Zinoviev par le stoïcisme de ses personnages et par leur désir de surpasser l’obstacle existentiel. « La prison lui a donné le fond que Tolstoï cherchait sous son pied. Il est une voix d'outre-Goulag, une voix joyeuse, délivrée, décourbée, russe par sa nature et prophétique par sa vocation, une voix qui s'est élevée sous l'haleine de la mort. »2
La solution de Soljénitsyne pour dépasser le chaos entropique du goulag est réservée au créateur, comme on l’apprend dans une inter-view. « Il faut chercher, nous dit-il, le catharsis, la purification dans chaque texte, chaque histoire que l’on écrit. »3 Si ses personnages cher-chent la vie ce n’est pas seulement par la détermination de l’instinct de conservation, mais ces personnages sont aussi désignés par une force qui dérive du derrière de la narration, c’est un besoin de tout dire, de tout confesser, de témoigner la vie. Car « le chaos c’est la mort » et, dans ce contexte, « tout créateur doit trouver des solutions, doit com-battre, doit détruire l’entropie »4 et l’œuvre harmonieuse est le résultat de cette lutte, de ce militantisme vitaliste. « Tout comme George Or-well, Soljénitsyne envisage une société décente dans laquelle l’homme ordinaire est protégé par les abstractions sophistiquées de la Gauche (l’utopie socialiste) et de la Droite (le marché comme une fin en soi sans limitation de la loi et de la moralité). »5
Dans le début de ses mémoires-méditations d’après la prison communiste roumaine, Le Journal de la félicité (Jurnalul fericirii), Nicolae Steinhardt choisit parmi les solutions pour « s’échapper » de la prison, c’est-à-dire pour lui survivre, deux solutions russes, celle de Zinoviev et celle de Soljénitsyne. La solution de l’auteur des Hauteurs béantes, Zinoviev, est celle du Barbouilleur qui ne détient rien et qui n’a donc rien à perdre ; celle de Soljénitsyne est la solution d’Isaievici du Premier Cercle, ou d’Archipel du Goulag. Il s’agit d’une totale re-
1Hannah Arendt, “The killing of man’s individality”, dansThe origins of totalitarism, III, trad. J.-L. Bourget, P. Davreu, P. Lévy, Paris, Points Seuil, 1995, p. 194. 2 Georges Nivat, Soljenitsyne, Les Éditions du Seuil, Paris, 1980, p. 183. 3 http://agora.qc.ca/Dossiers/Alexandre_Soljenitsyne 4Ibidem. 5 Daniel Mahoney J., Aleksandr Solzhenitsyn. The Ascent from Ideology, Rowan & Littlefield Publishers, Maryland, 2001, pp. 12-13.
153
nonciation, d’une complète abdication, d’un « suicide moral ». Mais est-ce que les personnages de Soljénitsyne confirment tous la solution identifiée par Steinhardt, c’est-à-dire celle du suicide, de l’abandon ? Son roman de 1962, Une journée d’Ivan Denissovitch, confirme et, en même temps, infirme cette hypothèse, car chez Soljénitsyne il s’agit de la Vie, puisque ses personnages s’y abandonnent.
Alexandre Issaïevitch Soljénitsyne (1918-2008) :
l’Exilé
« Soljénitsyne est l’écrivain dominant de ce siècle » écrivait David Remnick dans sa « Lettre de Moscou »1 et pourtant il constate que « la plupart des écrivains d’avant-garde de la Russie d’aujourd’hui ne le prennent pas au sérieux. » La mémoire de Soljénitsyne est asso-ciée à la mémoire des Goulags, avec la narration descriptive de la déportation, avec le besoin de la vérité et surtout avec une entière litté-rature carcérale qui l’a suivi. Il a sans doute une place précise et importante dans l’histoire de l’URSS et dans l’histoire littéraire russe. Son destin est celui de l’exilé perpétuel, en cherchant sa place après les années à Rostov sur Don, après le Goulag, l’exil ou la quête d’un pays utopique qu’il ne trouvera jamais. En même temps, sa mémoire n’a pas toujours été celle d’un vrai archange de la liberté et de l’apolitisme, son image publique étant parfois soumise au débat de ses concitoyens. Il a été critiqué par son pacte avec Khrouchtchev pour pouvoir publier son premier roman, Une journée de la vie d’Ivan Denissovitch, et aussi pour son rapprochement vers la politique de Vladimir Poutine. Après le retour de l’exil il recevra en 2007 le président Poutine chez lui, en re-cevant ultérieurement un prix d’Etat : « C’était vraiment un paradoxe douloureux de voir comment l’ancien prisonnier pouvait sympathiser avec l’ancien officier du KGB, affirme son éditeur russe, Viktor Ero-feev. En tant que conscience de la nation, Soljénitsyne aurait dû aussi prendre la parole plusieurs fois ces derniers temps, quand il voyait le pays sombrer dans l’autoritarisme. Je ne sais pas pourquoi il a gardé le silence. Peut-être ses idées politiques lui ont-elles joué un mauvais tour. »2
1 David Remnick, Letter from Moscow, “EXIT THE SAINTS”, “The New Yorker”, July 18, 1994, p. 50; 2Apud http://www.bibliomonde.com/auteur/alexandre-soljenitsyne-2486.html
154
Pourtant, Georges Nivat1, l’un des spécialistes de l’œuvre de Soljénitsyne, comparait son destin à celui de Herzen, « le grand exilé russe du XIXe siècle qui, lui aussi, venu en Occident, dénonçait l'Occi-dent bourgeois et égoïste et s'agrippait à une vision slavophile de la Russie pour ne pas sombrer dans le pessimisme historique. La même occidentophobie nourrit l'une et l'autre vision du monde. »2 Cette Rus-sie utopique qu’il cherche jusqu’au bout de sa vie restera son obsession perpétuelle, une Ithaque perdue à jamais. C’est comme l’image allégo-rique d’un ancien zek qui, rentré du Goulag, ne trouvera plus sa maison, ni dans l’Occident de sa dissidence, ni rentré de son exil dans un pays menacé par la pauvreté et l’esclavagisme idéologique.
Alexandre Soljénitsyne est né le 11 décembre 1918 à Kislo-vodsk, dans le nord du Caucase, six mois après la mort de son père, ancien volontaire pendant la guerre, décoré pour son courage. Cette absence paternelle deviendra spectrale pour tout le reste de sa vie. La famille maternelle de Soljénitsyne était une famille riche de Kouban où son grand-père possédait et administrait de la terre. Six ans plus tard, en 1924, sa mère, Taïssia Soljénitsyne s'installe dans la ville de Rostov-sur-le-Don où le jeune Alexandre aura une enfance heureuse, malgré les embarras matériels. Cette enfance « rostovienne » représentera une nouvelle expérience centrale dans sa vie à cause de l’hybridité eth-nique, la ville étant peuplée par des Casaques, Ukrainiens, Grecs, Arméniens, tout comme l’amalgame ethnique du Goulag représenté dans son œuvre et aussi à cause de la langue russe qu’il apprend ici. Il admet d’ailleurs qu’en matière de langue cette hybridité linguistique, résultat du Babel rostovien, lui a causé des difficultés. « Plus tard, de-venu adulte, j’ai passé des années à rattraper ce que j’avais perdu à cause du mauvais russe pratiqué à Rostov. »3 Il suit l’école dans ce mi-lieu de la province russe et, pendant l’année 1936, il entre à l'université de Rostov en choisissant la faculté de mathématiques et physique. Pourtant, en 1939 Soljénitsyne décide de s'inscrire à l'institut de philo-sophie, d'histoire et de littérature de Moscou, suivant les cours par correspondance, conscient de sa prédisposition pour les sciences hu-
1 D’ailleurs, les points biographiques définitoires pour la carrière d’écrivain de Soljé-nitsyne ont étés réalisés en consultant les informations complètes offertes par Georges Nivat, dans son livre concernant la vie et l’activité littéraire de Soljénitsyne, ed. cit. et en conjugaison avec le travail de D. M. Thomas, op. cit., qui observe plutôt le côtéac-tiviste de l’auteur. 2 Georges Nivat, op. cit., p. 182 ; 3 http://agora.qc.ca/Dossiers/Alexandre_Soljenitsyne
155
maines. L’année 1941 il achève ses études à Rostov et passe aussi des examens littéraires à Moscou. Malheureusement, il est mobilisé en 1941, et quelques mois après il est reçu à une école d'officiers à Kos-troma, où il obtient un grade de lieutenant et, concernant le parcours militaire, il deviendra capitaine pendant l’année 1944.
L’année suivante, suite à la surveillance de sa correspondance contenant des commentaires politiques avec son ami « Koka » Vitkie-vitch, il est arrêté et, le 27 juillet 1945, il est condamné à huit ans de camps de travail et de correction, par l'article 58 du Code pénal de l’URSS. Ses expériences de Goulag commencent à Nouvelle-Jérusalem, puis à Moscou sur un chantier de construction, à la « cha-rachka » de Marfino et ensuite il est envoyé en Asie, à Ekibastouz, en Kazakhstan. Tout comme son premier personnage du Goulag, le pre-mier portrait d’un zek, Ivan Denissovitch, il y sera maçon. Finalement, en février 1953, Soljénitsyne est libéré du camp et il est envoyé en « relégation perpétuelle » au Kazakhstan.
En février 1956, trois ans après la mort de Staline, il sera réha-bilité par le tribunal suprême de l’URSS et il se rendra à Moscou, puis à Rostov. Il obtient un poste de professeur de physique dans une école de campagne. En 1959, Soljénitsyne écrit, en trois semaines, comme une sorte de décompensation après les années de Goulag, le roman Une journée d'Ivan Denissovitch, le texte qui va ouvrir le débat en URSS concernant la vérité des camps de concentration soviétiques des années cinquante. Après de longues négociations avec les représentants du pouvoir, Alexandre Tvardovski, le célèbre rédacteur en chef de la revue littéraire Novy Mir, obtient l'autorisation directe de Nikita Khrouchtchev et publie en décembre 1962, dans le numéro II de la re-vue, Une journée d'Ivan Denissovitch. La résonance de ce texte sera énorme, l’auteur devenant très connu en URSS, tout comme dans le monde entier1, et l’avalanche des réactions le déterminera à affirmer qu’« il s'est échappé alors comme un immense cri collectif. »2 Cette revue propose aussi la candidature de Soljénitsyne pour le prix Lénine. C’est l’année du commencement des dossiers de deux projets, deux livres témoins, très importants dans la création littéraire de Soljénit-syne, l'Archipel du Goulag et Le Pavillon des cancéreux. D’ailleurs il
1 Voir l’anthologie du courrier reçu de Soljénitsyne suite à la publication de ce texte, dans Cahier de l’Herne. Soljénitsyne, Dirigé par Georges Nivat et Michel Aucoutu-rier, Editions de l’Herne, Paris, 1971, p. 212-223. 2Apud Georges Nivat, op. cit., p. 21.
156
commencera à écrire l'Archipel du Goulag en 1966 et il le finira en 1968.
Le 12 Novembre 1969 il est exclu officiellement de l'Union des écrivains de l’URSS et dans la lettre de protestation il affirmera les valeurs humaines qui ont animé sa position envers les oppressions so-viétiques : « Il est temps de se rappeler que nous appartenons d'abord à l'espèce humaine ! »1 Les romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, et le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, apparus déjà en Occident sont des arguments littéraires puissants pour le prix Nobel de littérature qui lui est accordé en 1970, qu’il ne pourra malheureusement recevoir qu’en 1974, après son expulsion de l’URSS. Le prix n’est pas reçu que quatre ans plus tard de son attribution à cause du fait de n’avoir pas pu être présent à Stockholm, afin de garder sa nationalité russe et de peur de ne pas pouvoir revenir à Moscou.
En Décembre 1973, aux éditions YMCA Press de Paris, parait le premier tome du roman l'Archipel du Goulag, parution qui amplifie la campagne de presse négative contre Soljénitsyne en URSS, il est persécuté pour sa résistance vive contre le servage communiste de son pays. En 1974 il lance son « Appel de Moscou », protestation et encou-ragement contre l’humiliation, contre tout mensonge, pour la résistance à tout prix et pour la liberté. En conséquence, un mois après cet appel, le 13 Février 1974, suit « l’arrestation, incarcération à la prison de Le-fortovo. Déchu de la nationalité soviétique et proscrit, Soljénitsyne est envoyé par avion spécial en Allemagne fédérale. Accueilli à l'aéroport de Francfort par l'écrivain Heinrich Böll, il s'installe aussitôt à Zurich, où réside son avocat, et où il retrouve les traces de Lénine émigré. »2A partir de ce moment commencera le long exil activiste de Alexandre Soljénitsyne, un exil actif de vingt ans (1974-1994), avec des pérégri-nations entre la Suisse, les États-Unis et la France, en étant présent avec des conférences et interviews sur les droits de l’homme, l’égalité, l’Occident et son « mal » et la condition de l’artiste dans les pays totali-taires et non-seulement. Pendant toute cette période ses œuvres circulent en samizdat3 en URSS, en gardant l’esprit critique vif, envers
1Ibidem, p. 25. 2Ibidem, p. 28. 3 C’est-à-dire, nous dit l’éditeur français de Soljénitsyne, Nikita Struve : «Une parole écrite soustraite au contrôle du pouvoir, comme les définissent leurs auteurs puisque le mot «samizdat», né de l’URSS, n’existe pas dans les dictionnaires soviétiques. », dans http://www.russieinfo.com/l%E2%80%99editeur-nikita-struve-raconte-son-ami-soljenitsyne.
157
un régime opprimant et envers un Occident sécularisé, entropique, in-capable de persévérer pour les idéaux humanistes.
Alexandre Soljénitsyne regagnera la citoyenneté russe suite au Glasnost et à la Perestroïka, demandés et imposés par la politique me-née par Mikhaïl Gorbatchev et suite à ce processus évident de dénonciation de tous crimes stalinistes, de toutes horreurs des Goulags et des libertés interdites auparavant, L'Archipel du Goulag est publié en URSS aussi à partir de 1989. Après la chute de l’URSS, en décembre 1991, il rentre en Russie le 27 mai 1994 et vit à Moscou jusqu’au4 août 2008, date où il meurt suite à une insuffisance cardiaque. Pendant tout son retour en Russie, Soljénitsyne a gardé son esprit vif, son activisme intellectuel public, en militant pour une Russie qui devrait récupérer la dignité perdue. « Certes, dit-il, notre pays, est la proie de ses propres peurs, violences et horreurs, qui nous étranglent. Mais l’humanité n’est pas un paradis. Elle ne vit pas au paradis. »1
Une journée d'Ivan Denissovitch – la première confes-sion de l’Enfer concentrationnaire
Le moment de l’apparition du roman Une journée d’Ivan Denis-
sovitch, 1962, est très important pour la littérature et pour l’histoire de l’URSS, en étant le premier ouvrage qui ait dénoncé les camps sovié-tiques, les Goulags et de la tragédie des milliers de gens y déportés. Inconnu en 1962, Alexandre Issaïevitch Soljénitsyne, qui connaissait cette expérience atroce, devenait le porte-parole des gens qui mouraient de malnutrition, de froid et à cause de la torture dans ces camps d’extermination soviétiques. « Dans cette période, nous dit son bio-graphe, il est devenu la seule lueur d'espoir pour ceux qui étaient les esclaves du communisme. Dans Ivan Denissovitch, Le Premier cercle, et Le Pavillon des cancéreux il a été capable de relier l’authenticité de l’expérience personnelle avec une superbe unité de forme. »2
L’apparition dans la revue littéraire Novy Mir, en décembre 1962, du roman Une journée d’Ivan Denissovitch est un vrai événement en URSS et pas seulement. Il s’agissait d’une histoire explosive, dans laquelle on apprenait pour la première fois les conditions de vie dans un
1 http://agora.qc.ca/Dossiers/Alexandre_Soljenitsyne 2 D. M. Thomas, op. cit., p. 535.
158
camp de détenus politiques, dans un Goulag, pendant les années 1950. Le personnage suivi pendant une journée, c’est Ivan Denissovitch Choukhov, un simple paysan robuste qui reflète l’image de l’absurdité, du chaos et de la déshumanisation de ces Goulags soviétiques. Mais comment fut-il possible la publication d’une telle confession explosive qui détonnait l’entier système de « rééducation » staliniste des années 50, en le mettant en question. Les contextes favorables à la publication de ce livre se sont conjugués. D’abord, le contexte favorable pour éviter le refus de publication, a été le XXe Congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique (PCUS), congrès qui s'est tenu à Moscou entre le 14 et le 25 février 1956. Apres la mort de Staline, du « Père Moustache »1, comme il est nommé dans le roman, en 1953, on a commencé un pro-cessus de « déstalinisation » et pendant ce congrès, ce processus a été officialisé comme objectif majeur de l’URSS. Le nouveau président, Nikita Khrouchtchev, voulant consolider sa position idéologique et de pouvoir, avait intérêt à entretenir cette « déstalinisation », en dénonçant tous les crimes et les horreurs stalinistes. Dans un tel contexte, le roman Une journée d’Ivan Denissovitch qui décrivait l’existence suite à la déportation dans un camp de travail dans le Nord-Kazakhstan en raison de « trahison de la patrie », pendant les années 50, a trouvé le terrain parfait pour sa parution et est vite devenu représentatif pour cette nou-velle propagande.
Cette parution est possible suite aux négociations successives, après des vifs débats, en 1961, d’Aleksandr Tvardovski, le directeur de la revue Novy Mir, et grâce à ses efforts auprès du Politburo d'URSS. Mais seule l’intervention directe de Nikita Khrouchtchev rendra pos-sible la première édition, en tirage de 96 900 exemplaires dans le numéro 11 de cette revue, en novembre 1962. Ensuite, en 1963, le ro-man aura deux autres éditions, une dans la revue Roman Gazeta (700 000 exemplaires) et l'autre dans la maison d’éditions Sovietski Pissatel (100 000 exemplaires).2 D’ailleurs, l’année 1963 connait aussi une po-lémique âpre entre Literatournaia Gazeta et Novy Mir, débat autour des valeurs idéologiques, ethniques et esthétiques du roman de Soljénit-
1 Dans le roman il y a une allusion à Staline, introduite à la suggestion de Vladimir Lébédiev, comme l’auteur nous confirme d’ailleurs dans Le chêne et le veau,l’œuvre autobiographique de Soljénitsyne : « Un de la chambrée gueulait : - Le Père Mous-tache, vous voudriez qu’il vous plaigne, pauvres croquants, quand il se méfie de son propre frère ? » (p. 168-169). 2 Georges Nivat (dir.), Alexandre Soljenitsyne. Le courage d'écrire, Éditions des Syrtes, 2011, p. 68.
159
syne. On lui reprochait la tendance généralisatrice, la passivité de son personnage et même « une structure archaïque de pensée et de langue, une phraséologie conservatrice ».1 Malheureusement, le fait que cette publication ait été autorisée par Khrouchtchev lui-même pour des rai-sons de propagande lui a valu la principale critique, qui reste encore en question, c’est-à-dire « un critique du socialisme qui restait à l'intérieur du socialisme. » et, tout de même, « le défaut d'insertion dans une con-ception plus globale de la vie soviétique. »2Mais le but de Soljénitsyne n’est pas celui de généraliser et de réaliser un tableau complet de tous les champs de travail de l’URSS, mais celui de provoquer le débat con-cernant cette réalité qui a eu différents degrés de dureté. D’ailleurs, une pensée de Choukhov démontre aussi ce principe : « Ce qu’il y a de bien, au bagne, c’est la liberté à pleines tripes. Une supposition qu’à Oust-Jima vous auriez dit à quelqu’un, dans le tuyau de l’oreille, qu’on manque d’allumettes en ville, ça vous valait sec dix ans de rallonge. Mais, ici, vous pouvez aller crier sur les wagonka ce qui vous chante, les mouchards ne vont pas vous balancer : le Parrain s’en contrefiche » (p. 169). Même l’introduction de Tvardovski, observe Georges Nivat, contient et entretient une perspective similaire : « Ce récit austère est une preuve supplémentaire qu'il n'est point de secteur ou de phénomène de la réalité qui soient aujourd'hui exclus de la sphère de l'artiste sovié-tique et inaccessibles à une authentique description. Tout est fonction des moyens de l'artiste lui-même. »3
Une journée du CH-854, de la brigade 104, c’est-à-dire d’Ivan Denissovitch Choukhov, un moujik vigoureux de la Russie centrale, dans le camp de travail du Kazakhstan, est le noyau d’action de ce ro-man. Il a été accusé pour « trahison de la patrie », c’est-à-dire une accusation politique d' « espionnage », suite au fait d’avoir été le pri-sonnier des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. L’emprisonnement était considéré comme trahison, car on demandait aux soldats soviétiques de choisir plutôt le suicide que l’humiliation d’être prisonnier. D’ailleurs, l’affirmation de Choukhov à Aliocha, le baptiste, « C’est pourtant pas ma faute » d’être condamné, exprime l’absurdité de sa position. Sa condamnation a, elle-aussi, des traits d’absurdité car il avait signé une déclaration pendant l’enquête, d’avoir réussi à s’échapper des Allemands en acceptant d’être leur espion. En
1 Georges Nivat, Soljenitsyne, ed. cit., p. 45. 2Ibidem, p. 45. 3 Aleksandr Tvardovski apud Georges Nivat, Ibidem, p. 45.
160
effet, la division de Choukhov fut encerclée pendant l’année 1942 par les Allemands et ils furent faits prisonniers dans une forêt. En s’échappant, il rejoint les lignes russes mais il est condamné comme traître et emporté dans un nouveau camp et ensuite dans un Goulag ou il est convaincu que, même s’il a reçu dix ans de condamnation, il pas-sera dans cet enfer toute sa vie.
Les huit ans que Choukhov a déjà passé dans les camps, sa dé-tention ayant commencé dans le camp commun de Oust-Ijma, le transforment en le plus véritable zek1, ayant l’objectif de survivre au froid, à la maladie et surtout à la faim. En effet, le roman écrit dans un style direct et descriptif, sans introspection ou dialogue complexe, a comme but principal celui de marquer les « règles » tacites pour sur-vivre une journée dans le Goulag. Cette « recette » dramatique est simplifiée au maximum par Soljénitsyne et les règles pour survivre sont filtrées par les yeux d’un homme simple, sans éducation et sans la conscience des conflits idéologiques possibles. Même les rares souve-nirs que l’auteur permet de revenir à la mémoire de Choukhov sont des souvenirs qui restent sans réponses dans la logique du personnage. Ayant vu « l’époque où on est devenu kolkhozien » (p. 60), il n’arrive pas à comprendre « qu’on vive chez soi et qu’on travaille dehors », en réfléchissant au désastre qui s’est abattu sur les gens du village russe : « Les hommes qui étaient au front, la moitié n’est pas revenue – et ceux qui ont réchappé ne veulent plus entendre parler du kolkhoze : ils vi-vent chez soi et travaillent dehors. » (p. 60), en préférant travailler dans la ville, en usine ou aux tourbières.
Toutes les figures de cette histoire sont celles des survivants dans un enfer glacé du Goulag et on a le tableau d’une masse amorphe des hommes qui luttent pour subsister et qui inventent des méthodes pour le faire. À part Choukhov, « qui comprend la vie » (p. 172), il y a aussi d’autres camarades dans le Goulag qui sont les images de l’adaptation humaine. Mais il nous semble qu’aucune ressemblance entre ces personnages et leur auteur ne peut pas être établi, car il est évident que Soljénitsyne a voulu garder l’air d’objectivité, en filtrant toute l’action par les yeux d’un narrateur impersonnel, qui suit seule-ment les actions quotidiennes et qui connait évidemment la banalité « rituelle » d’un camp de concentration mais qui ne veut pas céder au jugement émotionnel. Il ne permet que rarement des effusions affec-tives et des inflexions de subjectivité. Les figures de Choukhov, Turine
1 Captif, enfermé du Goulag staliniste.
161
le brigadier, César l’intellectuel, Buinovski le communiste, Fétioukov-le-Chacal ou Aliocha le baptiste, à côté des Estoniens, des Lettons, des Moldaves, des Ukrainiens etc. forment un immense tableau divers et hybride de la déshumanisation. L’auteur est presque toujours au-dessus de cette masse indivise de souffrance, comme s’il n’avait aucune expé-rience commune avec ces détenus.
Dans la préface de l’édition française, Jean Cathala a raison en ne trouvant aucune trace entre le condamné à dix ans de travail dans le Goulag, Ivan Denissovitch Choukhov et l’auteur, lui aussi ayant eu l’expérience du camp de travail, en 1945, étant condamné à huit ans de prison pour « activité contre-révolutionnaire ». Cathala constate que ce personnage est « un autrui fabriqué de toutes pièces : le bagnard Ivan Denissovitch Choukhov, meneur de jeu qui ne garde aucune trace de son créateur, ni par le milieu social, ni par son passé, et dont la vision des choses, les réflexions, la langue même restent, d’un but à l’autre du livre, sans une seule fausse note, celle d’un paysan de la Russie cen-trale. Derrière ce truchement, Soljénitsyne disparaît. Totalement. Aucune scène, aucune description, aucune pensée qui semblent venir de lui. »1
Pourtant, au dernier repas, le repas du soir, il nous laisse sentir sa voix, par les yeux de Choukhov, qui dépasse sa vue pragmatique sur le monde, sa perspective de survivant et qui contemple dans la salle à manger l’image d’un prisonnier qui fait note discordante et qui est le seul à flotter au-dessus de cette masse humaine désespérée pour obtenir les écuelles. Il s’agit de U-81, le vieux sans âge et sans borne de libéra-tion, la victime soviétique par excellence : « De cet ancêtre-là, on avait dit encore à Choukhov que ça ne se pouvait plus compter, les années qu’il avait vécues dans les prisons et par les camps, (vu que c’était de-puis qu’il y a eu le pouvoir des soviets). Aucune amnistie ne l’avait jamais touché. A chaque dix ans que finissait sa peine, on lui en rajou-tait dix aussitôt. » (p. 165). L’image de ce vieux, redue par les yeux de Choukhov est une étrange représentation d’une autre façon de surclas-ser les limites du Goulag, et sans doute, il est la voix de l’auteur dans cet enfer, une voix qui récupère la dignité humaine que Soljénitsyne aurait pu trouver dans la figure du Zosime de Dostoïevski.
1 Jean Cathala dans la Préface du roman Une journée d’Ivan Denissovitch, ed. cit., p. 16.
162
« Entre toutes ces échines courbées de bagnards, c’était la seule dressée droite, si droite que, regardé d’en face, le vieux avait l’air de s’être mis un coussin dessous ses fesses. Pas une tondeuse n’aurait pu rien plus mordre sur son crâne, à cause qu’à cette vie de château ses cheveux étaient partis tous. Et les yeux, au lieu de guigner ce qui se faisait au réfectoire, il les gardait braqués par-dessus la tête de Choukhov, sur Dieu sait quoi, que lui seul voyait. Sa lavasse, il la mangeait lentement, avec une cuiller de bois ébréchée, sans piquer un plongeon dans l’écuelle, comme tout le monde, mais en remon-tant la main jusqu’à la bouche. Des dents, il n’en avait ni en haut ni en bas, plus une, de sorte que c’est avec les gencives qu’il mâchait son pain… Mais il faut croire que, dedans lui, c’était de l’accroché solide, car ses trois cents grammes, il les posait point, comme nous autres, à même les salissures de la table, mais sur un bout de chiffon sortant de la lessive. » (p. 165)
En effet, ce portrait est la représentation de l’Esprit, le seul qui
transgresse cet univers atroce qui déshumanise tout être. Par ce vieux ermite, Slojénitsyne laisse la lumière descendre dans l’obscurité perpé-tuelle du goulag et la différence essentielle entre lui et les autres c’est que lui aussi a survécu à l’enfer, mais en gardant l’humanité par la no-blesse de l’esprit. Survivre, comme thème fondamental de ce roman, et généralement de toute littérature concentrationnaire, veut dire com-battre contre l’instinctivité, contre la matière, le corps qui devient obsession et qui demande de la nourriture, de la protection, contre le froid et contre la torture. Quant au vieux observé par Choukhov, sa ré-sistance est réalisée par une transgression de toute matière et par son esprit. Le repas décrit ici c’est comme une Cène, comme un rituel noble et pur dans toute cette ambiance de l’impureté absolue. Le contraste, comme procédé narratif pour accentuer un trait, fonctionne parfaite-ment pour Soljénitsyne. Voilà une des observations méditatives de Choukhov qui nous permettent d’affirmer, en suivant d’autres commen-tateurs de ce roman1, que ce texte n’est pas seulement un récit descriptif qui vise à démasquer les drames du Goulag. Par cette histoire Soljénitsyne suit le chemin de l’homme et de sa deshumanisation, entre le jour et la nuit, en gardant aussi l’espoir de transgresser ce chaos,
1 Des bons exemples dans ce sens sont ceux de George Nivat dans son livre sur Soljé-nitsyne, op. cit., ou plus récemment, de Leona Toker, dans son livre Return from Archipelago. Narratives of Gulag Survivors, Indiana University Press, 2000.
163
cette entropie, comme il décrit le destin de l’écrivain dans l’interview cité.
Leona Toker, dans les commentaires sur « La fiction du Goulag d’Alexandre Slojénitsyne » (« The Goulag Fiction of Aleksandr Sol-zhenitsyn »)1 admet, comme la plupart des commentateurs d’ailleurs, le fait que le roman a eu un effet public terrible, ressuscitant la conscience antitotalitaire de la société, en URSS tout comme en Occident, par l’image des camps de travail pendant l’époque staliniste, que Soljénit-syne rend. En même temps, elle insiste sur le caractère particulier de ce roman dans le tableau des textes qui exposent la réalité des Goulags. « L’histoire, nous dit-elle, ne présente pas un tableau tout à fait fiable et compréhensif de l’expérience des camps de travail. Elle dit la vérité, mais pas la vérité complète, étant placée dans un camp de Kazakhstan, où la vie était meilleure que dans les mines de charbon de la même ré-gion ou dans les camps gelés arctiques. »2 En même temps, Leona Toker admet que Soljénitsyne aurait accepté d’alléger le matériel pour ne pas rater la chance de le publier. Il y a des détails qui manquent par intention et on dirait que ce n’est pas forcément par esquive politique, en profitant du dégel post-staliniste, en gardant quand même un esprit « soumis », mais aussi par technique narrative, car cette « journée » décrit un cadre temporel précis, augmenté au maximum par les yeux du personnage qui cherche à survivre à chaque pas. L’auteur fait parfois abstraction des tentations réalistes d’un tel récit apparemment panora-mique à cause d’une certaine manière existentialiste qui subsiste derrière son discours, celle de l’homme dans un contexte matériel limi-té et absurde qui l’oblige à survivre et à chercher le chemin vers la liberté. Cet existentialisme de substance, élémentaire à toute œuvre de Soljénitsyne et à la grande prose analytique russe d’ailleurs, réclame la capacité de l’homme à surclasser la limite par sa volonté et il est re-trouvé derrière la « technique paradigmatique »3. Cette technique, nous dit la même Leona Toker, consiste dans « le récit systématique d’une journée largement représentative, du réveil au coucher. »4 Il s’agit donc d’un existentialisme paradigmatique.
On peut parler d’une certaine progression dans ce sens dans l’œuvre de Soljénitsyne et, en même temps, d’une certaine descen-
1Ibidem, pp. 188-209. 2Ibidem, p. 190. 3Ibidem, p. 190. 4Ibidem, p. 190.
164
dance, qu’on a déjà anticipée, celle de Dostoïevski. Par exemple, Une journée d’Ivan Dénissovitch dévoile avec précision le mécanisme d’un Goulag et les sources de la vie dans un monde matériel, et dans Le Premier Cercle l’auteur développera une certaine méthode du commen-taire idéologique et métaphysique qui suggère à Vladislav Krasnov la connexion avec la prose de Dostoïevski : « Contrairement à Une jour-née, intéressé premièrement aux aspects physiques de l’enfer staliniste, Le premier cercle est concentré sur son aspect métaphysique, ou idéo-logique. Dans ce sens, Le premier cercle de Soljénitsyne n’est pas seulement idéologique comme toute autre roman écrit par Dostoïevski après ses Souvenirs de la maison des morts mais montre aussi une puis-sante continuité idéationnelle entre les deux auteurs. »1 En effet, une définition de l’homme qu’on peut trouver chez Dostoïevski dans Sou-venirs de la maison des morts définit l’esprit de tout le roman de Soljénitsyne, et surtout du roman Une journée de la vie d’Ivan Dénis-sovitch : « Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.»
Souvent, tout comme certaines figures de Dostoïevski, les per-sonnages de Soljénitsyne cherchent eux aussi la rédemption dans les choses simples, dans la routine quotidienne et matérielle du camp qui offre le bonheur simple et implicitement la raison de vivre. Le sommeil de Choukhov à la fin de sa journée est « presque » un sommeil heureux à cause de ce bonheur simple dans lequel réside le message de ce texte, le message de la vie de Soljénitsyne : survivre à l’entropie et à l’immoralité du monde qui opprime les innocents. « Il s’endormait, Choukhov, satisfait pleinement. Cette journée lui avait apporté des tas de bonnes chances : on ne l’avait pas mis au cachot ; leur brigade n’avait point été envoyée à la Cité du Socialisme ; à déjeuner, il avait maraudé une kacha ; les tant-pour-cent avaient été joliment décrochés par le brigadier ; il avait maçonné à cœur joie ; on ne l’avait point pau-mé avec sa lame de scie pendant la fouille ; il s’était fait du gain avec César ; il s’était acheté du bon tabac ; et au lieu de tomber malade, il avait chassé le mal (p. 189) ».
L’idée de Soljénitsyne est celle de trouver le bonheur dans la vie, une philosophie épicurienne paradoxale, car dans des conditions hostiles au corps, déterminé par la sensation continuelle de la faim et du
1Vladislav Krasnov, Solzhenitsyn and Dostoevsky. A study in the Polyphonic Novel, George Prior Publishers, University of Georgia Press, 1980, pp. 22-23.
165
froid sibérien, les détenus trouvent un appui dans des choses qu’autrement ils auraient ignorées : « Aujourd’hui, ç’a été fête : deux kacha au déjeuner, deux soupes au dîner ! Bonne chose, et pour quoi on peut bien remettre les autres. » (p. 164) C’est une des joies simples de la vie de Choukhov, qui a la vie d’une machine, et par cette mécanicité on peut dire que Soljénitsyne trace la vie menaçante de l’homme mo-derne en général, de l’individu qui devient machine, semblable à une autre forme d’esclavagisme. Tous les jours il transporte des briques et de la terre, est en même temps le maçon, le charpentier, martèle et coupe le bois et finalement, puisqu’il n’a pas été malade et mis au ca-chot, parce qu’il a eu du bon tabac, le double de nourriture, il remercie à Dieu, à « son » Dieu pour encore une journée qui est passée, c’est-à-dire « presque de bonheur ».
Ce bonheur simple est le substitut de la liberté car à part la faim et le froid le détenu doit éviter même de penser à la liberté. C’est ici qu’on trouve le sens du choix d’un tel personnage simple et physique-ment robuste comme Choukhov, qui peut facilement éviter les réflexions qui pourraient le déchirer et l’affaiblir : « Or, même pour penser, ça n’est jamais libre, un prisonnier. On retourne toujours au même point, en n’arrêtant pas de retourner les mêmes idées. Est-ce qu’ils ne vont pas retrouver la miche en fourgonnant dans la paillasse ? Ce soir, est-ce que le docteur voudra bien vous exempter de travail ? Le commandant, il couchera au mitard ou pas ? Et comment il a pu s’arranger, César, pour se faire donner des affaires chaudes ? » (p. 58). Pourtant, en vue de chercher le sens de ce monde absurde, comme pro-longation de son expérience du Goulag, l’auteur crée à la fin de son roman une connexion avec les textes à venir, en anticipant le ton rhéto-rique du Premier cercle, par exemple. La question finale du personnage est éloquente pour cette quête du sens : « Est-ce qu’il voulait vraiment, la liberté ? Ou pas ? ». La réponse prouve cette lutte entre la chair et la conscience, entre l’intérieur, associé à ce qu’il connait et maîtrise déjà dans le Goulag et la déchirante peur d’un extérieur menaçant qu’il ne connait plus : « Ou pas ? Il n’en savait plus rien. Au début, oh, ce qu’il voulait ! ». Le processus de renonciation prouve une sorte de conver-sion de Choukhov à une religion des zeks, la religion des résignés. Mais cette religion est fondée, tout comme celle du baptiste Aliocha, sur la conviction de la Vie. L’argument narratif utilisé par Soljénitsyne est l’utilisation et la fonction de la mémoire de Choukhov. Par exemple, il se rappelle, toujours dans ce contexte de la méditation sur le sens de la
166
liberté, et en argumentant sa nouvelle conviction, le fait que « chaque soir, il comptait combien des jours avaient passé et combien restaient encore à faire. Ensuite, il en eut marre. Et, après, ça s’est éclairé : des gens comme lui, on ne les renvoie pas chez soi : on les relègue. En re-légation, est-ce qu’il vivrait mieux qu’ici ? Ça reste à voir. Or la seule chose qu’il demanderait au bon Dieu, c’est de rentrer chez soi. Et ren-trer chez soi, on ne lui permettra jamais.» (p. 186)
Une journée d’Ivan Dénissovitch est une œuvre d’avant-garde de la littérature concentrationnaire et anticipe l’Archipel du Goulag, Une voix dans le chœur, de Siniavski ou Journal d’un condamné à mort, de Kouznetsov. Mais contrairement à Chalamov ou Siniavski et même à la logique froide et sombre de Zinoviev, « Soljénitsyne a trou-vé, au cœur même de son expérience concentrationnaire, non la nuit de l'absurde mais l'éclat du sens. Là s'est forgé son caractère définitif ». Dans cette direction, il nous semble qu’il rejoint la quête du sens de la vie de Dostoïevski. La contemplation froide du « propagandiste » reli-gieux Aliocha est importante pour son personnage Choukhov du roman Une journée d’Ivan Dénissovitch. À la fin de cette description grave d’une journée de la vie concentrationnaire d’un zek, une méditation dans cet enfer nous relève les convictions d’un simple paysan soumis à la terreur définitive du Goulag. En regardant Aliocha, Choukhov com-prend qu’ « il ne frime pas, Aliocha. Ça s’entend à sa voix et ça se voit à ses yeux : il est heureux en prison. » (p. 186) L’explication est expo-nentielle pour tout exilé absurde et implicitement pour le destin de l’auteur : « - Tu vois, Aliocha, dans ton cas, ça se goupille bien : le Christ t’a dit d’aller en prison alors tu y es allé pour le Christ. Mais, moi, pourquoi j’y suis ? Parce qu’en 41 ils s’étaient pas préparés à faire la guerre ? C’est pourtant pas ma faute. » (p. 186) Si au début de son emprisonnement il cherchait la journée à venir pour entrevoir le salut, après des années, l’exilé cherche la raison, le sens du chaos et de l’entropie. Il confie à Aliocha n’avoir pas perdu la croyance en Dieu. « Seulement, lui dit-il, je peux pas croire à votre ciel et à votre enfer. Faudrait quand même pas nous prendre pour des demeurés en nous promettant l’un ou l’autre. » (p. 185) L’emprisonné ne croit plus au futur, donc dans le possible. Il survit à l’instant dans le concret qui n’exclut pas Dieu, comme dit Ivan qui le remercie pour encore une journée de vie, mais qui l’implique dans le quotidien. C’est ici qu’on trouve, dans la durée et au quotidien, toute la religion d’un zek.
167
Bibliographie : ***Alexandre Soljénitsyne. Le courage d'écrire, Georges Nivat (dir.), Édi-
tions des Syrtes, 2011 ; ***Cahier de l’Herne. Soljénitsyne, Dirigé par Georges Nivat et Michel Au-
couturier, Editions de l’Herne, Paris, 1971 ; ***Solzenitsyn, Alexander. An International Bibliography of Writings by and
about Him, Compiled by Donald M. Fiene, Ann Arbor, Ardis, 1973; Arendt, Hannah, “The killing of man’s individality”, dansThe origins of tota-
litarism, III, trad. J.-L. Bourget, P. Davreu, P. Lévy, Paris, Points Seuil, 1995 ;
Horvath, Robert, « The Solzhenitsyn Effect: East European Dissidents and the Demise of the Revolutionary Privilege », dans “Human Rights Quar-terly”, Volume 29, Number 4, November 2007;
Krasnov, Vladislav, Solzhenitsyn and Dostoievsky. A study in the Polyphonic Novel, George Prior Publishers, University of Georgia Press, 1980;
Mahoney J., Daniel, Aleksandr Solzhenitsyn. The Ascent from Ideology, Ro-wan & Littlefield Publishers, Maryland, 2001;
Nivat, Georges, Soljénitsyne, Les Éditions du Seuil, Paris, 1980 ; Remnick, David, “Letter from Moscow. EXIT THE SAINTS”, dans “The
New Yorker”, July 18, 1994; Soljénitsyne, Alexandre, Une journée d’Ivan Denissovitch, Roman traduit du
russe par Lucia et Jean Cathala, Préface de Jean Cathala, Julliard, 1975 ;
Toker, Leona, Return from Archipelago. Narratives of Gulag Survivors, In-diana University Press, 2000;
http://agora.qc.ca/Dossiers/Alexandre_Soljénitsyne http://www.bibliomonde.com/auteur/alexandre-Soljénitsyne-2486.html http://www.russieinfo.com/l%E2%80%99editeur-nikita-struve-raconte-son-
ami-Soljénitsyne
168