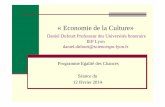Prévention des risques infectieux dans les laboratoires ... - SF2H
Droit et economie de la regulation Les risques de regulation Volume 3 sous la direction de
Transcript of Droit et economie de la regulation Les risques de regulation Volume 3 sous la direction de
Droit et economie de la regulation
Les risquesde regulation
Volume 3
sous la direction de
Marie-Anne Frison-Roche
avec les contributions de
Kerry Allbeury Emmanuel JeulandHerve Ascensio Jean-Pierre Jouyet
Christian de Boissieu Alain LacabaratsThomas Cazenave ^avid Martimort
Jacques Cremer Robert MettoudiFrancois Ewald . . • ., .
, , . r Maurice NussenbaumJean-Louis Fourgoux p' i
Marie-Anne Frison-Roche ^ " " ^ Jean-Michel Clachant Jerome Pouyet
Antoine Cosset-Crainville Gerard RameixMichel Cuenaire Joel R. Reidenberg
Martin Hirsch Jacques Ziller
2005
PRESSES DE SCIENCES PO ET DALLOZ
David A. Westbrook, City of Cold : An Apology For Capitalism in a Time ofDiscontent, Routledge, 2003'.
Les habitants des Etats-Unis d'Amerique se presentent & nous, francophones d'Eu-rope, comme de vieux amis qu'on ne reconnait plus apres un trop long voyage. Nonseulement nous ne les reconnaissons pas, mais les mots qu'ils utilisent n'ont souventplus le meme sens que pour nous, ce qui nous desespere de communiquer. C'est biendommage.
Un ouvrage important d'un jeune auteur americain proche de John-KennethGalbraith, David Westbrook, nous donne I'occasion d'observer un pan de la penseeoutre-Atlantique sur la question enflammee du marche et de sa regulation.
L'ouvrage parait au milieu d'une avalanche sans precedent de mecontentementscontre le capitalisme et la puissance laissee aux mecanismes de marche dans notresociete. Est-ce que les marches libres {free markets) donneront a la societe, sur le longterme au moins, des solutions ad^quates k nos probl^mes de societe, ou est-ce que lecapitalisme et leJaisser^faireieront germer_une apocalypse sociale, a defaut d'inter-vention d'une force temperante contre la soif inextinguible de pouvoir et d'enri-chissement de ceux qui dominent le marche ?
Est-ce que I'intervention du legislateur ou du gouvernement fausse le fragile6quilibre de la nature (le marche) ? Est-ce qu'au contraire cette intervention permetau marche de fonctionner parce que le marche ne serait pas le lieu d'une activitenaturelle, mais le produit d'une construction humaine, trop humaine ? Est-ce que lemarche impose ses regies, comme un dieu le ferait, ou est-ce que les regies de marchesont convenues entre les participants a ce marche ?
L'ouvrage de David Westbrook, qui rassemble une serie d'essais structures autourde ces questions, apporte une reponse philosophique — pour ne pas dire subtile — aces questions, meme s'il soutient que « le temps des philosophes (en fran^is dans letexte) est passe, et n'est plus accessible^ ». Son approche est postmodeme — pour nepas dire ironique — meme s'il declare vouloir ^viter une approche postmoderne
1. Ce texte reprend des ldees d^velopp^es dans deux commentaires publies par I'auteur de ceslignes dans le n° 52 : 4 de la Buffalo Law Review et dans le n° 39 : 1 du Journal of World Trade. L'auteurremercie les editeurs de ces revues de I'y avoir autorise.
2. Note 4 a I'introduction de David A. Westbrook, City of Gold : An Apology For Capitalism m aTime of Discontent, p. 307.
Analyses bibhographiques 307
« Standard^ ». II tente d'offrir a ses lecteurs une description de l'organisation de notresociete, de la maniere dont nous y vivons, sans s'enfermer dans quelque ideologie quece soit. Et il presente notre societe globalisee sous un titre surprenant et, a premierevue naif, celui de la « Cite de Tor"* ».
Les circonstances entourant l'ecriture de l'ouvrage' peuvent etre comparees,meme si de loin seulement, a celles qui ont entoure Blaise Pascal lorsqu'il ecrivait cequi devint ses Perxsees. II s'agissait d'ecrire une apologie du christianisme, alors que denombreux pratiquants se plaignaient des inconstances de I'Eglise, de ses divisions, etque certains philosophes des Lumieres se moquaient de cette institution qui n'avaitque trop demontre ses immenses faiblesses.
Les essais de David Westbrook sont enracines dans notre societe visible, unesociete globalisee, cosmopolite, qui cultive l'individualisme, le progres et la consom-mation. David Westbrook nous ramene au principe dont procede l'action des deci-deurs politiques et economistes : la politique et I'economie ne sont pas des fins en soi,il s'agit de moyens destines a nous aider a communiquer et a am^liorer les echanges(monetaires et non monetaires) entre nous.
Trouverons-nous le « sens de la vie » dans l'arene politique ? Realiserons-nousnotre destinee a travers le succes economique ? L'auteur donne une reponse negativea ces deux questions. Pourtant, l'efficacite de notre organisation politique et econo-mique est un fait. Et ce fait est digne d'une apologie.
L CONCEPTION DE LA « CITE DE-L'OR »-
Le livre est divise en quatre parties, chacune divisee en trois essais iteratifs, sauf lapremiere partie qui compte cinq essais.
La premiere partie (« Desire's Constitution ») decrit notre « Cite de I'or » histo-riquement (comment fut-elle congue ?) et structurellement (comment fonctionne-t-elle ?). La deuxieme partie identifie les limites de cette societe et sa pauvreteexistentielle (elle genere I'alienation, des relations inauthentiques et une identitefondee sur le shopping et I'imitation). La troisieme partie examine les approches intel-
3. Op. at., chap. II, note 22, p. 313.4. En contraste a la « Cite de Dieu » de Saint Augustin, la « Cite de Tor » est mat^rialisee unique-
ment par le travail et l'action humaine. L'or, c'est-a-dire l'argent, est le fluide vital de cette cit^. Encontraste a la « Cite de Dieu », la « Cite de l'or » est elementaire, alienante, et incline a une certainetyrannie. Neanmoins, ajoute l'auteur, « je maintiens que [la Cit6 de ror] peut etre justifiee, et meme,avec certaines reserves, admiree » {op. at., p. 303). C'est ce que l'ouvrage tente de demontrer.
5. Notamment l'essor fulgurant des valeurs technologiques suivi de leur effondrement enmars 2000, les elections controversees de Georges W. Bush en 2000, les attentats du 11 septembre2001, la globalisation, les divers scandales financiers de ces dernieres annees.
308 Les risques de regulation
lectuelles du marche : la science economique, la justice sociale et le lib^ralisme poli-tique. Ces dernieres approches sont toutes considerees comme epuisees (exhausted),incapables de nous apporter l'apaisement attendu. La demi&re partie tente de recon-cilier les attentes humaines d'identite, d'authenticite et de communication dans lecadre de cette Cite.
A . L'^CONOMIE DE MARCH^ COMME VECTEUR DE PAIX
Le premier essai decrit le tournant conceptuel qui s'imposa au lendemain de laseconde guerre mondiale. Le XIX si^cle avait ete celui de l'industrialisation et del'avenement de I'Etat bureaucratique. La premiere guerre mondiale a inscrit dans lefonctionnement de la societe un principe de brutalisation^ qui s'est encore renforceavec la seconde guerre mondiale pour atteindre des sommets d'industrialisation et debureaucratisation de la destruction.
Apres la seconde guerre mondiale, des hommes comme Harry Dexter White,George C. Marshall, Dean Acheson, jean Monnet et Robert Schuman, mandarinsdes temps modemes, ont mis leurs forces au service de la creation d'un environne-ment international heritier de cette industrie et de cette bureaucratie, mais qui seraitle lieu le plus improbable de renaissance de ces violences insensees. Le « Marchecommun » europeen et les accords de Bretton Woods sont vus par l'auteur commeleur plus bel achevement'.
Le nouvel environnement international a ete fonde sur l'integration econo-mique, cette integration _etant vue non comme unaccessoire a faction politique,mais comme un mecanisme constitutif de ce nouvel environnement^. Cette consti-tution etait fondee sur la substitution de I'engagement economique a l'enthousiasmepolitique.
La constitution de la « Cite de l'or » a muri pendant la guerre froide (1945-1991). La chute du mur de Berlin a apporte la consecration symbolique du succes ducapitalisme de marche sur son ennemi jure, le collectivisme etatique. A partir de cemoment, le role eminent des mecanismes de marche dans notre societe ne pouvaitplus etre nie, meme s'il ne cessait pas pour autant d'etre problematique.
6. G. L. Mosse, De la grande guerre aux totalitarismes. La brutalisation des societes europeennes,Hachette, 1999.
7. L'auteur ne fait que mentionner la constitution de TONU. On peut I'expliquer parce que son sujetest centre sur I'economie politique et financi&re, et que la constitution de I'ONU repond plus a desdeveloppements traditionnels de la politique international qu'a l'essor d'un nouveau langage et d'unenouvelle logique.
8. D. A. Westbrook, op. dt., p. 25.
Analyses bibhographiques 309
B. CONSTITUTION POLITIQUE D'UNE ECONOMIE DE MARCHE
Particulierement pour les penseurs europeens continentaux, cette evolution consti-tue un retoumement sans precedent. Les valeurs republicaines identifiees notam-ment par Montesquieu et Rousseau devaient etre revues. Meme si ces valeurs restentaux fondements de nos societes democratiques, elles ont demontre qu'elles ne suffi-saient pas a faire un monde de paix; elles contenaient encore les germes de nouveauxmassacres pour le bien de la nation. 11 fallait penser au-dela du Leviathan hobbesiensi Ton voulait apporter une paix durable {enduring peace) a notre monde.
Montesquieu a vu I'equilibre de la constitution politique de la societe dans laseparation des pouvoirs. Les branches legislatives, executives et judiciaires du pouvoirdans un Etat de droit, autonomes les unes par rapport aux autres, contribuaient, atravers les tensions qui les reliaient, a creer pour le citoyen un espace de liberte satis-faisant.
Le nouvel ordre instaure dans la « Cite de l'or » place les marches face a cettetriade de pouvoirs. Les marches constituent une composante influente de notreregime politique. L'agora est confrontee au forum, c'est-a-dire au marche et, biensouvent, il est remplace par le marche.
Avant de critiquer le poids ecrasant des marches sur notre politique, les autresessais de la premiere partie decrivent la structure de la « Cite de l'or ». L'argent estle principal moyen de communication dans cette c i te ' : a travers les mecanismes desprix, des choix publics sont realises, des productions sont lancees ou abandonnees,des regions sont desertees ou envahies par des entreprises economiques.
Les marches financiers ajoutent une dimension temporelle cruciale a notresociete. La valeur d'un actif financier, c'est essentiellement Tactualisation des profitsfuturs qu'il pourra engendrer *°.
9. En tant que l'argent represente egalement un investissement ou un engagement, il implique uncertain degre de confiance et de croyance. Cet element qui me parait essentiel est mentionne en passantpar l'auteur (op. cit., p. 49).
10. En fait, la plupart du temps, l'investisseur achete des espoirs de revenus futurs, sur la base decroyances qui sont plus ou moins fondees sur une analyse rationnelle de I'information collectee. Lesmarches creent ainsi une approximation collective de la valeur des choses, ce qui constitue en fait unensemble de croyances communes {op. cit., p. 71; sur l'idee que les croyances collectives dans le marchesont des conventions, des accord mutuels tacites — et mimetiques — v. A. Orlean, Le pouvoir de lafinance, Odile Jacob, 1999. Andr^ Orlean developpe une th&se controversee de l'attitude mimetique— autoreferentielle — des acteurs des marches financiers, developpee par John Maynard Keynes inTheorie generak de I'emploi, de I'interet et de la monnaie. Petite biblioth&que Payot, 1971, Livre IV,chap. 12, sections IV et V, oCi il ecrivait, en 1935, ces fameuses phrases : « Le risque de predominancede la speculation tend a grandir a mesure que l'organisation des marches financiers progresse [...] Lorsquedans un pays le developpement du capital devient le sous-produit de l'activite de casino, il risque de s'ac-complir en des conditions defectueuses [...] II est generalement admis que, dans I'interet meme dupublic, l'acces au casino doit etre difficile et couteux. Peut-etre ce principe vaut-il aussi en matiere deBourses. »).
310 Les risques de regulation
Cette structure marchande et financiere genere Tantith^se d'une communautesociale. L'argent a pour correlat la propriete privee. Inversement, sans proprieteprivee, pas besoin d'argent. La propriete privee, c'est essentiellement le droit d'ex-clure les autres *'. Ce qui amene l'auteur a conclure que les habitants de la « Cite del'or » s'excluent mutuellement. Se referant aux propos du jeune Marx, il constate queles temps modemes sont des temps ou les relations humaines ont, dans une largemesure, ete remplacees par des relations aux choses ^^, a la propriete. Cette evolutionleur fait perdre le sens de la rencontre avec autrui, de l'echange humain. L'analysemarxiste se prolonge dans le constat que les gens peuvent, dans la sphere econo-mique, etre assimiles a une matiere premiere, a des choses utiles et rentables. Marxconsiderait — d'une fagon romantique sans doute — que cette situation devait, parle processus dialectique de I'histoire, generer des soulevements de masses et la revo-lution. Cette perspective eschatologique est largement discreditee, refrenee et acade-miquement rejetee aujourd'hui.
Dans la « Cit^ de l'or », eviter de devoir partager est un point focal de la poli-tique. L'envie est un vecteur puissant d'activite de la societe de marche '^. Cettesociete cree de toutes pieces la rarete en mettant les desirs et les appetits au centredu debat politique. Cette situation implique que « dans une telle culture, l'idee d'ega-lite ne peut pas etre prise au serieux *'* » et qu'une telle societe est incapable d'arti-culer une chose publique, une res publica. La « Cite de l'or » est un assemblaged'individualistes en competition, une constellation d'egoistes. Les habitants de la« Citd de l'or » ne sont ni citoyens d'une nation, ni citoyens du monde.
Voila la desagreable conclusion de la premiere partie de cet ouvrage remarquable.D'une part, le concept d'Etat nation est disqualifie. D'autre part, les fondations denotre societe sont terriblement pauvres moralement.
11. Comp. Particle 544 du Code civil: « La propriete est le droit de jouir et disposer des choses dela maniere la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibe par les lois ou par les regle-ments. » Le souci d'autrui est etranger & cette definition, sauf, indirectement, dans la limitation l^galeevoquee.
Meme la religion catholique considere de longue date que la propriete privee est un droit naturel(voir notamment les encycliques Rerum Novarum, 1891, et Centesimus Annus, 1991). Les fameusesencycliques Mit Brenner\der Sorge et Divini Redemptoris, 1937, qui adoptaient une attitude tres trancheea la fois contre le nazisme et contre le communisme sont des exemples frappants de I'engagementcontemporain de I'Eglise catholique sur les questions sociales, sp^cialement la question de la legitimitede la propriete privee. Le droit d'exclure est, comme il est dit au texte, visceralement compris dans l'ideede propriete privee. Savoir comment rdconcilier cela avec le message chretien de charit^, c'est uneautre histoire (v. notamment P. Ricoeur, Liebe und Gerechtigkeit/Amour et Justice, Hrsg von OswaldBayer, Tubingen, Mohr, 1990).
12. II faut bien reconnaitre I'importance des « choses », pivot de nos interets materiels et des lorsde notre individuation materielle (voir le texte de Hanna Arendt, auquel se r^fere la note 48 ci-dessous).
13. D. Westbrook, op. cit., p. 88.14. W., p. 89.
Arudyses bibliographiques 311
II. EXILDUMOI
La deuxieme partie de l'ouvrage rassemble des essais critiques sur la position de l'in-dividu dans la « Cite de Tor ». Cette « Cite de Tor » est d'abord alienante. En Tab-sence de communaute, Tinteraction humaine se reduit a des echanges marchands,sans aucune signification collective (autre que celle de Tenrichissement monetaireindividuel ou collectif— le PIB — qui est denue de sens en lui'tneme) '5.
La « Cite de Tor » genere Tinauthenticite, des relations artificielles gouvemeespar Tapparence, volontiers fallacieuses, impregnees de calculs et de strategies, ainsique la theorie des jeux ** nous Texpose a Tenvi. Les habitants de cette Cite sont desmercenaires : ils agissent en fonction du retour sur investissement qu'ils attendent deleur engagement personnel dans le marche du travail '^. Le soir, une fois sonnee laretraite, ils rentrent dans le no man's land de leur privacy, cet espace vide de sens parla societe marchande, mais fierement protege des outrages de la chose publique.
En elevant les relations monetaires au rang de principe constituant, la « Cite deTor » a abjure la possibility d'une vie politique sincere '^. La « Cite de Tor » recon-nait que notre sens commun et la plupart de nos references sont en fait de puresconventions, avec une part significative d'arbitraire. L'identite dans cette Cite estenracinee dans Texperience d'etre un consommateur et la confiance dans un avenirdefini en termes financiers (benefices financiers, pecule de vacances, pecule pour laretraite", etc.).
Toute signification, vue comme un imperatif romantique ou existentiel, estabsente de la « Cite de Tor ». La recherche de la quietude a Tinterieur du cercledoux de la vie privee serait la seule issue a cette fatale absence de sens dans la viepublique mercenaire ^°. Ce tournant vers la vie privee est une forme d'exil. L'exil eststructurel dans la « Cite de Tor », ce qui nous ramene a l'idee que cette cite est Tan-tithese de toute idee de communaute ou de reconnaissance. Dans la « Cite de Tor »,nous vivons ensemble exiles les uns par rapport aux autres. L'harmonie, le sentimentd'appartenance peuvent exister, mais en dehors de la « Cite de Tor ».
15. Ainsi que John-Kenneth Galbraith le rappelle vigoureusement dans son dernier ouvrage {Lesmensonges de I'economie, Grasset, 2004, p. 30).
16. Pour une introduction a cette theorie economique, v. notamment P. Cahuc, La nouvelle miaroe'conomie. La Decouverte, coll. « Reperes », 1998, p. 17-47.
17. Ce sentiment a et€ brillamment exprime dans l'ouvrage de Corinne Maier, Bonpurparesse. DeI'art etdela necessite d'enfaire le moins possible en entreprise, Michalon, 2004. Cet ouvrage, qui exprimeun sentiment manifestement partag^ des deux cot^s de l'Atlantique, a pourtant genere des commentairessarcastiques tant dans le Financial Times (27 juill. 2004) que dans le New York Times (14 aout 2004).
18. Id., p. 143.19. Le pecule, nous rappelle le Petit Robert (1997), est la somme des « economies qu'un esclave
amassait pour acheter sa liberte ».20. D. Westbrook, id., p. 161.
312 Les risques de regulation
La conclusion de la deuxieme partie est que la « Cite de Tor » n'est pas digned'allegeance. Elle ne peut etre notre abri pour la vie^^ Mais elle fonctionne.
III. APPROCHES INTELLECTUELLES DU MARCHE
La troisieme partie de l'ouvrage aborde les approches intellectuelles classiques dumarche : Tapproche scientifique (la science economique), Tapproche sociale (le debatsur la justice sociale) et Tapproche politique (le marche vu comme le centre vital dela societe liberale).
A. ECONOMIE
L'economie vue comme une science est un phenomene relativement recent. L'en-quete d'Adam Smith sur « la nature et les causes de la richesse des nations » etait unessai de philosophie et de politique par un professeur de philosophie morale. C'estavec des economistes comme Ricardo et Walras que les mathematiques ont investila pensee economique liberale initiee par Adam Smith.
Les mathematiques, par leur puissance d'abstraction et leur rigueur logique, ontpu aider a mieux circonvenir le phenomene complexe du marche dans I'economieliberale. Cette evolution est en ligne avec le mouvement d'expansion du domaine dessciences et de la rationalite, qui devait provoquer un repli des valeurs religieuses et,principalement, de la croyance. La libre recherche scientifique devait faire progres-ser la revelation de verites universelles ou particulieres et permettre enfin de maitri-ser le cours des choses. La verite ne doit plus etre decouverte a travers lacontemplation ou la perception de messages prophetiques. La verite se decouvre a Tis-sue d'un processus purement humain de recherche et d'experimentation sous lecontrole de la raison.
Les venerables moines diriges par des abbes qui tissaient un ample manteauintellectuel sur TEurope du Moyen Age ont ete remplaces par des armees de fonc-tionnaires diriges par des managers technocrates. Tous ont en commun ce talentd'etre silencieux sur les fins qu'ils poursuivent. Ils sont eduques, conditionnes etprevisibles. Leur identite disparait derriere la toute-puissance des structures qu'ilsservent^^. Dans cette mesure, il y a bien continuite dans le processus historique.
21./d., p. 167.22. Lire a ce propos l'etude exceptionnelle de la philosophe et fonctionnaire europeenne, Nicole
Dewandre, Critique de la raison administrative, Le Seuil, 2002. Elle analyse la syntaxe de l'action admi-nistrative et souhaite y voir naitre une same culture ironiste, c'est-a-dire responsable, mais non denuee
Analyses bibhographiques 313
meme s'il y a quelques regrettables hoquets sanglants dus a des exces de convictionou de passion.
La mathematisation de I'economie offre Texemple le plus frappant de la tenta-tive d'objectiver — de maitriser — l'action humaine. C'est une veritable quete dunouveau Graal, celui de la verite ultime des mecanismes de marche. Leur explicationest recherchee aussi profondement que possible jusques et y compris dans Tintimitedes acteurs du marche, dans leurs reins et dans leur coeur.
Implicitement, cette attitude en economie considere comme acquis que lesmecanismes de marche sont, en fin de compte, autosuffisants, qu'il n'y a plus rien endehors du marche qui pourrait exercer une influence de Texterieur, non susceptibled'etre mattrisee par la science economique. Les marches pourraient etre decrits sansaucun recours a Texpression de sentiments, de preoccupations pour Tenvironnementou les inegalites.
Tout ce qui exerce une influence sur l'attitude des participants du marche doitpouvoir etre int^gre dans le module mathematique de I'economie, fut-ce sous formede cout de transactions {transaction costs) ou d'extemalites. L'extraordinaire deve-loppement de I'economie comportementale indique bien a quel point Tambition deI'economie est de capturer tous les aspects du comportement des agents dans lemarche^^. Cette ambition est peut-etre une nouvelle forme, passagere, de la deme-sure, T« hubris » de la demarche scientifique modeme.
Mais David Westbrook considere que ce n'est pas tant T« hubris » scientiste deseconomistes qui cause notre desappointement que leur inhabilite a voir dans lesmecanismes monetaires un jeu de langage, et de voir que, comme tout langage,l'echange monetaire represente la realite sans Tincorporer. Le marche est un lieu decommunication. II offre une lecture de la realite a travers les valeurs qu'il donne auxchoses. Le marche ne constitue pas la realite des choses. II parle des choses, c'est tout.Et c'est bien assez pour la fonction qu'il doit remplir.
David Westbrook suggere qu'une science economique alternative devrait donnerune plus grande consideration au fait qu'il y a une difference significative entre lemonde comme il est marchande aujourd'hui et le monde tel qu'il est 2**, suggerant lameme distance que celle qui existe entre la verite et les ombres qui glissent sur lesparois de la caverne de Platon^'.
Une telle approche alternative est rassurante. Elle impliquerait Texistence d'uneliberte en dehors des marches et, par consequent, une plus grande attention aux
d'humour ni de sens de I'autoderision, pour mieux voir la r^alit^ qui n'est jamais totalement maitriseedans une society liberale, mais tout au plus regulee et accompagn^e par l'appareil administratif.
23. D. Westbrook, id., note 5 du chapitre IX, p. 330-331, qui renvoie aux fameux modeleseconometriques developp^s par Amos Tversky et Daniel Kahneman (par exemple : « Prospects theory :an analysis of decision under risk », Econometrica, vol. 47 [1979], 263-291).
24. Id., p. 140.25. Platon localisait la verit6 dans le monde des ldees. Mais c'est une autre histoire. David West-
brook semble etre tout sauf idealiste.
314 Les risques de regulation
limites inherentes aux marches, pour qu'il n'en deborde pas. Cela nous rapproche desidees d'humilite et de modestie sans doute salutaires pour toute demarche scienti-fique, a fortiori lorsqu'elle porte sur l'action humaine.
11 y a quelque chose en dehors du marche, quelque chose qui ne peut pas etrecapture par la matrice du marche sans reduire considerablement cette realite, voirememe la detruire. Les sentiments, les marques d'affection, les emotions sont hors dumarche et ils importent pourtant. Bien entendu, les sentiments sont presents sur lemarche, comme des elements qui perturbent la rationalite des agents. Les profes-sionnels du marketing le savent, qui essayent d'influencer le comportement duconsommateur en agissant sur leurs emotions, leurs sentiments, en essayant de lesaffecter par leurs messages. Ils essayent d'organiser leur attitude, de la conditionnerpour assurer une rencontre optimale de ces sujets avec la production de masse qu'ilsservent.
David Westbrook suggere que le regard esthetique aide a eviter de se revoltercontre cette manipulation constante de nos emotions par le marketing qui ne veutfaire que de l'argent et non du sens. L'approche esthetique nous aide a garder unedistance entre nous et les autres, pour permettre, sans etre trop manipules, d'inter-agir dans la cit^. L'esthetique nous aide a tol^rer le fait que I'economie traite les genscomme des instruments et non comme des sujets.
B. PENSEE PROGRESSISTE
.Dans-un-essaisuivant,-David Westbrook considere que le concept americain-—d'Economic Justice constitue une erreur de classification. Ne s'agit-il pas plutot d'uneerreur semantique, d'une contradictio in terminis ? L'economie est le domaine de laproduction, de la circulation et de la consommation des biens et des services. Cela apeu a voir avec la justice. Adam Smith notait ces mots fameux, dans son enquete surles causes de la richesse des nations :
« Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous espe-rons acquerir notre dtner, mais de leur consideration pour leur interet personnel {theirown self-interest). Nous nous adressons non a leur humanity, mais a leur egoisme (theirself-love). [...] [Chaque individu] cherche uniquement sa propre securite, son propregain. Et il est en cela guid^ par une main invisible a promouvoir une fin qui est etrangerea ses intentions. En poursuivant son propre interet, il promeut souvent celui de la societeplus efficacement que s'il le voulait vraiment. Je n'ai jamais vu grand-chose de bienrealise par ceux qui affectaient de faire commerce pour le bien public . »
Si nous acceptons cette analyse vieille de plus de deux siecles, qui est encore citeedans tous les breviaires de l'economie classique, nous devons accepter que le compor-
26. A. Smith, Enquete sur la rmture et les causes de la richesse des nations, Garnier-Flammarion,Livre I, chap. 2, et Livre IV, chap. 2.
Analyses bibhographiques 315
tement economique soit ou devrait etre etranger a toute consideration morale. Pour-tant, Adam Smith etait un professeur de philosophie morale. Son premier traite etaitune Theorie des sentiments moraux, qui a occupe la quasi-totalite de sa carriere acade-mique. Dans cette theorie, la sympathie etait vue comme le sentiment originaire detoutes les vertus morales. Adam Smith meprisait profondement la tendance du compor-tement purement economique ^ rechercher non seulement la satisfaction de son propreinteret, mais aussi, dans son prolongement, a provoquer Tavidite et l'envie ^'.
La contradiction apparente d'Adam Smith entre son analyse de l'economie et satheorie morale n'a jamais ete resolue de maniere decisive ^s. La Richesse des Nationsconclut aux bienfaits des marches libres gouvernes par Tegoisme {self love), meme siTamoralite tend a Timmoralite si Ton ne retient pas fermement la tendance humainea Texageration, a la vanite et a Tavidite (« toujours plus! »).
L'idee que, en laissant le marche sous la gouverne de Tegoisme, on obtient laforme de marche la plus efficace est une evidence. Mais efficience ne veut pas direjustice. L'efficience concerne le bien-etre dans la societe. La justice n'est pas unequestion de raisonnement economique, c'est d'abord un raisonnement social.
C . ^TRE LIBERAL OU NE PAS £TRE
La brillante theorie de la justice de John Rawls^^ est un bel exemple d'une tentativeliberale d'integrer la justice dans une dimension individualiste de marche. Le fameuxvoile d'ignorance, derriibre lequel chaque individu choisirait naturellement et ration-nellement une societe juste et egalitaire,Testexentre surja queteJndiyidu_elle_de_i_a_maximisation de I'interet personnel. La theorie de Rawls est impeccablement equi-table, mais elle est fondamentalement impersonnelle. A cet egard, elle n'est pas forteloignee de l'analyse du marche ideal faite par Milton Friedman en ces termes :
« Les prix qui emergent dans les transactions volontaires entre acheteurs et vendeurs— en bref sur le marche libre {free market) — sont capables de coordonner l'activite demillions de personnes, dont chacune ne connait que son propre interet... Le systfeme desprix remplit cette tache en Tabsence de toute direction centrale, et sans qu'il soit neces-saire que les gens se patient ni qu'ils s'aiment^^. »
27. V. la Theorie des sentiments moraux, PUF, partie 1, section III, chap. Ill (ajoute dans la derniereedition de 1790). Dans ce texte, Adam Smith vitup&re contre les gens qui, generalement, sont inca-pables d'agir avec frugalite et de s'abstenir de courir apres l'enrichissement materiel a tout prix.
28. Sur ce qui a ete baptise par les chercheurs allemands de Das Adam Smith Problem, v. notam-ment J.-P. Dupuy, v° « Smith » in Monique Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d'ethique et de philosophiemorale, PUF, 2001.
29. J. Rawls, Theorie de la justice, Le Seuil, 1971; a propos de revolution de la pensee de Rawls, lireP. Ricoeur, « Le Juste », Esprit, 1995.
30. M. et R. Friedman, Free to Choose, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1980, p. 13. C'estmoi qui souligne (dernifere phrase : « ... The price system is the mechanism that performs this taskwithout central direction, without requiring people to speak to one another or to like one another »).La traduction est reprise de l'ouvrage de Jean-Pierre Dupuy (p. 72) cite en note 38 ci-dessous.
316 Les risques de rigulation
En fait, le liberalisme conseille aux individus d'eviter de penser en termes poli-tiques ^ Le liberalisme maximise Tespace du domaine prive {privacy) et institution-nalise fondamentalement une societe de personnes isolees, une societe atomisee.Tout sens de la communaute s'y dissout en une averse de droits subjectifs indivi-
Ainsi que l'auteur le fait remarquer ci juste titre, curieusement, le liberalismeparait aujourd'hui autant theoriquement depasse qu'il est ideologiquement victo-rieux^^. Il introduit un autre jeu dans la Cite, un jeu de procedures certes equitables,mais qui sont incapables de donner a cette Cite les codes moraux sans lesquels ellene peut pas fonctionner '*. Cela dit, pour citer Winston Churchill, « la democratieest une forme de gouvernement epouvantable, mais elle vaut sans doute mieux quetoutes les autres qu'on a deja subies^' ».
Dans la Cite de Tor, il y a actuellement une defaillance democratique. Les insti-tutions de Bretton Woods autant que les institutions europeennes sont pleines defonctionnaires qui prennent part aux decisions de gouvernement de la Cite en dehorsde tout processus democratique. La Constitution europeenne est un mouvementinteressant de la part de ces institutions pour tenter de reintegrer le processus demo-cratique. Les tentatives de TOrganisation mondiale du commerce et du Fonds mone-taire international de mieux communiquer avec le public, d'etre plus transparentes,sont un autre tournant vers les mecanismes democratiques.
La democratie et le capitalisme de marche ont certains principes communs quiles rendent complementaires^*. Tous les deux ont pour principe la libre expressiondes opinions. Tous les deux sont fondes sur une idee de competition (electorate dansun cas, de marche_dans Tautre). II est un fait que le resultat pratique est dans lesdeux cas une bien pauvre approximation des ideaux qu'ils recouvrent. Dans l'arenepolitique, Thypocrisie et la manipulation ont une place considerable '', sans parler deTinherent arbitraire qui conduit toute election, ainsi que Tont demontre les electionspresidentielles americaines en 2000 et fran^aises en 2002^^. De meme, dans lemarche, les imperfections sont legions : I'information est difficile a capter, les parties
31. D. Westbrook, op. cit., p. 222.32. Cette excellente expression est du doyen Jean Carbonnier in Droit et passion du droit sous la
V' Republique, Paris, Flammarion, 1996, p. 121.33. D. Westbrook, op. cit., p. 215.34. Id., p. 221.35. Cite par David Westbrook, op. cit., note 26 du chapitre 1, p. 310 et, au texte, p. 230.36. J.-P. Fitoussi, La democratie et le marche, Paris, Grasset & Fasquelle, 2004, p. 45-70.37. P. Van Parijs, The Spotlight and the Microphone. Must business be socially responsible, and can it?,
Belgique, Louvain-la-Neuve, 2002 (http://www.etes.ucl.ac.be/Publications/dochs.htm, Doc n°. 92,consulte en dernier lieu le 19 septembre 2004), citant Jon Elster, « The Market and the Forum », inJ. Elster et A. Hylland (eds), Foun(iatiom of Social Choice Theory, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1986.
38. J.-P. Dupuy, Avions-nous oublii le maU Penser la politique apres le 11 septembre, Paris, Bayard,2002, se referant & Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy {1942-1950), ainsi qu'a
Analyses bibiiographiques 317
sont de force inegales et la concurrence est souvent un leurre^'. Et pourtant... 9amarche. Le marche et la democratie sont des moyens, certes imparfaits, et non desbuts en eux-memes. Ils sont des moyens en vue de la realisation d'objectifs qui aurontete determines, pour ne pas dire choisis, individuellement ou coUectivement.
IV. RETOUR AUX SENTIMENTS HUMAINS
Dans la derniere partie de son ouvrage, David Westbrook detend le presuppose selonlequel la logique du marche determine completement la vie dans la cite, et tente dediscemer la possibilite d'une pensee politique parmi les habitants de cette cite, penseequi se reconnaitrait elle-meme faible, fragile, selon Texpression du philosophe italiende la postmodernite, Gianni Vattimo'*°. II s'attaque a trois questions :
- quelles verites peut-on partager dans le marche ?- quel ordre social peut etre institue dans une societe qui integre une economie
de marche ?- est-ce que la sympathie et Timagination peuvent avoir libre cours ou consti-
tuent-elles de vaines preoccupations ?
A. LA REGULATION DES MARCHES
La premiere question parait recevoir une reponse classique. II n'existe pas de veriteabsolue, specialement dans le domaine des marches financiers, qui actualisent sanscesse les opportunites futures de benefice. L'information a propos de ces opportu-nites est cruciale. Elle nous permet de gerer le risque futur et de mieux capturer lemeilleur investissement. Les societes cotees devraient des lors informer le public deces opportunites en meme temps que les amis et familiers {friends and families). Toutesles informations a propos d'evenements qui sont de nature a influencer le cours debourse de l'action devraient etre rendues publiques sans delai; les privilegies quiconnaissent ces informations avant les autres ne devraient pas faire de transaction surces titres tant que I'information n'a pas encore ete rendue publique, etc.
la demonstration classique, par Kenneth J. Arrow {Social Choice and Individual Values, Cowles Founda-tion Monograph, 12), de I'inexistence d'un systeme de choix social parfait, demonstration qui trouveson origine dans les travaux mathematiques et politiques de Condorcet (1743-1794).
39. J.-K. Galbraith, op. cit. en note 15.40. II a invente le concept de pensiero debole, pensee que son auteur reconnatt comme fragile des
I'origine et pour toujours, parce qu'une pensee ne capture jamais le tout des choses, elle est toujourspartiale, partisane, elle n'arrete pas le vent, pas plus que le roseau, en ce qu'il differe en cela au chene.Lire ad generalia Gianni Vattimo, La fin de la modemite, Le Seuil, 1987.
318 Les risques de regulation
L'egalite d'information et l'idee de « traitement equitable » que recouvrent cesregies sont des actes de foi que les r^gulateurs des marches financiers ont la missionde soutenir. Ainsi que Tindique David Westbrook, cet acte de foi implique egalementun effort — salutaire — d'imagination. Laisses a eux-memes, les marches financierstendent a devenir des clubs tres fermes dont la brillance se nourrit de l'argentd'envieux investisseurs particuliers qui trop souvent se brulent les ailes a de vaineschimferes.
Pour l'auteur, Texigence d'^galite d'information, Tusage du plain English promupar la Securities of Exchange Commission (SEC), la profusion d'informations dans lesprospectus — si rarement lus —, creent des fictions collectives, des mythes d'unmarche ordonne. Nous pouvons etre satisfaits de cette situation, meme si elle nenous a pas permis, et ne nous permettra jamais, d'eviter Tapparition periodique dansles marches financiers d'une « exuberance irrationnelle'*^ » ou d'une « avidite conta-gieuse'*^ ».
Depuis la « tulip mania » des Pays-Bas au XVII siecle, I'exuberance financiere, unefaiblesse typique des marches financiers capitalistes, a periodiquement enflammeTesprit et l'activite des gens ordinaires qui se pensaient soudain avoir decouvert unesource facile et inepuisable d'enrichissemenf*^.
L'engouement pour les valeurs technologiques, dont les cours se sont soudaineffondres en mars 2000, prosperait parmi des descriptions pleines d'imagination d'unenouvelle ere economique. C'etait seulement la derniere buUe de notre Cite de Tor.Si nous Tapprochons d'une maniere esthetique, c'est-a-dire avec une certainedistance intellectuelle, une certaine ironie, peut-etre pourrons-nous quand memeconserver Tespoir que nous n'avons pas con^i en vain cette regulation de marche.Pourtant, ajoute l'auteur, irreverencieusement, « Taccumulation de reglementationsfinanci^res continuera encore longtemps a produire une abondance d'incongruiteshilarantes'*'* », meme si ceux qui ont brule leurs ailes dans ces episodes exuberants yont parfois laisse la vie'*'. L'ordre politique dans une societe gouvemee par les marchesressemble bien souvent a une tragi-comedie.
41. Expression d'Alan Greenspan, president du Federal Reserve Board, le 5 decembre 1996, aucours du diner annuel de l'American Enterprise Institute for Public Policy Research (Washington D.C.). Cestermes ont servi de titre a l'ouvrage fameux de l'economiste Robert J. Shiller, Irrational Exuberance, Prin-ceton, 2000, ^crit juste avant l'effondrement des valeurs technologique.
42. « Infectious greed », autre expression d'Alan Greenspan, prononcee le 17 juillet 2002, devantCommittee on Banking, Housing, and Urban Affairs (S^nat des Etats-Unis d'Amerique).
43. Voyez, entre autres, en France : F. Braudel, La dynamique du capitaUsme, Flammarion, Champs,1985; en Belgique : E. De Keuleneer, L'autonomie bien controlee, Bruxelles, La mediane, 1997; v. egale-ment J.-K. Galbraith, A Short History of Financial Euphoria, edition originate Whittle CommunicationL.P., 1990, et C. P. Kindleberger, Manias, Panics & Craches : A History o/Financial Crisis, 4' ed., JohnWiley & Son, 2000.
44. D. Westbrook, id., p. 253.45. En France, Pierre B^regovoy s'est suicide en 1993 apres avoir ete suspecte pour delit d'initie
et apres avoir perdu les elections. Dans la faillite d'Enron, le vice-president Clifford Baxter s'est suicidepeu apres l'effondrement du chateau de cartes. Le sociologue Emile Durkheim a note que, pendant les
Analyses bibliographiques 319
Pour etre efficiente et pour generer le bien-etre, la comedie — Tinteraction desacteurs dans une societe de marche — est gouvemee par des regies elaborees par unregulateur, qu'il s'agisse du legislateur, d'une autorite administrative independante oud'une organisation professionnelle autor^gulatrice. La comedie des marches est uneconstruction humaine, trop humaine'*^. Les regies semblent faire partie du decor decette comedie. Elles Thabillent, mais elles ne procurent pas le repos, le sentiment dejustice ni la parfaite efficience tant attendus.
Meme la banque centrale, dont Tindependance vis-a-vis de Texecutif estconsideree comme une piece centrale de notre constitution politique, est tout auplus un instrument qui tempere les exc^s du marche, elle n'est pas un sauveur. II n'ya pas de sauveur dans la Cite de Tor. Rien ne pourra jamais nous debarrasser du risqued'une defaillance system ique de nos marches financiers ou d'un effondrement denotre economie.
Dans ce decor instable, une chose parait etablie. Notre societe subsiste notam-ment parce qu'y existe un fort imaginaire commun^^, une representation forte d'uneconviction commune de certaines realites imaginaires. Les instances de regulation,qui veillent, dans la mesure de leurs moyens, a faire respecter sur le marche les regiesproduites par cet imaginaire, constituent sans doute un element significatif de I'equi-libre de notre societe.
B. LES SENTIMENTS MORAUX, LA CONFIANCE
Dans son dernier essai, l'auteur se tourne vers les inevitables preoccupations moralesdes habitants de la Cite de Tor. Les marches sont amoraux, comme une voiture, unstylo ou un violon le sont. 11 s'agit de choses, d'instruments. Les hommes mettent cesinstruments en mouvement, ils communiquent et voyagent grace a eux. Pour utili-ser les mots tres eclairants de Hanna Arendt, I'interet pour ces choses est ce qui tientles hommes ensemble.
« Vivre ensemble dans le monde signifie essentiellement qu'un monde d'objets se tiententre ceux qui Tont en commun, comme une table est situee entre ceux qui sont assis
periodes de crise financieres graves, le nombre de ce qu'il denomme les « suicides anomiques » augmentesubstantiellement (6. Durkheim, Suicide (1930), PuF, 2002, Livre II, chap. V). L'idee d'anomie seretrouve plusieurs fois sous la plume de David Westbrook, comme s'il s'agissait d'un signal de ce qui nousguette, sans qu'il puisse en dire plus (voir op. cit., p. 140, 287 et 296; adde p. 100 ou il reconnait quel'anomie peut etre un puissant terreau pour les derapages extremistes).
46. Id., p. 265.47. A propos du caractere determinant de I'imaginaire pour l'essor de la societe, lire C. Castoria-
dis, L'institutwn imaginaire de la societe, Le Seuil, 1975. L'essor de la societe de consommation est a cetegard un danger important, que denonce Constantin Castoriadis dans plusieurs essais des Carrefours dulabynnthe III et IV (« L'epoque du conformisme generalise », in Le mor\de morcele, Le Seuil, 1990; « Lamontee de I'insignifiance », in La montee de I'lnsignifiance, Le Seuil, 1996) et Post-scriptum a I'lnsignifiance,L'Aube, 1999.
320 Les risques de regulation
tout autour; le monde, comme tout entre-deux, relie et s^pare les hommes en memetemps'*^. [...][Le domaine public, ou notre interet est necessairement situe,] nous rassemble et enmeme temps empeche que nous nous effondrions les uns sur les autres, pour ainsi dire'". »
Bien au-dela du concept unidimensionnel d'extemalites ou de cout de transac-tions, les marches impliquent une communication entre des hommes, une transmis-sion de quelque chose qui peut agir comme un liant, quelque chose qui, memetemporairement, permet aux hommes de rester en contact, d'echanger des choses etdes idees. La confiance est ce liant, qui rend possible que les hommes ne vivent pascompletement atomises dans une structure de marches, ou tout contact serait a analy-ser comme un assaut, une agression. La confiance est un sentiment, une attitude quinous aide a entrer en relation avec les autres sans violence, en abandonnant quelquechose a Tautre, en lui donnant quelque prise sur nous-memes.
A cet egard, les curieux assauts des economistes, qui pretendent evacuer toutereference au sentiment de confiance pour fonder tout le raisonnement economiquesur le calcul'", procedent d'une grave myopie a propos du phenomene humain.
Le comportement confiant est un comportement courant qui ne manque pas decontredire le pur calcul et la pure rationalite''. Par un tel comportement, Tagent faitl'economie d'un controle total de la situation. La societe est en bonne partie orga-nisee sur cette hypothese de justesse de la confiance et le droit viendra, dans toutela mesure du possible, conforter cette croyance commune.
Pour reprendre les termes souvent cites de l'economiste americain KennethJ. Arrow :
48. H. Arendt, Condition de I'homme modeme, Calmann-Levy, 1961 et 1983, p. 92; addeJ.-P. Dupuy, op. cit. en note 39, p. 30.
49. H. Arendt, ibid.50. V. en particulier O. E. Williamson, « Calculativeness, Trust, and Economic Organization »,
Journal of Laui and Economics, vol. XXXVI, Chicago, 1993; contra : A. Orlean, « La theorie econo-mique de la confiance et ses limites », m R. Laufer et M. Ordillard (dir.). La confiance en question, L'Har-matan, 2000 et, du meme auteur, « Sur le role respectif de la confiance et de I'interet dans la constitutionde l'ordre marchand », in A qui se fier ? Confiance, interaction et theorie des jeux. Revue du MAUSS,n° 4, 1994, p. 17. A propos de la notion de confiance, voyez notamment le v° « Confiance » parAnnette C Baier, in M. Canto-Sperber (dir.), Dictionnaire d'ethique et de philosophie morale, PUF, 2001et la celebre etude du sociologue allemand Niklas Luhmann, Vertrauen [1973] publiee en anglais sousle titre Trust arvi Power chez John Wiley & Sons, 1979.
51. L'economiste indien Amartya Sen montre dans un exemple fameux & quel point un monde depurs calculateurs opportunistes serait un monde compose d'« idiots rationnels ». Voici l'exemple : « Oilse trouve la gare ? », me demande un passant. - « La-bas, dis-je en montrant le bureau de poste, etvoudriez-vous me poster cette lettre en chemin ?- Out », repond I'autre, decide a ouvrir I'enveloppe pourvoir si elle contient quelque chose d'interessant » (A. Sen, « Des idiots rationnels », in Ethique et econo-mie, PUF, coll. « Quadrige », 2001, p. 103. Amartya Sen a regu le prix Nobel d'^conomie en 1998). Nousne croyons evidemment pas que cet exemple correspond a notre lot quotidien. Dans la realite, nous agis-sons en comptant sur un minimum de loyaute de nos innombrables partenaires et en offrant nous-meme au moins ce minimum. Nous faisons un minimum de confiance a ceux avec qui nous realisonsdes echanges, auxquels nous confions une partie de notre avoir ou de notre sort. Nous ne pouvonsd'ailleurs rationnellement faire autrement. Le soupgon generalise mene a la paralysie.
Analyses bibliographiques 321
« Presque toute transaction commerciale, et en tout cas celle dont I'execution s'etaledans le temps, a en elle-meme un element constitutif de confiance. On peut soutenir quela plupart des situations d'arrieration economique dans le monde peuvent etre expliqueespar un manque de confiance mutuelle'^ ».
Un climat de confiance permet une plus grande efficacite du systeme econo-mique 5 . II suppose Texistence de comportements ethiques, soucieux de morale. Maisce n'est pas le droit qui etablira un tel comportement.
« Le droit est un ensemble d'articles et de regies accompagnees de sanctions, il n'en estpas de meme pour la morale. L'acte immoral suscite la desapprobation, Tindignation, ledegout, mais, dans Tespace public du moins, ce n'est pas en tant qu'il est immoral qu'ilest sanctionne, il n'est sanctionne que dans la mesure ou il est contraire a la loi ou a ladeontologie ou aux reglements internes, et les sanctions appliquees sont imperson-nelles'"*. »
Le sentiment qui permet a la confiance de sourdre dans une relation humaine estla sympathie, ainsi que les dernieres pages de l'ouvrage de David Westbrook Texpo-sent. Mais l'auteur n'explique pas ce qu'est la sympathie.
Comme indique ci-dessus, la sympathie est le concept central de la Theorie dessentiments moraux d'Adam Smith. Cela nous ramene naturellement a I'origine denotre economie politique.
David Westbrook reste pourtant sceptique jusqu'au bout:
« La sympathie poun ait difficilement etre vue comme un remede parfait a la distance quenous devons necessairement tenir pour mener a bien notre vie politique''. »
11 me semble apercevoir-la les limites de son analyse.Jl a raison lorsquMl signale__.que Texpression de flots d'emotions et les parades enthousiastes autour du drapeaurestent une tendance dangereuse pour Tepanchement de nos sentiments. En cela, onpeut comprendre qu'il souhaite que la Cite de Tor bannisse une telle expressionpublique de sentiments. Mais faut-il en conclure que les sentiments font integrale-ment partie de la vie privee, qu'ils doivent y etre exiles ? Telle parait rester sa thesejusqu'au bout. Cela correspond a une vision purement instrumentale du domainepublic, tandis que le domaine prive serait celui de la vraie vie. Cette analyse dumonde est un retournement complet par rapport a l'analyse classique heritee de la
52. K. J. Arrow, Gifts and Exchanges, Philosophy and Pubhc Affairs, 1972, p. 357.53. D. Westbrook, id., p. 354.54. M. CantO'Sperher, Linquietude morale et la vie humaine, PuF, 2001, p. 101-102. Le meme auteur
remarque par ailleurs justement que « le d^sarroi de notre epoque s'exprime a l'evidence par la demandede regulations, de limites... le bien et le mal sont inextricablement meles lorsque les besoins reels (detravail, d'argent) sont a la fois satisfaits et exploit^s, lorsque des valeurs objectives sont realisees tout enservant tres concr&tement des int^rets particuliers. On voit bien [...] combien le souci de regulation despratiques est important. 11 conduit ci l'elimination des abus les plus graves, et a la formation de regiesprecises et connues de tous ceux qui sont concern^s » (id., p. 91-92).
55. D. Westbrook, op. at., p. 287.
322 Les risques de regulation
pensee grecque, qui faisait de la vie publique le sommet de toute vie, tandis que la vieprivee etait une part de la vie qui avait moins de merite'^.
Pour David Westbrook, la vie publique, la vie dans la Cite devrait etre gardee adistance, froide et calculatrice, en sorte qu'elle soit, d'une part, efficace et, d'autrepart, qu'elle reste paisible.
Mais alors, comment faire nattre et prosperer la confiance mutuelle, indispen-sable aux relations humaines ? La solution offerte par le recours exclusif a la « trans-parence '^ », qui se veut froide et calculatrice, mene a une impasse '^. La transparenceen tant qu'expression d'une vertu (Thonnetete) a ses limites.
L'exigence de transparence est le produit du soup9on. Elle a une ambition tota-lisante et s'oppose a la liberte. Or, la liberty est une qualite essentielle de notresociete, tout comme son coroUaire, le droit au secret''.
En outre, la transparence a un coOt eleve et risque de creer a la longue une para-lysie de l'action. L'equilibre de nos systemes de regulation ne pourra trouver un refugeque temporaire dans un systeme de transparence, pendant le temps ou la mefiance etle soup9on ont pris le dessus. Mais, a la longue, une societe transparente risque de neplus avoir de vertu, meme plus celle dont procede la transparence : Thonnetete. Latransparence integrate est de toute fa^on impossible. Tout n'est pas connaissable,tout n'est pas maitrisable. Meme a notre epoque ou Tinformatique permet de maitri-ser instrumentalement une masse inouie d'informations, de tres nombreux secretsrestent bien gardes, c'est heureux dans certains cas, c'est malheureux dans d'autres.II serait absurde egalement de pretendre que les informations qui circulent peuventcorrespondre a des verites indiscutables. Les debats considerables qui existent apropoi_deja_presentation_descomptesdes societes.expriment-biena quel point lUn-formation est une question de jugement, d'appreciation^. Non seulement Tinfor-
56. Hannah Arendt, Condition de I'homme modeme cite ci-dessus en note 48, denonce avec forcece retournement tout en reconnaissant qu'il n'y a pas d'issue a cette Evolution, en dehors de l'lnquid-tude, pour reprendre le sentiment evoqu^ par Monique Canto-Sperber {op. cit. en note 55).
57. Que la SEC aux Etats-Unis a mis en exergue il y a quelques annees avec sa « Regulation FD(fair disclosure) », voir http://www.sec.gov/rules/final/33-7881.htm, lien visits en dernier lieu le2 decembre 2004.
58. A. Etchegoyen, La force de la fidilite dans un monde mfidele, 2004, p. 163-175. Le « panop-tique » de Jeremy Bentham est un bon exemple de l'utopie que vise la transparence. Le controle estcomplet grace au systeme du panoptique, de meme la perte de liberte est complete. Adde la reflexion deMarie-Anne Frison-Roche, qui ecrit que « notre systeme est a present compromis par cette reference aI'information. Cette reference a I'information serait en train de devenir venimeuse car elle detruit labarriere des secrets, et done des libertes, sans desormais produire pour I'instant la confiance sur laquellefonctionne la prosperite de nos societes » {in Les legons d'Enron. Capitalisme, la dechirure, Autrement,2003, p. 56). Adde les reflexions de David Westbrook, dans une autre etude, a propos de la loi Sarbanes-Oxley, « Telling All: The Sarbanes-Oxley Act and the Ideal of Transparency », 2004 Mich. St. DCLL. Rev. 441.
59. Voyez notamment les essais publies sous la direction de Marie-Anne Frison-Roche, Secretsprofessionnels, Autrement, 1999.
60. Voir a cet egard les developpements roboratifs de Nicolas Vernon, Matthieu Autret et AlfredGalichon, L'information finarxaere en cnse. Comptabilite et capitalisme, Odile Jacob, 2004.
Analyses bibhographiques 323
mation est toujours discutable^', mais la grammaire et le style utilises pour la commu-niquer resultent de choix qui eux-memes pretent toujours a discussion^2.
** *
L'ensemble de ce livre important est une demonstration forte des limites danslesquelles le capitalisme globalise peut etre vu comme une maniere effective et effi-ciente d'organiser Tinteraction Economique dans notre societe cosmopolite. Unedistance rigoureuse est maintenue par rapport aux diverses ideologies qui offrent leconfort intellectuel d'une solution englobante pour Thumanite, soit a travers unereduction rationnelle des mecanismes sociaux, soit a travers un rejet emotionnel deTinsupportable legerete de Tetre, de Tepuisant inachevement de toute constructionhumaine. La « Cite de Tor » n'est ni la Cite de Dieu, parce qu'elle n'incame aucuneperfection, ni la cite des fourmis, parce que chacun est invite par le jeu democratiquea y avoir une conscience propre et a Texprimer. II y a quelque espoir que notre citesurvive encore quelques generations avant de disparaitre a son tour. Si nous accep-tons les limites de la cite, nous pouvons meme penser en termes de justice, de soli-darite et de beaute, pour autant que nous ne nourrissions pas Tespoir de rendre lesmarches eux-memes justes, egalitaires ou beaux (sauf pour la beaute de la comedie).
Jean-Marc CollierAncien assistant a I'Universite libre de Bruxelles (ULB),
avocat honoraire du barreau de Bruxelles, juriste *
61. C'est notamment du principe de discussion que procede toute la philosophie de Jurgen Haber-mas (voir notamment Verite et justification, Gallimard, 2001).
62. A propos du scientisme dont procede la pr^tention a mattriser la verite par le discours et de lanecessite de reconnaitre que la perception de la realite s'inscrit fondamentalement dans un processusde logique discursive, lire C Perelman, L'empire rhetonque : rhetonque et argumentation, Vrin, 1997.
* Les idees exprimees dans cette recension n'engagent que leur auteur et aucunement l'institutionqui l'emploie.