Discours sur la maison et dynamiques identitaires chez les ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Discours sur la maison et dynamiques identitaires chez les ...
Discours sur la maison et dynamiques identitaires chez les Podokwo, Muktele et Mura (monts Mandara du Cameroun)
Une approche à l’ethnicité et au statut social
Thèse
Melchisedek Chetima
Doctorat en histoire Philosophiæ Doctor (Ph.D.)
Québec, Canada
© Melchisedek Chetima, 2015
III
Résumé
Cette thèse examine les pratiques architecturales et les dynamiques identitaires chez
les Podokwo, Muktele et Mura des monts Mandara (Cameroun). Elle s’organise autour de
l’hypothèse-cadre selon laquelle la logique pratique et fonctionnelle de la construction, de
l’extension et de la transformation d’une maison évolue en tandem avec des considérations
d’ordre symbolique, notamment la production des sentiments ethniques (Hodder, 1982) et
la quête du prestige social à l’intérieur de la communauté (Duncan, 1982 ; Roux, 1976). En
partant de l’approche développée par des auteurs comme Ian Hodder (2012, 2006, 1999,
1982), Daniel Miller (2010, 2007, 2005, 2001, 1987), et Christophey Tilley (2010, 2006,
2004, 2002, 1999), je montre comment la maison, à travers ses multiples usages, devient
porteuse de plusieurs appartenances identitaires à un niveau sociétal et individuel
(Bromberger, 1980). Pour cela, j’ai porté mon attention, non seulement sur ce que les
individus font avec la maison, mais aussi sur la manière dont celle-ci construit à son tour
l’identité des individus (Miller, 2001 : 119). J’ai par ailleurs centrée mon analyse autour de
quelques évènements clés survenus dans l’histoire des Podokwo, des Muktele et des Mura,
en particulier la descente en plaine (1963), l’exode rural et le fonctionnariat (1980) et la
transition démocratique (1990). Ces évènements influent sur les pratiques architecturales et
sur les discours identitaires qui en sont les corolaires.
V
Abstract
This thesis examines the architectural identity dynamics and practices among the Podokwo,
Muktele and Mura of the mounts Mandara (Cameroon). It is organized around the
assumption that practical and functional logic that guide the construction, the extension and
the transformation of house evolves in tandem with symbolic considerations, such as the
production of ethnic distinctions (Hodder, 1982) and the quest of social prestige within the
community (Duncan, 1982; Roux, 1976). Based on the approach developed by authors like
Ian Hodder (2012, 2006, 1999, 1982), Daniel Miller (2010, 2007, 2005, 2001, 1987) and
Christophey Tilley (2010, 2006, 2004, 2002, 1999), I argue that the house, through its
multi-purpose uses, can become an active agent for the production of identity belonging,
both at a societal and individual level (Bromberger, 1980). For this reason, I have focused
my attention not only on what people do with the house, but also on how the house that
people built, built also people (Miller 2001: 119). I have also focused my analysis on
several key moments of the history of Podokwo, Muktele and Mura such as the plain
downhill (1963), the rural exodus and civil service (1980) and the democratic transition
(1990) that affect the architectural practices and the identity discourses which are its
corollaries.
VII
Table des matières
RÉSUMÉ III
ABSTRACT V
TABLEDESMATIÈRES VII
SIGLESETABRÉVIATIONS XVII
GLOSSAIRE XIX
REMERCIEMENTS XXV
INTRODUCTIONGÉNÉRALE 1
1.Quelquesmotssurlagenèseetlecontextedelarecherche 22.Uncontextehistoriquemarquépardesraidsesclavagistesetladominationcoloniale 73.Problématiqueethypothèsesdetravail 134.Structuregénéraledelathèse 17
CHAPITREI:CONSIDÉRATIONSTHÉORIQUESETPOSITIONNEMENTÉPISTÉMOLOGIQUEDEL’ÉTUDE 21
I.LESPREMIÈRESÉTUDESSURLAMAISON 211.Approchenaturaliste:dudéterminismeenvironnementalaudéterminismetechnologique 222.Traditionsethnographiquesetthéoriesfonctionnalistesdelamaison 253.AmosRapoportetlathéorie«culturellemulticausale»delamaison 29II.APPROCHESSYMBOLIQUESOUL’ARCHITECTUREENTANTQU’IMAGEAUTO‐REPRÉSENTATIONNELLEETPROJECTIVE 341.«Tuescequetuconstruis»:espacearchitecturalentantqu’instrumentdepouvoir 352.Approchedelamétaphore:l’architectureentantque«portraituresymbolique» 413.Approchesstructuralistesoulamaisoncommeobjectivationdesrelationssociales 45III.THÉORIESDELAPRODUCTIONSOCIALEDEL’OBJET 501.Del’objetproduitàl’objetproducteur:archéologiepostprocessuelleetétudedelaculturematérielle 502.Histoiresocialeetfacteurshistoriquesdechangementsarchitecturaux 58IV.POSITIONNEMENTTHÉORIQUEDEL’ÉTUDE:ENTRETHÉORIEDELAPRATIQUEETAPPROCHEDEL’ACTIONSOCIALEDEL’OBJET 65
CHAPITREIIAPPROCHEMÉTHODOLOGIQUE:UNECO‐CONSTRUCTIONENTRETERRAIN,CORPUSTHÉORIQUEETTECHNIQUESD’ENQUÊTE 69
I.APPROCHESMÉTHODOLOGIQUES:TRAITSGÉNÉRAUX 69
VIII
1.Approchephénoménologiqueinterprétative:entreherméneutiqueetinteractionnismesymbolique 702.D’unterrainàl’autre:uneethnographie«multi‐située»dansunedémarcheendotique 74II.DELAMÉTHODED’ÉCHANTILLONNAGEAUCRITÈREDESÉLECTIONDESPARTICIPANTS 79III.INVENTAIREDESINSTRUMENTSDECOLLECTEDESDONNÉES 891.Entretienssemi‐directifsdansunedémarchedialogiqueetréflexive 892.Lestrajectoiresdevie:uneméthodebiographiqueàdoublefocale 933.Lesdonnéesdel’observationparticipanteetleuranalyse 994.Laphotographiecommecatalyseurd’entretien 101IV.«LAMARIÉEESTSOUVENTTROPBELLE»:DUCHOIXDUMODÈLED’ANALYSEDESDONNÉES 105Conclusion‐Lamaison:unespacedeproductionetdecommunicationdesidentitéssociales,individuellesetdesrelationsdegenre 108
CHAPITREIIIHISTOIREPLURIELLE,MÉMOIREPLURIELLE,OUBLIPLURIEL:LESMONTAGNARDSÀL’ÉPREUVEDELEURPASSÉSERVILE 113
I.DEL’HISTOIREÀLAMÉMOIREHISTORIQUEDEL’ESCLAVAGE:UNDIALOGUEIMPOSSIBLE? 115A.HISTOIRE«OFFICIELLE»ETÉCONOMIEDELAVIOLENCEDANSLEBASSINTCHADIEN(XVE‐XXESIÈCLE) 1161.Hégémoniedesroyaumesdubassintchadienetraidsesclavagistes 1172.HammanYadjideMadagalietl’économiedelaviolence(1902‐1927):regardssursonjournalpersonnel 122B.REFOULEMENTETTRANSMISSIONSYMBOLIQUEDELAMÉMOIRESERVILEDANSLESTRADITIONSORALES 1301.Traditionshistoriquesetfabricationdesmythesd’origine:unestratégiede«miseàmort»del’histoireservile? 1322.Chantsetconstructiond’unemémoirealternative 138II.IMAGINAIRESCOLONIAUX,MIMÉTISMELOCALETINSCRIPTIONDEL’IDÉOLOGIEVICTIMAIREDANSL’ESPACEPUBLIC 1461.Delajustificationdesviolencescolonialesparlacréationd’unimaginairedepeuplesauthentiquesetrebelles(1916‐1960) 1472.«Sortirduregardcolonial»:architectureettransmissiondel’imagedepeuplesrésistantsettravailleurs 1573.Retourdelatraditionetrécupérationdumythecolonialdel’authenticité(1960‐1990) 1644.Démocratisationetinscriptiondel’idéologievictimairedansl’espacepublicde1990à2011 167CONCLUSION 171
CHAPITREIVLAMAISONCOMMECADREDEPRODUCTIONETDECOMMUNICATIONDESIDENTITÉSETHNIQUES 175
I.IDENTITÉMONTAGNARDEOUCOMMENTLAMAISONABOLITLESFRONTIÈRESETHNIQUES 1771.«Sediremontagnards»pardespratiquesarchitecturalesquiseressemblent 1782.«SedireMontagnards»pardespratiquesreligieusesassociéesàl’habitat 183
IX
II.DEL’IDENTITÉMONTAGNARDEAUXDIFFÉRENTESREPRÉSENTATIONSARCHITECTURALESDEL’APPARTENANCEETHNIQUE 191A.LEPLANINTÉRIEURDESMAISONS:UNÉLÉMENTDÉCODEURDUSTÉRÉOTYPEETHNIQUE 1921.Stéréotypearchitecturalpodokwo 1932.Stéréotypearchitecturalmuktele 1963.Stéréotypearchitecturalmura 1984.Variationsdeformesarchitecturalesetreprésentationsidentitaires 201B.DESÉLÉMENTSARCHITECTURAUXEMBLÉMATIQUESPOURUNEIDENTIFICATIONETHNIQUE 2061.Leshəmaetsonrôledansl’identificationethnique 2062.Lemawnikmukteleoul’unionsymboliquedesclansopposés 2123.Commentguérirlemalquivientdel’intérieurdelamaisonetdugroupe?Objetsdomestiquesàdimensionmagique 2174.Construirecommel’autre…maisrestersoi:domesticationdesformesarchitecturalesdesvoisinsetsignificationsidentitaires 224C.(RE)PENSERL’ETHNIEDANSLESMONTSMANDARA 229III.«NOSMAISONSSONTDESCENDUESENPLAINE,NOUSNEVIVONSPLUSCOMMEAVANT»:DESCENTEENPLAINEETDYNAMIQUESARCHITECTURALEETIDENTITAIRE 2361.Delapermanencedesmaisons«ethniques»enmontagne 2382.Lesvillagesdelaplaine:entrepermanencesetmutationsdustéréotypeethnique 2443.Deladisparitiondustéréotypeethniquedanslesbourgsmusulmansàlamiseenparenthèsedel’identitéethnique 2554.Retouràl’identitémontagnarde,cettefoispolitique:del’instrumentalisationdelasymboliquedelamaisondanslecontextedelatransitiondémocratique 260CONCLUSION:ONNENAITPASETHNIQUE,ONLEDEVIENT! 269
CHAPITREV«LAMAISONESTUNMIROIRDANSLEQUELLESGENSTEREGARDENT»:ARCHITECTURECOMMEMÉDIUMD’EXPRESSIONIDENTITAIRE 275
I. «TUESCEQUETUCONSTRUIS»:MAISONETRANGSOCIALAVANT1960 278A.«DIS‐MOIOÙTUASCONSTRUITETJETEDIRAIQUELLEESTTAPOSITIONSOCIALE»:DIALECTIQUEENTREHAUTETBASETSITUATIONSOCIALE 2791.Surlanotiond'espace 2792.Siteetsens,altitudesetascensionsociale 2823.Delasémiologiedel’espaceàl’espacecommeagentdesocialisation 289B.MAISONENTANTQUEMODELEDUCORPSHUMAINETPROBLEMATIQUEDEL’ANTHROPOMORPHISME 2921.«Lesmaisonssontaussideshumains»:maisonsetimagesdelaféconditéchezlesMura 2942.«Leventredelamaisonestsourcedevie»:évolutiondelamaisonenlienaveclechangementsocialdel’occupant 303II.«PARTIRPOURCONSTRUIRE»:ÉPIDÉMIOLOGIEDESCOMPORTEMENTSBÂTISSEURSDESANNÉES1980ÀNOSJOURS 314A. «JEVAISÀYAOUNDÉ…CHERCHERLÀ‐BASUNEVIEMEILLEURE»:DEL’EXODERURALCOMMEITINÉRAIRED’ACCUMULATION 3161.Yaoundéoulafacecachéed’unailleursdemisère 317
X
2.«Sefaireunnomauvillage»:bellemaisonetmatérialisationdelaréussitesocialepost‐migratoire 3233.«Unebellemaisonvousfaitrêver,voicil’enversdudécor»:jeuxetenjeuxdelacompétitionarchitecturale 331B.«DEL’AUTRECÔTÉDUMIROIR»:NOUVELLESÉLITES,NOUVEAUCOMPORTEMENTBÂTISSEURETRAPPORTSINVERSÉSAVECLEVILLAGE 3391.LesBlancsdemontagneetl’ethosdeconsommationostentatoire:deuxprofils 3402.Maison,salon,télé:del’ordreprivéauverdictpublic 3443.Élites,undangerouélitesendanger?Lesparadoxesdelanouvellerelationélites/village 352CONCLUSION:MAISONSTRADITIONNELLES,MAISONSMODERNES:REGARDSCROISÉS 359
CONCLUSIONGÉNÉRALEAGENCYDELAMAISONOUCOMMENTLESGENSCONSTRUISENT(OUDÉSIRENTCONSTRUIRE)DESMAISONSQUILESDÉVORENT 363
1.Lamaisonetl’ethnicitécommedespalimpsestes 3652.Maison‐homme,maisonhantée,maisonanthropophage 370
SOURCES 383
I.SOURCESORALES‐LISTEDESPARTICIPANTSÀLARECHERCHE 383II.SOURCESÉCRITES 3851.Archivescoloniales 3852.Journaux 3873.Sourcesphotographiquesetfilmiques 3884.Liensinternet 390III.OUVRAGESETARTICLESGÉNÉRAUX 3911.Ouvragesdeméthodologie 3912.Théoriesdelamaisonetdelaculturematérielle 3953.MontsMandaraetbassintchadien:généralités 4135.Théoriesdel’espace,esclavageetmémoireservile 4266.Colonisation,étudespostcolonialesettourisme 4357.Migration,rapportsélites/villageetsorcellerie 438ANNEXE1 445FORMULAIREDECONSENTEMENTVERBAL 445ANNEXES2 448PROTOCOLED’ENTRETIENPOURLESPARTICIPANTSVIVANTDANSLESVILLAGESDEMONTAGNE 448ANNEXE3 452PROTOCOLED’ENTRETIENPOURLESPARTICIPANTS 452VIVANTDANSLESVILLAGESDELAPLAINEETÀMORA 452ANNEXE4 456PROTOCOLED’ENTRETIENPOURLESORIGINAIRESDESMONTSMANDARADEVENUSFONCTIONNAIRESET
VIVANTENVILLE 456ANNEXE5 459EXTRAITDUJOURNALD’HAMMANHADJISURSESRAIDS 459
XI
ENTERRITOIREANIMISTESENTRE1912ET1920 459ANNEXE6 480QUELQUESEXTRAITSDESGUIDESTOURISTIQUESSURUDJILA 480ANNEXE7 483PLAND’UNEMAISONPODOKWODESSINÉPARCHRISTIANSEIGNOBOS(1982) 483ANNEXE8 484PLAND’UNEMAISONMUKTELEDESSINÉPARBERNARDJUILLERAT(1971) 484ANNEXE9 485MÉMORANDUM:LESKIRDISDÉNONCENTIBRAHIMTALBAETABBABOUKAR 485ANNEXE10 487VENTREDELAMAISONDUCHEFDEBALDAMA(DESSINÉPARCHRISTIANSEIGNOBOS,1982) 487ANNEXE11 488LIGNEGÉNÉALOGIQUEDESCHEFSD’UDJILA 488ANNEXE12 489PLANDELAMAISONDUCHEFD’UDJILA,UNMODÈLEDERÉUSSITESOCIALECHEZLESPODOKWO 489
XIII
Listes des illustrations
Tableau 1 : Fiche individuelle accompagnant la transcription d’une tranche de vie .................... 107
Carte 1 : Répartition des groupes ethniques dans les monts Mandara septentrionaux (Fond de la carte, Müller-Kosack, 2003 : 194) ...................................................................................................... 6 Carte 2 : Localisation du Kanem, Borno et Wandala (Source : MacEachern, 2001 : 82) ............. 120 Carte 3 : Califat de Sokoto et les régions environnantes (Source : MacEachern, 1993 : 255) ...... 128
Graphique 1 : Répartition des participants par ethnies et lieu de résidence (massif ou plaine) ........ 82
Graphique 2 : Répartition des informateurs par âge ......................................................................... 84
Graphique 3 : Répartition des participants par genre et lieu d’habitation ......................................... 85
Graphique 4 : Répartition des participants selon le critère religieux ................................................ 87
Graphique 5 : Bilan des raids menés par Hamman Yadji entre 1912 et 1920 ................................ 126
Figure 1 : Perspective fonctionnaliste de la maison selon Lewis Morgan (2003) ............................ 26
Figure 2 : Schéma explicatif du primat des changements sociaux sur les facteurs climatiques et technologiques dans les variations de la maison selon Marcel Mauss .............................................. 28
Figure 3 : Processus de démantèlement du concept de culture selon Amos Rapoport ..................... 32
Figure 4 : Structure anthropomorphique d’un village dogon (source: Griaule, 1965 [1948]: 95) .... 43
Figure 5 : Relation récursive et réciproque entre individus et maisons ............................................ 55
Figure 6 : Maison de Slagama en altitude ceinte par un grand mur d’enceinte. En dessous est la maison de son voisin, petite concession de trois cases et d’un grenier ............................................. 96
Figure 7: Quartier dzaŋƏ mededeŋe (Udjila) apparaissant sur une carte postale non datée (source : archives personnelles du Chef d’Udjila). ........................................................................................ 151
Figure 8 : Carte postale montrant une femme d’Udjila en train d’aller chercher les vivres dans le grenier (Source : www.delcampe.net) ............................................................................................. 151
Figure 9 : Cartes postales montrant en arrière-plan les maisons montagnardes; symboles de l’authenticité (Source : www.delcampe.net) ................................................................................... 152
Figure 10 : Scène entre populations animistes (dessin de Christian Seignobos à l’imitation d’Yvan Pranishnikoff, dans Beauvilain, 1989 :337) .................................................................................... 156
Figure 11 : Occupation des sommets montagneux synonyme de la résistance dans le discours mémoriel sur l’esclavage et la colonisation .................................................................................... 160
Figure 12 : Vue de la muraille de protection des vestiges architecturaux trouvés sur le site DGB en territoire mafa .................................................................................................................................. 161
XIV
Figure 13 : Pierres rituelles adossées au premier vestibule d’une maison mura, attestant de l’importance de la maison dans le déroulement des rites ................................................................ 184
Figure 14 : Pots d’ancêtres placés dans la case sacrificielle dans une maison podokwo ................ 185
Figure 15 : Grenier du chef de famille, objet de nombreux rites et sacrifices ................................. 186
Figure 16 : Stéréotype d’une habitation podokwo tel que schématisé par les participants au sol et reproduit par moi ............................................................................................................................. 194
Figure 17 : Le plan typique dune habitation Mura typique ici ........................................................ 200
Figure 18 : Toits des cases d’une maison muktele de Baldama ...................................................... 202
Figure 19 : Toits des cases d’une maison mura de Dume ............................................................... 203
Figure 20 : Grenier podokwo aux formes élancés ........................................................................... 203
Figure 21 : Grenier mura avec des formes plus en obus ................................................................. 204
Figure 22 : Cuisine podokwo avec l’entrée tournée vers le mur d’enceinte ................................... 204
Figure 23 : Cuisine muktele avec l’entrée tournée sur la cour intérieure ........................................ 205
Figure 24 : Une maison podokwo ceinte par le shəma lui donnant son caractère ethnique ............ 209
Figure 25 : Petit muret muktele (mawnik) qui sera défait à sa base pour permettre à la mlok de sortir de temps en temps de sa période de claustration ............................................................................. 215
Figure 26 : Descendance de Tchokfe Kazlaŋa permettant de situer dans le temps le conflit Mura/Podokwo ................................................................................................................................ 227
Figure 27 : Mawnik reliant la claustration de la mlok à le madvedev, symbolisant le passage de l’individualisme clanique à la solidarité ethnique ........................................................................... 232
Figure 28 : Maison podokwo donnant une idée sur la domestication des maisons en tôles à l’intérieur du modèle ethnique ........................................................................................................ 239
Figure 29 : Maison muktele donnant une idée sur la domestication de la maison en tôle à l’intérieur du modèle ethnique ......................................................................................................................... 240
Figure 30 : Maison podokwo illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts ............................................................................................................................... 247
Figure 31 : Maison muktele illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts ............................................................................................................................... 247
Figure 32 : Maison mura illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts ..................................................................................................................................... 248
Figure 33 : Village de Godigong (Podokwo) illustrant l’ouverture des jeunes montagnards aux maisons en tôles et rectangulaires ................................................................................................... 252
Figure 34 : Maquette de la tenue de l’Association culturelle podokwo à l’occasion de leur premier festival culturel (décembre 2010) .................................................................................................... 263
Figure 35 : Participants au séminaire sur les « minorités montagnardes et gouvernance ............... 265
XV
Figure 36 : Photographie de la maison utilisée comme image publicitaire lors de l’atelier de formation organisé par Takouma .................................................................................................... 268
Figure 37 : Quelques facettes de l’ethnicité dans les monts Mandara ............................................ 271
Figure 38 : Quartier de Mogode à Udjila, situé sur une de nombreuses crêtes montagneuses que compte le village ............................................................................................................................. 284
Figure 39 : Maison de Tekuslem à Baldama, située sur un escarpement montagneux ................... 284
Figure 40 : Maison de Kwetcherike à Dume, située sur un escarpement montagneux ................... 285
Figure 41 : Maison du chef d’Udjila, située sur un replat sommital le plus élevé du quartier de Mogode ........................................................................................................................................... 287
Figure 42 : Polygamie en tant que facteur important dans l’élargissement de la maison et l’ascension sociale du propriétaire .................................................................................................. 310
Figure 43 : Océan de toits de la maison du chef de Baldama : un indicateur de son statut matrimonial et social ....................................................................................................................... 311
Figure 44 : Toits et mur des cases constituant le ventre de la maison du chef de Baldama, vue de gauche ............................................................................................................................................. 312
Figure 45 : Vue des quartiers Bastos résidentiels sur la colline et de Bastos-Nylon dans .............. 319
Figure 46 : « Grand salon », une maison en carabotte logeant plus d’une trentaine des migrants podokwo habitant au quartier Bastos-Nylon ................................................................................... 320
Figure 47 : Appartements destinés à des locations individuelles ou de groupes. C’est dans ce secteur que vivent la plupart des migrants montagnards qui louent des chambres individuelles pour accueillir leurs épouses. .................................................................................................................. 321
Figure 48 : Maison en tôle et de forme rectangulaire en chantier à Mora-Massif, symbole de la réussite post-migratoire ................................................................................................................... 328
Figure 49 : Maison en tôle construite en dur à Tala-Mokolo. Point n’est besoin de crépir une telle maison; le parpaing étant synonyme d’ascension sociale. .............................................................. 332
Figure 50 : Maison en tôle construite en dur à Biwana, un village podokwo de la plaine. ............. 333
Figure 51 : Salon et salle à manger de la maison d’une fonctionnaire originaire des monts Mandara vivant à Maroua .............................................................................................................................. 346
Figure 52 : Salon d’un haut fonctionnaire originaire des monts Mandara vivant à Yaoundé ......... 348
Figure 53 : Télévision au salon d’une élite montagnarde de Yaoundé : un élément important dans la mise en scène du soi. ....................................................................................................................... 349
Figure 54 : Télévision au salon d’une élite montagnarde de Maroua : un élément important dans la mise en scène du soi. ....................................................................................................................... 349
Figure 55 : Fissures sur les parois d’une case de l’ancienne maison de Duniya, preuves de sa possession par les esprits malveillants (photographie prise en 2007 par moi). ............................... 374
XVII
Sigles et abréviations
ACP : Association culturelle podokwo
Aculmaf : Association pour la promotion de la culture mafa
AEF : Afrique Équatoriale Française
ANP : Archives Nationales de Paris
ANY : Archives Nationales de Yaoundé
AOF : Afrique Occidentale Française
API : Approche phénoménologique interprétative
CAR-LSS : Centre d’appui à la recherche-Laboratoire des sciences sociales
CODESRIA : Conseil de recherche pour le développement des sciences sociales en Afrique
CRDI : Centre de recherche pour le développement international
DCK : Dynamique culturelle kirdi
DGB : Dig gid bay (voir glossaire)
ELECAM : Élections Cameroun
ENAM : École nationale d’administration et de la magistrature
GIERSA : Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines
IRD : Institut de recherches pour le développement
ISH : Institut des Sciences Humaines
Laimaru : Association des minorités ethniques du Cameroun
MDR : Mouvement pour la défense de la République
MUS : Mission-Unie du Soudan
XVIII
NORCAMTOUR : Agence de promotion touristique du Nord-Cameroun
OJRDPC : Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais
ORSTOM : Organe de recherche scientifique et technique d’Outre-Mer
RDPC : Rassemblement démocratique du peuple camerounais
SDN : Société des Nations
SOM : Section Outre-Mer (déplacée à Aix-en-Provence)
UCL : University College of London
UEEC : Union des églises évangéliques au Cameroun
UNDP : Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
XIX
Glossaire
Compte tenu de la multiplicité des langues en présence (Podokwo, Muktele, Mura,
Fulfulde, etc.), j’ai au maximum limité l'emploi des termes locaux pour faciliter la lecture
de la thèse. Toutefois, j’ai fait usage de quelques mots et expressions locaux, notamment
lorsqu’il fallait décrire les plans des maisons et les formes architecturales considérées
comme des emblèmes ethniques au sein de chaque groupe. J’ai aussi utilisé quelques mots
issus du vocabulaire colonial et du fulfulde, qui fait office de la langue d'usage au Nord-
Cameroun. Ce tableau fournit la liste complète de ces termes et expressions accompagnés
de leur signification en Français.
Langue podokwo
Mot local Signification en Français
Farançaka Les Français
Guitsikə zhəbe Vestibule
Huđə kaya Cour intérieure de la maison
Jamaka Les Allemands
Kaya Maison
Kayə parəkwa Maison Podokwo
Kede Grenier
kudigue Cuisine
Massaba
Tare qui empêche l’accumulation, malchance
Nafa
Sorcellerie dans son aspect accumulateur
XX
Sakama Pots ancestraux
Shəma Mur d’enceinte podokwo
Slala nasa Quartier de la femme
Vira Case à coucher
Virə baba Case à coucher du père
Virə nəsa Case à coucher de la femme
Zləma Étables et Enclos à bétail
Langue muktele
Mot local Signification en Français
Magol mis Première épouse
Mat kaf a uda Rite de gratitude envers les fondateurs de la maison qui s’effectue au pied du grenier de l’homme
Asaô Petits murets de pierres reliant les cases
Burma Pots ancestraux
Daboza Divisions intérieures du grenier
Dzogdzog Vestibule
Gay Maison, mais signifiant aussi bouche ou parole
Gazarak :
Lieu de repos du chef de famille, première pièce à traverser pour entrer dans une maison muktele,
Hohl Étables et enclos à bétails
kawdal
Cour intérieure de la maison, considérée comme la partie féminine de la maison
XXI
kudig gaylag Case à coucher de la première épouse
Kudig Case à coucher
Madagl gaylag Cuisine de la première épouse
Madvedev
Fête muktele, considérée comme un nouvel an agraire et social
Mawnik Petite brèche créée dans le mur au servir d’entrée et de sortie à la nouvelle mariée pendant la période de claustration
Mazazay Fête lignagère, consistant en un sacrifice annuel à la Terre
Mlok Nouvelle mariée, mot désignant également l’étranger
Kudig gaygo Case à coucher de la deuxième épouse
Madagl gaygo Cuisine de la deuxième épouse
Vda Grenier
Yao phao Eau de farine
Zawda Fiancé
Zil gay Père de la maison
Matakor phao Rite consistant à remettre trois boulettes de farine aux jeunes marié
Langue mura
Mot local Signification en Français
Adaw Maison
Bakashidgwe Fête annuelle mura au cours desquelles seuls les hommes sont présents
XXII
Bertchama Vestibule, première pièce à traverser
Gerda Lay Pots ancestraux
Hiŋa Cuisine
Kemtsawak Enclos à bétails
Kutak Case
Kutak hermana Case de la femme
Kutak humaf Case de l’homme
Merketchek Sorcier
Mutak zhamba Pots servant à enterrer le placenta à l’intérieur de l’espace domestique
nashikem Tête de la maison
Pepa adaw Père de la maison
Sadake Festival annuel des Mura
Takour Grenier
Takour hermana Grenier de la femme
Takour humaf Grenier de l’homme
Tsedjihay Ancêtres
Zhamba Placenta
Autres
Concession Termes utilisés par les pouvoirs coloniaux pour désigner les maisons
Djihad Guerre sainte
Fulfulde Langue peule
XXIII
Lamidat Territoire dépendant d'un lamido
Lamido Titre donné à un chef peul
Maray Fête du taureau, chez les Mafa et les Mofu
May Nom attribué à un souverain dans le Borno
Di-Gid-Biy (DGB) « Les yeux du roi au-dessus » : nom local d’un ancien complexe architectural situé sur le territoire mafa dont la construction est attribuée à des génies
Quartiers (architecturaux)
Traduction littérale du terme local désignant la partie de la maison occupée par les femmes
XXV
Remerciements
Cette thèse a vu le jour grâce au soutien financier du Centre de recherche pour le
développement international (CRDI), du département d’histoire de l’université Laval
(Fonds de soutien au doctorat), de la faculté des lettres de l’université Laval (Bourse de
séjour de recherche à l’extérieur). En Afrique j’ai bénéficié du soutien financier du Conseil
pour le développement des sciences sociales en Afrique (CODESRIA). Je tiens à les
remercier pour leur soutien et à remercier aussi le Groupe interuniversitaire d’études et de
recherches sur les sociétés africaines (GIERSA) de l’université Laval qui m’a octroyé un
local.
Je remercie infiniment ma directrice de recherche, Muriel Gomez-Perez, pour ses
orientations, sa lecture minutieuse du manuscrit et son appui financier à travers les contrats
de recherches. Dès mon arrivée à l’Université Laval à l’été 2010, elle a su mettre la barre
haute et à continuer à la pousser toujours plus haute à mesure que je m’en approchais. Elle
était persuadée que je pouvais faire mieux et ne manquais pas à me proposer de nouvelles
perspectives lorsque j’en avais besoin. Muriel Gomez-Perez m'a enfin guidée dans le
monde de la recherche, en me montrant l'importance à me faire publier et à participer à des
colloques et autres activités scientifiques de haut niveau.
Je voudrais à sa suite remercier trois personnes qui ont joué un rôle de premier plan
dans ma formation. D’abord le Professeur Saibou Issa, Directeur de l’École normale
supérieure de Maroua, pour avoir participé aux différentes étapes de ma formation et pour
avoir été le premier à m’avoir montré les incroyables possibilités dans le métier d’historien.
Toujours ouvert et attentif à mes sollicitations, Saibou Issa a eu un impact réel dans ma vie
académique, professionnelle et personnelle. J’ai par ailleurs pu bénéficier des conseils de
Christian Seignobos, Directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement
(IRD-France) et de Bienvenu Denis Nizesété de l’Université de Ngaoundéré, qui ont été à
la genèse de ce projet lorsque j’étais encore étudiant de maîtrise. Depuis lors, ils n’ont pas
cessé de m’encourager, de m’écouter et de discuter avec moi chaque fois que je les ai
sollicités. Un merci spécial au professeur Gilbert Taguem Fah, pour le modèle d’enseignant
qu’il a été pour moi, pour son humilité et sa disponibilité, mais surtout pour m’avoir fait
XXVI
profiter depuis la maîtrise de son Centre d’appui à la recherche-Laboratoire des sciences
sociales (CAR-LSS).
Je remercie vivement les professeurs Laurier Turgeon et Alain Laberge qui ont
animé le séminaire de Doctorat à l’automne 2010 et à l’hiver 2011. Laurier Turgeon a joué
un rôle important dans mon projet doctoral, d’abord en me proposant de m’inscrire dans
l’approche post-processuelle de la culture matérielle, ensuite en me recommandant à des
programmes de bourse. Un merci spécial au professeur Bogumil Jewsiewicki Koss pour
m’avoir aidé à porter un regard nouveau sur mon objet de recherche lors de ma première
discussion avec lui. Il m’est également impossible d’ignorer le professeur Paul Lovejoy de
l’université York pour ses commentaires généreux sur le manuscrit duquel est issu le
chapitre III de cette thèse, et pour m’avoir mis au courant des travaux de Bawuro Barkindo
sur le sultanat du Wandala.
Je voudrais dire merci à Daniel Miller et à Victor Buchli, professeurs à University
College of London (UCL), dont les travaux ont stimulé ma réflexion. Tous deux m’ont
encouragé dans mon approche de la maison et m’ont offert la possibilité de partager les
résultats de mes recherches à travers la revue Home Culture et le blog material world. José
Van Santen de l’Université d’Amsterdam et Wouter Van Beek du Centre d’études
africaines de Leiden ont toujours répondu à mes demandes, surtout lorsqu’il fallait discuter
des questions liées à la mémoire servile, à la conception de l’espace, mais surtout à
l’invention de l’ethnie dans les monts Mandara. Ils m’ont aidé à compléter mes références
sur les monts Mandara et ont mis à ma disposition leurs propres ouvrages, y compris les
plus récents. Suzanne Preston Blier, de l’université Harvard, Jean-Pierre Warnier et Charles
Becker du Centre d’études africaines de Paris, Scott MacEachern de Bowdoin College,
Ibrahima Thioub de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Denise Piché, professeure à
l’École d’architecture de l’université Laval, Ana Lucia Araujo de l’université Howard, Jean
Boutrais de l’Institut de recherche pour le développement (IRD-France) m’ont encouragé
d’une manière ou d’une autre et m’ont fait bénéficié de leurs savoirs multiformes.
Ma gratitude va à Élodie et Prisca pour la réalisation des graphiques et des cartes
utilisées dans ce travail, à Aladji pour sa lecture du manuscrit, à Georges pour les bons
moments passés ensemble, et à Bertin avec qui je partage le même bureau. Je voudrais
XXVII
conclure par un merci spécial à tous les membres de ma famille, d’abord mes parents Josué
Ndoula et Tefeme Marie, ensuite mes frères et sœurs Emmanuel, Shalom, El-Shaddai,
Alliance Fidèle, Jacob, Margueritte et Sabine. Je voudrais conclure par une action de grâce
au Seigneur qui m’a donné la force et le courage de pouvoir arriver au bout de cette
aventure.
1
Introduction générale
Tu vois le petit mur là ? Il contient seulement quelques cases, tu peux compter les toits. Là, c’est un pauvre type qui habite seul. Toutes ses femmes l’ont abandonné, et pourquoi ? Parce qu’il n’arrive pas à les entretenir [Rires]. Et où sont ses enfants ? Même sa maison montre qu’il est un homme irresponsable. Comment pareil homme peut-il se faire respecter dans le village ? Chez nous, la maison est comme un miroir dans lequel les gens te regardent.
(Entretien avec Slagama, homme, 65 ans, le 23 mai 2007, à Udjila).
Ces commentaires de Slagama, un participant à ma recherche en 2007, posent en
substance la question de la maison comme une entité sociale active, capable de donner des
informations sur le statut social de son occupant. Ils invitent à reconnaître les efforts que les
gens font pour créer des identités différentielles, et cela à partir entre autres des pratiques
liées à la maison. Ici, Slagama dénigre la maison de son voisin, une petite structure
localisée en contrebas de la sienne, pour définir sa place en tant que personne marginale au
sein de la société, et surtout pour remettre en cause sa capacité à bien s’occuper des
membres de sa famille dont il en est le chef. Autrement dit, la métaphore de la maison en
tant que « miroir dans lequel les gens te regardent » n’évoque pas uniquement son rôle
comme reflet passif des relations sociales. Elle fait aussi allusion à son pouvoir d’action et
à sa capacité de communiquer, de représenter, d’influencer et d’enseigner les individus qui
l’habitent (Tilley, 2006: 1; Miller, 2005: 5; Buchli, 2002: 209). En tant que telle, la maison
est parfois vécue comme un symbole fort de la réussite ou de l’échec d’une personne dans
la vie.
Cette thèse ambitionne de mettre à jour l’entrelacement entre maison et identité,
notamment dans ses ramifications ethniques et individuelles. Ce qui demeure fondamental
tout au long de l’analyse est la chose suivante : les deux axes actanciels définis (ethnicité et
statut social) et la maison sont mutuellement constitutifs l’un et l’autre dans la mesure où
2
ils s’influencent réciproquement (Appadurai, 1996:13-14; Hodder, 1982: 85). Avant
d’expliciter plus amplement cette relation dialectique qui est au cœur même de ma
problématique, profitons du fait qu'on en soit encore à l'étape introductive pour dire
quelques mots sur la genèse du projet ainsi que sur le contexte historique de la recherche.
1. Quelques mots sur la genèse et le contexte de la recherche
L'idée derrière cette thèse remonte à une série de discussions que j’ai eues avec
Christian Seignobos, Directeur de recherche honoraire à l’Institut de recherche pour
développement (IRD – France) qui a consacré près de 40 années de recherche au Nord-
Cameroun. Ce dernier me proposa à l’issue de la soutenance de mon mémoire de DEA de
travailler sous sa supervision sur les architectures vernaculaires en lien avec la mémoire
servile. Jeune doctorant, soutenir ma thèse dans des délais raisonnables était alors ma
priorité. Or, cette problématique s’avérait pour le moins difficile à élaborer tant les
populations fournissent des interprétations variées du rapport entre maison et mémoire.
Toutefois, je me suis engagé dans une telle recherche pour une triple raison. D’abord, je
trouvais l’idée de bénéficier d’un contrat de recherche avec l'IRD intéressant dans la
mesure où cela me permettait de me consacrer pleinement à la recherche et d'enrichir ma
réflexion en travaillant dans un environnement adéquate. Ensuite, je voyais en la richesse
documentaire (bases des données, revues électroniques, documents audiovisuels, catalogue
des collections et catalogue de la médiathèque) de l’IRD un atout important pour
approfondir ma pensée sur la problématique de la maison. Je comptais aussi pouvoir
bénéficier de l’expertise des chercheurs ayant consacré de longues années de recherche aux
monts Mandara à travers leurs critiques, leurs remarques et leurs suggestions. Réaliser une
thèse sous l'égide de l'IRD me permettait enfin de pouvoir faire connaitre mes recherches et
d’élargir mes compétences scientifiques. Immédiatement après l'obtention de mon DEA, je
disposais ainsi de 06 mois pour effectuer une recherche préliminaire sur le terrain à partir
d’un protocole d'entretiens centré sur le lien entre la maison et la mémoire servile. Les
résultats de mes enquêtes ne m’ont pas cependant permis d’aller dans cette direction.
Vu la complexité de la question mémorielle et ne disposant pas de documentation
pour circonscrire le sujet, je décide de réorienter le travail essentiellement sur la maison, en
3
épousant une démarche parallèle à celle de Seignobos. Géographe de formation, celui-ci
était davantage intéressé par les questions des techniques de construction, de l’occupation
de l’espace, des matériaux de construction et de l’impact du milieu sur les constructions
vernaculaires. Autrement dit, les travaux de Christian Seignobos s’inscrivaient davantage
dans une logique technologique, un chemin tracé par André Leroi-Gourhan au début des
années 1950. Selon cet auteur, l’habitat répond à une triple nécessité : 1. créer un milieu
techniquement efficace, autrement dit fonctionnel ; 2. assurer un cadre au système social,
c’est-à-dire découper l’espace et le personnaliser ; 3. mettre de l’ordre, à partir d’un point,
dans l’univers environnant (Leroi-Gourhan, 1973 [1954]). Or, ces conditions ne
permettaient pas de répondre très adéquatement à mon objet de recherche et cela m’a
poussé à explorer d’autres voies. C’est dans cette perspective que l’idée pionnière d’Amos
Rapoport de faire ressortir la configuration et la transformation de l’architecture du
déterminisme physique et technologique a stimulé ma réflexion. Amos Rapoport démontre
comment la taille, l'emplacement, la forme et l'apparence des habitations traditionnelles
sont principalement régis par des facteurs socioculturels (1969: 46-60).
Par ailleurs, étant donné ma formation essentiellement d'historien, il convenait de
donner une dimension historique à ma recherche et de déjouer ainsi le fétichisme
ethnologique qui caractérise les ouvrages produits sur l’architecture africaine de manière
générale, d’où l’élaboration d’une problématique axée sur l’identification des liens entre ce
que Christian Seignobos appelle habitat traditionnel (1977) et les nouvelles maisons
apparues dans les années 1980 à travers les deux principales questions suivantes : quels
rôles sociaux et techniques joue la maison dans la formation, l'expression et la
transformation des structures sociales, et en quoi celles-ci affectent-elles réciproquement
les transformations des pratiques architecturales des individus ? Cette double question me
paraissait essentielle pour comprendre la dynamique et les forces socio-culturelles qui
conditionnent et expliquent les mouvements architecturaux, et qui varie d’un contexte
historique donné à un autre.
L’orientation du sujet étant ainsi précisée, se pose la question de la définition des
groupes ethniques à étudier. Dans les monts Mandara vivent une mosaïque de groupes
humains. Les auteurs comme Antoinette Hallaire (1991), Christian Seignobos (1982) et
4
Jean Boutrais (1973) en dénombrent une vingtaine juste dans la partie septentrionale. Cette
région a fait l’objet d’une abondante littérature, même si, comme le précise Scott
McEachern (1990), les données relatives au contexte historique de migration et de
peuplement restent toujours mystérieuses et très disproportionnées selon les ethnies.
Globalement, les travaux ont porté sur trois principales ethnies que sont les Mafa (Müller-
Kossack, 1999, 1997; Van Santen, 1995; 1993; 1985; Gavua, 1990; Boisseau, 1974;
Genest, 1974), les Mofu (Vincent, 1991, 1975, 1972, 1971; Boutrais, 1978) et les Kapsiki
(Van Beek, 1997, 1995, 1989, 1987, 1986, 1981). Quant aux autres groupes ethniques tels
que les Podokwo, les Mineo, les Gemzek, les Zulgo, les Mada ou encore les Mura, ils n’ont
reçu que très peu d’attention ethnographique. Mon choix de travailler sur les Podokwo, les
Muktele et les Mura est en partie lié à cette absence de véritables études qui leur sont
consacrées. Mentionnons cependant quelques travaux pionniers, notamment les travaux
ethnographiques de Diane Lyons sur les Mura et ceux de Bernard Juillerat consacré aux
Muktele.
Les travaux de Diane Lyons ont essentiellement porté sur le rapport entre la
conception de l’espace et les perceptions culturelles des rôles et des relations de genre
(1989; 1992). Cette auteure s’est aussi intéressée à la manipulation des maisons
rectangulaires à Dela par quatre différents groupes ethniques que sont les Mura, les Urza,
les Wandala et les Suwa (1994). Bien que l'utilisation des maisons rectangulaires soit
associée aux influences islamiques et européennes, Diane Lyons montre que leur
incorporation dans l'architecture ethnique relève d’une stratégie utilisée par les Mura pour
négocier leurs propres intérêts politiques, dans un contexte marqué par la volonté de
modernisation des structures de l’État. Il s’est écoulé vingt ans entre les observations
ethnographiques de Diane Lyons et le début de mes recherches sur les Mura, mais les
conclusions auxquelles elle est parvenue sur l’espace domestique mura et sur l’utilisation
des formes rectangulaires reflètent en partie les informations recueillies et analysées dans la
présente recherche.
En dehors des écrits ethnographiques de Diane Lyons, d’autres études sur les Mura,
notamment celles de Jan Mouchet et de Hermann Forkl peuvent être signalées. Jean
Mouchet, un ancien administrateur colonial français a publié une série d’articles sur les
5
groupes vivant dans les monts Mandara septentrionaux, incluant les Mura et les Podokwo
(Mouchet, 1947: 111-124). Un autre article sur les Mura vient de Hermann Forkl (1988),
même si son objet central portait plutôt sur les Wandala, et non sur les groupes
montagnards. Ceux-ci ont été interviewés dans le cadre de leurs rapports avec le royaume
du Wandala et Hermann Forkl indique d’ailleurs qu’il a eu recours à un interprète d’origine
wandala, qui était, d’après Diane Lyons, membre de la famille royale. Or, comme cela sera
précisé dans le chapitre quatre, les Wandala et les groupes montagnards entretenaient des
relations plus ou moins concurrentielles. Cela pourrait partiellement expliquer pourquoi les
données présentées par Hermann Forkl sur les groupes montagnards sont décalées par
rapport à celles d’autres chercheurs cités plus haut, Jean Mouchet et Diane Lyons en
l’occurrence.
Les Muktele quant à eux ont fait l’objet d’un travail de synthèse ethnographique
produit par Bernard Juillerat (1971, 1970, 1968) qui a passé seize mois de travail sur le
terrain répartis en deux séjours (janvier à septembre 1966 et octobre 1967 à juin 1968). Cet
auteur s’est particulièrement intéressé aux structures sociales muktele, notamment à
l'origine des lignages à travers les récits mythiques et la tradition orale, à la constitution de
l’ethnie et à l’organisation sociopolitique des différents clans et lignages. Une place
importante est faite aux relations interlignages à travers les relations matrimoniales,
notamment aux chants de courtisation et à l'interprétation symbolique du mariage. Ses
travaux ont permis de concevoir un protocole d’entretiens sur le rôle de la maison dans les
relations interethniques à travers la connexion entre le mawnik, petite brèche ouverte dans
le mur et la fête du madvedev1.
Contrairement aux deux précédents groupes, les Podokwo n’ont pas reçu l’attention
de chercheurs. Dans l’état actuel de nos connaissances, la seule référence disponible est un
œuvre écrite par un ancien administrateur colonial français, en l’occurrence Bertrand
Lembezat (1949), sur le clan podokwo de Mukulehe, dans laquelle il livre son appréciation
des us et coutumes locaux.
1 Voir glossaire pour les significations des termes mawnik et madvadev.
6
Carte 1 : Répartition des groupes ethniques dans les monts Mandara septentrionaux (Fond de la carte, Müller-Kosack, 2003 : 194)
Si les recherches spécifiques conduites sur les trois groupes sont rares ou inexistantes,
il existe néanmoins des ouvrages généraux dans lesquels des pages leur sont consacrées.
Les plus significatifs sont les travaux de Christian Seignobos (1982), de Jean Boutrais
(1973) et d’Antoinette Hallaire (1991; 1965). Les travaux d’Antoinette Hallaire constituent
à ma connaissance la première étude systématique des ethnies habitant les monts Mandara
septentrionaux. Elle a produit une vaste étude sur la répartition démographique et les
pratiques agricoles, mais en y incluant des données intéressantes sur l’architecture dont l’un
des traits les plus évidents, écrit-elle, est la répugnance pour les terrains plats et la
préférence aux terrains situés en altitude (Hallaire, 1991). Ce constat, qui sera corroboré par
d’autres chercheurs (Vincent, 1991; Seignobos, 1982), a permis d’élaborer l’hypothèse
selon laquelle il existerait un rapport entre le souci d’occuper topographiquement un site en
7
altitude et la volonté d’affirmer son prestige et son statut social, une idée plus amplement
développée dans le chapitre V.
Un autre ouvrage ayant inspiré cette présente étude est le travail de Jean Boutrais
(1973) sur la descente des Montagnards en plaine et les conséquences qu’elle a entrainées
sur les structures sociales, les relations entre clans et ethnies. Boutrais a effectué des
recherches échelonnées entre 1968 et 1969 centrées autour du massif de Mokyo. Il a donc
eu le temps d’observer l’impact et les effets de la descente en plaine sur les structures
sociales et les réactions des Montagnards face à l’opération de descente orchestrée par le
sous-préfet de Mora en 1963.
Signalons pour finir un dernier ouvrage, et non le moindre, produit par Christian
Seignobos (1982) sur les architectures traditionnelles dans les montagnes du Nord-
Cameroun. Cet ouvrage présente l’architecture comme un élément d’identification
ethnique, car remarque Seignobos, chaque groupe possède un stéréotype architectural
propre et décelable dès la simple visite des concessions (1982). Se basant, sur les plans, les
matériaux et les techniques de construction, Seignobos a par la suite procédé au
regroupement des architectures en trois modèles à savoir le modèle mafa, le modèle mofu
et le modèle podokwo. Sur ces trois modèles s’accrochent, fait-il valoir, des aires
architecturales pouvant aboutir à une sorte de dialectisation de l’habitat (1982 :42).
Seignobos fait en outre valoir que la différence entre ces trois modèles est surtout visible à
travers les murs d’enceinte, lesquels donnent aux habitations montagnardes l’allure de
véritables bastions (Seignobos, 1982 : 28). Ce constat l’amène finalement à situer
l’élaboration de ces modèles ethniques dans un contexte historique marqué par des rais
esclavagistes et plus tard par la domination coloniale.
2. Un contexte historique marqué par des raids esclavagistes et la domination coloniale
L’évolution historique des groupes humains habitant les monts Mandara est à
inscrire dans la dynamique globale du bassin tchadien, un espace géographique qui a vu
l’émergence des royaumes tels que le Kanem-Borno, le Bagirmi et le Wandala. Leur
expansion territoriale s’accompagne d’une série de violences qui semble être à l’origine des
8
vagues successives de migrants cherchant à se réfugier dans des principaux sites défensifs, à
l’instar des monts Mandara. Considérés comme des « réservoirs d’esclaves » (Urvoy, 1949),
les Montagnards furent constamment harcelés, ce d’autant plus qu’ils étaient réfractaires à
l’Islam, religion des principales hégémonies (Garaktchémé, 2012; Urvoy, 1949). Face aux
razzias perpétrées par les esclavagistes, ils mirent en place des mécanismes de défense ce qui
se révéla dans leur système de construction des maisons (Seignobos, 1982). Plus que cela,
les Montagnards ont, consciemment ou inconsciemment, refoulé leur passé servile, et l’ont
remplacé par des traditions historiques d’origine véhiculant plutôt des récits de nature
mythique. En tant que moyen d’embellissement de la mémoire, les mythes et les chants ont
créé une sorte de trou noir dans la mémoire (Jewsiewicki, 2011 : 4), absorbant ainsi les
souvenirs de la servilité2. C’est à ce contexte d’hégémonie des royaumes de la plaine et de
refoulement des souvenirs du passé servile par les « gens de montagne » que se greffa la
colonisation européenne au début du XXe siècle.
Ce furent d’abord les Allemands qui prirent possession de la région, en vertu des
accords signés avec les chefs duala en juillet 1884 qui leur ouvrirent la voie à la conquête
du Cameroun. Mais la conquête militaire ne se termina véritablement qu’en 1902 par la
victoire militaire allemande sur les troupes de Rabah à Kousseri, une ville située à environ
250km des monts Mandara. Fascinés par l’organisation des lamidats et des sultanats
islamiques, c’est tout naturellement que les Allemands associèrent les Wandala à
l’administration des Montagnards. L’administration coloniale allemande ne dura toutefois
qu’une décennie, car leur défaite lors la Première Guerre mondiale entraina la perte de leurs
possessions coloniales africaines, dont le Cameroun. Un condominium franco-britannique,
mis sur place le 14 septembre 1914, aboutit au partage du Cameroun entre les forces alliées
qu’étaient les Français et les Britanniques, précisément le 04 mars 1916.
Dans le cadre de ce grand partage, trois quarts du territoire, incluant le nord du
Cameroun, revint aux Français. Faute de ressources humaines nécessaires, ces derniers
suivirent les pas de leurs prédécesseurs allemands en s’appuyant sur les structures
2 Voir le chapitre III pour les détails sur le contexte historique de l’émergence des royaumes péri-tchadiens (Kanem, Borno et Wandala) (XIXe-XIXe siècle) et de l’hégémonie peule (XIXe- début XXe siècle). Les raids esclavagistes qui accompagnèrent le développement de ces hégémonies ont influé sur les discours mémoriels et identitaires des Montagnards.
9
politiques wandala pour administrer les monts Mandara septentrionaux, ce qui accentua les
actes d’insoumission des Montagnards à l’autorité coloniale. L'opinion la plus répandue
tout au long de la période coloniale française était alors que les Montagnards étaient
naturellement arriérés, rebelles et hostiles à tout contrôle (voir par exemple Kerbellec,
1943; Maronneau, 1934; Chabral, 1931; Remiré, 1929; Vallin, 1927; Coste, 1923; Petit,
1920; Audoin, 1919). Les réactions des Français à l’insoumission ont été souvent
dévastatrices, même si ces derniers procédèrent finalement à quelques réaménagements à
partir des années 1940 en créant des cantons en territoire montagnard.
La décennie 1940 inaugure ainsi un nouveau thème dans la politique coloniale
française, qui est celui de « restauration des anciens pouvoirs païens » (Boutrais, 1973 : 64)
ou de kirdisation du pouvoir (Garaktchémé, 2014). Ce nouveau thème est en fait le
prolongement et l’aboutissement de la politique dite de pacification commencée dans les
années 1930 (Beauvillain, 1991). Il se manifeste concrètement par la création des cantons à
la tête desquels sont nommés des Montagnards placés directement sous le commandement
du chef de subdivision, les soustrayant ainsi à l’autorité du sultan de Mora. Les trois
cantons podokwo (Podokwo-sud, Podokwo-nord et Podokwo-centre), et le canton Mora-
Massif seront dès lors créés en 1942 (voir Boutrais, 1973 : 64). Par contre chez les Muktele,
il faudra attendre 1949 pour voir l'administration coloniale parvenir à la création de deux
cantons distincts: le canton Muktele-Baldama et le canton Muktele-Zuelva (voir Juillerat,
1971 : 21). La mise en place des cantons a contribué à la sédimentation et au renforcement
de la conscience ethnique encore embryonnaire, laquelle se traduit par un attachement plus
marqué aux symboles ethniques en particulier à l’architecture « ethnique » (Seignobos,
1982). Des auteurs comme Scott MacEachern (2002, 2001, 1998, 1992), David Nicholas,
Judith Sterner et Kodzo Gavua (1988), Jean Boutrais (1973) ou encore Bernard Juillerat
(1971) ont d’ailleurs surestimé le rôle de la colonisation en liant l’apparition des sentiments
ethniques à la création des cantons. Nos enquêtes chez les Podokwo, Muktele et Mura
amènent à relativiser cette thèse. En effet, si la création des cantons semble avoir été
réappropriée par des groupes ethniques tels que les Mafa et les Bulahai (David, Sterner et
Gavua, 1988) ou les Uldeme (MacEachern, 1998), les groupes étudiés dans le cadre de ce
travail peinent encore à s'identifier aux cantons. Ici, les trois strates d'identification en
vigueur restent le clan (par l'évocation de l'origine et de l'ancêtre communs), l'ethnie (par
10
l'évocation d'une langue et d'une architecture communes), et l'identité montagnarde (en
situation de contacts avec les Wandala)3.
L’impact de la colonisation sur les représentations identitaires semble plutôt être lié
à la création des imaginaires et des figures-types de l’Autre montagnard. La création de ces
imaginaires était nécessaire pour légitimer la mission civilisatrice qui était au fondement
même de la colonisation, mais dont l’application sur le terrain fut marquée par les violences
à l’égard des colonisés (Bancel, Blanchard et Vergès, 2003). L’architecture montagnarde
s'imposa comme le principal lieu d’élaboration de ces représentations stéréotypées et fut
décrite comme authentique et originale (Ferrandi, 1928). Les Montagnards se servirent de
la même architecture pour inverser les imaginaires coloniaux et véhiculer deux discours
valorisants d’eux-mêmes, à savoir d’une part le mythe du résistancialisme et d’autre part
l’amour pour le travail dont la construction du mur de pierres en est la matérialisation4.
L'indépendance du Cameroun obtenue en 1960 mettait théoriquement fin à l’exploitation de
la main d’œuvre montagnarde dans la mise en place des infrastructures coloniales, mais
ouvrait en même temps la voie à une succession rapide d’évènements qui influèrent sur les
dynamiques identitaires et les pratiques architecturales.
D’abord, il y a le décret sous-préfectoral déjà mentionné qui rend obligatoire la
descente dans les plaines environnant les massifs. Selon les estimations de Boutrais,
environ 45 000 personnes s’établirent en plaine seulement au cours de l’année 1963
(Boutrais, 1973: 53). Globalement la migration en plaine s'effectua selon deux modalités
différentes : la première fut l'installation des populations sur les piémonts et sur la portion
de la plaine située en contrebas du massif; la deuxième fut l’installation dans les villes
wandala, laquelle provoqua un peuplement plus hétéroclite. En outre la descente des
Montagnards en plaine donna lieu à l’observation des trois schémas suivants : l'attachement
plus marqué à la montagne chez ceux qui sont restés en montagne; l'hybridation
architecturale et identitaire chez ceux vivant dans les villages de la plaine; l'assimilation
quasi-complète aux Wandala par l'adoption des symboles architecturaux islamiques chez
3 Se référer au chapitre IV quant au rôle de la politique coloniale dans la sédimentation de la conscience ethnique montagnarde.
4 Voir le chapitre II sur la création des imaginaires coloniaux et leur récupération par les locaux.
11
ceux vivant dans les bourgs musulmans. Mais dans tous les cas, on remarque qu’à partir des
années 1970 et 1980, l’architecture montagnarde intègre de plus en plus deux nouveaux
éléments à savoir, la tôle et la forme rectangulaire. Dans les massifs, notamment chez les
personnes du troisième âge, la tôle et la forme rectangulaire ont été domestiquées et
incorporées à l'intérieur des structures symboliques existantes. En revanche, chez les
jeunes, surtout ceux habitant en plaine, elles ont introduit des ruptures considérables dans
les formes et les pratiques architecturales5.
La tôle et le plan rectangulaire des maisons apparaissent comme une stratégie du
paraitre moderne à partir des années 1980 (Boutinot, 1994) qui marque l’intensification de
l’exode rural et l’entrée des Montagnards dans la fonction publique. L’aspiration à une vie
meilleure poussa de nombreux jeunes à envisager l’utilisation des villes comme espace
complémentaire à l’économie montagnarde (Boutinot, 1994; Iyebi-Mandjeck, 1993). Une
des particularités de l’exode rural est la nostalgie du retour au village pour y consommer sa
réussite migratoire en y construisant une maison « moderne » c’est-à-dire neuve. L’exode
rural constitue d’ailleurs un repère historique important, dans la mesure où les jeunes
montagnards s’y réfèrent pour scinder leur histoire entre un avant et un après : l’avant est
associé à un mode de vie précaire défini par des maisons traditionnelles, et l’après évoque
l’émergence d’un style de vie nouveau et moderne dont la principale caractéristique est
l’apparition des belles maisons au village. Toutefois, c'est davantage l’entrée des
Montagnards dans la fonction publique qui est porteuse des changements car elle redessine
et brouille les rapports entre eux et leurs communautés d’appartenance. Ces fonctionnaires
que les locaux considèrent comme leurs fils en ville et comme leurs évolués, c’est-à-dire
leurs élites, sont des gens qui, ayant été les premiers de la région à avoir fait des études
universitaires, ont eu droit à des carrières plus ou moins remarquables dans la fonction
publique. Du fait de leur revenu dépassant de loin les modiques sommes engrangées
mensuellement par les migrants urbains, ces élites vivent dans ce que les gens du village
considèrent comme du luxe. Ceci suscite leur mécontentement dans la mesure où ce
prétendu luxe, en étant consommé ailleurs et non au village, est assimilé à du gaspillage.
5 Voir le chapitre IV sur le rôle de la descente en plaine sur les pratiques architecturales selon qu’on est en montagne, dans les villages de la plaine ou vivant dans les bourgs musulmans.
12
Par ailleurs, cet écart entre la fortune des fonctionnaires et le revenu des autres
montagnards offre le prétexte pour des accusations réciproques de sorcellerie : d’une part,
les gens du village justifient la fortune de leurs élites par la vente des parents (Geschiere,
2013, 2012, 1998), ce d’autant plus qu’elle est accumulée ailleurs, loin du regard de la
communauté, d’autre part, ces dernières soupçonnent aussi les gens du village d’utiliser les
forces occultes pour les éliminer par pure jalousie, d’où la forte tendance des fonctionnaires
à construire leurs maisons ailleurs qu’au village pour se soustraire, à la fois, aux
accusations et aux attaques de sorcellerie6. Malgré ces rapports minés d’ambigüités entre
élites et villages, on observe par moment des rapprochements, notamment dans le cadre des
associations ethno-régionales mises sur pied par les élites dans le contexte de la transition
démocratique. Dans cette avenue, la maison traditionnelle s’est chargé de nouvelles
significations : elle ne sert pas seulement à souligner l’identité ethnique, mais davantage
l’identité montagnarde. Les discours identitaires de l’après 1990 insistent davantage sur les
traits communs que sur les particularités ethniques de l’architecture. Toujours dans le cadre
de cette transition démocratique, la mémoire de l’esclavage, mise sous silence sous la
période coloniale et postcoloniale, est capitalisée à la faveur de la construction de cette
identité montagnarde ; l’objectif étant de se considérer comme une entité régionale pour se
positionner face au pouvoir en place en « clients politiques » (Chétima, 2010)7.
Au regard de ce contexte historique, il ressort que le XXe siècle fut une période
riche en évènements: fin de l’esclavage (début du XXe siècle), violences coloniales et
création des imaginaires (1916-1960), création des cantons dans les massifs (1940-1950),
descente forcée des Montagnards en plaine (à partir de 1963); exode rural et entrée massive
des Montagnards dans la fonction publique (à partir de 1980), et transition démocratique (à
partir de 1990). Ces évènements ont influencé diversement et de manière discontinue les
discours identitaires des Montagnards, ce qui m’a contraint à circonscrire aussi l’analyse
temporelle de manière discontinue et interrompu. Par ailleurs, le cadre chronologique
6 L’ambigüité du discours sur la sorcellerie apparait surtout avec l’entrée des originaires des monts Mandara dans la fonction publique. Ces derniers, du fait qu’ils habitent dans des maisons confortables en ville, sont considérés comme les Blancs du village, et feront en même temps l’objet de rumeurs de sorcellerie. Voir le chapitre V pour plus de détails.
7 Pour les discussions sur le rôle de la transition démocratique et sur l’utilisation des symboles architecturaux dans les discours identitaires centrés sur l’identité montagnarde, se référer aux chapitres II et IV.
13
restera davantage limité en aval aux années 1940 dans la mesure où les évolutions, ou plus
simplement les disparités, dans les discours identitaires autour des maisons sont rarement,
ou plutôt sporadiquement, soulignés dans les discours des populations aussi bien que dans
les archives coloniaux. Cette période d’avant 1940 est surtout caractérisée par un discours
mémoriel qui tend à refouler le passé et à le présentifier (Hartog, 2003), nivelant ainsi
l’ontologie différentielle de la trame historique.
3. Problématique et hypothèses de travail
Depuis la parution de l’ouvrage fondateur d’Amos Rapoport en 1969 sous le titre
House form and culture, il est aujourd’hui admis que la forme de la culture matérielle, bien
que contrainte par des exigences environnementales et fonctionnelles, sert surtout d’un
moyen de communication d'informations. En attribuant des rôles secondaires aux
déterminants physiques et en insistant sur la primauté des forces culturelles (Rapoport,
1969 : 47), les travaux de Rapoport vont favoriser la marginalisation de la matérialité et de
la physicalité dans les études ultérieures sur la maison (voir par exemple Lawrence, 2000;
Johnson, 1993; Geertz, 1973). Cette lacune sera en partie comblée avec l’avènement du
structuralisme de Claude-Lévy-Strauss (1991, 1987, 1984, 1979), qui à travers son concept
de « société à maison », fera un pas important vers la conciliation du physique et du social,
du naturel et du culturel, du matériel et de l’immatériel. Cependant, les approches
structuralistes sont venues avec leurs propres faiblesses, car comme les critiques de Hillier
et Hanson (1984: 5) le soulignent, elles ignorent le rôle des individus et leur capacité à
apporter des changements sociaux dans un contexte donné. En d'autres termes, les
structuralistes dépeignent les individus comme étant « subordonnés à des mécanismes
d'organisation de l'inconscient» (Humphrey, 1988: 16) plutôt que comme «des acteurs
sociaux compétents » (Hodder, 1982 : 8). En outre Ian Hodder estime que les structuralistes
ne font aucun effort pour comprendre les règles de changement structurel qui interviennent
dans le temps et dans l’espace.
Ce type de critique a largement contribué à la réévaluation du rôle de la maison au-
delà de la simple réflexion passive des cultures pour la considérer comme un lieu actif,
structurant mais aussi structuré, par des systèmes de production et de reproduction de la
14
culture (Dant, 2005, 1999; Olsen 2003; Appadurai, 1987; Miller, 1987; Csikszentmihalyi et
Rochberg-Halton, 1981). Des études seront réalisées à partir des différents contextes
temporels et spatiaux pour montrer que les objets ne sont pas passifs, mais qu’ils sont
activement utilisés par les individus dans la création, le maintien et l’affirmation de leurs
identités sociales et individuelles (Olsen, 2003: 91). Dans ce contexte, la maison apparait
nécessairement comme un domaine clé pour étudier l'interaction entre les gens et les
choses, car les gens n’habitent pas leurs maisons comme un réceptacle vide, mais comme
un lieu significatif qui exprime ce qu’ils sont (Kyung, 2012; Hodder and Hutson, 2003;
Johnson, 1993).
Ma problématique s’inscrit dans ce contexte global de réévaluation de la matérialité
et de l’action sociale de l’objet. Je considère la maison dans son sens inclusif pour désigner
non seulement la structure physique et matérielle qu’elle est, mais également toute la
dimension immatérielle, tous les savoir-faire et toute la dimension expressive qui y sont
associés. La matérialité de même que le sens de la maison ne sont jamais figés; ils sont
variables d’un groupe à un autre (Moore, 1986), et d’une période à une autre (Bailey, 1990:
26), ce qui me permettra d’insister sur la dynamicité de la maison dans la construction des
identités sociales (Hodder, 1982) et individuelles (Duncan, 1982).
Ma recherche doctorale se détache ainsi de toute une littérature ethnologique qui
associe l’architecture traditionnelle aux concepts de stabilité et d’authenticité. Je propose au
contraire une approche dynamique en prenant en compte les différentes temporalités
(descente en plaine, exode rural, fonctionnariat et transition démocratique) lesquelles
permettront d’analyser et de comprendre les dynamiques architecturales selon qu’on quitte
un espace montagneux pour un espace plat, et selon les évolutions de familles au fil du
temps, des rapports de genre et des rapports intergénérationnels. Cette étude s’inscrit
également dans un nouveau paradigme qui articule le local et le global (Clifford, 1997) et
ambitionne de saisir les représentations sociales et symboliques de la maison en fonction
des contextes spatiaux et sociaux, de regarder et de lire la maison dans cette pluralité de
contextes, et enfin, de saisir par là même la trajectoire de vie suivie par les individus et par
leurs maisons. L’aspect spatial et temporel permettra en outre d’établir des comparaisons
interethniques, mais aussi des comparaisons entre les maisons en montagne et celles en
15
plaine pour dégager les permanences et les ruptures en prenant en compte l’expérience de la
mobilité des gens.
Par ailleurs, mon approche s’inspire des travaux de l’anthropologue britannique
Daniel Miller qui préconise un recentrement du regard sur la matérialité de la maison, car
« nos mondes sociaux sont constitués par elle » (1998 : 3). Daniel Miller appelle les
chercheurs à accorder une attention particulière aux contextes et aux agents qui, selon lui,
transforment l’entité physique de la maison (house) en une entité sociale pleine de
signification (home). Contrairement aux analyses structuralistes, Daniel Miller pense que
les individus manipulent les formes de la maison comme une stratégie visant à créer, à
reproduire ou même à contester les valeurs et les idéaux culturels qui leur sont associées
(2005; 1987). Considérer la réalité de la sphère domestique - liée mais pas limitée aux
frontières physiques de la maison - comme un lieu de production des structures de pouvoir,
rend dès lors pertinent la prise en compte du concept home dans la définition de la maison.
Dans la lignée de Daniel Miller, je reconnais que la maison est inextricablement liée et
mutuellement constitutive des structures sociales, politiques et économiques. Inversement,
les processus sociaux influent considérablement sur la sphère domestique. En prenant appui
sur un tel postulat, cette thèse illustre comment la maison, à travers ses multiples usages,
devient à la fois porteuse et agent de communication de plusieurs appartenances identitaires
à un niveau sociétal et individuel (Bromberger, 1980). L’analyse sera centrée autour de
quelques périodes clés que sont la descente en plaine (1963), l’exode rural (1980) et la
transition démocratique (1990). Le moment le plus décisif sera cependant les années 1980
qui marquent l’émergence des nouvelles maisons, fruits de l’accumulation d’argent lors des
séjours migratoires.
Un deuxième aspect de la recherche de Daniel Miller, important pour mon
approche, est l’idée que la culture matérielle est un lieu de transmission et de codification
de notre propre image pour les autres. Miller formule des concepts tels que
appropriation et accommodation pour décrire et expliquer les processus par lesquels la
maison est personnalisée, et la façon dont elle devient un processus de création identitaire
(voir Miller, 2002). De cette façon, l’attention doit être portée, non seulement sur ce que les
individus font avec les objets, mais aussi sur la « manière dont les objets que les individus
16
font, font à leur tour les individus » (Miller, 2001 : 119), d’où les propos de cet auteur selon
lesquels, « where we cannot possess we are in danger of becoming possessed » (Miller,
2001 : 120).
En considérant la manipulation active de la maison dans trois différents contextes
(la famille, le village et la région), cette étude examine les manières dont deux catégories
d’identité se dessinent (ethniques8 et individuelles9) et montre comment ces identités
interviennent dans la configuration de l’intérieur domestique, et comment cette dernière
règlemente à son tour les représentations identitaires. J’établis comme hypothèse-cadre que
chez les Podokwo, les Muktele et les Mura, la logique pratique et fonctionnelle de la
construction, de l’extension et de la transformation de la maison évolue en tandem avec des
considérations d’ordre symbolique, notamment la production des sentiments ethniques
(Hodder, 1982) et la quête du prestige social à l’intérieur de la communauté (Duncan,
1982 ; Roux, 1976). Plus qu’un simple miroir reflétant passivement l’image de l’individu
qui l’habite, la maison constitue le premier signal de la naissance d’un « être social »,
respecté et crédible à l’intérieur de même qu’à l’extérieur de son groupe. Ainsi, les gens
construisent la maison, non pas seulement pour s’abriter, mais pour refléter ce qu’ils croient
être la position prototypique de leur groupe par rapport à d’autres, et leur position
prototypique au sein de leur groupe.
Il s’agit donc dans cette recherche d’apporter une contribution à l’histoire des
constructions identitaires chez les Podokwo, les Muktele et les Mura en centrant l’étude
autour de leurs maisons. Dans cette perspective, j’ambitionne d’élargir les idées de
Rapoport (1973; 1969) qui voyait déjà en la maison un signe et un témoin de la culture de
l’individu qui l’habite. Plutôt que d'être simplement l'expression de l’appartenance à une
culture donnée, je défendrai l’idée que la maison et les objets domestiques deviennent des
arènes à travers lesquels la culture vient activement affecter les sujets. Autrement dit, le
rapport de causalité entre individu et maison se trouve inversé : chez Amos Rapoport, la
maison reste soumise et dépend essentiellement de l’action humaine, alors qu’ici, l’analyse
8 Voir chapitre IV sur le rapport entre pratiques architecturales et dynamiques identitaires.
9 Voir chapitre V sur l’utilisation de la maison comme lieu d'affirmation et de négociation des identités individuelles.
17
intègrera aussi la question de l’agency de la maison qui, parfois, surclasse la volonté de
l’homme. Ainsi, en suivant Arjun Appadurai (1986), Christopher Tilley (2006, 2002) et
Daniel Miller (2011, 2010, 2005, 2001) qui mettent le focus sur le pouvoir d’action sociale
de l’objet, cette thèse développe une trajectoire théorique spécifique à propos de la place de
la maison dans les relations sociales et individuelles. À travers les idées théoriques qui en
découleront, elle permettra de voir comment les relations sociales sont créées et reproduites
à travers la construction et la transformation de la maison.
L’objectif général ainsi posé peut être décliné en des objectifs spécifiques qui
s’énoncent comme suit : étudier la maison comme un outil que les personnes utilisent pour
souligner, négocier, bricoler, et dans une certaine mesure, mettre en parenthèse leur identité
ethnique au gré du contexte dans lequel ils agissent ; explorer l'expression de l'être - ou du
vouloir être - par le biais de la maison et des objets peuplant les intérieurs domestiques dans
deux contextes différents à savoir l’avant et l’après 1980; comprendre les relations de
pouvoir à travers la lecture que les personnes font de l’extérieur et de l’intérieur de l’espace
habitable chez l’élite traditionnelle et chez la nouvelle élite (les personnes devenues
fonctionnaires surtout à partir de 1980) ; comprendre les changements qui interviennent
dans les formes de la maison en rapport avec les changements qui interviennent au niveau
du statut social du propriétaire et inversement.
4. Structure générale de la thèse
Cette thèse se décline en cinq chapitres. Le premier chapitre est consacré à l’ancrage
théorique à partir duquel seront abordées les pratiques liées à la maison. Elle fait un tour
d’horizon sur les principales théories avancées pour comprendre le rapport entre la maison
et ses occupants, depuis les travaux novateurs de Franz Boas (1881) jusqu’à l’avènement de
l’archéologie post-processuelle en passant par les approches multi-causales d’Amos
Rapoport et structuralistes de Claude-Lévy Strauss. En lien avec ma problématique et
suivant le débat issu des travaux de Pierre Bourdieu, Ian Hodder, Daniel Miller et
Christopher Tilley, une importance particulière sera accordée aux théories de l’action
sociale lesquelles insistent sur le rôle des objets dans la fabrique de la vie sociale des
individus et dans la constitution de relations socioculturelles.
18
Cette recherche se poursuivra dans un deuxième chapitre par une présentation des
circonstances historiques liées au passé servile et colonial qui influent, par touches, sur la
façon dont est organisé le discours sur l’identité. Les Montagnards ont développé diverses
stratégies pour occulter et/ou pour évoquer symboliquement la mémoire servile, lui
substituant d’autres types de mémoires variables selon les contextes et au gré de leurs
intérêts identitaires, économiques et politiques. Ce chapitre jette ainsi un regard croisé sur
l’histoire, ou plutôt les histoires, officiellement admises de l’esclavage et de la colonisation,
et la lecture locale qu’en font les Montagnards pour apprivoiser ces deux évènements
« dramatiques » et pour les incorporer dans un registre mémoriel, avec pour finalité la
transmission d’une identité mouvante et changeante suivant les époques.
Le troisième chapitre sera consacré à la présentation de l’approche méthodologique
et de l’expérience de terrain effectué au cours des années 2007, 2011 et 2012.
Conformément à la tradition de la recherche sur le sens de la maison, l’approche
phénoménologique interprétative (API) a été choisie pour l'accent qu’elle met, à la fois, sur
le contexte et sur l'interprétation. L’API a été combinée avec l’approche ethnographique
multi-située qui a permis de suivre la dynamique des pratiques architecturales et des
significations sociales de la maison d’une période à une autre et d’un espace géographique
à un autre. En ce qui concerne l’enquête proprement dite, le chapitre présente les quatre
principales techniques de collecte des données qui ont été mobilisées tout au long de la
recherche : les entretiens semi-directifs, les tranches de vie, l’observation directe et la
pratique photographique.
Le quatrième chapitre porte sur la maison en tant que cadre de production et de
communication des identités ethniques, et met en lumière quatre principales dimensions
identitaires à savoir: l'identité montagnarde exprimée à travers des éléments architecturaux
communs et construite en opposition aux Wandala de la plaine; les identités particulières
des groupes montagnards, mises en valeur à travers les spécificités ethniques, et variables
selon qu'on inter-acte avec tel ou tel groupe montagnard ; une constellation de
représentations identitaires consécutive à la descente des Montagnards en plaine à partir de
1963 (attachement plus marqué à la maison traditionnelle chez ceux qui continuent de vivre
en montagne et sur les piémonts, hybridation architecturale et identitaire chez ceux vivant
19
dans les villages de la plaine, imitation des symboles architecturaux des Wandala chez ceux
vivant dans les bourgs musulmans.) ; enfin, l'identité régionale reproduite dans le contexte
de la transition démocratique des années 1990 par des élites montagnardes en quête d'un
positionnement politique, et construite autour de l'iconographie et de la métaphore
architecturales.
Enfin, le cinquième et dernier chapitre porte sur la maison en tant que médium
d’expression identitaire à un niveau individuel. Toujours dans la mouvance des approches
de la culture matérielle, il propose de voir la maison et les objets domestiques comme une
arène particulièrement pertinente pour l'affirmation et la négociation des identités
individuelles chez l’ancienne aussi bien que chez la nouvelle élite. Il met en évidence le
souci de standing social (Roux, 1976) dans deux époques différentes, à savoir l'avant et
l'après 1980, une date qui marque l’émergence d’une nouvelle classe d’élites constituée des
migrants urbains et des fonctionnaires. Avant 1980, le rang social était donné par des
éléments extérieurs de la maison (situation en altitude, surface occupée par la maison, toits
en tiges de mil, nombre de pièces qui composent le quartier des femmes), et l’est encore
chez l’ancienne élite traditionnelle. Par contre, chez les migrants urbains, les signes de la
réussite se greffent dans les toits en tôle et les formes rectangulaires des maisons. Avec
l’émergence des fonctionnaires, la réussite sera lue à partir de l’intérieur de la maison, à
travers l'entassement des meubles au salon et dans la salle à manger.
21
Chapitre I :
Considérations théoriques et positionnement épistémologique de l’étude
L'étude de l’architecture vernaculaire attire de plus en plus l'attention des chercheurs
désireux de comprendre la signification de l’environnement bâti dans lequel vivent et
travaillent les populations au quotidien. Les questions posées sont entre autres: pourquoi y
a-t-il des différences dans les formes bâties? Quelle est la nature de ces différences et quels
en sont les facteurs explicatifs ? De nombreux chercheurs relevant des disciplines
scientifiques comme l’anthropologie, l’histoire, la géographie, l’histoire de l’art, et
l’archéologie se sont impliquées dans les débats sur ces questions. À partir des années
1980, la récente théorie sociale de l’objet a opéré une révolution épistémologique en se
concentrant sur les nouvelles dimensions spatiales et temporelles du comportement humain.
Ces développements sont la preuve que l'attention portée sur la maison est encore
d'actualité, d’où l’intérêt d’explorer la documentation pertinente pour, d’une part, définir
les grands axes de recherche en termes de problèmes et d'approche théorique, et d’autre
part, préciser notre positionnement théorique et épistémologique dans ce vaste champ de la
recherche architecturale.
I. Les premières études sur la maison
L’examen de l'environnement bâti trouve son origine dans les premières théories du
déterminisme environnemental, et dans les traditions ethnographiques. Le déterminisme
environnemental est un point de vue qui met l'accent sur l'effet direct de l'environnement
physique sur la maison, en ignorant ou en sous-estimant d'autres facteurs (contexte
historique, spécificités culturelles, organisation sociale, etc.). En revanche, le
fonctionnalisme en architecture est un focus sur la forme bâtie suivant l’usage qui lui est
affectée. Ces deux approches, quoiqu’opposées, ont favorisé une analyse évolutionniste de
l’habitat; la première mettant l'accent sur l’évolution des techniques, et la seconde sur
l’adaptation de l’habitat aux besoins. L’opposition théorique entre naturalistes et
22
fonctionnalistes alimente les débats sur l’architecture jusqu’au début des années 1970,
période marquée par les travaux novateurs d’Amos Rapoport sur le rapport entre la maison
et la culture. Cette section retrace ainsi l’évolution de ces différentes approches dont: 1.
L’approche dite naturaliste ou géographique qui accorde l’importance aux considérations
environnementales et technologiques dans l’explication des variations dans les formes de la
maison ; 2. Les approches ethnographiques qui lient les formes bâties à l’organisation
sociale et mettent l’accent sur l’aspect fonctionnaliste de la maison; 3. La théorie culturelle
multicausale d’Amos Rapoport qui est une critique des théories du déterminisme
environnemental et des approches fonctionnalistes de la maison.
1. Approche naturaliste : du déterminisme environnemental au déterminisme technologique
L’approche naturaliste est l’une des vieilles explications fournies pour comprendre
les variations dans la forme, la construction et l’orientation de la maison. Pour les tenants
de cette approche, les considérations environnementales, telles que définies par la
disponibilité des matériaux de construction, les techniques de construction, les sites et les
conditions climatiques, représentent l’élément le plus important dans le façonnement d’une
architecture vernaculaire (Blier, 2006 : 238). La nature fournirait non seulement les
matériaux nécessaires pour la construction, mais indiquerait à l’habitant la façon de
concevoir sa maison. En se basant sur les facteurs influençant le choix des types des
maisons au Soudan, David Lee (1969) soutient que les différences architecturales sont le
reflet des variations climatiques. Il fait remarquer qu’au sud du Soudan, les formes des
maisons sont rondes en raison des fortes pluies, alors que dans la partie septentrionale, les
maisons épousent une forme plutôt rectiligne en raison des conditions climatiques arides.
La théorie du déterminisme environnemental a davantage consisté en
l’accumulation des données (croquis, photographies, relevés d’habitation, etc.) qui se
limite, le plus souvent, au stade de l’inventaire (Padenou et Barrué-Pastor, 2006 : 32). Elle
cherche également à expliquer les caractéristiques physiques de la maison, y compris sa
forme extérieure, le plan intérieur, la décoration, les éléments de construction spécifiques
(portes, fenêtres, toitures), l'emplacement sur le site, etc., en démontrant l'influence des
facteurs environnementaux. Cependant, derrière cette approche naturaliste se profile le plus
23
souvent une théorie évolutionniste primaire, attribuant le prétendu progrès de l’habitat soit
à un peuple supérieur, en général occidental, soit au développement naturel des besoins au
fil du temps, correspondant lui-même au progrès de l’histoire et à l’augmentation des
richesses (Ruegg, 2011 : 117). Les théories du déterminisme environnemental ont dès lors
conduit à des classifications architecturales dans lesquelles certaines architectures sont
situées en haut de l’échelle et d’autres en bas (Calvet, 1975).
Par exemple, dans la deuxième section de leur ouvrage, Amman et Garnier (1889)
font remarquer que la race blanche est la première à perfectionner son habitation. Ils
consacrent la dernière section à la catégorie de ce qu’ils appellent civilisations isolées. Dans
ce groupe sont cataloguées entre autres, les habitations japonaises et chinoises, les maisons
des Esquimaux, l’architecture de l’Amérique précolombienne (des Mayas, des Incas et des
Aztèques) et les habitations des Africains. Une autre classification réalisée par Julius Glück
(1959) situe, tout en bas de l’échelle, l’architecture africaine représentée par une habitation
pygmée. Selon Julius Glück, cette habitation n’appartient pas au monde de l’architecture. Il
s’agirait plutôt d’une préforme, d’Ur-architektur, en raison de sa construction
rudimentaire10. De ces différentes classifications, il ressort qu’il est difficile d’aboutir à une
hiérarchisation architecturale dans laquelle certaines habitations se trouveraient en haut et
d’autres en bas (Roux, 1976 : 12)11. Chaque architecture ne peut en effet revêtir sa véritable
10 Selon Glück, cette habitation ne peut appartenir au monde de l’architecture. Il s’agirait plutôt d’une préforme, d’Ur-architektur - selon sa propre expression - à cause de sa construction si simple. Il n’existerait pour ainsi dire qu’un pas entre les Africains et les singes en matière d’habitation. Des recherches ultérieures ont cependant prouvé qu’en dépit de sa sobriété et de son caractère apparemment simple, l’habitation pygmée est d’une rare complexité. Glück ignorait par exemple les pratiques sociales, culturelles et religieuse y afférentes. Il s’est intéressé au comment et avec quoi est construite la maison des Pygmées sans considérer le pourquoi de sa construction.
11 Il paraît intéressant de commenter les postulats qui fondent ces regroupements de types de maisons et de types de civilisations. Simone Roux écrit que « s’y exprime avec la tranquillité de la bonne conscience une vision européocentriste imprégnée du colonialisme triomphal et du racisme ostensiblement assuré. Elle rejette tout ce qui n’est pas l’histoire de l’Occident dans la barbarie ; au mieux, ces civilisations isolées [ne participent pas au progrès de l’humanité] » (1976 :12). Les classifications architecturales ont en effet servi de preuves d’absence de civilisation des peuples colonisés. En Afrique, elles ont parfois conduit à méconnaitre l’africanité de certains sites architecturaux découverts sur le continent africain. Les colonisateurs de l’ex-Rhodésie (actuel Zimbabwe) par exemple refusèrent d’admettre l’africanité du Great Zimbabwe, un site bien construit qui mettait à mal la vision colonialiste de l’architecture africaine. Sa construction fut plutôt attribuée aux Arabes et aux Phéniciens et, comme l’écrit Malaquais, « la question qui a érigé Great Zimbabwe a suscité
24
signification que replacée dans le contexte culturel et social de son émergence. Qu’elle soit
monumentale ou petite, bâtie en matériaux importés ou en matériaux locaux, qu’elle soit
d’origine occidentale, chinoise, japonaise ou africaine, elle porte toujours inscrite en elle
l’affirmation de multiples facettes de la vie sociale et culturelle du peuple qui l’a mise en
place. Elle est aussi bien un besoin qu’une valeur sociale, politique et religieuse12.
Puis a lieu un déplacement théorique de la maison vue sous l’angle du déterminisme
environnemental vers la maison étudiée d’un point de vue technologique. L’un des
pionniers de l’étude de la technologie relative à l’habitat est André Leroi-Gourhan avec son
ouvrage Milieu et technique (1973) [1945] devenu un classique. Dans son étude des formes
d’habitats universels et des techniques qui s’y expriment, Leroi-Gourhan (1973) [1945]
produit des schémas comparatifs pour l’ensemble de la planète. Sur cette base, il avance
l’idée d’une logique du développement du plan à partir d’une cellule primitive qui aurait
réuni un toit, un foyer et un lit ; ceux-ci constituant les besoins primaires élémentaires
(Leroi-Gourhan, 1973 : 268). Pour appuyer sa théorie, cet auteur se base sur les plans
monocellulaires de la maison familiale et sur les plans pluricellulaires des maisons
communautaires chez les Indiens d’Amérique. André Leroi-Gourhan observe que les
maisons communautaires sont composées d’un foyer central commun autour duquel
viennent se loger les familles séparées par de légères cloisons. Dans la maison familiale par
contre, la technique consiste, soit à cloisonner plus ou moins fermement l’espace, soit à
construire autant de maisons qu’il y a de fonctions (Leroi-Gourhan, 1973 : 269).
Cependant, André Leroi-Gourhan postule que cette différence entre plan monocellulaire et
maisons communautaires, si elle répond à des besoins précis, fait surtout appel à la
technique pour comprendre leurs formes et leurs dimensions.
de véritables batailles rangées dans les années 1970 et la prison ou la mort attendait ceux qui attribuaient sa construction aux Africains» (Malaquais, 2002 : 13-15).
12 C’est ce qui a certainement amené Simone Roux à écrire que l’architecture est : « ce lieu sacré, chargé d’antiques significations religieuses, objet de rites et de cultes, elle est, de plus, un bien matériel dont on évalue le prix, le signe du rang et de la puissance de ceux qui l’occupent, elle est encore le témoignage concret des techniques et des sensibilités artistiques qui donnent à la vie des hommes l’apport culturel et esthétique d’une civilisation» (1976 : 57). Cet aspect est important pour tout historien qui veut comprendre la maison dans l’histoire.
25
Il faut reconnaître à Leroi-Gourhan, par rapport aux premières théories du
déterminisme environnemental, le mérite de distinguer très nettement les hommes et leurs
technologies. Sa mise en perspective spatiale ou géographique de l’évolution technique
présente l’avantage de complexifier une vision purement chronologique, abstraite et
uniforme à travers laquelle les chercheurs classiques cernaient la maison13. Cependant, la
perspective technologique reste encore trop étroite pour comprendre la maison, même si
elle a constitué un point de départ important pour les études architecturales. Elle est aussi
générale que descriptive, et beaucoup trop limitée pour rendre compte, de manière
significative, des différences entre les formes de la maison dans leur épaisseur culturelle.
2. Traditions ethnographiques et théories fonctionnalistes de la maison
L'idée que la maison et l’organisation sociale s’accommodent et s’expriment l’une
dans l’autre trouve son origine dans les premières théories fonctionnelles de Lewis Morgan
(2003) [1881], et de Franz Boas (1964) [1888]. En tant que manifestation de la culture, la
maison a été considérée comme une médiane permettant à un groupe de s'adapter et de se
maintenir avec succès au sein de son environnement social. En plus de fournir un abri
contre les éléments de la nature, Boas (1964) [1888] affirme que les formes bâties reflètent
les cultures qui les ont produites. Ces approches ethnographiques, élaborées à l’issue des
travaux de terrain, se sont davantage inscrites dans la tradition fonctionnaliste. En tant que
telles, elles expliquent la finalité des formes construites en se référant à leur rôle dans le
maintien de la société en tant qu’un groupe particulier et différent des autres. Elles
décryptent leur rôle dans l’expression de l'organisation sociale, de la structure sociale, de la
cosmologie, etc.
En 1881, Lewis Morgan exprimait déjà ce lien intime entre une maison et son
occupant. Sur la base des études qu’il a réalisées chez les Indiens de Mexico, de Yucatan et
du Guatemala, cet auteur soutient en effet que le principe social « trouve son expression
dans l’architecture et prédétermine son caractère» (2003 : 105). Avant d’arriver à cette
13 Pour une analyse de l’apport de André Leroi-Gourhan à l’étude de la maison, Voir François Ruegg (2011 : 40-50).
26
conclusion, Lewis Morgan a identifié différents types de comportements sociaux et
différentes coutumes susceptibles d’expliquer la forme des maisons.
Figure 1 : Perspective fonctionnaliste de la maison selon Lewis Morgan (2003)
Dans son ouvrage Houses and House-life of the American Aborigine (2003) [1881],
il observe que les formes des maisons indiennes ont été conçues pour répondre à un besoin
social. Cette remarque l’amène à conclure que les groupes humains construisent leurs
maisons pour correspondre à des besoins comportementaux précis et à des exigences
fonctionnelles (voir figure 1). La tradition structuro-fonctionnaliste se poursuivra avec les
idées de Durkheim et de Mauss sur l'environnement bâti en tant que partie intégrante et
symbolique de l'ordre social.
En se concentrant sur la question plus large de l'organisation spatiale, Émile
Durkheim et Marcel Mauss (1963) [1888] considèrent l'environnement bâti comme
intimement lié à la vie sociale. Contrairement à Morgan (2003) [1881], Durkheim et Mauss
(1963) voient dans l'environnement bâti, non pas seulement un produit des représentations
collectives fondées sur des formes sociales, mais aussi un modèle pour reproduire les
Besoinssociauxetcomportementaux
Exigencesfonctionnelles
27
formes sociales elles-mêmes14. Alors que Morgan met l’accent sur les caractéristiques de
l’organisation sociale pour répondre aux problèmes de l'environnement bâti, Durkheim et
Mauss soulignent les aspects cognitifs de ladite organisation sociale.
Dans un volume devenu classique et consacré aux Esquimaux, Marcel Mauss et
Henri Beauchat (1979) fournissent une interprétation dynamique de l’habitat et se
proposent d’observer « la manière dont la forme matérielle des groupements humains,
c’est-à-dire la nature et la composition de leur substrat, affecte les différents modes de
l’activité collective (Mauss et Beauchat, 1979). Ils décrivent les variations de la maison
comme une forme essentielle à l'adaptation de la société des Esquimaux, à la fois, aux
changements climatiques annuels et aux changements sociaux. Si les maisons varient en
termes de matériaux, de technologie et de forme, Marcel Mauss (1968) estime que les
changements les plus importants sont ceux en termes de taille et d'organisation sociale.
Ainsi, quoique l'adaptation à l'environnement soit importante, l'intérêt essentiel de Marcel
Mauss était de savoir pourquoi la maison d'hiver, contrairement à la tente d’été, était
communautaire – et donc plus grande – et abritait plusieurs familles. Cette observation lui
permet de lire la morphologie sociale du groupe dans la maison d’hiver.
Par ailleurs, il remarque aussi que la répartition de l’espace par famille est égalitaire,
et donc, non proportionnelle au nombre de ses membres. Marcel Mauss trouve ici un
argument d’ordre sociologique pour montrer que la distribution de l’espace ne se fait pas
toujours en tenant compte de la surface disponible. Pour cet auteur, la maison
communautaire d’hiver est la preuve du caractère non purement environnemental et
technologique de l’habitat. Mauss (1968) rejette comme explication la conservation de la
chaleur, la diffusion de la technologie et les exigences des activités de chasse collectives. Il
soutient plutôt que la grandeur de la maison d'hiver était nécessaire pour répondre au rituel
collectif qui se tenait pendant les mois d'hiver. En outre, il remarque que les Eskimos
n’habitent pas tous dans des régions froides et que, d’autres peuples, dans les mêmes
régions, vivent toute l’année sous des tentes beaucoup moins efficaces contre le froid que
celles des Eskimos (voir figure 2). 14 Pour une analyse détaillée de l’approche durkheimienne et maussienne de l’environnement bâti et de sa relation avec l’organisation sociale, voir l’ouvrage de synthèse de Victor Buchli (2013), et les articles de synthèse de Suzanne Blier (2006) et de Denise Lawrence et Setha Low (1990).
28
Figure 2 : Schéma explicatif du primat des changements sociaux sur les facteurs climatiques et technologiques dans les variations de la maison selon Marcel Mauss
Mauss se distingue donc de la perspective limitée du déterminisme environnemental
et technologique en signalant le risque qu’il y a d’expliquer la maison par des variables
environnementales sans regarder d’autres facteurs, notamment sociaux. La perspective de
Marcel Mauss est infiniment plus riche que celles des premiers chercheurs géographes,
architectes et ethnographes à la recherche d’originalité et d’antériorité ou de foyers de
diffusion des styles de construction. Son analyse permet en effet de confronter l’habitat à la
double causalité environnementale et socioculturelle. La vie sociale oriente les formes
architecturales plus que les seules conditions climatiques, même lorsque celles-ci sont
rudes, une avenue qui sera plus tard théorisée par l’architecte américain Amos Rapoport
(1969). Mauss ne nie pour autant pas les influences du climat, du site et des matériaux de
construction disponibles, mais il trouve dans la vie sociale des Eskimos les principales
raisons de la dispersion et de la concentration de leur habitat. La pratique de la chasse et de
la pêche ainsi que la recherche de la chaleur influent sur les formes des établissements
eskimos, mais seulement en partie, estime Marcel Mauss (1968); la plus grande influence
étant celle des pratiques sociales.
Changements sociaux
Transformation de la maison
Changements climatique et technologique
29
Au demeurant, les études ethnographiques de la maison ont contribué à la
compréhension de la façon dont les systèmes sociaux agissent sur les formes bâties.
Cependant, comme l'a noté Schiffer (1978), malgré la richesse empirique des données
recueillies sur le terrain, une grande partie du travail ethnographique est restée fragmentaire
en théorie. Les descriptions de la forme, de l'utilisation et de la signification de la maison
seront plus tard récupérées par d’autres chercheurs qui disposent des éléments suffisants
pour proposer des explications. C’est par exemple le cas d’Amos Rapoport qui, s’inscrivant
dans la mouvance de l’anthropologie culturaliste, comble les lacunes théoriques des
ethnographes (Morgan, Boas, Mauss et Durkheim en l’occurrence) en faisant valoir le
primat des facteurs invisibles, notamment celui des contextes historiques et culturels, dans
la compréhension de la maison.
3. Amos Rapoport et la théorie « culturelle multicausale » de la maison
Si l’idée exprimée par Marcel Mauss sur l’importance de la double causalité
(environnementale et sociale) ouvre la voie à une nouvelle avenue dans la recherche
architecturale, c’est surtout Amos Rapoport qui contribue à sa refondation théorique. Son
œuvre la plus connue, House form and culture (1969), est un ouvrage concis, mais
globalement comparatif qui rejette les simples explications déterministes en faveur d'une
approche « culturelle » multi-causale et holistique (1980, 1977, 1973, 1969). L’auteur
critique l’approche naturaliste et géographique de la maison en lui reprochant de réduire
l’analyse à des classifications morphologiques et à l’évolution technologique. Rapoport
réfute tour à tour les explications à partir du climat, des matériaux, de la technique, du site
et de l’économie qu’il juge insuffisantes pour comprendre les différentes formes
architecturales (1972 : 58)15.
15Par réaction contre le déterminisme, Rapoport place les facteurs environnementaux après les facteurs socioculturels dans la séquence des chapitres qui composent son ouvrage House form and culture. Rapoport (1972 :34) reconnaît que plusieurs formes de maison peuvent exister simultanément dans une société, car la forme est en partie indépendante des matériaux ou des techniques à disposition. Cet auteur invite à considérer la complexité des interactions et ne parle plus de facteurs déterminants pour désigner les éléments environnementaux. Dans cette avenue, il considère la maison comme l’expression d’un rapport entre milieu humain (culture) et milieu physique (nature). Il accorde dès lors la primauté aux forces socioculturelles et voit la maison comme un phénomène d’abord culturel avant d’être influencée par des facteurs géographiques et techniques (Rapoport, 1973 : 8).
30
Le primat de la diversité culturelle sur les facteurs écologiques est démontré dans
une étude des contrastes entre les formes des maisons des Pueblo et des Navajo pourtant
vivants dans une même aire géographique (1969). Il découvre que dans ces deux
communautés, les éléments invisibles (symboles, rites, relations sociales, etc.) sont de loin
les plus importants dans la détermination de la forme d’une maison. Amos Rapoport
soutient que c’est le style de vie d’un groupe, défini comme l'intégration de tous les aspects
culturels, spirituels et sociaux, qui explique le mieux les variations dans la forme de la
maison (1969 : 47). La maison devient ainsi une catégorie analytique, un instrument actif
capable d’avancer des informations anthropologiques sur la nature des rapports sociaux, et
surtout sur l’identité des individus qui l’habitent. Rapoport considère dès lors comme
primaires les forces socio-culturelles, et comme modifiantes les forces dues aux conditions
climatiques, aux méthodes de constructions et aux matériaux disponibles (1972 :83).
Par ailleurs, Amos Rapoport remet en cause l’idée fonctionnaliste des ethnographes
(Morgan, Boas en l’occurrence) même si ceux-ci admettent l’importance des facteurs
sociaux dans l’explication des faits architecturaux. Ce qui est déterminant, selon Rapoport,
c’est le type de réponse que l’on apporte aux besoins, et non pas les besoins eux-mêmes
(1972 :82). Certes, les diverses sociétés donnent une réponse précise à des besoins (loger,
manger, dormir, habiter etc.) lorsqu’elles construisent une maison. Cependant, ces
fonctions de base sont souvent ignorées au profit des choix initialement considérés comme
non fonctionnels, soutient Amos Rapoport (1972. Par exemple en prenant le cas des peuples
des monts Mandara, s’il est avéré qu’un grenier est construit pour conserver les récoltes de
la famille, l’usage qu’on en fait dans la pratique quotidienne ne reflète toujours pas les
fonctions pour lesquelles il a été construit. Les références culturelles et symboliques (rites,
prestige, honneur, etc.) prennent très souvent plus d’importance dans les interactions des
populations avec leurs maisons.
Toutes ces considérations amènent finalement Amos Rapoport à écarter l’utilisation
du mot maison (the house) et à plaider pour le concept de foyer (home) en tant que
nouveau paradigme épistémologique. Home permet de cerner la relation significative qui
existe entre l’homme et son environnement bâti ; une relation dans laquelle l’homme
31
devient un actant social, agissant de manière indépendante des contraintes naturelles
(Rapoport, 1995)16. Dans la même veine, Coolen, Kempen et Ozaki (2000) soutiennent que
le terme house se limite aux considérations physiques et matérielles de la maison sans une
attention portée sur les relations que les gens développent avec cette structure physique. En
revanche, home est un mot puissant, capable de relier la structure physique à des
significations symboliques, pouvant à leur tour influer sur le comportement des gens (voir
aussi Paadam, 2003). En tant que lieu d’organisation sociale, psychologique, culturelle et
physique, home permet dès lors de contenir les différentes significations de la maison.
Després résume les recherches sur le sens de la maison en tant que foyer (home) en
rapportant quelques significations relevées par les informateurs dans de nombreux travaux
de recherche :
Home as security and control, home as reflection of one’s ideas and values, home as acting upon and modifying one’s dwelling, home as permanence and continuity, home as relationships with family and friends, home as a centre for activities, home as refuge from the outside world, home as indicator of personal status, home as material structure, and home as a place to own (Després, 1991)17.
À l’intérieur de ce nouveau paradigme où house (maison en tant que structure
physique) devient home (maison en tant que structure sociale), Amos Rapoport parachève
sa critique du déterminisme physique et technologique, et situe l’étude de la maison plutôt
dans le champ de la culture (Rapoport, 1986 ; 1982 ; 1977 ; 1976). La culture étant un
domaine vaste, Rapoport suggère de la séquencer en des sous-domaines pour atteindre la
sphère basique des activités à partir de laquelle il devient facile d’étudier la maison en tant
qu’entité culturelle (voir figure 3).
16 Amos Rapoport (1995) constate que le terme house est assez ambigu et flou en tant que paradigme de recherche.
17 Beaucoup de ces aspects ressortent également dans les travaux de Sommerville (1997), Mallet (2004), Blunt et Dowling (2006) ou encore de Hauge (2007). Paadam (2003) postule que le mot home ne devrait pas être perçu comme une construction physique statique, car il implique toujours une dimension sociale, même si ses occupants n’ont aucune connaissance de cette signification.
32
Figure 3 : Processus de démantèlement du concept de culture selon Amos Rapoport
(1990 ; 1976)
Ses œuvres postérieures (2000 ; 1995 ; 1990 ; 1989) s’attèlent à comprendre la
manière dont la culture génère la forme bâtie et la façon dont le sens de la maison est
transmis sous forme de communication non verbale. Quoiqu’architecte de formation, Amos
Rapoport s’oriente ainsi vers l’anthropologie symbolique et vers les théories de
l’herméneutique pour analyser la maison en tant qu’indicatrice du statut social des
individus au sein de leurs communautés d’appartenance. Malgré son regard vers
l’anthropologie symbolique, cet auteur insiste toujours sur le fait qu’il ne cherche pas à
prouver l’action exclusive des forces socio-culturelles dans la création de la maison, mais
plutôt sa primauté. Autrement dit, il milite en faveur de l’idée qu’il y a toujours plusieurs
forces combinées qui opèrent : certaines sont des facteurs primaires (culture) et d’autres des
facteurs modifiants (climat). Il conclut finalement que :
Culture
Vision du monde
Valeurs
Stylesdevie
Activités
33
L’homme construit peut-être pour dominer son environnement, mais c’est autant l’environnement interne, social et religieux que l’environnement physique qu’il domine. Il fait ce qu’il veut dans la mesure où le climat le permet ; il utilise outils, technique et matériaux pour s’approcher le plus possible de son modèle idéal. La prédominance relative des divers facteurs modifiants dépend autant du comportement du peuple envers la nature que de la puissance des facteurs ; le degré d’utilisation des ressources et des techniques est autant fonction des fins poursuivies et des valeurs que de leur disponibilité (Rapoport, 1972 :83).
En s’inspirant des travaux d’Amos Rapoport, Susan Kent (2000 ; 1991 ; 1990 ;
1987) postule que les individus ne sont plus des simples marionnettes de leur
environnement physique. Ils disposent au contraire des ressources culturelles et
symboliques qui leur permettent de manipuler la maison pour répondre à leurs besoins
sociaux (Kent, 1990). Sans rejeter l’importance des éléments physiques, Susan Kent
considère la structure physique de la maison comme un simple instrument de médiation des
relations entre l’homme et son environnement. Aussitôt cette médiation faite, l’auteure
estime que « tout le reste est culturel » (Kent, 2000 : 267). La maison chez Kent n'existe
donc pas indépendamment de la volonté humaine ; elle est un produit de l’esprit humain.
Elle devient, comme le suggère Alison Blunt et Robyn Dowling (2006) un processus de
création et de compréhension des formes d'habitation et d'appartenance. Susan Kent (1990)
note enfin que la maison varie en importance selon les caractéristiques
sociodémographiques, les modes de vie, la situation socio-économique et les diverses
autres activités relevant d’autres domaines, une conclusion qui rappelle une fois encore les
travaux d’Amos Rapoport.
Plus que Kent, celui qui est connu comme le pionnier des recherches en sémiotique
et en anthropologie symbolique est l’universitaire Umberto Eco. Toujours se situant dans la
lignée de Rapoport, cet auteur développe une théorie complète de la sémiotique appliquée
aux phénomènes architecturaux. Dans son livre, A Theory of Semiotics (1976), Umberto
Eco définit l’architecture comme un système d'objets produits et d’espaces circonscrits qui
communiquent une pluralité des fonctions sur la base des systèmes de conventions (codes).
Cet aspect communicatif prédomine, selon Eco, sur l'aspect fonctionnel et utilitariste de
34
l’architecture, et le précède. De ce point de vue, il conclut que les fonctions signifiées de la
maison ne sont pas nécessairement des référents. Elles ne sont pas forcément des fonctions
qui peuvent être effectuées, ou qui ont été effectuées. Eco postule qu’il existe dans certaines
sociétés des unités d’habitation qui n’ont jamais été utilisées, mais leur rôle dans la
communication du statut social du propriétaire est important. Dans cette avenue, les
fonctions signifiées de la maison sont avant tout des unités culturelles, avant d'être des actes
concrets. Autrement dit, la maison est fondamentalement un signifiant, dans le sens
saussurien du terme, qui dénote un sens (un signifié) (Eco, 1976)18.
La sémiotique architecturale développée à la suite des travaux d’Amos Rapoport est
une approche importante car, elle souligne la nécessité de prendre en compte les facteurs
culturels et symboliques dans l’étude de la maison. Des auteurs comme Julia Robinson
(2006), Susan Kent (2000), Cooper Marcus (1995), Martin Locock (1994) ou encore
Roderick Lawrence (1987) considèrent les matériaux et les techniques comme des simples
facteurs modifiants plutôt qu’essentiels. Autrement dit, que les matériaux changent
n’entraine pas nécessairement un changement dans les pratiques de l’habiter, car « ce qui
est symbolique est plus important que ce qui est utilitaire » (Rapoport, 1972 : 35). Un tel
système de pensée va donner lieu à la prolifération des études sur la symbolique de la
maison, dont la principale caractéristique est l’accent mis sur la maison en tant qu’image
auto-représentationnelle et projective des identités sociales.
II. Approches symboliques ou l’architecture en tant qu’image auto-représentationnelle et projective
Les approches symboliques interprètent l'environnement bâti comme un système des
symboles, et comme une expression culturellement partagée des structures et des processus
mentaux. Elles s’interrogent sur la signification des formes construites et la façon dont elles
signifient et expriment un sens. En mettant le focus sur l'environnement bâti, de nombreux
théoriciens de l’approche symbolique considèrent la maison comme un moyen tangible
pour la description et l’explication des caractéristiques souvent intangibles du processus 18 Malgré la mise en avant de l’aspect sémantique et communicatif des éléments architecturaux, Eco fait valoir que ceux-ci ont des fonctions non linguistiques, et ne peuvent par conséquent pas être analogues aux signes linguistiques. Selon Eco, les éléments architecturaux sont plus complexes et difficiles à interpréter (Eco, 1976).
35
d’expression culturelle19. En tant qu’expression de la culture, la maison joue un rôle de
communication et de véhicule de sens entre les groupes, et entre les individus au sein d’un
même groupe, et ceci à différents niveaux. Les explications symboliques reposent souvent
sur la démonstration de la façon dont l'environnement bâti correspond à des conceptions
idéales de la vie sociale, politique et religieuse d’un peuple donné. Dans ce sens, les
attributs physiques de la maison se bornent à l’imitation et à la représentation des divers
aspects, conscients et inconscients, de la vie sociale (Lawrence et Low, 1990).
Dans l'ensemble, les approches symboliques intègrent dans leurs analyses la sphère
domestique et non domestique de la maison, et quelquefois aussi, les sites de constructions
et l’ordonnancement des villages. Elles se déclinent en plusieurs formes, entre autres : 1. les
analyses socio-symboliques qui mettent l'accent sur la façon dont les formes bâties
communiquent le statut social ou politique des occupants; 2. les approches métaphoriques
qui s’intéressent aux fonctions anthropomorphiques et mnémoniques de la maison ; 3. les
approches structuralistes qui sont fortement influencées par la théorie linguistique de
Saussure.
1. « Tu es ce que tu construis20 » : espace architectural en tant qu’instrument de pouvoir
Une abondante littérature a porté sur la maison en tant qu’expression directe des
structures sociales ou politiques. Les formes bâties et leur position topographique agissent
comme des dispositifs de communication exprimant, à travers des codes symboliques, les
relations entre groupes, ou les positions détenues par les individus au sein d'une culture
donnée.
L’un des illustres travaux dans ce sens est le postulat de Hilda Kuper (1972) selon
lequel la disposition des maisons sur un site et l'organisation de leurs significations peuvent
19Par voie de conséquence, cette approche suppose que les processus d’expression culturelle sont le principal facteur déterminant des formes.
20 Je reprends ici le titre d’un article écrit par Dominique Malaquais (1994) intitulé: You are what you build: architecture as identity in the Highlands of West Cameroon et dans lequel l’auteure explore les rapports entre architecture et pouvoir.
36
correspondre à la structure politique et sociale d’un peuple. En tant que symboles, les sites
revêtent des significations et des valeurs puissantes. Ils possèdent des éléments-clés qui,
comme dans un système de communication, sont utilisés pour exprimer les relations
sociales. Dans une étude menée sur les maisons swazi, Hilda Kuper (1972) révèle que les
sites sont très souvent manipulés par les acteurs politiques pour une variété de fins, et dans
différentes situations. Le même postulat est avancé par David Gilmore (1987) qui suggère
que les rapports de classe constituent une carte mentale que les populations projettent dans
l'organisation spatiale de la maison.
Le registre des études portant sur la maison en tant qu’expression du pouvoir intègre
aussi l’ouvrage de Michel Foucault (1975) sur la naissance de la prison. Ce lieu
d’habitation mis en place par l’État contribue à la gouvernementalité des corps, et permet à
la société de contrôler, de mesurer, de dresser les individus pour les rendre, à la fois, dociles
et utiles (Foucault, 1975 : 198). Foucault utilise le plan du panopticon de Jeremy Bentham
pour décrire ce mécanisme architectural de dressage corporel. Il s’agit d’un dispositif
composé d’un bâtiment circulaire en périphérie, et d’une tour centrale dont les fenêtres
donnent sur la façade intérieure du bâtiment. Chaque cellule située dans le bâtiment
périphérique possède deux ouvertures : l’une donnant sur les fenêtres de la tour, et l’autre
donnant sur l’extérieur. Le surveillant placé dans la tour centrale pouvait ainsi voir tous les
prisonniers sans être vu par ces derniers. Ce dispositif oblige dès lors les détenus à se
comporter comme s'ils étaient sous surveillance permanente. Michel Foucault (1984) parle
alors de la « pédagogie de l’espace » dans la mesure où celui-ci est utilisé comme un
instrument de savoir et de pouvoir.
Dans sa synthèse sur le rapport entre espace, pouvoir et savoir, Michel Foucault
donne d'autres exemples de ce qu'il appelle une « organisation structurelle » et
architecturale de l'espace à des fins disciplinaires. Il faut tout de même remarquer que
Foucault était plus intéressé par l'espace que par les formes architecturales en tant que
telles. Pour lui, l'architecture existe pour assurer une certaine répartition de la population
dans l'espace, une canalisation de leur circulation (Foucault, 1984). En d'autres termes,
l'architecture est analysée comme une technologie politique qui lie les questions de
gouvernement, c'est-à-dire les questions de contrôle et du pouvoir sur les individus, par le
37
biais de la canalisation spatiale de leur vie quotidienne. Michel Foucault illustre ainsi
comment l'architecture en tant qu’institution contribue avec succès au maintien du pouvoir
d'un groupe sur un autre, et fonctionne comme un mécanisme de codage de leurs rapports
réciproques à un niveau qui inclut le déplacement du corps dans l'espace, ainsi que sa
surveillance.
Les travaux de Michel Foucault (1984, 1977) sur le rôle de l'environnement bâti
dans le dressage corporel des individus sont utiles à la fois pour une analyse symbolique et
pour la théorie de l’action sociale de l’objet et de la maison. Toutefois, l'application directe
des concepts foucaldiens de l'espace architectural en tant que « corps discipliné » demeure
discutable. L’espace architectural peut structurer les actions humaines, mais il ne dicte pas
ces actions et ne contraint pas nécessairement les choix individuels. En outre, contrairement
aux prisons, aux hôpitaux, et aux centres d’asile qui sont les champs d’observation de
Michel Foucault (1977), les maisons d’habitation sont des espaces ouverts à l'utilisation et à
la réinterprétation. Elles peuvent prendre des aspects directs de la production sociale, mais
ne limitent pas l’action, comme on le voit dans les espaces institutionnalisés étudiés par
Foucault.
Une série d'études historiques publiées en 1979 dans Radical History Review élargit
l'analyse du rapport entre architecture et pouvoir en examinant comment la disposition
spatiale de la maison contribue à la puissance de certains groupes au détriment d'autres, et
«comment l'espace lui-même fonctionne comme un objet de luttes sociales » (Amsden,
1979). Les contributeurs de ce numéro spécial, théoriquement influencés par la géographie
marxiste, se concentrent sur la façon dont les aménagements architecturaux particuliers
s’accommodent aux relations sociales qu’entretiennent les individus à l’intérieur de la
maison, mais aussi au sein de leurs communautés d’appartenance.
Un autre domaine clé a porté sur la relation entre l'identité (individuelle ou sociale)
et la maison. L'individualisme signifie qu'une personne donne souvent la priorité à ses
propres objectifs par rapport aux objectifs du groupe, et définit son identité en termes de
qualités personnelles plutôt que d’identification au groupe (Duncan, 1985). En revanche,
l'identité sociale peut être plus importante dans les cultures où le collectivisme et
l'interdépendance sont plus importants. Ces différentes formes d’identité trouvent leur
38
expression dans l’architecture. La thèse la plus développée dans ce domaine vient de la
plume de James Duncan (1989 ; 1985), qui soutient, à partir des études réalisées aux États-
Unis et en Inde, que les différentes formes de la maison expriment des stratégies
institutionnalisées pour la présentation de soi en tant que membre d'un groupe social
particulier (1981 ; 1973)21. Duncan stipule que le logement reflète les structures sociales et
les relations de classe, que ce soit dans les sociétés collectivistes ou dans celles dites
individualistes.
Dans les cultures collectivistes, les maisons ont tendance à refléter l'identité de tout
un groupe (identité sociale) plus que celle des individus (identité individuelle) (Duncan,
1981). La maison dans les cultures collectivistes est perçue comme un symbole des valeurs
du groupe et comme l’expression de l'interdépendance (Rapoport, 1985). Par contre, dans
les cultures individualistes, où l'identité personnelle est plus importante que l'identité
sociale, la maison devient davantage le reflet de la réussite individuelle plutôt que celui des
valeurs du groupe22. En même temps que les pays en développement se modernisent et
deviennent plus occidentalisés, les relations sociales collectivistes et les valeurs qui sont
représentées dans les styles de maisons passent à des formes beaucoup plus individualistes
(Duncan, 1981). Duncan fait en outre valoir que les images collectivistes sont associées à
des groupes sociaux fermés et à la ségrégation sexuelle du travail. En tant que telles, les
maisons collectivistes sont considérées comme des conteneurs des femmes. Par contre, les
maisons individualistes se caractérisent par une grande mobilité, et par une ségrégation
sexuelle moins poussée. Dans les deux cas, James Duncan considère les maisons comme
des symboles de statut sexué (1981).
21D’autres auteurs, travaillant principalement dans les sociétés urbaines contemporaines, constatent que les différences de classe sont exprimées et communiquées à travers la manipulation de l’environnement construit, que ce soit au niveau du décor intérieur de la maison que de celui des paysages bâtis en général (voir par exemple Jopling, 1988 ; Anderson, 1973 ; Duncan, 1973).
22 D’après Duncan, l'extérieur d'une maison reflète davantage l'identité sociale dans une large mesure, et l'identité personnelle dans une moindre mesure (Duncan, 1981). En revanche l’intérieur de la maison exprime davantage l’identité individuelle et moins l’identité de groupe. Ainsi, lorsqu’une personne ne s'arrime pas à l'identité sociale, elle se concentre probablement sur la façon dont l'intérieur de sa maison reflète son identité personnelle. Les détails de la vie d'un individu, sa personnalité et ses intérêts s’expriment davantage dans l’intérieur de sa maison et dans la disposition des objets domestiques (Duncan, 1981).
39
Bonnie Loyd (1981) et Géraldine Pratt (1981) trouvent des preuves abondantes dans
les sociétés de classe et de caste à l'appui de ces hypothèses. Cependant, tout en admettant
l’importance des études de James Duncan, la catégorisation qu’il fait entre les sociétés
collectivistes et les sociétés individualistes m’apparaît critiquable. Mes enquêtes de terrain
montrent qu’il est difficile de parvenir à une telle catégorisation simplement en se basant
sur des changements qui interviennent dans l’architecture. Les changements architecturaux
sont toujours le résultat de l’interaction entre identité individualiste et identité collectiviste
d’une société donnée. Ces deux identités (sociale et individuelle) étant en interaction, créent
pour l’environnement bâti, une signification beaucoup plus complexe qu’elle ne paraît sous
la plume de Duncan.
Du côté des africanistes, l’étude la plus pertinente du rapport entre architecture et
pouvoir est celle de Dominique Malaquais (2002). L’auteure montre que, chez les Bamiléké
du Cameroun, le « site d’habitation était en soi une affirmation d’identité, une proclamation
d’autorité et une matérialisation spatiale de la structure sociopolitique » (Malaquais,
2002 :43). Ce dit site avait une telle valeur qu’il régissait l’emplacement d’une maison et
obéissait à la représentation qu’avaient les populations de l’espace. En effet, les Bamiléké
ont développé un riche bagage de métaphores où le haut et le bas figurent comme des
entités chargées de symboles. Ils associent à la hauteur l’idée de l’impureté, de la pollution
et de la pourriture, et à la bassesse l’idée de la pureté, de la jeunesse et de la croissance
(Malaquais, 2002 : 44). Les hautes altitudes sont les lieux où les divinités maléfiques
déploient leurs activités, alors que les basses altitudes sont des lieux de vie et de guérison,
où les divinités bénéfiques trouvent leurs demeures (Malaquais, 2002 : 45).
Cette distinction qu’établissent les Bamiléké entre le haut et le bas a laissé une
empreinte indélébile sur le paysage architectural, car elle régit l’emplacement
topographique des maisons. Comme l’écrit Malaquais, « le statut social de ceux qui se
situent aux échelons supérieurs de la hiérarchie sociale se manifeste topographiquement
dans le fait qu’ils occupent les lieux les plus bas » (Malaquais, 2002 : 48). Ainsi,
l’habitation du chef était toujours située en bas pour exprimer son pouvoir et son autorité
sur l’ensemble de la communauté. Tout comme les palais royaux, les maisons des notables,
plus modestes que celles des chefs, étaient également situées en bas pour montrer ce qu’ils
40
ont et pour créer leur réputation. En revanche, les concessions des petites gens étaient
construites en haut pour matérialiser leur pauvreté et leur docilité (Malaquais, 2002 : 212).
Une autre application des concepts du haut et du bas est fournie par Antoinette
Hallaire (1975) dans son analyse des habitations montagnardes des monts Mandara du
Cameroun. Contrairement aux Bamiléké, les ethnies des monts Mandara tendent à valoriser
les lieux élevés par rapport aux basses altitudes. Si cette attirance pour les hauteurs
s’explique par l’ancien état d’insécurité qui a prévalu dans la région, Antoinette Hallaire
explique la primauté qui leur est accordée à leurs valeurs symboliques (1975 : 22). Dans
l’imagerie montagnarde en effet, les divinités bénéfiques présidant aux destinées des
communautés habitant les sommets, alors que les divinités maléfiques ont leurs demeures
sur les piémonts, les plaines et dans les fonds des vallées. La hauteur est le symbole
d’autorité et du pouvoir, alors que la bassesse est celui de la docilité, de la servilité et de la
soumission. Exercer un pouvoir et détenir une autorité est, par conséquent, étroitement lié
au fait d'occuper sur le terrain une position dominante (Hallaire, 1975 : 23). Dans ce sens,
les habitations des chefs traditionnels sont toujours situées sur des hautes altitudes pendant
que les simples cultivateurs établissent leurs demeures sur les plateaux et les piémonts. Les
chefs de quartiers résident, quant à eux, au point habitable le plus haut de leurs territoires
respectifs. Même les hiérarchies claniques et lignagères s’établissent sur le terrain en
fonction de l’altitude. Les quartiers les plus élevés, observe Antoinette Hallaire,
appartiennent aux clans prééminents23, et les bas-quartiers appartiennent aux clans
inférieurs (1975 : 24).
En somme, l’approche de l’architecture en tant qu’instrument de pouvoir identifie
les expressions immédiates et directes des structures sociales et politiques à travers la
maison. Elles se concentrent sur la façon dont les significations associées à des formes
construites sont manipulées dans la transmission des valeurs et des identités. Il ressort que
les formes bâties sont une matérialisation des structures sociopolitiques au sens large, une
23 En général, les clans prééminents sont ceux des descendants des premiers arrivés dans les massifs.
41
idée qui posera les jalons des théories plus élaborées du symbolisme et de l’approche
métaphorique de l’architecture24.
2. Approche de la métaphore : l’architecture en tant que « portraiture symbolique25 »
Les théories de la métaphore ont été utilisées par un certain nombre de chercheurs
pour étudier l'architecture comme un système de significations symboliquement codées.
Les métaphores permettent de passer de l'abstrait et du rudimentaire au concret et au
facilement saisissable. C'est à travers des métaphores que les humains se représentent le
monde et créent de l'ordre dans le cosmos.
Les théories de la métaphore appliquées à la maison sont les mieux représentées par
les travaux de James Fernandez (1988 ; 1986, 1978), qui affirme la primauté de la
métaphore comme une expression culturelle. En tant que telle, la métaphore permet de
décoder et de comprendre le sens exprimé par l'environnement bâti. Le célèbre ouvrage de
James Fernandez sur les Fang (1977) est une illustration parfaite de la puissance
métaphorique de l’architecture. Cette monographie commence par une vision globale des
Fang et de la manière dont leur architecture est représentée dans l'espace. Ensuite,
Fernandez tente de relier la cosmologie, le mythe, la structure sociale, et l'architecture du
village à travers un système de significations culturelles. À partir de là, il développe sa
notion d'« espace de qualité » composé d'axes de continuum entre les oppositions bipolaires
de sens, et démontre finalement comment la métaphore est, à la fois, interprétative et
stratégique (Fernandez, 1986)26.
24 Les études sur la symbolique de la maison, dont la plupart se base sur des travaux de terrain, fourniront plus tard une base de données importante pour repenser les théories du symbolisme et pour le développement de la théorie sociale de l’objet et de la maison.
25 Par « portrait emblématique », Drewal entend une métaphore « qui parvient à évoquer une image de la personne au moyen de groupes de symboles qui, souvent, n’ont rien d’anthropomorphiques » (Drewal, 1990 : 41).
26 Dans un essai plus récent, Fernandez identifie une façon métaphorique de parler du « lieu » comme étant un ensemble d'attitudes et de pratiques développées autour d’un site et de ses habitants. Autrement dit, la façon poétique de parler d'un lieu est transformée en une partie de ce lieu.
42
Les théories de la métaphore ont également été utilisées par un certain nombre de
chercheurs pour explorer l'architecture en tant que système des symboles (Bachelard, 2004
[1957] ; Blier, 1987 ; Moore, 1981). Le meilleur exposé dans ce sens vient de Suzanne
Blier (1987) qui retrace le symbolisme métaphorique des maisons et des structures des
villages batammaliba à partir de leurs significations cosmologiques et sociales, mais
également à partir de leurs significations corporelles. L'environnement bâti pour les
Batammaliba représente toutes les facettes de la vie personnelle, sociale et culturelle, et
possède sa propre trajectoire de vie elle-même. La métaphore fournit ainsi un moyen pour
commander l'expérience, et l'architecture est une métaphore au sens large du terme (Blier,
1987). Un exemple similaire de la puissance métaphorique de l'architecture vient de la
plume d’Alexander Moore (1981) qui lie la forme architecturale des Cuna à la structure
sociale de leur société. Pour les Cuna, l'architecture traditionnelle exprime dans le langage
métaphorique, la réplique symbolique de toutes leurs structures politique et sociale.
Un autre groupe de chercheurs s'appuient sur des éléments d'analyse métaphorique
pour relier le cosmos avec la maison (Bastien, 1985 ; Basso, 1984 ; Eliade, 1983 ; Rykwert,
1976). À travers ses analyses de l’architecture dogon, Marcel Griaule (1954) décrit
comment l’organisation territoriale représente la forme d’une graine, qui est un symbole
central dans la mythologie dogon. D’autre part, il montre que la structure du village est
anthropomorphique, et s’étend du nord au sud comme un corps d’homme sur le dos. Cette
structuration des villages dogon découle de leur conception de l’univers, de la ville et de
l’homme, qu’ils considèrent comme identiques. On retrouve le même ordonnancement dans
les villes sao étudiées par Masudi Alabi Fassassi (1997). Ici la ville est considérée comme
le rabattement du monde sur le plan terrestre avec l’homme pour pôle central. En
conséquence, « la ville est un monde dans un monde ». Dans le même ordre
d’extrapolation, « l’homme est un monde dans la ville ayant pour centre son organe
géniteur » (Fassassi, 1997 : 33).
43
Figure 4 : Structure anthropomorphique d’un village dogon (source: Griaule, 1965 [1948]: 95)
De son côté, Joseph Rykwert met en évidence le principe de la représentation
symbolique du monde en étudiant la maison comme une reproduction parfaite de l’univers.
Les indigènes australiens qu’il étudie pour fonder sa théorie, considèrent la maison comme
une métaphore de la voie lactée ; lieu du séjour éternel des ancêtres (Rykwert, 1976).
L’exemple donné par Mircea Eliade (1983) sur la maison des Sioux est également
significatif. L’auteur rapporte que les Sioux voient la maison comme un modèle réduit de
l’univers. Son toit symbolise la coupole céleste, le plancher représente la terre, les quatre
parois indiquent les quatre directions de l’espace cosmique. La construction de la maison
est elle-même déterminée par un triple symbolisme: les quatre portes, les quatre fenêtres et
les quatre couleurs, signifiant les quatre points cardinaux. Construire une maison tient donc
compte de la représentation que se font les Sioux du cosmos ; la maison devenant une
image simplifiée du monde (Eliade, 1983 : 66).
44
Si la maison est un modèle réduit de l’univers, le corps humain est lui-même un
modèle réduit de la maison selon le même principe de correspondance entre macrocosme et
microcosme. En s’appuyant sur l’exemple de la maison traditionnelle mongole, Mircea
Eliade rend compte des significations métaphoriques que les populations attachent au toit
en tant qu’accès vers l’au-delà. Les urnes funéraires mongoles sont en effet pourvues d’un
trou dans le toit pour permettre à l’âme du défunt de s’échapper et de rejoindre l’au-delà
(Eliade, 1983 : 72-73). De la même manière, le corps humain possède au sommet de son
crâne un lieu par lequel il entre en contact avec le divin. D'autres auteurs utilisent la
métaphore du corps pour montrer la correspondance interculturelle entre l'architecture
religieuse et les diverses parties du corps humain (Hugh-Jones, 1995 ; 1993 Johnson, 1988 ;
Bourdieu, 1970). Le focus est mis sur l'alignement du corps dans l'espace comme ayant une
importance religieuse et cosmologique. Toutes ces études permettent d'examiner la nature
idéologique de l'architecture à la fois comme une métaphore cosmologique et corporelle.
L'utilisation de la métaphore dans l'analyse symbolique de la maison est l'une des
approches architecturales les plus complètes et les plus réussies27. Sa principale force est
d’allier l’imagination de l’autochtone qui pense et qui crée la métaphore et celle du
chercheur qui l’analyse (Lawrence et Low, 1990 : 473). Cependant, certains adeptes de la
métaphore vont progressivement éloigner la maison de sa dimension matérielle pour
l’étudier essentiellement en tant que signe (Bachelard, 2004 [1957], Barthes, 1993; Geertz,
1983 ; Baudrillard, 1981 [1968]). Pour Clifford Geertz (1983) par exemple, les individus ne
sont plus esclaves de leur environnement bâti, mais plutôt des significations culturelles
qu’ils ont eux-mêmes créées. Il souligne que l’habitat humain ne peut être compris et lu
qu’à l’intérieur du paradigme culturel dans lequel l’homme agit et existe. Dans ce contexte,
la passivité du sujet par rapport à la nature, mise en cause par Amos Rapoport (1973),
donne place à une autre passivité, issue cette fois-ci d’un rapport de soumission au web
culturel. L’anthropologie symbolique de Clifford Geertz renoue dès lors avec la séparation
entre la nature et la culture qui avait cours jusqu’aux travaux révolutionnaires d’Amos
27 Bien que ces études ne traitent pas explicitement de l'environnement bâti, les auteurs explorent le corps comme isomorphe avec la maison. La maison fournit la métaphore en tant que dispositif expressif et évocateur, capable de transmettre la mémoire, la moralité et l'émotion (Basso, 1984). La métaphore de la maison est utilisée pour comprendre le monde et l’être humain, et inversement, le monde et le corps humain sont utilisés pour comprendre la maison (Bastien, 1985).
45
Rapoport. Cela conduit à la marginalisation voire à l’absence de la dimension matérielle de
la maison, dans la mesure où celle-ci n’existe finalement qu’en tant que symbole
(Bachelard, 2004). Les approches structuralistes représenteront le premier pas vers la
conciliation du matériel et de l’immatériel.
3. Approches structuralistes ou la maison comme objectivation des relations sociales
Lorsque Claude Lévi-Strauss (2004 [1979] ; 2002 [1967]; 1991 ; 1984) introduit la
notion de « maison » dans les études de la parenté, il s’agissait avant tout de répondre à un
problème posé par la théorie des groupes de filiation. La notion était destinée à appréhender
les groupes sociaux qui, tout en se présentant morphologiquement comme des clans ou des
lignages, échappaient à la grille classificatoire traditionnelle ; leur mode de recrutement
n’étant ni unilinéaire, ni bilinéaire, ni strictement indifférencié, ni même contraint à la seule
filiation, voire à la parenté généalogique en tant que telle (voir Hamberger, 2010 : 7).
Reprenant les idées de Franz Boas28, Claude Lévi-Strauss (1982) développe alors l'idée que
les sociétés qui tracent leur descendance à travers les deux lignes maternelle et paternelle
sont organisées autour de la maison. Dans ces systèmes indifférenciés, les individus
peuvent être membres de plusieurs groupes sociaux et basés sur la parenté en même temps.
Ainsi, plutôt que de définir la maison par un quelconque substrat matériel ou
immatériel, Lévi-Strauss postule qu’il faudrait la considérer comme l’hypostase d’une
relation entre les clans antagonistes, dont elle réconcilie les oppositions sous l’apparence de
l’unité retrouvée (Moisa, 2010). La maison se constitue ainsi « à l’intersection des
perspectives antithétiques » (McKinnon, 1995 : 170-188 ; Lévi-Strauss, 1979 : 190). Cette
nouvelle réalité révèle le pouvoir de la maison, sa capacité active de conciliation des
conflits au sein du couple, en devenant « une arme utilisée contre le désordre » (Lévi-
28Claude Lévi-Strauss fonde sa théorie de la parenté sur les travaux de Boas chez les Kwakiutl. Franz Boas a été intrigué par l'organisation complexe de la parenté de cette société, qui avait affiché des éléments matrilinéaires et patrilinéaires simultanément. Il a écrit plusieurs articles en essayant de démêler les complexités du système, parfois pour défendre la primauté des principes patrilinéaires, parfois pour défendre le contraire. Enfin, il a choisi d'utiliser le terme local, au lieu de clan, tribu, ou tout autre concept anthropologique que lui ou d'autres avaient précédemment utilisé pour se référer à l’unité sociale de base chez les Kwakiutl (Lévi-Strauss, 2004 [1979]). Lévi-Strauss constate finalement que la maison en tant qu’entité juridique, agit au-delà des limites des classifications de la famille (Lévi-Strauss, 1987 : 2) en conciliant les dichotomies induites par les deux lignées matrilinéaire et patrilinéaire (Lévi-Strauss, 2004 [1979]: 173-174).
46
Strauss, 1983). Non seulement la maison reprend et dissimule le langage de la parenté, elle
résout surtout plusieurs problèmes causés par des intérêts antagonistes entre les deux
lignées paternelle et maternelle (Lévi-Strauss, 1983).
Par ailleurs, Claude Lévi-Strauss avance que les populations s’organisent, non pas
seulement autour de la maison en tant que propriété physique qui les contient, mais
davantage autour des titres, des propriétés et de l’héritage. Lévi-Strauss définit la maison
dans ce contexte comme :
une personne morale titulaire d'un patrimoine constitué, à la fois, de la richesse matérielle et non matérielle, qui se perpétue grâce à la transmission de son nom, de ses biens et de ses titres sur une ligne réelle et imaginaire, considérée comme légitime aussi longtemps que cette continuité puisse s'exprimer dans la langue de la parenté ou d'affinité et, le plus souvent, les deux à la fois (1982: 174).
Ces biens matériels et immatériels sont transmis d’une génération à l’autre à travers
la ligne de sang ou à travers une filiation fictive ; les règles strictes de la relation étant
moins importantes dans les « sociétés à maison » que la continuité de la maison elle-même
et de ses biens. De cette façon, les « sociétés à maison » peuvent retracer leur ascendance à
des personnes spécifiques, mythiques ou réelles, qui ont fondé la maison d'origine dans un
endroit spécifique. Les maisons ont peut-être changé d'emplacement, mais les membres
conservent la mémoire partagée de cette origine (Lévi-Strauss, 2004 [1979]: 164-165).
Cette approche lévi-straussienne est centrale pour la compréhension de la
dynamique de la maison. Elle permet de voir les changements qui interviennent dans les
formes de la maison dans l’espace, mais surtout dans le temps, d’une génération à l’autre,
d’une période à une autre (Bretell, 1999). Destinée à durer, à être partagée et à être utilisée
par plusieurs générations, la maison vernaculaire est essentiellement un lieu
d’investissement considérable dans la reproduction biologique, économique et culturelle de
la famille (Moisa, 2010). Les faits matériels et immatériels, la durabilité, la permanence et
la localisation de la maison conditionnent les stratégies familiales et inversement. Cette
réciprocité entre longévité de la maison et continuité de la famille amène Donna Birdwell-
47
Pheasant et Denise Lawrence-Zuniga à postuler qu’« investir matériellement et
émotionnellement dans la maison signifie investir dans la famille et dans sa continuité
(Birdwell-Pheasant et Lawrence-Zuniga, 1999 : 12-15). Grâce à son concept de société à
maison29, Lévi-Strauss explore en outre le rapport entre les caractéristiques physiques de la
maison et le rôle que celle-ci véhicule en tant que symbole. Ses travaux représenteront le
premier pas vers une conciliation du matériel et de l’immatériel dans l’anthropologie
symbolique de la maison30. Selon Lévi-Strauss, malgré la mise en avant de la fonction
symbolique de la maison, l’aspect matériel reste crucial sans laquelle la fonction sociale ne
peut être étudiée (Lévi-Strauss, 1983). Le concept de société à maison permet donc de
mettre en exergue la capacité de la maison à objectiver les relations de parenté et à
matérialiser la dynamique des relations sociales qui se produisent lors et après le mariage.
Bien que Lévi-Strauss ne dise pas clairement que les sociétés à maison sont des
sociétés hiérarchisées, tous les exemples qu'il utilise, et la définition même de la société à
maison qu’il offre font référence à une organisation sociale hiérarchique (Gillespie, 2000 :
8 et 49). La complexité des stratégies par le biais de la maison pour accumuler la richesse,
le statut, le pouvoir ou la propriété que souligne Lévi-Strauss, ne peut entrer que dans un
ordre hiérarchique ou dans un système égalitaire déjà subvertie (Lévi-Strauss, 1987 : 152).
Dans cette avenue, la maison apparaît comme un véhicule pour la naturalisation des
différences de rang (Gillespie, 2000 ; Waterson, 1995; Hugh-Jones, 1995; McKinnon,
1995 ; Gilmore, 1987 ; 1977). À partir des années 1980, le concept de société à maison sera
d’ailleurs récupéré par d’autres auteurs structuralistes pour expliquer le rapport entre la
maison et la hiérarchie. Dans une recherche conduite en Asie du Sud-Est, Charles
29Lévi-Strauss (1979) élabore ce concept de « société à maison » dans son ouvrage intitulé La voie des masques, Paris, Pocket, ouvrage qui sera réédité en 2004.
30 On remarque cependant que la notion de « maison » dans l’approche Lévi-straussienne ne figure qu’au sens métaphorique. Lévi-Strauss ne l’a jamais considérée comme une véritable structure spatiale (Hamberger, 2010) ; chose qui lui a valu de nombreux critiques. Cette absence de l’architecture dans le modèle Lévi-straussien sera le point de départ de son renouvellement par un groupe de chercheurs réunis autour de Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones (1995), dont le programme consistait en un sens à remettre sur pied la notion de maison. Leurs recherches posent les fondements d’une nouvelle série d’études qui dépasse la vision de Lévi-Strauss et qui considèrent la maison, non seulement, comme résultat d’une fusion des principes opposés, mais comme lieu de leur articulation (McKinnon, 1995 : 188).
48
Macdonald associe explicitement la maison en tant que personne morale à la hiérarchie :
« Plus la société est hiérarchique, plus le placement du roi est haut dans son palais, plus les
critères de Lévi-Strauss se vérifient; la maison fonctionnant en tant qu’unité résidentielle,
économique, rituelle et politique » (Macdonald, 1987 :7-8).
Si l’approche structuraliste représente l’approche théorique la plus cohérente
développée sur la symbolique de la maison (Lawrence et Law, 1990 :467), de nombreuses
critiques lui sont faites, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur du champ
anthropologique. Pierre Bourdieu objecte par exemple que les analyses des oppositions
contradictoires, tout en prétendant révéler une signification culturelle, peuvent conduire les
chercheurs à imposer leur propre ordre sur le matériel ethnographique (1980, 1977). Pierre
Bourdieu critique également la vision statique et synchronique de la culture par les
approches structuralistes, et le fait qu’elles ne tiennent pas compte du changement social
historique (1977)31. À la suite de Pierre Bourdieu, Ian Hodder (1982: 8) critique le
structuralisme, entre autres, pour l'absence d'une théorie de la pratique, pour le rôle limité
de l'individu, pour l'absence d'un modèle adéquat de changement, et pour le problème de la
vérification. En outre, les approches structuralistes, en débit du rapprochement entre le
matériel et l’immatériel, entre l’objet et le social, offrent une définition encore limitée de la
maison, vue comme un reflet passif et symbolique des relations sociales.
Cette définition de la maison comme un miroir sera d’ailleurs contestée par Ian
Hodder (1982), dans le cadre de son étude sur le rapport entre la culture matérielle et
l’ethnicité. Cet auteur remarque que l’objet joue des rôles actifs et pluriels au sein d’une
même société, et ceci, à des échelles différentes32. Dans le royaume lozi par exemple, les
populations établissent et maintiennent les frontières ethniques par l’usage symbolique de
la poterie. Dans le même temps, les mêmes pots sont manipulés pour justifier les tensions
familiales au sein des ménages lozi, grâce à des types particuliers de décoration figurant sur 31 Pierre Bourdieu s'inquiète du fait que les règles culturelles qui composent les structures symboliques n'apparaissent jamais dans la tête de l'indigène comme cela ressort dans l'analyse de l'ethnologue. Il se plaint du fait que le structuralisme masque cette contradiction en localisant les règles dans l'inconscient. Cet accent mis sur les pratiques cognitives de l'homme exclut, de l’avis de Bourdieu, l'action ou le praxis (2000, 1996, 1994, 1980).
32 Ian Hodder (1982: 212) fait valoir que les objets ne sont pas des moyens extra-somatiques qui permettent à l’homme de s’adapter, mais qu’ils sont véritablement constitutifs de l’homme.
49
les pots. Inspiré notamment par l'anthropologie sociale de Mary Douglas (1991), Ian
Hodder fait valoir que, plutôt que de refléter les cultures (comme un passif sous-produit de
la vie sociale), la variabilité dans les aspects symboliques de la poterie est activement et
réellement utilisée dans la vie sociale. Il conclut que la signification de l’objet dépend de la
façon dont il est utilisé dans le cadre des stratégies et des idéologies de groupes particuliers.
Un objet donné peut être utilisé pour « souligner ou pour refuser, pour maintenir ou pour
perturber les distinctions ethniques ou les réseaux de circulation de l'information » (Hodder,
1982: 85). La culture matérielle n'est donc pas un reflet inerte du comportement humain,
mais davantage une pratique sociale active et constitutive de l'ordre social.
Ian Hodder affirme enfin que les approches symboliques et structuralistes n’ont pas
suffisamment théorisé la culture matérielle. Il note qu’il y a eu très peu de considérations
sur la sociabilité des maisons, sur leur meaningfulness, et sur la façon dont elles
transforment les personnes par leurs imbrications multiples dans les régimes de valeur.
Comme le souligne Lynn Meskell avec perspicacité, « c’est seulement par l'accent mis sur
les significations sociales de l’objet que nous pouvons saisir les multiples façons dont la
maison prolonge l’être social » (Meskell, 2004:28). Ces considérations sur l’action sociale
de l'objet seront au centre de nouvelles études anthropologiques et historiques (Appadurai,
1986b) et au sein d’un groupe interdisciplinaire réuni sous la coupole de l’archéologie post-
processuelle (Tilley et al., 2006 ; Miller, 2005; Meskell, 2004 ; Buchli, 2002 ; Myers,
2001)33.
33L’archéologie dite post-processuelle (post-processual archaeology) est un paradigme de pensée en archéologie qui a vu le jour dans les années 1980 sous la houlette des chercheurs comme Christopher Tilley, Daniel Miller ou encore Ian Hodder. Ce paradigme vient en réaction à l’archéologie processuelle, plus connue sous le nom de la new archeology, laquelle proposait de voir l’archéologie comme une discipline véritablement scientifique, ce qui voudrait dire que les archéologues devraient conduire leurs recherches en utilisant la méthode scientifique. En revanche, les archéologues post-processuels pensent qu’il serait inapproprié de concevoir les travaux archéologiques comme véritablement scientifiques dans la mesure où, d’une part, les objets sur lesquels travaillent les chercheurs ne sont pas passifs mais actifs, et d’autre part, l’interprétation des symboles véhiculés par ces objets peut parfois être biaisée par l’expérience personnelle du chercheur lui-même.
50
III. Théories de la production sociale de l’objet
Les théories de la production sociale axent sur les forces sociales, politiques et
économiques qui produisent l'environnement bâti, et inversement, l'impact de
l'environnement bâti sur l'action sociale. L'accent est principalement mis sur les contextes
historiques et socioculturels dans lesquels la maison existe. Cette approche a joué un rôle
important dans l’ébranlement des frontières conceptuelles entre les différentes disciplines
portées vers l’étude de la maison34. Les œuvres les plus importantes proviennent de deux
principaux domaines que sont : 1. L’archéologie postprocessuelle qui met l’accent sur
l’objet en tant que produit et producteur de la vie sociale ; et 2. l’histoire sociale des formes
bâties qui intègre les différentes variables contextuelles dans l’étude de l’objet et de la
maison.
1. De l’objet produit à l’objet producteur : archéologie postprocessuelle et étude de la culture matérielle
L'un des développements les plus passionnants de l'anthropologie contemporaine est
le regain d'intérêt pour les études de la culture matérielle. De manière significative,
l’archéologie post-processuelle a joué un rôle clé dans le développement des théories
sociales de l’objet. Elle réintroduit les objets au cœur de l’analyse des phénomènes sociaux
et culturels, en tentant de dépasser la vision statique par laquelle les théories
fonctionnalistes et structuralistes les appréhendaient35.
Les études dans le domaine soutiennent que les sujets et les objets ne sont pas des
domaines séparés, mais sont co-constitutifs les uns des autres36. Comme l’affirme Tilley :
34 Les concepts dominants des théories sociales de l’objet incluent les notions de production et de reproduction sociale plutôt que celui de la culture. La culture est souvent mentionnée en termes de pluralité culturelle et/ou de la culture en tant que catégorie, ou en termes d'ethnicité comme catégorie socialement pertinent (Moisa, 2010).
35 À l’intérieur comme à l’extérieur du champ anthropologique, il y a une reconnaissance croissante du fait que les objets ne sont pas des reflets passifs de la société, mais plutôt des participants actifs dans les pratiques sociales (Myers, 2001 ; Hoskins, 1998; Appadurai, 1986b). L’anthropologie sociale et culturelle avait jusque-là montré la spécificité culturelle de l’objet comme essentiellement non-humaine, inerte et passive, par opposition aux humains qui sont vivants et ont l'agency. L’orientation théorique de l’archéologie postprocessuelle a donc été de remettre en question cette dichotomie.
36 Les objets ne sont pas seulement des simples miroirs reflétant passivement les états subjectifs ou inconscients des structures mentales. Au contraire, les personnes et les objets existent dans une relation dynamique et réciproque.
51
«les formes matérielles ne sont pas simplement le reflet préexistant des distinctions
sociales, des ensembles d'idées ou des systèmes symboliques. Elles sont plutôt le moyen
par lequel ces valeurs, ces idées et ces distinctions sociales sont constamment reproduites,
légitimées, ou transformées » (Tilley, 2006: 61). À travers la fabrication et l’utilisation,
l’échange et l’interaction avec les objets, les gens se font eux-mêmes. Parmi les promoteurs
de ce domaine d’étude, de nature interdisciplinaire, je cite entre autres Victor Buchli
(2006 ; 2002 ; Hoskins (2006; 1998) ; Christopher Tilley (2010, 2006, 2004,
2002) ; Daniel Miller (2011, 2010, 2008, 2005, 2001, 1987) et Ian Hodder (2012, 2006,
1992, 1982, 1978). La plupart d’entre eux ont enseigné à la Cambridge University et à
l'University College of London (UCL); deux institutions qui deviendront d’ailleurs les
principaux centres de production et de diffusion des études contemporaines de la culture
matérielle37.
Ce fut d’abord à Cambridge que le projet d’élaboration de la nouvelle réflexion sur
la culture matérielle a débuté, grâce aux travaux de Ian Hodder et de ses étudiants. Ces
derniers développent une nouvelle archéologie contextuelle (new contextual archeology) en
revisitant la notion de Bourdieu d’habitus (Hodder, 1986; 1982). Par la suite, le projet sera
poursuivi et porté à son optimum avec le départ de Daniel Miller de la Cambridge vers
l’UCL. Archéologue de formation, Daniel Miller s’oriente désormais vers l’anthropologie
et élabore en compagnie de ses étudiants un modèle d'étude de la culture matérielle, qu’ils
inscrivent à l’intérieur de l'anthropologie de la consommation (anthropology of
consomption), en utilisant la notion de structuration d’Antony Giddens (1984; 1981; 1970).
Grâce à ce concept, Daniel Miller présente un modèle de la dualité de la structure,
37 L'University College of London abrite d’ailleurs une revue interdisciplinaire de la culture matérielle, The Journal of Material culture, qui se concentre essentiellement sur le rôle des objets dans la construction des identités sociales et de la production de la culture. De nombreux ouvrages collectifs qui définissent les intérêts et les ordres du jour de l’archéologie post-processuelle ont également vu le jour dans cette université (voir par exemple Tilley et al., 2006 ; Buchli, 2002; Miller, 2001, 1998, 1995 ; Tilley, 1990). Par ailleurs, l’UCL abrite également depuis 2010 la revue Home Cultures, fondée par Victor Buchli et essentiellement dévolue à la compréhension critique de la sphère domestique dans ses rapports avec les multiples facettes identitaires. Dans ce contexte, Home Cultures s’intéresse à la relation entre le corps et la maison, à la culture de la consommation, à la culture matérielle, à la signification de la maison, à la fluidité et aux conséquences sociales des pratiques architecturales.
52
impliquant une relation mutuellement constitutive entre « agent » et « structure » (Giddens,
1984). Si l’archéologue Ian Hodder s’oriente davantage et l’anthropologue Daniel Miller
vers Anthony Giddens, tous deux ont favorisé l’émergence de l’archéologie
postprocessuelle dont le but assigné est l’exploration de la relation entre les mondes
culturel et matériel.
Une première perspective théorique au cœur de leur réflexion est l’accent mis sur la
pratique plutôt que sur la connaissance discursive. Ce point de vue découle de la théorie de
la pratique de l'anthropologue et sociologue français Pierre Bourdieu. En alliant le
marxisme, le structuralisme et la phénoménologie, sa théorie de la pratique a eu en effet
une grande influence dans les études contemporaines de la culture matérielle. Son concept
le plus célèbre, élaboré dans Esquisse d'une théorie de la pratique (Bourdieu, 1972) est un
remaniement de l'idée d’habitus, introduite dans les sciences sociales par Marcel Mauss
(1935). Pierre Bourdieu définit l'habitus comme un système de «dispositions durables,
transposables» (1977: 72), un « schème de pensée et des perceptions corporelles,
d’appréciations et d'action » et comme un « principe générateur d'improvisations
réglementées » (1977: 78). À bien des égards, l’habitus met en rapport les notions
d'habitude (comportements acquis par la pratique routinière) et de l'habitat, dans la mesure
où c'est à travers l'intériorisation de l'environnement physique et social que les gens sont
socialisés.
Du point de vue de la culture matérielle, l’exemple classique de l’habitus de Pierre
Bourdieu est son analyse de la maison kabyle (1970). L'article se lit d'abord comme une
analyse structuraliste classique, dans lequel l'organisation spatiale de la maison reproduit
(et parfois inverse) une série d'oppositions symboliques de genre qui structurent la
cosmologie kabyle. Cependant, Bourdieu montre que cette structure est malléable et
contingente selon les mouvements et les perspectives de l'évolution des Kabyles eux-
mêmes. Il constate que les significations ne sont pas strictement déterminées par la théorie,
mais sont générées par les gens à travers leurs pratiques quotidiennes, c’est-à-dire à travers
leurs habitudes. Bourdieu explore la façon dont les modes de pensée et d’action des
Kabyles ont été inculqués à travers la «pédagogie implicite» de l'habitus. Tout comme les
Kabyles façonnent leurs maisons, affirme Pierre Bourdieu (1977: 72), de la même façon ils
53
sont façonnés par leurs maisons. Ce processus qu’il appelle objectivation a induit des
conséquences inédites pour l'étude de la maison. En effet, en se servant de ce concept, des
auteurs comme Christopher Tilley (2006), Webb Keane (1997) et Daniel Miller (1987)
tentent de dépasser le dualisme qui prévalait dans la pensée empiriste moderne et qui
appréhendait les individus et les objets comme deux entités différentes et opposées (Tilley
2006 : 61).
À la suite de Pierre Bourdieu, Anthony Giddens (1984 ; 1979 ; 1976) élabore sa
théorie de la structuration par laquelle l'espace est incorporé dans la théorie, non comme un
environnement à part, mais comme faisant partie intégrante de la survenance d'un
comportement social. Comme l’affirme Giddens (1984), tout modèle d'interaction se
produit dans l'espace et dans le temps. L'importance des éléments spatiaux et architecturaux
pour l'analyse sociale est représentée par le concept de locale (Giddens, 1979: 206). Dans le
modèle d’Anthony Giddens, les éléments individuels de l'interaction transforment le
système au niveau de l'action sociale. Inversement, le système social agit sur les
comportements individuels.
L'importance de cette innovation théorique est que l'action sociale au niveau de
l'individu (microanalyse) est reliée avec succès à la structure sociale (macroanalyse) par
l'agency de l’homme. La pratique devient, dès lors, la base pour le changement social
structurel. Dans cette avenue, Anthony Giddens considère la reproduction sociale comme
un processus basé sur la performance des activités de la vie quotidienne (Lawrence et Low,
1990). Ces activités sont apprises à travers la socialisation, au cours de laquelle les règles
de conduite s'incorporent comme une partie intégrante de la vie d'un individu. La
socialisation se poursuit tout au long de l'âge adulte au fur et à mesure que l’individu
entreprend de nouvelles activités. En ce sens, la reproduction sociale et la socialisation
deviennent l'une et l'autre des moyens de dressage et de mise en forme de l’individu et de la
société. Ce processus, que Giddens appelle structuration, s'exprime à la fois dans les
propriétés sociales structurales et dans les pratiques quotidiennes.
En reprenant les travaux de Pierre Bourdieu (1980) et d’Anthony Giddens (1984),
Christopher Tilley (2006) développe sa propre notion d’objectivation, qu’il définit comme
un processus par lequel l’idée d’un individu ou d’un groupe d’individus se concrétise dans
54
une forme matérielle38. Cet auteur remet à son tour en question le rationalisme de Descartes
selon lequel l’esprit domine toujours la matière et que la forme matérielle est prédéfinie
mentalement avant d’être effectuée concrètement. Plutôt que de précéder la forme, Tilley
estime que l’idée se construit en même temps qu’elle, dans un va-et-vient continuel entre
l’abstraction de la pensée et la matérialité de l’objet (2006 ; 1994)39. Daniel Miller (2005 ;
2001 ; 1998 ; 1995 ; 1987) pousse plus loin l’idée de Tilley en suggérant que le processus
dialectique entre abstraction de la pensée et matérialité de l’objet ne se limite pas
uniquement au moment de sa construction, mais se poursuit à travers les différents usages
que l’on fera par la suite de l’objet (Miller, 1987).
En partant de ce postulat, Daniel Miller propose que l'objectivation soit au
fondement d'une théorie dialectique de la culture. Il fusionne dès lors les dualités sujet/objet
et individu/société en soulignant que les deux couples d'oppositions sont autant constitutifs
de la culture que constitués par elle. Miller ne considère donc pas l’objectivation comme
une simple réflexion théorique, ou comme un simple processus de signification. Il soutient
plutôt que «l'objectivation est une affirmation de la nature non réductrice de la culture en
tant que processus» (Miller, 1987: 33). Tout comme Pierre Bourdieu, Daniel Miller met
l’objectivation en rapport avec la praxis – entendue comme stratégies matérielles - plutôt
que de la définir comme un processus d’auto-aliénation comme dans le principe hégélien. Il
consacre ainsi l’importance de l’objet d’une part, en tant que forme matérielle
continuellement expérimentée à travers les pratiques, et d’autre part, en tant que forme à
travers laquelle nous expérimentons continuellement notre propre ordre culturel (Miller,
1987 : 105).
À partir des idées de Roland Barthes (2001 ; 1993 ; 1983 ; 1973) sur le texte, et de
Foucault (1984 ; 1975) sur la relation entre pouvoir et savoir, Daniel Miller écarte ainsi
l’usage de l’objet comme un symbole des réalités humaines et milite pour son autonomie.
Alors que le symbole se limite à un rôle d’évocation qui dépend du contexte
38 Voir un texte de synthèse sur les théories de la culture matérielle réalisé par Laurier Turgeon (2009) dans lequel il accorde une place de choix au concept d’objectivation tel que théorisé par Christopher Tilley et Daniel Miller.
39 Dans la même veine, Christopher Tilley suggère que les relations sociales ne préexistent pas à la culture matérielle, mais se construisent en même temps qu’elle dans un va-et-vient récursif et dialectique.
55
d’interprétation, l’artéfact, lui, est une entité réelle et palpable qui joue un rôle essentiel
dans la reproduction sociale (Miller, 1987 : 107). Pareil au texte, l’objet, une fois créé, subit
un processus d’objectivation, c’est-à-dire de mise à distance avec son constructeur et de
multiplication de son sens en fonction des multiples usages dans lesquels il est engagé
(Moisa, 2010).
En appliquant les résultats des travaux de Christopher Tilley et de Daniel Miller à
l’habitat, Mihaly Csikszentmihalyi et Eugen Rochmerg-Halton considèrent la maison et les
objets domestiques comme des «agents de socialisation » (Csikszentmihalyi et Rochmerg-
Halton, 1981 : 50-52) ; et comme des véritables agency. Désormais, ce n’est plus l’homme
qui réagit toujours sur l’habitat, mais c’est l’habitat lui-même qui acquiert la force
nécessaire de faire de lui un actant (Propp, 1970). Dans la même veine, Chang-Kwo Tan
considère la maison comme ayant une valeur d’agency, car « elle réagit et modifie ses
propriétaires » (Tan, 2001 : 170). Le concept d’agency attribue, dès lors, à la maison le
statut d’agent, dans la mesure où elle est capable d’influencer et d’orienter le comportement
de ses occupants (Hoskins, 2006 :74). Cette réciprocité dynamique entre individus et
maisons amène Christopher Tilley à finalement considérer l’objet comme « un site multiple
pour l’inscription et la négociation des relations sociales, du pouvoir et des dynamiques
sociales » (2002 :28). Dans ce sens, il propose d’étudier l’objet en tenant compte de
l’interaction dialectique et récursive entre les personnes et les objets, car « autant les
personnes font et utilisent les objets, autant les objets font les personnes» (Tilley, 2006 : 4).
Figure 5 : Relation récursive et réciproque entre individus et maisons
Individus
Maisons
56
Une deuxième approche théorique qui domine les études contemporaines de la
culture matérielle est la notion de matérialité. Selon Christopher Tilley, « la matérialité fait
partie intégrante de la culture et il y a des dimensions de l’existence sociale qui ne peuvent
pas être comprises sans elle » (2006 : 1). Dans un travail qu’il consacre à l’analyse des
symboliques sociales du canoë wala au Vanuatu, Tilley remarque que les Wala ont investi,
inscrit et incorporé des propriétés sensorielles à leurs canoës en y sculptant des organes
comme des oreilles, des bouches et des moustaches, et en dotant la poupe et la proue de ces
embarcations d’organes féminins ou masculins (2002 : 53). Pour cet auteur, « le pouvoir de
cette imagerie réside dans ses références aux qualités tactiles et sensuelles ainsi que dans
ses références au corps humain » (Tilley, 2002 : 25). Ainsi, le canoë et son usage
deviennent un vrai véhicule du pouvoir, mais surtout révèlent les relations sociales qu’ils
créent, notamment la relation entre l’homme et la femme. Le pouvoir de l’homme par
rapport à celui de la femme est généré par l’imagerie ouverte du canoë, et la distinction
entre le haut et le bas (Tilley, 2002 : 51). Plus qu’un simple symbole, le canoë devient alors
un médium pour exprimer les contacts sociaux, un agent qui possède la force de « dire ce
dont on ne peut pas dire ou écrire » (Tilley, 2002 : 28 ; 1991). Ces observations amènent
Christopher Tilley à conclure que «les formes matérielles ne sont pas simplement le reflet
préexistant des distinctions sociales, des ensembles d'idées ou des systèmes symboliques.
Elles constituent une des caractéristiques qui définissent l'être humain » (2006: 61). Miller
et Tilley s’appuient sur l’analogie de la culture matérielle avec le langage pour affirmer une
telle importance : «être humain c’est de parler; être humain c’est aussi de fabriquer et
d’utiliser les objets » (Miller et Tilley 1996: 5).
Ce principe a également été développé par Daniel Miller à travers ses ouvrages
Material Culture and Mass Consumption (1987) et Materiality (2005). Dans ces deux
ouvrages, Miller tente de comprendre en quoi le monde matériel participe à l’organisation
du monde social. Ecrits à une époque où le structuralisme était le modèle théorique
dominant dans les études des maisons, les ouvrages de Miller ouvrent la voie à la réflexion
sur les objets en tant que phénomènes culturels significatifs et dotés d’une autonomie
propre. Plutôt que d'être simplement l'expression de profonds mécanismes sociologiques,
Miller présente la maison et les objets domestiques comme les moyens par lesquels la
57
culture vient affecter les sujets (Miller, 1998 ; 1994). Autrement dit, pour Daniel Miller, si
les individus fabriquent des objets, ils sont également à leur tour fabriqués par ces mêmes
objets. À travers ses concepts théoriques, Miller parvient ainsi à transcender la séparation
binaire entre les sujets et les objets, entre le matériel et l’immatériel jusqu’alors au
fondement de la définition symbolique et structuraliste de la maison (Miller, 1987 : 12)40. À
sa place, il propose d’étudier la manière dont les relations sociales sont créées à travers la
manipulation des objets. Cette réhabilitation de l’objet oblige de passer au-delà des
frontières de l’espace bâti, car l’espace le plus peuplé d’objets est le domestique (Moisa,
2010 ; Miller, 1987).
Les implications de ces recherches stimulantes sont nombreuses. Elles montrent
comment la matérialité de l’objet est fondamentale (plutôt que complémentaire) à la
constitution des relations sociales. Comme l’affirme Christopher Tilley (2006: 61), elle
n'est pas un sous-ensemble, une partie ou un domaine de quelque chose qui est plus grand,
plus large ou plus significatif, mais elle y est constitutive. Ce postulat lui permet de
critiquer la séparation du matériel et de l’immatériel, et invite à l’exploration de la manière
dont les deux sont unis dans une étroite interaction, l’un se construisant par rapport à
l’autre.
En outre, les travaux de Daniel Miller (2011 ; 2005 ; 1998 ; 1995 ; 1987) tentent de
mettre à jour les cadres culturels, philosophiques et normatifs qui structurent l’organisation
de la maison, des objets domestiques, mais aussi des objets moins reconnus que sont les
marchandises anonymes. Ainsi, malgré sa banalité et son insignifiance, l’objet est
important, non parce qu’il est visible, mais parce qu’on ne le « voit » pas (Miller, 2005b;
1987). La culture matérielle n’existe pas à travers notre corps ou notre conscience,
proclame Miller, mais elle est un environnement extérieur qui nous provoque et qui nous
transforme. En prenant appui sur l’exemple précis de la maison, il souligne que sa longévité
temporelle peut la rendre active, indépendamment de l’action des gens qui
l’occupent (Miller, 2001 : 119). Dans cette avenue, Miller propose qu’au lieu de toujours
mettre l'accent sur ce que les individus font avec l’objet, il devient nécessaire de montrer 40 Daniel Miller écrit que « the goal of this revolution is to promote equality, a dialectal republic in which persons and things exist in mutual self-construction and respect for their mutual origin and mutual dependency (2005b: 38).
58
« comment les objets que les individus font, font les individus41» (Miller, 2005b : 38), car
l’objet « joue un rôle essentiel dans la reproduction sociale » (Miller, 1987 : 107), et dans la
structuration du comportement humain (Miller, 2005b : 5).
Au demeurant, les études de Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Christopher Tilley
et Daniel Miller élargissent la notion de la maison en tant que signe et témoin de la vie de
l’individu qui l’habite ; idée déjà présente chez Amos Rapoport (1972) et chez d’autres
adeptes de l’anthropologie symbolique. Tout en admettant cette notion, Tilley et Miller
avancent cependant que dans le rapport homme-environnement bâti, la maison n’a pas un
statut passif, mais plutôt actif. La passivité de la maison par rapport à l’homme, idée
dominante chez Rapoport, cède par conséquent la place à l’agency de la maison qui, de par
sa longévité, peut à son tour l’emporter sur l’homme (Miller, 2001). En outre, la maison
n’est pas saisie en tant qu’entité statique et systématique, comme l’a étudié la tradition
symbolique, mais en tant qu’entité dynamique et plurielle ; une idée qui sera reprise et
développée par les théoriciens de l’histoire sociale dans leur approche du pouvoir de
changement de la maison42.
2. Histoire sociale et facteurs historiques de changements architecturaux
Une des questions qui ont alimenté les débats sur l'architecture est celle du
changement (Blier, 2006 : 33). Certains auteurs (Guidoni ; 1978 ; Rapoport, 1969 ;
Rudofsky, 1964) ont soutenu que les constructions vernaculaires sont des entités statiques,
et donc, ne peuvent pas être étudiées historiquement. À l’inverse, d’autres chercheurs
(Coiffier, 1990 ; Glassie, 1975) considèrent que les maisons vernaculaires ne sont pas en
marge du temps. C’est par exemple l’avis d’Anthony King (1987 ; 1984 ; 1980 ; 1979 ;
1976) dont les travaux dans ce domaine sont révélateurs.
41 « We need to show the things that people make, make people » (Miller, 2005b: 38).
42 Dans l’analyse de la culture matérielle telle qu’opérée par les chercheurs de l’archéologie post-processuelle, les deux dimensions de l’habitat, spatiale et temporelle, sont prises en compte. La dimension temporelle inclut le cycle domestique, les structures de la vie historique, la continuité et les changements subis par les maisons tout au long des générations, l’incorporation de la mémoire collective, etc. La dimension spatiale rassemble l’organisation de l’espace intérieur, la définition des frontières spatiales de la maison, la disposition de la maison et ses caractéristiques à l’intérieur de la communauté, les relations sociopolitiques et économiques entre les sociétés à maison et leurs voisins à une échelle régionale (Gillespie, 2000 : 3).
59
Anthony King soutient que les maisons sont essentiellement des produits sociaux et
historiques. « Elles s’inscrivent dans des contextes historiques particuliers, résultent des
besoins sociaux et s’accommodent à une variété de fonctions: économique, sociale,
politique, religieuse et culturelle (King, 1980). Leur taille, leur apparence, leur
emplacement et leur forme sont régis non seulement par des facteurs physiques (climat,
topographie ou matériaux), mais également par « les idées, par les formes d'organisation
économique et sociale, par la répartition des ressources et de l'autorité, par les activités, les
croyances et les valeurs qui prévalent dans une société à une période donnée» (King,
1980:1). Antony King poursuit en notant que lorsque la société change, de nouvelles
formes de maison émergent pendant que d’autres deviennent obsolètes. La société produit
des maisons qui maintiennent et/ou renforcent ses formes sociales. Il devient donc possible
de reconstituer l'histoire d’un peuple donné à mesure que leurs maisons évoluent dans des
contextes socioculturels particuliers, puisque l’évolution de la forme physique desdites
maisons permet d'exprimer des positions idéologiques au sein d'une période historique
donnée43.
Une autre approche temporelle a porté sur les implications architecturales de la
dynamique temporelle et du contexte sociopolitique changeant. Dominique Malaquais
(2002) rapporte que chez les Bamiléké de l’Ouest-Cameroun, l’architecture était jusqu’aux
années 1990 au centre de la construction du moi et du statut à une échelle individuelle.
Mais à partir de cette date, elle change de signification pour devenir un symbole de choix
dans la construction de l’identité ethnique bamiléké à la faveur de la transition
démocratique des années 1990 (Malaquais, 2002: 272). En effet, la transition démocratique
a inscrit l’ethnicité au centre de grands débats politiques au Cameroun. Dans ce contexte, la
référence à l’identité régionale est devenue le mot d’ordre des élites locales avec pour
objectif de présenter « une vision du pays bamiléké comme d’un vaste tout sans faille […]
[et de] résister aux attaques d’autres groupes ethniques et coalition régionales » (Malaquais,
43D’après Anthony King (1984), les maisons résultent essentiellement des besoins sociaux et remplissent une variété de fonctions, notamment économiques, sociales, politiques, religieuses et culturelles. Dès lors qu’elles ne sont pas régies par de simples facteurs physiques, mais par des facteurs sociaux, elles sont susceptibles de changement à mesure que changent les sociétés.
60
2002: 274). À partir des années 1990, on passe donc logiquement de la quête d’une identité
individuelle à la quête d’une identité ethno-régionale.
Cette reconfiguration identitaire a eu un impact considérable sur la conception et
l’usage de l’espace bâti. Dominique Malaquais observe par exemple l’utilisation de certains
éléments architecturaux comme un signe de l’ethnicité, notamment les toits en pointe qui
ont changé de signification identitaire (2002: 274). Les photographies des toits sont de plus
en plus utilisées dans les tracts et pamphlets politiques comme un symbole de la « marque
bamiléké ». Désormais, les distinctions entre gens de hauts rangs et petites gens, longtemps
entretenues par cette même architecture, s’estompent dans la mesure où « l’identité de
groupe remplace le statut individuel comme principal agent de signification » (Malaquais,
2002: 276). Ainsi, sans subir de modifications dans ses formes, le sens de l’espace
domestique peut être manipulé et recontextualisé d’une génération à l’autre, d’une période
à l’autre (Bretell, 1999).
La troisième approche temporelle, aussi importante que les précédentes, est
l’histoire sociale des objets laquelle décline en «biographies culturelles» et en «cycle de
vie » des objets (Appadurai, 1986: 34). L’approche de la biographie culturelle est l’analyse
de la trajectoire de vie des objets spécifiques qui sont souvent échangés entre les peuples.
En revanche, l’approche de l’histoire sociale se réfère à une gamme d’objets dont les
significations varient sur le long terme. Selon Arjun Appadurai (1986), ces deux formes
d’identité d’objets sont liées, dans la mesure où c’est l'histoire sociale qui détermine les
biographies culturelles de ces objets.
L’un des promoteurs de l’approche biographique est Igor Kopytoff (1986). En
développant la notion de ce qu’il appelle « carrière objectale », cet auteur considère les
objets comme possédant une vie sociale similairement à celle des individus. L'approche
biographique suit ainsi analogiquement le principe du récit de vie ; un récit dans lequel
l' « objet devient plutôt le sujet et le principe organisateur de la narration » (Riggins,
1994 :2). L'analyse de la trajectoire de vie est d'une grande utilité pour la compréhension
des valeurs sociales, ancrées dans un groupe à une période donnée. Elle permet de dévoiler
61
les constructions sociales qui interviennent dans la relation entretenue par les individus
avec leurs maisons44.
L'analyse d’Arjun Appadurai est aussi, de ce point de vue, très éloquente, voire
complémentaire, puisqu’il considère également l’objet comme ayant une vie et une valeur
sociale. L’ouvrage collectif The Social Life of Things: Commodities, Cultural Perspective
sous sa direction avait pour but de définir «une nouvelle perspective sur la circulation des
objets dans la vie sociale» (Appadurai, 1986: 1)45 et de démontrer que la valeur d'un objet
est créée à travers les réseaux sociaux, culturels et politiques dans lequel son échange a lieu
(Appadurai, 1986: 3). Autrement dit, en même temps que les objets évoluent à travers des
contextes d’échanges différents, et souvent changeants, ils acquièrent des identités, des
usages et des valeurs différentes. Dans cette avenue, Appadurai affirme que «les objets
matériels, tout comme les personnes, ont une existence sociale» (1986: 3).
L’approche de la trajectoire de vie et de la vie sociale des objets a été très utilisée au
sein des chercheurs africanistes, notamment par Dominique Malaquais (2002), Labelle
Prussin (1995) et Suzanne Blier (1987 ; 1983). Blier compare les maisons batammaliba à
des humaines, à qui on peut parler et qui possèdent leurs propres biographies qu’il est
possible de reconstituer. Pour les Batammaliba, rapporte Suzanne Blier, la maison une fois
complétée, est assimilée à un bébé qui vient de naitre (Blier, 1983 : 373). Au cours de son
cycle de vie, elle est en mesure de grandir, de respirer et de se déplacer. Avec des soins
appropriés, les maisons, tels les humains, peuvent avoir une espérance de vie pouvant
atteindre 56 ans (ou dix cycles d’initiation). À cet âge, tels les humains, elles sont appelées
à « mourir pour donner naissance à une autre, construite avec le tissu de la vieille » (Blier,
1983 : 373). La maison et le corps peuvent, dans ce sens, être considérés comme le
prolongement l’une de l’autre.
44 Voir la synthèse effectuée par Marie-Blanche Foucarde (2007 : 34) sur l’approche biographique de l’objet.
45 La plupart des recherches sur l’objet biographique ont porté sur l'échange des objets entre différents peuples ou différentes personnes. Une fois échangés, les produits sont perpétuellement soumis à des classifications et à des reclassements (Kopytoff, 1986), ce qui rend possible de reconstituer leur histoire sociale. Charles Orser (1994) a par exemple utilisé cette approche dans son étude de la culture matérielle des esclaves dans le contexte des plantations. En plus de l'utilisation et de la valeur d'échange de l’objet, il a identifié la valeur propre où la présence même de l'objet contribue à perpétuer certaines idées et croyances. Ici, les objets ont l'agency, non pas à travers la conscience, mais en vertu des effets qu'ils ont sur les gens (Foucarde, 2007).
62
En partant de l’analyse faite par Suzanne Blier, Dominique Malaquais (1994) s’est
penchée sur le cycle de vie de la concession chez les Bamiléké en rapport avec la quête du
statut social. Elle s’est surtout intéressée au rapport entre l’élargissement de ce que les
Bamiléké appellent estomac de la maison et la montée d’un individu dans la hiérarchie
sociale46. Dans l’imaginaire bamiléké, l’estomac représente la partie du corps où débute la
reconnaissance sociale. Il est le lieu des premiers rites subis par un individu, et demeure
l’objet d’autres rites tout au long de sa vie » (Malaquais, 1994 : 24). De même que la
croissance d’une personne est la preuve que son « estomac a grandi », la demeure d’un
individu s’élargit au fur et à mesure que celui-ci monte dans la hiérarchie sociale
(Malaquais, 1994 : 25). Ainsi, en même temps que s’amorce la quête du statut social,
s’enclenche également le processus architectural marqué au tout début par la construction
d’une simple structure. Avec le temps et au fur et à mesure que son occupant monte dans la
hiérarchie, « cette construction si modeste, deviendra le noyau d’un édifice beaucoup plus
vaste et complexe » (Malaquais, 2002 : 205). Par la suite, tel un organisme humain qui croit
et se multiplie, la maison donne naissance à d’autres maisons avant de disparaitre avec le
temps. Au cours de sa trajectoire de vie, elle subit, dès lors, toute une série de
« métamorphoses dont chacune est le reflet d’un changement de statut de son possesseur »
(Malaquais, 2002 : 213).
Une dernière analyse relative au cycle de vie de la maison apparait sous la plume de
Labelle Prussin (1995). Dans son étude sur l’architecture des nomades d’Afrique, cette
auteure observe qu’au fil des années, la concession, aussi grande soit-elle, diminue
progressivement en taille pour n’être à la fin qu’une très petite structure (Prussin,
1995 :168). Les transformations architecturales surviennent surtout à la suite du décès du
chef de famille. En effet, lorsqu’une femme décède avant son mari, il doit se remarier pour
que la maison de la défunte soit occupée par la nouvelle femme. En revanche, lorsque le
mari décède avant la femme, la maison est complètement démantelée pour être reconstruite
un peu différemment (Prussin, 1995 : 167). Autrement dit, la durée de vie d’une concession
nomade est étroitement liée à la durée de vie du chef de famille, car celui-ci est considéré
46Chez les Bamiléké, l’estomac représente la partie du corps où débute la reconnaissance sociale. Il est le lieu des premières rites subis par un individu, et demeure l’objet d’autres rites tout au long de sa vie » (Malaquais, 1994 : 24).
63
comme l’âme de la maison. On pourrait donc conclure que la maison et ses occupants
partagent une histoire de vie commune (Casten et Hugh-Jones, 1995), et autant les
individus habitent la maison, autant cette dernière habite à son tour les individus.
En introduisant la vie sociale des objets dans le lexique anthropologique et
historique, les travaux d’Appadurai sont vite devenus des références dans les études de
l’histoire sociale de l’objet. La contribution la plus importante de cet auteur est cependant
d’ordre méthodologique. Dans son introduction au volume qu’il a dirigé, Appadurai fait
valoir que, pour comprendre la circulation historique des objets, « nous devons suivre les
objets eux-mêmes, dans la mesure où leurs significations sont inscrites dans leurs formes,
leurs usages, et leurs trajectoires » (Appadurai, 1986: 5). En plaçant les objets matériels au
centre de son étude ethnographique, Arjun Appadurai rend impossible de les ignorer dans
la vie sociale et culturelle au sens large47. Selon lui, on ne peut saisir les objets qu’en les
suivant par-delà les frontières géographiques, historiques et socio-politiques qu’ils ont
traversées48. C’est en tenant compte de ce principe qu’il introduit la dimension historique à
l'étude des artefacts, les révélant comme des entités dynamiques processuelles,
enchevêtrées dans des réseaux historiques et interculturels.
Le souci de prendre en compte la dimension historique se retrouve aussi sous la
plume de Simone Roux (1976). À travers son étude de la maison européenne depuis
l’époque antique jusqu’à la société libérale du XXe siècle en passant par l’architecture
médiévale, Roux fait ressortir pour chaque époque, les pièces architecturales qui encodent
la richesse et le rang social. Par exemple, elle indique qu’au Moyen-Âge, le nombre des
pièces, la grandeur de la maison et la décoration extérieure traduisaient le rang social de son
propriétaire. Par contre, à l’époque moderne, le prestige se donnait essentiellement par le
nombre des objets et du mobilier dans l’espace domestique (Roux, 1976 : 151). En dépit de
la variation temporelle de la signification sociale de la maison, Simone Roux note qu’elle a
continuellement été un des principaux outils d’objectivation du statut d’un individu à
48 En effet, en suivant le parcours spatial et temporel de l’objet, il devient possible de retracer les échanges dont il a été le témoin. Il devient également possible de mettre à jour une part des « expressions non verbales et des actions concrètes du quotidien qui ne s'embarrassent pas toujours de mots » (Turgeon, 2003 : 63) pour enfin saisir les relations que les individus ont avec lui, par le sens et la signification dont il a été investi (Foucarde, 2007 : 35).
64
l’intérieur de sa société. Autrement dit, elle a toujours servi de moyen pour projeter et
communiquer ce que l’on est. Elle est en outre utilisée comme une visée pour la
différenciation de soi par rapport à l’autre, afin d’acquérir un statut respectable au sein de la
société. Indépendamment des époques donc, certains aspects architecturaux ont toujours été
utilisés comme instrument au service de cette différenciation (Roux, 1976 : 233). Par
exemple, le choix d’une maison grande et le choix des matériaux de construction se font
toujours, non pas en fonction des ressources disponibles, mais davantage en fonction du
rang social.
Enfin, l’étude de Philippe Bonin et Roselyne De Villanova (1999) sur la migration
et ses conséquences sur l’architecture vernaculaire représente un autre travail qui retrace
l’évolution de la forme des maisons dans un contexte de mobilité. Ces deux auteurs
marquent le caractère dynamique de l’habitation dans ce contexte. Ils montrent qu’à
l’époque des migrations généralisées, le dédoublement des lieux de résidence apparait
comme une manière de gérer son identification à plusieurs cultures. En s’inscrivant dans la
mouvance tracée par Philippe Bonin et Roselyne De Villanova, Daniela Moisa (2010)
analyse la maison de rêve dans le pays d’Oas (Roumanie) dans le contexte de l'immigration
des habitants en direction de grandes métropoles européennes et nord-américaines. Les
nouvelles maisons qu’ils construisent à leur retour n’ont rien de spécifiquement roumaine
et rien de spécifiquement occidentale. De fait, l’immigration conduit non seulement à
l’adoption et à l’adaptation de nouveaux modèles architecturaux vus en Occident, mais
également à un re-travail des pratiques architecturales locales en fonction de nouvelles
exigences et influences occidentales. Autrement dit, les nouvelles maisons du pays d’Oas
s'intègrent à une analyse des trajectoires résidentielles entre ici et là-bas (Moisa,
2010 :477), dans la mesure où elle est la synthèse des pratiques architecturales du pays
d’accueil et de celles du pays d’origine. En insistant sur le lien entre maison, temps et
identité, ces deux dernières études peuvent servir de référence pour ma recherche sur
l’architecture dans la mesure où elles permettront de réfléchir sur la double résidence dans
les monts Mandara intervenue à la suite de la descente des Montagnards en plaine dans les
années 1960.
65
Au demeurant, les études historiques de la production sociale de la maison
s’intéressent à l'analyse des forces de production, et introduisent une nécessaire perspective
diachronique. Elles analysent en outre, et de manière critique, non seulement l'évolution et
la production de la forme, mais aussi l'impact que celle-ci induit, à la fois, sur le
comportement individuel et sur les relations sociales. Cependant, ces approches n'ont pas
intégré les idées du symbolisme architectural qui ont immaculé les études structuralistes de
la maison, et qui ont constitué des avenues importantes pour la recherche africaniste sur la
maison africaine.
IV. Positionnement théorique de l’étude : entre théorie de la pratique et approche de l’action sociale de l’objet
Mon analyse de la maison sera située à l’interstice de l’approche de Pierre Bourdieu
sur la pratique et de celle de Christopher Tilley et Daniel Miller sur l’action sociale de
l’objet. Ce positionnement épistémologique permettra de corriger les faiblesses inhérentes à
ces deux approches et d’analyser l’interaction dynamique entre les individus et leurs
maisons, de façon à intégrer, à la fois, les dimensions symboliques, matérielles et
contextuelles de l’architecture. Si Bourdieu prête davantage attention au symbolisme de la
maison en tant qu’objectivation des relations de genre, Tilley et Miller s’attachent
davantage à sa dimension matérielle et aux variables contextuelles qu’ils considèrent
comme indispensables pour toute analyse symbolique (Miller et Tilley, 2011 ; Miller,
1987). Ce qui rapproche les deux est leur postulat selon lequel la maison ne peut pas révéler
sa portée sociale et identitaire en dehors des pratiques sociales dans lesquelles elle est
impliquée ; idée que je reprends d’ailleurs comme fil d’Ariane pour mon étude sur la
maison et l’identité dans les monts Mandara.
Ce qui m’oriente vers la théorie de Bourdieu de la pratique est d’abord sa capacité à
concilier la dichotomie épistémologique induite par les deux courants anthropologiques que
sont le culturalisme-symbolique et le structuralisme. Contrairement aux auteurs appartenant
à ces deux courants, Bourdieu souligne que la maison ne peut pas être pensée en dehors de
la pratique. Son analyse de la maison kabyle lui fournit le cadre dans lequel il met l'accent
sur la dimension spatiale et symbolique de l'action. Par ce fait, Bourdieu apporte une
contribution significative à la compréhension théorique des interactions humaines avec
66
l'environnement bâti. En faisant appel aux travaux de Pierre Bourdieu, mon étude vise à
intégrer les acquis de sa théorie de la pratique, de façon à prendre en compte les histoires de
vie des individus, leurs choix et leurs expériences au fil du temps. Cependant, il est
important de ne pas se limiter aux théories de Bourdieu, car elles sont parfois elles-mêmes
critiquées pour leur manque d'attention aux spécificités matérielles et pour l’absence de la
dynamique historique (Kyung, 2012 ; Semprini, 1995 ; Bailey, 1990 ; Humphrey, 1988).
Dans l’analyse de la maison kabyle, laquelle lui a d’ailleurs permis d’élaborer son concept
d’habitus, Pierre Bourdieu semble en effet s’enfermer dans des signifiés symboliques
premiers, négligeant parfois la capacité de la maison de forme et de sens à changer au cours
de sa trajectoire de vie, et à jouer un rôle différent en tant que symbole. Autrement dit, la
« vision statique et synchronique de la culture », chassée par Pierre Bourdieu avec
véhémence par la grande porte, semble parfois se réintroduire subrepticement par la fenêtre.
En réévaluant la place du matériel dans les systèmes symboliques, l’approche de
l’archéologie postprocessuelle - dont Tilley et Miller se positionnent comme des
promoteurs - permet d’éviter le piège d’une étude essentiellement centrée sur la recherche
des « signes » qui a prévalu dans les études symboliques et structuralistes de la maison, y
compris chez Bourdieu. En utilisant la métaphore du texte, les théoriciens de l’archéologie
postprocessuelle «lisent» et décryptent le sens codé de la maison en l'examinant dans son
contexte historique, et en tenant compte de sa matérialité (Miller, 2005 ; Tilley, 2002 ;
Giles, 2000; Hodder, 1986). Cependant, même si les auteurs de l’archéologie
postprocessuelle prétendent s’ouvrir à la dimension symbolique dans leurs analyses de
l’espace domestique, on remarque qu’ils se limitent généralement à la dimension matérielle
de l’objet (sa fabrication, sa manipulation, sa consommation, etc.) en montrant le pouvoir
que cela exerce sur les individus. Daniel Miller (2005) écarte d’ailleurs l’usage de l’objet
en tant que symbole, en considérant essentiellement sa matérialité.
Mon positionnement théorique à l’interface de la théorie de Bourdieu de la pratique
et des théories de l’archéologie post-processuelle sur l’action sociale, permet à la fois de
tirer profit des acquis de chacune des deux approches, et de combler en même temps leurs
impuissances. Cette nouvelle perspective autorise d’une part, la remise en question de la
dichotomie objectif/subjectif par l’identification de la maison comme médiatrice entre le
67
monde physique et les pratiques, réflexion ouverte par Bourdieu en 1970 dans son analyse
sur la maison kabyle. D’autre part, elle autorise de situer les analyses de la maison à
l'intérieur et à travers un certain nombre de contextes spécifiques, chemin lancé par Daniel
Miller, Christopher Tiller et Ian Hodder dans leurs études sur la culture matérielle. En effet,
la maison étant avant tout significative pour les gens qui l’ont construite, modifiée et
occupée49, comprendre sa signification symbolique exige de tenir compte à la fois de la
pratique et des contextes culturel et historique dans lesquels les actions et les expériences
des individus prennent forme. C’est dans cet interstice entre pratique et contexte que
j’inscris mon approche de la maison dans les monts Mandara ; une approche reposant à la
fois sur des formes matérielles de la maison et sur les récits symboliques produits autour et
à partir de ces dernières dans un contexte donné.
Au total, le regain d’intérêt pour la maison et l’objet a donné lieu à plusieurs types
d’approches de la maison. Traditionnellement étudiée par les géographes, les ethno-
architectes et les anthropologues, l’étude de la maison attire aujourd’hui de nombreux
adeptes parmi lesquels figurent des archéologues, des ethnologues, des historiens ou encore
des sociologues. L’architecture constitue dès lors un phénomène extrêmement composite
dont l’étude ne saurait se réduire aux matériaux et aux techniques de construction. Elle
fonctionne comme un «fait social total50» (Mauss, 2007 [1923-1924]), et comme un lieu
d’intersection de multiples logiques (techniques, environnementales, sociales, culturelles et
historiques). Par ailleurs, elle ne se contente pas de refléter le statut social (Latour,
2007 :47), il est l’un des termes des relations sociales. Elle ne se limite pas à être un
symbole, elle a aussi la capacité d’agir sur le monde social. Elle peut être support de
mémoire, d’émotions, d’affectivité (Garabuau-Moussaoui et Desjeux, 2000 : 11). La
relation à la maison peut en outre être révélatrice de relations de positionnement, de
placement des uns par rapport aux autres au sein d’une communauté donnée. En tant que
telle, la maison sert de médiatrice permettant à l’individu, d’une part, d’intégrer dans la
société, et d’autre part, de rendre visible cette place. En cela, les maisons participent bien à 49Ce que l’architecture signifie pour les gens qui la construisent et l’utilisent a été considéré par un certain nombre de chercheurs (par exemple Barrett, 1994; Blanton, 1994; Fogelin, 2006; Geertz, 1993; Hodder, 1986; Locock, 1994; Parker, Pearson et Richards, 1994; Rapoport, 1990 ; 1988 ; 1976 ; 1969).
50Par « phénomène social total », Marcel Mauss désigne toute activité humaine qui a des implications dans toute la société, dans les sphères économiques, sociales, politiques, et religieuses.
68
la construction de la société, même s’il est vrai que c’est la société qui les a construites au
départ.
Par ailleurs, ce vaste parcours théorique permet d’affirmer que l'architecture peut
influencer les normes sociales à l’œuvre dans une société aussi bien que les refléter. Il
témoigne également de la nécessité de l’interdisciplinarité dans les études portées vers la
maison et ses rapports avec l’identité. Le lien entre une personne et sa maison est si
étroitement liée que l'accent mis indistinctement sur la matérialité ou l’immatérialité ne
donnerait pas une image suffisamment large du rapport entre l’architecture et l’identité. Il
est donc important de tenir compte des traits physiques et matériels de la maison ainsi que
des variables contextuelles (sociaux et historiques) du peuple auquel appartient cette
maison.
69
Chapitre II
Approche méthodologique : une co-construction entre terrain, corpus théorique et techniques d’enquête
L’approche méthodologique de cette recherche démarre d’une expérience ancrée
dans le terrain ; un terrain vécu, observé et interprété ; un terrain qui s’inventait au fil des
recherches antérieures menées dans le cadre des mémoires de Maîtrise et du DEA, et à
l’issue desquelles je me posais des questions sur le dispositif méthodologique à adopter. Ce
chapitre présente le cheminement poursuivi tout au long des étapes de la recherche, de la
préparation du terrain à l'analyse des données. Il s’agira donc de définir les approches
méthodologiques adoptées dans le cadre de la collecte des données sur le terrain (I). Suivra
ensuite la présentation de la méthode d’échantillonnage et des critères de sélection des
participants à la recherche (II). Je terminerai par la présentation des méthodes d’analyse des
données (III).
I. Approches méthodologiques : traits généraux
L’étude de la maison apparaît au premier abord comme interdisciplinaire;
l’architecture étant un objet d’étude ne relevant véritablement d’aucune discipline, mais
abordée par plusieurs. Du fait de ce caractère fondamentalement transversal, cette
recherche puise dans les différents champs des sciences humaines et sociales, tant au niveau
des concepts que des méthodes, afin de favoriser une compréhension plus complète des
constructions identitaires à l’œuvre par le biais de la maison. Ma démarche ne repose donc
pas sur une procédure d’enquête unique et linéaire, mais souscrit à une démarche
qualitative et interprétative. La flexibilité d’une telle démarche permet la saisie des
phénomènes du quotidien qui, « par essence ne sont pas mesurables » et «échappent à toute
codification et programmation systématique» (Mucchielli, 1991 : 3). Par le terme
«recherche qualitative », Jean-Pierre Deslauriers et Hermance Poliot désignent l’étude « des
phénomènes sociaux dans leur contexte ordinaire, habituel [...] visant à faire éclore des
70
données nouvelles et à les traiter qualitativement » (1982: 147). De par sa perspective
holistique, la posture qualitative est essentielle et importante dans l’« étude des conduites
humaines dans un cadre social et culturel donné» (Jodelet, 2003 :144). Pat Ellis (1986)
considère pour sa part l’outil qualitatif comme pertinent et judicieux pour l’accent qu’il met
sur les individus et sur le contact direct avec le terrain. C’est ainsi qu’il écrit :
L’approche qualitative nous aide à comprendre les gens dans leur interaction dans différents contextes sociaux et à définir la réalité sociale à partir de leur propre expérience, perspective et signification plutôt qu’à partir de celles du chercheur [...]. Elle permet de soulever des questions non posées jusque-là et dont les réponses aident à mieux comprendre comment et pourquoi les personnes participent comme elles le font dans une variété de processus (Ellis, 1986 : 138).
Pour ma part, j’ai privilégié cette approche pour l’importance qu’elle accorde à
l’induction et aux descriptions en profondeur. Aborder les questions relatives aux
constructions identitaires et à leurs reconfigurations suivant les intérêts du contexte
nécessite en effet l’usage des outils moins rigides, car plus susceptibles de rendre compte
de « dimensions oubliées » (Kandem, 2010 : 62). Cette approche a représenté un atout
certain pour saisir la diversité et le caractère évolutif des situations sociales et culturelles
par le biais de la maison et des objets domestiques. Deux principales méthodes issues de la
recherche qualitative ont été particulièrement sollicitées tout au long de la recherche, à
savoir : 1. l’approche phénoménologique interprétative et 2. l’ethnographie multi-située.
1. Approche phénoménologique interprétative : entre herméneutique et interactionnisme symbolique
La phénoménologie a d'abord été développée par Edmund Husserl (1970) [1927]
qui la définit comme l'étude d'un phénomène tel qu'il est vécu, et de la façon dont l'individu
construit activement le monde. En s’intéressant peu au phénomène en soi, et davantage à la
façon dont celui-ci est vécu par un individu, les adeptes de la posture phénoménologique se
posent en critique du positivisme qu’ils accusent d'être victime de l’«illusion objective»
(Giorgi, 1997). Même si Amadeo Giorgi (1989) reconnaît qu'il pourrait y avoir une « réalité
objective », indépendante de la perception humaine, il soutient que l'accès que nous
71
pouvons avoir à cette réalité n’est possible que par l’action humaine. À travers ses divers
ouvrages (Giorgi, 1997 ; 1994 ; 1989 ; 1985), la phénoménologie sera reconnue comme une
méthode scientifique pour la recherche qualitative. Amadeo Giorgi décrit le processus de la
recherche phénoménologique en cinq étapes: la collecte des données, la lecture des
données, la division des données en unités, l'organisation et l'expression des données brutes
en langue disciplinaire, et enfin l’expression écrite de la structure de l’objet étudié (Giorgi,
1997).
En tant qu’approche méthodologique, la phénoménologie vise à capturer d'aussi
près que possible la façon dont l'informateur expérimente un phénomène, par opposition à
la tentative de produire un énoncé objectif d’un objet ou d’un événement donné (Smith et
Osborn, 2004). De nombreux méthodologues trouvent cependant la phénoménologie
comme une méthode de recherche limitée en ce qu’elle s’intéresse à la description d'un
phénomène tel qu'il est vécu, mais sans en fournir une interprétation selon les contextes
(Smith, 2004; Smith et Osborn, 2004; Smith et Dunworth, 2003). En partant de ce constat,
Jonathan Smith (2004) postule que la phénoménologie peut conduire le chercheur à
« plaquer » ses propres expériences dans l'explication de l’objet étudié. Cette critique
amène de nombreux chercheurs à repenser la phénoménologie traditionnelle en l’orientant
vers une approche qualitative plus éclectique et ouverte à l’interprétation. L’approche
phénoménologique interprétative (API) recommande le processus d'interprétation en deux
étapes : la première concerne la manière dont les informateurs interprètent leur propre
monde; la deuxième vise la manière dont le chercheur tente de donner un contenu
conceptuel et scientifique aux propos des informateurs (Smith, 2004). Smith connecte ainsi
l’API à l'herméneutique, aux théories de l'interprétation et de l'interactionnisme
symbolique, et considère le contexte comme immanent aux pratiques.
Cette ouverture à l’interactionnisme symbolique51 a motivé mon choix de situer mes
enquêtes dans le cadre de l’approche phénoménologique interprétative. Tout en conservant
le focus sur la description de l'essence d'un phénomène, l’API souligne que le processus de
recherche sur le terrain doit être dynamique et interactif, et que le rôle du chercheur doit
51 L’application de l’approche de l’interactionnisme symbolique peut être trouvée chez Harold Garfinkel (2007) [1967]), David Le Breton (2004), Jean-Claude Kaufmann (2004) [1996], ou encore chez Ervin Goffman (1974) [1967].
72
être actif. Dans cette avenue, s’entretenir avec une personne n’est pas seulement recueillir
de l’information comme s’il s’agissait d’une extraction minière, c’est avant tout interagir
avec l’informateur pour faire jaillir son point de vue au sein d’un contexte donné. Cette
analyse contextualisée suppose de « regarder » l’objet d’étude dans plusieurs directions
(Bensa, 1996 :13; Bateson, 1977 : 13). J’adopte d’ailleurs la définition d'Alban Bensa de la
notion de contexte qu’il considère comme «un ensemble d’attitudes et de pensées dotées de
leur logique propre, mais qu’une situation peut momentanément réunir au cœur d’un même
phénomène » (1996 : 44). L’API permet ainsi de comprendre la signification des pratiques
relatives à la maison en prenant en compte la diversité des structures spatiales, sociales,
culturelles dans lesquelles les comportements des individus ainsi que leurs discours autour
et sur la maison s’articulent.
La deuxième raison qui a motivé mon choix de l’API est l’importance qu’elle
accorde aux symboles en tant que médiateurs actifs dans la définition de soi. Aborder
l’étude de la maison dans une perspective interactionniste symbolique revient alors à la
considérer comme un puissant agent dans la définition du statut social des occupants et à
reconnaître son importance en tant que médiatrice dans la présentation de soi aux autres
membres de la société. Cette présentation de soi peut être vue d'un point de vue
dramaturgique, où la maison et les objets domestiques deviennent une collection de décors
et d'accessoires de la performance sociale (Goffman, 1973). Lors du processus de collecte
des données sur le terrain, je remarquais que les gens choisissaient, pour les manipuler,
certains aspects symboliques de leurs maisons dans le but de me convaincre de
l’importance qu’ils ont au sein de leurs sociétés. À partir de cette lecture, j’ai envisagé
d’analyser les discours sur la maison selon quatre plans : le premier est la manière dont la
maison parvient à encoder, à afficher et à communiquer des messages sur l’individu ; le
deuxième est la lecture que font les individus de leurs maisons et de celles des autres à
l’intérieur d’une même communauté; e troisième est le discours des individus sur leurs
modèles ethniques et sur ceux des autres communautés; le quatrième est ce que j’appelle les
« discours de coulisses » que tiennent les populations loin des regards des étrangers et
auxquels on ne peut y accéder sans un minimum d’interaction avec les autochtones.
73
La troisième raison qui m'a orienté vers l’API se fonde sur la distinction qu'Ervin
Goffman (1973) établit entre les signes qu'une personne donne à voir (fronstage) et les
signes qu’une personne dégage (backstage). Par le concept de frontstage, Goffman désigne
le type d’informations ou de symboles qu’un informateur désire communiquer
intentionnellement, mais qui peut s’avérer être une mise en scène destinée à satisfaire
l’enquêteur. Il s’agit d’une sorte d’avant-scène permettant à l’informateur de bâtir une
image de ce qu’il désire communiquer aux chercheurs. En revanche, le concept de
backstage désigne les coulisses, qui se trouve à l’arrière et peut rester inaccessible au
chercheur si celui-ci ne développe pas une sensibilité d’écoute. Le fronstage est
intentionnellement exposé au regard des autres et comprend, entre autres, la présentation
des éléments qui, symboliquement, participent à la renommée des gens. Cela peut inclure,
le site d’habitation, le décor intérieur d’une maison, les meubles, etc. Le backstage est en
revanche reculé, occulté dans les entretiens, et parfois, est loin de donner une image
positive.
Cette division en frontstage et backstage que les populations opèrent est plus
prononcée dans les régions qui connaissent la pratique des activités touristiques. C’est ce
qui s’observe par exemple dans les monts Mandara, où le développement de l’industrie
touristique a conduit à la refonte et à la mise en scène du paysage culturel local dans le but
de le rendre davantage pittoresque, séduisant et propre à la consommation touristique. En
effet, parce que les populations estiment que les touristes et autres chercheurs assimilés
recherchent tout ce qui est exotique, elles simulent certaines manifestations culturelles,
falsifient leurs listes généalogiques et leurs traditions historiques, accordent de nouvelles
significations aux éléments architecturaux, etc. Si le chercheur se limite à recueillir des
informations sans avoir une bonne connaissance ethnologique de la société étudiée lui
permettant de déceler les données folklorisées de celles qui sont réelles, ses résultats se
limiteront immanquablement au frontstage, c’est-à-dire à l’avant-scène de l’information.
Ces observations m’ont amené à adopter la posture phénoménologique
interprétative dans laquelle l’enquête prend l’allure d’une interaction. La causalité de
l’entretien a permis de réduire au maximum l’artificialité de la situation d’enquête, et de
sortir progressivement du frontstage pour charpenter les couloirs qui mènent vers le
74
backstage. Dans cette avenue, j’ai conçu la situation d’entretien comme une transaction
mutuelle, une co-production, et non comme une extraction minière (Debarbieux et Rudaz,
2010 ; Olivier de Sardan, 1996; Legavre, 1996)52. Cette technique m’obligeait parfois à
faire le deuil de la neutralité en intervenant dans le fil de la discussion, et en relançant au
besoin mes interlocuteurs, les emmenant à affiner leurs positions (Mauz, 2002 : 73-76 ;
Mondada, 2001). C’est dans cet état d’esprit que les échanges, aboutissant à un recueil des
récits produits autour et à partir des maisons, ont été le plus souvent menés.
Il faut enfin préciser que l’usage de métaphores est une pratique courante dans les
monts Mandara. Or, les métaphores sont parfois difficiles à cerner et à interpréter de prime
abord. Elles donnent l’impression de tourner en rond lorsqu’on est peu habitué à ce mode
de communication. Les métaphores peuvent d’ailleurs être utilisées par les informateurs
comme une stratégie d’évitement de la question. La situation d’interaction permet, dans ce
cas de figure, de comprendre les significations symboliques des propos des informateurs et
d’accéder ainsi à la richesse dont regorgent les métaphores. L’ouverture à l’herméneutique
a en outre favorisé la compréhension de la complexité sémantique de la maison qui
ressortait dans les multiples lectures contextuelles et métaphoriques faites par différentes
catégories d’informateurs.
2. D’un terrain à l’autre: une ethnographie « multi-située » dans une démarche endotique
L’approche qualitative de mon objet d’étude repose également sur une ethnographie
multi-située, laquelle, contrairement aux ethnographies traditionnelles, permet de saisir un
phénomène en repérant ses manifestations à travers plusieurs sites (Saidi, 2007 : 61). Dès
1995, Georges Marcus soulignait qu’outre le modèle classique de fieldwork, lequel
« perpétue l’observation et la participation ethnographique sur un site unique » (1995 : 79),
on assistait à l’émergence d’un autre type d’ethnographie dite multi-située. Georges
Marcus définit cette nouvelle posture comme suit:
52 Certains auteurs remarquent cependant que cette transaction peut être inégale au moins dans un premier temps puisqu’elle est généralement déclenchée à la demande de l’enquêteur qui en sait souvent plus long sur son interlocuteur que ce dernier sur lui. C’est alors à l’enquêteur de donner suffisamment d’indices à l’enquêté sur ce qu’il est, d’où il vient, ce qu’il fait sans pour autant trop se dévoiler pour que ce dernier puisse se livrer (Kaufmann, 1996).
75
Multi-sited research is designed around chains, paths threads, conjunctions, or juxtapositions of locations in which the ethnographer establishes some form of literal, physical presence, with an explicit, posited logic of association or connection among sites that in fact defines the argument of the ethnography (1995:90).
Georges Marcus préconise une ethnographie multi-située qui peut être réalisée de
plusieurs manières et grâce à différentes techniques : « follow the people, follow the thing,
follow the metaphor, follow the plot, story or allegory, follow the life or biography, follow
the conflict » (Marcus, 1995 : 89). Autrement dit, la recherche ethnographique multi-située
peut servir entre autres à poursuivre les biographies, les objets, les métaphores, etc.
(Turgeon, 2003). Ici, le terme poursuite doit être conceptualisé. Il signifie l'étude des
origines de l’objet, ses métaphores, ses manifestations, ses métamorphoses, ses
ramifications à l'échelle de la culture et de la société, et son évolution d'une temporalité à
une autre (Saidi, 2007 ; Turgeon, 2003). Cette technique qui consiste à suivre l’objet a été
particulièrement revisitée par Arjun Appadurai dans sa collection The Social Life of Things
(1986). Dans cet ouvrage, cet auteur et ses collaborateurs recommandent de prendre en
compte la complexité des trajectoires de vie des objets, de pluraliser les lieux de leur
manifestation et d’investiguer les différents processus par lesquels ils sont passés.
Deux raisons principales m’ont amené à inscrire mes enquêtes dans le cadre d'une
ethnographie multi-située. La première est qu’elle permet de ne pas se limiter à un terrain
unique (a single site), mais plutôt de pratiquer une ethnographie mobile grâce à laquelle le
chercheur poursuit littéralement et/ou conceptuellement son objet d’étude, en se déplaçant
d’un site à l’autre. D’après Georges Marcus, cette technique du following ou du
tracking favorise l’explication, non seulement des mécanismes qui relient les sites entre
eux, mais aussi des effets de ces mécanismes sur chaque site (Marcus, 1995). Cela permet
ainsi d’opérer une comparaison inter-sites à l’intérieur d’une même recherche53. Georges
Marcus fait une distinction intéressante entre la comparaison comme pratique
conventionnelle de l’ethnographie et un nouveau type de comparaison qu’il considère 53 À ce propos, Laurier Turgeon propose de définir l’ethnographie multi-située comme une approche qui « privilégie l’observation et la prise en compte de plusieurs sites, leur comparaison et leur traduction, l’étude de différents niveaux d’interactions, l’examen des trajectoires mouvantes des gens, des récits et des objets. » (2003 : 165).
76
comme intrinsèque à l’objet étudié (Marcus, 1995 : 102). En suivant cet auteur, j’ai cherché
à comparer les valeurs identitaires associées à la maison dans les montagnes et à celles
associées aux maisons construites en plaine ou dans les bourgs musulmans. J’ai pris en
compte la façon dont les significations de la maison se transforment d’un site à un autre
sous la pression des paradigmes nouveaux. Dans cette perspective, les propos de mes
répondants ont varié d’un site à un autre, selon qu’on se trouve en montagne ou dans un
village de la plaine, et ces variations m’ont permis d’identifier les facteurs explicatifs. La
posture ethnographique multi-située a donc favorisé le décloisonnement des groupes
étudiés et leur poursuite dans leur nouveau site à l’issue de la migration des populations en
plaine.
Par ailleurs, Georges Marcus précise que la méthode du following ne sert pas
uniquement à mettre en parallèle deux sites physiques, mais aussi à interroger les
différentes catégories de la population (hommes, femmes, adultes, jeunes, etc.). C’est la
démarche que j’ai adoptée en analysant les discours de différentes catégories de personnes,
et en tenant compte à la fois du contexte spatial et temporel auquel elles appartiennent. Cela
a permis de rendre compte des visions parfois divergentes du rôle de la maison selon les
générations, les classes d’âge et le genre. La technique du following implique en outre une
dimension temporelle et nécessite la prise en compte des périodes ou des références à des
événements saillants qui ont pu influencer les discours autour de la maison ou de l’objet.
Georges Marcus (1995) précise d’ailleurs que la notion de site ne doit pas seulement se
limiter à un lieu, mais doit aussi être comprise comme un processus dans le temps, ou
comme une série d’événements. L'étalement de mon étude sur trois moments (période avant
la descente en plaine, période après la descente en plaine avec l’exode rural et le
fonctionnariat, temps démocratique) s'inscrit dans cette perspective et me permet de
souligner, pour chaque aspect de la maison, l’influence de la descente en plaine, de l’exode
rural et de la transition démocratique dans les transformations architecturales.
La seconde raison du choix de la méthode multi-située est qu’elle se prête bien à
une recherche endotique, c’est-à-dire à une anthropologie du proche, du familier, où l’aller-
retour entre le terrain du chercheur et son quotidien est constant, et où le semblable devient
l’Autre. Dans cette avenue, Georges Marcus note que l’émergence de l’ethnographie multi-
77
située relève de la disparition de l’Autre exotique (the loss of the subaltern) comme
principal objet d’étude: « Although multi-sited ethnography may not necessarily forsake the
perspective of the subaltern, it is bound to shift the focus of attention to other domains of
cultural production and ultimately to challenge this frequently privileged positioning of
ethnographic perspective » (Marcus, 1995: 101). Mon terrain d’enquête n’étant pas à
proprement parler exotique, ma position d’historien n’est pas celui d’un chercheur étranger
qui doit s’initier et se familiariser avec son univers d’enquête. Même si je ne suis pas
coutumier aux pratiques quotidiennes des populations vivant dans les monts Mandara pour
avoir vécu ailleurs, ma proximité culturelle existe du simple fait d’être originaire de cette
région. Dans cette avenue, mon statut est davantage celui d’un chercheur indigène, pour
reprendre l’expression de James Clifford (2003) ; statut qui déstabilise les principes sur
lesquels se fonde traditionnellement le travail ethnographique, et notamment la dichotomie
intérieur/extérieur :
I used to be accepted that real anthropology was 'outside' and informants or local historians 'inside'. That inside/outside relation has been exposed in practice, and the 'indigenous anthropologist' is turning out to be something complicated and multiply located with respect to the sites of study, of intellectual production and reception (Clifford, 2003: 20).
Je m’inscris donc dans ce nouveau courant de la recherche qui, selon Jean-Didier
Urbain, cesse de restreindre l’étude à une altérité exotique et lointaine pour se pencher sur
« l’Ici-Maintenant » (2003 : 74). Il s’agit d’une démarche dont la fonction est
d’exotiser l’endotique; de faire resurgir du sens, des signes et des significations que
l’habitude, le quotidien et l’existence ordinaire ont laminés, usés, effacés ou ensevelis dans le
familier, la norme ou le banal (Urbain, 2003 : 74).
Il faut cependant reconnaitre la part de subjectivité inhérente à toute démarche
endotique. En considérant mon rapprochement culturel de l’univers étudié, j’étais bien
conscient du danger que cela représentait, notamment le piège de prendre pour acquises les
idées reçues, parfois emprunts d'illusions et d’hypothèses non fondées. J’étais conscient que
la subjectivité pouvait parsemer les résultats de mon étude et que l’avantage culturel pouvait
m’empêcher d'aller au-delà du fronstage que les populations donnent souvent à voir.
78
Cependant, au lieu de me blâmer, j'ai plutôt choisi de faire fructifier mon origine comme un
moyen susceptible de m'aider à regarder autrement les cultures étudiées et à les appréhender
dans la perspective d'une démarche endotique. Je me suis servi de mon appartenance pour
créer le rapprochement nécessaire entre moi et mes participants, et au fur et à mesure que les
enquêtes progressaient, ils finirent par me considérer, non pas comme un « Noir acquis à la
cause des Blancs », mais comme « notre fils qui étudie au Canada », selon leurs termes. J'ai
pu ainsi intégrer aisément toutes les communautés visitées et observer dans les détails leur
manière d'interpréter et d'appréhender la maison et les objets domestiques. J’ai par la suite
mis à profit ma formation à l’étranger et ma jeunesse vécue ailleurs pour décentrer le regard,
lequel décentrement a été utile pour éviter le piège de l’aveuglement potentiel.
Ainsi, s’il s’avère ardu de faire la part du subjectif et de l’objectif dans une démarche
endotique, il était néanmoins possible d’en prendre conscience et d’adopter une posture
distanciée qui peut s’instaurer, selon Urbain, par le renouvellement constant du regard :
« Modifier sans cesse la trajectoire du regard, le désorienter, c’est aussi le rôle de
l’ethnologue de proximité. Sortant d’un réseau d’attractions officielles et interrogeant « ce
qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner », son but est bien de défamiliariser, de
déritualiser l’observation, de la décaler (Urbain, 2003: 94). La posture endotique m’a donc
permis d’être un « chercheur recentré » (Urbain, 2003 : 94) qui revient au centre de sa société
et de sa culture par le décentrement du regard.
Au demeurant, les choix de la phénoménologie interprétative et de l’ethnographie
multi-située comme approche méthodologique ont été faits en raison de leur appel constant à
l’interaction entre le chercheur et ses répondants. L’un des avantages d’une telle posture est
d’avoir permis de contourner l’image « de poseurs de trop de questions » que les populations
des monts Mandara se font des chercheurs, qu’ils soient africains ou occidentaux. Les
orientations méthodologiques étant faites, il convient de passer désormais à la présentation
des aspects pratiques de la méthode, c'est-à-dire à sa mise en exercice à travers les enquêtes
sur le terrain.
79
II. De la méthode d’échantillonnage au critère de sélection des participants
Il existe deux méthodes classiques de construction d'un échantillon: la méthode
probabiliste ou aléatoire, habituellement associée à la collecte et à l’analyse de données
quantitatives54, et la méthode non probabiliste ou non aléatoire, fréquemment associée à la
collecte et à l’analyse de données qualitatives (Ouellet et Saint-Jacques, 2000). Dans la
mesure où cette recherche se veut qualitative, j’ai opté pour la méthode d’échantillonnage
non probabiliste.
Celle-ci suppose un échantillonnage plus orienté et plus délibéré qui ne s'appuie pas
sur la théorie des probabilités. Si elle ne permet pas d'évaluer la probabilité pour chaque
unité de la population d'être échantillonnée (Ouellet et Saint-Jacques, 2000; Tremblay,
1991), la méthode non probabiliste permet au chercheur de prélever un échantillon selon
certaines caractéristiques précises de la population (Deslauriers, 1991; Miles et Huberman,
1991). Pour la construction de mon échantillon non probabiliste, j’ai privilégié la méthode
d'échantillonnage par « boule de neige» qui « identifie les bons cas grâce à des personnes
qui connaissent d'autres personnes qui connaissent des cas riches en information » (Miles et
Huberman, 1991 : 60). Il s’agit donc d’une technique fondée sur une démarche inductive
qui permet de recruter des personnes par l'intermédiaire des connaissances à qui on
demande de désigner d'autres personnes correspondant aux critères retenus (Ouellet et
Saint-Jacques, 2000 ; Kuzel, 1992; Tremblay, 1991). Dans la ville de Mora par exemple,
j’ai pu, à partir de deux personnes ressources, entrer en contact avec cinq autres
participants. Trois de ces derniers ont à leur tour aménagé des rendez-vous avec d’autres
personnes potentielles.
Ainsi, à l'issue des rencontres, certains des participants m'ont recommandé une
nouvelle personne susceptible de répondre à certaines questions concernant mon objet
d’étude. Chacun a donc fait intervenir son réseau social, qui de l'association culturelle, qui
des amis de longue date, pour intervenir directement ou indirectement dans l’enquête. Cette
méthode que les locaux qualifient de « bouche à oreille » est une pratique très courante
54 L'échantillonnage probabiliste consiste en effet en une sélection des «unités» (Chauchat, 1985) au moyen de méthodes aléatoires permettant de mesurer la probabilité que chaque unité a de faire partie de l'échantillon et d'assurer que toutes les unités aient les mêmes chances d'en faire partie (Ouellet et Saint Jacques, 2000; Tremblay, 1991; Trudel et Antonius, 1991).
80
dans les monts Mandara et a donc parfaitement fonctionné dans le cadre de ma recherche.
Dans cette avenue, le principe d'arborescence ne rencontrait presqu'aucune difficulté car
chaque informateur faisait volontairement part de son plaisir à contacter ses connaissances
qu’il jugeait aptes de participer à l’enquête en leur précisant les thèmes de discussion. Mon
échantillon s'est peu à peu constitué sur cette base. Au total, j’ai pu entrer en contact avec
soixante-dix participants dont vingt-six Podokwo, vingt Muktele, dix-huit Mura et six
participants islamisés rencontrés à Mora55. Ce déséquilibre en termes statistiques est en
partie lié à la disponibilité ou non des participants, et surtout des interprètes. En effet, dans
la mesure où les entretiens se déroulaient dans la plupart des cas dans les langues locales, il
fallait trouver des personnes s‘exprimant, à la fois, en français et dans au moins une langue
locale pour me servir d’interprètes. Dans certains groupes, comme chez les Mura, je ne
pouvais compter que sur les services d’une seule personne, laquelle a été indisponible
pendant la fin de mon séjour, ce qui m’a contraint de limiter le nombre des participants
mura à dix-huit.
Le choix de ces trois groupes s’avère rationnel pour les raisons suivantes.
Premièrement, les Podokwo, les Uldeme et les Muktele sont des peuples voisins ce qui, du
point de vue géographique, permet la couverture complète de la zone par les enquêtes de
terrain. Deuxièmement, il s’agit des peuples qui affirment avoir une origine commune, et
qui ont entretenu des rapports divers au cours de leur histoire. Troisièmement, mon
appartenance à l’ethnie podokwo rend facile le contact avec les informateurs issus des deux
autres ethnies en raison des rapports réciproques qu’entretiennent les trois peuples. La
quatrième et dernière raison découle des travaux de Christian Seignobos (1982) sur la
classification des architectures dans les monts Mandara. Je rappelle que cet auteur distingue
trois modèles, à savoir le modèle mafa, le modèle mofu et le modèle podokwo. Les
maisons des Podokwo, des Uldeme et des Muktele obéissent, selon l’auteur, à la même
logique architecturale et appartiennent à la même aire culturelle. Cependant, les
55 Ce nombre ne tient pas compte des informateurs qui ont participé à ma recherche dans le cadre de mes travaux de Maitrise et de DEA, et qui, pour une raison ou pour une autre, n’ont pas pu être contactés dans le cadre des enquêtes de terrain pour le Doctorat. Néanmoins, certains de leurs verbatim ont été utilisés pour soutenir une idée lorsque cela était nécessaire. Dans le même sens, ce nombre exclut les informateurs interviewés dans les localités autres que les sept (Udjila, Baldama, Dume, Godigong, Tala-Mokolo, Mora-Massif et Mora) retenues pour l’étude. Leurs noms ont tout de même été ajoutés à la liste des informateurs (voir la page 379 à cet effet).
81
convergences entre les maisons au sein de ces trois peuples n’excluent pas les particularités
ethniques, car les populations distinguent très souvent un kay podokwo et d’un gay
muktele. Chacun de ces trois groupes regorge de nombreux villages et clans situés en
montagne aussi bien que dans les villages de plaine apparus dans le cadre des campagnes
successives de descente des années 1960. Il convenait donc de retenir comme premier
critère de sélection des participants le lieu d’habitation pour pouvoir interviewer d’une part,
des familles ayant résisté à la politique de descente en plaine et, d’autre part, celles qui s’y
sont établies.
De manière générale, j’ai séjourné dans six localités différentes, dont trois villages
en montagne (Udjila, Zuelva et Dume), et trois villages en plaine (Godigong, Tala-Mokolo
et Mora-Massif). Autrement dit, pour chaque ethnie, j’ai choisi un village de montagne et
un village de plaine comme lieu de déroulement des entretiens et d’observation des
pratiques de construction, d’aménagement et d’habitation des maisons. Deux des trois
villages montagneux, en l’occurrence Udjila et Zuelva, ont été choisis en vertu des enquêtes
précédentes menées dans le cadre de mes travaux de maîtrise et de DEA. Par conséquent, il
était plus facile pour moi de m’y réintégrer, et d’être accueilli avec moins de gêne par les
populations et par les participants. Plus que cela, Udjila et Zuelva sont des localités dans
lesquelles on trouve encore des vastes maisons traditionnelles dont les dispositions
obéissent aux témoignages des informateurs. À Udjila, j’ai pu observer par exemple que les
clans prééminents, c’est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir, occupent des positions
dominantes du point de vue du relief, position qui vient confirmer les observations faites
par Antoinette Hallaire (1965) et Christian Seignobos (1982) ainsi que les propos de mes
propres informateurs. Le village de Dume chez les Mura a également été choisi en raison de
la forte prégnance des valeurs associées aux altitudes si bien qu’elles orientent encore
aujourd’hui le comportement des gens.
82
Graphique 1 : Répartition des participants par ethnies et lieu de résidence (massif ou plaine)
Pour les villages de la plaine, mon choix s’est orienté vers Godigong, Tala-Mokolo
et Mora-Massif. Godigong et Tala-Mokolo représentent dans l’imaginaire des Montagnards
des symboles de la modernité. On y trouve de commodités telles que l’électricité, des salles
de cinéma, des maisons modernes, dans le sens neuves, qui leur valent d’ailleurs le surnom
de Petit Paris. De fait, la présence d’un centre missionnaire, d’un dispensaire et d’une école
primaire a contribué à l’éducation et à l’entrée massive des jeunes dans la fonction publique
notamment dans les services de santé, la police et les forces armées nationales. De ce point
de vue, le choix de ces deux villages était important pour d’une part étudier les attitudes des
gens vis-à-vis des nouvelles maisons et de leurs propriétaires, et d’autre part, l’attitude de
ces derniers vis-à-vis des maisons traditionnelles. Par contre, le choix de Mora-Massif s’est
imposé de lui-même étant donné qu’il figure comme l’unique village mura situé en plaine
qui compte plus de cent personnes. Outre ces six villages, il convenait également d’inclure
la ville de Mora dans l’échantillon d’enquête à cause des rapports historiques entretenus
entre le royaume du Wandala de Mora et les Montagnards de la partie septentrionale des
Lieu de résidence Massif Plaine
60%
40%
67%
33%
66%
34% 100%
Po
urc
en
tag
e
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
EthnieMuktele Mura Podokwo Ville de Mora
83
monts Mandara, mais aussi à cause du fait qu’elle abrite un grand nombre de Montagnards
islamisés. De manière générale, leur choix est guidé par l’objectif d’établir des
comparaisons inter-ethniques, mais aussi des comparaisons entre les maisons en montagne
et celles en plaine pour saisir les permanences et les transformations architecturales. Il a
ainsi permis de voir comment les « gens de la montagne » et les « gens de la plaine » voient
leurs rapports à la maison.
Une fois les localités retenues, j’ai procédé à la sélection des participants en prenant
en compte un certain nombre de critères. Premièrement, j’ai considéré le facteur âge. Dans
les localités de montagne, j’ai surtout privilégié les ainés en raison de leur connaissance de
l’histoire locale, et du fait qu’ils ont vécu tous les événements qui ont rythmé la vie des
Montagnards de la création des cantons jusqu’à la transition démocratique en passant par la
migration forcée en plaine, l’exode rural et l’avènement du salariat dont les effets sur les
pratiques architecturales sont évidents aussi bien en montagne qu’en plaine. Il faut tout de
même noter que, dans le contexte des monts Mandara, les aînés, s’ils ne sont pas réticents à
livrer une information, sont par contre d’habiles manipulateurs des données. Le défi était
donc de distinguer les vraies informations de celles qui sont reformulées pour devenir
exotiques. Dans cette perspective, il était important que j’accorde une importance à d’autres
types d’informateurs le plus souvent négligés par les chercheurs. J’ai ainsi intégré dans
mon échantillon des cadets sociaux que sont les femmes et les jeunes. En effet, le savoir
détenu par les aînés leur est progressivement transmis au fur et à mesure qu’ils grandissent,
à travers des rencontres au clair de lune ou à l’occasion des travaux communautaires qui
ont régulièrement cours.
Contrairement aux aînés qui livrent au chercheur des informations parfois biaisées,
les cadets ont tendance à ne donner que ce qui leur a été enseigné et transmis. J’ai donc
construit mon échantillon sur la base de l’intergénérationnel en intégrant parfois trois
générations d’informateurs (grands-parents, parents et enfants), appartenant à un même
ménage (les grands-parents, les parents et les enfants pubères). J’étais intéressé de voir les
liens que chaque génération développe avec la maison et le chez soi au quotidien, et les
différentes perceptions que les uns et les autres ont des différents types de maisons
(traditionnelle, moderne, musulmane) et de leur rapport avec l’identité de ceux qui les occupent.
84
Graphique 2 : Répartition des informateurs par âge
Concernant le troisième critère, celui du sexe, j'ai mené à la fois des enquêtes auprès
des hommes et des femmes dont les connaissances sur l’histoire ethnique en général et sur
mon objet d’étude en particulier sont avérées. Si les hommes étaient plus habiles à fournir
les informations sur les questions d’ordre politique (successions dynastiques, conflits et
mécanisme de résolution des conflits, construction des maisons, principes de la
transmission des maisons en héritage, etc.), les femmes étaient, quant à elles, détentrices
d’un type particulier de savoir lié aux thèmes économiques ou se référant au quotidien
(fonctionnement de l’espace domestique intérieur, agency de la femme au sein de la
maison, répartition de l’espace intérieur de la maison selon le sexe, etc.).
0 5 10 15 20 25
Total
80etplus
65‐79
50‐64
35‐49
25‐34
18‐24
00‐17
85
Graphique 3 : Répartition des participants par genre et lieu d’habitation
Cependant, les femmes étaient, tout au long de l'enquête, moins disposées à me
parler dans un contexte public comme elles l’étaient dans leurs maisons. Elles n’étaient pas
non plus à l’aise à donner des informations en présence de personnes de sexe masculin.
Lorsque l’entretien se déroulait à l’intérieur de l’espace domestique par contre, très peu de
femmes ont refusé d'être interviewées. La raison est que l’intérieur de la maison est
considéré comme un espace dévolu aux femmes. En revanche, les entretiens avec les
hommes se déroulaient essentiellement à l’entrée de leurs concessions. Lorsqu’on pénétrait
dans l’enceinte de la maison, la plupart des hommes me recommandaient à leurs épouses,
leur demandant de m’expliquer le fonctionnement de l’espace domestique et de me montrer
les « objets importants de leur maison ». Cette conduite qui se rencontrait en général dans
les trois localités de montagne retenues pour cette étude (Udjila, Baldama, Dume) se
justifie par le fait que les Montagnards associent la maison à la femme et le village à
l’homme. Maîtresse du ménage, de la maison et de tous les mobiliers qui y sont contenus,
la femme apparaît comme la personne la mieux indiquée pour expliquer le fonctionnement
de l’intérieur domestique. En revanche, l’homme passe la majorité de son temps à
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SommedeH
SommedeF
86
l’extérieur. S’il est à la maison en journée, sa présence reste limitée à la partie supérieure,
notamment dans des pièces telles que les étables et les chèvreries où il veille sur les bétails.
On pourrait résumer ce jeu de rôle en disant qu’à l’extérieur, la maison représente l’objet de
l’honneur masculin, tandis qu’à l’intérieur elle traduit l’honneur féminin d’où le rôle de
représentante de la maisonnée conférée à la femme, en particulier en cas des visites. Ce titre
lui confère le pouvoir d’interdire l’intrusion d’un visiteur dans l’enceinte de la maison. Par
exemple, au cours de mon séjour à Dume, deux femmes me refusèrent l’accès dans leurs
maisons. Signalons aussi qu’il était difficile d’obtenir l’autorisation de visiter l’espace
intérieur des maisons royales, des notables et des individus distingués au sein de l’élite
traditionnelle, notamment la partie la plus inférieure des concessions, plus connue sous le
dénominatif ventre de la maison. La raison en est que le ventre de la maison est comme le
ventre d’une personne et représente un lieu d’intimité personnel et familial56. En définitive,
j’ai considéré les femmes comme des potentielles participantes à ma recherche et elles
m’ont révélé certains pans de l’histoire que je n’ai pas pu obtenir auprès des informateurs
masculins pourtant considérés comme les seuls détenteurs du savoir traditionnel.
Un quatrième et dernier critère, et non le moindre, est la religion. D’emblée, il faut
préciser qu’avant la pacification de la région aux périodes coloniales, les Montagnards
étaient exclusivement animistes. La descente massive en plaine dans la décennie 1960
coïncide avec l’implantation de la Mission-Unie du Soudan (MUS), laquelle mission
favorise la conversion de plusieurs Montagnards au christianisme. La christianisation des
Montagnards semblait aller de soi dès lors que cette nouvelle religion était perçue comme
concurrente à l’islam des « esclavagistes » d’hier. Dans cette perspective, le christianisme a
pénétré jusque dans les montagnes quoiqu’avec des résultats moins spectaculaires par
rapport à la plaine. Par ailleurs, la pacification de la région aux époques coloniales a permis
l’établissement des rapports commerciaux entre les Montagnards et les Wandala. Cela a
conduit à l’islamisation de certains Montagnards et à leur établissement dans les bourgs
musulmans (Seignobos, 1982 : 91). La ville de Mora par exemple est constituée de
nombreux Montagnards descendus en plaine et s’étant islamisés, ils côtoient
quotidiennement des populations d’origine musulmane. Le critère religion a favorisé la
56 Pour plus de détails sur l’imaginaire du ventre et de son rapport avec la maison et le statut social de l’occupant, se référer au chapitre V.
87
lecture du statut social selon qu’on appartient à la religion ancestrale (animisme),
chrétienne ou musulmane.
Graphique 4 : Répartition des participants selon le critère religieux
Pour la conduite de la recherche proprement dite, j’ai élaboré trois protocoles
d’entretien en fonction des contextes sociaux et géographiques des participants : l’un pour
les populations habitant en montagne (voir annexe 2 : 450), l’autre pour les populations
vivant dans les villages de la plaine et dans les villes musulmanes (voir annexe 3 : 454), et
le dernier pour les originaires des monts Mandara devenus fonctionnaires (voir annexe 4 :
458). La prise en compte de plusieurs temporalités et de plusieurs espaces géographiques
ont permis de voir comment les Montagnards manient différentes facettes de leurs
appartenances ethniques et individuelles en les associant à des aspects architecturaux
particuliers. Si dans certains cas, ces choix dépendent des avantages économiques et
politiques qu'offre le contexte (MacEachern, 1990: 316-317; Hodder, 1982: 83-85), dans
d'autres cas ils s'effectuent en dehors de tout calcul politique et économique. Tout ceci
implique de concevoir l'identité ethnique et individuelle comme des produits d'un processus
social plutôt que d'une culture donnée, faite et refaite plutôt qu'allant de soi, choisie en
fonction des circonstances plutôt qu'attribuée par la naissance.
Totalmontagnardsislamisés 6
montagnardschristianisés 34
Animistes 30
88
Par ailleurs, la construction de la grille d’entretiens a consisté à préparer
préalablement une liste de questions cohérentes et pertinentes selon mes deux axes de
recherche précédemment identifiés, tout en les rendant intelligibles pour les participants.
J’ai ainsi été amené à reformuler certaines questions sous une forme simple et
compréhensible de manière à pouvoir stimuler l’échange avec l’informateur. Par exemple,
en posant la question « comment caractérisez-vous une maison mura? », la plupart des
participants ont eu du mal à développer amplement leurs réponses, se contenant simplement
de répondre en citant tels ou tels techniques et matériaux de construction. Or, il est difficile
de distinguer les maisons des Mura des autres groupes du point de vue des matériaux.
Lorsque j’ai reformulé la question sous la forme : « Est-ce que les Mura construisent leurs
maisons comme les Podokwo ? », les réponses ont donné lieu à des descriptions qui se sont
parfois étalées sur une journée, et à la schématisation au sol du plan idéal d’une maison
mura. Par la suite, certains participants m’ont invité à visiter l’intérieur de leurs maisons en
m’expliquant les éléments qui les différencient par rapport aux habitations podokwo et
uldeme. La reformulation des questions sous une forme simple donne dès lors lieu à des
explications détaillées et soutenues de la part des répondants.
Dans le même ordre d’idées, les questions de type --« D’où vient votre groupe
ethnique ? Comment êtes-vous arrivé là ? Qui a habité en premier dans cette maison ? »-
donnaient lieu à des réponses imprécises et vagues de la part des participants. À partir des
indices obtenus dans leurs propos, j’ai reformulé mes questions de manière à être plus
précis. Ainsi, au lieu de poser la question « D’où vient votre groupe ethnique ? », je posais
la suivante : « Avez-vous entendu parler de Waza ? ». Autrement dit, les questions n’ont
pas été conçues comme des produits finis, mais plutôt comme des outils susceptibles d’être
continuellement adaptés et reformulés suivant l’évolution de la recherche sur le terrain. Le
succès des entretiens dialogiques reposait sur de telles questions, car de par leur nature
spécifique et précise, elles stimulaient les participants à retracer, avec une certaine aisance,
les divers gestes et habitudes qui prévalent à la construction, à l'aménagement, et à la
présentation de la maison en lien avec l’identité du propriétaire.
Les contours de l'échantillon ainsi définis, il faut désormais en justifier la
composition. En effet, soixante-dix informateurs ne peuvent prétendre à la représentativité
89
de la population totale des monts Mandara. Cependant, cet échantillon offre une variété
d'expériences suffisante pour atteindre les points de régularité et de saturation dont parlent
Barney Glaser et Anselm Strauss (1967). Il m’a permis d'identifier clairement des
représentations et des pratiques communes ou divergentes entre les populations rencontrées
en montagnes et celles en plaine ou dans le village cosmopolite de Mora. Plutôt que
d'attester d'une représentativité, les participants ont plutôt contribué à former une palette de
discours autour du rapport entre les individus et leurs maisons. C’est d’ailleurs ce principe
qui régit la posture qualitative, laquelle implique une approche restreinte et précise de
l’échantillonnage plutôt que de garantir la représentativité de toutes les couches de la
population concernée par l’étude. Ma recherche est donc exploratoire et vise l’exemplarité
et non l’exhaustivité. Dans cette perspective, ce qui m’intéresse est moins la taille de la
représentativité que les discours, leurs répétitions, leurs contradictions et leurs
complémentarités qui me semblent plus utiles pour une meilleure compréhension des
constructions identitaires par le biais des maisons.
III. Inventaire des instruments de collecte des données
Le corpus comprend des données issues des entretiens qualitatifs et des trajectoires
de vie, des données issues de l’observation participante menée conjointement à la collecte
des données orales, et des données issues de la pratique photographique. Cette partie se
penche donc sur les outils mis en place pour la collecte de ces différentes données. Sont ainsi
exposées : 1. Les considérations liées à la structure et au déroulement des échanges avec les
informateurs, lesquels échanges ont pris la forme d'entretiens semi-directifs et de trajectoires
de vie ; 2. La technique d’observation participante ainsi que les éléments observés lors de
mes différents séjours sur le terrain; 3. L'apport de la photographie comme stimulateur des
entretiens et comme support de conservation des données.
1. Entretiens semi-directifs dans une démarche dialogique et réflexive
Selon plusieurs auteurs, dont Mamoussé Diagne (2006), une «raison orale» structure
les sociétés africaines à travers le primat de la parole qui se démultiplie dans de nombreuses
fonctions sociales. L'auteur invite les chercheurs à demeurer attentifs à cette pluralité de
sens et à faire usage d’une méthodologie appropriée dans la collecte des données sur le
90
terrain. Les entretiens semi-dirigés sont particulièrement importants dans ce contexte car ils
permettent à la fois de s’assurer que l’on couvre les éléments importants pour répondre aux
questions de recherche, et que l’on donne aux répondants l’opportunité d’apporter leurs
propres idées et d’exprimer leurs pensées par rapport aux thèmes abordés (Poupart, 1997).
De l’avis de Jean Poupart (1997), ce type d’entretien est idoine pour discuter plus
amplement avec les participants du sens qu’ils donnent à leurs conduites et pour étudier la
façon dont ils se représentent le monde. Il permet donc de découvrir le sens et les finalités
que les acteurs associent à leur situation et à leurs actions.
Dans la logique de la posture méthodologique que j’ai choisie à savoir l’approche
phénoménologique interprétative, les entretiens semi-directifs ont été envisagés comme une
conversation pour rapprocher le plus possible la recherche d’un mode de communication
reconnu dans la culture locale à savoir le dialogue. Il fallait à cet effet créer une situation
d’écoute de façon à ce que l’informateur puisse disposer d’une réelle liberté de parole, et
qu’il ne se sente pas en situation d’interrogatoire. Créer une situation d’écoute exigeait
parfois d’admettre et d’accepter les détours et les digressions de l’interlocuteur, comme ses
hésitations ou ses contradictions.
J’ai donc considéré mes interlocuteurs comme de réels participants à la recherche,
dans une logique de dialogue. Le choix de cette méthode a permis d’établir un climat de
confiance et d’améliorer la qualité de la recherche57. L’objectif était dans un premier temps
de comprendre le rapport entre maison et identité en partant de la logique propre des
participants, sans y porter un jugement de valeur. En fonction de ma problématique de
recherche, deux axes ont globalement structuré et orienté les entretiens avec les
informateurs : le premier axe concerne le rapport entre la maison et l’identité ethnique, et
second axe est le rapport entre la maison et l’identité individuelle. Chacun de ces deux axes
comportait des variantes pour prendre en compte des spécificités liées à chaque participant,
de son histoire de vie et de son statut social. Il était de ma responsabilité de respecter le
regard qu’ils portaient sur la maison - non seulement de le respecter, mais également de
57 J’ai pu avec profit négocié mon statut d’originaire de la région pour entrer facilement en contact avec mes interlocuteurs. Comme le prescrit Georges Marcus (1995 : 98), j’ai adopté lors des entrevues, la démarche d’un ethnographer-activist en renégociant mes identités en fonction de la situation où je me trouvais afin d’en apprendre davantage sur mes interlocuteurs.
91
s'intéresser à leur vision du monde, indépendamment des hypothèses que j’ai conçues à la
suite de la phase préliminaire de la recherche et de la recension d’ouvrages théoriques. Les
participants n’étaient pas non plus contraints par le temps ni par le nombre d'histoires ou
d'anecdotes qu’ils souhaitaient raconter.
En dépit de l’avantage qu’offre l’entretien dialogique, les propos des informateurs
n’étaient pourtant pas à confondre avec la réalité. J’étais ainsi bien conscient de la nature
subjective que pouvaient avoir les données produites au cours des entretiens. Jean-Claude
Kauffman invite d’ailleurs à ne pas considérer le récit livré par les informateurs comme la
réalité, mais plutôt comme une interprétation de celle-ci (Kaufman, 1996). Les lectures de
Christian Ghasarian (2002) m’ont davantage éclairé sur les principaux défis que la
démarche dialogique pose au chercheur sur son terrain. Il écrit que le « chercheur connaît
une sorte de conflit existentiel entre le subjectivisme (la sensibilité) et l’objectivisme (la
rigueur) d’une part, la bonne conscience due à l’idée d’utilité scientifique et la mauvaise
conscience associée au fait d’être un témoin indiscret d’autre part » (Ghasarian, 2002 : 24).
Face à ce double conflit, Ghasarian propose d’ajouter à l’approche dialogique celle dite
réflexive ou interprétative. La combinaison de ces deux approches permet à la fois une
pleine liberté aux participants, et une prise en considération d'autres paramètres
susceptibles d’influencer le déroulement des entretiens. Christian Ghasarian est plus
explicite à ce sujet lorsqu’il suggère de ne pas être naïf dans sa recherche et à garder une
démarche réflexive ; laquelle prend en compte les structures cognitives du chercheur, son
rapport subjectif à l'objet d'étude et le processus d'objectivation de la réalité (Ghasarian,
2002). Une série de questions accompagne alors le traitement critique des données sur les
raisons qui motivent les réponses et les points de vue des participants sur une question ou
une thématique donnée.
Mes propres expériences de terrain offrent un bon exemple de l’importance de
conjuguer sensibilité et réflexivité. Par exemple, trois de mes informateurs ne pensent pas
que les maisons ont une portée identitaire alors que celle-ci ressort clairement dans les
propos de la plupart des répondants et est bien documentée par des recherches menées
ailleurs (voir par exemple Moore, 2000; Desprès, 1991). J’ai essayé de comprendre les
informations recueillies auprès de ces répondants qui paraissaient ignorer complètement la
92
signification symbolique et identitaire de l’architecture. Un des participants rencontré à
Zuelva (une localité muktele) était très enthousiaste en décrivant l’architecture muktele au
début de la recherche. Il se présenta d’ailleurs à moi comme une des personnes importantes
de la communauté, et comme un informateur idéal pour un sujet portant sur la maison. Il
visait en quelque sorte à tirer profit de l’entretien, espérant recevoir en retour une
rétribution financière ou un appui ultérieur. Son enthousiasme est également lié au fait
qu’inter-acter avec un « chercheur venu du Canada » était une source de prestige qu’il
fallait s’approprier. Dès lors que j’abordais le sujet de la lecture du statut social au travers
de l’architecture, il manifesta peu d’intérêt à en parler. Il se bornait à affirmer que la maison
n’avait aucune portée identitaire et qu’elle n’attestait pas de l’importance d’une personne au
sein de leur communauté :
Tu as beau construire une maison en étage ou avoir une grande concession avec un beau mur de pierres. Si tu ne t’exprimes pas en français, cela va t’amener où ? Je crois que tout cela relève du passé. Moi je trouve que le plus important est de savoir parler le français et d’être l’« ami des Blancs », de recevoir régulièrement des cartes postales à partir de l’étranger » (entretien avec Gamnaga, homme de 35 ans, le 07 février 2012, à Zuelva).
Sans être totalement d’accord avec lui, j’étais néanmoins tenu d’accorder
professionnellement du crédit à ses propos aussi étranges qu’ils puissent paraître au regard
d’autres données collectées au sein de la même communauté. J’ai donc cherché à
contextualiser sa réponse pour voir les facteurs qui pourraient l’influencer à prendre une
telle position. Vers la fin de mon séjour, je lui ai naturellement fait part de mon désir de
visiter le chez lui pour qu’au cas où je revienne dans le village, je puisse m’y rendre et y
demeurer eu égard des bons rapports qui m’unissaient désormais à lui. Cependant, il
déclina ma demande sous prétexte qu’étant célibataire, il ne pouvait pas m’accueillir chez
lui. Or, être célibataire signifie en même temps n’avoir pas de maison ; le vocabulaire du
couple se confondant avec celui de la maison. De ce fait, tout en s’exprimant bien en
français pour avoir été à l’école et qu’on le nomme l’ami des Blancs dans le village, il ne
remplissait pas les conditions de l’honorabilité telles que définies par la communauté à
savoir : avoir une maison et fonder une famille. Loin d’être une information à rejeter, les
93
affirmations de cet informateur confirment bien la valeur identitaire de la maison
lorsqu’elles sont mises en rapport avec son histoire de vie et son statut social. Limiter
l'analyse à ses seules déclarations, et ne pas les voir à la lumière des variables contextuelles,
aurait rendu l'analyse des résultats moins riches et moins perspicaces58.
Par ailleurs, à partir des propos de cet informateur, j’ai réalisé que la question de la
maison et de l'identité était un sujet sensible étant donné que la maison est parfois vécue
comme un symbole fort de la réussite ou de l’échec d’une personne dans la vie sociale. La
maison révèle des informations sur les relations familiales et les réseaux sociaux, ou
l'absence de ces relations et de ces réseaux. Il donne des informations sur l'économie d'un
ménage et l’honorabilité d'un individu, ou sur sa vulnérabilité économique et l'absence de
son honorabilité. Dans cette avenue, il était difficile pour certains de mes informateurs de
parler directement de leurs maisons surtout lorsque celles-ci ne traduisaient pas l’image
qu’ils ont souhaité avoir au sein de la société. Ceux qui, à l’image de mon informateur cité
plus haut, n’avaient pas reçu de maison en héritage et qui n’en avaient pas construit
manifestaient davantage de gêne à s’exprimer sur le sujet.
En raison de cette sensibilité, j’ai dû changer mon protocole d’entrevue pour inciter
les participants à parler du rapport entre la maison et l’identité à la troisième personne du
singulier. Par exemple, au lieu de demander: « Quels renseignements votre maison
peuvent-elles donner aux autres sur votre statut dans le village ? », je posais plutôt la
question: «Peut-on connaître l’importance qu’une personne a dans le village par le biais de
sa maison ? ». Après avoir parlé de la façon dont on lit les informations sur les autres par le
biais de leurs maisons, il devenait probable et facile pour les participants de parler d’eux-
mêmes à partir de leur propre maison ; ce qui ouvrait la voie à un autre type de données
orales, à savoir les trajectoires de vie.
2. Les trajectoires de vie : une méthode biographique à double focale
Très souvent appelé méthode biographique ou life history, la trajectoire de vie est
une méthode de recueil et de traitement des données obtenues auprès de personnes
58 L’approche phénoménologique interprétative a permis de voir que les facteurs situationnels et contextuels étaient des éléments à prendre en compte dans l’analyse des données qualitatives (Myers, 2002).
94
rapportant leur vécu quotidien passé ou présent (Mucchielli, 2003 : 199). Il désigne à la fois
une méthode d'enquête et le produit de cette méthode, à savoir le témoignage recueilli.
Daniel Bertaux affirme qu’il constitue une forme particulière d’entretien, « l’entretien
narratif, au cours duquel un chercheur [...] demande à une personne ci-après dénommée
sujet, de lui raconter tout ou une partie de son expérience vécue » (Bertaux, 1997 : 6).
D’une manière générale, soutient Perla Serfaty-Garzon (1993), les trajectoires de vie
doivent permettre, par synthèse et recoupement, la compréhension d’un problème social.
En envisageant au départ de recueillir différemment les trajectoires de vie des
personnes et des maisons, je me suis rendu compte que les deux étaient associés et
s’imbriquaient l’un dans l’autre. En effet, en demandant à mes informateurs de parler de
leur parcours de vie, ils finissaient immanquablement de parler de leurs maisons. En
revanche, lorsque je leur demandais de présenter leurs maisons (origine, date de
construction, unités architecturales, etc.), les récits terminaient par l’évocation de leurs
biographies. Bien qu’au départ mon attention était portée sur les trajectoires de vie des
individus, j’ai réalisé combien les objets étaient importants dans la mesure où ils servaient
aux participants d’illustrer certaines périodes charnières qui caractérisent leurs parcours de
vie (appartenances sociales, pratiques et habitudes, etc.). Les trajectoires de vie ont dès lors
été réalisés en ayant à l'esprit les deux objectifs suivants : obtenir des informations utiles
sur l’histoire de vie de la maison à partir des biographies des personnes qui l’ont occupé;
obtenir des informations sur la trajectoire de vie des personnes en retraçant les
transformations survenues au niveau de leurs maisons.
Par ailleurs, en parlant d’eux-mêmes, les informateurs ont également parlé de leurs
rapports avec les autres, de leur honneur et de leur statut social au sein de leur communauté
d’appartenance, matérialisés par la position topographique et la grandeur de leurs maisons.
Dans cette circonstance, les trajectoires de vie se sont particulièrement révélées comme
indispensables pour connaître les discours des acteurs sur la maison (pratiques de
construction, d’habitation et de socialisation), à partir de leurs propres expériences. Ils ont
permis de comprendre que le rapport aux maisons et aux objets évolue en fonction des
histoires de vie de chaque individu. Chaque récit de vie a été ainsi l'occasion de voir se
manifester les liens particuliers que les individus attachent à leurs maisons. Ils ont enfin
95
permis de saisir le degré de valeur qu’une personne accorde à chaque partie de sa maison,
et de comprendre les émotions et la nature de son attachement à celle-ci et aux mobiliers
intérieurs.
Par ailleurs, plusieurs d’entre mes informateurs pendant qu’ils racontaient leurs
parcours de vie, me convièrent à une sorte de visite guidée de l’intérieur et de l’extérieur de
leurs maisons. Au fur et à mesure qu’on pénétrait dans l’enceinte de la maison, ils
présentaient des objets et des unités architecturales en les mettant en rapport, soit avec une
séquence de leurs vies, soit en soulignant l’importance de ces éléments dans la construction
de leur statut actuel au sein de la société. La visite-guidée leur a donc permis de mettre en
valeur les relations qu’ils ont au quotidien avec leurs maisons et avec leurs objets
domestiques. Par cette technique, ils m’ont en quelque sorte donné à voir leurs curricula
vitae, comme si la maison était un accomplissement de leurs luttes et de leurs combats tout
au long de leur histoire de vie.
Par exemple, lors d’une rencontre avec Slagama, un participant à ma recherche dans
le village d’Udjila, j’ai été invité à le suivre dans sa concession, désireux de me montrer les
nombreuses cases et personnes qui la composent. Avant d'arriver dans l'enceinte intérieure,
nous marchions à travers les vestibules, les cases d’entrée avec ses caractéristiques de deux
ouvertures, chacune donnant l’accès à une autre. Une fois dans l’enceinte de la concession,
Slagama me montra avec admiration les quartiers d’épouses, sept au total composés,
chacun d’une cuisine, d’une case à coucher et de deux greniers. En m’expliquant les
principes qui commandent la disposition des domaines des épouses au sein de la maison,
Slagama profita pour souligner l’importance de la polygamie dans la société podokwo :
« avoir plusieurs femmes te permet d’avoir une grande maison et des récoltes abondantes »,
pense t-il. En prenant pour modèle de réussite sociale son cas personnel, Slagama explique
qu’avec ses sept épouses, sa concession ressemble à un bastion et impose le respect dans
tout le village. En tant que tel, Slagama est très respecté dans le village. Un de ses voisins
affirme d’ailleurs :
Les gens écoutent Slagama quand il parle au sujet des affaires du village et remettent rarement en question les conseils qu’il donne. Si tu aperçois une maison comme sa part, la personne qui l’occupe doit être un homme très riche dans la société, et en temps de grande famine, c’est vers lui que les
96
autres gens du village accourent pour avoir les vivres. « C’est un travailleur acharné, comme tu peux voir en observant ses cases et ses
greniers toujours remplis de mil », renchérit un autre voisin. Ses sept femmes et une dizaine
de ses enfants les plus âgés forment la majeure partie de sa force de travail. Cependant,
Slagama explique qu’il n’est pas respecté parce qu’il a beaucoup de femmes, d’enfants et
de vivres, mais simplement parce que sa maison impose le respect et oblige les passants à
jeter un regard d’admiration pour son mur et pour les toits enfilés de ses nombreuses cases.
En faisant le tour extérieur de sa maison, nous apercevons la maison d’un voisin à Slagama
située juste en contrebas.
Figure 6 : Maison de Slagama en altitude ceinte par un grand mur d’enceinte. En dessous se situe la maison de son voisin, petite concession de trois cases et d’un grenier
En tant que tel, Slagama est très respecté dans le village. Un de ses voisins affirme
d’ailleurs : « Les gens écoutent Slagama quand il parle au sujet des affaires du village et
remettent rarement en question les conseils qu’il donne. Si tu aperçois une maison comme
sa part, la personne qui l’occupe doit être un homme très riche dans la société, et en temps
de grande famine, c’est vers lui que les autres gens du village accourent pour avoir les
97
vivres ». Ses sept femmes et une dizaine de ses enfants les plus âgés forment la majeure
partie de sa force de travail. Cependant, Slagama explique qu’il n’est pas respecté parce
qu’il a beaucoup de femmes, d’enfants et de vivres, mais simplement parce que sa maison
impose le respect et oblige les passants à jeter un regard d’admiration pour son mur et pour
les toits enfilés de ses nombreuses cases. En arrivant à l’extrémité arrière de l’enceinte de
sa concession, Slagama aperçoit le mur d’un de ses voisins et le pointe de doigt en me
chuchotant :
Tu vois le petit mur là ? Il contient seulement quelques cases, tu peux compter les toits. Là, c’est un pauvre type qui habite seul. Toutes ses femmes l’ont abandonné, et pourquoi ? Parce qu’il n’arrive pas à les entretenir [Rires]. Et où sont ses enfants ? Même sa maison montre qu’il est un homme irresponsable. Comment pareil homme peut-il se faire respecter dans le village ? Chez nous, la maison est comme un miroir dans lequel les gens te regardent (entretien avec Slagama, homme de 65 ans, le 23 mai 2007, à Udjila).
De l’extérieur, les deux maisons forment en effet un énorme contraste : le grand mur
de Slagama garni de toits de cases d’une part, et le mur décrépi de son voisin avec
seulement quelques cases d’autre part. La visite guidée effectuée en compagnie de Slagama
montre donc clairement les imbrications entre le récit de vie des personnes avec l’histoire
de vie leurs maisons. Elle établit également le rapport entre soi et les autres en termes
d’importance et de réussite sociales.
Les visites guidées des maisons n’étaient pourtant pas un choix méthodologique au
début de la recherche. Les observations faites tout au long de celles-ci m’ont convaincu de
les intégrer dans le dispositif méthodologique en tant que moyen d’investir et d’investiguer
les espaces domestiques des participants et de les mettre en rapport avec leurs histoires de
vie. Cette façon de faire a révélé le lien étroit entre les trajectoires de vie et les expériences
de la maison (Blunt et Dowling, 2006), et m’a amené à corroborer le principe selon lequel
le « chez soi », c’est-à-dire la maison, est un « prolongement du soi-même » (Serfaty-
Garzon, 2003). Les trajectoires de vies couplées des visites guidées étaient d’autant plus
nécessaires que les participants étaient moins gênés dans la présentation de leur espace
98
domestique, car l’attention du chercheur que je suis était portée non pas sur eux, mais sur
les pièces et les objets qu’ils me présentaient. La visite guidée donnait donc lieu à plus de
spontanéité dans les récits et dans les rapports aux objets.
Tout au long de la visite de l’intérieur domestique, il importait de prendre en
considération d’autres indications que les simples tranches de vie, notamment les gestes et
les émotions qui accompagnaient la présentation des pièces de la maison et des mobiliers
intérieurs. Les trajectoires de vie à partir des éléments architecturaux constituaient ainsi une
grammaire à part entière et une source importante d’informations sur le rapport entre
maison et identité. La présentation des maisons rendait compte des multiples facettes de
l’identité (ethnique, individuelle, relation de genre, etc.), ou tout au moins, celles que les
participants s’autorisaient à révéler. Parce que les gens et les maisons sont amenés à
« bouger » dans le temps et dans l’espace, les tranches de vie m’ont amené en compagnie
de mes participants à « bouger » d’une période à une autre, d’un lieu à un autre, en suivant
le démembrement d’une maison familiale. Cette technique du following et du tracking fut
le principal moyen qui me permettait de saisir les représentations sur la maison en fonction
des contextes spatiaux et sociaux, de regarder et de lire la maison dans cette pluralité de
contextes, et enfin de saisir par là même la trajectoire de vie suivie par ces personnes et par
leurs maisons. En intégrant la dimension temporelle et spatiale dans la collecte des
trajectoires de vie de mes participants, j’ai réalisé que les représentations sur la même
maison pouvaient varier d’une génération à une autre, d’un site à un autre.
Les données recueillies suite aux entretiens qualitatifs et aux trajectoires de vie ont
permis de calibrer mes objectifs en fonction de la problématique de recherche du moment
(toujours évolutive), de mes questionnements (sans cesse renouvelés) et de ma
connaissance du terrain (relativement cumulative). À cet égard, l’observation participante,
comme les entretiens et les trajectoires de vie, a constitué une étape privilégiée de
production de « modèles interprétatifs issus du terrain » (Olivier de Sardan, 1996) testés au
fur et à mesure de leur émergence.
99
3. Les données de l’observation participante et leur analyse
Les adeptes de l’observation participante affirment généralement que l’immersion,
le contact in vivo avec la communauté étudiée reste la pierre angulaire de la pratique du
terrain. Jean-Pierre Deslauriers la définit comme une « technique de recherche [...] par
laquelle le chercheur recueille des données de nature surtout descriptive, en participant à la
vie quotidienne du groupe, de l’organisation, de la personne qu'il veut étudier» (1991 : 47).
Dans l’observation participante, le chercheur participe dès lors aux activités qui ont cours
au sein de la société étudiée en s’efforçant d’adopter autant que possible le mode de vie des
populations. Sur mon terrain, l’observation participante a consisté à assister aux différents
travaux de construction (taille des pierres, extraction de l’argile, élévation des murs des
cases, confection des toitures, etc.), ainsi qu’aux séances de préparation de ces activités.
Les discussions informelles dans ces différents contextes ont permis de recueillir de
précieuses informations, bien souvent occultées dans le cadre formel des recueils de
trajectoires de vie et des entretiens.
Une première phase d’observation a porté, à la fois, sur les ressemblances et les
différences entre les maisons d’une communauté à une autre, et entre les maisons à
l’intérieur d’une même communauté. Les observations concernaient, entre autres,
l’emplacement de la maison sur le site, la forme, la structure, les matériaux utilisés et leur
provenance, l’aménagement de l’intérieur par rapport à l’extérieur, etc. Ces observations
avaient pour objectif de voir s’il y a un modèle ethnique à partir duquel une communauté
construit la maison. J’ambitionnais aussi d’étudier les différences observées entre les
maisons au sein d’une même communauté, en dépit de l’existence du modèle ethnique.
Cette première phase d’observation a permis de dresser une typologie architecturale en
fonction de l’ethnie, du genre et du statut social, et de comprendre que les personnes
appartenant à des statuts sociaux différents habitent dans des maisons différentes en termes
de caractéristiques physiques, de l’emplacement de la maison, du nombre d’unités
architecturales, des décorations et des styles d’aménagement particulier (Duncan, 1985).
Elles ont montré que les populations locales tirent des conclusions évidentes sur la classe,
la richesse et le statut social des individus selon le site sur lequel leurs maisons sont situées,
et selon le nombre d’unités architecturales qui les composent (Lindstrom, 1997). Les
100
matériaux de construction sont également présentés pour caractériser les occupants d’une
maison selon leur sexe (Sadalla et Sheets, 1993), et les aménagements intérieurs sont
parfois associés à différents attributs sociaux, notamment à la personnalité des femmes.
En observant la matérialité de la maison, mon objectif n’était donc pas simplement
de typifier les maisons, mais de comprendre les différents facteurs qui expliquent les
similitudes et les différences entre les maisons à l’intérieur et à l’extérieur des frontières
ethniques. Sans tomber dans le piège du déterminisme environnemental ou technique,
l’observation de la matérialité de la maison a permis de contextualiser les discours et les
pratiques qui s’organisent autour de la maison, et de comprendre d’autres logiques qui les
sous-tendent que les simples critères environnementaux et techniques.
Le deuxième aspect de l’observation a porté sur les modes d’habiter et sur les
rapports qu’entretiennent les individus avec leurs maisons. La façon dont les gens vivent le
rapport à leurs maisons est remarquable dans la mesure où celles-ci symbolisent quelque
chose de plus grand que leur fonction ou leur contenu (Bourdieu, 1994). On remarque bien
que la valeur d’utilité est surclassée ou même négligée ; les gens se focalisant dans leurs
discours sur les aspects qui expriment, symboliquement ou activement, leur statut social.
Autrement dit, l’aspect matériel est perçu comme un médium actif dans la construction et la
communication de l'identité personnelle et du groupe ethnique auquel on appartient. Par
ailleurs, l’observation des pratiques d’habitation des maisons en plaine montre que les
nouvelles maisons apparues dans les années 1980 véhiculent des significations identitaires
d’une manière différente des maisons ethniques, mais sans que ces significations aient
changé. Les nouvelles maisons autant que les maisons ethniques, bien qu’agissant dans
deux registres différents, constituent, dès lors, la base sur laquelle les gens se font connaître
à l’intérieur de leurs communautés, voire au-delà. Ainsi, en dépit des différences entre les
deux modèles architecturaux, la maison reste dans les deux cas une cible d’objectivation du
statut social à l’intérieur d’une communauté donnée. Ce qui diffère d’une génération à une
autre, d’une temporalité à une autre et d’un espace à un autre, c’est la forme que prennent
cette communication et cette affirmation de soi.
Au demeurant, l’observation participante a permis de dépasser les « avant-scènes »
que les populations présentent souvent aux chercheurs dans leurs discours. Celles-ci font en
101
effet régulièrement usage des mises en scène culturelles pour faire de leur village une
destination touristique par excellence. Elles ont réduit leurs cultures locales (rituels
religieux, rites traditionnels, manifestations coutumières, etc.) au folklore pour attirer une
grande clientèle. Par exemple, la plupart des participants expliquent que la concession du
chef d’Udjila est restée indemne pendant plus de quatre siècles sans subir de modifications.
L’observation des objets matériels contenus dans ladite concession, en particulier les pots
ancestraux, et les discours qu’ils ont stimulés ont permis de reconstituer la liste
généalogique et de situer la construction de l’actuelle maison du chef plutôt dans
l’intervalle de 150 à 200 ans. Par la suite, j’ai repris l’entrevue avec mes participants qui,
finalement, expliquèrent que la concession du chef était auparavant située sur les premiers
escarpements surplombant les plaines de Mora. Avec l’implantation du royaume du
Wandala à Mora et son islamisation au XVIIIe siècle, les gens d’Udjila abandonnèrent cette
concession pour construire l’actuelle, située en pleins massifs. Cette délocalisation était
importante dans la mesure où le royaume du Wandala avait pour rôle de capturer les
esclaves parmi les Montagnards et de les vendre au royaume du Borno (Boulet et al.,
1979).
En tant que technique d’enquête à part entière, l’observation participante a favorisé
un éclairage contextuel des données recueillies par le biais des entretiens et des trajectoires
de vie. Daniel Miller (2004) encourage d’ailleurs les chercheurs travaillant sur la maison ou
sur les objets domestiques, à « regarder à l’intérieur des murs » pour voir ce qui se passe
chez les gens, car c’est en voyant comment ils interagissent avec leurs maisons et leurs
objets que l’on peut comprendre leurs propos, et saisir la manière dont ils vivent leurs
identités. Ainsi, au-delà des informations fournies par les participants, l’observation de la
maison a fait découvrir les différents modes d’habiter et les imbrications multiples entre les
histoires de vie des occupants et de leurs maisons, notamment lorsque ladite observation
était soutenue par la photographie.
4. La photographie comme catalyseur d’entretien
La photographie a d’abord été utilisée comme un moyen pour stimuler les contacts
avec les participants. Elle servait par la suite à les faire réagir par rapport aux photographies
102
de leurs propres maisons ou de celles des groupes ethniques voisines. Pour la plupart des
participants, le fait de photographier une maison montre que celle-ci est un élément
important, et par conséquent, constitue la fierté de celui à qui elle appartient. Comme le
soulignent Delphine Dion et Richard Ladwein (2005), la photographie devient alors un
outil d’interaction entre le chercheur et les informateurs, et contribue à atténuer les
impressions de voyeurisme et de distanciation.
Par exemple, dans la localité de Zuelva chez les Muktele, la photographie fut un
moyen d’entrer favorablement en relation avec les populations et de gagner leur confiance.
Grâce à elle, la relation méfiante entre eux et moi s’est transformée en amitié. En effet, je
ne représentais au début de l’enquête qu’un « Noir qui fait comme les Blancs» selon leurs
propres expressions. Malgré cette méfiance à mon égard, j’ai été invité dès mon second jour
à dîner dans la famille de mon interprète. Dans les monts Mandara, un étranger, quelle que
soit son origine est d’abord une personne qu’on accueille en partageant un repas ou en lui
servant à boire. En acceptant cette offre, j’ai augmenté ma crédibilité, car partager un repas
avec les locaux est un rituel qui réduit la méfiance et la suspicion. Ce rituel humanise en
quelque sorte le processus d’entretien qui devient alors un dialogue bidirectionnel. Une fois
le dialogue instauré, j’ai demandé de prendre tout le monde en photographie de souvenirs
sous prétexte de me remémorer leur bienséance et leur hospitalité. Cette demande me
permis sans m’en rendre compte, de gagner toute ma crédibilité dans la famille de mon ami,
et plus tard, dans tout le village. Le fait de faire visualiser les photographies aux
populations immédiatement après leur prise favorisait en outre les échanges autour et par
les images.
Dans ce contexte et suivant les recommandations de Collier et Collier (1986), j’ai
continué à photographier ce dont les membres de la famille de mon ami étaient les plus
fiers : le mur d’enceinte de leur maison, les toitures enfilées en tiges de mil, les
constructions en pierres sèches, les greniers, les tombes des ancêtres décédées se trouvant à
l’entrée de leur concession, etc. Après cela, le chef de famille m’invita à photographier les
objets qui constituent la fierté du village, entre autres, le marché, les monuments
historiques (tranchées, lieu de guerre, tombes des premiers migrants), la maison du chef, les
terrasses, les champs de mil, etc. En chemin, il arrivait constamment que mes
103
accompagnateurs me conseillaient telle ou telle maison, tel ou tel quartier à photographier.
Cela me permettait de discuter sporadiquement avec eux de la raison pour laquelle ils me
recommandaient certaines maisons, et pas d’autres. Il ressort de leurs explications qu’une
belle maison était définie en fonction du site de construction (la hauteur), la beauté du mur
d’enceinte (témoin de l’appartenance ethnique), l’enfilement des toitures en tiges de mil
(témoin de la prospérité économique du propriétaire), et la multitude des unités
architecturales (témoin du nombre important des personnes qui vivent dans la maison).
La photographie a donc constitué un intérêt substantiel, surtout dans un contexte où
la prise de notes lors des entretiens était considérée avec suspicion surtout que ces
populations ont vécu des répressions policières pendant les périodes coloniales et
postcoloniales. Dans ce contexte, l’usage de la photographie a rendu possible mon
interaction avec les gens et d’être identifié, non en tant que personne hostile au monde
social observé, mais comme une personne œuvrant dans le sens de leurs intérêts. Parfois,
mes interlocuteurs m’invitaient à photographier leurs maisons de l’intérieur comme de
l’extérieur sans qu’une demande leur soit adressée. Le fait d’avoir remis des exemplaires
des photographies aux concernés a davantage milité en faveur de mon intégration et a
stimulé les entrevues.
La photographie a enfin servi comme un support d’entretien au moyen de laquelle
j’ai cherché à comprendre le sens des pratiques sociales et culturelles à partir de son
décryptage. Parfois, je rencontrais mes informateurs pour réaliser un entretien sur les
questions soulevées par les commentaires autour d’une photographie donnée. L’interview
photographique était parfois plus ludique et plus décontractée que dans les entrevues
classiques dans la mesure où les personnes interrogées ne se sentaient pas directement
concernées par l’entretien. La discussion semblait ne pas tourner autour d’eux, mais
davantage autour des photographies. L’interview photographique a dès lors offert aux
participants la possibilité de se détacher de l’entretien et de dépersonnaliser la discussion.
Ils avaient l’impression de commenter une photographie et non pas de participer à la
recherche. Pour davantage dépersonnaliser les échanges et favoriser une bonne discussion,
j’ai procédé à la sélection des photographies impersonnelles pour réaliser les entrevues.
J’entends par photographies impersonnelles celles qui ne portent pas directement sur les
104
acteurs, mais sur les maisons et les espaces domestiques. D’après Collier et Collier (1986),
plus la photographie est impersonnelle et abstraite, plus les réponses seront personnelles.
L’entrevue photographique a permis d’avoir, lors des analyses, des détails qui
parfois échappent à la prise de notes sur-le-champ, nécessairement rapide et mutilante
(Piette, 1986). La photographie m’est apparue dans ce contexte, comme un prolongement
du regard humain et du processus d’observation (Copans, 2002). Contrairement à une
situation d’observation classique, la photographie favorisait le retour aux images aussi
souvent que je le souhaitais. En ce sens, Barthes souligne que la photographie « livre tout
de suite ses détails qui font le matériau même du savoir ethnologique » (1980 : 52) et
qu’elle « permet d’accéder à un infra-savoir » (1980 : 54).
Cependant, l’usage de la photographie pose un certain nombre de problèmes qu’il
convient de mentionner. En effet, l'acte photographique n'est jamais neutre, il constitue « un
moyen de négociation, de contact ou d’accès à d’autres informateurs ou à d’autres sources
d’information » (Piette, 1992). Il contient avant tout le regard du chercheur que je suis
auquel s'ajoute la participation des informateurs. C’est dans ce sens que les participants
intervenaient très souvent pour me donner des instructions sur les meilleures maisons à
photographier. À l’extérieur des maisons par exemple, lorsque je demandais l’autorisation
de photographier telle ou telle partie de la maison, les occupants me proposaient l’angle de
vue pour que cela fasse, selon eux, « une belle photo ». À l’intérieur, les occupants
procédaient à une sorte d’arrangement des objets domestiques avant de passer à l’acte
photographique. Le désir de mes informateurs à participer dans l’acte photographique a
révélé des détails ou des faits notables que je n’ai pas pu observer lors de la simple visite de
la maison ou lors des entrevues. Étant donné toutes ces interactions sociales et culturelles,
Becker (1974) considère que, dans la pratique photographique, il ne s’agit pas de prendre
des photographies (take pictures), mais de construire des photographies (make pictures).
Dans ce contexte, Heisley (2001) déclare que le chercheur ne doit pas chercher à prendre
des individus en photographie, mais plutôt à faire des photographies avec des individus.
Au final, les photographies ont fourni des détails sur le niveau de vie, le style de vie
(statut et référents identitaires : ethniques, individuels, religieux), la vie au sein de
l’habitation (utilisation de l’espace, activités, signes d’hospitalité, etc.) et les activités
105
effectuées à l’extérieur de l’habitation (Collier et Collier, 1986). Chaque photographie a
ensuite été répertoriée dans une grille d’observation organisée autour des thèmes suivants :
ethnicité, statut social, genre, organisation de l’espace, espace géographique. Les thèmes
ont eux-mêmes été organisés selon le cadre spatial et temporel. Ainsi, sans nier la
subjectivité de la pratique photographique, celle-ci a constitué une source importante
d’information qui a permis de faire des comparaisons et des recoupements entre les
différentes maisons à l’intérieur d’une communauté et entre les différents modèles
architecturaux ethniques.
IV. « La mariée est souvent trop belle » : du choix du modèle d’analyse des données
La mariée est souvent trop belle. Pour qui a été sans cesse confronté à des savoirs oraux hétérogènes, fluctuants, voire en « miettes », inégalement répartis, diversement structurés, peu systématisés, stratégiquement proférés, politiquement manipulés, les fresques symboliques ou les tableaux « ethno-scientifiques » bien ordonnés laissent rêveur, et sceptique. L’ordinaire de l’anthropologie, en tout cas de l’anthropologie de terrain, c’est quand même l’ambiguïté et la multiplicité des systèmes de valeurs, les contradictions et les divergences incessantes dans les propos, la structure floue et les limites incertaines des « systèmes de représentation », la discordance fréquente entre normes et pratiques (Olivier de Sardan, 1996).
Cet extrait de l’article d'Olivier de Sardan sur la « violence faite aux données »
invite à la prudence dans le processus d’analyse des données de terrain que le chercheur
donnera à voir à travers l’écriture. « La mariée est souvent trop belle » est une manière non
seulement d’avertir les chercheurs sur les excès interprétatifs que les informateurs
attribuent à un phénomène, mais également sur les excès interprétatifs que le chercheur lui-
même peut accorder aux propos des informateurs en les enjolivant, et par conséquent, à
distordre le terrain. « La violence faite aux données » ne se limite donc pas seulement à
l’écriture des données, mais également à la manière dont on rend compte de leur recueil et
de leur analyse. C’est en tenant compte de cette interpellation que j’ai transcrite, classer et
analyser les différentes données collectées tout au long du processus de la recherche.
Globalement, celles-ci ont présenté trois niveaux consécutifs d’analyse. Le premier niveau
concerne ce que j’appelle « traitement des données », le deuxième porte sur l’analyse
106
transversale des données et le troisième sur l’analyse verticale des données.
La première strate d’analyse a consisté à retranscrire, coder et catégoriser les
données collectées dans le but de mieux les organiser. Ces données ont constitué un corpus
d’environ 160 pages, 4 carnets de terrain manuscrits consignant les observations et les
propos recueillis sur les lieux mêmes de l’enquête, une collection d’environ 2000
photographies. Le passage à l’écrit a été effectué par transcription intégrale des entrevues et
des trajectoires de vie. Après plusieurs lectures de mes carnets de terrain, j'ai commencé à
avoir une compréhension plus profonde de ce que les participants voulaient dire. Au fur et à
mesure que je lisais, je prenais des notes dans les marges sur le sens des phrases et des
thèmes d'intérêt qui se dégageaient. La signification d'une déclaration a été codée par des
notes, des signes et des couleurs. Les codes ont été attribués suivant mon intuition et au fur
et à mesure que ma compréhension du phénomène augmentait. Des feuilles séparées ont été
utilisées pour dresser la liste des thèmes et chercher des liens entre eux. Lors de la
transcription, seules quelques hésitations et répétitions, considérées comme inutiles à
l’appréhension du sens, ont pu être occasionnellement supprimées. Les tranches de vie ont
également été entièrement retranscrites. Par la suite, chaque récit de vie a été accompagné
d’une fiche avec, d’une part, des informations sur la personne, notamment son nom, son
âge, son statut social et matrimonial, et d’autre part, des informations sur sa maison, sa
composition, sa situation topographique et son usage.
Date de l’entretien et lieu d’entretien
Photographies associées
Cassette associée
Vidéos associées
Nom et Prénom
Âge et lieu d’habitation
Statut matrimonial
Statut social
107
Religion
Biographie de la maison
Date approximative de construction
Quel type de maison
(modèle ethnique ou moderne)?
Combien d’unités architecturales composent la concession ?
Situation de la maison dans le village
Organisation de l’espace domestique
Biographie du chef de ménage
Nombre de lignées remontant à l’ancêtre fondateur de la maison
Nombre d’épouses dans la maison
Nombre d’enfants
Autres personnes vivant dans le ménage
Usage générationnel de l’espace intérieur
Tableau 1 : Fiche individuelle accompagnant la transcription d’une tranche de vie
Le deuxième niveau portait sur l’analyse qualitative de chacune des entrevues et des
trajectoires de vie qui ont constitué le corpus de ma recherche. Cette analyse, que j'ai
appelée verticale, avait pour but de condenser les résultats par l'entremise de résumés
descriptifs. Cela m’a permis de passer en revue les thèmes et les sous-thèmes abordés avec
les participants et d’étudier les logiques qui sous-tendent leur énonciation. Pour cela, je me
suis inspiré du modèle d’analyse qualitative proposé par Barney Glaser et Anselm Strauss
(1967) à savoir le modèle de la théorisation ancrée ou grounded theory. Ce modèle propose
des allers et retours entre la collecte des informations sur le terrain et leur analyse.
J’alternais ainsi le travail de réflexion sur les données déjà collectées et la mise au point de
nouvelles stratégies pour en collecter d'autres. L’analyse des données a donc été à la fois
108
émique et étique (Paillé, 2006), c’est-à-dire qu’elle a combiné le sens que les acteurs
donnent aux faits, à leurs actions et à leur vécu, avec une théorisation savante qui permet de
relier ce savoir commun avec des règles d’explication tirées des théories existantes.
Le troisième niveau d’analyse des informations que j’ai appelé « analyse
transversale » avait pour but d’interpréter et de discuter les résultats des enquêtes orales, de
les confronter à d’autres sources (matérielles, écrites) afin d’en dégager les points de
convergence et de divergence. Cette phase a souvent donné lieu à de nouvelles enquêtes sur
le terrain lorsque cela s’avérait nécessaire. Mon journal de terrain a joué un rôle
particulièrement important à cet égard, en ce qu’il permettait de faire le point et de faire le
va-et-vient entre problématique et données, interprétation et résultats, fournissant autant
d’occasions de trouver de nouvelles pistes de recherche, de modifier mes hypothèses, et
d’en élaborer de nouvelles. L'analyse était alors une entreprise dynamique, en constante
progression, alimentée en permanence par le travail sur le terrain (Miles et Huberman,
1991: 85).
Conclusion - La maison : un espace de production et de communication des identités sociales, individuelles et des relations de genre
Choisir pour objet d'étude la maison comme point de départ pour expliquer les
logiques sociales à l'œuvre dans les constructions identitaires a nécessité que je me tourne
vers une méthodologie à la fois souple et rigoureuse. Une question se trouvait à l'origine de
la construction de mon approche : comment observer avec justesse la relation complexe,
changeante selon les contextes, et réciproque entre les individus et leurs maisons, entre les
communautés et leurs modèles architecturaux ethniques ? Deux aspects m’ont
particulièrement intéressé : le premier portait sur l’analyse formelle de la matérialité même
des maisons (leur emplacement, les matériaux de construction, le nombre des formes
architecturales, le plan intérieur, etc.). Le deuxième aspect visait davantage l’analyse du
sens que les gens donnent aux maisons, et ce qu’ils font avec et autour de ces dernières.
En étudiant la maison dans une perspective interactionniste symbolique, je me suis
rendu compte que les gens s'expriment et perçoivent les autres, non seulement par leur
comportement et par des déclarations verbales, mais aussi et surtout par la nature de leurs
109
maisons. Une grande partie des données et des résultats de l’enquête montre que le sujet de
la maison en tant que moyen de produire et de communiquer son identité est partagé par
presque tous les participants. La maison leur apparaît comme un outil important pour
maximiser la différence entre Eux et Nous. Dans ce contexte, les gens construisent la
maison, non pas seulement pour s’abriter, mais pour refléter ce qu’ils croient être la
position prototypique de leur groupe par rapport à d’autres, et leur position prototypique à
l’intérieur de leur groupe.
À l’issue du travail de terrain, il ressort clairement que la maison est une expression
de l’identité, à la fois, pour soi et pour les autres. « Nos propres habitations et les quartiers
dans lesquels nous vivons influencent l’image que nous avons de nous-mêmes et affectent
les rapports que nous avons avec les autres habitants du village » (Doucha, 67 ans, 23
janvier 2012 à Mora-Massif). Cette déclaration confirme les conclusions des études menées
ailleurs par Harold Proshansky, Abbe Fabian et Robert Kaminoff (1983), Moisa (2010) ou
encore par Ashild Hauge et Amulf Kolstad (2007). Ces deux derniers auteurs constatent
d’ailleurs que les maisons fournissent diverses informations sur la personnalité, les intérêts,
les biographies, le statut social et les relations sociales de ceux qui les habitent. Si l’identité
des gens est consubstantielle à la nature des maisons qu’ils habitent, elle est dès lors
affectée régulièrement par des changements qui interviennent dans les maisons au fil du
temps, et est en constante négociation à travers les interactions sociales. Par ailleurs,
l’enquête de terrain montre que la maison dans les montagnes affecte l'identité, non
seulement par les impressions visuelles que donnent la grandeur ou la beauté d’une forme
particulière, mais aussi par la façon dont elle facilite le développement des réseaux sociaux
entre les membres d’une communauté donnée. En revanche, dans les villages de la plaine,
la maison affecte l’identité par la façon dont elle facilite la vie privée et l’individualisme
des occupants.
Toutes ces observations m’amènent à suivre Laurier Turgeon, Jocelyn Létourneau et
Khadiyatoulah Fall dans leur définition de l’identité qu’ils conçoivent comme « une chose
construite, comme un processus socio-politique plutôt qu'une essence figée dans le temps »
(1997 : IX). En tant que telle, l’identité jouit d’une grande élasticité qui, « sur une gamme
d’éléments partagés, joue des morceaux différents au cours des époques, selon les lieux et
110
en fonction des sujets » (Foucarde, 2007 : 46). Une telle définition m’amène finalement à
envisager l’identité dans une perspective constructiviste et à la considérer comme un
sentiment de qui nous sommes en tant qu'individus, et comme une construction sans cesse
élaborée au fur et à mesure des interactions individuelles. Elle concerne à la fois ce qui
nous rend semblables à d'autres personnes et ce qui nous rend différents. Dans les monts
Mandara, les gens structurent cette perception de soi et des autres au moyen de la maison
qui devient alors une catégorie sociale capable de les différencier au sein de leurs sociétés.
Parce que destinée à durer dans le temps et contenant des objets à caractère cultuel, la
maison constitue un agent potentiellement important pour produire et communiquer
l’identité des gens et pour construire leur statut social. Globalement, deux facettes de
l’identité sont transmises à travers la maison à savoir: la maison en tant que cadre de
communication de l’identité ethnique, la maison en tant que cadre de communication de
l’identité individuelle.
L'identité ethnique est expliquée par Tajfel (1981) comme un sentiment qu’a un
individu d'appartenir à un groupe social donné, laquelle appartenance s’accompagne parfois
des émotions et de la fierté de partager des valeurs d’unité et de passé commun aux autres
membres du groupe (Meintel, 1993). J’élargis cette définition de l'identité ethnique en y
incluant la maison dans la mesure où il existe pour chaque groupe représenté dans mon
échantillon, un stéréotype architectural sur la base duquel les gens construisent leurs
maisons, indépendamment du nombre des personnes qui y vivent et de leur statut social.
Dans cette perspective, la maison est d’abord une entité sociale qui fournit un socle pour la
production de l’identité ethnique d’un groupe (Hauge, 2007). En ce qui concerne l’identité
individuelle, elle est définie comme un ensemble des signes et des symboles par lesquels
l’individu affirme son importance au sein de sa société d’appartenance. Par exemple, les
participants appartenant à l’élite traditionnelle, indépendamment de leur statut social,
affichent une préférence aux sites en hauteur pour la raison que l’altitude est perçue comme
un symbole physique qui maintient et améliore l'estime de soi. Même les participants qui
ont leurs maisons sur les piémonts reconnaissent la valeur identitaire des sites en hauteur et
admettent que les basses altitudes, malgré la grandeur et la beauté de leurs maisons, ont un
impact négatif sur leur estime de soi. En revanche, les participants appartenant à la nouvelle
élite, affiche leur préférence aux maisons en tôle et de forme rectangulaire qu’ils associent
111
à la modernité. Ces deux facettes de l’identité (identité ethnique, identité individuelle) qui
ressortent dans les discours sur et autour de la maison, constituent l’ossature de cette
recherche et feront l’objet des chapitres suivants.
113
Chapitre III
Histoire plurielle, mémoire plurielle, oubli pluriel: les montagnards à l’épreuve de leur passé servile
Dans son article intitulé Travelling memory publié en 2011, Astrid Erll évoque deux
phases importantes qui ont dominé les études mémorielles à travers le temps. Elle fait
remonter la première phase à Maurice Halbwachs, notamment à la publication d’un
ouvrage fondateur, Les cadres sociaux de la mémoire (1925), suivi d’un autre publié à titre
posthume à savoir La mémoire collective (1950). Dans ces deux ouvrages, Maurice
Halbwachs met l'accent sur un éventail de questions relatives à la formation de deux modes
d’historicité à savoir la conscience historique et la mémoire collective. La principale
marque de fabrique de cette première phase, explique Astrid Erll, réside dans l’étude de
l’expression mémorielle à un niveau individuel plutôt qu’au niveau de la collectivité, dans
un contexte historique marqué par les deux guerres mondiales (2011 : 9).
Si les travaux de Maurice Halbwachs ouvrent la voie à l’étude de la mémoire
individuelle, ceux de Pierre Nora donnent lieu à une floraison des recherches s’intéressant
aux modalités de formation historique des communautés d’appartenance et de la nation en
particulier59. En effet, la trilogie fondamentale publiée sous la direction de Nora sous le titre
Les lieux de mémoire (1984-1989) ne voit pas la mémoire comme une simple partie d'un
processus individuel, mais en tant qu’une activité collective simulée dans les monuments
nationaux, les musées et les commémorations qui constituent autant de références et
d’attributs identitaires, constamment mobilisés au bénéfice de la formation des collectivités
59 Astrid Erll pense que c’est au cours de cette seconde phase que les transformations sociales dramatiques ont convergé: fin des empires coloniaux, changement de génération de ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, intérêt accru pour l'Holocauste à la fois dans le monde universitaire et dans la culture populaire, chute de l'Union soviétique et du communisme, phénomènes migratoires, mondialisation et numérisation des médias de masse (Erll, 2011 : 9).
114
sociales, ethniques et nationales (Erll, 2011 : 6). Les travaux de Nora qui consacrent ainsi la
seconde phase d’études mémorielles (Erll, 2011 : 6), décentrent le regard sur la notion de
mémoire pour le recentrer sur celle de lieu. C’est à travers les lieux de mémoire que les
évènements du passé sont constamment réinterprétés et de façon permanente pour donner
une consistance identitaire au type de collectivité que l’on souhaite construire dans le
présent et dans le futur (Létourneau et Jewsiewicki, 2003 : 7). Dans ce contexte, la mémoire
cesse d’être une activité de transmission pour être une stratégie de présentification (Hartog,
2003) dont le but est la revendication des identités autrefois perdues ou déclassées
(Létourneau et Jewsiewicki, 2003: 7), ce qui remet en cause l’idée de la nation comme
d’une société ethniquement homogène (Erll, 2011 : 6).
Sans remettre en question les arguments évoqués par Astrid Erll pour subdiviser les
études mémorielles eu deux phases, j’estime qu’il faudrait désormais y ajouter les
recherches menées autour de la mémoire de l’esclavage et de la colonisation tant elles ont
mobilisé un grand nombre d’auteurs à travers le monde, à l’instar de Olivier Pétré-
Grenouilleau (2014, 2010, 2005, 2004), Lucia Araujo (2014, 2012, 2011, 2010), Bogumil
Jewsiewicki (2011, 2008), David Richardson (2010), David Eltis et David Richardson
(2008), Myriam Cottias (2007, 2006), Paul Lovejoy (2000, 1993, 1981, 1979), Claude
Meillassoux (1991), Frederick Cooper (1979), Martin Klein (1998, 1978) pour ne citer que
ceux-ci. Dans la lignée de Pierre Nora, ces auteurs montrent comment la mémoire est
culturellement héritée, c’est-à-dire patrimonialisée (Jewsiewicki, 2008 : 7), et comment les
objets historiques qui en sont le support sont eux-mêmes des produits faits et refaits.
Définie par Marianne Hirsch comme une postmemory, c’est-à-dire « the experience of
those who grow up dominated by narratives that preceded their birth, whose own belated
stories are evacuated by the stories of the previous generation shaped by traumatic events
that can be neither understood nor recreated » (1997: 22), la mémoire de l’esclavage et de
la colonisation fait très souvent recours à la médiation dans laquelle le patrimoine matériel
et immatériel apparait essentiel en tant qu’héritage qui participe activement, mais aussi de
façon contextuelle, à la transmission des identités (Jewsiewicki, 2008: 7).
En tant que postmemory, les souvenirs de la servilité intègrent la logique de l’oubli
et du refoulement d’une part, et la logique de la visibilité et de l’audibilité d’autre part
115
(Jewsiewicki, 2011 : 4-5). Ana Lucia Araujo (2007, 2011) montre par exemple que chez
les individus d’ascendance servile, la mémoire est marquée par des ruptures et des lacunes
alors qu’elle est définie par la continuité chez les descendants des marchands d'esclaves
(Araujo, 2011 : 82). En tant que sociétés ayant subi l’oppression servile et coloniale, les
groupes humains habitants les monts Mandara ont, consciemment ou inconsciemment,
refoulé certaines références à la mémoire servile dans leurs traditions orales, lesquelles se
rapportent pourtant aux évènements du passé (origine, itinéraire migratoire, installation
dans les massifs).
Toujours dans la même logique du refoulement, les imaginaires créés par des
administrateurs coloniaux ont été récupérés et retournés par les locaux qui s’en sont servis
pour produire d’autres types de mémoires supplantant les souvenirs des violences
coloniales. En prenant en compte cette tendance à toujours présentifier et à produire de
nouvelles versions de leur passé, il est important de montrer comment les populations ont
créé des passerelles entre l’histoire servile « officielle » telle qu’elle présentée dans les
ouvrages de synthèse historique et dans les archives coloniales, et la conscience historique
de l’esclavage et de la colonisation telle qu’elle est véhiculée au sein des groupes
concernés. L’objectif est de montrer comment les montagnards arrivent à déjouer les
souvenirs de la servilité et des violences coloniales pour construire de nouvelles identités
dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont situationnelles et contextuelles.
I. De l’histoire à la mémoire historique de l’esclavage: un dialogue impossible?
L’histoire et la mémoire ont longtemps été associées et très souvent fusionnées.
Toutes deux ont été pensées comme une sorte de souvenir, de chronique ou de commentaire
(Le Goff, 1988 : 180). Cependant, mises sur une échelle hiérarchique, de nombreux auteurs
(Araujo, 2011; Jewsiewicki, 2009, 2008, 2005; Blustein, 2008; Hartog, 2003; Spiegel,
2002; Maier, 1993) distinguent l’histoire de la mémoire en considérant la première comme
un compte rendu officiel d’une vérité plus ou moins consensuelle, et la deuxième comme
étant par définition anachronique (Araujo, 2011 : 1). Comme le souligne Bogumil
Jewsiewicki, on a recours à l'histoire pour étudier le passé dans son propre temps, alors que
le recours à la mémoire renvoie plutôt à ce rapport au passé qui ne passe pas, dans la
116
mesure où elle est une propriété qui permet de rendre présent l'absent advenu dans un autre
temps (2011 : 4)60.
Cette partie s’intéresse à ces deux modes distincts du discours sur le passé chez les
populations des monts Mandara. La première section sera ainsi dévouée à la reconstruction
du passé servile des Montagnards à la lumière du contexte historique d’insécurité ayant
caractérisé les rapports entre groupes humains dans le bassin tchadien entre le XVe et le
XXe siècle. La deuxième section portera sur les jeux de mémoire et les enjeux identitaires
qui en découlent tel qu’ils se donnent à voir dans les traditions orales lesquelles, à travers
les mythes d’origine, occultent la servilité tout en favorisant sa transmission symbolique
par le biais des chants historiques.
A. Histoire « officielle » et économie de la violence dans le bassin tchadien (XVe-XXe siècle)
La localisation géographique actuelle du bassin tchadien correspond à l'ensemble
constitué du Borno State (État du nord-est de la République fédérale du Nigeria), des
régions tchadiennes du Chari-Bagirmi, du Moyen-Chari et du Mayo-Kébbi et de la région
camerounaise de l'Extrême-Nord. Cette zone fut l’objet de divers bouleversements sociaux
induits par des raids esclavagistes qui accompagnèrent l’émergence et l’hégémonie des
grands États du bassin tchadien entre le XVe et le XVIIIe siècle (David, 2014 : 371). Le
XIXe siècle verra quant à lui l’hégémonie des Peuls qui, grâce aux conquêtes d'Ousmane
Dan Fodio, purent étendre leur domination politique au nord du Nigeria, mais aussi au nord
du Cameroun (Njeuma, 2012 [1878]; Van Santen, 1993 ; Abubakar, 1977 ; Hamilton et
Kirk-Greene, 1958). Leur expansion territoriale donna lieu à la fondation du califat de
60 Cette séparation binaire entre histoire et mémoire remonte à la publication par Maurice Halbwachs de l’ouvrage La mémoire collective (1950) dans lequel il discute de la relation entre les deux objets. Halbwachs distingue en effet deux formes d’historicité : la première est écrite sous forme de livres et fournie des descriptions schématiques des périodes et des successions chronologiques d’événements et de dates (1950: 48-50). Cette histoire écrite n’est pas soutenue par la mémoire collective, mais existe seulement en tant que cadres externes pour le groupe dans sa reconstruction du passé, et surtout dans son placement par rapport à un cadre de référence plus large (Halbwachs, 1950 : 50). La deuxième forme d’historicité est la mémoire historique, c’est-à-dire, l’histoire générale instrumentalisée par les membres d’un groupe donné à des fins de construction identitaire (Halbwachs, 1950 : 50) et de modification « des imaginaires collectifs, de stratégies politiques d’insertion dans la complexité du monde contemporain, et de régénération des communautés d’appartenance » (Létourneau et Jewsiewicki, 2003 : 5).
117
Sokoto à partir de 1804 duquel furent partie les lamidats peuls du Nord-Cameroun
(Njeuma, 1978 : 42). Cette section se penche premièrement sur le rôle joué par les
royaumes du bassin tchadien dans le peuplement des monts Mandara entre le XVe et le
XVIIIe siècle, et deuxièmement, sur l’économie de la violence sous le règne du chef peul
de Madagali, Hamman Hadji (1902-1927), telle qu’elle apparait dans son journal
personnel61.
1. Hégémonie des royaumes du bassin tchadien et raids esclavagistes
De nombreux chercheurs (Van Beek, 2013, 2012; Bah, 2003 ; MacEachern, 2002,
2001, 1993; Seignobos et Iyébi-Mandjeck, 2000 ; Van Santen, 1993; Hallaire, 1991;
Vincent, 1991; Boutrais et al., 1984; Mohammadou, 1982; Martin, 1981 ; Boutrais, 1973 ;
Juillerat, 1971) situent légitimement les mouvements migratoires à l’origine du peuplement
des monts Mandara dans le contexte de l’émergence des hégémonies politiques qui ont vu
le jour dans le bassin tchadien aux siècles passés. Déjà au XI siècle, l’expansion du Kanem
produit comme conséquence le refoulement vers le sud du vieux fond de peuplement sao
(Hallaire, 1991 : 109) duquel seraient issus plusieurs clans habitant les monts Mandara.
Jean-Yves Martin mentionne par exemple le cas des Marghi et des Matakam qui s’y sont
réfugiés à la suite des guerres conduites par le Kanem contre les Sao (Martin, 1881 : 221).
Les clans slalawa, mukulehe et Uzləgaya chez les Podokwo se réclament également du
fond sao et disent avoir regagné les monts Mandara par vagues successives avec une longue
escale à Waza (Chétima, 2006). Le Kanem connaît son apogée au XIIIe siècle sous
Dounama II et son influence s’étendit au sud jusqu’aux monts Mandara (Mohammadou,
1982). Suivra par après une période de déclin à la suite des guerres intestines et des
61 Ce journal écrit par Hamman Hadji par l’entremise de son scribe-esclave Ajia fait état de ses aventures esclavagistes dans et autour des monts Mandara. Le manuscrit a été trouvé par les Britanniques lors de l’arrestation d’Hamman Hadji en aout 1927 à Madagali. Il a été inséré pendant longtemps dans les archives coloniales et classé « top secret » par les régimes coloniaux et postcoloniaux qui tardèrent à le publier. C’est seulement avec l’avènement du premier gouvernement militaire du Nigeria en 1966 que l'interdiction fut levée, et le manuscrit rendu public. Le manuscrit est finalement publié dans sa version anglaise et annexé à un ouvrage paru sous la direction de James Vaughan et Anthony Kirk-Greene en 1995 sous le titre : The diary of Hamman Yaji: chronicle of a West African Muslim ruler. Voir annexe 5 pour quelques extraits de la version anglaise du manuscrit.
118
attaques extérieures (notamment de la part des Boulala) qui provoquent l’éclatement du
Kanem au XIVe siècle, laissant ainsi la voie à l’émergence et à l’hégémonie du Borno au
XVe siècle.
Héritier du Kanem, le Borno fut pendant près de quatre siècles (XVe-XVIIIe) un
État puissant de même qu’un pivot central des échanges économiques dans le Soudan
central de par sa position géographique particulière (Barkindo, 1989; Lovejoy, 1986). Il
constitua également l’une des portes d’entrée de l’Islam en Afrique noire. Exploré par les
Européens (Dixon Denham en 1823 ; Heinrich Barth en 1849 ; Van Vogel en 1853), le
Borno est décrit comme un vaste État dont la marque principale est son intérêt avéré pour
les esclaves. Si le XIVe siècle fut marqué par une longue période de crise économique et
des dissensions internes qui fragilisèrent le Borno, le XVe siècle s’apparente
vraisemblablement à une nouvelle ère, notamment avec la montée au trône du May Ali Gaji
(1470-1503) (Bah, 2003 : 15). Pour matérialiser cette nouvelle ère, celui-ci déplaça la
capitale dans la ville de Ngazargamu nouvellement construite et protégée par de grandes
fortifications. Dès sa prise de pouvoir, May Ali Gaji manifesta son intention de participer
au commerce transsaharien, et de ce fait, se livra à des raids réguliers aux dépens des
populations païennes qui n’eurent de choix que l’absorption ou la fuite vers les zones de
refuge (Bah, 2003 : 15). Mais le Borno atteignit surtout son apogée avec May Idriss
Alaoma, lequel fit de Borno une puissance à la fois politique, économique et militaire (Ibn
Fartoua, 1970 : 13).
Dès sa prise de pouvoir, celui-ci ambitionne la conquête de tous les territoires
païens situés au sud de son royaume jusqu’aux massifs du Mandara. Ses quinze premières
années de règne furent ainsi marquées par une réelle intensification des campagnes
militaires destinées à s’approvisionner en esclaves (Bah, 2003 : 16). Yves Urvoy écrit à ce
sujet que « depuis Idris Alaoma, la pesée est continuelle et l’avancée des Kanouri par
l’absorption ou le refoulement est constante » (1949 : 63). Christian Seignobos et Olivier
Iyébi-Mandjeck situent également le peuplement continu des monts Mandara à cette
période (2000 : 46). Borno doit sa suprématie militaire à l’utilisation de la cavalerie et à des
armes à feu vraisemblablement fournies par l’Empire ottoman en échange des convois
d’esclaves qui lui étaient annuellement envoyés à travers le Sahara (Bah, 2003 : 15).
119
Outre le Kanem et le Borno, le Wandala n’a pas moins refoulé vers les montagnes
les peuples qu’il rencontrait sur son chemin lors de son extension vers l’est. Jean Vossart
signale le cas des Maya qui occupaient la plaine de Doulo au XVIIe siècle et dont certains
rameaux ont été refoulés vers les monts Mandara, notamment les clans urza, Mboku et
Molkwa (1953 : 35). Au départ, le Wandala était lui-même animiste et vassal du Borno. À
ce titre, il envoyait annuellement aux souverains bornouans un tribut d'esclaves capturés au
sein des contrées montagnardes (Mohammadou, 1982). Mais à la fin du XVIIIe siècle, la
dynastie locale du Wandala chercha à s'émanciper de la tutelle bornouane en profitant de
l’éloignement qui la séparait de la capitale du Borno. Pour conquérir sa souveraineté, elle
embrassa l’Islam et transféra sa capitale de Kerawa à Doulo, et plus tard à Mora située juste
en contrebas des monts Mandara (MacEachern, 2001, 1991 ; Barkindo, 1989 ;
Mohammadou, 1882). Par ce fait, les Wandala détruisaient toute possibilité d’être asservis
par les Bornouans et s’arrogeaient le droit de lancer à leur propre profit des razzias au sein
des populations animistes (Morrissey, 1989). En revanche, l’islamisation du Wandala
signifiait pour les Montagnards l’avancée de l’islam dans leur direction et des incursions
esclavagistes plus fréquentes et plus cruelles dans leurs montagnes (Juillerat, 1971 : 37).
Si les raids étaient déjà en place dans les massifs du Mandara avant le XVIIIe siècle,
c’est véritablement à partir de l’islamisation du Wandala qu’ils s’intensifièrent, dans la
mesure où les Wandala firent des esclaves l’une des plus importantes transactions avec le
Borno (Morrissey, 1989 ; Barkindo, 1979). En échange des esclaves, le Borno leur
fournissait des tissus, des armes, et surtout des chevaux dont ils avaient besoin (Lovejoy,
1986). Le cheval apparaissait comme un animal de prestige et doté d’une réelle vocation
militaire. Selon un dignitaire de la cour du sultan à Mora, les souverains d’antan
échangeaient jusqu’à quinze à vingt esclaves pour un seul cheval62.
62Heinrich Barth évoque une situation similaire dans l’émirat de l’Adamawa où de nombreux esclaves furent échangés contre des chevaux. Cet auteur avance le chiffre de 500 chevaux acquis par le lamidat de Ngaoundéré en 1850 contre des milliers d’esclaves. Voir à cet effet, Heinrich Barth, 1965 [1857-1859]: 543-550.
120
Carte 2 : Localisation du Kanem, Borno et Wandala (Source : MacEachern, 2001 : 82)
On doit surtout à Dixon Denham la première et la plus vivante description de la
façon dont l’économie esclavagiste était exploitée dans la région. Il fut le premier Européen
à avoir vu les monts Mandara et à observer les contingents d’esclaves en provenance des
massifs (Van Beek, 2012: 34; Barkindo, 1989: 150 ; Vincent, 1978 : 575-606). Dans la
capitale du Wandala à Mora, il fut témoin du paiement par les gens issus d’un groupe
montagnard d’un tribut de 200 esclaves au sultan pour que celui-ci renonce à ses raids en
direction de leurs territoires (Denham, 1826 : 313). Denham estimait que plus d’un millier
d’esclaves par année étaient capturés dans les montagnes et vendus sur les marchés
d’esclaves à Mora (1826 : 313)63. Dans sa relation de voyage, il écrit:
63 Selon Jeanne-François Vincent (1978 : 575-606), le chiffre avancé par Dixon Denham pourrait être exagéré, un avis aussi soutenu par Bawuro Barkindo (1989: 150) et par Scott MacEachern (1993: 254). Jeanna-Françoise Vincent fait en effet remarquer que le voyage de Dixon Denham de Borno à Mora était fait
121
By the assistance of a good telescope, I could discover those who, from the terms on which they were with Wandala, had the greatest dread, stealing off into the very heart of the mountains; while others came towards Mora, bearing leopard skins, honey, and slaves, plundered from a neighbouring town, as peace-offerings; also asses and goats, with which their mountains abound: these were not, however, on this occasion destined to suffer. The people of Musgow64, whose country it was at first reported (although without foundation) that the Arabs were to plunder, sent two hundred head of their fellow-creatures, besides other presents, to the sultan, with more than fifty horses (Denham, Clapperton et Oudney, 1826: 121).
Globalement, c’est l'islam qui a constitué le fondement de cette idéologie
esclavagiste. Les souverains se sont basés sur les interprétations du message coranique de
l’ « infidélité » pour justifier leurs expéditions en territoire païen. Le terme « infidèles »
qui, dans les faits, s’applique à ceux qui n’adoptent pas « la vraie religion», désignait aussi
dans la pratique ceux qui sont « réductibles en esclavage» (Saibou, 2005 : 854). En tant
qu’idéologie, l’islam a ainsi joué un rôle complexe et de premier plan dans la mesure où les
razzieurs, de même que les détenteurs d’esclaves, trouvaient en lui une justification des
pratiques esclavagistes (Klein, 1998 : 18). Comme le souligne fort bien Bogumil
Jewsiewicki, avoir été esclave en contexte musulman signifie en même temps avoir été un
non-croyant (2011 : 7).
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Montagnards du Mandara se faisaient
appelés par l’expression kirdi, un terme probablement dérivé de la langue bagirmi signifiant
à la fois « infidèle et non-musulman » (Saibou, 2005 : 855). Le terme était cependant aussi
en usage dans le Borno si l’on s’en tient à la relation de voyage du diplomate britannique
Dixon Denham qui rapporte que les populations des massifs Mandara étaient connues sous dans le cadre d’une expédition dirigée par des Arabes-Kanuri. Leur regard péjoratif sur les « païens » en tant qu' « esclaves » par nature pourrait avoir influencer Denham dans son estimation du nombre d’esclaves reçus par le sultan du Wandala le jour de son arrivée à Mora, dans la mesure où il fut pendant le long du voyage et de son séjour à Mora en compagnie des Kanuri.
64Jeanne-Françoise Vincent (1978 : 583) fait valoir que le territoire « musgow » mentionné par Denham ne se réfère pas au pays Mousgoum, mais plutôt au territoire mafa de Mozogo situé dans les monts Mandara. Ce point de vue est également partagé par Gerhard Muller-Kossak (2003 : 41-42), et par Scott MacEachern (1990 : 110-112).
122
le nom de kirdi entendu comme des « nègres qui n'ont jamais embrassé la foi musulmane »
(Denham, 1826: 145). Annette Van Andel, une autre Britannique ayant visité le Borno au
milieu du XIXe siècle, va dans le même sens en situant l’usage du terme dans le contexte
des raids menés par le Borno contre les infidèles. Pour elle, le mot kirdi désignait chez les
Bornouans « des peuples infidèles et primitifs susceptibles d’être transformés en esclaves
(Van Andel, 1998 [1853]: 36), une signification qui se rapproche du mot peul kado que
José Van Santen traduit à la fois par « non musulmans et non civilisés » (Van Santen,
1993 : 52). Cet auteur observe par exemple que l’expression « je me suis islamisé » signifie
en même temps « je me suis civilisé (Van Santen, 1993 : 52).
Ainsi, l'acquisition des esclaves au sein des populations montagnardes, qui devrait
être la conséquence de leur « infidélité », devint plutôt sa véritable finalité notamment avec
l’avènement du djihad peul au XIXe siècle. C’est d’ailleurs au nom du djihad que les raids
d'esclaves furent institutionnalisés en un système coercitif par les souverains musulmans
(Lovejoy, 2003) qui, à l’image du lamido Hamman Yadji de Madagali, en avaient fait un
facteur-clé pour la production et la distribution des esclaves (Van Santen, 1993 ; Van Beek,
1992) à travers l’Ouest africain.
2. Hamman Yadji de Madagali et l’économie de la violence (1902-1927) : regards sur son journal personnel
The … [northern districts of Madagali, Cubunawa. and Mubi] taken over by this province … are the most lawless, ill-governed places I have seen in Nigeria … Slave dealing and slave raiding are rampant … chiefs of minor importance were given rifles with which they were encouraged to attack the wretched pagans [who are] hiding like frightened monkeys on inaccessible hilltops … of course, everyone goes about fully armed: spears, shields, bows and arrows, clubs, etc. (Resident britannique à Yola en 1920, cité par Kirk-Greene, 1958: 84)
La ville de Madagali, aujourd’hui incorporée dans l’État de l’Adamawa au Nigéria,
a un passé unique pour avoir connu successivement trois administrations coloniales
différentes. D’abord, elle fut placée sous l’autorité allemande de 1902 à 1916, dates qui
correspondent respectivement à la prise de Mora par le commandant Hans Dominik, et à la
123
victoire des forces alliées sur les troupes allemandes au Cameroun (Van Beek, 2012; Weiss,
2000; Vaughan et Kirk-Greene, 1995). De 1916 à 1922, elle fut sous l’autorité coloniale
française et intégrée à la division administrative de Maroua. Entre 1922 à 1961 enfin,
Madagali revint aux Anglais grâce à un accord franco-britannique formalisé par la Société
des Nations (SDN) en 1922, et fut dès lors incorporé au sein de la Northern Cameroon
Province (Van Beek, 2012; Weiss, 2000; Vaughan et Kirk-Greene, 1995, Van Santen,
1993).
Dès les années 1809 à la fin des années 1920, les différents souverains de Madagali
ont fait de l’esclavage le principal pilier de leur économie, et de ce fait, ont régulièrement
fait allégeance au califat de Sokoto (Kirk-Greene, 1958: 60) qui constituait l’une des
destinations privilégiées des « esclaves domestiques »65 à cette période (Lovejoy, 1993;
1990; 1978). Devenu l’État le plus grand et le plus peuplé d’Afrique de l'Ouest au XIXe
siècle, la fondation du califat de Sokoto (I804-1808) a coïncidé avec le déclin des
exportations d’esclaves vers les Amériques, lesquelles ont été remplacées par la production
et la commercialisation des produits tels que le sel, les arachides, les produits de palme et
surtout les noix de cola (Klein et Lovejoy, 1979). Paul Lovejoy caractérise d’ailleurs le
déclin de la traite européenne et le développement du commerce intérieur comme le facteur
le plus important dans la rétention d’esclaves à l’intérieur de l’espace transsaharien et de
leur destination vers des activités internes, notamment le travail domestique, le
concubinage et les plantations (2002 : 262). C’est dans ce contexte global que les
souverains de Madagali, localité située à proximité des monts Mandara, ont mené des
attaques en territoire montagnard pour s’approvisionner en esclaves.
De tous les souverains de Madagali, Hamman Yaji est certainement celui qui a le
plus marqué la mémoire historique des Montagnards qui se souviennent de lui comme d’un
monstre ayant commis d’énormes atrocités (Van Beek, 1992 : 301; Kirk-Greene 1960 :
75)66. Ce dernier est arrivé au pouvoir en 1902 après l’assassinat de son père par le
65 Sur l’usage du concept de l’esclavage domestique, se référer entre autres à Claude Meillassoux (1986); Igor Kopytoff et Suzanne Miers (1977) et John Grâce (1975).
66 Un récit circule chez les Kapsiki associant Hamman Yadji à des pratiques anthropophages pour mettre en exergue sa prétendue cruauté. Voici le récit tel que rapporté par Vandu Zra Té à Wouter Van Beek: « Hamman Yadji est natif de Madagali, c’est là-bas qu’il est né. Il voulait absolument être chef de Madagali,
124
lieutenant allemand Hans Dominik, et régna jusqu'à sa déposition par les Britanniques en
1927 (Van Santen, 1993; Kirk-Greene, 1960 : 75). Pendant cette brève période, Hamman
Yadji a régulièrement organisé des invasions dans la partie méridionale des monts
Mandara, prenant, torturant et tuant hommes, femmes et animaux, et punissant les villages
qui résistaient à ses demandes d’esclaves (Kirk-Greene, 1960 : 75). Wouter Van Beek
rapporte par exemple les propos d’un de ses informateurs kapsiki, Vandu Zra Tè, connu
pour être l’une des rares personnes à s’exprimer sur les atrocités commises lors des raids
esclavagistes menés par Hamman Hadji :
He used people as money, Hamman Yaji. He asked a Fulbe woman for a pounding stick and paid with a slave. He bought a mat, and paid with a slave. To buy a calabash, or a stick, he paid with people. Even a jar with shikwedi [a crop for the sauce] he paid with a slave. That is what he did » (Vandu Zra Té cité par Van Beek, 2012: 301).
Redouté par les populations des montagnes, Hamman Hadji était également très
connu des colons qui ont parlé de lui comme d’un « tyran qui a conduit des raids
esclavagistes et opprimé les esclaves pendant plus d’un quart de siècle avec une cruauté
incroyable » (Kirk-Greene, 1969: 4). Si Hamann Hadji est présenté comme le prototype
même de la brutalité esclavagiste, il ne fut certainement pas le seul souverain peul à se
livrer à des incursions en territoire montagnard. Il n’est pour ainsi dire que la partie visible
de l’iceberg dans la mesure où ce genre de phénomène était une pratique courante dans la
région67. Cependant, Yadji s’est fait connaitre comme la figure emblématique de
mais a été longtemps empêché parce que son père n’était pas encore avancé en âge pour lui céder le trône. Son père lui dit: “Tu es encore petit, tu ne peux pas être chef”. Et Hamman Yadji de rétorquer: “qui a dit cela?”. Zubeiru” [nom donné à l’émir de Yola] répondit son père. Hamman Yadji partit l’instant d’après voir Zubeiru à Yola et lui dit: “Fais de moi un chef “. Celui-ci lui répondit: “Jamais, tu ne pourra être capable de régner”. “Je pourrais, répliqua Yadji, qu’est-ce que je peux faire pour mériter ta faveur?”. Alors Zubeiru lui dit: “Si tu peux, tu dois tuer ton père, prendre son cœur et son foie et les manger. Si tu peux faire cela, tu peux devenir chef”. Hamman Yadji sortit de là et rentra pour tuer son père – praw praw– il prit son cœur et son foie et les mangea. Alors le peuple lui donna la chefferie (Vandu Zra Té cité par Van Beek, 1992 : 303).
67 En effet, Hamman Yadji n’a pas été le seul souverain et n’a pas été le premier à avoir fait des razzias esclavagistes le principal pilier de son économie. Renate Lukas (1973), Heinrich Barth (1857 :195) et Dixon Denham (1826 : 197) ont tous rapporté que cette région fut un grand fournisseur d’esclaves au XIXe siècle et ce, en dépit de la protection qu’offrait le relief accidenté des monts Mandara contre la cavalerie des esclavagistes.
125
l’esclavage grâce à son journal personnel saisi par les colons britanniques au moment de
son arrestation en aout 1927. Rédigé entre le 16 septembre 1912 et le 25 aout 1927 par son
scribe-esclave Ajia, ce journal fait état de ses aventures dans et autour des monts Mandara,
comme illustrées dans les extraits suivants :
6-7-1913 On Saturday the 3rd of Mairordu Sumaye I sent my people to Sina and they captured 30 cattle and 6 slave girls. Between 2 and 27-2-1915 I raided Humumzi and captured 4 slave girls and 20 cattle. 29-9-1918 On Sunday 22nd of Laihadji Fahld al Mar raided Futu in the morning and captured 23 cattle, 22 gowns, 3 red fezzes and 15 goats. 7-5-1919 On Wednesday the 6th of Wirardu Sumaye I raided Sir with Lawan Aji of Gaur and we captured 8 slaves, 122 cattle and 200 sheep. 30-12-1919 I raided Wula and we captured 20 slaves. 15-5-1920 On Saturday the 25th of Wairordu Sumaye I sent Jauro Soji to raid the pagans of Gumshi. They took from them 70 slaves, 48 cattle and 90 goats68.
À la lecture complète du journal, il ressort qu’Hamman Hadji a mené 118 raids dans
64 localités différentes en seulement neuf années (1912-1920). Un peu plus de 2000
esclaves furent capturés et 168 autres tués lors des attaques. À ce nombre déjà
impressionnant s’ajoutent plus de 3500 bétails saisis par les razzieurs. Le graphique suivant
donne un aperçu général du nombre d’esclaves et de bétails (bœufs, chèvres et moutons)
pris ainsi que du nombre d’esclaves tués lors des raids tels qu’ils apparaissent dans le
mémoire personnel de Yadji.
68 Voir annexe 5.
126
Graphique 5 : Bilan des raids menés par Hamman Yadji entre 1912 et 1920 (Source : Journal d’Hamman Hadji)
Il convient toutefois de remarquer que les rapts ne constituaient pas l’unique
méthode d’approvisionnement en esclaves, car la prise se faisait aussi parfois de manière
indirecte par le truchement des Montagnards eux-mêmes. La menace de l'esclavage interne
était parfois plus redoutée, surtout pendant la période de grande famine des années 1920 au
cours de laquelle les Montagnards vendirent leurs propres parents et amis aux Peuls et aux
Wandala en échange des denrées alimentaires, du sel et du poisson (MacEachern, 1993;
Van Santen, 1993; Van Beek, 1992)69. Dans certains massifs situés au cœur des mont
Mandara comme ceux des Muktele, il était presqu’impossible pour les esclavagistes de
capturer directement les esclaves (Juillerat, 1971 : 16). Ils le faisaient indirectement par
l’intermédiaire des locaux en profitant des guerres interminables qui les opposaient
régulièrement. Hamman Yadji rapporte lui-même dans son journal la complicité des
Montagnards dans les pratiques esclavagistes à partir de 1922, comme cela est illustré par
les extraits suivants :
69 Sur les échanges commerciaux qui avaient cours dans le califat de Sokoto, voir entre autres Paul Lovejoy (2005; 1986, 1978).
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Bétail Ovinsetchèvres montagnardstués Esclaves
127
11-1922 On Tuesday the 17th of Haram Petel the pagans of Sina brought a woman of theirs to me, who they say stole from the people. 24-11-1925 On Tuesday the 8th of Banjaru Tumbindu the pagans of Kamale accused one of their men of being a ‘witch’ and they caught him and brought him to me. They wanted too to reap his corn, so I sent my horsemen to them.
Au regard du journal d’Hamman Yadji et des témoignages de Dixon Denham et
Heinrich Barth rapportés plus haut, il ressort que le nombre d’esclaves qui parvenaient dans
les cours des souverains peuls et wandala atteignait de très grandes proportions. Jacques
Lestringant (1964) affirme que c’était le seul commerce véritablement florissant dans la
région au XIX et au début du XXe siècle. Antoinette Hallaire estime également que près de
la moitié de la population du Wandala était essentiellement constituée d'esclaves (1965 :
58). Il faut ajouter à cela les dons de diverses natures régulièrement attribués aux
souverains musulmans par les Montagnards pour acheter la paix sur leurs territoires
(MacEachern, 1993 : 256 ; Van Beek, 1992: 309; Vincent, 1978: 583). La question centrale
qui émerge de ces considérations est celle de savoir à quoi et vers où étaient destinés ces
esclaves ? Le journal d’Hamman Yadji70 et l’histoire orale des populations des monts
Mandara ne fournissent que peu de détails pour pouvoir répondre à cette question.
Néanmoins, les travaux de Paul Lovejoy (2005 ; 2002 ; 1993 ; 1990 ; 1988 ; 1979 ; 1978b)
sur les échanges commerciaux et les pratiques esclavagistes dans le califat de Sokoto
duquel dépendait Madagali et la plupart des lamidats du Nord-Cameroun, offrent quelques
indices utiles.
70 Il est vrai que Yadji mentionne occasionnellement la vente d’esclaves et leurs prix : « 25/2/1917: I received 50 shillings and two gowns for a slave girl. Sometimes the villagers ransomed their women back (36 shillings, 7/11/1914), but most slave women were given away (21 & 22/2/1919). For ‘slaves’ – presumably men – there is the case of 6 slaves returned to Sena (a Higi village, 23/7/1913). Voir annexe 5 pour plus de détails.
128
Carte 3 : Califat de Sokoto et les régions environnantes (Source : MacEachern, 1993 : 255)
Comme la plupart des émirats musulmans, le califat de Sokoto était en grande partie
alimenté par les esclaves que lui livraient des chefs musulmans placés sous sa tutelle. Selon
Paul Lovejoy (2002 ; 1988 ; 1978), les hommes étaient en grande partie destinés à servir
dans la cour royale en tant que domestiques, mais surtout dans l’armée et les plantations.
Les femmes esclaves étaient quant à elles destinées au concubinage et à la fabrication des
produits comestibles et textiles, deux éléments essentiels de l’économie locale au XIX et
XXe siècles. Le véritable problème que le califat rencontrait était que la population servile
ne se reproduisait pas d’une part, parce que les esclaves travaillant dans les plantations
semblaient réticents à se reproduire (Lovejoy, 2002) et d’autre part, parce que les principes
musulmans fournissaient un mécanisme d’intégration d’esclaves par le biais du rachat et du
concubinage (Lovejoy, 2002). Aussi, les esclaves diminuaient naturellement en nombre,
d’autant plus que ceux destinés à l’armée et aux harems royaux étaient castrés. Le califat de
129
Sokoto était d’ailleurs réputé pour être un centre prisé de « fabrication » et de distribution
des eunuques (Adam, 2008 : 15). Or, l’économie de plantation et l’industrie textile ont
besoin d’un renouvellement constant de la main d’œuvre. Dans cette logique, le «mode de
production esclavagiste » (Meillassoux, 1978) ne pouvait se faire que par la voie
d'asservissement continu d’hommes et de femmes et de leur répartition aux diverses
activités à mesure qu’ils parvenaient à la cour royale à Sokoto (Lovejoy, 2002 : 258).
En prenant en compte ce contexte global qui caractérisait la production d’esclaves
dans le califat de Sokoto de la fin du XIXe au début du XXe siècle, il est possible qu’une
bonne partie d’esclaves montagnards capturés par les souverains peuls aient pris la
direction de Sokoto. Selon les estimations de Paul Lovejoy, l’État historique de
l’Adamawa, qui comprenait aussi tout le Nord-Cameroun, exportait environ 5000 esclaves
par an vers le centre de Sokoto au moment de l'effondrement du commerce transatlantique,
dont la grande majorité furent des femmes71. De fait, les femmes étaient beaucoup plus
recherchées que les hommes (Lovejoy et Richardson, 1995; Cooper, 1994: 64). Le journal
d’Hamman Hadji confirme cette hypothèse, dans la mesure où il avait tendance à
surévaluer les esclaves de sexe féminin.
Dans cette avenue, les prix d’esclaves féminins sur les marchés étaient de loin
supérieurs à ceux d’esclaves masculins (Lovejoy et Richardson, 1995 : 270-278). Par
exemple, Bernard Juillerat rapporte qu’au début du XXe siècle, les prix pratiqués sur le
marché d’esclaves à Mora étaient de vingt boubous de coton pour une jeune fille, douze à
dix-sept boubous pour un jeune homme, et sept boubous pour un homme déjà avancé en
âge (Juillerat, 1971 : 16). Le coût élevé des jeunes filles s’explique par le fait qu’elles
étaient les plus recherchées, car destinées au concubinage qui, de l’avis de Paul Lovejoy
(1988 : 257) constituait en même temps une stratégie d’intégration et d’acculturation des
esclaves au sein des empires musulmans d’Afrique de l’Ouest. C’est d’ailleurs ce
mécanisme d’intégration qui emmena Heinrich Barth à suggérer que l’esclavage tel qu’il se
pratiquait à Borno et dans le califat de Sokoto n’offensait que très peu l'esprit humain car, 71Tout le contraire dans le commerce transatlantique dont la tendance générale était la préférence aux esclaves hommes au détriment des esclaves femmes. Pour la discussion sur le rapport de genre et les prix différentiels pratiqués entre les commerces transatlantique et transsaharien, voir entre autres Paul Lovejoy et David Richardson (1995); Claire Robertson et Martin Klein (1983); Martin Klein et Paul Lovejoy (1979).
130
écrit-il, « l'esclave était généralement bien traité, n’était pas surchargé par le travail, et était
très souvent considéré comme un membre de la famille (Barth, 1965)72.
Quoique certains esclaves aient joui d’un statut enviable, notamment dans l’armée
et le concubinage, Paul Lovejoy attire l’attention sur le fait qu’ils ne furent pas moins situés
au bas de l’échelle sociale, étant donné les violences perpétrées à leur égard et surtout un
strict contrôle de leurs mouvements (Lovejoy, 1981). Autrement dit, leur condition a
toujours été extrêmement précaire et « radicalement incertaine » (Shaw, 1998 : 3-74). La
crise la plus évidente fut cependant d’ordre identitaire, laquelle a d’ailleurs conduit à la
mise en place des mécanismes de refoulement ou de (ré)aménagements symboliques
(Létourneau et Jewsiewicki, 2003 : 8) du passé servile, qui à travers les mythes et les
chants, favorisent la construction d’une mémoire alternative plus utile et plus convenable
(Chétima et Gaimatakwon, 2015).
B. Refoulement et transmission symbolique de la mémoire servile dans les traditions orales
Les recherches sur l'histoire orale en Afrique (Thioub, 2007; Konaté, 2007; Dibwé,
2006; Law, 2003; Willis, 1993; Perrot, 1993; Vansina, 1961) se sont globalement nourries à
deux types de sources, à savoir d’un côté les traditions orales, et de l’autre les témoignages
oraux73. Les traditions orales peuvent être définies comme des récits oraux qui se
rapportent au passé d’un groupe donné en remontant aussi loin que possible dans le temps,
et qui sont transmis d’une génération à l’autre (Vansina, 1961). Elles peuvent prendre la
forme d’un mythe, d’un chant, d’une légende ou d’un proverbe, et sont formellement
conservées sous des formes plus ou moins fixes et plus ou moins invariables (Salau, 2011 :
126). Autrement, il n’y a de traditions orales que lorsqu’il y a transmission d’un récit d’une
72 Cette idée sera reprise par des chercheurs qui, à l’instar d’Igor Kopytoff et Suzanne Miers (1977) ou encore de Polly Hill (1977 : 209; 1976 : 407), portèrent au compte de l’esclavage domestique un certain nombre d’avantages, notamment l’idée que les esclaves aient été bien traités par leurs maitres (Hill, 1970 : 209). Cependant, des critiques plus récentes (Miller, 2012; Lovejoy, 2002; Eltis, 1999; Inikori et Stanley, 1992) remettent en question ce point de vue. Paul Lovejoy soutient que l’esclavage domestique dans le califat de Sokoto, bien qu’il ait manifesté des traits de bienfaisance, fût aussi marqué par la violence et la brutalité, exprimées lors de la capture aussi bien que lors des prestations de service chez leurs maitres (1981 : 201-243).
73 La différence entre ces deux aspects de la tradition orale est amplement détaillée dans l’ouvrage de Jan Vansina intitulé De la tradition orale. Essai de méthode historique, publié en 1961.
131
génération à une autre. Elles font de ce fait partie de la « mémoire collective » du groupe, et
servent de fonction de légitimation (Klein, 1988 : 209). En revanche, les témoignages oraux
sont des données qui sont recueillies au moyen d’entrevues auprès des informateurs pour
avoir une idée sur leurs expériences en tant que participants, témoins oculaires ou non d’un
fait donné (Vansina, 1961). Ils sont, comme l’écrit Martin Klein (1988), largement
tributaires des gens qui les rapportent et ne sont dès lors pas conservés et transmis de
manière formelle, comme c’est le cas avec les traditions orales.
Traditions orales et témoignages oraux sont tous deux indispensables pour la
reconstruction de l'histoire des « peuples sans histoire » (Klein, 1988) et des individus
situés au bas de l’échelle sociale à l’intérieur d’un groupe donné (Salau, 2011). La
scientificité d’une histoire écrite sur la base des sources orales avait pourtant été remise en
cause au vu de nombreux écueils qu’elles présentent, notamment leur caractère fluide et
fragile74. Même les auteurs qui reconnaissent la validité de l’oralité comme matériau
indispensable à la reconstitution du passé ne nient pas l’existence de certains facteurs
pouvant la rendre malléable. Claude-Hélène Perrot (1985) s’est penché sur deux de ces
facteurs à savoir : le poids des intérêts à défendre dans le présent qui oriente par moment le
contenu des récits historiques et le travail de la mémoire qui rejette certains matériaux et
ajoute des significations nouvelles à d’autres.
Ces deux facteurs sont surtout présents au sein des groupes d’ascendance servile,
comme ceux vivant dans les monts Mandara, dans lesquelles certaines références liées à
l’histoire servile sont simplement mises sous silence dans les traditions historiques
d’origine lesquelles véhiculent plutôt des récits de nature mythique. Cette partie traite de
tels enjeux en mettant essentiellement l'accent sur quelques traditions historiques (mythes
74 Des auteurs, à l’instar de Hegel, en sont d’ailleurs venus à nier l’historicité de l’Afrique ; l’histoire n’étant alors réservée qu’aux nations possédant l’écriture. Dans son ouvrage intitulé La raison dans l’histoire, Hegel écrivait : « L’Afrique n’est pas une partie historique du monde. Elle n’a pas de mouvements, de développements à montrer en elle […]. Ce que nous entendons par l’Afrique est l’esprit ahistorique, l’esprit non développé, encore enveloppé dans des conditions de naturel et qui doit être présenté ici seulement comme au seuil de l’histoire du monde (1965 [1822] : 269).
132
d’origine et chants) relatives à l’installation des groupes humains dans les monts Mandara
et à la servilité. La façon dont la mémoire servile apparait dans les mythes est différente de
la façon dont elle est traitée à travers les chants historiques : dans les mythes, elle joue sur
le thème du refoulement et de l’occultation alors que dans les chants, elle est reconstruite
autour des luttes identitaires chez les esclaves dans leurs communautés d’accueil.
1. Traditions historiques et fabrication des mythes d’origine : une stratégie de « mise à mort » de l’histoire servile ?
When nations, societies, agents of memory or other individuals wish to remember and make others remember, they often turn to total silence. That silence, however, is not unbounded, nor does it rest in a vacuum. On the contrary, the silence is intentional, purposive and planned in advanced, and its raison d'être is commemoration (Vinitzky-Seroussi et Teeger, 2010:1008).
De manière générale, on remarque que les traditions historiques mentionnent
rarement le contexte d’insécurité comme la raison de la migration et de l’installation des
populations dans les massifs. Par exemple, les récits d’origine et de migration que j'ai
recueillis chez les Podokwo jouent sur le thème de la recherche d’un taureau égaré et
retrouvé dans les monts Mandara. La version « officielle » du récit chez les Podokwo de
Tala-Dabara est la suivante :
À l’origine du monde, tous les peuples de la terre vivaient aux environs d’une mer appelée Parlama75. Un jour, la région fut frappée par une sécheresse qui entraîna la mort des animaux et des hommes, et on ne pouvait plus pratiquer l’élevage et l’agriculture. À cette même période, les hommes commencèrent à se faire la guerre. C’est ainsi que Nabi Ngurtu, notre ancêtre, entreprit un long déplacement pour s’installer dans la montagne de Waza. Un jour, un homme sema une graine de calebassier derrière sa concession. Après avoir germé, il crût rapidement et sa liane atteignit les massifs76. Il produisit une calebasse au bord d’un point d’eau appelée uzle huma. La même année, un bœuf s’échappe de Waza, et suivant l’itinéraire de la liane, arrive au bord de la source uzle huma. Trois enfants furent envoyés de Waza à sa recherche. Guidés par la
75Selon la description que font les informateurs de la situation géographique de la mer parlama, on pourrait l’identifier au lac Tchad.
76Allusion est faite ici aux monts Mandara, situés à plus d’une soixantaine de kilomètres de la localité de Waza où la calebasse a été plantée.
133
liane et les excréments du taureau perdu, ceux-ci réussirent à le retrouver couché à côté de la calebasse. Ils envoyèrent l’un d’eux à Waza pour en parler aux anciens. Ceux-ci dirent alors : « Les dieux nous ont trouvé un nouveau site. Partons d’ici et allons au lieu qu’ils ont choisi pour nous abriter». C’est ainsi qu’ils entreprirent la longue migration qui les conduisit jusque dans les massifs.
Un mythe d’origine recueilli chez les Muktele de Zuelva par Bertrand Juillerat rejoint
étrangement celui des Podokwo. Voici le mythe :
Avant de s’établir à Zuelva, les Makdaf étaient à Waza. Là-bas, il y a longtemps, une femme makdaf avait douze fils, six beaux et six laids. Elle préférait les six premiers. Un jour que le père se sentit mourir, il demanda à sa femme d’appeler ses douze fils à son chevet. Pensant que son mari allait leur donner de lourdes besognes, la femme ordonna à ses six favoris d’aller se cacher en brousse. « Où sont mes six autres fils ?» demanda le père. « Ils sont allés se cacher dans la brousse et ne veulent pas venir », dit la femme. Le père mourut en ayant transmis sa volonté seulement aux enfants laids. La femme alla alors rejoindre ses autres fils et, prétendant que leur père voulait les faire travailler, leur demanda de quitter le pays. « Je vais planter ici une calebasse, dit-elle, elle va vous montrer le chemin que vous devez prendre ». La calebasse crût en une seule journée et les enfants suivirent la liane ; la plante avançait devant eux et leur montrait le chemin. Arrivés au massif de Mora77, les six fils trouvèrent une calebasse le long de la liane : elle contenait des métaux précieux et fut partagée en six parts. À Udjila, ils en trouvèrent une semblable à la première. Ils continuèrent de suivre la calebasse qui avançait comme un serpent devant eux. Arrivés à Zuelva, ils virent soudain trois grosses pierres qui roulaient dans leur direction. Elles s’arrêtèrent devant eux leur barrant le passage. À cet endroit une nouvelle calebasse poussa devant les frères ; ils la partagèrent. Les six hommes pensèrent s’arrêter là, mais la calebasse repartit et les mena jusqu’à Angwal (vallée des Muktele) où ils se partagèrent encore une calebasse qui poussa devant eux. Après cela, ils regardèrent si la liane allait encore repartir ; mais elle n’avança plus. « Voici l’endroit où nous devons nous installer », dirent les frères. Ils commencèrent à construire de petites cases (Juillerat, 1971 : 64).
Même si ces deux récits prétendent expliquer l’origine, le processus migratoire et
l’installation des Podokwo et des Muktele dans les monts Mandara, c’est davantage leur
dimension mythique qui est véhiculée au détriment de la réalité historique. Être venu depuis
le rocher de Waza à la suite d’une calebasse supposée avoir passé ses rameaux jusqu’à
fructifier à soixante kilomètres de ses racines ne peut en effet que relever d’un mythe.
Celui-ci ne mentionne aucunement l’insécurité comme l’origine des migrations. Mais pour
authentifier leur récit, les Muktele organisent annuellement des cultes dédiés aux ancêtres
77Le « massif de Mora » qui figure dans ce récit désigne le site d’implantation du groupe ethnique Mura. Il surplombe la ville historique de Mora qui fut en même temps la capitale du royaume du Wandala.
134
et centrés autour de la calebasse. En raison de l’origine mythique et divine de la calebasse
dans le récit migratoire des Muktele, elle tient un rôle important dans les rites pour les
jumeaux car ces derniers sont vus comme les descendants directs du monde divin, et par
conséquent sont à la fois des mi-humains et des mi-dieux. Tout comme la calebasse, les
jumeaux possèdent une puissance surnaturelle qu’il faut craindre si les règles des rites qui
leur sont associés n’étaient pas respectées78.
Les Podokwo, quant à eux, se réfèrent à la bouse annuellement appliquée sur les
parois des cases et greniers, et aux mâchoires de bœufs superposées à l’entrée de chaque
concession pour authentifier leur mythe. Il s’agit, selon Bassaka Kuma: « de remercier les
dieux de s’être incarnés dans le taureau pour nous conduire dans les massifs » (entretien
avec Bassaka Kuma, homme de 70 ans, le 27 mai 2007, à Udjila). Ils se réfèrent également
aux endroits évoqués dans le récit qui correspondent effectivement aux toponymes actuels.
Si le mythe mentionne la guerre comme l’une des causes de départ, aucune référence n’est
faite des dangers que représentaient les royaumes du Kanem, du Borno et du Wandala.
Certains informateurs podokwo admettent par contre que leur récit d’origine est une
légende imagée, « une parabole de la fuite devant des royaumes beaucoup plus puissants»
(entretien avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 16 mars 2010, à Godigong). D'autres
vont jusqu’à postuler que la non-référence à l’histoire servile est un oubli délibéré et
planifié par les générations antérieures, parce que délicate pour être transmise : « si les
traditions orales ne disent pas grand-chose sur l’esclavage, nous savons au moins que les
temps étaient durs à l’époque de nos parents », affirme Mezhəne, (entretien, homme de 35
ans, le 27 mai 2007, à Udjila).
Le récit d’origine et de migration muktele cité plus haut se rapproche de celui
recueilli chez les Mofu-Gudur par Liliane Sorin-Barreteau :
Autrefois, la terre ne formait qu’une vaste étendue d’eau. Lorsque Dieu créa le premier homme et l’a jeté sur la terre, il s’est noyé. Alors Dieu a décidé de faire pousser les plantes sur l’eau, puis il a envoyé un caméléon pour tester le nouvel environnement. Le caméléon ne se tenait que sur les herbes. Dieu a
78 José Van Santen mentionne également l’importance de la calebasse dans les rites pour jumeaux chez les Mafa (Voir José Van Santen, 1993: 176).
135
alors décidé de jeter les montagnes. Les montagnes ont bu l’eau, mais il en est resté un peu. Après cette dernière action, la terre se présentait comme elle est aujourd’hui, c’est-à-dire de la terre, des montagnes, des arbres et de l’eau. Dieu a de nouveau jeté deux personnes (un homme et une femme) dans ce nouvel environnement. Ce couple a eu sept garçons. Devenus grands, le père a voulu les circoncire, mais la femme s’y opposait de peur de voir mourir ses enfants. Néanmoins, elle a envoyé trois enfants vers le père pour la circoncision et elle en a gardé quatre. L’homme a circoncis les trois enfants et a demandé à la femme pourquoi elle n’a pas envoyé les quatre autres. La femme a prétexté qu’elle ne savait où ils étaient, mais l’homme savait qu’elle les préférait. L’ainé faisait partie des enfants non circoncis. Sentant sa mort prochaine, le père a réuni ses enfants pour leur distribuer ses biens comme héritage. Ces biens étaient constitués d’un taureau, d’une vache, d’une faucille, deux haches, d’une machette, d’une houe, du mil rouge, du mil jaune et du sorgho. Les deux groupes d’enfants – circoncis et incirconcis – étaient là. Le groupe des non-circoncis auquel appartenait le fils ainé eut le taureau, la houe, la hache, la faucille, du mil jaune et du mil rouge. Les circoncis eurent la vache, la machette, la hache, du sorgho et du mil rouge. Les deux groupes se sont également réparti l’habitat. Les non-circoncis obtiennent la maison en montagne et les circoncis obtiennent la maison en plaine. L’ainé des circoncis a semé son sorgho en saison pluvieuse et cela n’a pas poussé. L’ainé des non-circoncis a tué son taureau tandis que la vache des circoncis leur a donné troupeau (Sorin-Barreteau, 1996 : 15).
Ce récit vise à retracer l’origine des Mofu et à expliquer leur situation actuelle
(habitat en montagne, agriculture, sacrifice des taureaux, incirconcision, etc.). Par ce mythe,
les Mofu enseignaient à leurs descendants les différences fondamentales entre animistes de
la montagne et musulmans de la plaine. Les premiers sont des non-circoncis et les seconds
des circoncis. Les premiers sont des éleveurs et ont d’immenses troupeaux de bœufs alors
que les seconds sont d’excellents agriculteurs. Le récit fait également allusion à un taureau
que les Mofu ont eu en héritage et qui a été sacrifié par le fils ainé. Les Mofu établissent
très souvent un parallèle avec le sacrifice des taureaux encore en vigueur dans certains
clans. Cependant, le récit ne fait aucune allusion aux véritables raisons qui ont conduit les
Mofu dans les massifs du Mandara, ni aux rapports conflictuels avec les empires
musulmans de la plaine.
136
En revanche, il existe un détail important qui échappe parfois à la vigilance des non-
initiés au langage symbolique mofu : c’est la répartition des chiffres entre hommes et
femmes. Le mythe précise que la femme a gardé quatre enfants et a renvoyé les trois autres
à l’homme pour la circoncision. Dans le langage symbolique des Mofu, le chiffre impair est
toujours associé à l’homme et le chiffre pair associé à la femme. De ce fait, les peuples de
la plaine (les conquérants musulmans) sont identifiés à l’homme tandis que les « gens de la
montagne » sont identifiés à la femme. Le chiffre trois symbolise la force et le pouvoir. En
revanche, le chiffre quatre traduit l’idée de vaincu et de dominé79. Le mythe évoque dès
lors de façon allégorique le statut de « vaincus », de « dominés» et de « victimes » que
certains clans mofu ont connu dans leurs rapports avec les « grands » de la plaine. On se
trouve donc devant un dilemme marqué à la fois par la volonté d’oublier et par le devoir de
transmettre la mémoire servile. Dans ce contexte, le refoulement émerge comme une autre
forme de mémoire dont l’objectif est la «rupture, non pas avec le passé servile, mais avec la
conscience de ce passé. On pourrait, dès lors, considérer ces deux récits - et d’autres
semblables - comme une stratégie d’occultation de la mémoire de l’esclavage et de la fuite
devant les envahisseurs.
De nombreux chercheurs membres de l’Office de la recherche scientifique et
technique outre-mer (ORSTOM) devenu par la suite l’Institut de recherche pour le
développement (IRD) ont également recueilli des récits d’implantations dans d’autres
ethnies. Ils sont arrivés au même constat à savoir, l’absence des données relatives à la
mémoire de l’esclavage. Jean Boutrais remarque que la plupart des traditions orales situent
les origines des peuples montagnards au nord-est, c’est-à-dire, dans une direction qui
suggère les empires péri-tchadiens (Boutrais, 1973). Cependant, précise-t-il, aucun autre
détail n’est donné quant à la véritable raison de départ. En considérant les mythes d’origine
qu’il a recueillis dans certaines ethnies des monts Mandara, Alain Marliac arrive à la même
conclusion, et souligne que « le processus s’étale sur plusieurs siècles sans qu’il ne soit
79Il ne faudrait tout de même pas généraliser l’explication des symboles liés aux chiffres à toutes les ethnies montagnardes. Chez les Mafa par exemple, les chiffres pairs et impairs n’ont pas la même signification que chez les Mofu. Bien qu’associés à la femme, les chiffres pairs traduisent l’idée du sacré et de la régularité alors que les chiffres impairs associés à l’homme traduisent l’irrégularité. Par conséquent, le symbole des chiffres met en exergue l’importance du sexe féminin chez les Mafa. Chez les Podokwo, Muktele, Uldeme et Mura, le symbole des chiffres est proche de celui qui a cours dans la société mofu. Pour plus de précisions, voir les analyses de Van Santen (1993 : 167).
137
toujours fait mention pour l’expliquer de la pression des empires péri-tchadiens » (1991 :
57). Les mythes parlent au contraire des dissensions entre frères, de l’appauvrissement des
cultures, de recherche du gibier perdu comme cause de départ80. Quant à Bertrand
Lembezat, il rapporte dans son essai de reconstitution des traditions orales que, sur le
massif urzal, un groupe se souvient d’ancêtres venus du nord-est, qui utilisaient des poteries
épaisses et grandes. Cependant, aucune autre explication n’est donnée sur les raisons de
départ (Lembezat, 1961 : 15). Dans d’autres clans montagnards, les récits d’origine jouent
formellement sur le thème de l’absence de mémoire. Ils ignorent simplement la migration
et se déclarent résolument autochtones. C’est le cas par exemple du clan uzlama. « Nous
n’avons jamais été ailleurs qu’ici » déclare Gigla Kamba (entretien avec homme de 60 ans,
le 22 avril 2005, à Uzlama). « Notre origine est dans cette montagne. Nous sommes sortis
de la boue sous forme des chenilles et nous nous sommes transformés par la suite en des
hommes», renchérit Dugdje Duluva (entretien, homme de 58 ans, le 22 avril 2005, à
Uzlama).
Au demeurant, on constate qu’en lieu et place de la mémoire de l’esclavage, c’est
plutôt l’oubli qui semble constituer la véritable histoire des peuples habitant les monts
Mandara. Faut-il hâtivement conclure qu’ils ont réellement oublié leur passé servile ? C’est
ce que postule par exemple Yves Urvoy qui, en se basant sur le cas des Marghi, soutient
qu’ils n’ont aucun souvenir de leur migration ancienne (1949). C’est aussi le postulat que
semble défendre Martin Klein qui, dans une étude sur l’esclavage au Soudan occidental,
écrit que les communautés d’ascendance servile ont du mal à retracer leur origine servile
(1988 : 212)81. Tout en reconnaissant le silence des traditions orales sur le mode de
80 Il convient ici de relativiser et de préciser que l’origine des migrations n’est pas toujours la menace des raids esclavagistes de la part des États islamisés de l’époque. Si elle constitue la principale cause, d’autres événements s’y sont greffés, notamment la sécheresse, la famine, les dissensions entre les frères, etc. Cependant, les récits d’origine dans leur grande majorité évoquent toutes les autres raisons, mais choisissent délibérément d’occulter la menace que représentaient les grands royaumes péri-tchadiens comme raison d’occupation des massifs du Mandara.
81 Pour justifier cette affirmation, Martin Klein (1988) cite aussi les difficultés que Richard Roberts (1987) a rencontrées dans sa quête de personnes-ressources pouvant le renseigner sur la thématique de l’esclavage. De toutes les entrevues qu’il a réalisées chez les Marakana (environ soixante-dix informateurs consultés), une communauté pourtant d’ascendance servile, seulement deux informateurs se sont prononcés sur le sujet en ne fournissant que de très courtes interviews sur des généralités (Roberts, 1976-1984). À la suite de ces observations, Martin Klein (1988) conclut que le passage sous silence de la mémoire de l’esclavage dans les traditions orales, ne relève pas d’une simple réticence des informateurs. Il a davantage trait à leurs expériences
138
production esclavagiste (captures, commercialisation, expériences de vie d’esclaves
retournés), il est plausible de parler de refoulement plutôt que d’oubli, dans la mesure où ce
silence est parfois utilisé comme un moyen de transmettre autrement la mémoire servile
(Salau, 2011 : 142). Dans ce sens, les mythes d’origine présentés ci-dessus fonctionnent
comme des espaces sociaux, complexes aussi bien que riches, destinés à créer une sorte de
« trou noir » dans la mémoire (Jewsiewicki, 2011 : 4), pour recueillir, absorber et avaler les
souvenirs de l’esclavage. En tant que tels, les mythes révèlent un double héritage à savoir:
d’une part, la réalité d’avoir été esclaves et d'autre part, le fait d’avoir oublié et effacé les
souvenirs liés à cette servilité (Jewsiewicki, 2011: 5). L’examen des chants historiques
relatifs à l’esclavage permet davantage de confirmer cette hypothèse.
2. Chants et construction d’une mémoire alternative
Contrairement aux mythes d’origine qui affichent une amnésie stratégique, les
chants historiques se font plus explicites dans l’évocation de la mémoire de l'esclavage. La
plupart de ces chansons ont survécu dans le cadre de contes et proverbes qui sont encore
racontés dans les montagnes, et grâce auxquels les vieillards transmettent aux jeunes
certaines traces du passé (Chétima et Gaimatakwon, 2015). Les deux chants ont été
différemment enregistrés par Alexandre Gaimatakwon dans deux villages mafa : le premier
a été enregistré à la suite d’une entrevue avec Yakadam Matakone le 20 juin 2007 à
Mozogo, et le deuxième au cours d'une entrevue avec Douka Matakone le 21 juin 2007 à
Moskota82. Pour mieux saisir la portée de ces chants, il convient de les présenter
distinctement, à la fois dans leur version transcrite et traduite, et de préciser par la suite le
contexte de leur élaboration.
Le premier chant est contenu dans un conte mettant en scène les Wandala et une
esclave mafa. Selon le conte, celle-ci avait été capturée par les Wandala au cours d’une
en tant qu’esclaves, lesquelles les ont dépouillés de leur capacité à parler en leurs noms propres et de conserver des traditions historiques évoquant la servilité au sein de leur communauté.
82Pour une analyse de ces deux chants en lien avec la transmission symbolique de la mémoire servile, voir le chapitre d’ouvrage que j’ai co-écrit avec Alexandre Gaimatakwon sous le titre : « Re-appropriating the Repressive Past through. Memories of Slavery in the Mandara Mountains», dans Paul Lovejoy, Vanessa Oliveira and Maria Velazquez (dirs.), Slavery, Memory, Citizenship. African, Trenton, African World Press, ouvrage sous presse.
139
incursion dans la montagne pendant la période de l’esclavage. Durant sa captivité, elle
chantait et dansait sous les regards admirateurs de ses maîtres. Une fois, alors qu’elle
chantait le premier chant, elle se mit à danser comme d’habitude, mais cette fois en
s’éloignant progressivement de ses maîtres au point de s’enfuir. Autrement dit, elle est
arrivée à tromper la vigilance de ses ravisseurs par ses chants et ses danses. Voici le chant
et sa transcription :
Premier chant
Transcriptions Va gadana dem mamga te gi Mblevmè
(Allez dire fille mère dans maison Mblevmè) Civèd n’dè wandala a ldakda may gèd
(Chemin allant wandala perd ma tête) Va gadata wandalahi a ta n’fiyè ndeva’a (Allez dire wandala qu’ils mettent moi milieu)
- Ldau a ked yè (Peur tue moi)
Traduction
-Dites à ma sœur qui est chez Mblevmé -Que le chemin qui mène chez les Wandala me perd la tête
-Dites aux Wandala qu’ils me placent au milieu J’ai peur.
À considérer le chant, on a l’impression que le public auquel la jeune esclave
s’adresse est constitué uniquement des Wandala. Cela paraît tout de même absurde
puisqu’il est évident que la chanteuse essaie de faire passer son message par l’entremise
d’autres personnes. En effet, le premier et le troisième vers commencent par des injonctions
« Dites » ou « Allez dire ». Si l’identité des porteurs du message n’est pas connue, on peut
déduire que la fille s’adresse à plusieurs personnes à la fois puisqu’elle utilise les pluriels
Va gadana et Va gadata plutôt que les singuliers respectifs gadana et gadata. La teneur du
message est brève et concise : « Dites […] que le chemin qui mène chez les Wandala me
fait perdre la tête ». Par ce conte, la société mafa exprimait, de manière voilée la peur de
l’assimilation à laquelle les esclaves faisaient face dans leur société d’accueil
140
essentiellement dominée par la culture islamique. Les raisons de cette peur sont contenues
dans les vers suivants : « Dites aux Wandala qu’ils me placent au milieu […]. J’ai peur! ».
Le terme milieu doit être expliqué. Selon Gaimatakwon (2007), il ne désigne pas un
milieu géographique au sens propre du terme, mais plutôt une sphère située entre deux
civilisations différentes : la civilisation montagnarde d’une part, et celle des Wandala
d’autre part. Par ces mots, la jeune esclave formule un vœu à l’endroit de ses maîtres. Elle
leur demande de lui permettre de rester esclave sans pour autant l’obliger à devenir comme
eux, c’est-à-dire à devenir musulmane. Une traduction plus conceptuelle de ce chant faite
donne donc ceci :
- Dites à ma sœur qui est chez Mblevmè -Qu’être comme les Wandala m’est difficile
-Dites aux Wandala que je sois juste leur esclave -Sans devenir musulmane
-J’ai peur!
Il y a donc un rapport étroit entre ce chant et le contexte d’insécurité qui a prévalu
dans la région du bassin tchadien aux siècles précédents. En mettant l’accent sur les crises
identitaires que les esclaves éprouvaient dans leurs sociétés d’accueil, le chant rejoint à
première vue les idées d’Orlando Patterson (1982) qui, à travers son concept de mort
sociale (social death), soutient que l’esclavage n’a pas seulement arraché les esclaves à leur
communauté d'origine, mais les a aussi plongés dans l’avilissement, l’humiliation et dans
une souffrance sans nom. Autrement dit, ils étaient doublement orphelins car après avoir
été arrachés à leurs groupes d’origine, les esclaves n’ont pas eu une vie normale dans leurs
nouvelles communautés où ils vivent davantage comme des « zombies sociaux, c’est-à-dire
des « morts-vivants » (Patterson, 1982). Dans cette avenue, la condition d’esclaves ne se
limite pas seulement à l’assimilation, mais aussi intègre la peur, le déshonneur et la crise
identitaire : « dites à ma sœur… qu’être comme les Wandala m’est difficile […]. J’ai
peur ». Finalement, le message que la société mafa semble vouloir faire passer aux jeunes
est que le fait d’intégrer la communauté des esclavagistes est plus épouvantable que la
condition même d’esclave : « Dites aux Wandala que je sois juste leur esclave, sans devenir
musulmane ». Des pareils chants ont sans doute contribué au renforcement de l’identité
141
montagnarde, signifiant pour les populations : « résistance à l’assimilation ». Ainsi, bien
que se référant à la servilité, le premier chant contourne l’aspect avilissant de l’esclavage
pour mettre davantage l'accent sur son aspect purement identitaire.
Le second chant s’inscrit dans la même logique et exprime clairement en des
termes assez impudiques l’arrivée des Wandala. Le mot "déjà" employé dès le premier vers
ne signifie pas que cette arrivée était la bienvenue comme si elle constituait un avènement
longtemps attendu. Il exprime plutôt le début d’une rencontre éprouvante pour les
Montagnards. Les esclavagistes venaient à la recherche des personnes qui erraient çà et là
dans les montagnes, en particulier des femmes à la recherche d’eau ou encore des jeunes à
la recherche d’herbe pour le bétail (MacEachern, 1991 : 79). Voici la version transcrite et
traduite du chant :
Deuxième chant
Transcription Wandalahi ta kalka ma
(Les Wandala ils venus déjà) Wun tuda ta kalka ma
(Pénis dehors ils venus déjà) N’sundololo wun ta kalka ma
(Longs pénis ils venus déjà)
Traduction
-Les Wandala sont déjà venus -Ceux qui ont le gland (de la verge) dehors sont déjà venus
-Ceux qui ont les longs pénis sont déjà venus
Le profond ressentiment des Montagnards vis-à-vis des Wandala est exprimé en
des termes outrageux : « Ceux qui ont le gland (de la verge) dehors sont déjà venus […].
Ceux qui ont les longs pénis sont déjà venus ». Ces vers satiriques visent à tourner les
circoncis au ridicule. Dans la plupart des ethnies des monts Mandara, la circoncision était
142
un sacrilège, un acte public de renoncement à sa propre nature et culture (Gaimatakwon,
2007). De ce fait, le deuxième chant exprime davantage l’inquiétude de ces sociétés face à
l’islamisation des Montagnards dans les communautés musulmanes, notamment peules et
wandala. L’islam était considéré comme étant le facteur identifiant des esclavagistes alors
que l’animisme caractériserait l’identité montagnarde. Dans cette avenue, un Montagnard
islamisé était perçu comme un danger pour sa propre culture si tant est qu’il fait dorénavant
corps avec les Foulbé ou les Wandala (Lyons, 1996; Hallaire, 1991)83.
En se référant aux travaux de Paul Lovejoy (2002 ; 1995 ; 1993 ; 1990 ; 1988) et
aux témoignages des femmes esclaves recueillis par José Van Santen (2002 ; 1993), il est
possible de situer la composition de ces deux chants dans le contexte de la pratique du
concubinage qui avait cours dans le califat de Sokoto, y compris dans le lamidat de
Madagali et le sultanat du Wandala à Mora au début du XXe siècle. Nous avons déjà
montré que l’esclavage a concerné davantage les femmes que les hommes. Les
témoignages oraux recueillis par Nicolas David (2014) ; Wouter Van Beek (2012) ; Scott
MacEachern (2011) et surtout par José Van Santen (2002 ; 1998 ; 1993) confirment que ce
sont bien les femmes qui étaient les plus recherchées par les esclavagistes. Leur
recrutement a d’ailleurs continué au-delà de l’interdiction formelle exprimée par les
pouvoirs coloniaux britanniques et français au début du XXe siècle (Van Beek, 2012),
notamment par le biais de l’achat et surtout du concubinage (MacEachern, 2013 ; Van
Santen, 1993)84. C’est dans ce contexte que beaucoup de ces esclaves femmes ont été
incorporées dans les ménages des riches aristocrates musulmans en tant que concubines, un 83La perception qu’ont les Montagnards des personnes qui se sont islamisées n’est pas identique dans toutes les ethnies. Dans les monts Mandara septentrionaux (Podokwo, Muktele, Uldeme, Mura), toute personne convertie à l’islam est frappée de suspicion (Voir Lyons, 1996 ; Hallaire, 1991). Par contre, dans la partie méridionale, les interactions entre Montagnards islamisés et Montagnards animistes ont très souvent existé (Voir Van Santen, 2006 ; 1995 ; 1993).
84 Par le concubinage, les aristocrates musulmans poursuivaient trois objectifs sociaux. Premièrement, il permettait aux aristocrates d’avoir plus de femmes qu’il ne leur est permis par la loi islamique. En effet, la loi en vigueur dans le califat de Sokoto considérait les concubines comme une catégorie spéciale d’esclaves et non comme des véritables épouses (Lovejoy, 1988 : 245-247). Dans ce sens, en plus des quatre femmes qu’il leur est permis d’avoir selon les principes islamiques, les hommes pouvaient avoir autant de concubines, dans la mesure où ces dernières sont censées n’être que des esclaves. Deuxièmement, le concubinage permettait d’augmenter la taille des ménages grâce aux enfants issus des relations avec les femmes esclaves. Les enfants des concubines étaient légalement libres, et leurs mères pouvaient devenir libres à la mort de leurs maîtres, si tant qu'elles ont eu des enfants avec ceux-ci.
143
statut qui leur permettait d’être traitée avec plus de modération que les hommes (Lovejoy,
1988 : 245).
De fait, les concubines, parce que choisies pour leur attirance sexuelle pour leurs
maîtres, avaient des droits et des privilèges auxquels les autres catégories d’esclaves
n’avaient pas accès. Certaines avaient par exemple droit à l’alimentation, étaient mieux
vêtues que lorsqu’elles étaient dans les massifs et avaient parfois droit à l’éducation, ce qui
a conduit plusieurs femmes montagnardes à positiver le concubinage et à valoriser le mode
de vie islamique au détriment du mode de vie montagnarde (Van Santen, 2002 : 69). Les
propos de Jamila, une ancienne concubine originaire de l’ethnie mafa ayant épousé un Peul
de Madagali illustrent bien cette situation :
Avant [dans la montagne] je n’avais pas de vêtements, pas même pour pouvoir attacher mon enfant au dos. Dès l'instant où je suis venu à Magagali, j’ai toujours eu de quoi me vêtir […]. Je mange tout ce que je veux, j’ai assez de vêtements et un bon endroit pour rester, alors pourquoi devrait-on me laisser souffrir à nouveau ? Je n’ai plus besoin de cultiver, et même si je le fais j’ai le droit de tout vendre […]. Tout, tout dans la maison, c’est l'homme qui doit l’acheter pour sa femme […]. Je ne parlais pas le fulfulde85 dans les massifs. Même pour demander de l’eau: « useni hokkam ndyam [s’il te plait donne moi de l’eau] »86, je ne pouvais pas le dire. Quand j’ai fait un mois à Madagali, j’ai appris à préparer du bon repas comme le font les Peuls. Après deux mois, ayant appris quelques mots fulfulde, l’homme qui voulait me marier est venu, et je suis devenue musulmane […]. Je suis allé voir un Marabout qui m’a montré comment je pouvais apprendre le Coran, et j’ai appris à lire. J’apprenais petit à petit comme un petit enfant à l’école. À partir de ce jour-là, je priais cinq fois par jour, mais ensemble avec une autre personne pour que je vois si je le fais bien […]. Depuis le moment où j’ai quitté la montagne, je n’ai jamais préparé ou bu de la bière du mil. Maintenant, je n’aime plus voir les gens qui boivent, comme si moi-même j’en n’avais jamais bu (citée par Van Santen, 2002 : 70).
En prenant en compte ce contexte global dans le califat de Sokoto marqué par un
intérêt prononcé pour le concubinage et des récits des anciennes concubines, on peut
85 Le fulfuldé est la langue parlée par les Peuls, devenue aujourd’hui la langue vernaculaire au Nord-Cameroun.
86Phrase considérée comme la plus basique chez les Fulbé, de même que chez la plupart des groupes montagnards.
144
émettre l’hypothèse que les véritables destinataires du message véhiculé par les chants sont
les femmes. Les chants racontent d’ailleurs l’expérience d’une esclave fugitive qui
s’adresse essentiellement à sa sœur restée dans la maison de son père : « Dites à ma sœur
qui est chez Mblevmè ». Le véritable but des chants est dès lors de dissuader les femmes
montagnardes, qui dans un contexte de précarité économique, pourraient être tentées par le
concubinage. Selon les témoignages collectés par José Van Santen (2002 ; 1998 ; 1993),
plusieurs femmes montagnardes, aujourd’hui intégrées dans leurs sociétés d’accueil,
soulignent leurs préférences au mode de vie islamique, comme l’illustrent les propos de
Jamila cités plus haut, mais aussi de cette femme rencontrée par José Van Santen (2002) :
«les femmes au sein de la communauté islamique sont plus jolies. Moi j’aime être assez
jolie ».
C’est sans doute pour remettre en question cet idéal du mode de vie islamique,
largement véhiculé par les anciennes esclaves, que se justifie la teneur du premier chant :
« Dites aux Wandala que je sois juste leur esclave, sans devenir musulmane. J’ai peur ». Il
s’agit donc du discours de l’inversion destiné à contrer les privilèges associés au
concubinage (vêtement, éducation, civilisation, etc.) en révélant les luttes identitaires
beaucoup plus bouleversantes que vivent ou pourraient vivre les esclaves. Le fait que les
paroles des chants soient attribuées à une esclave fugitive joue le rôle de dissuasion et
donne davantage une certaine valeur à son témoignage en tant qu’expérience vécue. Ainsi,
à travers les chants, la mémoire servile se trouve inscrite à l’intérieur de nouvelles
structures de sens, qui loin de reconnaître les traits de bienfaisance associés au concubinage
tels que rapportés par les anciennes esclaves, mettent en lumière les conflits identitaires
vécus par les esclaves.
On pourrait ainsi considérer la transmission de la mémoire servile par les chants
comme une inversion du phénomène américain du passing (O’Toole, 2003), lequel évoque
l’adoption de l’identité des Blancs par les Noirs, et l’oubli de leur ascendance africaine. Ici,
c’est plutôt l’identité montagnarde qui est magnifiée indirectement par le biais de la
stigmatisation de l’Autre musulman (voir deuxième chant) et à travers l'accent mis sur la
difficulté à assumer l’identité des asservisseurs, d’où la peur exprimée par l’esclave
fugitive dans le premier chant. La célébration de l’identité montagnarde se rapproche
145
néanmoins du phénomène du passing étant elle aussi construite sous l’empire du tri des
événements à oublier ou à transmettre (Jewsiewicki, 2011 : 5). Par exemple, les
Montagnards évoquent sans aucune gêne les temps de grandes famines et d’invasions
acridiennes qui furent particulièrement répétitives au début du XXe siècle (MacEachern,
Beauvilain, 1989 : 313-14; Boutrais et al., 1984). Pourtant, ces deux évènements sont tout
aussi traumatisants et sont survenus à la même période que la vente d’esclaves à grande
échelle des années 1920 avec l’arrivée au pouvoir d’Hamman Yadji (1902-1927). Les
chants occultent le fait que c’est dans ce même contexte de grandes famines que plusieurs
Montagnards vendirent leurs propres parents, surtout des filles, en échange des denrées
alimentaires pour assurer leur survie (MacEachern, 2011; Van Santen, 1993).
Au demeurant, contrairement à ce que pense Martin Klein qui trouve la raison de la
non-transmission de l’histoire servile dans la nature même de l'esclavage en faisant valoir
l’argument que « les esclaves sont essentiellement des gens sans histoire » (1989 : 212), je
considère qu’elle est plutôt intrinsèquement liée au « travail de mémoire » (Jewsiewicki,
2006; Konaté, 2006), laquelle est inévitablement sélective. C’est cette capacité de la
mémoire à présentifier le passé (Hartog, 2003) et à le recycler (Spiegel, 2002 : 162) qui
distingue le discours mémoriel du discours historique entendu ici comme un compte-rendu
d’évènements qui se sont produits dans le passé et qui doivent être compris à la lumière de
ce passé (Araujo, 2011 : 4). Comme le soulignent plusieurs auteurs (Araujo, 2014, 2012,
2010; Jewsiewicki, 2011, 2010, 2006; Konaté, 2006), le travail de mémoire met sous
silence certains aspects de la servilité (razzias esclavagistes et responsabilité des
Montagnards) alors que d’autres (conditions de vie des esclaves dans le contexte du
concubinage) sont plutôt inversés et investis de nouvelles significations. Le silence des
traditions orales sur ne signifie donc pas une absence totale de discours, mais plutôt une
absence de contenu dans la mesure où elles véhiculent d’autres évènements permettant de
refouler et d’entretenir autrement le discours sur l’esclavage.
J’avance ce postulat en me fondant sur la distinction que Vered Vinitzky-Seroussi et
Chana Teeger (2010) établissent entre deux types de silence, à savoir le covert silence et
l’overt silence. Par overt silence, les auteurs se réfèrent à une absence littérale de la parole
et des données sur un objet particulier. Par covert silence, ils se réfèrent plutôt à des mises
146
en scène du silence, à la couverture et au voilage de certains évènements par la médiation
du patrimoine. L’histoire servile dans les monts Mandara semble être disséminée dans
l’overt silence qui, à travers les mythes et les chants, se trouvent voilé et refoulé. En servant
de moyen d’embellissement de la mémoire, les mythes et les chants amoindrissent le
caractère honteux de la servilité et la transmettent dans un langage imagé et parfois cru.
Autrement dit, ils sont aussi bien un moyen utilisé pour refouler et enfouir des aspects
tragiques du passé qu’une stratégie de mise en garde contre l’islamisation et la
foulbeisation des Montagnards, notamment des femmes. C’est aussi ce travail de mémoire
qui explique pourquoi la fin des pratiques esclavagistes est elle-même absente dans les
traditions orales locales (Van Beek, 2012). Si les informateurs reconnaissent le rôle
important de la colonisation dans la fin de l’esclavage, elle a elle-même ouvert la voie à une
nouvelle vague de violences exercées par les pouvoirs coloniaux français et entretenues par
le biais des images stéréotypées des Montagnards.
II. Imaginaires coloniaux, mimétisme local et inscription de l’idéologie victimaire dans l’espace public
La catégorisation des indigènes en figures-types a été une caractéristique constante
de la colonisation française. En se référant aux travaux publiés sous la direction de Nicolas
Bancel et de Pascal Blanchard (Bancel et al., 2004 ; Bancel et Blanchard, 2003 ; Bancel,
Blanchard et Vergès, 2003 ; Bancel et Blanchard, 2003; Bancel et Blanchard, 1998; Bancel,
Blanchard et Gervereau, 1993), trois archétypes de l’indigène ont été les plus marquants, à
savoir : l’image du bon sauvage magnifiant la bravoure, la puissance physique et la
bonhommie du tirailleur; l’image de rebelles appliquée surtout aux Magrébins, fixant leur
inclinaison à la guerre et aux violences; et enfin, l’image du piètre combattant indochinois,
archétype qui s’évanouira cependant avec la guerre d’Indochine (Bancel et Blanchard,
1998). Ces représentations stéréotypées étaient nécessaires pour cristalliser et entériner la
différence entre « Nous » et « Eux » (Bhabha, 2007 : 121 ; 1994 : 86) et pour légitimer le
projet colonial lui-même dont l’application fut marquée par les violences à l’égard des
colonisés (Le Cour Grandmaison, 2009, 2005; Bancel et Blanchard et Vergès, 2003). C’est
à un tel processus auquel on a assisté dans les années 1916-1960, période qui voit émerger
147
une double figure de l’Autre montagnard. Il s’agit, d’une part, de la figure de peuples
authentiques et barbares, et d’autre part, de celle de peuples rebelles et sauvages.
1. De la justification des violences coloniales par la création d’un imaginaire de peuples authentiques et rebelles (1916-1960)
La politique coloniale française en Afrique fut en général une politique
d’administration directe, contrairement aux Britanniques qui lui ont préféré un système de
domination indirecte, en se servant des structures politiques déjà existantes. Dans ce sens,
la centralisation et l'assimilation furent des éléments-clés de l’administration française
(Cooper, 1998; Fuglestad, 1983). En tant que tels, les Français, contrairement aux Anglais,
n’étaient pas prêts à reconnaitre les structures politiques locales existantes. Mieux, ils ont
cherché à contrôler et à remplacer celles-ci autant que possible (Fuglestad, 1983: 85).
Cependant, n’ayant parfois pas de ressources suffisantes pour mettre en œuvre leur stratégie
de gouvernance directe, les colonisateurs français ont, à certains égards, fini par adopter le
système d’administration indirecte, surtout à partir des années 1920. Néanmoins, la
centralisation du pouvoir restait du ressort l’essor des administrateurs coloniaux, lesquels
dépendaient directement du ministère des colonies basé en France (Cooper, 1998: 31).
Comme déjà mentionnée dans l’introduction générale de cette thèse, la présence
française au Cameroun succède à celle des Allemands qui furent les premiers à avoir pris
possession du pays entre 1884 et 1916. Mais dans la pratique, c’est seulement à partir de
1902 que cette présence devient effective notamment dans la partie septentrionale du pays
(Abwa, 1994). Fascinés par l’organisation sociopolitique des Peuls et des Wandala, c’est
tout naturellement que les Allemands les associèrent à l’administration territoriale du Nord-
Cameroun, plus particulièrement à la gestion des populations montagnardes (Lyons, 1996).
Toutefois, étant préoccupés par le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914,
les Allemands n’ont pas eu le temps nécessaire pour mettre en place une véritable politique
d’administration au Cameroun, où ils seront d’ailleurs délogés à la suite de leur défaite au
profit des forces alliées françaises et britanniques.
Ayant hérité de la presque totalité de la partie septentrionale, les Français ont
continué à administrer les populations des monts Mandara en se servant essentiellement des
148
structures politiques musulmanes, en particulier les lamidats peuls (pour la partie
méridionale) et le sultanat du Wandala (pour les monts Mandara septentrionaux). À cette
période de l’entre-deux-guerres mondiale, l’islam était alors considéré avec moins de
suspicion par les autorités coloniales françaises, et les musulmans comme susceptibles
d’être plus convertibles à la civilisation que les autres indigènes (Le Cour Grandmaison,
2005 :82; Triaud, 2000 : 181; Stewart, 1997: 56). C’est donc tout naturellement que les
Français ont coopéré avec les souverains islamiques, même si cette coopération rencontrait
l'opposition de certains hommes politiques français (Glew, 1998: 135).
L’inexistence chez les Montagnards de structures politiques centralisées observés
chez les Wandala et les Peuls a été considérée comme un signe de leur barbarie, et sera à la
base de la création des imaginaires coloniaux (Lyons, 1996 : 253). De fait, l’organisation
sociale des Montagnards, communément perçue comme acéphale était en quelque sorte la
preuve de cette absence de civilisation et de maturation politique87. « Authentiques », les
Montagnards sont dépeints comme des êtres subordonnés à une nature ingrate (monts
Mandara) qui les écarte des produits de la civilisation (Kerbellec, 1943; Margerel, 1937;
Billant, 1934; Chabral, 1931; Remiré, 1917; Vallin, 1929; Coste, 1923; Petit, 1920;
Blanvillain, 1917). Par exemple, Leo Africanus écrivait: « In the mountains live tribes who
raise goats and cattle. They plant millet and other, but unknown, cereals. Some of these
montagnards have no religion, neither Christian nor Jewish or Islamic. They live like
animals without faith » (Leo Africanus, 1896: 310). Jean Ferrandi les considérèrent pour sa
part comme d'« authentiques sauvages aux mœurs anarchiques », qui «n'ont pas encore
rompus aux subtilités de nos codes » (Ferrandi, 1928 : 99). C'est d'ailleurs ce constat qui
amena l'administration coloniale à encourager l'intégration des groupes montagnards aux
87 En effet, les groupes montagnards ne possèdent pas de véritables chefs - comme c'est le cas chez les musulmans de la plaine - et donc pas d’interlocuteurs susceptibles de servir d’intermédiaires. Ils ne forment qu'un conglomérat de petits lignages existant dans un réseau de relations traditionnelles d'alliance et d'opposition avec des groupes similaires, et ayant des liens historiques avec un territoire d'accueil particulier. Il est à noter que les sociétés musulmanes du Nord-Cameroun ne reçurent pas de tels attributs négatifs, tout au moins pour ce qui concerne leurs formes d'organisations politique et religieuse. Les pouvoirs coloniaux définissaient les Montagnards par opposition aux populations musulmanes des plaines environnantes. Les Montagnards, peuples sauvages et non civilisés, contrasteraient avec les populations musulmanes plus ou moins évoluées. Voir pour les détails Scott MacEchern (2002; 1991) et Diane Lyons (1996; 1990).
149
structures hiérarchisées des lamidats et sultanats peuls déjà en place, car «partout où le
Foulbé a pénétré le Kirdi, il l'a civilisé» (Blanvillain, 1917).
En raison de sa fixité, l’architecture traditionnelle s'imposa comme le principal lieu
d’élaboration de cette représentation stéréotypée des Kirdi en tant qu’êtres authentiques.
On note ainsi, dans des ouvrages rédigés par d’anciens membres de l’administration
coloniale (Benoist, 1957; Lembezat, 1949; Ferrandi, 1928; Strümpell, 1923) un certain
nombre d’incises traduisant l’intérêt porté à l’architecture. Celle-ci marque les esprits au
point d’être présente dans toutes les monographies coloniales sur les monts Mandara. Dans
son Retour du Tchad, André Gide (1995 [1926]) reprend et développe ce type de
représentation, fondée sur l’authenticité lorsqu’il considère les habitations des monts
Mandara comme des plus originales. Jean Benoist, médecin français en tournée dans les
massifs du Mandara, offre également un portrait saisissant à la vue des cases mafa :
Comme tous les montagnards du monde, les Matakam sont marqués par le site où ils vivent. Ils en ont la rudesse, les traits abrupts, l'inaccessibilité. Un charme prenant aussi. Leurs cases sont uniques en Afrique : les toits hauts, pointus, aux douces inflexions de pagodes, se juchent à tous les étages des pentes, sur les petites esplanades ménagées par les rocailles. D'abord on ne voit pas les villages, tellement ils se fondent dans l'ocre et le grisé du sol dont ils sont issus, et le pays semble désert. Puis on découvre une case, par hasard, profilée sur le ciel ou terré entre les pierres. D'autres peu à peu apparaissent, comme semées par un mauvais plaisant sur un paysage auparavant nu (1957 : 137-138).
Globalement, trois thèmes émergent de la littérature coloniale consacrée à
l'architecture des Montagnards: son originalité, son exotisme et son caractère défensif. Les
deux premiers thèmes découlent en réalité de ce dernier aspect dans la mesure où le
caractère défensif (enceinte fortifiée, obscurité, porte unique et exigüe) de la maison
constituait en même temps la preuve de son originalité et de son exotisme. Jean Ferrandi
fournit une description intéressante à ce sujet :
L'habitation des Kirdis, note-t-il, est très originale [...]; de l'extérieur, ces installations ressemblent plutôt à une petite ville fortifiée d'où émergent des
150
tours gothiques; le Kirdi est là chez lui, à l'abri des regards et des agressions; plusieurs passages discrets, percés dans le mur, lui permettent de fuir avec sa famille à la première alerte; les ouvertures sont d'ailleurs très petites; on ne peut les franchir qu'en se ployant en deux [...]; parfois l'enceinte enclot aussi une grotte naturelle comme il y en a de nombreuses dans le massif du Mandara (1928 :116).
Dépeinte ainsi sous les traits de l’originalité et de l’exotisme, l’architecture fournit la
preuve de l’altérité figée du Montagnard, provoquant de fait, deux réactions opposées à
savoir, d’une part, un sentiment de supériorité, et d’autre part, une certaine fascination.
L’iconographie coloniale (Bancel, Blanchard et Gervereau, 1993) a davantage participé à
cette exotisation. On trouve dans presque tous les ouvrages parus au cours de la première
moitié du XXe siècle88, des photographies des maisons montagnardes, qui viennent ainsi
administrer la preuve que « ces êtres authentiques vivent dans une symbiose parfaite avec
la nature » (Benoist, 1957 : 138). À partir de ces photographies se cristallise une certaine
définition de l'indigène primitif et statique, indispensable pour la justification de la
colonisation et de la mission civilisatrice qui en est le fondement89.
88 Voir par exemple les auteurs comme Jean-Claude Froelich (1956); Réné Gardi (1955; 1953); Paul Hinderling (1955); Bertrand Lembezat (1952; 1950; 1948); De Lauwe (1937); Jean Ferrandi (1928).
89Il est d’ailleurs intéressant de remarquer ces photographies stéréo typiques se prolongent au-delà de la période des indépendances à travers les premiers ouvrages scientifiques produits sur les monts Mandara. Selon Dagawa (cité par Chétima, 2011), les photographes donnaient parfois des conduites à tenir avant toute prise de vue et sur la posture à adopter, les bijoux à porter, le site sur lequel se tenir, le repas à préparer et les habits à porter. Bref, tout est conditionné de sorte que les changements ne ressortent pas sur les photographies (Urry et Crawshaw, 1997 ; Urry, 1990). La photographie assure ainsi l’objectivation du lieu, c’est-à-dire sa « mise à distance » en vue d’épouser les discours sur l’authenticité. C’est dans ce sens que Marc Augé (1997) estime qu’il y a très souvent une disparité entre l’iconographie touristique et la réalité.
151
Figure 7: Quartier dzaŋƏ mededeŋe (Udjila) apparaissant sur une carte postale non datée (source : archives personnelles du Chef d’Udjila)90.
Figure 8 : Carte postale montrant une femme d’Udjila en train d’aller chercher les vivres
dans le grenier (Source : www.delcampe.net)
90 À partir des maisons qui y figurent, trois des informateurs septuagénaires ont avancé la période d’avant 1950, et soutiennent leur information par un incendie qui aurait ravagé le quartier au début des années 1950 qui aurait changé sa physionomie.
152
Figure 9 : Cartes postales montrant en arrière-plan les maisons montagnardes; symboles de l’authenticité (Source : www.delcampe.net)
Les Français étant officiellement en Afrique pour civiliser et pour transformer les
Africains en des Français à la peau noire (Le Cour Grandmaison, 2005 : 84; Bancel,
Blanchard et Vergès, 2003 : 13, 122), la supposée authenticité des Montagnards constitua
une arène particulièrement importante pour la mise en œuvre de la politique d'assimilation.
Celle-ci visait dans son essence l’effacement des différences entre les colonies et la
métropole, de sorte que les citoyens français et les sujets français puissent vivre une
expérience commune (Blanchard, 2001). Cette similitude n’était cependant pas donnée
d’emblée aux indigènes, dans la mesure où ils devraient y être convertis par le biais du
moulin civilisateur de l’Occident (Mbembe, 2000). Dans la pratique, la politique
d’assimilation a montré toute son ambigüité car elle fut marquée par la répression et la
violence, une violence légitimée dans le cadre de ladite mission civilisatrice. En figeant les
Montagnards dans un ailleurs lointain, la France coloniale se pose ainsi en rédemptrice,
ayant pour mission de délivrer ces derniers de la sauvagerie qui les gouverne pour
permettre leur assimilation progressive dans l’empire colonial français (Bancel et
Blanchard, 2003 : 150), d’où l’insistance sur un thème particulièrement récurrent dans la
littérature coloniale, à savoir leur prétendu instinct naturel à la guerre et à la rébellion.
153
En effet, tout au long de la période coloniale française, les Montagnards ont été
décrits comme des gens extrêmement violents et dangereux, utilisant des flèches
empoisonnées combinées à la sorcellerie (Blanvillain, 1923). Les comptes rendus des
tournées et les rapports administratifs reflètent particulièrement cette réputation des
Montagnards en tant que peuples rebelles. Lors des tournées de reconnaissance en date du 7
au 9 juillet 1917, le Lieutenant Blanvillain, alors Chef de la subdivision de Maroua, écrivait
ceci:
Ces Kirdis insoumis n'avaient jamais vu d'Européens et croyaient de bonne foi leur montagne inviolable [...]. Les Émissaires reviennent avec les mêmes réponses: «Nous ne voulons pas voir d'Européens, nous avons tout ce qui nous faut chez nous, il nous manque que du feu». Allusion ironique et provocatrice m'invitant à aller bruler leurs villages si je pouvais (Blanvillain, 1917).
Il est utile de constater que toute la littérature coloniale a globalement reproduit ce
schéma selon lequel les Montagnards n'aiment pas voir le Blanc. Ces derniers seront dès
lors catalogués et traités comme des bandits en raison de ce refus d'admettre l'autorité
coloniale et de coopérer avec elle. C'est ainsi que le Capitaine Remiré, à l'issue d'une
tournée de prise de contact du 4 au 19 mars 1929 écrit:
La plaie du pays est toujours les «Kirdis» qui se livrent au vol et au pillage presque sûrs de l'impunité. Un isolé ne peut voyager dans le pays sans être tué ou dépouillé. Ils se croient toujours les rois de leurs montagnes. Ils sont restés trop longtemps inconnus de nous et les chefs de subdivision n'ont pas toujours eu les moyens de réprimer leurs forfaits (Remiré, 1929).
Cette insistance sur l’usage de la violence en territoires païens procède évidemment
d’une « définition » des Montagnards comme des gens agissant beaucoup plus par leur
instinct naturel que par leur instinct culturel, dans la mesure où ces derniers ne parviennent
pas à contenir le caractère spontané de leurs réactions, d’où cette présence permanente de la
violence. Au cours de la tournée d'impôt de juillet 1931, le colonel Chabral, Chef de la
Subdivision de Mokolo, écrivit aussi ceci:
154
Les habitants de Ziver en raison de leur position topographique particulièrement propice à abriter des bandits, ont de tout temps été les plus turbulents. Les plus agressifs de tous les Kirdis. Conscients de leur situation privilégiée à cet égard, ils ont toujours attaqué, razzié, brûlé les quartiers les plus proches de leur habitat et, autrefois les dégâts qu’ils commettaient étaient très importants. Ils se sentaient invulnérables dans leur repère. Depuis quelques années, malgré plusieurs représailles exercées par mes prédécesseurs, ils ont continué leurs méfaits, mais à une plus petite échelle. Pour montrer leur état d’esprit, il suffit de rapporter les dernières plaintes reçues. Leur mauvaise action terminée, ils se retiraient en disant à leur victime : « Maintenant tu peux aller chercher ton Blanc. S’il vient, il y en aura autant pour lui ». Ces habitants, ainsi qu'il est écrit plus haut, sont les plus turbulents. Ils possèdent une réputation qui les fait craindre aux alentours; ils sont considérés comme des démons. Pour démontrer les convictions de la force qu’ils croyaient détenir, ils avaient avant ma visite, engagé des paris avec leurs voisins. Certains qu’ils me mettraient en échec, ils gagèrent à leurs voisins que si le « Blanc » montait chez eux, ils donneraient une petite fille ou un mouton et que, si toutefois il réussissait, il n’en sortirait pas vivant et son casque servirait à boire du « pipi » (Chabral, 1931).
On note la même réaction chez le Lieutenant David, Chef de la Subdivision de Mora
qui, à la suite d'une tournée effectuée en 1934, qualifie les monts Mandara comme «un
vaste massif très mouvementé et très pauvre, peuplé de bandits qui ne tiennent pas du tout à
voir le Blanc» (David, 1934). Pour mettre davantage en exergue le caractère animal et
instinctif des Montagnards, les rapports coloniaux feront presque toujours allusion
aux incidents qui mettaient très souvent aux prises les différents groupes ethniques91. À ce
sujet, Bertrand Lembezat note :
Farouches, indépendants, groupés en petits ilots fermés, tous ces traits que nous avons rencontrés ne pouvaient manquer d’avoir pour nos gens une conséquence générale : ces montagnards sont des guerriers […]. De tribu à tribu, de massif à massif, les incidents étaient de règle, sinon permanents du
91 L’usage du terme incident au lieu de conflits ou de guerre est ici important, car il met davantage l’accent sur une violence aveugle et irrationnelle, qui ne peut être arrêtée que par une violence rationnelle, légitimée par un élément fondateur du projet colonial, à savoir la pacification (Bancel, Blanchard et Vergès, 2003 : 157).
155
moins endémiques, à telle enseigne qu’on ne se risquait qu’au péril de sa vie sur les territoires ennemis (Lembezat, 1961 : 41).
Il convient de rappeler que l’élaboration de l’imaginaire du Montagnard en tant que
rebelle intervient dans un contexte global marqué par les débats autour de l'indigénat
(Merle, 2004 : 143-144). Ce régime, expérimenté pour la première fois en Algérie en 1881,
a été appliqué dans l’ensemble des colonies françaises d’Afrique sous des formes variées
jusqu'à son abolition en 1946 (Merle, 2004 : 142). Dans le principe, il consistait à concevoir
une justice spéciale pour réprimer des infractions commises par les indigènes dans les
colonies, qui ne sont ni prévues ni réprimées par la loi française (Merle, 2004 :143-144). La
raison de son application est de permettre d’une part, le maintien de l'ordre dans les
colonies, et d’autre part l'avancée des indigènes sur la voie de la civilisation (Charlick,
1991 : 36). Cependant, de nombreux chercheurs ont fait valoir que l’indigénat a autorisé
des violences extrêmes et des abus de pouvoir des administrateurs coloniaux sur les
colonisés (Le Cour Grandmaison, 2005: 89; Merle, 2004; Bancel, Blanchard et Vergès,
2003; Blanchard et Bancel, 2001; Blanchard, 2001). Robert Charlick écrit par exemple que
dans le système de l’indigénat, les Africains ont été privés de leurs droits les plus basiques,
et ont été soumis à des arrestations arbitraires et à des travaux forcés (1991: 36).
156
Figure 10 : Scène entre populations animistes (dessin de Christian Seignobos à l’imitation d’Yvan Pranishnikoff, dans Beauvilain, 1989 : 337)
La figure 10 donne une illustration parfaite de la construction stéréotypée du
Montagnard comme d’un être sauvage et barbare. On observe, entre autres, des corps
d’individus qui gisent sur le sol tués lors des affrontements sans doute imaginaires, le corps
d’une femme discuté par des protagonistes, un enfant tiraillé de manière particulièrement
violente, un individu s’emparant violemment d’une chèvre, et enfin des individus cherchant
des voies d’accès pour pénétrer dans les greniers, certainement pour piller les vivres. Ce
genre d’illustration a sans doute largement participé à la construction du mythe du
Montagnard sauvage et sournois, et donc ennemi de la civilisation (Le Cour Grandmaison,
2005 : 90). En effet, les actes de pillage tels qu’on l’observe sur la figure 10 ne pouvaient
être attribués qu’à des barbares, à des démons, pour reprendre l’expression du Colonel
Chabral (1931), Chef de la subdivision de Mokolo en 1931. D’où la nécessité de prendre
des mesures extrêmes pour stopper leur cruauté et parvenir ainsi au besoin à leur
apprivoisement. C’est sans doute cette supposée pacification qui a justifié la création d'un
157
poste militaire dans les monts Mandara en 1922, avec l’alibi de vouloir enrayer les velléités
insurrectionnelles des Montagnards (Garakchémé, 2014). Par ailleurs, face au refus et à
l’incapacité de ceux-ci de s’acquitter de leurs impôts, l’administration coloniale élabora une
politique de la traque à leur égard (Zelao, 2012 : 188), au point où les violences policières
étaient devenues la norme dans les massifs (Garakchémé, 2014). Il était d’ailleurs de
coutume que les administrateurs en fin de séjour recommandaient à leurs remplaçants de
s’assurer l’escorte « d’un minimum de dix fusils pour traverser le pays kirdi» (Blanvillain,
1923).
Au demeurant, la création de la figure-type du Montagnard procède d’une volonté
de régulation de la violence coloniale elle-même, mais d’une violence coloniale jugée
nécessaire pour assurer la pacification de la région. Elle procède également de la volonté de
montrer le bien-fondé de l’entreprise coloniale qui est d’imposer la pax française, laquelle
ne pouvait être justifiée que par la création des représentations que Gayatri Spivak définit
comme une violence épistémique (Spivak, 1999) 92. Toutefois, en dépit de la multiplication
des actes de répression, les Français ne parvinrent pas à endiguer complètement cette
prétendue insubordination des Montagnards qui, à travers leur architecture traditionnelle,
vont re-tourner les différents imaginaires pour créer un autre mythe, celui du
résistancialisme.
2. « Sortir du regard colonial93 » : architecture et transmission de l’image de peuples résistants et travailleurs
À force de subir l’oppression coloniale, les Montagnards se sont naturellement
engagés dans un processus de résistance qui leur a permis de sortir de leur situation
marginale imposée par les pouvoirs coloniaux. En se servant de la mémoire de leur
installation dans les massifs et du caractère défensif de leurs maisons, ils inversent les
imaginaires coloniaux pour véhiculer d’autres images valorisantes d’eux-mêmes. Pourtant,
92 Gayatri Chakravorty Spivak entend par violence épistémique, l’oppression et la minoration du colonisé telle qu’elle se donne à voir à travers la production d’un type de savoir stéréotypé destiné à légitimer le discours occidental sur la personne du colonisé. Cette violence épistémique, explique Spivak, a précédé dans la majorité des cas l’entreprise coloniale et a produit des distorsions, des clichés et des généralisations abusives qui ont servi à valider les fantasmes occidentaux d’un soi authentique du sujet colonisé.
93 J’emprunte cette expression à Habib Saïdi (2007) qui l’utilise comme intitulé de sa thèse de doctorat.
158
c’est cette même installation dans les montagnes qui a contribué à bâtir l'image de
« peuples victimes de l’esclavage et de la colonisation» telle qu’elle se donne à voir dans
les ouvrages consacrés aux monts Mandara (Vincent, 1991 ; Hallaire, 1991 ; Boutrais et al.,
1984 ; Seignobos, 1982 ; 1979 ; Boulet, 1975; Juillerat, 1971). Certains auteurs ont ainsi
parlé des Montagnards comme étant des refoulés, qui n’avaient de choix que de
s’accrocher à leurs montagnes pour échapper aux raids esclavagistes, et aux vindicatifs des
autorités coloniales dans le cadre de leurs tournées de collecte d’impôts à travers les
massifs. Pour Jean-Claude Froelich par exemple, seule une situation de refoulement permet
d’expliquer l'occupation des massifs ainsi que la nature des habitations montagnardes
(1968 : 53-54). Chez les Montagnards en revanche, l’image véhiculée à travers les
mémoires de l’esclavage et de la colonisation n’est pas celle de la victimisation, mais plutôt
de la résistance (Garakchémé, 2014) d’une part, et de l’amour pour le travail physique
d’autre part.
Dans ce sens, l’occupation des monts Mandara leur apparaît comme un calcul
tactique et comme une logique d’insubordination (Garakchémé, 2014). Les dispositifs
naturels du milieu, la présence des grottes et des murs de protection sont mis à profit pour
la transmission de ce nouveau discours mémoriel centré autour de la résistance (Chétima et
Gaimatakwon, 2015). Celui-ci est surtout présent chez les aînés dont certains comme
Mozogoum qualifient l’occupation des monts Mandara comme « la plus belle partie de leur
histoire » (entretien avec Mozogoum, homme de 87 ans, le 8 juin 2012, à Udjila). Il s’agit
alors d’une reconfiguration qui tend à remplacer une période historique honteuse, marquée
par les violences coloniales elles-mêmes ayant succédé aux raids esclavagistes, par une
autre considérée comme glorieuse. Cette forme de mémoire se retrouve aussi dans les
discours tenus lors des manifestations culturelles par les jeunes intellectuels dans lesquels
aucune allusion n’est faite aux violences coloniales. L'accent est plutôt mis sur le rôle de la
montagne dans la résistance à toute forme de domination, sur la collecte des
renseignements à travers des sentinelles postées aux endroits stratégiques, sur la pratique de
la divination, sur la croyance en l’invisibilité et en l’invulnérabilité des Kirdi (Zelao,
2006 :11). Certaines grottes qui servirent de lieux de repli lors des incursions coloniales en
montagne ont aujourd’hui acquis une réputation de lieux de mémoire dans l’imaginaire
locale, et des cérémonies cultuelles se déroulent parfois à ces endroits pour leur conférer
159
une certaine sacralité (Garakchémé, 2011). Cette tendance à considérer l'occupation des
massifs comme preuve d'insubordination semble avoir été présente à l’époque coloniale
elle-même. Ussalaka Duluva, un informateur ayant participé à la construction du tronçon
routier Mora-Udjila dans le cadre des travaux forcés sous la colonisation française, rapporte
les paroles d’un chant exécuté par les travailleurs sous la supervision de leurs maîtres
colonisateurs : « On peut dompter un lion, mais pas un homme de rocher. Les Wandala
l’ont essayé, les Jamaka l’ont essayé. Et ils ont compris. Maintenant ce sont les Farançaka.
Eux aussi comprendront qu’on ne peut pas dompter un homme de rocher par la force »
(entretien avec Ussalaka Duluva, homme de 70 ans, le 24 avril 2007, à Udjila).
L’architecture traditionnelle est également considérée comme un témoignage du
refus de soumission à l'autorité coloniale. C’est ce qui ressort des propos de Bassaka Kuma,
un informateur affirmant lui aussi avoir vécu les violences exercées par les colons lors des
différentes opérations de police menées dans les massifs d’Udjila :
Quand les Farançaka venaient dans les montagnes, les sentinelles le signalaient à tout le monde, et chacun entrait dans sa maison. Ils trouvaient souvent le village désert, criaient en tirant des coups de fusil. Mais personne ne toussait. On faisait comme si le village était en deuil. Parfois, ils entraient dans les maisons, mais comme il y avait de l’obscurité partout, ils ne pouvaient voir personne. Quand ils ont compris qu’on se cachait à l’intérieur de nos maisons, ils ont commencé à les incendier. Nous aussi, nous avons changé de stratégie : on ne se cachait plus à l’intérieur, mais dans les rochers. C’est comme ça que tout le monde a commencé à aménager des grottes dans les roches les plus proches de la maison. D’autres préféraient aller sur les sommets pour mieux se moquer des Blancs lorsqu’ils venaient mettre feu aux maisons (Bassaka Kuma, entretien avec homme de 70 ans, le 09 avril 2007, à Udjila).
De ce point de vue, les Montagnards considèrent la disposition architecturale de
leurs habitations comme relevant davantage d'une stratégie militaire que d'une réponse
passive aux impératifs de défense. L’attirance marquée pour les zones inaccessibles est
d'ailleurs vue comme une tactique permettant d’organiser la résistance (Garakchémé,
2014). Lorsqu’on quitte la ville de Mora pour les monts Mandara, les premières cases
n’apparaissent qu'à l'approche des dénivellations importantes. Pour compléter l’avantage
160
qu’offre le relief, les Montagnards ont développé des formes de défense collective dont les
traces, encore visibles aujourd'hui, sont présentées avec fierté aux jeunes générations pour
qu'ils s'en inspirent dans leur lutte contre toute forme de domination94.
Figure 11 : Occupation des sommets montagneux synonyme de la résistance dans le discours
mémoriel sur l’esclavage et la colonisation
94Il s’agit en général des murs de pierres sèches barrant tous les points de passage et d’accès aux habitations. Ces murs étaient construits en contrebas des massifs ou parfois en cercles concentriques sur les sommets montagneux. Lire aussi sur cette question Christian Seignobos (1976 : 8).
161
Figure 12 : Vue de la muraille de protection des vestiges architecturaux trouvés sur le site DGB en territoire mafa
Un autre élément lié à la mémoire coloniale est la revalorisation du travail physique.
Sous prétexte du refus de paiement des impôts et de la non-obéissance aux ordres des
maitres coloniaux, de nombreux Montagnards ont été contraints à des travaux forcés dans
le cadre des projets de mise en œuvre des infrastructures routières. Bassaka Kuma de
souvient encore de la pénibilité du travail lorsqu’il raconte :
C’est nous qui avons cassé toutes les roches pour donner la voix au camion (bulldozeur) de pénétrer la montagne. C’était un travail pénible. Quand tu rentrais chez toi le soir, c’était seulement pour dormir. On travaillait de 6h à 18h parfois sans repos. On n’était pas payé pour ça, mais on était obligé parce que si tu refusais de travailler, on brulait ta maison et on disait que c’est parce que tu n’as pas payé l’impôt. Pourtant c’est parce que tu n’es pas venu travailler (homme de 70 ans, entretien, le 09 avril 2007, à Udjila).
Si la mémoire de la colonisation chez les informateurs ayant participé à ces travaux
reste directement liée aux traitements inhumains dont ils furent l’objet, elle se trouve
162
transformée chez leurs descendants immédiats, lesquels tendent plutôt à en faire la source
de leur capital social et identitaire. La plupart des groupes montagnards se définissent
aujourd’hui comme des travailleurs acharnés, et en prennent pour preuve le fait d’avoir été
associés par les pouvoirs coloniaux dans l’exécution des tâches difficiles, alors qu’il
s’agissait inévitablement des travaux exécutés sous la contrainte. Les populations y
recourent surtout pour établir des comparaisons avec les habitants de la plaine, Peuls et
Wandala en particulier, qu’ils considèrent comme des « faibles, incapables d’exécuter des
travaux exigeant la force physique (entretien avec Ussalaka Duluva, homme de 70 ans, le
02 mars 2007, à Udjila). Par exemple, les Podokwo assimilent les travaux habituellement
accomplis par les Wandala à des tâches féminines en raison de leur facilité (commerce et
élevage en particulier). En revanche, ils s’arrogent le statut de grands travailleurs, lequel
serait matérialisé dans le travail de la terre et dans la construction du mur de pierres :
Les Wandala travaillent eux aussi la terre, mais ne cultivent que le « derrière » de la maison, comme les femmes. Ils ne peuvent pas supporter une journée de travail au champ. Un homme de rocher par contre peut tout faire. Il casse la pierre, il les taille en morceaux pour construire son mur d’enceinte, il travaille le bois pour avoir ses perches de soutènement, il tresse les tiges de mil pour la toiture des cases, il range les cailloux dans le champ avant toute semence, il défriche son champ avant de le cultiver. Même le Blanc a vu que l’homme de rocher aime le travail. C’est pourquoi il est venu le chercher. Le montagnard passe tout son temps à travailler (entretien avec Zabga Valla, homme de 62 ans, le 18 mars 2012, à Udjila).
En associant les tâches les plus difficiles (culture du mil, construction des maisons)
à la masculinité et les travaux légers (cuisine, éducation des enfants, soin des vieillards,
petite agriculture, puisage d’eau, volaille) à la féminité, les Montagnards tentent ainsi de
s’extirper des imaginaires coloniaux en s’arrogeant un statut honorable tout en confinant les
Wandala à une place plus ou moins marginale95. Les travaux forcés et les brutalités
coloniales qui l’ont accompagné se trouvent dès lors domestiqués et inscrits à l'intérieur du
code local de l'honneur. Dans ce contexte, la mémoire de la colonisation cesse d’être 95 Pourtant, ce sont ces derniers, et non les Montagnards, qui furent estimés et associés par les Français à l’administration coloniale. Pour plus de détails, voir Diane Lyons (1996).
163
synonyme de l’oppression pour devenir un élément de la fierté du Montagnard qui, à
travers la colonisation, a prouvé son habilité dans l’exécution des travaux difficiles: « On
travaillait comme des fous. Pourtant on ne gagnait rien. Même la nourriture était préparée
par nos femmes. Le travail était très difficile » (entretien avec Bedje Barama, homme de 58
ans, le 18 mars 2012, à Udjila).
Ce regard sur le travail pénible en tant que symbole masculin s’est accentué dans les
années 1980 dans le cadre du jeu du défi et de la riposte que se livrent les jeunes
montagnards dans la construction des maisons en tôles. La construction d’une telle maison
exige de ces derniers d’aller en ville, d'y travailler dans des conditions extrêmement
pénibles pour accumuler l’argent nécessaire. De retour au village, ceux qui réussissent à
construire à l’issue du projet migratoire sont honorés, non seulement pour avoir construit
un abri, mais davantage parce que cet abri est la preuve de leur amour pour le travail et de
la souffrance endurée ailleurs. En revanche, les individus qui n’ont pas pu, pour des raisons
particulières, accumuler l’argent nécessaire pour construire leur maison sont stigmatisés, et
perçus comme des paresseux partis en ville pour fuir le travail pénible de la terre96. Dans
cette avenue, les nouvelles maisons apparues dans les années 1980 permettent à la
communauté d’origine d’émettre un jugement de valeur sur la capacité du migrant à se
débrouiller et à braver les difficultés de la vie pour assurer sa survie. Finalement, les jeunes
montagnards partent en ville, non pas pour y trouver une vie meilleure, mais davantage
pour prouver leur capacité à endurer les conditions difficiles de travail, laquelle ne peut être
démontrée au village que par la construction d’une maison en tôles. La nouvelle maison est
ainsi mise à contribution pour domestiquer les travaux forcés vécus sous la période
coloniale et pour construire une nouvelle identité à la fois héroïsante et valorisante.
L'indépendance obtenue en 1960 mettra théoriquement fin à l’exploitation de la
main d’œuvre montagnarde dans la mise en place des infrastructures coloniales, les
imaginaires continuèrent d’être véhiculés à travers certains ouvrages et documentaires,
surtout ceux datant des années 1960. Certains ouvrages ont par exemple reproduit
l’imaginaire du Montagnard authentique, en procédant à une sélection photographique 96 Voir le chapitre 5 pour une analyse plus détaillée de la place qu’occupe la nouvelle maison dans le discours identitaire des migrants montagnards et des logiques qui sous-tendent les concurrences à la plus belle maison auxquelles ils se livrent habituellement.
164
montrant des hommes et des femmes dénudés97. Aussi, dans un ouvrage publié en 1969,
Jean-Paul Lebeuf écrivait pour remarquer que «pour tout vêtement, les Matakam
accrochent à leur cou une peau qui flotte dans le dos et laisse nu le devant du corps; une
mince ficelle leur entoure la taille» (Lebeuf, 1969 :32). Par ailleurs, les populations locales
recyclent ces mêmes représentations coloniales pour les authentifier à la faveur de leurs
dividendes touristiques, d’où le re-tour de la tradition.
3. Retour de la tradition et récupération du mythe colonial de l’authenticité (1960-1990)
L’imaginaire colonial d’authenticité et son mimétisme par les locaux ont transformé
les monts Mandara en une destination touristique privilégiée au Cameroun. Déjà en 1959,
l’administrateur colonial Jean-Claude Froelich eut l’idée de poser les jalons du tourisme en
construisant la toute première structure d’accueil, à savoir le campement de Rhumsiki
(Chétima, 2011 ; Ahmadou, 1997). L’État camerounais, devenu indépendant en 1960, a
continué cette politique de promotion du tourisme en initiant des travaux de
réaménagements des infrastructures routières pour faciliter l’accès aux sites. Les localités
montagnardes ayant particulièrement bénéficié de l’attention des pouvoirs publics furent les
villages de Rhumsiki et d’Udjila. Les axes routiers Mora-Udjila par Godigong, Mokolo-
Mora par Koza, et Mokolo-Rhumsiki furnt réaménagés dès la première décennie de
l’indépendance (Chétima, 2011).
De nombreuses structures d’hébergement et de restauration furent également
construites, à l’instar du campement de Mokolo en 1972, du centre artisanal de Djingliya en
1982, des restaurants La Casserole en 1987 et le Petit Paris en 1992 (Zra, 1997). Dans la
même perspective, l’agence de tourisme du Nord-Cameroun (NORCAMTOUR) fut créée
en 1970 avec pour objectif de mener un certain nombre d’actions pour la promotion du
tourisme dans la partie septentrionale (Seignobos et Tourneux, 2002). La fin de la décennie
1980 fut par contre marquée par une chute drastique des investissements alloués au secteur
touristique en raison de la crise économique et de l’adoption des politiques d’ajustement
97 Voir à titre d'illustration Paul Hinderling (1984); Jean Boulet (1975); Gardi René, (1973); Yves Schaller (1973); Bernard Juillerat (1971); Jean-Yves Martin (1970); Henry Mary (1969); Antoinette Hallaire (1965); Bertrand Lembezat, (1961).
165
structurel (Zra, 1997). NORCAMTOUR suspend d’ailleurs ses activités et ferme en 1986
(Seignobos et Tourneux, 2002). Cette chute d’investissements s’est particulièrement
traduite par l’arrêt des travaux de construction des routes et des structures d’hébergement,
ayant entrainé la baisse de l’achalandage touristique régional (Chétima, 2011).
Tout au long de cette période correspondant au boom touristique (1960-1980), les
populations se sont livrées à des mises en scène délibérées du mythe de l’ « authenticité »
pour attirer un flux important des touristes dans leurs localités (Chétima, 2011). À Udjila
par exemple, la seule présence des touristes pousse les populations à amplifier leur retard et
à produire des versions strictement imaginées de leurs cultures. Les touristes amenés par
bus à partir de Mora, sont généralement conduits dans les concessions les plus
traditionnelles pour effectuer des visites commentées par des guides locaux, le plus souvent
désignés par le chef du village lui-même. Ces derniers expliquent aux touristes les
différentes étapes de la construction d'une maison podokwo. La visite termine toujours par
la concession du chef qui constitue la principale curiosité touristique locale. Elle est
présentée par les locaux et les guides comme authentique, stable, et vieille de quatre
siècles.98 On retrouve ainsi les mêmes concepts qui ont présidé à la distorsion de l’Autre
montagnard dans le cadre du projet colonial français, à savoir la stabilité, la fixité et
l’authenticité. Seulement, ces images se trouvent ici inversées et retournées aux touristes
pour susciter chez eux une certaine fascination et intensifier ainsi l’activité touristique.
Un détour dans l’histoire du village d’Udjila montre que la construction de la
maison du chef ne remonte pas aussi loin dans le passé. Le site actuel n’est pas le même
que celui occupé à l’installation du clan dans les montagnes. Les autochtones expliquent
d’ailleurs que la concession du chef était auparavant située sur les piémonts de Slala-
Məndaha, et avancent comme principale raison de son transfert sur le site actuel (massif de
Mogodé) la volonté de traduire topographiquement l’autorité du chef sur les « gens du
98Cela apparait par exemple dans l'extrait ci-après: «La tribu Kirdi Moura vous délivre ses secrets, ce peuple entièrement à part, de par son mode de vie vous racontera son histoire. Ces Monts regorgent d’énormes richesses culturelles diversifiées (les us et usages Kirdis, la tombe de Fari le mystique, tombes en canaris ou perforées), on y trouve des vestiges de la Première Guerre mondiale. Vous ferez aussi la découverte d’une chefferie traditionnelle : le chef et ses 50 femmes ainsi que ses 111 enfants ; les différents marchés où les sourires vous accueilleront à chaque étape» (www.camerounsacrevoyages.com).
166
village » (Chétima, 2007)99. Des raisons d’ordre historique pourraient également être
avancées pour expliquer le changement de site. En considérant les données matérielles
(pots ancestraux, tombes ancestrales) contenues dans la maison, et en tenant compte des
noms des différents chefs l’ayant occupé, on peut situer la durée de vie de celle-ci dans
l’intervalle de 100 à 150 ans100. Or, cette date nous fait remonter à la moitié du XIXe siècle,
c’est-à-dire à la période qui suit directement le transfert de la capitale du Wandala à Mora
(fin du XVIIIe siècle)101. Il est possible que les gens d’Udjila durent quitter les piémonts
surplombant la ville de Mora pour s’éloigner du Wandala dont l’intérêt pour les esclaves
est souligné par de nombreux auteurs (Barkindo, 1989 ; Forkl, 1983 ; Mohammadou,
1982). Quoiqu’il en soit, la maison du chef n’est pas « vieille de quatre siècles » comme
présentée dans le cadre des visites touristiques. Elle n’est pas non plus restée stable et fixe,
car en vue de créer de l’espace pour les nouvelles personnes (épouses et enfants en
particulier), elle était sans cesse remodelée et ses hautes murailles sans cesse détruites et
reconstruites (Chétima, 2007).
Autre objet de fascination des touristes, c’est le nombre impressionnant des épouses
du chef : plus d’une cinquantaine selon les autochtones, une information relayée par de
nombreux écrits touristiques102. Pourtant, une enquête réalisée sur la concession cheffale
montre que « la cinquantaine d’épouses » est une invention locale destinée à entretenir
l’activité touristique. Chez les gens d’Udjila en effet, chaque épouse vivant dans la
concession possède son propre domaine architectural comprenant une cuisine, une case à
coucher et deux greniers. Or, il existe au total seize domaines dans les deux quartiers de
femmes qui composent la maison du chef. Deux nouvelles épouses étaient néanmoins
99 Voir le chapitre V pour plus de détails sur le rapport entre site d’habitation et statut social.
100 D’après les données fournies par les locaux, il y a au total quatre générations des chefs qui se sont succédé dans l’actuelle maison. Ces données sont confirmées par la présence de quatre pots ancestraux et de quatre tombeaux correspondant à chacun des monarques ayant occupé la maison avant l’actuel chef.
101 Voir Bawuro, Barkindo (1989) et Eldridge Mohammadou (1982) pour des détails sur le transfert de la capitale du Wandala à Mora.
102Voir par exemple les liens suivants : http://www.dentrodeafrica.com/fr_extremenord.php; http://www.guide.mboa.info/guide-touristique/chefferies-etroyaumes/fr/visiter/actualite/2702,la-chefferie-doudjilla-le-sa-re-du-chef.html; http://www.fagusvoyages.eu/plaintext/franais/circuits/24jours.html; http://www.nomade-aventure.com/fiches-techniques/CMR02F.pdf;
http://nirvatravel.com/fra/46-cameroun/75-safari-dans-le-nord-du-cameroun-circuit-3
167
logées dans deux cases situées hors des quartiers d’épouses, ce qui portait à dix-huit le
nombre total des épouses vivant dans la concession au moment de l’enquête en 2007. Sur la
base de ces observations, j'ai réalisé une nouvelle entrevue avec le chef et d’autres
informateurs à l’issue de laquelle ils admirent que le chiffre de cinquante est une
exagération destinée à séduire le Blanc et à nourrir sa curiosité touristique.
Il y a donc un décalage entre le discours sur l’authenticité telle que véhiculée par les
habitants et les faits. Ce décalage vient du fait que les guides locaux fournissent des
informations qui épousent la demande touristique. Ils savent que les touristes sont à la
recherche d’une société pure, immuable, vierge et exempte d’influences extérieures. Les
avantages avant tout économiques de leur présence amènent à remanier les divers éléments
du patrimoine culturel local, conduisant à des reconfigurations identitaires (Doquet, 2002 ;
Brown, 1999 ; MacCannel, 1992 ; 1976, 1973). Dans cette logique, comme le souligne le
penseur de l’hyper-réalité, Umberto Eco, « le faux est reconnu comme historique et comme
tel, il est déjà revêtu d’authenticité » (1986 : 33).
Au demeurant, suivant leurs intérêts économiques, les acteurs locaux ont
constamment recyclé les stéréotypes créés par les pouvoirs coloniaux pour réinventer leurs
traditions (Ranger, 1993) en vue d’en faire un des moteurs-clés du développement du
tourisme. Non seulement, ces traditions sont de facture récente, puisqu’elles sont à situer
dans le contexte de la création des imaginaires coloniaux, elles sont surtout artificiellement
inventées avec pour seul objectif d’accroitre l’achalandage touristique régional. C’est dans
cette même logique d’« invention des traditions » (Hobsbawm et Ranger, 1983) que
s’inscrit la nouvelle dynamique identitaire à l’œuvre depuis l’avènement de la
démocratisation en 1990 ; une identité centrée cette fois-ci autour du thème de la
victimisation.
4. Démocratisation et inscription de l’idéologie victimaire dans l’espace public de 1990 à 2011
Si la résistance anticoloniale valorisant la réputation guerrière des Montagnards était
la marque de fabrique au sortir de la colonisation, la période suivant la démocratisation a
davantage favorisé la montée d'une revendication mémorielle construite autour de l'identité
168
victimaire. Celle-ci est devenue un sujet très idéologisé revenant périodiquement dans les
discours publics, à différents niveaux et dans diverses circonstances. En prônant la posture
victimaire, les Montagnards revendiquent une certaine justice sociale laquelle devrait se
traduire par leur accès dans les rouages du pouvoir (Bigombe, 1999 : 250). Autrement dit,
le souci de participation à la vie politique sonne comme un « enjeu de libération et de
décompression des normes, des codes et des logiques qui ont consacré, dans la longue
durée, l’hégémonie des royaumes musulmans » (Zelao, 2012 : 23).
Par le statut de « victimes de l’histoire », les Montagnards tendent à utiliser la
mémoire servile pour créer et renforcer leur solidarité interethnique à la faveur de la
création de l’identité montagnarde103. En effet, prise individuellement, aucune ethnie des
monts Mandara ne peut constituer un enjeu démographique pour le régime politique en
place. Cependant, dans leur globalité, elles représentent l’un des taux démographiques les
plus élevés du Cameroun (Bigombe, 1993 ; Fendjoungué, 1993). En tant que telles, les
identités et les velléités ethniques sont de plus en plus mises de côté au profit de la création
et de la valorisation d’une identité régionale désormais construite autour de la mémoire
servile. On peut légitimement considérer cette nouvelle tendance comme relevant d'une
« logique du terroir » permettant surtout à l’élite locale de promouvoir son statut de porte-
parole ethnique sur la scène politique nationale, et de s'assurer ainsi de la loyauté de leurs
populations (Mouiche, 2000; Bigombe, 1999). Une élite locale postule que :
Si nous sommes différents les uns des autres de par nos langues, nous partageons en commun le même cadre géographique (les montagnes) et les mêmes héritages historiques (l’esclavage et la colonisation), car nous avons été victimes de la traite musulmane. On ne devrait pas parler des Podokwo, des Muktele, des Mafa, des Mofu ou des Uldeme. Nous sommes des montagnards, point à la ligne, et nous avons un même passé qui fait de nous une seule communauté (entretien avec Gouada, homme de 39 ans, le 20 juillet 2006 à Yaoundé).
L’histoire servile fait dès lors l'objet d’une opération de domestication et de
réappropriation dans le contexte démocratique à l’œuvre au Cameroun. L’objectif de la 103 Voir le chapitre IV pour plus de détails sur l’instrumentalisation de l’ethnicité dans le contexte de la transition démocratique, notamment à travers l’utilisation des symboles et des métaphores architecturaux.
169
création de la Dynamique Culturelle Kirdi (DCK) en 1991 entre en droite ligne avec ce
souci de rassembler toutes les ethnies non-musulmanes. La finalité de cette
« confédération ethnique» était d'inscrire l’idéologie victimaire dans l’espace public
national. C'est dans ce sens que les élites locales rassemblées au sein de la DCK rédigent en
1993 un mémorandum intitulé Mémorandum de la majorité opprimée du Grand Nord-
Cameroun qu’elles adressent au Président de la République. Les rédacteurs y dénoncent,
entre autres, l’exclusion de la majorité kirdi, l’extension de l’islam à toutes les populations
montagnardes, le retard de la scolarisation et du développement (Mouiche, 2000, 1996;
Bigombe, 1999; Fendjoungue, 1993). Dans ce registre s’inscrit également le
« Mémorandum des montagnards chrétiens et animistes du Mayo-Sava » écrit en 2009 par
un collectif d’élites locales. Les auteurs revendiquent une certaine justice sociale,
dénoncent l’exclusion de la majorité des Montagnards animistes au profit de la classe
d’élites essentiellement musulmanes et issues d’une « minorité démographique ». L’histoire
servile est donc mise en avant dans les différentes revendications sociales pour, non
seulement fédérer les différents groupes ethniques jadis antagonistes, mais également se
constituer en groupes de pression avec l’objectif d’inverser les logiques de la domination
musulmane. D’où le concept de « minorités politiques104 » (Fendjoungué, 1993; Bigombé,
1993) régulièrement utilisé pour dénoncer cette disproportion entre l’importance
démographique des populations et leur représentation au sein de la fonction publique.
Par ailleurs, le terme kirdi qui était autrefois rejeté par les populations, est
aujourd’hui intégré au discours politique national. Les élites locales se sont d’ailleurs
approprié le concept de la kirditude élaboré par Jean-Marc Ela pour souligner leur fierté
104Le concept de « minorité politique » ne renvoie pas forcément à l’effectif démographique, comme c’est le cas lorsqu’on définit les minorités ethniques. Il renvoie plutôt à la question de la représentation politique des différents groupes ethniques dans l’appareil d’État. À ce sujet, Geisser (1996) écrit qu’en tant que « minorité politique », un groupe ethnique se retrouve dans une situation sociale défavorable en ce qu’il manque de représentants dans l’appareil d’État. Stasiulis et Abu-Laban (1991) abondent dans le même sens lorsqu’ils considèrent la représentation politique des groupes ethniques comme étant indispensable pour la défense de leurs intérêts au niveau de l’État. Dans le cadre des memoranda, les auteurs font généralement usage du concept de « minorité politique » pour l’inscription de leur groupe ethnique sur l’échiquier régional et national, même si au final ces revendications s’inscrivent plutôt dans la logique de la commercialisation et du marchandage des solidarités primaires en vue de s’approprier une partie du « gâteau national » mis en compétition par l’État. Voir Luc Sindjoun (1999).
170
d’avoir un fond kirdi (Ela, 1994 : 8). Ce concept, devenu très politisé depuis les années
1990, leur sert de paravent dans leur entreprise de protestation contre l’exclusion et la
discrimination dans l’arène politique actuelle (Saibou, 2005 ; Bigombe, 1999). Il dénote
également une prise de conscience de leur poids démographique et de leur force politique
(Schilder, 1993 : 119). Jean Baptiste Baskouda, une des figures politiques montagnardes,
en a fait une apologie :
Je suis kirdi et me glorifie de ce nom. Sur ma face on a jeté ce mot avec maladresse. Me voici homme-parjure, homme-crachat qui se redresse ; avec courage j’ai décidé de le ramasser tendrement, en me revendiquant comme tel, sans rancune, sagement. Et pourquoi ? (Pourquoi donc ces lugubres lamentements) ? Pourquoi soudain ces hypocrites ? Ces sombres indignations ? Les maîtres-créateurs pouvaient-ils oublier qu’importe le lieu où vous jetez le fumier, tôt ou tard, il fertilise et fait germer […]. Moi, le Kirdi, je suis fier de ma chanson de sagesse ; fier de la sagesse de mon combat ; fier du combat pour ma survie (1993 : 74-80).
Au demeurant, la kirditude traduit le refus d’être assimilé par le modèle culturel
islamique et la volonté de constituer un mouvement politique. Les années sombres des
conquêtes, d’asservissement et d’hégémonie des royaumes péri-tchadiens ont nourri des
frustrations qui ne pouvaient s’exprimer que par le refoulement dans le contexte
monolithique du gouvernement Ahidjo (1960-1982). Le régime Ahidjo était d’ailleurs
considéré par les Montagnards comme étant hostile à leur expression identitaire, car
marqué par la primauté de la « dictature du silence » ou de ce que Achille Mbembe appelle
l’« État théologien » (Mbembe, 1986).
Au plan politique, l'idéologie victimaire s’est traduite par la création d’un parti
politique de souche kirdi, le Mouvement pour la Défense de la République (MDR), destiné
à contrebalancer la création de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
soupçonné de servir de paravent à l’hégémonie musulmane (Adama, 2004 :163). En effet,
l’UNDP dirigée depuis janvier 1992 par Bello Bouba Maigari d’origine peule, est
considérée par les Montagnards comme exclusivement musulmane et, de ce fait, suspectée
d’être un nouvel instrument de leur asservissement (Socpa, 1999). Le slogan peul prôné par
171
ce parti : « Cameroun wartan bana nane » traduit en français par « le Cameroun deviendra
comme avant », est alors interprété par les Montagnards comme une nouvelle marche vers
la renaissance de l’hégémonie islamo-peule.
Il ressort donc que les revendications mémorielles sur fond victimaire en cours dans
les monts Mandara servent essentiellement à des fins idéologiques et politiques. Elles
participent davantage de la maximisation des intérêts particuliers des élites et servent de
« de cheval de bataille politique à des personnes en quête d’un espace de positionnement
sur la scène politique nationale» (Bigombe, 1999 : 250). La finalité est de se constituer
un capital politique et de se positionner en clients politiques vis-à-vis d’un pouvoir en quête
de l’électorat. Dès lors, l’histoire servile saisie comme lieu de mémoire sert de pilier à la
régulation des postures politiques des élites montagnardes. Tzvetan Todorov explique bien
la logique d’une telle idéologie victimaire lorsqu’il écrit :
Si l’on parvient à établir de façon convaincante que tel groupe a été victime d’injustices dans le passé, cela lui ouvre dans le présent une ligne de crédit inépuisable. Puisque la société reconnaît que les groupes, et non seulement les individus, ont des droits, autant en profiter ; or plus grande a été l’offense dans le passé, plus grands seront les droits dans le présent. Au lieu d’avoir à lutter pour obtenir un privilège, on le reçoit d’office par sa seule appartenance au groupe jadis défavorisé » (Todorov, 1995 : 50).
Il serait donc illusoire de saisir le comportement actuel de ces « gens de montagne »
en faisant fi de l’histoire des raids esclavagistes et de la colonisation européenne. La
récupération de la mémoire servile s’apparente dès lors à ce que Charles Maier
appelle « the surfeit of memory » (1996), concept par lequel il désigne des communautés
excessivement obsédées par les torts commis contre eux, lesquels sont récupérés pour servir
à la construction des identités centrées autour des notions de victimisation et de réparation.
Conclusion
Maurice Halbwachs avait déjà souligné que dans le cadre de leurs rapports avec le
passé, les individus révisent constamment les cadres sociaux de la mémoire pour servir les
intérêts du présent. Aussi, cet auteur montre que le discours mémoriel, contrairement au
172
passé historique, est anachronique par nature (Halbwachs, 1950 : 50). Ce discours n’existe
pas en tant que fait réel, mais en tant que construction permanente en lien avec l’identité
sociale à défendre dans le présent (Jewsiewicki, 2011 ; Hartog, 2003). Ce regard sur le
travail mémoriel est davantage souligné dans les sociétés ayant connu la servilité, comme
celles vivant dans les monts Mandara dans lesquelles on observe une révision constante du
discours sur le passé. Le travail de ré-interprétation des éléments du passé s’effectue en lien
avec le contexte temporel qui détermine lui-même la transmission ou le refoulement de tel
ou tel aspect. Comme le montre Bogumil Jewsiewicki, la capacité de se souvenir, de parler
ou de commémorer un passé « tragique » se fonde implicitement sur la capacité de trier et
de mettre sous silence certains évènements de ce même passé, lesquels peuvent resurgir à
mesure que le contexte de sa mise en silence change (2011 : 4). C’est dans ce sens que le
discours mémoriel des Montagnards a, jusqu’aux années 1990, refoulé la mémoire servile
pour lui substituer d’autres formes de mémoire construites à travers les mythes d’une part,
et des chants historiques d’autre part. Mythes et chants ont fonctionné comme des
mécanismes de domestication de l’histoire « officielle » dans la mesure où ils ont permis de
véhiculer un discours alternatif, construit autour du refoulement et de la transmission
symbolique de la servilité.
La dichotomie entre les deux modes de discours – historiques et mémoriels – à
l’époque coloniale est cependant devenue imprécise dans la mesure où l’histoire coloniale,
construite sur la base des imaginaires, a été domestiquée et mimée par les Montagnards. La
définition du Montagnard, barbare et authentique, entretenue tout au long de la période
coloniale française (1916-1960) sonnait comme un processus d'altérisation, (Saïd, 1980)
dont le but était de le distancer et de le fixer dans l’image d’un être lointain, marginal et
exotique, de façon à l’inférioriser et à le déposséder de son soi à lui (Spivak, 1999;
Shurmer-Smith et Hannam, 1994: 89). La création de l’imaginaire d’un peuple rebelle et
sauvage était quant à elle importante pour justifier la politique de la pacification qui était au
fondement même de l’entreprise coloniale française en Afrique.
Cependant, dans cette volonté de domination épistémique (Spivak, 1999), le
Montagnard ne s’est pas cantonné à un rôle passif et ne n’est pas contenté d’arborer son
statut de l’«ombre de soi » du colonisateur (Spivak, 1990 : 31). Au contraire, il s’est engagé
173
dans un processus de résistance. Celui-ci a impliqué, d’une part, l’apprivoisement de
l’image coloniale de « peuples rebelles et sauvages » pour produire un discours identitaire
valorisant de soi, à savoir l’image de peuples résistants et travailleurs. D’autre part, il a
impliqué le mimétisme du mythe colonial de l’authenticité, notamment dans le cadre du
développement du tourisme culturel dans les années 1960 (Chétima, 2011b). À partir de
1990, la mémoire coloniale se voit surclassée par celle de l’esclavage dans le contexte de la
transition démocratique, lequel permet désormais aux Montagnards de s’afficher comme
des victimes de l’histoire, et à ce titre, de réclamer des réparations sous la forme des
dividendes politiques, à travers notamment la participation à la vie politique nationale.
La lecture plurielle du passé commun aux groupes ethniques est donc
consubstantielle au passé servile et colonial, qui constitue de fait leur « réservoir
symbolique de représentation » (McIntosh, 1992; 1989). En tant que tels, les différents
groupes ethniques y puisent des éléments de légitimation de leurs discours mémoriels et de
leurs dynamiques identitaires qui en sont les corolaires (McIntosh, 1989: 77). Judith Sterner
(1992) a d’ailleurs étendu ce concept de réservoir symbolique aux monts Mandara pour
étudier les constructions identitaires et les relations sociales plus ou moins ambigües
entretenues par les groupes montagnards entre eux d’une part, et entre un groupe
montagnard et les Wandala d’autre part. Si l’esclavage et la colonisation constituent
un réservoir symbolique structurant et orientant les discours mémoriels et identitaires, la
maison et les objets domestiques leur sont apparus comme des cadres de production et de
communication des différentes facettes identitaires, lesquelles par définition sont tout aussi
situationnelles et contextuelles.
175
Chapitre IV
La maison comme cadre de production et de communication des identités ethniques
De nombreux travaux d’ethnologues et d’anthropologues ont investi le champ de
recherche portant sur l’identité, et en particulier sur l’identité ethnique. Certains spécialistes
affirment qu'il existe une base primordiale à l’identité ethnique (Conversi, 2007; Smith,
2003; Kellas, 1991; Scott, 1990; Van Den Berghe, 1978; Isaacs, 1974; Geertz, 1963; Shils,
1957) tandis que d’autres l’expliquent en constructivistes (Laitin, 1998; Turgeon,
Letourneau et Fall, 1997; Hardin, 1995; Barth, 1994; Eller et Coughlan, 1993; Menteil,
1993; Eriksen, 1993; Jewsiewicki et Letourneau 1992; Anderson, 1991; Cohen, 1974,
1978; Barth et al., 1969). Pour les premiers, les identités ethniques sont des caractéristiques
profondément enracinées dans la généalogie, la culture et la langue (Van den Berghe, 2005:
118; Horowitz, 2002: 72-82; Kellas, 1991:12-13; Scott, 1990:150; Geertz, 1963:109). Pour
les seconds, elles sont des choix pragmatiques entrepris par des acteurs (MacEachern,
2007: 397-405; 2002: 201; 1991: 269; David, Gavua, MacEachern et Sterner, 1991: 174;
Cohen, 1978: 378; Barth, 1969: 14). Ces débats ont souvent été formulés en termes
dichotomiques opposant primordialistes aux constructivistes105. Les études plus récentes
(MacEachern, 2011, 2007; Rudolph, 2006; Anderson, 2006; Alcoff, 2003; Joireman, 2003)
ont cependant remis en question l’explication primordiale autrefois dominante, en validant
les conclusions établies par Fredrik Barth (1969). Contrairement aux primordialistes qui
étudiaient les groupes ethniques dans une ethnographie séparée, Barth et ses collaborateurs
ont conduit une recherche comparative dans laquelle ils ont observé la manière dont les
groupes maintiennent et entretiennent les frontières entre eux bien que leurs cultures soient
similaires et indistinctes (Barth, 1969), et bien que les individus puissent se mouvoir de part
et d’autre des limites ethniques (Haaland, 1969: 59).
105 Les premiers souscrivent à une adhésion ethnique par la naissance, et les seconds suggèrent plutôt que les individus choisissent entre différentes identités selon leurs intérêts économiques et politiques.
176
En m'inscrivant dans la lignée de Fredrik Barth et de ses collaborateurs, je considère
l’ethnicité comme un processus historiquement constitué, jouissant d'une grande élasticité,
qui sur la base d’éléments partagés, joue des morceaux différents au gré des contextes, des
lieux et des acteurs. Cependant, prolongeant ce qu'écrit Fredrik Barth, je m'inscris dans
l'approche élaborée par Ian Hodder (1985; 1982; 1979) et par Arjun Appadurai (1996) qui
ajoutent à l’approche barthienne une dimension psychologique en connectant la culture
matérielle à l’identité ethnique. Dans un travail ethnographique mené chez les ethnies du
Baringo au Kenya, Ian Hodder (1982)106 observe que les objets ne sont pas simplement
utilisés comme de simples insignes passifs de l’appartenance à un groupe, mais qu’ils sont
constitutifs de l’ordre social et utilisés pour souligner ou pour refuser, pour maintenir ou
pour perturber les distinctions ethniques dans l’objectif d’obtenir des gains économiques
(Hodder, 1982: 85). Toutefois, Arjun Appadurai postule que l’activation de critères de
différence entre deux groupes n’est pas toujours motivée par la poursuite des gains
économiques et politiques (Appadurai 1996: 14). En mettant l’accent sur les traits culturels,
Appadurai, remet, comme Hodder l’a fait, la culture matérielle en corrélation avec l’idée de
l’appartenance ethnique. Plus encore, il réévalue le rôle de marqueurs identitaires pour les
définir comme un ensemble dynamique de traits matériels sélectionnés, investis d’une
valeur symbolique, et activement utilisés comme critères de différenciation par rapport à
d’autres groupes (Appadurai, 1996: 13-14).
En suivant Ian Hodder et Arjun Appadurai, mon approche s’éloigne légèrement de
celle adoptée par de nombreux anthropologues, politologues et historiens ayant étudié
l’ethnicité en Afrique (Otayek, 2001 et 2000; Amselle, 1999 et 1990; Cahen, 1994;
Comaroff, 1987; Amselle et M'Bokolo, 1985) concernés davantage par le rôle des
circonstances historiques (coloniales en particulier) dans l’émergence des sentiments
ethniques. Pour ma part, je m'intéresse surtout à une analyse ethnographique détaillée des
constances et des ruptures dans les représentations matérielles de l’identité ethnique à partir
notamment des années 1940, période correspondant à la création des cantons en territoire
montagnard. Même si ces deux aspects, ethnogenèse et composante culturelle, sont
106Beaucoup d'auteurs (Miller, 2005; Meskell, 2004 ; Riggins, 1994; Buchli, 2002, 2000 [1999]; Olsen et Kobylinski, 1991; David et MacEachern, 1990; Appadurai, 1986) suivront Hodder en explorant le rôle de l’art, de la poterie en particulier, dans les sensibilités intergroupes.
177
inextricablement liés, les données collectées dans le cadre de cette recherche et mes
observations sur le terrain m’amènent à me porter davantage sur la manière dont les
Podokwo, les Mura et les Muktele construisent et maintiennent les frontières sociales.
Ainsi, j’avance l’argument que les éléments architecturaux sont activement et sélectivement
utilisés par les acteurs pour construire, reconstruire, négocier, et dans une certaine mesure,
supprimer leur identité au gré du contexte dans lequel ils agissent et ce, en mettant en
lumière quatre principales dimensions identitaires : l’'identité montagnarde exprimée à
travers des éléments architecturaux communs et construits en opposition aux Wandala de la
plaine; les identités particulières des groupes montagnards mises en valeur à travers les
spécificités architecturales propres à chaque ethnie, et variables selon qu’on interagisse
avec tel groupe ou tel autre; une constellation de représentations identitaires consécutive à
la descente des Montagnards en plaine, allant du repli identitaire à sa suppression en
passant par sa mise en parenthèse; enfin, l’identité régionale reproduite dans le contexte de
transition démocratique par des élites montagnardes en quête d’un positionnement
politique, et construite autour de l’iconographie et de la métaphore architecturales.
I. Identité montagnarde ou comment la maison abolit les frontières ethniques
Il était une fois, les hommes vivaient sous des arbres comme des animaux de
champs. Mais ces arbres ne les mettaient pas à l’abri de la pluie, du soleil et du vent.
Chaque fois qu’il pleuvait, les hommes se retrouvaient sous la pluie. Un jour, un homme
décida de trouver une solution à ce problème. Il était imaginatif et se dit: à quoi bon rester
sous des arbres qui ne protègent guère de la pluie? Il décida d’aller observer comment font
les animaux de la montagne. Alors, il observa d’abord la panthère, celle-ci dormait sous les
rochers. Ensuite, il observa le singe, celui-ci dormait sur des troncs d’arbre. Il observa enfin
la souris, celle-ci vivait dans le trou. Il apprécia la façon de faire de la panthère et décida de
construire une maison de pierres. Malheureusement, la maison s'écroula aussitôt construite.
En interrogeant un devin, celui-ci lui conseilla d’offrir d’abord des sacrifices aux ancêtres
et de fixer sa maison en haut de la montagne où se trouve l'esprit des ancêtres. Il suivit le
conseil du devin et fit des sacrifices. Il construisit d’abord son grenier, ensuite les cuisines
et les chambres des épouses, et enfin les vestibules. Il retourna chercher les autres en
plaine; certains le suivirent, d’autres refusèrent. Ceux qui le suivirent devinrent tous des
178
gens de la montagne, et ceux qui restèrent devinrent des musulmans (entretien avec
Matsama, homme de 65 ans, le 22 mars 2007, à Makulahe).
Ce conte m’a été raconté pour la première fois en mars 2007 lors des travaux de
construction du mur d’enceinte d’Ussalaka, un Podokwo habitant le village de Makulehe.
Une variante m’a aussi était racontée par Madjagola, un répondant muktele de Baldama
(entretien avec Madjagola, homme de 60 ans, le 30 avril 2007, à Baldama). Il n’est pas
important qu’il soit pris comme une histoire vraie au sens littéral du terme, mais seulement
comme un récit ouvrant une perspective intéressante sur la dichotomie entre « gens de la
montagne » et « gens de la plaine ». À considérer le conte, on observe que cette dichotomie
est, non seulement associée aux pratiques architecturales communes aux groupes
montagnards, mais également à des pratiques religieuses associées à l’habitat.
1. « Se dire montagnards » par des pratiques architecturales qui se ressemblent
Les habitations montagnardes sont certes diverses, et chaque ethnie possède son
propre modèle de construction (Chétima, 2010: 42; Seignobos, 1984: 181; 1982: 35;
Hallaire, 1965: 9-11). Cependant, plusieurs traits communs sont utilisés pour marquer la
différence avec les Wandala de la plaine. Le premier élément différenciateur est sans doute
la pierre: « Un Montagnard qui regarde avec dédain une maison de pierres est sûrement sur
le point de devenir un Wandala », spécule Tekuslem (entretien avec , homme de 75 ans, le
11 décembre 2011, à Baldama). Dans toutes les ethnies, la pierre se présente comme la base
même de l’architecture, et est le matériau le plus représentatif de la construction (voir
Chétima, 2011: 59; Seignobos, 1982: 32). Certains groupes l’utilisent à l’état brut, d’autres
fractionnent des blocs rocheux au moyen du feu et des pierres roulées servant d’enclumes.
Malgré ces variantes dans le travail de la pierre, tous les Montagnards interrogés sont
unanimes sur le fait que c’est la pierre qui distingue leurs maisons de celles des « gens de la
plaine ». Certes, son emploi dans l’architecture a à voir avec la rareté de la terre argileuse
dans les montagnes et de l’eau pour la travailler (Vincent, 1997: 338-342), mais la pierre
rêvait tout de même une connotation identitaire, comme le stipule un de mes informateurs,
Zabga Valla :
179
Un bon Montagnard ne doit pas habiter dans une maison de terre. Il doit montrer son ardeur au travail en se faisant construire une maison en pierres. Construire une maison en pierres est rude et difficile, c’est pourquoi les gens de la plaine préfèrent une maison en terre. La maison en pierres est réservée à la race des gens travailleurs. Partout où tu trouveras de telles maisons, il se trouve là un peuple travailleur. Partout où tu trouveras des maisons en terre, là se trouve un peuple paresseux qui vit aux dépens des gens travailleurs (entretien avec Zabga Valla, homme de 62 ans, le 18 mars 2012, à Udjila).
L’affectation de la pierre à un usage architectural est diverse et des variantes
existent entre les ethnies. On remarque qu’elle est partout utilisée pour la construction des
structures considérées comme masculines (case du père, vestibules, chèvreries et étables).
Les cases des femmes en revanche sont construites en argile. La pierre, disent les
Montagnards, est le symbole de la continuité, de l’éternité et de la durabilité. L’argile par
contre symbolise la fragilité, la vulnérabilité et la faiblesse (Chétima, 2011: 95). C’est la
raison pour laquelle les chambres des hommes sont construites en pierre tandis que celles
des épouses sont en argile (entretien avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 27 avril 2007
à Godigong). Plus que des maisons faites de pierres et d’argile, les habitations offrent un
espace de représentation des identités sexuelles et sociales au sein d’un ménage. Dans cette
perspective, les femmes et les enfants en bas âge avaient leurs demeures dans des cases
d’argile. «Les femmes sont fragiles comme de l’argile, c’est pourquoi on les fait habiter
dans des cases d’argile », me confient régulièrement mes informateurs lors de mes séjours
de recherche.
Par ailleurs, l’argile est considérée par les Montagnards comme caractéristique des
maisons wandala, d’où l’analogie métaphorique entre femmes et Wandala très courante
dans les monts Mandara. Toutefois, cette analogie exprimée à travers l’utilisation des
matériaux (pierre = homme = Montagnard; argile = femme = Wandala) n’est pas à prendre
dans son sens premier dans la mesure où il n’existe aucune similitude sexuelle entre les
femmes et les Wandala. Elle n’exprime pas non plus l’idée que ces derniers seraient un
groupe constitué d’individus faibles, fragiles et vulnérables comme sont représentées les
femmes dans l’imaginaire montagnard. L’analogie juxtapose plutôt les vrais « gens de la
montagne » (hommes montagnards) et ceux qui sont étrangers (épouses au sein de la
maison et Wandala). Comme le signale déjà Bernard Juillerat (1971: 133), et Diane Lyons
180
(1992: 135-138), la femme est considérée dans presque toutes les communautés
montagnardes comme un élément mobile de la société. Même lorsqu’elles sont intégrées
dans la maison conjugale, elles sont toujours considérées comme des étrangères et se
sentent comme telles. Dans ce sens, elles sont susceptibles de quitter la maison conjugale et
le village quand elles le souhaitent.
Par exemple, dans les trois localités de montagne (Udjila, Baldama et Dume) que
j’ai retenues dans le cadre de cette étude, il est de coutume qu’une femme nouvellement
mariée arrive dans la maison de son mari avec ses propres objets domestiques (ustensiles de
cuisine, jarres d’eau, literie, parure, etc.)107. Lorsqu’elle prend la décision de quitter
définitivement son mari, elle emporte avec elle tous ses objets personnels; un acte signifiant
la destruction symbolique et active de sa présence au sein de la maison conjugale. En
revanche, une femme qui souhaite se séparer temporairement de son mari quitte la maison
en laissant derrière elle ses objets constituant de ce fait un espoir de retour108. La femme
n’est donc pas intégrée comme membre à part entière dans la maison, et elle ne joue aucun
rôle important dans le déroulement des rituels destinés à assurer la continuité de la maison,
excepté la première épouse. Elles sont, de la sorte, symboliquement similaires aux
Wandala, aussi considérés comme des étrangers au sein de l’espace humanisé de la
montagne. Le symbolisme du genre crée donc une équivalence analogique entre les épouses
des Montagnards et les Wandala en soulignant les parallèles entre la représentation
matérielle de la femme (argile) et l’utilisation de ce même matériau dans la maison
traditionnelle des Wandala109. Ce que la femme est au sein de la maison conjugale, le
Wandala l’est au sein du terroir montagnard.
107 Ces pratiques sont à certains égards observables non seulement dans les localités de montagne, mais également dans les villages de la plaine (Godigong, Tala-Mokolo, Mora-Massif) étudiés dans le cadre de ce travail. Autrement dit, il s’agit d’un habitus (Bourdieu, 1984) qui traverse le temps même si les cas de divorces sont beaucoup moins présents aujourd’hui que par le passé. Néanmoins, lorsque la femme entreprend de quitter définitivement le ménage, elle le fait avec tous ses objets personnels ; signifiant ainsi l’acte de divorce conjugal.
108Lorsque les femmes voulaient attirer l’attention de leurs maris sur un mauvais traitement dont elles faisaient l’objet, elles emportaient tous leurs ustensiles pour les garder chez une voisine, ceci pour effrayer leurs maris car l’absence des objets de la femme était interprétée comme le signe éventuel d’un départ définitif de la maison (entretien avec Kwetcherike, homme de 60 ans, le 17 novembre 2011, à Dume).
109L’aspect culturel le plus saillant dans cette représentation symbolique des relations de genre au sein de la maison n’est donc pas seulement la différenciation entre hommes et femmes. Elle concerne la différenciation entre les Montagnards et les gens du dehors, c’est-à-dire les étrangers ou plus exactement les «gens de la plaine» pour utiliser l’expression la plus courante de mes informateurs.
181
On remarquera en outre que toutes les ethnies montagnardes ont une préférence
marquée pour les altitudes (Van Beek, 2014; Chétima, 2011; Smith et David, 1995; Lyons,
1992; Hallaire, 1991). La maison elle-même est organisée en deux parties; la partie
masculine située en haut et la partie féminine en bas. Ici encore, les Montagnards utilisent
les représentations imagées du haut et du bas pour juxtaposer les femmes et les Wandala
comme partageant des caractéristiques communes. Les hommes, au sein de la maison,
logent dans la partie haute, car la hauteur est synonyme de prestige. Les femmes sont en
contrebas parce que celui-ci porte en lui le symbole de la bassesse (Lyons, 1992: 129;
Hallaire, 1991: 47). Certes, la signification allégorique du bas est difficilement applicable
aux Wandala dans la mesure où les Montagnards reconnaissent qu’ils leur sont supérieurs
socialement et économiquement. Il faudrait voir ici encore le même souci de les cataloguer
en tant qu’étrangers au même titre que les femmes. Il y a presqu’un rapport étroit entre le
statut d’allogène et les basses altitudes. Par exemple, lorsqu’un groupe d’hommes se
réfugient au sein d’une ethnie à la suite d’une période de famines ou d’incidents intra-
ethniques, ils sont considérés dans le nouveau village comme des étrangers. Par
conséquent, la parcelle de terrain qui leur est accordée pour la construction de leurs
maisons se trouvait en bas, dans les plateaux internes (Hallaire, 1991).
Parce que vivant en plaine ou, plus exactement en brousse selon la terminologie des
Montagnards, les Wandala apparaissent sous la même forme métaphorique que les femmes
et les étrangers. Dans les travaux de construction, les personnes qui présentant aussitôt des
signes de faiblesse sont concomitamment qualifiées de femmes et/ou de wandala. Les deux
questions: « Mon ami n’es-tu pas un Wandala par hasard? » et « Mon ami tu es sûr que tu
es un homme? » sont utilisées pour ridiculiser ceux qui se fatiguent tôt, de même que ceux
qui, à un âge avancé, n’ont pas appris le travail architectural (entretiens avec Dawcha,
homme de 58 ans, le 03 mai 2012 à Mora-Massif; avec Dougzum, femme de 40 ans, le 30
octobre 2011 à Tala-Mokolo). Comme les femmes, les Wandala sont des personnes qui ne
peuvent pas accomplir des travaux manuels: « les Wandala ne peuvent pas travailler
comme nous les Montagnards. Ils sont paresseux, et c’est pour cela qu’ils payent les gens
pour travailler à leurs places », explique Mesləpe Ragwa (entretien avec homme de 24 ans,
entretien, le 10 mars 2012, à Udjila). La féminisation des Wandala ne résulte donc pas des
similitudes physionomiques et sexuelles perçues entre eux et les femmes. Elle résulte plutôt
182
d’une analogie structurelle établie par l’utilisation du sexe comme une métaphore de
dénigrement.
En outre, certaines unités et pratiques architecturales sont considérées comme
spécifiquement montagnardes et aident à marquer la différence avec l’autre musulman.
Dans les trois ethnies, les informateurs mentionnent le grenier comme l’élément le plus
fondamentalement montagnard. Ils sont d’ailleurs partout structurés de la même façon et
sont utilisés dans le marquage de la frontière avec les Wandala: « Le grenier est important
pour conserver les vivres, mais surtout il est au centre des cultes rendus aux ancêtres. C’est
pourquoi les Wandala n’ont pas de greniers parce que leurs ancêtres ne restent pas dans la
maison » (entretien avec Kwetcherike, homme de 60 ans, le 17 novembre 2011 à Dume).
Comme le mentionne le mythe cité plus haut, les répondants indiquent que la construction
d’une maison montagnarde commence presque toujours par l’édification d’un grenier110.
Une même discipline régit la descente dans les greniers; la consigne la plus stricte étant
l’interdiction formelle aux femmes de s’introduire dans celui du chef de famille. Celle qui
sera surprise en train d’y entrer ou d’y sortir sera traitée comme une voleuse et sanctionnée
comme telle (Chétima, 2006: 38).
Les unités d’habitation ont en outre une place définie au sein de la maison
montagnarde, et sont disposées selon le même principe dans toutes les ethnies. Les trois
groupes attribuent un rôle privilégié au domaine de la première épouse dans l’organisation
de la cour intérieure. Sa case à coucher, située à l’opposé de la case sacrificielle, sert de
pivot dans la répartition des autres cases avec certes de petites variantes ethniques. L’étable
fait face à la case de l’homme. Les enclos à bétail pour les chèvres jouissent d’une position
privilégiée, en ce qu’ils sont toujours construits dans la partie masculine de la maison. La
case du père est partout située à l’entrée de la concession pour lui permettre de jouer son
rôle de vigile. L’aire des greniers et le quartier d’épouses sont situés au fond, et par
conséquent, les non-initiés au domaine ne peuvent pas facilement y arriver sans se faire
attraper par le chef de famille, et par ses fils établis à l’entrée de la concession (entretiens
avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à Mora-Massif; avec Vaza Kamba, 110Dans tous les groupes montagnards, les greniers sont disposés dans une salle qui leur est consacrée au cœur de l’habitation. Les greniers de l’homme (deux ou trois) se distinguent de ceux des épouses en ce qu’ils ne sont pas compartimentés. Ils contiennent la quasi-totalité des récoltes du ménage en mil. Le grenier des épouses en revanche sont compartimentés pour recueillir les divers produits (haricot, arachide, sésame, pois de terre, etc.), les condiments pour les sauces et les produits de beauté et de parure de la femme.
183
homme de 50 ans, le 12 mars 2012, à Udjila ; avec Ambaya, femme de 35 ans, le 22 juin
2012 à Dume).
L’architecture témoigne donc de l’appartenance au grand groupe montagnard. Elle
agit comme un véhicule dans la transmission des valeurs et croyances fondamentales
(Buchli, 2013 :59; Tilley, 2002: 30) à propos des différences qu’il y a entre les gens de la
montagne et les Wandala, gens de la plaine. Ainsi, la maison pourrait-on dire, est utilisée
comme un agent de socialisation (Miller, 2001 : 119), et révèlent en même temps son
potentiel dialogique (Douglas, 1994: 9-22; Duncan, 1989: 230-250; 1985: 135-139) de
représentation et de construction du Soi montagnard par rapport à l’Autre wandala.
Cependant, la maison ne peut révéler cette portée identitaire qu’à travers les pratiques
sociales et religieuses dans lesquelles elle est impliquée (Hoskins, 2006: 74; Tan, 2001:
170; Miller, 1987: 105-107). L’analyse de son rôle dans la forge de l’identité montagnarde
doit subséquemment se faire en lien avec l’usage social et religieux qu’en font les acteurs.
2. « Se dire Montagnards » par des pratiques religieuses associées à l’habitat
Le deuxième élément de différenciation entre gens de la montagne et Wandala
mentionné dans le conte concerne les pratiques religieuses structurées autour de la maison.
L’importance de celle-ci dans le déroulement des rites s’observe à tous les niveaux, mais je
me limiterai essentiellement aux rôles de certains objets domestiques, à savoir la pierre
rituelle, les pots rituels et le grenier du chef de famille, trois éléments qui sont les plus
significatifs dans la définition religieuse de l’identité montagnarde.
Dans les trois groupes étudiés, on remarque la présence d’une ou de deux pierres
rituelles à droite de l’entrée de chaque concession, sur laquelle s’assoit le chef de famille
lorsqu’il préside aux rites familiaux et claniques. Les rituels sont pratiqués pour établir des
relations étroites avec les ancêtres immédiats dont le concours est nécessaire pour le bien-
être de la maison et de ceux qui y vivent (MacEachern, 2002: 203; Smith and David, 1995:
454). Les pratiques associées à la protection contre la sorcellerie, très courantes dans les
monts Mandara, se déroulent aussi à l’entrée de la maison. Tous les mâles se rassemblent
autour de la pierre rituelle à qui on offre des libations en signe d’offrande aux ancêtres
(Vincent, 1976: 183-185; Boutrais, 1973: 69). Lorsqu’il arrive une maladie ou toute autre
catastrophe naturelle menaçant la vie d’un membre de la maison, des libations sont offertes
184
aux ancêtres, à travers la pierre rituelle, par le plus âgé du clan pour les implorer d’épargner
la vie de ce membre (entretiens avec Tekuslem, homme de 80 ans, le 11 décembre 2011, à
Baldama et avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 27 avril 2007, à Godigong).
Figure 13 : Pierres rituelles adossées au premier vestibule d’une maison mura, attestant de l’importance de la maison dans le déroulement des rites
La case à pots est le deuxième élément qui donne à la maison son caractère sacré.
Elle abrite des pots d’ancêtres assurant la continuité entre les ancêtres décédés et les
occupants actuels de la maison. Lorsqu’un chef de famille décède, la femme la plus âgée du
lignage lui fabrique un pot (sakama en Podokwo, burma en Muktele, gerda lay en Mura)
dans lequel reposera son âme après les funérailles (en général trois ans après la mort). À
l’occasion de celles-ci, les femmes de la maison et les belles-mères préparent la bière du
mil et les stockent dans des pots. Le vin contenu dans le pot rituel est exclusivement destiné
aux hommes réunis autour de la pierre rituelle à l’entrée de la maison. Après avoir bu la
bière, les anciens accoutrent le pot d’une gandoura noire111 et, après quelques gestes rituels,
111L’apparition de la gandoura dans les rites semble être récente. Elle serait intervenue à la suite des échanges économiques avec les Mandara de Mora et remonterait au XIXe siècle. Mais les informateurs ignorent comment cette cérémonie se déroulait avant l’introduction de la gandoura.
185
vêtissent le nouveau chef de famille avec la même gandoura. On extrait par la suite du sable
sur la tombe du défunt pour les verser dans le pot. Ce rituel signifie que « l’âme du défunt
n’est plus dans le tombeau, il est désormais dans son pot » (entretien avec Mesləpe Ragwa,
homme de 24 ans, le 24 avril 2007, à Udjila).
Figure 14 : Pots d’ancêtres placés dans la case sacrificielle dans une maison podokwo
Le pot sera déposé dans la case rituelle aux côtés d’autres pots et fera l’objet d’une
vénération particulière (Chétima, 2007: 65; Lyons, 1992; 128; Juillerat, 1971: 86). Tous les
pots sont fermés au moyen d’un couvercle en argile et ne sont rouverts qu’une fois l’an,
notamment à l’occasion des rites annuels se déroulant au sein de la maison. Leur usage est
règlementé avec une stricte interdiction aux femmes et aux enfants de les toucher sous
peine d’être atteints par des maux telles la stérilité et la maladie. La mort pourrait s’en
suivre selon la gravité des cas (celui qui touche à la viande qui leur est consacrée par
exemple). Les enfants de la concession ne semblent pas d’ailleurs ignorer les interdits dont
font l’objet ces pots, et n’expliquent leur rôle au sein de la maison qu’en les désignant :
« celui-ci est mon grand-père, celui-là est mon arrière-grand-père » (Chétima, 2007: 45).
Enfin, les mêmes préoccupations d’ordre liturgique privilégient le grenier du chef
de famille sous lequel se déroule l’essentiel des sacrifices offerts aux ancêtres de la maison.
186
C’est en effet au bas des greniers que siègent les ancêtres les plus proches et les plus
directement impliqués dans la gestion des affaires courantes de la maison (MacEachern,
2002: 203; Seignobos, 1982: 31; Vincent, 1976: 183-185). Cet emplacement est expliqué
par le besoin de protéger les récoltes contre les chenilles et les forces mystiques extérieures
(entretien avec Kwarissa, femme de 65 ans, le 08 mars 2012, à Udjila). D’autres signes qui
rappellent la permanence des rites pratiqués au sein de la maison sont constitués des
mâchoires de bœufs et de chèvres fixées sur les flancs des cases, des marques de libation
des bières sur le flanc des greniers, des objets sacrés à moitié enfouis dans le sol de la
maison, etc. Le lien entre la maison et les forces surnaturelles est dès lors direct, et les
pouvoirs des ancêtres les plus proches ne peuvent être accessibles qu’à partir de l’intérieur
de la maison.
Figure 15 : Grenier du chef de famille, objet de nombreux rites et sacrifices
Les éléments architecturaux exposés ci-dessus sont régulièrement utilisés par les
populations comme des marqueurs culturels (Appadurai, 1996) pour, d’une part se définir
en tant que « gens de la montagne », et d’autre part, définir leurs relations avec les Autres
de la plaine. Plus que sa fonction d’abri, c’est davantage la fonction rituelle et identitaire de
la maison qui est mise en valeur. Beaucoup des montagnards expliquent que leurs maisons
ont aidé à renforcer leur isolement, à vivre dans une société pacifique, et de manière
187
autonome des forces extérieures (De Colombel, 1986: 16, 22; Nyssens, 1986; Richard,
1977: 78; Juillerat, 1971: 75-78), que sont les royaumes esclavagistes jusqu’au XIXe siècle,
les colonisateurs européens au cours de la première moitié du XXe siècle, et les élites
politiques wandala à partir de 1960. Une de mes informatrices, Aje, explique la rareté des
interactions avec les Wandala de la façon suivante:
Nous avons notre façon de vivre et ils ont leur façon de vivre. Déjà nos maisons ne sont pas pareilles (...). Je peux épouser un Podokwo ou un Uldémé. Nous sommes les mêmes, mais comment pourrais-je épouser un Wandala? Comment pourrais-je abandonner mes pots pour aller vivre en plaine? (entretien avec Aje, femme de 70 ans, le 07 juin 2012, à Dume).
C’est la maison en tant qu’unité physique, mais davantage en tant qu’entité
religieuse qui constitue le fondement sur lequel les Montagnards manifestent leur
originalité en tant qu’un ensemble unifié et indivisible. Ils interprètent leur diversité
ethnique comme des simples divisions provenant de la coexistence de groupes familiers à
l’intérieur d'une même unité sociale qu’est la montagne (entretiens avec Menague, homme
de 86 ans, le 03 avril 2012, à Baldama; avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à
Mora-Massif; avec Tengola, homme de 25 ans, le 03 mai 2012, à Baldama; avec Mesləpe
Ragwa, homme de 24 ans, le 10 mars 2012, à Udjila). Chaque ethnie a, certes, sa propre
portion de territoire possédant des limites plus ou moins précises, mais ces limites sont
rarement considérées comme rigides, et sont régulièrement franchies par des groupes
d’individus sans que cela ne constitue un problème dans la conscience des Montagnards.
En revanche, les limites entre Montagnards et gens de la plaine sont plus que de simples
phénomènes physiques et géographiques. Elles sont avant tout des limites culturelles et
religieuses qui ne sauraient être franchies sous peine de connaitre une « mort sociale et
symbolique » (Hallaire, 1991: 25). Une interprétation de l’émergence de l’identité
montagnarde ne peut donc être comprise que dans le cadre d’un processus d’autodéfinition
par rapport aux Wandala, matérialisé dans l’architecture traditionnelle, mais aussi dans la
littérature orale112. Par exemple un chant sous forme de questions-réponses, régulièrement
112 De telles oppositions terminologiques entre communautés musulmanes versus communautés non musulmanes sont signalées dans d’autres contrées d’Afrique. Par exemple au Soudan, les Fur musulmans s’identifient en opposition au Fartit non-musulmans (OFahey, 1982: 77-78); au Tchad, les Arabes musulmans s’identifient en opposition aux Hadjeray non-musulmans (Fuchs, 1997). Enfin, au Nigéria, Hausa et Fulani musulmans sont opposés aux ethnies non-musulmanes (Morrison, 1976: 121-124).
188
chanté lors des travaux de construction ou de battage du mil chez les Mura rend compte des
différences perçues entre les deux groupes:
- Un Montagnard peut-il couper son pénis? - Non, comment pourrait-il regarder le gabaka?
- Un Montagnard peut-il cogner son front au sol? -Non, comment pourrait-il regarder le gerda lay?
-Un Montagnard peut-il manger dans un plat (d’aluminium)? -Non, comment pourrait-il toucher au pot?
-Un Montagnard peut-il toucher au chapelet? -Non, comment pourrait-il manier la pierre (rituelle)?
Il est à remarquer que l’appartenance ethnique n’est pas utilisée dans ce chant dans
la mesure où il thématise, non pas le rapport entre les Mura et les autres ethnies
montagnardes, mais le rapport avec « gens de la montagne » et « gens de la plaine ». Les
Montagnards n’utilisent l’expression « gens de la montagne » que pour signifier leur
relation avec les « gens de la plaine » en occurrence les Wandala. L'identité montagnarde
exprime en quelque sorte la reconnaissance d’un statut particulier en tant que groupe social
différent des Autres vivant en plaine (MacEachern, 2002: 201; 1990: 267-69)113.
Enfin, l’importance identitaire de la maison tient du fait qu'elle permet une quasi-
identification à la montagne et aux ancêtres. Attachés certes à un massif, les divinités et les
ancêtres aident les Montagnards, collectivement et individuellement, aussi longtemps qu’ils
ne s’écartent pas de leur montagne, et qu’ils respectent les principes régissant le
fonctionnement de la maison. Il est particulièrement remarquable que les rites relatifs à la
pluie effectués au sein d’un groupe ethnique donné le sont au bénéfice de plusieurs autres,
dépassant ainsi le simple cadre ethnique. C’est pour cette raison que les Muktele et les
Mura envoient régulièrement des présents aux maitres de la pluie se trouvant chez les
Uldeme et chez les Podokwo en reconnaissance de leur rôle en tant que « celui qui fait
tomber la pluie » (voir aussi Juillerat, 1971: 117). Cette généralisation des bienfaits de
l’esprit du lieu (Turgeon, 2009) à l’ensemble montagneux est interprétée comme une
réponse à l’hétérogénéité ethnique (Vincent, 1997: 345), et permet aux Montagnards de se
113 Selon Scott MacEachern (2002: 201), la plupart des ethnies utilisent d’ailleurs l’expression gens de la montagne ou gens du rocher pour exprimer, non pas seulement, cette relation intime entre eux et leur environnement, mais aussi pour signifier la reconnaissance d'un statut particulier en tant que Montagnards et des différences culturelles entre eux les gens de la plaine, plus particulièrement les Wandala.
189
présenter comme un ensemble unifié, face à ceux qui habitent la plaine. Finalement, un
informateur mura définit l’identité montagnarde comme un:
groupe de personnes qui partagent la même religion, qui partagent le même territoire, la même façon d’habiter la maison et la même bière. Dans tous nos groupes, la vie est articulée autour des cultes rendus aux ancêtres et autour de la consommation de la bière. Ce n’est pas pareil pour les Wandala. Ils ont leur religion, leur maison et ils ne boivent pas de la bière (entretien avec Kwona, homme de 65 ans, le 23 juin 2012, à Dume).
Il convient de préciser que l’unité montagnarde clamée par les Montagnards ne
découle pas d’une origine généalogique commune. D’une part, aucune tradition historique
ne précise l’origine commune à toutes les ethnies et à tous les clans vivant dans les
montagnes. Certains groupes, à l’instar du clan jeveriya chez les Mura, affirment être « les
gens du Ngolele » (MacEachern (1991: 174)114, alors que d’autres, notamment certaines
lignées podokwo et muktele, clament être venus des « rochers de Waza ». D’autre part, il
existe des récits d’origine, notamment chez les Mura, Uldeme, Plata, Vame et Urza, qui
mentionnent une parenté généalogique entre certains clans et les Wandala. Une de ces
traditions, recueillies chez les Mura de Jeveriya, raconte ce qui suit:
À Ngolele, les Mura et les Wandala étaient fils d’un même père et vivaient en paix dans les environs de Ngolele. Un jour le père voulut que ses enfants deviennent musulmans et décide donc de les circoncire. Il voyait que les musulmans étaient des vaillants guerriers et voulait que ses fils en deviennent autant. Sa femme qui ne voulut pas circoncire ses fils prit les meilleurs et les plus beaux et les cacha dans la montagne, laissant les plus méchants et les plus laids à la maison. Elle ne voulait pas que les bons soient circoncis et deviennent musulmans. Quand son mari est rentré, il lui demanda où sont partis les bons et les beaux enfants. Elle lui répondit qu’elle ne savait pas où ils étaient partis. Alors le père des enfants se mit en colère et lui dit avec sévérité: « Va dans la montagne avec ces enfants, mais ils auront à craindre ceux qui sont restés avec moi ». Elle partit en montagne avec les plus beaux. Les plus laids laissés à
114Selon les informations et les données toponymiques fournies par les Montagnards, et les recoupements faits par Scott MacEachern (1991: 174), Ngolele se trouverait dans l’ensemble montagneux des monts Mandara connu sous le nom de Zalideva, mais qui se trouve aujourd’hui dans la partie nigériane. Les traditions affirment qu’à Ngolele, Wandala et Montagnards vivaient comme des frères et appartenaient à la même lignée.
190
la maison devinrent Wandala et commencèrent à détester leurs frères cachés dans la montagne.
Malgré cette parenté généalogique entre Mura et Wandala -parenté également
soulignée par Hermann Forkl (1989: 543; 1988: 64), Eldridge Mohammadou (1982: 33) et
Jean Vossart (1953), les Mura semblent parfois l’ignorer pour ne s’intéresser qu’aux
hostilités qui ont caractérisé leur rapport depuis la conversion des Wandala à l’islam (voir
Mohammadou 1982: 28-99). Quelques répondants se remémorent encore les histoires de
leurs parents enlevés par ces derniers et vendus comme des esclaves aux Bornouans alors
qu’ils travaillaient dans leurs champs de mil (entretiens avec Kwetcherike, le 17 novembre
2011, à Dume; avec Aje, le 07 juin 2012, à Dume). Les différences religieuses accentuent
en outre les clivages entre les deux groupes. En tant que musulmans, les Wandala se
considèrent comme moralement supérieurs aux Mura et aux autres Montagnards (Lyons,
1996: 349-55). En revanche, les Mura considèrent les Wandala comme des étrangers venus
occuper une terre qui ne leur appartenait pas.
Ainsi l'identité montagnarde thématise, non pas le rapport qu’ont les Montagnards à
un ancêtre commun, mais davantage le rapport qu’ils entretiennent avec leur environnement
culturel, de même que la contribution de cet environnement culturel à la définition du Soi
montagnard. En commentant le mythe d’origine ci-dessus, les répondants mura
reconnaissent d'une part, la diversité d’origine des groupes montagnards et d'autre part, la
parenté généalogique entre certains clans montagnards et les Wandala. Dans cette avenue,
ils n’authentifient pas leur identité montagnarde en faisant état d’un patronyme ou d’un lieu
de naissance, mais en se fondant sur les différentes valeurs culturelles qui constituent leur
particularité en tant que « gens de la montagne ». Les principaux éléments qui ressortent
avec récurrence sont les rites religieux, la référence à l’architecture et le lieu géographique.
De cette façon, la montagne et la maison apparaissent, certes, comme des espaces
habités, mais plus encore comme des entités religieuses activement utilisées pour marquer
la différence avec ceux qui partagent d’autres croyances115. Cette identification à la
115La bipolarisation montagnards-Wandala ne doit pas cependant conduire à conclure à la rigidité de la frontière entre eux. Il existe des données historiques et ethnographiques (David et al, 1991; Vincent, 1991;
191
montagne perd évidemment de sa pertinence en absence de toute référence aux Wandala. Il
est d’ailleurs courant de voir un même individu passer de l’identité montagnarde à l’identité
ethnique selon qu’il décrit la relation de son groupe aux « gens de la plaine » ou aux autres
ethnies montagnardes. Tout cela amène, à la suite de MacEachern (2002, 2001) et de
David, Gavua, MacEachern et Sterner (1991), à considérer l’identité comme une entité
dynamique et situationnelle.
II. De l’identité montagnarde aux différentes représentations architecturales de l’appartenance ethnique
La question de savoir comment analyser l’interaction entre deux groupes
culturellement différents a constitué une vieille avenue au sein de la discipline
anthropologique. Clifford Geertz (1960), McKim Marriot (1955), Robert Redfield et Milton
Singer (1954), ou encore Edmund Leach (1954), ont tous considéré la différenciation
culturelle comme une preuve de l’intégration sociale. Edmund Leach, dans son analyse des
relations ethniques et structurelles en Birmanie, suggère que deux groupes ethniques de
culture différente n’appartiennent pas nécessairement à des systèmes sociaux divergents
(1954: 17). J’ajouterai à la pensée de cet auteur que deux groupes appartenant à une même
aire culturelle ne sont pas nécessairement homogènes tant il faut composer avec l’agency
des acteurs. Dans certains cas, l’homogénéité culturelle peut-être expressive des relations
sociales, et dans d’autres cas, ce sont plutôt les différences culturelles qui le sont. Si les
groupes ethniques ne sont pas figés mais emboîtés les uns dans les autres, il existe
néanmoins des traits distinctifs qui les séparent et qui dépendent exclusivement des
relations sociales qu’ils entretiennent entre eux (Geertz, 1956: 523). En d’autres termes, on
ne peut considérer les groupes ethniques comme des entités monolithiques, de même qu’ils
ne peuvent être considérés comme des entités homogènes. Ils sont continuellement
construits et reconstruits à travers les pratiques sociales des acteurs et à travers l’utilisation
active des marqueurs culturels (Tilley, 2006: 61). Étudier ces identités ethniques implique
par conséquent qu’on prête une attention particulière à la manière dont sont utilisés les
Hallaire 1991; MacEachern, 1991; Boutrais et al., 1984; etc.) qui suggèrent que la coopération était par moment caractéristique de leur relation et qui confirment ainsi le récit oral sus-évoqué.
192
éléments de la culture matérielle dans la structuration des interactions sociales (Meskell,
2004: 28).
Dans les monts Mandara, certains auteurs ont pourtant considéré les ethnies comme
des groupes homogènes et sans aucune grande particularité propre (Breton et Maurette,
1993; Froelich, 1968, 1964; Lembezat, 1961; De Lauwe, 1937). Il est, de ce fait, courant
qu’une étude menée sur un groupe ethnique donne lieu à des conclusions démesurément
appliquées à d’autres groupes. Il y a certes un nombre important de points communs entre
les ethnies des monts Mandara, surtout celles partageant entre elles une frontière commune.
Mais malgré ces similarités, les populations maintiennent une frontière plus ou moins
poreuse en fonction des relations qu'elles entretiennent avec les groupes voisins. Dans cette
partie, j’explore les manières dont les modèles architecturaux ethniques interviennent dans
la définition du soi ethnique chez les Podokwo, les Muktele et les Mura. Toutefois, je vais
au-delà de la simple description des symboles dans la mesure où je cherche à comprendre
pourquoi certains traits architecturaux sont plus importants que d’autres dans l’activation
des différences ethniques. De manière générale, la touche ethnique de l’architecture se
traduit à un double niveau. D’une part, elle se révèle dans l’organisation intérieure des
maisons, et d’autre part et de manière subtile, au niveau des formes architecturales
considérées comme emblématiques par les différents groupes.
A. Le plan intérieur des maisons : un élément décodeur du stéréotype ethnique
Christian Seignobos avait déjà émis l’hypothèse qu’il existait au sein de chaque
ethnie, un stéréotype architectural décelable, entre autres, à partir du plan intérieur de la
concession (Seignobos, 1982: 35). J'ai effectué quelques relevés d’habitation chez les
Podokwo, Muktele et Mura pour vérifier l’existence de ce stéréotype ethnique. J'ai aussi
interrogé les répondants sur là où devraient être placées les structures réservées aux
hommes, aux femmes, aux enfants, aux bétails et à d’autres types de mobilier au sein d'une
maison. En réponse à mes questions, les informateurs ont en général, dessiné le plan
ethnique au sol avant d’indiquer l’emplacement des structures réservées à chaque catégorie
d’individus, aux animaux ainsi que l’emplacement des greniers et autres mobiliers
193
intérieurs116. Je présente d'abord les informations collectées sur le terrain au fil de mes
enquêtes puis je propose certaines interprétations sur l’existence ou non d'une conscience
ethnique chez les populations des monts Mandara avant la période coloniale.
1. Stéréotype architectural podokwo117
L’habitat podokwo (kayə parkwa) s’ouvre sur une cour extérieure caractérisée par la
présence d’un grand arbre qui dispense son ombre en saison sèche aux membres de la
maison. Après avoir traversé la cour extérieure, on pénètre dans le kayə par une entrée
principale donnant lieu à une sorte d’antichambre montée en pierres. À partir de là, on
découvre à droite de l’entrée la case du père (virə baba: chambre père) légèrement retirée et
indépendante des autres cases. On y construit aussi un ou plusieurs étables (zləma sla) et
chèvreries (zləma nawa), montées essentiellement en pierres sans argile pour permettre
l’aération de l’intérieur118.
En face de l’axe d’entrée, on se trouve devant une série des case-vestibules
(guitsike) commandant l’accès dans l’enceinte de la maison (huđə kaya: ventre de la
maison). La première case-vestibule (Guitsikə zhəbe) est la structure la plus imposante
d'une maison podokwo de par sa hauteur et sa dimension. Son toit est également le plus
élevé et le plus fourni en tiges de mil. Elle est montée essentiellement en pierres soudées
par une couche d’argile pour permettre la résistance de la structure. La Guitsikə zhəbe est
en outre munie de deux entrées: la première constituant l’entrée dans la structure
proprement dite, la seconde commandant l’accès dans les autres structures. Deux autres 116Les descriptions proviennent à la fois des répondants hommes et femmes. Les descriptions fournies par ces dernières n'étaient en rien différentes de celles fournies par les répondants masculins, mis à part de légères variantes comme cela est constaté dans les explications venant des hommes. Se référer aussi à l’annexe 7 de cette thèse pour un exemple de plan ethnique d’une maison podokwo dessinée par Christian Seignobos (1982).
117Ce qui suit est la reconstitution de plusieurs entretiens réalisés avec les répondants podokwo, notamment avec Mozogum, homme de 87 ans, le 13 février 2012, à Udjila; avec Bassaka Kuma, homme de 70 ans, le 09 avril 2007, à Udjila; avec Ussalaka Duluva, homme de 70 ans, le 24 avril 2007, à Udjila; avec Wassa Badja, homme de 70 ans, le 13 mars 2012, à Udjila; avec Slagama, homme de 65 ans, le 22 mai 2007, à Udjila ; avec Bedje Barama, homme de 58 ans, le 13 février 2012, à Udjila; avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 17 février 2012, à Godigong; avec Madama Dougje, femme de 38 ans, le 14 février 2012, à Udjila; avec Duluva Mouche, homme de 27 ans, le 28 janvier 2012, à Godigong.
118La construction de l'étable et des chèvreries en pierre est aussi justifiée par le désir d’évacuer rapidement le bétail en cas d’incendie. Le mur est en effet facile à détruire parce que les pierres ne sont pas recouvertes d’une couche d’argile.
194
portes sont prévues pour donner accès à des éventuelles cases pour les fils. Chaque fils
ayant atteint l’âge mature doit avoir sa propre case au sein de la maison dans laquelle il
habitera avec sa femme jusqu’au jour où il aura sa propre maison. Après la traversée des
vestibules, on débouche dans le ventre de la concession, c’est-à-dire, dans l’ensemble
constitué de l’aire des greniers et du quartier des épouses (slala nasa: quartier des femmes).
Figure 16 : Stéréotype d’une habitation podokwo tel que schématisé par les participants au sol et reproduit par moi
L’aire des greniers est constituée de l’ensemble des greniers (kede) appartenant au
chef de famille et aux épouses. L'homme dispose de trois greniers à savoir: le grenier des
nouvelles récoltes (kedə səga), le grenier des récoltes antérieures (kedə slufa) et le grenier
du surplus en mil (kedə zhembe). La femme en dispose deux: l’un qui contient le mil
distribué annuellement par le chef de famille et l’autre pour accueillir ses divers produits de
1 3
4
2
5
5
3 6
7 8
10
9
11 12
13 14
16
15
17
18 19
Légende 1- Enclos à bétail 2- Case du père 3- Vestibule 4- Étable 5- Case des fils 6- Case des pots 7- Cuisine de la 2ème femme8- Chambre de la 2ème
femme 9- Cuisine de la 1ère femme10- Chambre de la 1ère
femme 11- Cuisine de la 3ème femme12- Chambre de la 3ème
femme 13- Greniers du père 14- Greniers de la 1ère femme15- Greniers de la 2ème
femme 16- Greniers de la 3ème
femme 17- Déclivité du terrain 18- Quartier de l’homme 19- Quartier d’épouses 20- Mur d’enceinte
20
195
beauté. Les ouvertures des greniers de l’homme sont tous tournées vers le vestibule tandis
que celles des épouses font face à leurs chambres respectives.
Les cases des femmes (virə nasa) et leurs cuisines (kudigue), disposées par ordre
d’ancienneté, délimitent la salle des greniers. Le domaine de la première femme (cuisine,
chambre à coucher et deux greniers) est situé en face de l’axe du vestibule. Toutes les cases
composant le slala nasa doivent être identiques pour éviter la jalousie entre les femmes.
Lorsque le chef de famille épouse une seconde et éventuellement une troisième femme,
celles-ci viendront s’établir de part et d’autre du domaine de la première. La construction
des cases d’argile n’inclut aucune porte d’entrée au départ. Celle-ci sera découpée après
avoir achevé l’élévation du mur. L’ouverture des cases, surtout celle des cuisines, doit être
très exigüe car il faut garder l’intérieur dans une entière obscurité119. L'ouverture de la vire
nəsa fait face à son silo alors que celle de la kudđigue lui tourne le dos en regardant vers le
mur d’enceinte120. L’ensemble constitué de l’aire des greniers et de slala nasa est ceint par
un haut mur d’enceinte (shəma) essentiellement monté en pierres sans argile. La maison
peut comporter d’autres cases pour abriter les parents du chef de famille, les filles divorcées
et revenues à la maison paternelle et les veuves. Ces cases sont construites en dehors de
l’enceinte de la maison, mais doivent être situées à une courte distance de part et d’autre de
l’entrée principale.
119 Dans certaines structures, explique David Mouche, « on ne pouvait sortir de l’intérieur que par marche arrière tellement que leur ouverture est si étroite qu’il ne permettait pas de sortir par devant au risque de tomber » (cité par Chétima, 2006: 64). L’exigüité de l’ouverture de la case est une précaution contre les aléas du climat et contre l’insécurité. En effet, pour des raisons climatiques, il fallait limiter l’ouverture au strict minimum pour se mettre à l’abri des rigueurs du climat à certains moments de l’année étant donné que les systèmes de fermeture des portes n’étaient pas développés. Une grande ouverture exposerait les occupants à la fraîcheur de décembre et de janvier.
120 La position des ouvertures des cuisines vers le mur d'enceinte joue un rôle de dissimulation. Cette position est néanmoins constamment utilisée pour signifier la particularité de la maison podokwo par rapport aux Mura et aux Muktele.
196
2. Stéréotype architectural muktele121
Comme chez leur voisin podokwo, la maison chez les Muktele est un ensemble de
cases rondes groupées plus ou moins circulairement, et serrées les unes contre les autres
autour d’une cour intérieure (kawdal). Un vestibule (dzogdzog) construit en pierres sans
argile précède l’entrée principale dans la maison (gay). Une fois le dzogdzog traversé, la
première case qu’on rencontre est celle où le chef de famille (zil gay) passe ses nuits. Elle
est suivie de deux ou trois autres cases masculines disposées en série et qui font office de
vestibules. De part et d’autre du premier vestibule se trouve de petites constructions de
pierres (hohl) pour garder les bœufs et les chèvres. Le dernier vestibule contient les pots
ancestraux (burma122). Les gazarak sont inhabités, mais constituent le chemin obligé pour
accéder dans l’enceinte de la maison (kawdal). Toutes les cases situées avant et autour des
vestibules constituent la partie masculine du gay. Le kawdal par contre est le domaine des
femmes et des enfants en bas âge.
Dans le kawdal se trouve un labyrinthe de greniers (vda) de forme cylindrique
contenant toutes les récoltes de la famille. On distingue les greniers de l’homme (au
nombre de deux) et les greniers des épouses (un par épouse). Les greniers de l’homme ne se
distinguent de ceux des épouses que par le cloisonnement intérieur. Ils ne sont pas en effet
compartimentés alors que ceux des épouses sont divisés en trois étages intermédiaires
(daboza). Chaque femme doit parer la façade de son grenier et de sa cuisine selon ses
propres motifs décoratifs. En revanche, il leur est interdit de décorer les vda du chef de
121 Les descriptions d’une maison idéale muktele desquelles est issue la synthèse présentée dans ce travail viennent de plusieurs informateurs. Entretiens avec Kwala, homme de 80 ans, le 27 décembre 2011, à Baldama; avec Tekuslem, homme de 75 ans, le 11 décembre 2011, à Baldama; avec Madjagola, homme de 60 ans, le 17 décembre 2011, à Baldama; avec Waoussa, femme de 50 ans, le 04 décembre 2011, à Baldama; avec Kaouala, femme de 45 ans, le 07 décembre 2011, à Baldama; avec Dougzum, femme de 40 ans, le 17 octobre 2011, à Tala-Mokolo. Ces descriptions sont proches de celle fournie par Bernard Juillerat (voir Juillerat 1971: 33). Se référer aussi à l’annexe 8 de cette thèse pour un exemple de plan ethnique d’une maison mura dessinée par Christian Seignobos (1982).
122 Il s’agit des pots rituels (tuguz azamna afik: cruche des gens du trou) fabriqués deux ou trois ans après la mort d’un parent ou dun grand-parent pour contenir ce que les Muktele appellent le double de sa personne, c’est-à-dire son âme.
197
famille, car ces derniers font l’objet de nombreuses libations et offrandes offertes
annuellement aux ancêtres du groupe123.
Figure 17 : Stéréotype d’une habitation muktele tel que schématisé par les participants au sol et reproduit par moi
Au fond du kawdal se trouve la case de la première femme (kudig gaylag: chambre
maison d’en bas) qui regarde vers le vestibule contenant les burma des ancêtres. Elle est
considérée comme la partie la plus féminine, parce que constituant le niveau le plus bas de
la maison. La cuisine de la première femme (madagl gaylag: cuisine maison d’en bas) est
construite en même temps que sa case à coucher, et doit être située à droite de celle-ci. Les
cuisines et les cases à coucher des autres femmes (Madagl gaygo et kudik gaygo: cuisine et
123Il n’est pas rare de trouver des mâchoires d’animaux fixés sur la paroi du grenier et des traces de l’eau de farine du mil (yao phao) sur les pierres formant la base du grenier. Ces libations sont généralement offertes à l’occasion de la fête des moissons (madvedev) et du rite de gratitude (mat kaf a uda: préparer couscous dehors) envers les fondateurs de la maison.
2 4
1
3
3
5
6
11
7
8
9
10
13
14
12
1
5
Légende 1 – Enclos à bétails 2- Case du père 3- Etables 4- Vestibule 5- Cases des fils pubères 6- Cuisine 3ème femme 7- Cuisine 1ère femme 8- Chambre 1ère femme 9- Cuisine 2ème femme 10- chambre 2ème femme 11- Chambre 3ème femme 12- Greniers du père 13- Greniers 1ère femme 14- Greniers 2ème femme 15- Greniers 3ème femme 16- Déclivité du terrain 17- Quartier de l’homme 18- Quartier d’épouses 19- Muret de pierres
15
16
17 18
15
19
198
chambre maison en haut) sont placées de part et d’autre de celles de la première femme.
Les autres cases composant le gay abritent les enfants célibataires ou mariés et sont toutes
localisées dans la partie masculine de la maison. Toutes les cases sont reliées entre elles par
un mur de pierres sèches (asaô) fermant complètement le gay. Entre les cases d’épouses et
leur cuisine, une brèche dans le mur (mawnik) sera créée pour permettre à d’éventuelles
nouvelles épouses d’entrer et de sortir de la maison en toute discrétion pendant leur
claustration. C’est pour cette raison que le mur constitue la forme architecturale la plus
typiquement muktele.
3. Stéréotype architectural mura124
Tous les informateurs mura ont commencé leurs descriptions par l’ordre dans lequel
les unités architecturales doivent être construites dans une maison. Elles obéissent à l’ordre
suivant: cuisines, enclos à bétail, cases des épouses, greniers, vestibules et mur d’enceinte.
Si le chef de famille est en même temps chef de son lignage, les greniers seront en premier
construits, pour lui permettre d’y placer ses gerda lay (pots ancestraux), car ceux-ci ne
doivent pas être exposés à la lumière du jour (entretiens avec Kwona, homme de 65 ans, le
22 juin 2012, à Dume; avec Lamise, femme de 58 ans, le 07 novembre 2011, à Dume; avec
Dagabou, homme de 50 ans, le 14 novembre 2011, à Dume).
L’homme de la maison passe ses nuits dans le premier vestibule ou dans sa case à
coucher localisée à droite de l’entrée principale. Pour éviter l’intrusion des esprits
maléfiques au sein de la maison, des objets de médecine sont enterrés à l’entrée (entretien
avec Dəgla, homme de 80 ans, le 07 novembre 2011, à Dume). À cet endroit se déroulent
aussi la plupart des rites, notamment le baptême du nouveau-né au cours duquel l’enfant
reçoit un nom et une amulette de protection (entretien avec Maryam, femme de 55 ans, le
14 novembre 2011, à Dume). Le quartier de la première femme (sa cuisine, sa case à 124 Les descriptions d’une maison idéale chez les Mura ont été faites par les informateurs suivants: Daugwene (homme de 82 ans, entretien le 03 novembre 2011, à Dume); Medyokwa (homme de 60 ans, entretien le 07 décembre 2011, à Dume); Dawcha (homme de 58 ans, entretien le 03 mai 2012, à Mora-Massif); Lamise (femme de 58 ans, entretien le 29 novembre 2011, à Dume); Amagouwe (homme de 55 ans, entretien le 17 mai 2012, à Mora-Massif); Maryam (femme de 55 ans, entretien le 14 novembre 2011, à Dume); Lydia Dagabou (homme de 50 ans, entretien le14 novembre 2011, à Dume); Mahama (femme de 36 ans, entretien le 29 mai 2012, à Mora-Massif). Je suis par ailleurs redevable à Diane Lyons qui a effectué les premières descriptions d’une maison-type mura et fournies des schémas de plusieurs maisons qu’elle a observées dans le cadre de sa thèse de doctorat (voir Lyons, 1992: 125-129).
199
coucher et son grenier) est localisé au fond de la maison, et doit être directement opposé au
grenier sous lequel sont placés les gerda lay (entretien avec Amagouwe, homme de 55 ans,
le 17 mai 2012). Les quartiers d’autres éventuelles épouses sont localisés à droite et à
gauche de celui de la première femme. La seconde femme occupe automatiquement le
domaine à droite et la troisième celui de gauche (entretiens avec Medyokwa, homme de 60
ans, le 07 décembre 2011, à Dume; avec Dawcha, homme de 58 ans, le 03 mai 2012, à
Mora-Massif; avec Maryam, femme de 55 ans, le 14 novembre 2011, à Dume). Les
femmes de la maison enterrent les placentas de leurs enfants dans la surface comprise entre
leur cuisine et leur case à coucher. Des pots à moitié enfouis dans le sol sont par la suite
placés au-dessus des placentas125. Tous les répondants considèrent ces pots d’une part
comme des objets dangereux et d’autre part, comme une pratique qui ne se rencontre nulle
part ailleurs que dans la maison mura.
Les coépouses ne doivent pas partager une cuisine commune, ni les belles-sœurs
une cuisine unique avec leurs-belles-mères, car ces dernières peuvent s’empoisonner les
unes les autres (entretiens avec Lamise, femme de 58 ans, le 29 novembre 2011, à Dume;
avec Dawcha, homme de 58 ans, le 03 mai 2012, à Mora-Massif; avec Maryam, femme de
55 ans, le 14 novembre 2011, à Dume). Les chambres à coucher des femmes et les cuisines
doivent être tournées vers le centre de la maison, mais doivent être restées invisibles à partir
de la case de l’homme, car il est inconfortable pour hommes et femme de se voir lors de la
prise des repas126. Tous les récipients vides appartenant aux femmes doivent être renversés
et percés pour qu’ils ne soient pas utilisés par ces dernières à des fins occultes (entretiens
avec Dəgla, homme de 80 ans, le 07 novembre 2011, à Dume; avec Kwona, homme de 65
ans, le 22 juin 2012; avec Maryam, femme de 55 ans, le 14 novembre 2011, à Dume)127.
125 La place primordiale qu’accordent les Mura à l’enterrement du placenta au sein de l’espace intérieur de la maison est amplement soulignée par Diane Lyons (1992).
126 Voir à cet effet les relevés de quelques maisons effectuées par Diane Lyons (1992).
127 En effet, les femmes qui laissent leurs pots ouverts sont suspectées de les utiliser à des fins occultes. Aucune raison concrète ne semble expliquer en quoi les récipients interviennent dans les pratiques de sorcellerie. Pourtant nos informateurs sur la question sont tous unanimes pour dire qu’ils sont utilisés par les femmes pour dissimuler à l’intérieur des produits maléfiques destinés à provoquer l’infertilité des coépouses, et dans certains cas, la mortalité infantile au sein de l’espace intérieur de la maison. Voir surtout Diane Lyons pour une analyse complète du rôle des récipients dans les pratiques occultes chez les Mura. David Nicholas, Judith Sterner et Kodzo Gavua (1988) pour des analyses similaires respectivement chez les Mafa et les Bulahay.
200
Les enfants en bas âge dorment avec leur mère. Une fois adolescents, les garçons rejoignent
leur père tandis que les filles continuent de vivre avec leurs mères jusqu’au jour de leur
mariage. Lorsque les garçons se marient, des cases supplémentaires leur sont construites au
sein de la maison paternelle et localisées de part et d’autre de l’entrée principale. Les enclos
à bétails sont également situés dans la partie haute de l’habitation, mais à gauche de
l’entrée128.
Figure 18 : Le plan typique dune habitation Mura typique ici
128 Ces informations sont ressorties de mes entretiens avec divers informateurs à Dume, et ont été confirmées au cours des observations personnelles lors des visites guidées des maisons en novembre 2011.
201
Lorsqu’on pénètre dans l’enceinte de la maison, on aperçoit un labyrinthe de
greniers disposés selon un ordre bien établi. Les greniers de l’homme sont placés sur la
droite, avec le gabaka (grenier sous lequel sont disposés les pots ancestraux) sur le côté
arrière-droit et regardant dans la direction de la cuisine de la première femme (entretiens
avec Daugwene, homme de 82 ans, le 03 novembre 2011, à Dume; avec Dawcha, homme
de 58 ans, le 03 mai 2012, à Mora-Massif; Lyons, 1992 :128)129. Les greniers des épouses
sont plutôt placés à gauche. Le placement du gabaka en face de la cuisine et de la chambre
de la première femme permet à celle-ci d’apprêter les offrandes que l’homme de la maison
offre annuellement aux gerda lay entassés sous le gabaka (voir aussi Lyons, 1992: 128).
L’entrée dans la case de la femme doit être orientée vers l’ouest alors que celle de l’homme
doit regarder vers l’est. Cette pratique est identique à la disposition des corps dans le
tombeau. L’homme est couché sur son côté droit avec son bras droit plié sous sa tête
tournée vers le soleil levant (est). La femme est couchée sur son côté gauche avec son bras
droit plié sous sa tête qui est tournée en direction du soleil couchant (ouest). L’homme est
donc placé dans la maison comme dans le tombeau face au soleil levant pour qu’il sache
qu’il est temps d’aller dans le champ du mil. En revanche, les femmes sont placées dans la
maison comme dans le tombeau en face du soleil couchant pour qu’elle sache qu’il est
temps de préparer le repas du soir. Cette façon d’interpréter les places occupées par
l’homme et la femme au sein de l’espace domestique constitue vraisemblablement l’un des
aspects distinguant la maison des Mura de celles des Podokwo et des Muktele. D’autres
variations interethniques, visibles à travers les formes des maisons (cases, greniers, murs)
servent également d’appui aux représentations identitaires.
4. Variations de formes architecturales et représentations identitaires
D’autres différences concernent entre autres les lieux d’accueil. Ils sont certes
placés sous des séchoirs placés à l’entrée des concessions dans toutes les ethnies. Mais ils
sont plus étendus et plus rapprochés de l’entrée principale chez les Muktele, et ténus
légèrement à l’écart chez les Podokwo. Les Mura y ajoutent une touche particulière en les
construisant sous la forme d’une vannerie. L’empreinte ethnique se traduit ensuite par la
forme de la toiture des cases pour laquelle les démarches et techniques de montage varient 129 Informations conformes aux observations effectuées lors des visites guidées des intérieurs des maisons.
202
d’une ethnie à une autre. Les Podokwo et les Muktele utilisent la technique d’effilement
des tiges de mil. Chez les Mura, un dôme de paille est plutôt fabriqué par terre avant d’être
posé sur le mur de la case. Pourtant la frontière ethnique séparant les Podokwo et les Mura
n’est matérialisée que par une petite rivière, ce qui veut dire qu’au plan géographique, ils
ont accès aux mêmes matériaux. Les Podokwo et les Muktele partagent aussi une frontière
commune, mais les toits de leurs cases se distinguent nettement. Les toits des cases
podokwo sont extrêmement pourvus en tiges de mil, qui les particularisent des cases
muktele. Une autre différence de forme se trouve au niveau du grenier. Ils ont partout la
forme cylindro-conique. Mais en fonction des ethnies dans lesquelles on les trouve, ils sont
soit élancés (Podokwo), soit petits (Mura), soit plus en obus (Podokwo)130. Enfin les
greniers mura se distinguent nettement des deux autres groupes du fait que l’entrée est
placée au sommet alors qu’elle est obtenue avant le montage du cône d’argile chez les
Podokwo et les Muktele.
Figure 19 : Toits des cases d’une maison muktele de Baldama 130 Au-delà de la volonté de marquer la différence, les Podokwo expliquent la forme en obus de leurs greniers en rapport avec la grossesse de la femme. Cela rejoint sans doute les conclusions de Jean-Pierre Sandoz (1998 : 24) et de Labelle Prussin (1972) selon lesquelles certaines formes de grenier en Afrique évoqueraient le rôle de reproduction de la femme. Voir aussi le chapitre 5 de cette thèse pour plus de détails sur la correspondance entre le ventre de la femme et le ventre de la maison en tant que lieu de vie.
203
Figure 20 : Toits des cases d’une maison mura de Dume
Figure 21 : Grenier podokwo aux formes élancées
204
Figure 22 : Grenier mura avec des formes plus en obus
Figure 23 : Cuisine podokwo avec l’entrée tournée vers le mur d’enceinte
205
Figure 24 : Cuisine muktele avec l’entrée tournée sur la cour intérieure
Dans l’habitation podokwo, chaque épouse possède sa chambre à coucher (virə
nəsa), une cuisine (kuđigue) et deux greniers (kede). Pendant que la chambre d’épouse fait
face à ses greniers, l’entrée dans la cuisine s’oriente plutôt vers le mur d’enceinte. Dans les
maisons muktele et mura par contre, les ouvertures des chambres d’épouses et de leurs
cuisines sont toutes portées vers l’aire des greniers. Le quartier d’épouses d’une maison
podokwo est ceint par un haut mur de pierres sèches non jointoyées (shəmə parəkwa: mur
podokwo). Dans une maison muktele, cases et cuisines sont reliées par un muret de pierres
(asaô matal). Les Mura ont élaboré un autre aménagement dans la mesure où leur mur
englobe toutes les cases en argile, en reliant en même temps les cases de pierres entre elles
(voir plans ethniques plus haut).
Au regard de ces descriptions, on peut émettre l’hypothèse que les stéréotypes
ethniques (Seignobos, 1982) sont créés dans le but de générer la différence avec l’Autre, et
relèveraient de ce qu’Arjun Appadurai (1996) appelle les « stratégies identitaires ». Dans
cette avenue, et comme le suggère d’ailleurs Ian Hodder (1982: 85), l’objectif serait celui
de matérialiser la différence séparant le Nous du Eux dans un univers géographique et
architectural ressemblant. Cette utilisation sélective de l’architecture dans la création des
sentiments identitaires amène à conclure qu’elle n’est pas simplement le reflet préexistant
206
des distinctions sociales. Plus qu’un simple symbole, elle s’interpose comme un médium
exprimant activement les relations sociales (Buchli, 2013 : 149). Elle devient ainsi un agent
qui possède la force de « dire ce dont on ne peut pas dire ou écrire » (Tilley, 2002 : 28 ;
1991). Ce rôle lui provient très souvent des relations ritualisées qu'elle entretient avec les
humains et les ancêtres; relations dans lesquelles elle agit comme un intermédiaire qui
encapsule et symbolise le surnaturel.
B. Des éléments architecturaux emblématiques pour une identification ethnique
En plus des plans des maisons, il existe d’autres faisceaux de détails. Chaque
groupe se fonde pour soutenir l’idée d’être particulier et homogène (Seignobos, 1982: 35).
Lorsque je posais à mes informateurs muktele la question de savoir en quoi leurs maisons
étaient différentes de celles des Podokwo (leur voisin ethnique le plus proche), il me
répondait: « c’est le mawnik (la brèche crée dans le mur) qui donne à notre maison sa
particularité dans toute la montagne ». Les Podokwo, quant à eux, vantent leur mur
d’enceinte qu’ils croient atypique dans tous les massifs. Enfin, les Mura se servent des
objets de médecine enterrés çà et là pour définir le caractère singulier de leurs maisons:
« un Mura peut aller n’importe où, mais tu trouveras toujours les objets de médecine
enterrés dans sa maison. Ça, ça lui colle à la peau », déclare Amagouwe, un Mura devenu
pourtant chrétien (entretien avec Amagouwe, homme de 55 ans, le 16 mai 2012, à Mora-
Massif).
Je ne me serai jamais attardé sur ces aspects si je n’avais pas remarqué la
récurrence avec laquelle ils revenaient dans les échanges avec mes informateurs. Cette
partie s’attache à analyser la place de ces éléments érigés en « emblèmes ethniques » dans
la définition de l’identité du groupe, à savoir le mur d’enceinte chez les Podokwo, les petits
murets chez les Muktele et les objets enterrés dans le sol de la maison chez les Mura.
1. Le shəma et son rôle dans l’identification ethnique
Il existe dans les monts Mandara deux modalités qui guident la construction du mur
d’enceinte. Soit il ceinture toutes les structures d'une habitation, soit il relie les différentes
structures entre elles pour former un ensemble clos. Les Podokwo construisent leurs murs
207
suivant la deuxième modalité. De l’avis des répondants podokwo, leur mur d’enceinte
serait atypique: « nous sommes les seuls à posséder ce modèle de mur », confie Malapa
Namba (entretien avec , homme de 57 ans, le 20 avril 2007, à Udjila), propriétaire d’une
maison à cinq quartiers ceints par un grand d’enceinte. À la question de savoir ce qui est
fondamentalement différent entre l’architecture podokwo et les architectures voisines
(muktele, uldeme, mura et Vame-Breme en particulier), Mezhəne, un informateur issu du
même clan que le chef d’Udjila, répond:
Il n’est pas difficile de reconnaitre une maison podokwo, regarde seulement à son shəma. Une maison podokwo perd son sens si elle n’est pas entourée par le shəma. C’est ça la différence fondamentale avec les autres Montagnards (entretien avec Mezhəne, homme de 35 ans, le 25 avril 2009, à Udjila).
Lors des travaux de construction des murs auxquels j’ai assisté, j’ai remarqué que
tous les discours s’orientaient vers le rôle du shəma dans la définition ethnique de la
maison. Dans le village de Tala-Dabara par exemple, un aîné s’indignait du fait que « la
maison podokwo disparaitra bientôt parce que le shəma n’intéresse pas cette génération »
(entretien avec Matsama Buda, homme de 70 ans, le 13 avril 2009, à Tala-Dabara). Si les
Podokwo apprécient la dimension artistique de leur mur, l’accent est davantage mis sur les
valeurs identitaires qui lui sont associées, à savoir le degré d’attachement à la montagne par
rapport à d’autres groupes, l’amour pour le au travail et la cohésion sociale de l’ethnie.
Le degré d’attachement à la montagne : « nous sommes plus montagnards que les
autres » (entretien avec Bedje Barama, homme de 58 ans, le 18 mars 2012, à Udjila)
exprime le rapport étroit entre le Podokwo et son environnement ainsi que leur
connaissance des types des roches à sélectionner pour les besoins de construction du
shəma. Bedje Barama, un informateur connu pour sa dextérité en matière de construction
des murs, explique que la sélection d’une roche au détriment d’une autre découlerait, de
leur maitrise parfaite de l’environnement pierreux:
Nous connaissons la montagne mieux que quiconque et la montagne nous connait. Regarde nos terrasses, tu ne verras cela nulle part ailleurs. Regarde aussi notre shəma, cela demande beaucoup de pierres. Et ce n’est pas n’importe quelle pierre que nous choisissons pour le construire. On
208
choisit les pierres qui résistent longtemps car le shəma doit traverser au moins trois générations. Va dans les massifs makulahe, namba et udjila, tu verras la même chose partout. Va dans les massifs mura et uldeme, tu verras que leur mur sont pauvres en pierres (entretien avec Bedje Barama, homme de 58 ans, le 18 mars 2012, à Udjila).
Le discours sur la particularité du shəma et sur le supposé attachement à la
montagne est aussi partagé par les femmes étrangères ayant épousé des hommes podokwo,
comme cela ressort dans les propos de cette informatrice d’origine muktele:
On ne s’attaque pas à une roche avec des mains simples. Cela demande beaucoup de courage et de technique. Le shəma demande beaucoup de pierres car il ceinture toute la maison. Les Muktele ne font pas pareil. Mais je les comprends, car ce n’est pas facile de s’approvisionner en pierres surtout que leurs massifs ne contiennent pas assez de pierres (entretien avec Kwarissa, femme de 65 ans, le 07 mars 2012, à Udjila).
Les journées consacrées au débitage des roches pour les besoins de construction
constituaient en même temps une occasion pour transmettre la connaissance du milieu
naturel aux jeunes et aux plus jeunes. Au cours de ces journées, les spécialistes reconnus
procèdent constamment à un test expérimental sous l’observation attentive des jeunes
présents sur les lieux de construction. Cette technique expérimentale consiste à tester la
résistance de chaque type de roches en utilisant des instruments appropriés tels que la
pierre-marteau (une grosse pierre enroulée qui joue le rôle de l’enclume) et le feu (voir
aussi Seignobos, 1982: 32). À l’issue de ce test, explique Malapa Namba, « les jeunes
apprennent à distinguer nettement les roches fragiles : celles qui cèdent facilement à
l’action de la pierre-marteau ou du feu, et les roches résistantes : celles qui tiennent
longtemps avant de céder » (entretien avec Malapa Namba, homme de 57 ans, le 23 janvier
2008, à Udjila).
209
Figure 25 : Une maison podokwo ceinte par le shəma lui donnant son caractère ethnique
L’attachement des Podokwo à la montagne se traduit aussi par leur capacité de
distinguer les pierres naturelles de celles qui sont surnaturelles, en particulier celles qui
interviennent dans les rituels de pluie. Les pierres de pluie ne doivent pas être incluses dans
la construction du shəma, car elles sont jugées dangereuses. C’est pourquoi, explique Zabga
Valla, par ailleurs chef de lignage, la présence des vieillards et de ceux qui ont acquis de
l’expérience en matière de construction est requise tout au long du processus de collecte des
pierres de construction, car :
Il ne faut pas que les gens ramassent par facilité les pierres faiseurs des pluies (...). Il en existe deux sortes à éviter: Il y en a qui ont des formes arrondies et lisses ressemblant à un œuf blanc. Celles-ci font tomber la pluie. Il y en a qui sont striées de veines multicolores, comme l’arc-en-ciel avec le rouge comme couleur dominante. Celles-là sont des pierres de sécheresse (entretien avec Zabga Valla, homme de 62 ans, le 21 février 2012, à Udjila).
210
Ces deux catégories ne doivent donc pas être sélectionnées pour la construction, car
placées dans le mur, elles sont très redoutables et provoquent des tornades en saison des
pluies, et des incendies en saison sèche131:
Lorsque le tonnerre tombe et qu’il y a de la foudre, les pierres aux formes lisses et arrondies peuvent fendre les rochers sur lesquels repose le shəma et peuvent provoquer l’écroulement de toute la maison. Pendant la saison sèche, les pierres-sécheresses provoque de grands incendies, surtout si elles sont en contact avec la fumée sortant des cuisines (dont les ouvertures sont tournées vers le shəma) (entretien avec Zabga Valla, le 21 février 2012, à Udjila).
Lorsque qu’au cours de la casse des roches, les travailleurs les aperçoivent, elles
sont soigneusement placées dans des sortes de nids fabriqués pour la circonstance et
ramenées dans la maison du faiseur de pluie. Il y a donc une relation presque mythique et
mythologique entre les Podokwo et leur environnement rocheux, une relation qui se décline
comme on l’a vu, en un ensemble de pratiques architecturales, mais aussi en fonction de
modes de croyances, de systèmes de représentation et de logiques d’anthropisation de
l’espace (Dragan, 1999).
La deuxième valeur que traduit le shəma est le sentiment d’appartenance ethnique,
c’est-à-dire le sentiment d’être un malgré la diversité clanique, régulièrement entretenu lors
des travaux de construction. La construction du mur, étant d’une grande complexité,
requiert une force commune de travail permettant ainsi le rassemblement de toute la
population. Au-delà de l’aide qu’on apporte à un membre du groupe, le travail en commun
répond à un autre besoin qui est celui d’éduquer et de conscientiser la masse. On entonnait
parfois des chants qui racontaient l’histoire de ceux ayant été surpris dans un acte de
délinquance sociale, tel que le vol et la fornication (entretiens avec Namba Walla, homme
de 40 ans, le 21 février 2012, à Udjila; avec Mezhəne, homme de 35 ans, le 22 mars 2007, à
Udjila). L’objectif de ces chants est de dissuader ceux qui, parmi les travailleurs, veulent
aussi entreprendre cette manœuvre déshonorante. Le rassemblement de la population pour
la construction d’un shəma permet en outre d’approfondir la solidarité entre les membres
131Pour une étude analogue menée chez les Mofu des monts Mandara, voir Vincent (1997: 337-349; 1991: 615-667).
211
des différents villages et des différents clans. De l’avis de Zabga pastou, érudit local
habitant le village de Godigong, il favorise le règlement des litiges entre clans et lignages,
ce qui contribue à renforcer davantage la cohésion sociale:
C’est un moment favorable pour enterrer la hache de la guerre entre deux clans ennemis. Pendant que les jeunes prouvent leur aptitude dans le travail, les vieillards des clans opposés s’occupent à régler les différends entre eux. Par la suite, l’eau de farine est partagée par tout le monde pour signer l’unité retrouvée (entretien avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 27 avril 2007, à Godigong).
On constate donc que le fait remarquable ne réside pas dans l’originalité du shəma
en tant que tel, mais dans les sens et les valeurs d’identification ethnique qui lui sont
associés. Pourtant, en parcourant l’aire géographique podokwo, on se rend à l’évidence
qu’on est en présence d'une constellation de sociétés segmentées. L’ethnie n’a aucune unité
politique et n’a pas non plus une origine commune (Voir Chétima, 2006: 29-30). L’unité
politique est plutôt infra-ethnique se situant au niveau de chaque massif. Au plan
historique, l’ethnie s’est constituée à partir d’éléments d’origines très diverses: migrants
venus de Waza (clans Slalawa, Makulahe, Uzləgaya), migrants venus d’autres contrées
montagnardes (les Udjila venus des massifs mada; les Mezhe venu des massifs Mbuki dans
l’actuel arrondissement de Tokombéré), migrants se déclarant résolument autochtones (les
Uzlama dont la tradition raconte qu’ils sont sortis de la boue sous forme de chenilles).
Pourtant, la place de la construction du shəma en tant que pont culturel entre ces clans est
presque toujours soulignée dans les entrevues avec les acteurs, indépendamment de leurs
différences claniques:
Ce mur, tu le trouveras chez les Makulahe, Udjila, Namba, Kassa et dans n’importe quel massif podokwo. Il n y a pas de différence entre nous. Quand nous construisons le shəma, les beaux-parents sont aussi invités pour partager la joie avec leurs gendres (...). Nous prenons d’abord l’eau de farine et ensuite la bière du mil. Tout le monde est content, même les ennemis retrouvent la paix (entretien avec Sevəda Chikoua, homme de 44 ans, le 13 janvier 2012, à Godigong).
212
Dans tous les discours des informateurs podokwo tendant à la comparaison avec les
ethnies voisines, on remarque une quasi-absence de segmentation lignagère. Par exemple,
le clan udjila ne met pas en avant ses particularités claniques lorsqu’il se définit par rapport
aux Muktele, mais ses particularités ethniques en tant que Podokwo dont le shəma en est la
matérialisation la plus évidente. Le critère architectural - mais aussi linguistique - est ici
très important dans la mesure où l’architecture et la langue, sont en quelque sorte les deux
éléments partagés par tous les clans podokwo (voir Seignobos, 1982). À travers son mur
d’enceinte, la maison rend possible l’agrégation à un ensemble ethnique plus vaste, incluant
tous les clans et tribus podokwo. Il semble, à la fois, unir les différents castes et lignages à
l’intérieur d’un même clan, et les différents clans qui composent l’ethnie. Les particularités
claniques et la conscience persistante de l’origine ancestrale différente, certes intériorisées,
sont dépassées au profit d’un bloc ethnique symbolisé par le mur d’enceinte, lequel fournit
aux acteurs un répertoire de références identitaires dans lequel ils puisent pour marquer
leurs différences avec les Mura et les Muktele.
2. Le mawnik muktele ou l’union symbolique des clans opposés
Comme leurs voisins podokwo, la forme architecturale qui donne à la maison
muktele une dimension ethnique sont les petits murets de pierres (asaô). Si les Podokwo
vantent davantage leur degré d’attachement à la montagne à travers leur shəma, les Muktele
mettent l’accent sur la dimension culturelle de leur asaô: « il offre à la nouvelle mariée une
voie de sortie pendant sa période de claustration » (entretiens avec Massadao, femme de 60
ans, le 28 mai 2012, à Baldama ; avec Tengola, homme de 25 ans, le 12 mai 2012, à
Baldama). À la différence du mur podokwo dont la qualité artistique est attestée
(Seignobos, 1982), l’asaô muktele impressionne moins esthétiquement. Il est monté en
pierres et relie les différentes cases entre elles. À une hauteur d’environ un mètre du sol,
une dalle de pierre est placée entre les parois des cases sur laquelle reposent les pierres de
la partie supérieure. La dalle de pierre permettra, le moment venu, de créer une brèche
(mawnik) à travers le mur, en défaisant les pierres de la partie inférieure. C’est par cette
brèche que la nouvelle mariée pourra, de temps à autre, sortir de l’enceinte de la maison
pendant toute la période de sa claustration. Cette importance du mawnik dans le
déroulement des rites matrimoniaux semble être la principale raison pour laquelle les
213
Muktele confèrent aux petits murets une dimension ethnique. Pour comprendre son rôle
identitaire, intéressons-nous à la manière dont se déroulent les rites matrimoniaux132.
La venue de la femme dans la maison conjugale est l’aboutissement d’un long
processus qui commence avec la courtisation jusqu’à son enlèvement par les gens du marié
(zawda). À l’approche de la maison conjugale, qui est aussi celle de ses beaux-parents, la
jeune fille donne l’impression de ne pas vouloir y entrer. Elle est néanmoins introduite de
force par les zawda qui l’obligent à lui faire passer l’étroite porte du gay (Juillerat, 1971:
182). Après la traversée des vestibules et de la salle des greniers, la jeune mariée est
également introduite de force dans la case de son mari, où elle restera claustrée jusqu’à la
fête du madvedev (entretien avec Waoussa, femme de 50 ans, le 22 décembre 2011, à
Baldama; avec Dugzum, femme de 40 ans, le 28 décembre 2011, à Tala-Mokolo). À partir
de ce moment, la nouvelle mariée prendra le nom de la mlok, un terme qui désigne en
réalité toute personne étrangère qui intègre un groupe déjà constitué (Juillerat, 1971:182).
Le lendemain de son arrivée, les gens de la famille du marié font griller une poule
dans un coin de la maison. Le poulet est ensuite rituellement présenté à la mlok par la belle-
mère qui lui répète trois fois la même expression: sak anay, dugu; sak anay, dugu; sak
anay, dugu (voici la poule, fille; voici la poule, fille; voici la poule, fille). Il s’agit en réalité
d’un rite plutôt que d’une volonté concrète d’offrir à manger à la mlok, car celle-ci restera à
jeun pendant les trois premiers jours de la claustration (Juillerat, 1971 : 182). Cette période
est aussi caractérisée par l’interdiction formelle de tout contact entre la mlok et le marié - y
compris le rapport sexuel (entretiens avec Kourbe, femme 57 ans, le 12 mai 2012, à
Baldama; avec Zara, femme de 33 ans, le 29 mai 2012, à Tala-Mokolo). De même, il est
interdit à la mlok de travailler, de satisfaire à ses besoins les plus naturels, et encore moins
de sortir hors de la case dans laquelle elle est claustrée. Elle est par contre autorisée à parler
132 Bernard Juillerat fournit en détail une description minutieuse des rites matrimoniaux dans son ouvrage sur les bases de l’organisation sociale chez les Muktele (1971). Le temps n’a véritablement pas changé la pratique de ces rites dans les localités de montagne telles que Baldama et Zuelva dans lesquelles j’ai mené mes enquêtes. Par contre, chez les Muktele descendus en plaine, elles tendent de plus en plus à régresser. Les observations de Bernard Juillerat des années 1970 et mes propres observations effectuées en 2007 et en 2012 ont permis d’orienter les questions lors de mes discussions avec les participants muktele sur le rôle que tiennent ces rites dans les représentations identitaires et dans la dynamique du mawnik.
214
de temps à autre avec son mari, tant que leur communication se fait en toute discrétion
(Juillerat, 1971: 183).
Le troisième jour correspond à la consommation du mariage133. Le mari est alors
autorisé à ouvrir une brèche (manwik) dans le muret de pierres qui constituera l’unique
point de contact entre la mlok et le monde extérieur. Il lui est strictement interdit d’utiliser
l’entrée principale du gay jusqu’à la fête du madvedev, et sa présence dans les parties
masculines de la maison (vestibules, cases du père, chèvreries et enclos) doit être limitée au
strict minimum. Le seul mouvement qu'elle effectue au sein de la maison est le va-et-vient
entre la case où elle est claustrée et le mawnik: « lorsqu’elle a envie de voir le dehors, elle
peut venir s’asseoir au seuil de le mawnik » (entretien avec Tekuslem, homme de 75 ans, le
13 décembre 2011, à Baldama), mais à la condition qu’elle le fasse en l’absence de tout
regard extérieur, explique Tobela (entretien avec Tobela, homme de 25 ans, le 19 octobre
2011, à Tala-Mokolo). Le troisième jour est enfin le jour où la mlok signe la fin de la
période de jeûne. Un repas rituel est préparé pour la circonstance par la belle-mère, et est
consommé conjointement par les gens du clan de l’époux et de la mlok délégués pour la
circonstance par les beaux-parents134. Après cela, les membres des deux clans prennent
ensemble l’eau de farine du mil (matakor phaô) apportée par les visiteuses (Juillerat,
1971 :186). La prise de l’eau de farine marque le début d’une relation d’harmonie entre les
deux clans désormais partenaires. La mlok continuera cependant de mener une vie de
réclusion à l’intérieur de la maison, mais il lui est désormais autorisé de sortir de temps à
autre par le mawnik (Juillerat, 1971 :186).
Toutes mes questions sur l’importance et la raison d’être du mawnik dans le
déroulement de ces rites matrimoniaux ont suscité deux catégories de réponses: l’une
d’ordre pratique et l’autre d’ordre symbolique. Au plan pratique, le « mawnik permet à la
mlok de ne pas utiliser l’entrée principale de la maison pour lui éviter le risque de croiser
son beau-père avec qui elle ne doit pas avoir de relation jusqu’à la fête du madvedev », 133 Pour plus de détails, consulter aussi un article de Bernard Juillerat (1968).
134Mais avant que la mlok ne soit autorisée à prendre ce repas, elle doit recevoir au préalable quatre boulettes de la pâte de farine crue que lui remettent les femmes venues de son village. La première boulette est apposée sur le revers de la main gauche, la deuxième sur le revers de sa main droite et la troisième à nouveau sur le revers de la main gauche. La quatrième boulette, par contre, lui est remise dans le creux de sa main droite, et celle-ci constituera le premier repas pris par la mlok depuis son entrée dans la concession conjugale.
215
explique Massadao (entretien avec Massadao, femme de 60 ans, le 28 mai 2012, à
Baldama). Au plan symbolique, il lui permet « de devenir une nouvelle personne »,
d’oublier la phase la plus critique de la claustration laquelle ouvre la voie à la période de la
fertilité (entretien avec Damatala, homme de 66 ans, le 13 décembre 2011, à Baldama). De
fait, la période qui suit les trois premiers jours de la claustration ouvre la voie à une série
d’unions sexuelles entre les deux partenaires qui perdurent jusqu’à l’apparition de la
première grossesse (Juillerat, 1968). Pendant cette période d’intenses activités sexuelles, la
mlok s’enduit régulièrement de l’huile d’ocre sur tout son corps, particulièrement sur le
crâne et les fesses dans le but de la fertilité (Juillerat, 1971: 187). Dès l’apparition de la
première grossesse, la mlok quitte la case de son mari et reçoit sa propre case au sein de la
maison conjugale, ce qui constitue une étape importante pour son intégration. À partir de
cet instant, elle cesse théoriquement d’être une étrangère dans la maison, mais attendra la
fête du madvedev pour que son incorporation soit pratiquement effective (entretien avec
Kwala, homme de 80 ans, le 27 décembre 2011,à Baldama).
Figure 26 : Petit muret muktele (mawnik) qui sera défait à sa base pour permettre à la mlok de sortir de temps en temps de sa période de claustration
216
Il y a donc un rapprochement entre le mawnik et le madvedev tant au plan
chronologique que symbolico-rituel. La première est le moment le plus important dans la
vie de la nouvelle mariée, car elle met fin à la période la plus critique de sa claustration. La
deuxième constitue le moment le plus important au niveau sociétal parce qu’étant la seule
manifestation culturelle célébrée à un niveau ethnique. Autrement dit, le mawnik est à la
jeune mariée ce que le madvedev est à la société muktele, et les deux sont interprétés
comme des transitions vers des jours meilleurs. L’abandon de la famille utérine est
interprété comme « une période de crise » vécue par la mlok, et sa symbolique est mise en
rapport avec les conflits inter-claniques, la famine, la sècheresse, l’infertilité qui survient au
niveau sociétal135.
En revanche, l’intégration complète dans la famille de son mari est un moment de
joie et de réjouissance et sa symbolique est mise en rapport avec la fête du madvedev. De
même que le mawnik débouche sur l’épanouissement de la jeune fille, de même le
madvedev ouvre la voie à une nouvelle saison dans les relations intra-ethniques. Si la
première est un nouveau recommencement à un niveau individuel, la deuxième est une
sorte du nouvel an au niveau sociétal. L’intégration effective de la mlok dans la maison
conjugale est exprimée symboliquement par reconstruction du mawnik, tandis que la
nouvelle année muktele qui commence avec la fête du madvedev, s’accompagnent d’une
série d’activités pratiques et symboliques entre autres: l’expulsion rituelle de l’esprit des
rivalités inter-claniques; la consommation de la bière du mil et de l’eau de farine
symbolisant les nouvelles relations entre deux clans ennemis, le nettoyage des maisons et la
réfection des toitures des cases; la construction d’une cuisine et d’un grenier à mil pour la
mariée.
135 Il est particulièrement intéressant de signaler qu’en plus de la fête du madvedev qui est célébrée par tous les clans muktele, existent une autre, que les Muktele appellent mazazay. À la différence du madvedev, il existe non pas un mazazay unique mais cinq mazazay correspondant aux cinq clans composants le groupe ethnique muktele. Autrement dit, sa célébration est limitée aux personnes appartenant à un même clan : « la fête du mazazay permet aux frères de manifester leur unité et d’offrir des prières au dieu [sans doute clanique]. Ce jour-là, personne n’est censé aller travailler au champ, même les travaux domestiques importants sont délaissés » (entretien avec Kwala, homme de 80 ans, le 27 décembre 2011, à Baldama).
217
En outre, la fin complète de la période de claustration de la mlok débouche sur son
intégration complète dans sa nouvelle famille, qui elle-même coïncide avec la fête du
madvedev. Cette transition, symboliquement exprimée par la fermeture du mawnik, permet
à la mariée ainsi qu’à sa famille et à son clan, d’être désormais considérés comme partie
intégrante de la famille et du clan du marié. En connectant en aval les rites matrimoniaux
de la claustration (moment de crise) et en amont la fête du madvedev (moment de joie et de
communion interethniques), le mawnik offre la symbolique du passage de la diversité
clanique à l’unité ethnique, du chaos à l’ordre unifié, et de la guerre à la paix (entretien
avec Massadao, femme de 60 ans, le 28 mai 2012, à Baldama). Elle articule dès lors une
catégorie ethnique en dépit des différences entre clans opposés qui composent le groupe
muktele; différences créées entre autres par des trajectoires historiques et généalogiques
différentes. La reconstruction du mawnik et la fête du madvedev sont donc intimement
liées et l’interprétation de l’une débouche presqu’invariablement sur l’interprétation de
l’autre.
3. Comment guérir le mal qui vient de l’intérieur de la maison et du groupe? Objets domestiques à dimension magique
En répondant à la question de savoir quelle est la forme architecturale qui traduit le
mieux la différence avec les maisons de leurs voisins podokwo, uldeme et urza, les Mura
ont invariablement répondu en citant, non pas une unité architecturale ou une technique
architecturale particulière, mais plutôt les multiples pots et objets de médecine enterrés çà
et là au sein de l’habitation. J’ai reformulé à plusieurs reprises et de plusieurs manières ma
question pensant qu’il se posait certainement un problème de communication entre moi et
mon interprète, mais les réponses sont restées invariables. Dans leur explication, les Mura
établissent une connexion logique entre les objets magiques et un ensemble de croyances
partagées d’un point à l’autre de l’aire mura, et dans lesquelles la maison figure comme
partie intégrante. Pour mieux saisir le rôle identitaire véhiculé par ces divers objets de
médecine, il convient de dire un mot sur le système de croyances mura et sur la manière
dont ils interviennent pour donner à la maison son rôle de référent identitaire.
Selon les Mura, il existe deux sources de pouvoir surnaturel : les ancêtres et la
sorcellerie. Alors que les ancêtres sont appelés à protéger la lignée patrilinéaire « pour que
218
la maison ne disparaisse pas », les sorciers sont, au contraire, à l’origine de la pauvreté, de
la misère et de la mort (entretien avec Kwona, homme de 65 ans, le 22 juin 2012, à Dume).
La puissance ancestrale est générée par un acte à portée collective entrepris par un individu
dans l’intention de protéger tout ce sur quoi repose la société (maison, territoire, mil et
enfants). La sorcellerie est, à l’opposé, un acte antisocial initié par un individu dans le but
de nuire à la vie d’un autre et à l’équilibre sociétal (Lyons, 1992: 137-138). Ces deux
formes de pouvoir opèrent dans l’espace intime de la maison. Les divers objets enterrés
interviennent d’une part, dans la neutralisation des effets pervers des sorciers malveillants,
et d’autre part, dans l’entretien et le dialogue avec les ancêtres bienfaiteurs.
Au rang d’objets censés traquer les puissances des sorciers, se distinguent d’une
part, les amulettes et os enfouis à l’entrée de la maison, et de l’autre, les pots enfouis dans
l’espace intime des femmes. L’entrée de chaque maison est magiquement revêtue par des
amulettes, une sorte de matériaux magiques généralement peints en rouge, et obtenus chez
les spécialistes. Dans la tradition mura, les objets associés à la neutralisation du pouvoir
maléfique des sorciers doivent être décorés en rouge ou en spirale; le rouge étant considéré
comme une couleur contenant un contre-pouvoir (entretiens avec Kwona, homme de 65
ans, le 22 juin 2012, à Dume; avec Lamisse, femme de 58 ans, le 22 juin 2012, à Dume;
avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à Mora-Massif)136. Les Mura croient
qu’en traversant ou en piétinant ces objets magiques, l’individu se trouve sous le contrôle
de son propriétaire. Le contexte de ce rite est efficace en soi. La cérémonie d’enterrement
des objets a lieu pendant la fête annuelle du Bakashidgwe au cours de laquelle seuls les
hommes sont présents à la maison. Les femmes quant à elles quittent la maison conjugale et
retournent dans leurs clans pour y rester pendant toute la durée de la fête (huit jours
environ)137. L’enterrement des os de coq à plumes rouges procure aux hommes une
136 Les motifs décoratifs observés sur les objets enterrés dans le sol de l’entrée sont similaires à ceux qui figurent sur les amulettes de protection, une sorte d’objets protecteurs attachés à la hanche ou suspendu au cou. Les amulettes sont puissantes parce qu’ils incorporent des symboles protecteurs en elles, notamment l’utilisation de la couleur rouge et noire qui sont considérées par les Mura comme des couleurs du pouvoir et de la puissance. Fabriquées de la peau de chèvre, les amulettes sont toujours décorées en rouge pour prévenir les attaques des sorciers (entretien avec Amagouwe, homme de 55 ans, le 16 mai 2012, à Mora-Massif).
137Le rite est adopté de manière cyclique, en s'appuyant sur des actes antérieurs qui réaffirment la continuité spatiale et temporelle des hommes avec la terre, les ancêtres et la maison. Contrairement aux hommes, les femmes n'enterrent pas d’objets de ce type dans leurs structures. Les femmes ne portent pas non plus d’amulettes personnelles. Diane Lyons (1992) tire argument de ce contraste pour en faire une analyse genrée
219
protection supplémentaire contre les attaques de sorcellerie venant de l’extérieur, et surtout
de l’intérieur de la part des épouses138. Présumées à priori sorcières, les femmes de la
maison doivent, à leur retour, marcher sur ces objets pour neutraliser n’importe quelle
puissance malveillance qu’elles possèderaient (entretiens avec Kwona, homme de 65 ans, le
22 juin 2012, à Dume ; avec Kwetcherike, homme de 60 ans, le 13 juin 2012, à Dume).
Par ailleurs, les objets jugés dangereux doivent être percés afin de libérer les
substances maléfiques qu’il contiendrait. Par exemple, les pots sont susceptibles d’être
utilisés par les puissances maléfiques et par les sorciers, et doivent être systématiquement
décorés et percés. Les femmes qui ne percent pas et ne décorent pas leurs pots sont
suspectées d’être sorcières, cachant à l’intérieur des médicaments pour nuire à la santé du
chef de famille, ou pour le rendre impuissant avec les autres épouses (entretien avec
Kwona, homme de 65 ans, le 22 juin 2012, à Dume). Les objets associés à l’accouchement
sont tout aussi dangereux, et doivent par conséquent être percés. Un enfant qui vient au
monde la tête enveloppée d’un amnios est considéré comme nuisible à son père, et doit être
percé dans son œil gauche pour neutraliser sa puissance maléfique. Le placenta est enfin
traité comme une substance dangereuse. C’est pourquoi il est enterré par les femmes dans
leur espace intime, généralement entre leur cuisine et leur case à coucher pour qu’il ne
tombe pas entre les mains d’une sorcière qui pourra l’utiliser pour faire du mal à l’enfant ou
à son père (entretiens avec Lamise, femme de 58 ans, le 19 juin 2012, à Dume; avec
Amaya Rachya, femme de 43 ans, le 22 juin 2012, à Dume). Le placenta est recouvert d’un
pot renversé et percé dans son fond pour libérer les puissances nuisibles liées à sa présence.
La deuxième catégorie d’objets sacrés placés dans la maison est ceux destinés à la
communion et à la communication avec les ancêtres. Contrairement au rouge dont le rôle
des relations entre homme et femme au sein de la maison; relation dans laquelle la femme est vue comme faisant desactes de sorcellerie envers l’homme qui se trouve ici en position de personne vulnérable.
138 D’après Dianne Lyons, l’inhumation des os du coq dans le sol à l’entrée de la concession est en contraste frappant avec la façon dont les Mura se comportent avec les os d’autres animaux domestiques (mouton et chèvre en particulier), dans la mesure où ces derniers sont jetés plutôt qu’enterrés. Les Mura pensent en effet que les os longs sont des objets dangereux lorsqu’ils tombent entre les mains d’un sorcier, et peuvent être utilisés comme un véhicule de puissances nuisibles pour attaquer leurs victimes (voir l’analyse faite par Lyons, 1998: 344-362). Ainsi, après chaque repas et par mesure de précaution, chaque personne collecte ses fragments d’os et les garde dans une poterie individuelle qu’il conserve également avec précaution avant d’être jetés dans le plus grand secret lors du festival annuel de Sadake (entretien avec Kwona, homme de 65 ans, le 23 juin 2012, à Dume).
220
est de neutraliser les effets néfastes des sorciers, le noir est plutôt mis en rapport avec les
ancêtres du clan et de l’ethnie. De ce fait, les pots destinés à la communion avec les esprits
sont en général décorés en noir. Par exemple, les récipients dans lesquels les Mura prennent
leur repas quotidien sont décorés en noir: « lorsque nous prenons la nourriture préparée par
les femmes, nous le prenons ensemble avec les ancêtres les plus proches », précise Dawcha,
(entretien avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à Mora-Massif). « Le noir est
beau et particulièrement attrayant pour les ancêtres » renchérit Daugwene (entretien avec
Daugwene, homme de 82 ans, le 16 juin 2012, à Dume), qui prennent ainsi part, non
seulement aux sacrifices qui leur sont destinés, mais aussi aux repas quotidiens avec leurs
descendants. Les gerda lay, ces pots qui contiennent les esprits d’ancêtres décédés, sont
pareillement décorés en noir.
On peut se poser la question de savoir en quoi la maison a des liens avec ces objets
magiques, et en quoi l’identité ethnique est-elle concernée par ce système de croyances? En
effet, les Mura établissent un lien étroit entre la maison, les pots, les gens du groupe et les
ancêtres. Ils étendent aux parties du pot et de la maison des termes applicables au corps
humain. Dans cette avenue, les pots sont décrits comme ayant une bouche, un cou, un
corps, un ventre, un nombril, et deux bras (entretiens avec Kwona, homme de 65 ans, le 22
juin 2012, à Dume; avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à Mora-Massif). La
preuve la plus plausible de cette équivalence spéciale entre pots et individus est le choix de
pots destinés à représenter les ancêtres. En tant que représentation anthropomorphique de
ceux-ci, ces pots sont équipés d’une tête, des bras, d’un cou, et possédé dans certains cas
d’un menton barbu139. Les pots représentant les ancêtres males sont parfois pourvus d’un
pénis stylisé alors que les pots représentant les ancêtres femelles sont quant à eux stylés
avec deux seins et une vulve (entretiens avec Lamisse, femme de 58 ans, le 19 juin 2012, à
Dume; avec Amagouwe, homme de 55 ans, le 16 mai 2012, à Mora-Massif). Les pots
représentant les jumeaux possèdent deux corps distincts, mais uni au niveau de l’ouverture
(bouche du pot), correspondant à la croyance selon laquelle les esprits de jumeaux sont
139 D'identiques décorations des pots ancestraux sont signalées dans d’autres groupes ethniques des monts Mandara, notamment chez les Mafa et Bulahay par Nicholas David, Judith Sterner et Kodzo Gavua (1988) ; Serge Genest (1972); David (1972), et chez les Uldeme par MacEchern (1987).
221
indissolublement liés (entretien avec Amagouwe, homme de 55 ans, le 16 mai 2012, à
Mora-Massif).
Le rodage rouge utilisé pour décorer la série des pots destinés à contrecarrer le
pouvoir des sorciers est produit en utilisant la même huile que celle produite pour enduire
le corps humain lors d’occasions festives. Les enfants en bas âge sont régulièrement oints
sur une grande partie de leur corps avec de l’ocre rouge, surtout lorsqu’ils doivent
participer aux fêtes populaires140. Les façades des greniers et des cuisines qui représentent
les seules unités architecturales en argile sont décorées en utilisant l’huile d’ocre. Le choix
de la terre termitière, de couleur très rouge, comme matériaux de construction des
structures en argile peut également avoir affaire avec le sens que les Mura attribuent à la
couleur rouge, surtout que les cases d’argile abritent essentiellement les femmes et les
enfants en bas âge. Enfin, les nouveaux morts étaient enterrés dans des pots décorés rouges
pour leur permettre de regagner en toute sécurité la communauté des ancêtres, explique
Medyokwa, qui est par ailleurs un des nombreux devins que compte le village de Dume
(entretien avec Medyokwa, homme de 60 ans, le 26 juin 2012, à Dume).
La plupart des informateurs mura interrogés sur ces similitudes dans le traitement
du corps humain, des pots et de certaines unités architecturales répondent qu’ils sont liés,
car le bien-être de la maison dépend du bien-être de son propriétaire et inversement. Dans
la même veine, les Mura attribuent certaines maladies et certains décès, en particulier ceux
des enfants, au mal-être psychologique de la maison141. À ce titre, les pots et les maisons
installent l’individu en tant que membre d’une lignée donnée142. Les lignages l’installent à
leur tour en tant que membre de la société mura grâce aux relations matrimoniales inter-
claniques dans lesquelles prime le clan maternel sur le clan paternel143. Par ailleurs, en tant
140 Le rouge, la couleur du pouvoir, offre également une protection contre les dangers non seulement par la décoration d’objets utilisés par les personnes, mais également par l’enduction des corps des personnes considérées comme les plus vulnérables (voir Lyons, 1998: 344-362). Ainsi, plus faible est la personne, plus exposée à la sorcellerie et à d’autres risques surnaturels il sera, et plus de rouge il aura besoin pour assurer sa protection. La symbolique des couleurs associant le rouge à la lutte contre les esprits malveillants et le noir à la communion avec les ancêtres existe chez les Mafa et les Bulahay (voir aussi David, Sterner et Gavua, 1988: 371-372).
141 Voir le chapitre V pour une analyse détaillée de l’interconnexion entre maison et occupant. 142 Voir aussi Jeanne-Françoise Vincent (1971) sur le rôle des pots dans la divination et dans la création des sentiments claniques et lignagers chez les Mofu. 143Sur le primat du clan maternel sur le clan paternel, voir Jeanne-Françoise Vincent (1985).
222
que siège de déroulement des pratiques religieuses, la maison assure une continuité entre
les membres morts, les membres vivants et les membres à venir du groupe144. Dans cette
veine, chaque chef de famille est garant du bonheur de tous les membres de sa maison y
compris ceux qui sont avant lui (les ancêtres du groupe maintenant décédés) et ceux qui
viendront après lui, explique Medyokwa (entretien avec Medyokwa, homme de 60 ans, le
26 juin 2012, à Dume) lui-même chef du clan. Pour cela, il doit, de l’avis d’Amaya, l’une
des femmes de Medyoka, accomplir scrupuleusement tous les rites religieux à l’égard des
ancêtres pour leur permettre d’être épanouis dans l’au-delà:
On dit que les ancêtres qui reçoivent des offrandes et qui communient avec leurs descendants sont assis et vivent heureux là-bas, alors que ceux qui ne reçoivent rien sont malheureux. Les ancêtres ne vivent pas selon les clans là-bas. Il y a juste deux classes: il y en a qui sont heureux et il y en a ceux qui sont malheureux parce qu’ils ne reçoivent pas de sacrifices. Ils restent tout le temps debout en train de regarder avec envie ceux qui reçoivent des sacrifices (entretien avec Amaya Rachya, femme de 43 ans, le 22 juin 2012, à Dume).
Mais pour pouvoir assurer cette continuité, les puissances maléfiques opérant au
sein de la maison doivent être neutralisées. C’est une fonction qui engage la responsabilité
de chaque chef de famille, quelle que soit son appartenance clanique. S’il manque à cette
responsabilité, les ancêtres morts peuvent le punir de son vivant, puisqu’il introduit une
rupture dans la lignée clanique et dans la communion ethnique. Ils peuvent par exemple lui
interdire l’accès à la communauté d’ancêtres dans l’autre monde au jour de sa mort, et le
condamner à la solitude éternelle (entretien avec Medyokwa, homme de 60 ans, le 26 juin
2012, à Dume). Quant aux futurs descendants, ils auront le droit de ne pas lui offrir le culte
post mortem. En négligeant d’enterrer annuellement les objets magiques, le chef de famille
peut ainsi introduire la rupture dans la cohésion du groupe; ce qui le condamne en retour à
l’exclusion de la communauté ancestrale dans l’autre monde.
La crainte de la sorcellerie occasionne par ailleurs des migrations inter-claniques,
renforçant la solidarité ethnique. Lorsqu’une maladie est attribuée aux attaques sorcières
après divination, la victime, disent les Mura, peut trouver protection dans la maison du frère
144La gestion de la maison implique, de ce fait, des obligations aussi bien envers les défunts qu’envers les gens à venir. Les ancêtres du groupe ont droit à des évocations et à des offrandes, et les descendants ont droit à un héritage.
223
de la mère (l’oncle maternel) où il restera jusqu’à son rétablissement (entretiens avec
Kwetcherike, homme de 60 ans, le 13 juin 2012, à Dume; avec Nache, femme de 48 ans, le
13 mai 2012, à Mora-Massif). Or, le village de l’oncle maternel appartient nécessairement à
un autre clan au regard de l’interdiction stricte des mariages intra-claniques. En octobre
2011, j’ai rencontré Tchargue, originellement habitant le village de Sama, mais vivant au
moment de l’enquête à Dume auprès de Mahama, qui est son oncle maternel. Tchargue était
tombé malade dans son village deux ans auparavant, et était complètement paralysé. Après
avoir consulté un devin, la maladie a été attribuée à une attaque sorcière venant d’une des
épouses de son papa. Pour ne pas succomber à la maladie, le devin lui a conseillé de migrer
temporairement dans le village de sa mère déjà décédée, et c’est ainsi qu’il quitta son
village et son clan pour trouver sécurité auprès de Mahama appartenant à un autre clan.
Selon les informateurs mura, les femmes de la maison du frère de la mère n’ont pas
le pouvoir de nuire au neveu. Elles sont plutôt pour ce dernier « un rocher qui ne manque
jamais au jour de la détresse », souligne Nache, une femme d’origine mura devenue
chrétienne au début des années 1980 (entretien avec, femme de 48 ans, le 13 mai 2012, à
Mora-Massif). Les sorcières de son clan qui intentaient à sa vie, ne peuvent pas l’atteindre
une fois qu’il trouve refuge auprès du « frère de la mère », car il est désormais sous la
protection du clan maternel. L’oncle maternel est donc naturellement la personne la plus
appréciée des Mura, et est décrit comme une personne tendre, bienfaisante, et aimable (voir
aussi Vincent, 1985 : 73-105). Dans la mesure où presque toutes les maladies sont
attribuées à une attaque sorcière, les mouvements inter-claniques sont constants, ce qui
renforce les liens sociaux entre deux ou plusieurs clans partenaires. Tandis que les femmes
de la maison paternelle sont considérées comme des sorcières malveillantes145 au sein de la
maison et du clan de leurs maris, les femmes du village du « frère de la mère » sont plutôt
affectueuses (entretiens avec Kwetcherike, homme de 60 ans, le 13 juin 2012, à Dume;
avec Nache, femme de 48 ans, le 13 mai 2012, à Mora-Massif). Même si elles sont
sorcières, elles sont animées de bonnes intentions vis-à-vis de leur neveu, et ne font du mal
qu’aux gens du clan de leurs maris. La relation neveu utérin-oncle maternel créée ainsi des
liens supra-claniques dans la mesure où ces deux individus appartiennent nécessairement à 145 Elles sont vues comme des sorcières avec pour intention de manger les enfants de la coépouse, de nuire au mari et aux autres enfants du village dans lequel elles sont mariées.
224
des clans différents. Autrement dit, la lutte contre la sorcellerie, commencée dans la maison
par l’enterrement d’objets de médecine, se trouve prolongée au-delà des frontières
claniques grâce à la mobilité inter-clanique des victimes, ce qui donne lieu à la formation
des relations sociales entre les villages et au renforcement du sentiment ethnique.
4. Construire comme l’autre… mais rester soi : domestication des formes architecturales des voisins et significations identitaires
Dans son introduction à l’ouvrage Ethnic Groups and Boundaries, Fredrik Barth
(1969a) a avancé l’idée que les différences ethniques n’étaient pas le résultat de l’isolement
géographique ou social, et, que les groupes ethniques n’étaient pas non plus de simples
porteurs d’entités culturelles distinctes. Au lieu de cela, Barth fait valoir que les frontières
servent de fondements aux systèmes sociaux très entrelacés (Barth, 1969: 10). Ces
observations l’ont conduit à suggérer que l’interaction entre les membres de différents
groupes ne conduit pas nécessairement à la perte des spécificités culturelles, mais que
celles-ci peuvent persister malgré le processus d’acculturation (Barth, 1969: 10).
Mes enquêtes de terrain m’invitent à confirmer les propos de cet auteur. Certaines
ethnies ont emprunté et domestiqué le modèle architectural d’un autre groupe, sans que cela
ne modifie les discours des acteurs dans l’interprétation de leur mode d’habiter. C’est le cas
des Podokwo qui ont intégré le modèle muktele dans leurs pratiques architecturales.
Répondant à une question sur la perception qu’ils ont de cet emprunt, Səvəda Chikoua
explique : « Nous avons adopté cette façon de construire pour matérialiser nos bonnes
relations avec les Muktele. Mais construire comme eux ne signifie pas devenir comme eux.
C’est juste un mariage de deux modèles» (entretien avec Səvəda Chikoua, homme de 44
ans, le 06 avril 2009, à Godigong). De la pensée de cet informateur, je voudrais me pencher
sur les rapports entretenus entre les deux peuples, avant d'expliquer le sens donné à
l’incorporation du modèle muktele dans l’architecture des Podokwo.
Selon mes informateurs, les relations matrimoniales entre Muktele et Podokwo
semblent avoir été une constance146. Les Muktele de Baldama par exemple constituaient
146 Voir aussi à cet effet, les nombreux travaux de Scott MacEachern (1991; 1990; 1987).
225
une réserve de femmes pour les Podokwo d’Udjila et inversement147. De ces rapports
matrimoniaux ont résulté une série d’emprunts qui ont favorisé le métissage de la culture
matérielle, et de l’architecture en particulier. Les gens du groupe ethnique duquel est issu
l’époux, se rendent régulièrement dans l’ethnie d’origine de l’épouse pour assister les
beaux-parents dans les travaux de construction et de réfection des cases (Chétima, 2006:
26-27). Il s’en est suivi très souvent l’imitation et la reproduction du modèle architectural
de l’« ethnie visitée » et inversement. Dans le cas particulier des Podokwo, l’imitation et la
reproduction du modèle muktele ont été codifiées par la tradition locale. Les jeunes chefs
de famille podokwo trouvent l’architecture muktele plus facile à construire et moins
exigeante en pierres que celle de leur groupe d’appartenance. Au-delà de la facilité des
techniques de construction du mur muktele, il y a, comme l'a souligné Səvəda Chikoua, la
volonté de matérialiser dans l’espace les bonnes relations. De ce fait, la concession du chef
podokwo d’Udjila inclut une partie construite essentiellement sur le modèle muktele. Le
chef Mozogo d’Udjila a en effet contracté plusieurs mariages avec des femmes muktele, et
« c’est pourquoi sa concession comporte un domaine construit selon le modèle muktele »
(entretiens avec Kwala, homme de 80 ans, le 18 mars 2008, à Baldama; avec Səvəda
Chikoua, homme de 44 ans, le 06 avril 2007, à Godigong). Dans tout le pays podokwo, le
mur reliant les cuisines et les cases est encore appelé « kayə matala: maison muktele ».
Inversement, les vestibules en enfilade que l’on rencontre dans les grandes concessions
muktele semble être d’une inspiration podokwo.
Contrairement à la fluidité de la frontière ethnique entre les Podokwo et les
Muktele, on observe une certaine rigidité au niveau de celle séparant les Podokwo et les
Mura. Tous les répondants Podokwo et Mura suggèrent qu’il y a eu très peu d’échanges
matrimoniaux entre eux et donc très peu d’emprunts d’éléments architecturaux (Chétima,
2006: 26). Leurs rapports ont été d’ailleurs plus conflictuels que pacifiques. Les répondants
Podokwo considèrent les Mura comme des faux Montagnards en les accusant d’entretenir
des relations ambigües avec les Wandala de Mora (entretien avec Slagama, homme de 65
ans, le 23 mai 2007, à Udjila). Dans ce sens, Ibn Fartoua, 1926 [1582] : 36)148 et Hermann
147 Cette information est aussi fournie par les répondants podokwo d’Udjila.
148Avant leur installation à Mora, les Wandala ont connu successivement deux autres capitales à savoir Doulo et Kerawa (voir le chapitre III; voir également Folk, 1989: 543; 1988: 643). Certains clans mura, vame,
226
Folk (1988: 64-67) postulent que les Mura avaient certains privilèges auprès des Wandala,
et étaient exempts de la conscription et de l’enrôlement obligatoire dans l’armée du
sultan149. Des données ethnographiques confirment également qu’au cours des périodes
troubles de leur histoire, certains sultans wandala ont trouvé refuge en territoire mura. Une
concession aurait d’ailleurs été construite dans les massifs pour garantir la sécurité des
souverains wandala lorsqu’ils se faisaient attaquer par d’autres groupes de la plaine (voir
Forkl, 1988: 65; Mohammadou, 1982: 33; Vossart, 1953). Les informateurs mura
reconnaissent en outre avoir hébergé le sultan Anarbana à la suite d'une attaque menée par
les troupes arabes150. Ferrandi rapporte enfin que, lors de la Première Guerre mondiale, le
sultan du Wandala avait fait construire un grenier de réserve en mil dans les montagnes, en
prévision des jours d’incertitude (Ferrandi, 1928: 128). Si on admet l’existence de cette
réserve, il est vraisemblable de penser avec Scott MacEachern (1990: 182) que sa
construction ne pouvait se faire sans la coopération active des Montagnards mura.
Il y a donc eu des relations plus ou moins intimes entretenues entre les Mura et les
Wandala. Si les Podokwo ont tendance à expliquer la rigidité de leurs frontières avec les
Mura par des relations ambivalentes entretenues par ceux-ci avec les Wandala, les
répondants mura tirent plutôt argument des conflits fonciers les ayant opposés aux
Podokwo de Tala-Dabara. La frontière séparant les deux groupes n’est que matérialisée par
une petite rivière, mais les mouvements des personnes de part et d’autre étaient
relativement rares. Plusieurs incidents ethniques survenus sont relatés par des informateurs
dans les deux groupes. La plus mémorable reste la mort d’un guerrier podokwo nommé
Tchokfe Kazlaŋa, assassiné par les combattants mura à l’issue d’une dispute entre femmes
uldeme disent également venir de Ngolele, localisée par MacEachern (1990) dans les massifs surplombant l’ancienne capitale des Wandala qui est Kerawa. La tradition précise qu'à Ngolele, les Montagnards et les Wandala vivaient en parfaite harmonie, comme des frères issus d’un même père. Ce récit est partagé par d’autres groupes notamment les Uldeme dont une variante a été recueillie par Scott MacEachern (1991: 177). Les auteurs comme Hermann Folk (1986), Christian Seignobos (1982) et et Eldridge Mohammadou (1982) confirment la parenté linguistique et historique entre les Wandala et les Mura.
149On se rappelle que le Wandala en tant que vassal de l’État du Borno, participait au commerce transsaharien (Forkl, 1986). Le tribut annuel qu’il payait au Borno consistait en l’octroi d’esclaves qu’il capturait au sein de groupes montagnards non-musulmans (voir le chapitre III).
150Depuis le transfert de leur capitale à Mora, il apparait que la retraite des sultans du Wandala était courante en période de guerre. Eldridge Mohammadou (1982: 31-34), Heinrich Barth (1965: 337), Jean Ferrandi (1928) et Dixon Denham et Hugh Clapperton (1826) évoquent dans leurs récits les séjours dans les massifs des souverains wandala.
227
autour d’un point d’eau. Selon les répondants mura, Tchokfe était mystiquement protégé
contre les coups de flèches, et constituait un grand espoir de victoire pour son groupe lors
des éventuelles confrontations ethniques. Lorsque les femmes podokwo furent attaquées
par leurs rivales mura, elles crièrent au secours, et Tchokfe qui se trouvait dans les environs
surgit pour porter assistance aux femmes de son groupe. Quelques hommes mura, aussi
descendus de leurs sommets pour couper de l’herbe aux animaux domestiques, alertèrent
leurs hommes qui vinrent sur le lieu de la bataille, armés de flèches et de cuirasses. Sachant
que Tchokfe Kazlaŋa était mystiquement immunisé contre les tirs des flèches
empoisonnées, un vieillard conseilla aux combattants d’uriner préalablement sur les flèches
afin de neutraliser le pouvoir du héros podokwo. Lorsque cela fut fait, la flèche atteignit
finalement Tchokfe Kazlaŋa qui rendit l’âme le même jour. En considérant la généalogie de
Tchokfe Kazlaŋa tel que reconstituée lors des enquêtes de terrain en 2012, on peut situer cet
évènement dans la période 1920-1930. Jusqu'à aujourd'hui, les membres des deux groupes
ethniques entretiennent la mémoire de ces évènements151.
Figure 17 : Descendance de Tchokfe Kazlaŋa permettant de situer dans le temps le conflit Mura/Podokwo
151 Cette histoire m’a été racontée, à la fois, par des répondants podokwo de Tala-Dabara et par les répondants Mura, entre autres par Mtsa chikoua (entretien, le 08 février 2012, à Tala-Dabara) et Dəgla (entretien, le 04 juin 2012, à Dume).
228
Cette histoire de meurtre et d’autres semblables liées à des disputes autour des
points d’eau et de la terre arable ont sans doute contribué à la maintenance de la frontière et
à la quasi-inexistante d’échanges d’éléments architecturaux entre les deux groupes. Les
disparités entre les modes de construction sont à leur tour utilisées par les Podokwo et les
Mura pour souligner leurs différences culturelles, ce qui confirme bien l’hypothèse de Ian
Hodder (1982) selon laquelle le degré du caractère distinctif d’un objet matériel aux
frontières de deux groupes sociaux dépend du stress économique et des inimitiés sociales
existant entre eux. Toutefois, malgré ces conflits qui restent présents dans la mémoire
collective, les répondants mura ne remettent pas en cause leur appartenance au groupe des
« gens de la montagne », et à ce titre, considèrent toujours les Podokwo comme
culturellement proches d’eux que ne le sont les Wandala152. Pourtant, les Wandala, comme
on l’a vu, partageraient une origine généalogique commune avec les Mura, notamment ceux
du clan de Jeveriya.
Ainsi, on s’aperçoit que la conscience ethnique ne dépend pas forcément du facteur
biologique, mais est aussi liée aux relations sociales, au moyen desquelles les différences
architecturales sont identifiées et diffusées à un niveau discursif en tant qu’outils
d’identification (Robinson, 2006; Locock, 1994 ; Doxtater, 1984 ; Hodder 1982). On
remarque aussi que les sentiments ethniques au sein d’un groupe donné sont toujours
générés en opposition à d’autres groupes (Fuchs, 1997; Morrison, 1976; Barth, 1969;
Haaland, 1969) grâce à l’utilisation des symboles architecturaux. Si la première unité
d’identification à laquelle les montagnards recourent habituellement reste la lignée
patrilinéaire (MacEachern, 2002), celle-ci est mise aux oubliettes lorsqu’ils sont en
situation d’interaction avec les autres groupes ethniques, ce qui corrobore la réflexion
émise par John Lonsdale pour qui :
« l’appartenance ethnique est un fait social universel : tout être humain crée sa culture à l’intérieur d’une communauté qui se définit par opposition aux ‘autres’… L’identité culturelle est ce que les gens en font plutôt que le résultat d’une fatalité historique » (1996 : 99).
152 Ils évoquent le caractère commun de l’architecture (usage de la pierre en particulier) pour souligner leurs similitudes avec leurs voisins podokwo.
229
Dans ce sens, les membres d’une ethnie donnée se présentent comme une entité
cohérente, et mettent en exergue cette unité ethnique, entre autres, par des pratiques
architecturales spécifiques, des fêtes et des rites ayant une portée ethnique, d’où
l’importance de dépasser la vision primordiale (Conversi, 2007; Smith, 2003; Kellas, 1991;
Scott, 1990; Van Den Berghe, 1978; Isaacs, 1974; Geertz, 1963; Shils, 1957) laquelle
définit l’ethnicité par l’aspect atavique. Les données exposées ci-dessus permettent plutôt
de la considérer comme une construction constante et consciente des acteurs sociaux
(Barth, 1969). Autrement dit, l’idée que les gens ont d’appartenir à un groupe est toujours
contextuelle et situationnelle, maintenue grâce à l’articulation symbolique de la différence
et de la similitude (Appadurai, 1996: 14; Olsen and Kobylínski, 1991: 6; Barth, 1969: 15),
une hypothèse qui permet de repenser l’ethnie dans les monts Mandara.
C. (Re)penser l’ethnie dans les monts Mandara
À partir des éléments exposés ci-dessus, il apparait que les Podokwo, les Muktele et
les Mura ont entretenu, à travers leurs manières d’habiter la maison, le sentiment
d’appartenance ethnique en dépit du caractère segmentaire et lignager qui les caractérise.
Cela s’inscrit en rupture avec deux courants de pensée qui ont émaillé les études sur les
ethnies dans les monts Mandara, et plus globalement en Afrique.
Le premier courant est incarné par les travaux de Gabriella Spedini (1999) qui
avance l’idée selon laquelle les ethnies montagnardes, plus spécialement les Mada, les
Uldeme et les Podokwo, formaient des entités ethniques stables et isolées dans leurs
territoires avant l’avènement de la période coloniale. L'auteure soutient l’idée de
l’isolement ethnique en se basant sur les enquêtes menées à Mora auprès de quelques
Montagnards à l’issue desquelles elle a observé un taux d’endogamie à 100% chez les
Podokwo en particulier (Spedini et al., 1999: 151-152). Sans remettre en cause la
crédibilité des enquêtes menées par cette auteure, il est difficile de soutenir l’idée d’une
stabilité ethnique dans les monts Mandara au regard des données recueillies et des
recherches ethnographiques et archéologiques qui m’ont précédé (MacEachern, 2001a,
1990; David et MacEachern, 1988; Boutrais et al., 1984; etc.). Et comme le souligne si bien
230
Scott MacEachern (2001b: 357-360), les exigences de survie ne permettaient pas un tel
cloisonnement ethnique dans un environnement aussi contraignant comme celui des monts
Mandara.
En réalité, l’individualisme apparent des Podokwo constaté par Gabriella Spedini se
trouve diffus et empêtré dans des systèmes sociaux interethniques d'une grande complexité,
fonctionnant à différentes échelles, allant de la simple cellule familiale à l’échelle
régionale. Les emprunts d’éléments matériels aux groupes voisins ont toujours jalonné
l’histoire des différentes communautés et ont changé, plus ou moins légèrement, leur
culture matérielle (De Colombel, 1990)153. Toutefois, les emprunts d’éléments
architecturaux muktele ne sont pas considérés par les Podokwo comme un changement
dans leur manière de construire, mais comme un processus normal visant simplement à
immortaliser les rapports entretenus. Il s’agit d« amener l’ailleurs chez soi» au sens de
Daniela Moisa (2009), de le domestiquer et d’offrir aux deux ethnies les moyens matériels
et symboliques de se rapprocher tout en maintenant leurs différences (Hodder, 1982; 1979).
Le deuxième système de pensée, sans doute le plus important, a souvent supposé
que les Montagnards n’avaient pas de conscience ethnique jusqu’à la période coloniale.
Bernard Juillerat (1971: 72-74) attribue la conscience ethnique muktele aux manœuvres de
l’administration coloniale, lorsque celle-ci effectue le regroupement des clans muktele en
deux cantons. Jean Boutrais (1973 : 36-37) corrobore les conclusions de Bertrand Juillerat
et tente de tirer argument du cloisonnement imposé par le relief aux divers clans. C’est
ainsi qu’il écrit: « Le Montagnard n'a pas une conscience ethnique très affirmée. Il est
certain que les difficultés de communication en montagne freinent la création de vastes
unités ethniques » (Boutrais, 1973: 36). Quelques années plus tard, Nicholas David, Judith
Sterner et Kodzo Gavua (1988: 173) avancent qu’avant la période coloniale, la conscience
ethnique chez les Montagnards n’existait pas, et que l’unité politique la plus large était le
massif. Ils se sont basés sur les similitudes qu’il y a entre les pratiques de décorations des
pots chez les Mafa et les Bulahay d’une part, et de l’autre, sur le fait que les Bulahay
153 Les interactions entre groupes montagnards sont aussi attestées par le multilinguisme qui les caractérise. (MacEachern, 2001; Barreteau, Breton et Dieu, 1984: 159-180). Les récits des migrations évoquent par ailleurs des migrations inter-massifs, et des réinstallations de certains clans au sein d’un nouveau groupe ethnique (MacEachern, 1998; David, 1992; Sterner, 1992; Boulet et al., 1984).
231
s’expriment aujourd’hui en langue mafa et se prennent parfois pour des Mafa. Par ailleurs,
Nicholas David, Judith Sterner et Kodzo Gavua font remarquer que chaque clan préside à
ses propres rites sous le leadership d’un chef de montagne (1991: 171), et soutiennent par
voie de conséquence l’idée de l’absence d’une conscience ethnique. Plus récents encore
sont les travaux de Scott MacEachern (2002, 2001, 1998, 1992) qui semblent lui aussi
confirmer l’hypothèse d’une absence de sentiment ethnique avant la colonisation chez les
populations des monts Mandara. Cependant, contrairement à David Nicholas, Judith
Sterner et Kodzo Gavua, Scott MacEachern se base sur les similitudes observées au niveau
de la céramique dans quelques groupes ethniques, en particulier chez les Uldeme, les Plata,
les Vame-Breme et les Mura. Il avance l’hypothèse que la diffusion des techniques de
poterie se serait réalisée par le biais des mouvements de personnes à travers les frontières
ethniques, et surtout par des mariages interethniques dont il situe l’existence à la période
précoloniale (MacEachern, 1990). Il considère la mobilité des Montagnards et les mariages
interethniques comme la preuve de la porosité des limites ethniques, elles-mêmes étant la
preuve de l’absence des sentiments ethniques.
Certes, l’ethnie ne recouvrait aucune homogénéité de parenté et ne servait en aucun
cas d’appui à une unification politique. Les informateurs sont d’ailleurs unanimes sur le fait
que les massifs d’une même ethnie se faisaient régulièrement la guerre (Slalawa versus
Udjila, Kassa versus Makulahe chez les Podokwo; Baldama versus Zuelva chez les
Muktele), et manifestent encore aujourd’hui des sentiments d’animosité inter-claniques. En
dépit de cela, les groupes étudiés dans le cadre de ce travail, entretenaient bien avant la
création des cantons dans les années 1940 un sentiment d’appartenance ethnique, même si
celle-ci n’avait pas constitué une donnée stable154. En effet, la cohésion ethnique ne
s’exprimait pas ici par une origine généalogique ni par la défense d’un territoire commun.
Elle était plutôt maintenue par des fêtes religieuses et des rites qui s’appliquaient à tous les
actes de la vie quotidienne du groupe, et dont le déroulement avait pour cadre la maison.
154 Pour les enquêtes sur l’existence ou non de sentiments ethniques avant la création des cantons en territoire montagnard (entre 1940 et 1950), j’ai privilégié les informateurs octogénaires; ils pouvaient fournir des détails sur la question de l’ethnie en tant qu’informations de premières mains. Même si les données peuvent être sujets à des manipulations (voir chapitres II et III), le fait d'avoir diversifié les informateurs dans les trois groupes permet de limiter les mises en scènes de l’information.
232
Les informateurs podokwo, muktele et mura sont enfin unanimes sur l’homogénéité
linguistique et architecturale entre les différents clans de leur groupe ethnique.
Il est en réalité difficile de soutenir l’idée de l’absence d'une conscience ethnique
avant le moment colonial en se prévalant du motif que les clans d'une même ethnie se
faisaient régulièrement la guerre. Comme nous l’avons vu avec le cas des Muktele, la
guerre et la paix, la stérilité et la fertilité, la crise et l’abondance, etc. sont perçues comme
des moments entrelacés. À la période de la guerre succède celle de la paix et de recherche
de la cohésion inter-clanique. Le statut de référent identitaire conféré au mawnik découlait
du discours local sur la symbolique de l’abandon par la mlok de la famille utérine (moment
de crise) et de son intégration dans la famille conjugale (moment de solution apportée à la
crise). Le mawnik lui-même étant relié en amont à la claustration de la mlok et en aval à la
fête du madvedev, qui symbolise le passage de l’individualisme clanique à la solidarité
inter-clanique.
Figure 28 : Mawnik reliant la claustration de la mlok à le madvedev, symbolisant le passage de l’individualisme clanique à la solidarité ethnique
233
De ce fait, on peut avancer que l’ouverture de la brèche dans le mur n’était pas
simplement un passage offert à la nouvelle mariée, mais constituait activement et
symboliquement un moyen de connexion entre deux clans, désormais unis par le lien du
mariage. Les petits murets sont ainsi au cœur de la construction de l’identité ethnique des
Muktele et traduisent leur volonté de concilier les crises disharmoniques découlant des
différentes trajectoires historiques et généalogiques suivies par les différents clans. Certes,
la domination coloniale a résulté en la création des cantons en territoire montagnard;
lesquels cantons étaient supposés correspondre aux unités sociales et linguistiques. Dans
certains groupes, cela a été le cas (les Mada par exemple), et dans d’autres, cela n’a pas été
le cas (voir Beauvilain, 1989: 386-398)155.
Ce processus de création de cantons a manifestement abouti dans certaines régions à
la création d'une conscience ethnique là où il y en avait pas. Cela pourrait être
éventuellement le cas des Mafa et des Bulahay. Ces derniers tendent à s’intégrer
progressivement dans le groupe mafa et à se considérer comme tels (voir aussi Vincent,
1991: 273; David, Sterner et Gavua, 1988: 366-367). On pourrait aussi citer le cas des Plata
qui se prennent pour des Uldeme et réagissent comme tels surtout lorsqu’ils font face à des
agressions extérieures (voir aussi MacEachern, 1990: 265-267). Malgré la pertinence de ces
exemples, la création des cantons n’a pas partout produit les mêmes résultats, d’où le risque
de généraliser les résultats des enquêtes menées au sein d’un groupe à l’échelle régionale.
Chez les Podokwo, l’administration coloniale a imposé la création de trois cantons à
savoir les cantons Podokwo-sud, Podokwo-nord et Podokwo-centre. Elle a, soit regroupé
au sein d’un même canton deux clans rivaux (slalawa et udjila dans le canton Podokwo-
Sud; makulahe et kassa dans le canton Podokwo-Nord), soit divisé un clan en deux cantons
différents (le clan namba partagé entre les cantons Podokwo-Centre et Podokwo-Nord)
(Chétima, 2006). La création des cantons podokwo n’a donc pas respecté les unités
claniques existantes. Pourtant, il est remarquable de voir que les populations peinent encore
155Parfois, les pouvoirs coloniaux ont regroupé deux groupes ethniques au sein d’un même canton (Mura et Vame-Breme, Mafa et Bulahay; Uldeme et Plata par exemple). Dans d’autres cas, ils ont fractionné une ethnie en plusieurs cantons indépendants (les Podokwo divisés en trois cantons, les Muktele et les Mura en deux).
234
à s’identifier aux cantons qu’ils considèrent comme d’origine coloniale156. En fait, les
cantons sont tout simplement ignorés et ne sont évoqués que dans le cadre des
recensements administratifs. Les trois strates d’identification en vigueur restent le clan (par
l’évocation de l’origine et de l’ancêtre communs), l’ethnie (par l’évocation d’une langue et
d'une architecture communes), et l’attachement à la montagne (en situation de contacts avec
les Wandala) (voir aussi Vincent, 1991: 273).
Par ailleurs, le groupement de deux clans rivaux au sein d’un même canton n'a pas
produit les mêmes effets que ceux observés dans les exemples Mafa/Bulahay et
Uldémé/Plata suscités (MacEachern, 1990: 265-267; David, Sterner et Gavua, 1988: 366-
367). De ce fait, les mêmes sentiments d’animosité qui ont caractérisé les relations entre les
clans podokwo de Tala-Dabara et d’Udjila avant la colonisation existent encore
aujourd’hui, et les individus recourent au même mécanisme pour les atténuer, à savoir la
promotion des mariages inter-claniques (Diyé, 2007; Chétima, 2006). Au-delà de leurs
différends, les deux clans se considèrent comme des Podokwo et considèrent les Podokwo
se retrouvant dans d’autres cantons comme des Podokwo, avec qui ils partagent une même
langue et des pratiques architecturales communes (Diyé, 2007)157.
La situation semble suivre le même schéma chez les Muktele. En considérant les
récits de migration collectés par Bernard Juillerat (1971; 1968), on constate, comme chez
les Podokwo, une absence d’homogénéité généalogique, territoriale et d’organisation
politique. Avant 1949, chaque clan composant le groupe occupait un massif distinct et avait
sa propre organisation politique. Lorsqu’au début de la décennie 1940, l’administration
coloniale tente de regrouper les cinq massifs en un seul canton, elle se heurta au refus
catégorique des chefs traditionnels (Juillerat, 1971 :21)158. Les répondants muktele
156 Malheureusement il n'y a aucune source disponible susceptible d’appuyer cette information, à part mon mémoire de maitrise (2006). Comme déjà mentionné à l’introduction de cette thèse, les Podokwo n’ont fait l’objet d’aucune monographie, et les archives sont également difficiles à localiser. 157 Christian Seignobos (1982) note aussi que d’une manière générale, la langue et l’architecture sont les deux éléments d’identification ethnique dans les monts Mandara.
158 Il m’a malheureusement été impossible de vérifier cette information faute d’avoir trouvé des documents d’archives relatifs à la création des cantons en territoire muktele, et Bernard Juillerat (1971) ne mentionne pas non plus ses sources. Cependant, plusieurs informateurs relatent oralement quelques incidents ayant opposés les chefs des lignages entre eux suite à la tentative coloniale de regrouper les différents massifs sous l’autorité d’un seul chef. Ce serait à la suite de ces incidents que le chef Kwala de Baldama aurait décliné la proposition coloniale d’être le tout premier chef de canton.
235
précisent d’ailleurs qu’il aurait été proposé à Kola Machia, chef du massif de Baldama à
l’époque, d’être à la tête du canton muktele une fois celui-ci créé; une proposition coloniale
qu’il déclina naturellement au nom de l’indépendance politique de chaque massif (voir
Juillerat, 1971: 21). C’est seulement en 1949 que l’administration coloniale parvint
finalement à créer deux cantons distincts soient, le canton Muktele-Baldama pour le massif
de Baldama avec à sa tête kola Machya, et le canton Muktele-Zuelva regroupant les quatre
autres clans (Zuelva, Mokoual, Guazla, Malika et Gamnaga) avec à sa tête Menegue,
jusque-là chef du seul massif de Zuelva (Juillerat, 1971). Cependant et contrairement à ce
que suggère Juillerat (1971), les populations ignorent complètement l’autorité des chefs de
canton, et ces derniers ne se font respecter que par les gens de leurs massifs. Par exemple,
les informateurs de Baldama (entretiens avec Tekuslem, homme de 75 ans, le 11 décembre
2011, à Baldama; avec Madjagola, homme de 60 ans, le 17 décembre 2011, à Baldama;
avec Kourbe, femme de 57 ans, le 19 décembre 2011, à Baldama) citent le cas des gens de
Gamnaga, pourtant incorporés dans le canton muktele de Zuelva, refusent de reconnaitre
l’autorité du chef de canton et font pourtant toujours recours à leur chef de clan pour régler
les différends. En revanche, malgré l’individualisme clanique apparent et les rivalités inter-
claniques encore existantes, les informateurs soulignent leur sentiment d’appartenir à
l’ensemble muktele, matérialisé selon eux par la langue, l’architecture (en particulier le
mawnik), les rites matrimoniaux et la fête du madvedev.
Ces observations autorisent à postuler que l’intervention coloniale n’est pas à
l’origine de la création des ethnies muktele, podokwo et mura, même si cette proposition
peut s’appliquer à d’autres groupes dans cette région ou ailleurs en Afrique. En revanche,
en créant des cantons qui ne correspondaient pas aux aires culturelles et linguistiques
locales, les pouvoirs coloniaux ont bricolé les cartes ethniques, mais ils ne les ont pas
inventées pour autant. Le rôle de la colonisation n'a pas été de créer les ethnies podokwo,
muktele et mura, mais de sédimenter la conscience ethnique déjà embryonnaire en lui
donnant un rôle certainement nouveau. En cela, les thèses émises par Jean-Loup Amselle
(1999, 1990) sur la création coloniale des ethnies et leur réappropriation par les populations
locales sont certainement valables pour certaines ethnies (Mafa, Mofu et Kapsiki en
particulier), mais elles ne peuvent pas être appliquées à des groupes tels que les Podokwo,
les Muktele et les Mura. La diversité des témoignages et des données matérielles recueillies
236
au sein de ces trois groupes montrent la nécessité de relativiser cette thèse. Ces suppositions
sur l’origine coloniale des ethnies a d’ailleurs été revues à la baisse par des auteurs comme
Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier (2003) qui, tout en participant à la ré-historisation
du fait ethnique, estiment que les références ethniques ne peuvent être réduites à des cartes
d’identité d’origine coloniale.
Au demeurant, si on admet sur la base des faits exposés ci-dessus l’antériorité de la
conscience ethnique, il est néanmoins indéniable que les pouvoirs coloniaux, en créant des
cantons, ont contribué à l’apparition de nouvelles formes d’identification au sein des
populations montagnardes. Ces nouvelles dynamiques identitaires sont davantage mises à
l’œuvre à partir des années 1963, lorsque les pouvoirs locaux entérinent le projet colonial
de faire descendre les Montagnards en plaine (Boutrais, 1973). Ces derniers s’identifient
non seulement en faisant référence à leur origine ethnique, mais davantage à l’opposition
montagne/plaine (Hallaire, 1991). Autrement dit, l’imaginaire de la montagne et de la
plaine qui était convoqué pour expliquer la différence entre un Montagnard et un Wandala,
devient dans le contexte de la descente en plaine, un facteur-clé dans le discours identitaire
des populations restées dans les massifs d’une part, et de celles descendues pour construire
leurs maisons en plaine d’autre part.
III. « Nos maisons sont descendues en plaine, nous ne vivons plus comme avant159 » : descente en plaine et dynamiques architecturale et identitaire
Dès les années 1920, la descente en plaine est apparue pour les pouvoirs coloniaux
comme une nécessité pour faciliter le contrôle des Montagnards. Ce thème devient surtout
une réelle préoccupation à partir des années 1940 au cours desquelles les chefs des cantons,
qui venaient d’être nouvellement promus, reçoivent l’ordre de descendre vivre sur les
piémonts (Boutrais, 1973: 70). Si les Montagnards de la partie méridionale acceptent de
descendre en plaine dès les années 1920, ceux de la partie septentrionale (Podokwo, Mura,
Uldeme, Muktele, etc.) en revanche refusent de quitter « les rochers de leurs ancêtres »
(Hallaire, 1991: 50-54; Boutrais, 1973: 76). Tous les rapports des administrateurs coloniaux
(voir Kerbellec, 1943, Maronneau, 1934 ; Nicloux, 1932 ; Chabral, 1931 ; Vallin, 1929,
159 Entretien avec Sevəda Chikoua, homme de 44 ans, le 13 janvier, à Godigong.
237
Remiré, 1929 ; Coste, 1923 ; Petit, 1920 ; Audoin, 1919 ; Panon, 1917) sont unanimes pour
constater l’échec des mesures incitatives de descente mises en place par l’administration
coloniale française (Seignobos, 1982: 79; Boutrais, 1973: 61). Il faut attendre les pratiques
coercitives de l’administration locale en 1962-63 pour que le mouvement se déclenche
véritablement. La descente des Montagnards s’effectue selon deux modalités différentes. La
première est l’installation des populations sur les piémonts respectifs de leurs massifs et sur
la portion de la plaine située en contrebas. Il s’agit, dans ce cas, d’un simple glissement de
l’ethnie dans la mesure où les Montagnards continuent de vivre en fonction de leur
appartenance ethnique (Boutrais, 1973: 53; Hallaire, 1991: 52). La seconde modalité est le
déplacement dans les villes et villages wandala, laquelle provoque un peuplement plus
hétéroclite.
Par ailleurs, la descente en plaine coïncide avec l’implantation des missions
chrétiennes, notamment la Mission-Unie du Soudan (MUS) et la Mission Catholique déjà
présente dans la région dès 1946. Les deux églises multiplient peu à peu leurs postes dans
les villages montagnards en construisant entre autres des églises, des hôpitaux, des
dispensaires et des écoles (Hallaire, 1991: 55-56). Les actions des missions chrétiennes
provoquent une vague de conversion chez les ex-Montagnards vivant désormais en plaine
(Hallaire, 1991). En revanche, les Montagnards à proximité des villes musulmanes étaient
plus ouverts à l’influence de l’islam. L’une et l’autre de ces deux religions ont donné lieu à
des changements qui débordent le simple plan religieux. Les changements consécutifs à la
descente en plaine, à la christianisation et à l’islamisation ont, dans tous les cas, entrainé de
nouvelles configurations identitaires, qui elles-mêmes, ont donné lieu à de nouvelles
pratiques architecturales et inversement. Au sein des trois groupes étudiés s’observent les
trois schémas suivants : l’attachement plus marqué à la montagne chez ceux qui continuent
de vivre en montagne et sur les piémonts, l’hybridation architecturale et identitaire chez
ceux vivant dans les villages de la plaine, l’assimilation quasi-complète aux Wandala et
l’adoption des symboles culturels islamiques chez ceux vivant dans les bourgs musulmans.
238
1. De la permanence des maisons « ethniques » en montagne
Dans les montagnes, le comportement architectural reste en général le même, que
l’on appartienne à la religion traditionnelle ou au christianisme. Les maisons sont
construites suivant le même plan que par le passé, même si elles tendent à délaisser
progressivement les crêtes montagneuses au profit des replats situés en contrebas. Il existe
néanmoins de légères disparités entre les maisons des personnes âgées et celles des jeunes
chefs de ménage. Les premières constituent les survivances de ce qu’était une maison
traditionnelle; les secondent obéissent certes au plan ethnique, mais tendent de plus en plus
à se désagréger du fait de la faible tendance à la polygamie observée chez les jeunes chefs
de famille. D’une manière générale, et mises à part les variances ethniques étudiées plus
haut, les maisons en montagne ont le même plan: Par une porte, toujours située en haut de
la maison, on pénètre dans une entrée autour de laquelle sont disposées la chambre du chef
de famille, les chèvreries et le vestibule. Le vestibule s’ouvre sur un couloir plus ou moins
long qu’il faut traverser avant d’accéder dans l’enceinte de la maison, constituée des
greniers, des cuisines et des chambres des femmes, disposées selon le même principe que
par le passé: domaine de la première femme au centre en face de l’axe du vestibule,
domaines d’autres femmes de part et d’autre de celui de la première. Elles sont encerclées
par un haut mur monté en pierres sèches (Podokwo), ou par de petits murets reliant les
différentes cases entre elles (Mura et Muktele). Les toits des cases, toujours coniques, sont
faits de longues perches recouvertes par les tresses de tiges de mil (ou par les pailles chez
les Mura). Comme par le passé, chaque femme possède dans la maison son propre domaine
composé d’une cuisine, d’une case à coucher et d’un grenier (deux par épouse chez les
Podokwo). La maison forme ainsi un ensemble totalement clos, à part l’unique ouverture
cachée du côté de la montagne.
Il y a cependant un élément qui semble de plus en plus modernisé à savoir la case du
père. Autrefois essentiellement construite en pierres avec un toit conique effilé en tiges de
mil, cette structure tend désormais à épouser une forme quadrangulaire avec un toit
entièrement fait en tôles. Sa construction est à situer dans le contexte de la descente en
plaine (Seignobos, 1982) et de l’exode rural (Hallaire, 1991). Cependant, la tôle n’est pas
vue comme un élément en disharmonie avec l’ancien modèle, dans la mesure où son
239
introduction dans la construction de la case du père est expliquée par l’idée de la distinguer
des structures occupées par les épouses: « toutes les structures contenues dans la partie
haute (c’est-à-dire la partie masculine de la maison) peuvent être en tôles. Mais le ventre de
la maison, doit rester en tiges de mil » (entretien avec Mahama, homme de 47 ans, le 21
mai 2012, à Mora-Massif). L’introduction de la tôle n’induit donc pas de rupture dans les
pratiques architecturales anciennes. Elle est simplement domestiquée et incorporée à
l’intérieur des structures symboliques existantes. Cette incorporation n’est certes pas
passive, car d’une année à l’autre, la dynamique de la construction des maisons en tôles est
si forte qu’elle touche pratiquement toutes les grandes maisons de montagnes.
Figure 29 : Maison podokwo donnant une idée sur la domestication des maisons en tôles à
l’intérieur du modèle ethnique
240
Figure 30 : Maison muktele donnant une idée sur la domestication de la maison en tôle à l’intérieur du modèle ethnique
Par ailleurs, la maison de montagne reste encore le lieu où sont accomplis les
nombreux sacrifices qui incombent au chef de famille. Des objets sacrés (débris de poteries,
pierres rituelles, piquets en bois) sont placés à des endroits précis (dans la cuisine de la
première femme, au pied du grenier de mil, à l’entrée principale) où sont célébrés les rites
familiaux, ceci en dépit de la conversion de certains chefs de famille au christianisme.
Rites, symboles et croyances ancestraux, transmis de génération en génération, y sont
toujours conservés et pratiqués. Les tombeaux des ancêtres situés à l’entrée des maisons
rappellent sans cesse que ces dernières n’appartiennent pas seulement aux vivants, mais
qu'elles marquent un trait d’union entre les ancêtres, les vivants et ceux à venir. La case à
pots continue de faire l’objet des interdits, montrant à quel point les ancêtres décédés sont
respectés et vénérés. Les Montagnards, même christianisés croient que les ancêtres
participent à leur vie et à leurs activités quotidiennes.
L’attachement à la maison de montagne et le refus de descendre en plaine sont
expliqués par la symbolique de l’espace toujours prégnante, qui comme on l'a vu, oppose la
montagne à la plaine. La plaine inhabitée, c’est d’abord la brousse, une « terre étrangère »
241
d’où il ne faut s’aventurer que pour la coupe du bois ou pour le ramassage de l’herbe pour
le bétail et de l’eau pour le breuvage (Hallaire 1991: 46; Seignobos 1982; Boutrais, 1973:
33-34). À l’opposé, la montagne représente l’espace habité de façon permanente, le « chez-
nous », pour utiliser le langage des Montagnards (MacEachern, 2002: 201; David, Sterner
et Gavua, 1988: 367; De Colombel, 1986: 16-22; Richard, 1977: 78; Juillerat, 1971: 75-78).
Les termes locaux désignant la montagne et la plaine véhiculent d’ailleurs d’autres notions.
Ainsi, le mot désignant la montagne véhicule l’idée d’un espace vivant, humanisé, socialisé
et habité (Vincent, 1997: 337-349; 1991: 615-667).
Inversement, le mot correspondant à la plaine est employé pour désigner la brousse,
le lieu vide d’hommes, ce milieu étranger et dangereux (Hallaire, 1991: 46; Boutrais, 1973:
34). En tant que lieu autre, les Montagnards manifestent un certain mépris, non seulement
pour les Wandala, mais aussi pour ceux des leurs qui se sont installés en plaine et sur les
piémonts160. D’après Bassaka Kuma, un aîné de soixante-dix ans, des chants étaient
exécutés pour dédaigner ceux qui étaient descendus de la montagne, et qui n’ont pas voulu
défier la contrainte administrative (entretien, le 09 avril 2007, à Udjila). La dichotomie gens
de la montagne versus Montagnards en plaine est si forte qu’un informateur Muktele vivant
en montagne, en occurrence Menague, s’est vu culturellement plus proche d’un Podokwo
de la montagne que d’un Muktele de la plaine (entretien avec Menague, homme de 86 ans,
le 26 avril 2012, à Baldama). En plus des clivages entre les ethnies se superposent donc le
clivage opposant les Montagnards vivant dans les massifs et les Montagnards habitant les
villages de la plaine. Ce clivage est entretenu même chez les plus jeunes. Un garçon de 15
ans délégué par le chef mura pour m’accompagner dans nos déplacements exprime en des
termes tendancieux cette opposition:
Les gens de la plaine croient qu’ils sont civiliser parce qu’ils ont l’argent. Ils ne respectent ni les coutumes ni les paroles des vieillards. Même mon neveu joue au vantard depuis que son papa a décidé de s’installer en plaine. Il a de habits, mais à quoi bon alors que leur maison de montagne s’est écroulée l’année dernière. Je me dis qu’il a perdu la tête. Les ancêtres se sont fâchés contre son papa et il en a payé de sa vie il y a de cela 6 mois seulement. Quant à moi, même si je n’ai rien, je préfère boire
160Les Montagnards islamisés sont quant à eux simplement oubliés et considérés, non pas comme des Montagnards autres, mais comme des Wandala.
242
ma bière de mil et oublier la galère que de corrompre avec l’argent de la plaine (entretien avec Tacha Dia, garçon de 15 ans, le 19 novembre 2011, à Dume).
Même lorsque les habitants de la plaine clament toujours leur rapport à la montagne,
le statut de vrais Montagnards leur est souvent méconnu par ceux qui vivent encore dans
leurs maisons de montagne. Au cours de mes enquêtes dans les massifs muktele de
Baldama, Menague me mettait en garde d’aller vers ceux qui vivent en plaine si je voulais
avoir de la « bonne information » sur l’architecture car, me disait-il: « les gens de la plaine
ont perdu un peu de leur culture muktele […]. Si tu as bien regardé leurs maisons, tu verras
qu’elles ont beaucoup changé par rapport à nos maisons en montagne» (homme de 86 ans,
entretien avec Menague, homme de 86 ans, le 26 avril 2012, à Baldama). Je me suis
également rendu à plusieurs reprises dans le massif makerna, une sorte de no man's land,
où les jeunes de divers horizons ethniques (Podokwo, Muktele, Uldeme et Urza) viennent
paître leurs troupeaux de bœufs. Ces jeunes organisent régulièrement une série d’activités
récréatives, allant du simple football au simulacre de combats traditionnels. Il est à
remarquer que les jeux ne s’organisent pas en fonction des ethnies, ni même en fonction
des villages pourtant fortement représentés. Ils mettent plutôt en scène deux camps
antagonistes, à savoir le groupe des Montagnards d'une part, et le groupe des habitants de la
plaine d’autre part. À travers ces jeux récréatifs, les jeunes de la montagne incorporent et
entérinent le clivage désormais établi entre eux et ceux vivant en plaine, fussent-ils leurs
cousins.
En outre, la conception de l’espace opposant montagne et plaine explique la
résistance manifeste à l’injonction administrative de descendre en plaine. Rappelons qu’en
1963, le sous-préfet de l’arrondissement de Mora, duquel dépendent les trois ethnies
étudiées, avait rendu obligatoire la descente de tous les Montagnards de sa circonscription
administrative (Boutrais, 1973: 60)161. Ce sont d’abord les chefs de canton qui reçurent
l’ordre de construire leurs maisons sur les piémonts, et de faire descendre chacun les
161Le seul chef de canton non concerné par cet ordre fut Mozogo Daouka, chef de canton Podokwo-sud. Il fut d’ailleurs encouragé par les autorités locales à rester en montagne du fait de la pratique de l’activité touristique dans son village qui profitait plus à l’administration qu’à la population (Boutrais, 1973: 70).
243
populations de son groupe (Hallaire, 1991; Seignobos, 1982; Boutrais, 1973). Ceux qui
refusèrent furent considérés comme des rebelles et remplacés par des personnes plus ou
moins malléables (Bah et Taguem, 1993: 140). Cependant, comme le note si bien
Seignobos (1982: 81), seuls ceux qui étaient moins accrochés à la montagne sont
descendus, en particulier les cadets qui avaient moins d’importance dans le déroulement
des rites et cérémonies religieuses au sein de la maison. La plupart des ainés sont restés en
montagne pour remplacer, le moment venu, leurs pères et assurer la continuité de la maison
et du culte ancestral qui s’y déroule162. En raison du lien étroit entre la maison et le culte
des ancêtres, son abandon total signifiait la rupture généalogique et la perte des repères
culturels et religieux. Il y a eu certes des ainés qui, du fait de leur conversion au
christianisme, ont préféré s’établir en plaine plutôt que de vivre dans la maison de
montagne. Ceux-ci sont simplement considérés comme des individus socialement morts, et
ont été remplacés par leurs cadets en tant qu’héritiers du patrimoine familial. Dans cette
veine, des prières étaient adressées aux ancêtres pour consacrer leur bannissement social,
comme l’illustre celle-ci prononcée par Tekuslem, lors d’un sacrifice à son père défunt en
date du 03 décembre 2011 :
Je ne sais pas si tu m’écoutes. C’est ton fils Tekuslem, qui te parle. Le devin m’a dit que tu aimerais que ton petit-fils Massabak t’offre un coq. Tiens, mais c’est plutôt ton petit-fils, Tsetsefa, qui te l’offre. Massabak n’est plus des nôtres, il a perdu la tête et s'en est allé en plaine. Les autres fils sont aussi mécontents et ils veulent tous m’abandonner pour aller chercher de l’argent en ville. Moi, je suis déjà vieux! Bientôt j’irai vous rejoindre là-bas, mais je ne sais pas si mes fils s’occuperont de moi comme je m’occupe de toi.
Cette prière exprime non seulement le bannissement de l’ainé de la maison
paternelle et du groupe lignager, mais aussi la crainte qu’ont les Montagnards de la menace
qui pèse actuellement sur leur monde. La pénétration de l’argent, la multiplication des
rapports économiques entre Montagnards et ceux établis en plaine, la scolarisation qui
commence à se développer, la descente continue en plaine des fils pubères, l’exode rural en
162Tout chef de maison, indépendamment de l’ethnie, entretient un culte à cinq ancêtres distincts ayant avec lui une relation généalogique directe : son père défunt, son grand-père et son arrière-grand-père. Tous les trois ont leurs pots conservés soit dans la case à pots, soit sous le grenier du père selon l’ethnie (voir aussi Vincent, 1976:180). Le père de l’arrière-grand-père possède quant à lui un autel placé près du seuil de l’habitation.
244
direction des grandes villes sont autant de facteurs qui obligent désormais le Montagnard à
s’ouvrir aux influences extérieures quoique vivant dans ses massifs. Cette situation donnera
certainement lieu à de nouvelles configurations identitaires dont il est encore difficile d’en
dessiner les contours.
2. Les villages de la plaine: entre permanences et mutations du stéréotype ethnique
Contrairement aux massifs qui semblent plus ou moins uniformes du point de vue
architectural, et cela en dépit de l’introduction des formes et matériaux nouveaux, les
villages de la plaine donnent lieu à une diversité des cas, oscillant entre permanences et
transformations, continuités et ruptures dans le plan architectural ethnique. Globalement,
les attitudes envers la maison varient selon les classes d’âges. Les survivances du plan
ethnique s’observent généralement chez les vieillards descendus au cours des premières
vagues migratoires (entre 1962 et 1980). Par contre, les transformations s’observent chez
les jeunes chefs de famille établis ou nés en plaine au cours des deux voire des trois
dernières décennies. Sur le plan topographique, les maisons des plus vieux occupent les
piémonts tandis que celles des jeunes chefs de famille s’éloignent progressivement de la
montagne, à mesure que les descentes en plaine s’effectuent.
Les personnes du troisième âge - qui sont aussi ceux descendus en plaine dans les
années 1960-1980 - essayent tant bien que mal de reproduire le modèle ethnique Jean
Boutrais (1973). Malgré leur présence en plaine pendant plus de quatre décennies, ils se
désignent toujours comme les gens du rocher. Quelques changements, plus ou moins
importants, peuvent néanmoins être relevés au niveau de leurs maisons. Dans les trois
groupes, l’habitation s’est décomposée, et les unités architecturales tendent à s’ouvrir sur
une cour centrale. La facture est plus sommaire qu’en montagne, car le segment des cases
communicantes et la série des vestibules en enfilade sont abandonnés, sinon simplifiées.
Cette transformation majeure est expliquée par l’absence de la pente et des dénivellations
en plaine: « c’est difficile de reproduire le plan de la maison de montagne ici car il n’y a
pas de pente » s’indigne Ngalewa, un des premiers Montagnards à s’installer dans le village
d’Uvada vers la fin des années 1969 (entretien avec Ngalewa, homme de 69 ans, le 22 avril
2009, à Uvada).
245
Du coût, l’organisation de l’habitat entre le haut et le bas est abandonnée au profit
d’un plan organisé autour des notions de l’avant et de l’arrière. Comme en montagne, la
case de l’homme reste la première structure lorsqu’on pénètre dans la maison, et la cuisine
de la première femme la structure la plus au fond. Chez les Podokwo, le mur de pierres
sèches qui ceinture l’habitation disparait. Les Muktele et les Mura quant à eux, reproduisent
avec facilité leurs petits murets, mais en les construisant en argile. Certaines unités
architecturales sont supprimées (cases à pots par exemple), pendant que d’autres font leur
apparition (magasin). Le petit bétail n'a plus la même importance du fait de l’absence des
sacrifices et des rites religieux au sein de la maison de la plaine. Par conséquent, le nombre
de chèvreries et d’étables se trouve réduit. L’entrée dans les différentes structures - cases et
cuisines - s’agrandit même si les individus essayent de la reproduire suivant le même
modèle que celui observé en montagne.
Dans ce même mouvement d’ensemble, la salle à greniers qui constituait le cœur de
la maison montagnarde, est certes reproduite, mais leur rôle est réduit à une fonction
purement identitaire et moins fonctionnelle. Ils contiennent rarement les récoltes; celles-ci
étant désormais entreposées dans des fûts et sacs disposés dans une structure faisant office
de magasin. Néanmoins, les greniers servent à la conservation d’objets traditionnels pris en
montagne (parures et vêtements, pots et objets sacrés). Il est remarquable de voir que les
répondants évoquent ces objets avec une certaine nostalgie, comme l’attestent les propos de
Ngalewa:
En montagne, les maisons sont différentes c’est vrai, mais on essaye toujours de faire quelque chose de semblable. Moi j’ai fait venir mes pots et mes calebasses dont je me servais pour le culte aux ancêtres. Des choses comme ça, ça ne se jette pas; elles sont très précieuses même si elles ne servent plus aujourd’hui. Quand je les regarde, je me sens comme dans ma maison de la montagne, je sens la montagne tressaillir en moi (entretien avec Ngalewa, homme de 69 ans, le 22 avril 2009, à Uvada).
La conservation d’objets sacrés s’expliquerait par le contexte de rupture vécue par
les individus. S’ils n’ont pas pu se soustraire à la migration en plaine, ils essayent en
revanche de combler cette rupture, non seulement par l’ordonnancement des unités
architecturales qui rappellent la montagne, mais aussi par la possession d’objets
246
traditionnels. S’ils n’interviennent pas dans les rites religieux, ces objets ramenés de la
montagne, leur permettent néanmoins de recomposer leur environnement montagnard en
plaine.
Malgré ces changements dans la forme, et quelques fois dans les matériaux de
construction, les ex-Montagnards essayent de maintenir le même mode d’organisation
intérieure et le même emplacement des individus au sein de la maison. Comme en
montagne, les maisons sont construites pour abriter un homme, sa ou ses femmes et ses
enfants mariés ou célibataires. Ni les hommes ni les femmes ne doivent habiter dans une
maison sans conjoint (entretien avec Mahama, homme de 47 ans, le 21 mai 2012, à Mora-
Massif). Les grands-parents sont logés individuellement dans des cases situées hors de la
maison, mais à proximité de celle-ci. Les cases, les enclos à bétails, les greniers et les
cuisines sont organisés selon les mêmes principes que dans les massifs. La cuisine et la
chambre de la première épouse sont situées au fond, en face de l’entrée principale. Les
cases et les cuisines des autres épouses sont placées de part et d’autre de celles de la
première femme. Le chef de ménage mange avec ses fils, et éventuellement avec les
visiteurs de sexe masculin, à l’entrée de la concession. Les femmes, quant à elles, prennent
leur repas en compagnie de leurs enfants en bas âge et de leurs filles dans leurs cuisines ou
dans la cour intérieure de la maison. Toutes les activités des femmes (accouchement des
enfants, préparation de la nourriture et de la bière du mil) ont lieu dans leurs domaines
respectifs situés au fond de la maison. Les greniers de forme cylindrique, éparpillés çà et là
dans la cours, rendent la vue obscure et facilitent les pratiques sociales traditionnelles telles
que la « honte du beau-père163 », et la séparation des hommes et des femmes pendant la
prise des repas. Ainsi, si la descente en plaine constitue le point de départ d’une nouvelle
histoire sur une nouvelle terre, la maison, elle, incarne paradoxalement un lieu de pérennité
identitaire de l’immigré montagnard. Elle est en quelque sorte une transposition de
l’identité montagnarde, permettant aux gens d’y prendre racine. 163 Chez les Muktele, comme chez les Mura et les Podokwo, le respect qu’une nouvelle mariée manifeste aux membres de la famille de son mari se traduit dans la honte envers ces derniers, surtout envers le beau-père. Par exemple, pendant la période de la claustration, la mlok n’est pas censée rencontrer sur son chemin le beau-père jusqu’à ce qu’elle cesse d’être une étrangère au sein de la famille. C’est la raison pour laquelle la mlok ne sort que très rarement de la maison pour éviter de rencontrer son beau-père dans l’espace public du village. C’est aussi la raison d’être du mawnik, cette brèche créée dans le mur, qui sert à la mlok de point d’entrée et de sortie de la maison. En utilisant cette brèche, celle-ci minimise le risque de rencontrer sur son chemin le beau-père, car ce dernier ne descend jamais dans la partie inférieure de la maison où vit la mlok.
247
Figure 18 : Maison podokwo illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts
Figure 19 : Maison muktele illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts
248
Figure 33 : Maison mura illustrant la reproduction du modèle ethnique chez les aînés descendus sur les piémonts
Des trois groupes, les Mura semblent être ceux qui ont le plus reproduit leur modèle
ethnique en plaine et sur les piémonts. Chez eux, la maison s’est simplement décomposée
sans être véritablement remodelée en une structure nouvelle. Les Mura essayent aussi de
conserver leurs exigences en matière d’architecture, et de s’accommoder tant bien que mal
à leur nouvel environnement sans déstructurer leur habitat. Les seuls changements
récurrents sont la rareté de la pierre dans la construction des cases et cuisines qui sont de
plus en plus montées en briques de terre. En revanche, la plupart des concessions
conservent leurs murets en pierres. Au niveau de l’organisation intérieure, les maisons
mura sont presque toujours construites sur un axe est-ouest, avec la case de l’homme à
l’avant tournée vers l’est et la cuisine de la première femme à l’arrière regardant à l’ouest.
De chaque côté de l’entrée principale se trouvent les enclos à bétails et les cases des
garçons pubères ou mariés. Dans l’enceinte de la maison, les greniers de l’homme (deux)
sont excentrés sur la droite, avec le gabaka faisant face à la cuisine de la première femme.
En revanche, malgré la présence du gerda lay sous le gabaka et des objets magiques
enterrés à l’entrée de la maison et dans l’espace intime des femmes, leur efficacité est
249
entamée du fait du déplacement de la maison en plaine, un endroit non apprécié par les
ancêtres (Hallaire, 1991: 46; Boutrais, 1973: 60).
Un paradoxe vient néanmoins prolonger la réflexion. L’inefficacité constatée des
rites religieux locaux dans la lutte contre les sorciers et les forces invisibles en plaine n’a
pas entrainé leur abandon. Elles continuent d’évoluer en tandem et en complémentarité
avec les croyances chrétiennes. Autrement dit, si la place faite à l’Église est faible, elle
n’est pas pour autant rejetée. Elle est tout simplement intégrée dans le dispositif religieux
local, pour « compenser l’inefficacité des ancêtres dans la maison de la plaine » (entretien
avec Dawcha, homme de 58 ans, le 03 mai 2012, à Mora-Massif). Deux croyances
chrétiennes - le baptême et le purgatoire - sont particulièrement domestiquées et lues à
travers les schèmes religieux locaux.
Chez les Mura, la fonction traditionnelle du baptême de l’enfant est de lui donner un
nom et de le rendre invulnérable à la puissance malveillante des sorciers. Du fait de la
descente en plaine, les forces protectrices de l’enfant ont perdu de leur efficacité, ce qui
rend sa défense moins efficace qu’en montagne164 (entretien avec Ambaya, femme de 35
ans, le 17 mai 2012, à Mora-Massif). En mixant le baptême traditionnel avec le baptême
chrétien, les Mura estiment que les deux se trouvent en complémentarité pour apporter à
l’enfant la protection dont il a besoin tout au long de sa croissance vers la maturité sociale
et physique. Quant aux rituels funéraires, j’ai souligné que leur fonction traditionnelle était
de faire accéder le défunt à la condition d’ancêtre (voir aussi Lyons, 1992), ce qui semble
aller de pair avec la doctrine chrétienne du purgatoire, particulièrement pratiquée au sein de
l’Église catholique. Sans avoir été à l’église, il n’est pas rare de voir les amis et parents du
défunt solliciter les prières du prêtre pour que celles-ci assurent au défunt un voyage
paisible vers le monde des ancêtres. Ici encore, les prières funèbres du prêtre ne sont vues et
lues que d’un point de vue local à savoir qu’elles offrent au défunt un moyen
supplémentaire lui permettant de rejoindre le monde des ancêtres. Elles ne remplacent
cependant pas les rites funéraires locaux, mais se trouvent en complémentarité avec eux. La
christianisation ne représente donc pas pour les ex-Montagnards mura une rupture dans leur 164Dans la tradition mura, le baptême ne se limite pas seulement à donner un nom à l’enfant, mais aussi à le confier à un ange-gardien chargé de le protéger contre la sorcellerie, mais aussi contre les maladies et les accidents.
250
histoire religieuse, dans la mesure où elle se trouve insérée dans le schéma structurel des
traditions religieuses locales165.
D’un autre côté, malgré la coexistence avec les Wandala musulmans, les Mura
maintiennent leurs différences culturelles et continuent d’utiliser leurs maisons pour
traduire ces différences. Cela requiert sans doute une inversion de l’hypothèse émise par
Diane Lyons (1996: 358-67) qui suggère que dans les relations de pouvoir entre deux
groupes où l’un possède une supériorité économique et sociale sur l’autre, il n’y a aucun
avantage pour le groupe économiquement faible de se différencier stylistiquement du
groupe économiquement fort. L’établissement de la frontière, explique cette auteure, ne
peut aller qu’à l’encontre de l’intérêt du plus faible. Ce dernier cherche à imiter et à
reproduire la culture matérielle du groupe économiquement supérieur, pour brouiller en
quelque sorte la frontière sociale qui les sépare (Lyons, 1996: 367). Le rapprochement
géographique entre les Mura et les Wandala n’ont pourtant pas réussi à « brouiller la
frontière existante », comme le pense Diane Lyons. Il a au contraire accentué les clivages
existants. On remarque un refus d’assimilation presque catégorique et un attachement aux
valeurs culturelles traditionnelles malgré les changements consécutifs à la descente en
plaine. Pourtant, il est certain que les Wandala possèdent un avantage économique et social
sur les Montagnards mura (Van Santen, 1998: 325-342; Bah, 1989: 61-62).
Par ailleurs, il n’est pas non plus possible d’expliquer le marquage symbolique de la
frontière entre Mura de la plaine et Wandala par des arguments économiques comme cela
est suggéré par Scott MacEachern (1990: 316-317). À mon avis et suivant Jenkins (1982:
204), l’explication la plus plausible trouve sa raison d’être dans la socialisation primaire
des vieillards, qui depuis leur enfance, ont intériorisé les différences culturelles entre eux et
les Wandala; différences matérialisées à travers l’interprétation de la symbolique du haut et
du bas, et à travers l’utilisation d’éléments architecturaux. Les racines de leur attachement à
la montagne remontent ainsi à leur enfance, d’où la charge émotionnelle (Epstein, 1994:
271-278) encore forte qui les lie à leur terroir d’origine. Cette charge émotionnelle est
parfaitement illustrée par les propos d’Amagouwe :
165 Se référer à cet effet à Antoinette Hallaire (1991) pour des observations similaires effectuées chez les Uldeme des monts Mandara.
251
Je suis ici (en plaine) dans mon corps, mais je suis en montagne dans mon esprit. La nuit, je rêve toujours de la montagne, je suis né dans la montagne, j’ai grandi dans la montagne et maintenant on me dit que la montagne n’est pas bien. Ils m'ont forcé à sortir de la montagne, mais la montagne ne pourra jamais sortir de moi. Le langage de la montagne me manque tellement, le langage de la montagne me manque (entretien avec Amagouwe, homme de 55 ans, le 16 mai 2012, à Mora-Massif).
Comme la plupart des personnes de son âge vivant aujourd’hui en plaine, cet
informateur a vécu en montagne jusqu’à sa descente opérée sous la pression des
administrateurs locaux au cours de la décennie 1960-1970. Il n’est donc pas descendu de
son propre gré, contrairement aux jeunes chefs de ménages descendus au cours des deux
dernières décennies, et chez qui la conscience d’appartenance ethnique est moins forte que
chez les migrants de la première génération (Boutrais, 1973).
L’attachement des vieillards à l’identité montagnarde contraste avec le regard des
jeunes vers la modernité et vers un style de construction proche de celui des Wandala.
D’une année à l’autre, ils construisent des maisons qu’ils appellent affectueusement
« nouvelle maison » ou encore « maison en tôles » par opposition à l’ancienne maison et à
celle en tiges de mil. Les informateurs situent l’apparition de ces nouvelles maisons vers le
début de la décennie 1980.
Sur le plan de la forme, la nouvelle maison est un mélange de cases rondes et
rectangulaires disposées autour d’une cour centrale, et reliées entre elles par un mur en
briques de terre ou en parpaings. On note l’existence quasi-permanente du vestibule, mais
celui-ci est construit sur le modèle wandala, et épouse une forme rectangulaire. Les toits en
tiges de mil sont encore présents, mais perdent de plus en plus de l’espace au profit des
toits en tôles. Les greniers à mil ont complètement disparu et sont remplacés par un
magasin dans lequel le chef de ménage dispose les vivres de la famille. L’entrée principale
dans la maison et les entrées dans les différentes structures sont fermées au moyen des
portes métalliques achetées sur le marché de Mora ou de Banki au Nigéria. D’atone en
montagne et sur les piémonts, la case de l’homme devient l’élément primordial et le seul
pour lequel on investit véritablement (Seignobos, 1982). Elle épouse elle aussi une forme
252
quadrangulaire avec un toit en tôles. L’intérieur comporte plusieurs pièces dont le nombre
varie de deux à cinq en fonction de l’opulence du propriétaire.
Figure 34 : Village de Godigong (Podokwo) illustrant l’ouverture des jeunes montagnards aux maisons en tôles et rectangulaires
L’apparition des nouvelles maisons est à mettre en rapport avec la mobilité des
Montagnards vers les centres urbains, notamment Yaoundé (Boutinot, 1994; Iyébi-
Mandjeck, 1993). La modique somme d’argent engrangée était accumulée sur plusieurs
années dans l’objectif de se construire une belle maison, c’est-à-dire, une maison en tôles et
de forme rectangulaire, comme celles qu’ils observent chez leurs voisins Wandala166. Il faut
néanmoins remonter à la période coloniale et locale pour comprendre l’importance que les
jeunes ex-montagnards accordent à la forme rectangulaire en tant que reflet de la
modernité. L’administration coloniale française a de tout de temps opposé les structures
sociales des Wandala qu’ils ont considérées comme socialement et politiquement
organisées par rapport à celles des Montagnards vues comme un symbole de l’anarchie
(Boutrais, 1973 : 69). Dans les archives coloniales, les Français utilisent le terme kirdi pour
les non-islamiques, mais aussi en tant que synonyme d’une personne non civilisée, non
instruite et n’ayant aucune habitude sanitaire, comme l’écrit Laroussinie en 1937:
166 Voir surtout le chapitre V pour plus de détails sur les formes rectangulaires et la tôle en tant que symboles de l’ascension sociale au sein des migrants montagnards.
253
D’ailleurs la cadence de leurs évolutions, pour un esprit observateur est très rapide en raison de leurs facilités d’imitation (sic!). Un exemple nous en est donné par l’école, ou les Kirdi tout aussi primitifs que leurs camarades de jeux de la montagne, en trois ans apprennent à comprendre et à parler le français, à lire, écrire, compter et sont capables de rédiger une petite lettre (Laroussinie, March l937).
Pris au dépourvu par l’absence d’une organisation politique chez les Montagnards,
les colonisateurs français en sont venus à inventer un « problème païen » dont les
principales composantes seraient « l’isolement sur les massifs, une conscience ethnique
forte et l’opposition à toute forme de domination » (voir Boutrais, 1973: 63). C’est sans
doute cette politique de dichotomisation Montagnards versus Wandala, associant aux
premiers l’image dégradante de « non civilisés » (Van Santen, 2002; Lyons, 1996) et aux
seconds l’image valorisante d’ « évolués » (Lyons, 1996: 359-360), qui a conduit à la
prolifération des formes quadrangulaires dans les villages de la plaine. Les maisons
rectangulaires sont d’autant valorisantes que tous les bâtiments administratifs et publics, y
compris ceux présents en territoire montagnard (dispensaires et écoles en particulier)
étaient construits suivant une forme rectangulaire. Les résidences des chefs des cantons
descendus en plaine ont aussi épousé des formes rectangulaires sous le vindicatif des sous-
préfets desquels ils dépendaient. À travers l’adoption des formes rectangulaires et des
maisons en tôles, les jeunes ex-montagnards tentent d’opérer une modification de l’image
de primitifs et de sauvages qui leur était collée à la peau, pour avoir la même estime que
celle manifestée à l’égard des Wandala par les autorités coloniales et locales167. Comme le
souligne Diane Lyons (1996: 364), ils ont pris conscience que leur accrochage à l’identité
montagnarde leur était préjudiciable, dans la mesure où l’administration a de tout temps
catalogué leur mode de vie comme l’antithèse même de la modernité. Les maisons
rectangulaires leur permettent dès lors de sortir aussi bien physiquement que
symboliquement de cette image dégradante, et de s’arborer une nouvelle identité sociale,
cette fois valorisante.
167 Dans ce contexte, on peut suivre l’hypothèse émise par Diane Lyons (1996: 341-367) qui considère la prolifération des maisons rectangulaires comme une stratégie visant à démolir les frontières sociales établies depuis de longues dates entre eux et les Wandala.
254
Par ailleurs, il est à constater que les emprunts entre ex-Montagnards sont quai-
inexistants, même dans le cas des villages géographiquement proches, comme ceux de
Biwana (Podokwo), Slala-Matala (Muktele) et de Mora-Massif (Mura) tous adossés à la
ville de Mora. L’évolution architecturale dans ces trois villages s’effectue toujours vers le
modèle des Wandala, même si des disparités énormes sont encore observées (voir Lyons,
1992; Seignobos, 1982). Les différences ethniques entretenues en montagne et chez les
vieillards de la plaine n’existent plus, et les mariages interethniques sont quasi-permanents.
Ici, le clivage n’est ni géographique ni ethnique. Il est plutôt d’ordre temporel et oppose
l’auparavant au maintenant et l’avant à l’après. L’avant se trouve associé à un style de vie
archaïque, celui vécu en montagne, caractérisé par un habitat obscur fait de pierres
(entretiens avec Duluva Mouche, homme de 27 ans, le 07 janvier 2012, à Godigong); le
maintenant est, quant à lui, associé à l’apparition de la nouvelle maison toujours valorisée.
Dans cette veine, contrairement aux vieillards qui regardent l’avant comme un âge d’or, les
jeunes expriment dans leurs discours un désir de détachement d’un passé de misère qu’ils
veulent oublier168.
Il faut néanmoins faire remarquer qu’en dépit de l’adoption des formes
rectangulaires, les pratiques liées à l’espace habité n’ont pas fondamentalement changé.
Comme par le passé, la maison continue de jouer un rôle capital dans l’articulation des
rapports homme/femme, auxquels s’ajoutent cependant les rapports jeunes/vieillards et
modernes/traditionnels. Autrement dit, les changements architecturaux ne sont pas
véritablement un moment de rupture pour les jeunes montagnards, du fait qu’ils n’induisent
pas nécessairement de rupture dans leur façon d’habiter la maison. Ils ont simplement
engendré de nouvelles configurations des relations sociales et des clivages entre les
différentes catégories d’individus au sein d’une même ethnie.
168 Dans un article consacré aux pratiques architecturales domestiques au pays d’Oas en Roumanie, Daniela Moisa s’intéresse à la dynamique identitaire des Certezeni de plus en plus ouvert à de nouveaux modes de construction des maisons importées de l’Occident. Du point de vue des discours, cette auteure observe que les Certezeni définissent toujours cette nouvelle maison qu’ils appellent « maison à l’occidental » en contraste avec la maison traditionnelle. Loin de signifier l’authentique et la spécificité d’une communauté tant valorisée par les ethnologues, cette dernière est plutôt devenu le miroir d’un passé de précarité dont tout le monde veut s’en débarrasser en se construisant une maison « à l’occidental » désormais devenu le symbole de la modernité et de l’urbanité.
255
En conclusion, la descente en plaine est, à la fois, un moment de dislocation du
modèle ethnique et d’ouverture au style wandala. Si les jeunes se considèrent encore
comme des Montagnards, ils se vantent aussi d’être des gens modernes et civilisés,
contrairement à ceux qui vivent dans la montagne et sur les piémonts. Ils ne construisent
plus des maisons en pierre comme en montagne, mais l’organisation intérieure rappelle,
tant bien que mal, les pratiques architecturales anciennes, notamment celles ayant trait aux
rapports entre hommes et femmes au sein de la maison. L’adoption des maisons
rectangulaires a certes introduit une rupture, mais la conscience ethnique reste encore
présente, et est constamment manipulée en fonction du contexte et des enjeux des acteurs
en présence (David, Gavua, MacEachern et Sterner, 1991 :174; MacEachern, 1990 : 254).
Les jeunes présentent donc une identité aux deux composantes suivantes : une liée à leur
culture ethnique d’origine et l’autre liée à la culture wandala ou moderne avec lesquelles ils
sont désormais en contact. La théorie d’une « identité duale » utilisée par Joseph Gugler169
(1991, 1971), et par Laurent et Lee (2007) peut être applicable pour expliquer cet étirement
entre regard sur le passé et regard sur le présent, le neuf étant associé à la modernité. La
preuve la plus évidente de cette dualité est le fait que ces jeunes, en cas de décès, se font
toujours inhumés en montagne à l’entrée de leurs concessions ancestrales, à l’opposé des
Montagnards islamisés, qui sont inhumés dans des cimetières réservés aux musulmans.
3. De la disparition du stéréotype ethnique dans les bourgs musulmans à la mise en parenthèse de l’identité ethnique
Parallèlement à la constitution des villages montagnards en plaine, beaucoup de
Montagnards ont préféré s’islamiser et s’installer dans les villes et villages mandara. Cette
islamisation déjà signalée dès les années 1980 par Christian Seignobos (1982), concerne
essentiellement les notables, les scolarisés et les commerçants. Comme le suggère Christian
Seignobos (1982), elle doit être située dans le contexte de la politique de l’unité nationale
prônée par le premier président du Cameroun indépendant Ahmadou Ahidjo, qui était
originaire de l’ethnie peule. Une première phase de cette politique a consisté à faire du
169Dans ses travaux sur l’urbanisation dans l’Est du Nigeria, Joseph Gugler avancent l’idée que les jeunes Igbo vivent dans un système dual, car ils continuent à entretenir des liens étroits avec leurs villages d’origine (Gugler, 1991, 1971). Leur attachement à leur village demeure crucial pour eux, en dépit du fait qu’ils vivent hors du terroir et de leur ouverture à la modernité.
256
Nord-Cameroun une société homogène et unie, sous le commandement du bloc musulman
(Mbembe, 1993), ce qui a renforcé l’image positive de l’identité musulmane qui a dès lors
copiée, adoptée et revendiquée par des personnes de groupes non-musulmans, dans le but
de promouvoir leur intérêt politique ou commercial (Schilder, 1994: 23-26). Ceci était
particulièrement nécessaire dans la mesure où Ahidjo avait mis en place une politique de
favoritisme des Islamo-Peuls dans les promotions professionnelles, les recrutements aux
concours administratifs et les activités commerciales (Mouiche, 1996; Schilder, 1994;
Mbembe, 1993). Pour bénéficier de ces avantages, de nombreux Montagnards ont non
seulement embrassé l’islam, mais aussi adopté des traits culturels islamo-peuls (Socpa,
1999 : 71; Schilder, 1994: 9). Avant de voir comment se matérialise cette islamisation au
plan architectural, il convient d'abord d'expliquer le sens que les Montagnards accordent au
terme conversion à l’islam.
Lorsque les gens évoquent le passage à l’islam, ils utilisent concomitamment trois
expressions qui, en français, sont loin de signifier la même chose. La première expression
utilisée est : « je suis descendu de la montagne et je me suis islamisé »; la deuxième
expression est « je suis descendu de la montagne et je me suis civilisé » (voir Van Santen,
2002: 82-86), et la troisième expression est: « je suis descendu de la montagne et je suis
devenu un wandala ». Autrement dit, les termes islamiser, civiliser et devenir Wandala sont
utilisés comme des synonymes et traduisent chez les Montagnards islamisés une même
réalité, à savoir une conscience active de la mort au soi ethnique. L’utilisation concomitante
de ces trois expressions amène à considérer l’islamisation comme un processus social qui
comprend, à la fois, un changement de religion, et un changement complet de style de vie
(usage d’une autre langue, adoption d’autres habitudes sanitaires, changement de quartier
résidentiel, adoption d’une nouvelle façon de s’habiller et de manger (voir aussi Van
Santen, 2002, 1998 et l993)170. Pour cette raison, la conversion à l’islam est vue, autant par
les Montagnards que par les Wandala, comme un processus dépassant largement le cadre
religieux pour englober d’autres aspects de la vie quotidienne, notamment l’adoption d’un
style architectural wandala. Toutes les maisons des islamisés, même ceux convertis
170 De ce point de vue, être un musulman ne signifie pas seulement à adopter le credo de base selon lequel «il n'y a pas d’autre Dieu qu’Allah et Muhammad est son messager », il signifie aussi s’adapter à la façon de vivre des Peuls ou des Wandala (Van Santen, 2002: 84).
257
récemment, sont de ce fait, calqués sur le modèle wandala. Les quelques variances
observées sont de même nature que celles observées entre les maisons wandala, et évoquent
non pas un statut ethnique autre, mais plutôt le degré d’opulence du propriétaire.
Comme les Wandala, les Montagnards islamisés construisent leur maison selon un
plan quadrangulaire. Les structures qui la composent sont disposées autour d’un ou de deux
cours centrales. L’importance de la clôture est soulignée, à la fois, par les Montagnards
islamisés et par les Wandala, de même que les aires sablées aménagées à l’entrée de la
concession pour les prières quotidiennes. Toutes les concessions visitées s’ouvrent par un
djaoulerou, une sorte de maison à deux entrées; l’une donnant sur l’extérieur, et l’autre
donnant sur la cour centrale. Pour les familles les plus fortunées, la maison est équipée d’un
second djaoulerou qui commande l’accès à la deuxième cour centrale autour de laquelle
sont disposées les structures abritant les épouses. Chaque femme a droit à une chambre
personnelle, mais la cuisine est unique et collective, explique Amada, d’origine mura mais
vivant à Mora à la suite de sa conversion à l’islam au début des années 1980 (entretien
avec Amada, homme de 35 ans, le 02 juillet 2012, à Mora). Toutes les structures épousent
des formes quadrangulaires, certainement adoptées à la suite de l’implantation des colons
dans la ville aux époques coloniales, même si elles sont aujourd’hui utilisées comme un
élément différenciateur avec les populations non musulmanes171. Les maisons
rectangulaires, de même que les toits en tôle sont interprétés par les islamisés comme la
preuve de leur citadinité et de leur urbanité par opposition aux Montagnards animistes et
chrétiens.
Toutes les unités d’habitation sont équipées d’une véranda dont le principal rôle est
de permettre aux membres de la maison d’éviter la forte chaleur qui règne au sein de la
maison pendant la saison sèche. C’est aussi là que se tiennent les activités quotidiennes et
de loisirs. Contrairement aux habitations des Montagnards, les islamisés indiquent qu’il n’y
a aucun rituel qui se déroule au sein de leurs maisons. Les activités rituelles et religieuses
sont plutôt centrées autour des mosquées, disposées çà et là dans toute la ville. La plupart
des Montagnards convertis étant commerçants, comme le sont les Wandala, la maison
171 Voir à cet effet l'excellente analyse faite par Diane Lyons sur l'apparition des maisons rectangulaires chez les Mura de Doulo et son utilisation pour brouiller la frontière entre eux et les Wandala (Lyons, 1996: 341-367).
258
dispose d’une boutique où sont stockées les marchandises. Elle est localisée à l’extérieur de
l’enceinte de la maison, et donne directement sur la rue pour permettre aux acheteurs d’être
servis à l’extérieur de la maison. Il n’y a donc aucun élément signalant un statut différent
de celui des Wandala. La distinction est plutôt établie avec les Montagnards animistes et
chrétiens vivant en dehors des bourgs musulmans. À la question de savoir s’il va très
souvent rendre visite aux Mura vivant dans les massifs, Amada répond en ces termes :
Qu’est-ce que je vais encore chercher dans la montagne alors que je suis devenu un Wandala? C’est vrai, j’ai encore mes frères qui vivent là-bas, mais depuis ma conversion, les choses ne se passent pas bien entre nous. Ils ne sont pas contents du fait que je sois devenu un Wandala et ont rompu leurs liens avec moi. Moi aussi, ça m’arrange, car je me sens plus comme un Wandala que comme un Mura, surtout que la mère de mes enfants est d’origine wandala (entretien avec Amada, homme de 35 ans, le 02 juillet 2012, à Mora)
En revendiquant l’identité wandala, les Montagnards islamisés se considèrent
comme une catégorie distincte des Montagnards non-islamisés. En tant que tels, ils
réagissent de la même façon que les Wandala lorsqu’ils interagissent avec les Montagnards
non-islamisés sur des lieux publics tels que le marché, l’école et les centres de santé.
Parallèlement à leur intégration dans la société wandala, il ressort dans les propos d’Amada
que l’islamisé passe par un véritable processus de bannissement de son statut en tant que
membre de son groupe montagnard (Hallaire, 1991). Chez les Muktele, l’acte symbolique
traduisant son bannissement est consacré par la destruction de sa case au sein de la maison
utérine; un acte que l’on n’observe qu’en cas de décès d’une personne âgée dans la maison
(entretien avec Tengola, homme de 25 ans, le 03 mai 2012, à Baldama). La destruction de
la structure signe l’acte de décès social de l’islamisé et l’effacement de sa mémoire au sein
de la cellule familiale. La similarité de l’action place d'une certaine manière l’individu
islamisé au même niveau qu’un individu décédé. À ce titre, il ne peut ni rester dans le
village ni hériter de la maison et des champs (entretien avec Zabga Pastou, homme de 40
ans, le 17 avril 2007, à Godigong). Pendant toute la période de mes enquêtes, il m’a été
impossible de rencontrer une seule personne qui, tout en étant islamisée, habite encore dans
les massifs. Tout porte à croire que la maison paternelle et la montagne ne riment pas avec
la nouvelle identité religieuse du converti. Par ailleurs, en cas de décès, les islamisés se font
enterrer dans des cimetières musulmans, contrairement à leurs pairs christianisés des
259
villages de la plaine qui sont remontés en montagne pour se faire inhumés devant les
concessions ancestrales (Hallaire, 1991; Seignobos, 1982; Boutrais, 1973).
Si le montagnard islamisé s’identifie aux Wandala, il fait tout de même allusion à sa
généalogie et reconnait dans certaines situations son origine montagnarde qu’il exploite
pour établir des relations des relations commerciales privilégiées avec les acheteurs
montagnards et s’attirer une bonne clientèle. C’est ce qui ressort dans les propos d’un
participant d’origine muktele mais se considérant comme un Wandala en raison de son
islamisation :
Mon origine se trouve dans la montagne, c’est là-bas que je suis né. Maintenant je me considère comme un vrai Wandala même si je suis muktele d’origine. Je suis devenu Wandala il y a de cela 6 ans. D’ailleurs, tous les Wandala viennent de quelque part, non? Et il y a plusieurs tribus. Il y a des Wandala d’origine sankré, il y a des Wandala d’origine mufulama et il y a des Wandala d’origine wadela. Moi, je suis un Wandala d’origine muktele (Rires). Il y en a aussi d’origine podokwo, d’origine mafa (entretien avec Omar, homme de 45 ans, le 13 juillet 2012, à Mora).
Autrement dit, cet informateur utilise le label ethnique muktele, non pas pour
souligner une appartenance ethnique, mais comme un segment du grand groupe wandala172.
Se faisant, il place le nom ethnique muktele au même plan que les divers groupes claniques
(sankré, mufulama, wadela, etc.) constitutifs du groupe wandala. Autrement dit, le fait
qu’Omar signale son origine muktele ne signifie pas que son mode de vie soit structuré par
les principes régissant son groupe d’origine montagnarde. Il s’agit simplement d'une
indication qui fait référence à son ascendance, de temps en temps convoquée pour obtenir
des prestations de service auprès des Montagnards lorsque cela lui est avantageux173. Il
admet par exemple amadouer les clients montagnards en leur disant qu’il était lui aussi
montagnard, et en leur parlant dans la langue muktele. Cette situation d’ambivalence amène
à admettre avec Schilder (1988: 146) que l’islamisation des Montagnards répondait, dans la
172 Voir aussi l’attitude des Fur nomadisés se prenant pour des Baggara décrit par Grønhaug Halland (1969). 173 Voir Schilde (1988) pour une analyse similaire chez les Moudang du Nord-Cameroun.
260
plupart des cas, au désir d’assurer la prospérité de leurs intérêts commerciaux et
politiques174.
En effet, en considérant la politique d’Ahidjo visant à créer un Nord-Cameroun
musulman (Adama, 2003; Mouiche, 1995; Mbembe, 1993; Ngayap, 1985), il y a lieu de
conclure avec Antoine Socpa (1999 : 71), qu’elle a produit deux résultats convergents :
d’une part, elle a renforcé et surtout disséminé l’identité des Wandala au-delà de leurs
limites ethniques et d’autre part, elle a provoqué le mimétisme de cette identité par les
Montagnards, grâce notamment à l’adoption des formes rectangulaires et à
l’islamisation175. Cependant, il s’agissait davantage d’une islamisation de façade (Socpa,
1999 : 42) dans le but d’avoir accès à des privilèges d’ordre commercial (Socpa, 1999;
Schilder, 1994). Cette stratégie du mimétisme est restée une caractéristique plus ou moins
constante pendant toute la gouvernance d’Ahmadou Ahidjo (Adama, 2003) et parfois au-
delà de son règne dans la mesure où ce n’est qu’avec la transition démocratique des années
1990 que le phénomène de « désislamisation » (Socpa, 1999 : 74-74) prendra de l’ampleur
en raison de l’ouverture du Cameroun au pluralisme politique et à la compétition électorale
(Saibou, 2005).
4. Retour à l’identité montagnarde, cette fois politique : de l’instrumentalisation de la symbolique de la maison dans le contexte de la transition démocratique
Le Cameroun se présente comme une Afrique en miniature, au carrefour des trois
grandes régions culturelles classifiées par les anthropologues : la Côte de Guinée, le
Soudan occidental et le Congo. Des recherches linguistiques récentes ont énuméré quelque
deux cents groupes ethniques identifiables et les cartes culturelles disponibles confirment la
complexité exceptionnelle de la configuration ethnique de ce pays (Kago, 1995; Collectif
changer le Cameroun, 1992). De ce fait, le Cameroun se présente comme très prédisposé
174 En se basant sur le cas des Mondang, Kees Schilder remarque que cette islamisation, malgré ses apparences, est restée ambivalente, voire impure (1994: 242). 175 À ce sujet, Kees Schilder écrit que l’islamisation, suivie du mimétisme du mode de vie musulman par les populations de souche kirdi, était l’unique moyen d’une part d’accéder dans les rouages de l’État et d’avoir droit à des privilèges économiques (1994 : 42). Cette stratégie de conquête de pouvoir a abouti à des changements de patronyme kirdi pour arborer des noms à résonance musulmane, ce qui amène Schilder à parler d’une islamisation plutôt par intérêt.
261
aux rivalités ethniques (Mbuyinga, 1989). Cependant, la politique gouvernementale en
période monolithique (1966-1990) était très hostile aux expressions identitaires et
régionales (Mouiche, 1996). Les associations ethniques relevaient dans ce contexte plus ou
moins de la clandestinité. La transition démocratique des années 1990 ouvre dès lors la voie
à un florilège d'associations à caractère ethnique et régional, dans le contexte duquel se
situe le processus de construction de l’identité montagnarde à travers l’usage des symboles
et des métaphores liées à la montagne et à la maison traditionnelle.
En 2007 s’est tenu à l’église de Mora-Massif un séminaire à l’attention des pasteurs
et évangélistes du district religieux de Mora pour les encourager à intégrer dans leur culte
de dimanche des séances de sensibilisation de leurs fidèles. Les organisateurs et les orateurs
(religieux, universitaires et politiciens pour la plupart), ont exposé les buts poursuivis à
savoir « la lutte contre les clivages ethniques » et «la constitution d’un bloc montagnard».
Une première phase des discours a mis l’accent sur le traitement injuste des Montagnards
animistes par les élites du département du Mayo-Sava, c’est-à-dire par les élites politiques
wandala, aussi considérées comme des représentants de l’État176. Les orateurs ont insisté
sur la nécessité pour les Montagnards de se libérer des clivages ethniques et tribaux pour
parler d’une seule voix lors des différentes consultations électorales, notamment les
élections municipales et législatives de 2007 qui étaient encore à venir. À la fin du
séminaire, quelques intellectuels sont invités à prendre la parole et ont présenté la nécessité
de la création d’une association montagnarde pour fédérer les associations ethniques déjà
existantes dans les différents massifs, et servir d’intermédiaires entre l’État et les paysans
montagnards177.
La volonté de constituer une seule voie dans les échéances électorales a débouché
sur l’inscription de deux jeunes intellectuels montagnards sur la liste du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais (RDPC) aux élections législatives de mai 2007. Ces
deux candidats, dont un podokwo (poste titulaire) et un Mura (poste suppléant), ont sillonné
176 Voir annexe 9 de cette thèse. 177Ce séminaire s’inscrivait dans les activités ordinaires du district de Mora, une fédération religieuse regroupant toutes les églises de l’arrondissement de Mora appartenant à l’Union des Églises Évangéliques au Cameroun (UEEC). Les organisateurs du séminaire ont manifestement estimé le rôle important que peuvent jouer les pasteurs et les évangélistes dans la sensibilisation et la conscientisation de la population montagnarde et dans formation d’un bloc uni lors des consultations électorales.
262
les différents massifs dans lesquels ils se présentèrent dans leur rôle de médiateurs entre
eux, les Montagnards et l’État. Dans cette même logique, un mémorandum intitulé:
« Mémorandum des Montagnards chrétiens et animistes du Mayo-Sava » fut adressé au
Président de la République. Le titre de ce document semble exclure de prime abord les
Montagnards islamisés et ne semble s’adresser qu’à ceux restés animistes ou devenus
chrétiens. Cependant, lors des différentes prises de parole dans les médias nationaux, les
élites n’ont eu de cesse de lancer un appel à leurs collègues islamisés tenus jusque-là à
l’écart du processus de (re)composition de l’identité montagnarde et qui semblaient avoir
renié leurs origines montagnardes.
Enfin, en décembre 2010 s’est tenu le premier festival de l’Association culturelle
des Podokwo (ACP). Au-delà de l’appel à l’unité ethnique, ce festival a également mis
l'accent sur l’identité montagnarde des Podokwo, identité qu’ils partagent avec les Mura,
les Uldeme et les Muktele. Les représentants de ces groupes (chefs traditionnels, élites
religieuses et élites intellectuelles) ont d’ailleurs été invités à prendre part au festival. Sur
des banderoles blanches accrochées devant la maison du chef d’Udjila où se tenaient les
manifestations, on pouvait lire une série de slogans, entre autres: A dəmə da hawə vuŋa
wamə nda məndə dzaŋa (Allons de l’avant, nous gens de la montagne) ou encore: Ba Jiba
kutərə mə batete wamə nda məndə dzaŋa : (Nous sommes tous un seul peuple, gens de la
montagne). Le but poursuivi par le festival est de réaliser l’unité podokwo, première étape
vers la constitution de l’unité montagnarde. Pour atteindre cet objectif, les organisateurs
n’ont eu de cesse d’exercer une pression morale sur les Montagnards islamisés, leur
rappelant leurs obligations, non seulement en tant qu’élites économiques, mais aussi en tant
qu'originaires de la montagne. Ils devaient prendre conscience qu’ils n’étaient pas
seulement des islamisés, mais avant tout des originaires de la montagne.
263
Figure 35 : Maquette de la tenue de l’Association culturelle podokwo à l’occasion de leur premier festival culturel (décembre 2010)
La figure 34 est une photographie de la maquette de l’uniforme conçu par
l’Association culturelle podokwo (ACP) dans le cadre de leur premier festival culturel tenu
à Udjila en décembre 2010. Sur la maquette on aperçoit quelques éléments considérés
comme définitionnels de l’identité montagnarde. Ces éléments sont, entre autres, la
calebasse (présente dans les mythes d’origine podokwo et muktele)178, le mil et le fonio
(élément nutritionnel de base des Montagnards), la montagne (symbole de l’identité
montagnarde). L’élément le plus perceptible sur la maquette est sans doute le cône au-
dessus duquel on aperçoit un soleil levant qui symbolise des lendemains meilleurs, une
rhétorique empruntée à Jean-Baptiste Baskouda (1993) dans son apologie de la kirditude.
Les significations associées au cône sont multiples : il évoque, à la fois, le toit conique des
cases traditionnelles, le sommet montagneux et le parapluie179. En revanche, l’interprétation
178 Voir à ce sujet les mythes d’origine podokwo et muktele présentés dans le chapitre III. 179 Propos tenus par le Président de l’Association culturelle des Podoko (ACP), Antenne de Maroua, lors de la réunion mensuelle tenue le 27 avril 2014 à Maroua. Il expliquait les symboles figurant sur l’uniforme de l’association et la nécessité de s’en procurer pour souligner la fierté d’être à la fois podokwo et homme de la montagne.
264
de ces trois images (case traditionnelle, montagne et parapluie) dépasse le cadre strictement
ethnique. Elles évoquent, d’une part, l’identité montagnarde matérialisée par la maison et la
montagne, et d’autre part, elles soulignent l’appartenance des Podokwo à l’association des
« minorités ethniques » au plan national ici matérialisée par la symbolique du parapluie.
En effet, le symbole choisi par l’association des minorités ethniques au Cameroun
(Laimaru) est un parapluie. Selon l’explication fournie sur la page facebook de Laimaru, le
choix du parapluie comme symbole de l’association traduit la volonté de rassembler toutes
les organisations minoritaires et les personnes qui travaillent avec eux au Cameroun180.
Ainsi, en choisissant le cône comme symbole phare de l’uniforme de l’ACP, il y a
non seulement la volonté de signaler l’identité ethnique, mais également l’identité
montagnarde ainsi que l’appartenance à l’association des minorités à un niveau national.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la base du cône est décorée par les couleurs du
drapeau national (vert, rouge, jaune avec une étoile frappée sur la bande rouge) qui selon
les concepteurs de la maquette, évoque la nécessité pour les Montagnards de participer à la
vie politique nationale, au même titre que les autres citoyens du Cameroun.
On pourrait multiplier des exemples de manifestations culturelles, politiques et
religieuses qui se sont tenues ces deux dernières décennies dans les monts Mandara, et dont
le plus récent fut la tenue en janvier 20-14 d’un atelier à Tala-Zoulgo sur le thème:
« Minorités montagnardes et gouvernance locale ». Cet atelier, organisé par l’association
culturelle Takouma, et placé sous le haut patronage du Haut-commissariat du Canada au
Cameroun, a constitué une plate-forme de discussions sur le devenir de la société
montagnarde. L’annonce a été ventilée à travers les réseaux sociaux tels que Facebook,
Google et Yahoo par les ressortissants de tous les groupes ethniques montagnards.
180 Voir la page facebook de l’association des minorités au Cameroun en cliquant sur le lien: https://www.facebook.com/LaimaruNetwork?fref=photo
265
Figure 36 : Participants au séminaire sur les « minorités montagnardes et gouvernance
locale », janvier 2014-12-31 organisé par Takouma
Par ailleurs, des écrivains montagnards s’activent à inscrire la question des
minorités dans l’espace public national à travers des projets d’édition d’ouvrages dont les
thèmes tournent autour de l’éviction des Montagnards des centres de décisions politiques,
et des lieux d’accumulation des ressources181. Sur les ondes des radios et les chaines de
télévisions nationales, l’élite intellectuelle, en tant que « voix des sans voix », rappelle sans
cesse la mise à l’écart et le maintien des kirdi à l’arrière-plan des autres groupes tant sur le
plan politique qu’économique. Il convient de rappeler que les Montagnards font remonter
leur marginalisation au régime Ahidjo (1960-1982) qui avait mis en place un projet de
constitution d’un Nord-Cameroun en un bloc, mais qui a fonctionné sur le terrain comme
un mécanisme d’exclusion de groupes sociaux non musulmans (Saibou, 2005: 199;
Bigombé, 1999 : 221-268; Ela, 1994: 9). Dans ce contexte, les Montagnards qui avaient
jusque-là refusé de s’islamiser étaient considérés avec une certaine répugnance par les élites
politiques du Cameroun indépendant, qui n’ont eu d’autre moyen que de les écarter de
l’arène politique nationale et des structures des pouvoirs. Cette situation a suscité un ras-le-
181 Voir annexe 9 de cette thèse pour plus de détails.
266
bol qui a néanmoins attendu la transition démocratique avant de se manifester
concrètement. À partir de cette date, les élites kirdi s’en sont prises ouvertement à l’État et
aux élites musulmanes, qu’ils accusent encore aujourd’hui de réserver un traitement
préférentiel aux islamo-peuls.
Le point commun à toutes ces manifestations est qu’elles tournent autour de la
référence à la montagne et à la maison. Ces deux labels ne doivent pas être pris ici dans leur
sens premier, mais davantage dans leur fonction symbolique en tant que deux aspects
définitionnels de la communauté montagnarde. La référence à la montagne et à la maison
poursuit ouvertement et symboliquement le but de se faire une place au sein de l’appareil
d’État dans un contexte marqué par le multipartisme et la compétition électorale depuis la
transition démocratique des années 1990182. Elle découle également de la même volonté
que par le passé, à savoir opposer les Montagnards animistes aux groupes musulmans vus
comme les vrais responsables de l’éviction des Kirdi dans le jeu politique postcolonial. À
travers l’utilisation du terme montagne, s’élabore l'image d’un groupe homogène avec des
intérêts identiques, par opposition aux Wandala et autres populations musulmanes de la
plaine. C’est donc cette ambition plus ou moins avouée qui a suscité un regain d’intérêt
pour la thématique de l’identité montagnarde, laquelle à son tour, a eu un impact
considérable sur l’utilisation des symboles architecturaux.
L’architecture qui était jusque-là au centre de la construction de l’identité à une
échelle ethnique, est devenue un symbole activement utilisé dans la (re)construction de
l’identité montagnarde. C’est ainsi que s’observent, ces deux dernières décennies, des
182 Depuis les années 1990 en effet, l’ascension politique des élites locales au Cameroun est déterminée par leur capacité à susciter, dans leurs régions respectives, l’électorat en faveur du régime au pouvoir. La formule pidgin-english Achidi Achu traduit bien cette logique clientéliste. Politics na njangui affirmait Achidi Achu à la veille des élections présidentielles de 1992, ce qui signifie littéralement : la politique est une tontine. En d’autres termes, la politique, c’est du donnant-donnant (Sindjoun, 1996 : 65). Par cette formule, Achidi Achu, par ailleurs Premier Ministre du Cameroun à cette période, expliquait à la population du Nord-Ouest que les réalisations de l’État dans leur région étaient conditionnées par leur soutien électoral au parti politique au pouvoir. Dans cette perspective, les actions sociales des élites sont une réaction au système patrimonialiste et clientéliste de l’État (Mbembe, 2000; Médard, 1991; Bayart, 1989, 1985). L’aboutissement de ce rapport clientéliste est, d’une part, l’infiltration de l’État dans les sphères au sein de la société (Mbuagbo et Robert, 2004; Konings, 2002; Nyamnjoh, 1999), et d’autre part, l’inféodation des composantes de la société civile au sein de l’État (Sindjoun, 1994). C’est dans ce sens que Luc Sindjoun (1999, 1996, 1994) considère les replis identitaires comme une démarche clientéliste des élites locales auprès de l’État. Il souligne que leurs actions s’inscrivent dans des réseaux de pouvoir et ont pour finalité leur accès ou leur maintien dans l’appareil d’État (Sindjoun, 1999).
267
reconstructions partielles ou totales des ruines architecturales en montagne par des gens
pourtant vivant en plaine. Des cases de pierres aux toits faits en tiges de mil sont de plus en
plus (re)construites, non pas pour y être habitées, mais pour marquer l’attachement des gens
à leur lieu d’origine. Des symboles architecturaux sont également utilisés à travers des
tracts, des pamphlets, de tableaux d’artisanats et des pages Facebook des différentes
associations montagnardes. Par exemple, les logos choisis pour confectionner les billets
d’invitation au séminaire de sensibilisation organisé par le district de Mora ont utilisé les
métaphores architecturales. De même, l’atelier de formation récemment organisé en
partenariat avec le Haut-commissariat du Canada au Cameroun a utilisé la photographie
d’une maison montagnarde comme image publicitaire. Les élites religieuses, politiques et
intellectuelles essayent, par la manipulation de ces symboles, de profiter d’un contexte de
relative ouverture politique et culturelle en cours depuis 1990 pour revendiquer une place
plus évidente dans l’espace public national, et pour tenter de contrer, indirectement et sans
esclandre, le pouvoir hégémonique des Wandala.
Parallèlement à l’utilisation des images architecturales dans les séminaires et
festivals, les élites locales tiennent des discours dans lesquels ils appellent les Montagnards
à l’unité, en utilisant constamment les métaphores architecturales contenues dans les
proverbes et contes locaux tels que : « La honte de sa propre maison est pareille à la peur
de la brousse on se trouve seul en brousse » ou encore « Le chien a peur de l’hygiène quand
il est en brousse, mais dès qu'il voit le toit de sa maison, il commence à l’aboyer ». Dans
ces deux exemples, on remarque que l’opposition montagne/brousse qui était autrefois
utilisée pour distinguer les Montagnards des Wandala, mais aussi pour distinguer les vraies
des faux Montagnards dans le contexte de la descente en plaine, cède la place à la
dichotomie maison/ailleurs : la maison c’est-à-dire le chez-soi, est un espace vivant et de
sécurité, alors que l’ailleurs est un lieu d’incertitude et de tous les dangers.
268
Figure 37 : Photographie de la maison utilisée comme image publicitaire lors de l’atelier de
formation organisé par Takouma
L'élément paradoxal réside dans le fait que ces élites (hommes d’Église, leaders
politiques et intellectuels) qui utilisent les éléments architecturaux n’habitent pas en
montagne, et ne vivent pas non plus dans des maisons de pierres. Beaucoup d’entre eux
sont d’ailleurs mariés à des femmes non-montagnardes, à tel point que leurs enfants ne
savent ni parler les langues locales ni pratiquer la culture et les traditions montagnardes.
Autrement dit, la maison ici instrumentalisée, est non pas le lieu où l’on y habite
réellement, mais un lieu symbolique dont l’aspect métaphorique aide à la constitution du
projet montagnard de construction d’un bloc politique uni. Cette architecture visuelle et
métaphorique est néanmoins si puissante qu’elle n’a pas besoin d’exister réellement pour
être transformée en emblème de l’identité montagnarde.
Contrairement à la période d’avant 1990 où les populations utilisaient leurs maisons
« réelles » pour se représenter en tant que groupe ethnique, l’instrumentalisation politique
de la maison se fonde donc sur une fiction architecturale mais qui, tout en étant visuelle ou
métaphorique, surpasse les nécessités fonctionnelles pour devenir une voie à travers
269
laquelle les élites montagnardes essayent de se faire entendre dans le contexte politique
actuel. On pourrait être tenté de corroborer, à la façon des instrumentalistes (Cohen, 1974;
Vincent, 1974), une définition simpliste de l’ethnicité et de réduire l’analyse des faits
ethniques à la manipulation arbitraire des traits culturels dans la poursuite des intérêts
politiques des acteurs. Même si cette hypothèse est vraie, les élites locales n’ignorent
cependant pas l’importance de l’aspect psychologique du rôle de l’histoire et de la mémoire
(particulièrement celle liée à l’esclavage)183, constamment réactivé par le maniement des
symboles architecturaux et d’autres éléments de la culture matérielle (parure et habillement,
alimentation, poterie, etc.). En tant que ressource d’action politique utilisée par les élites
locales, les symboles architecturaux et la référence à la montagne s’inscrivent dès lors dans
la logique de la commercialisation et du marchandage des solidarités primaires en vue de
s’approprier une partie du gâteau national mis en compétition par l’État (Sindjoun, 1999),
ce qui s’apparente à la logique de ce que John Lonsdale a appelé le tribalisme politique et
qu’il définit comme l’utilisation politique de l’ethnicité (1996 : 99)184. Il serait cependant
réducteur de considérer un tel usage des solidarités primaires pour définir l’ethnie comme
un simple épiphénomène politique, car dans d’autres situations il s’effectue en dehors de
tout calcul politique.
Conclusion: On ne nait pas ethnique, on le devient!
Au terme de ce chapitre, on peut conclure que les éléments communs et différents
de la maison, de même que la constance et l’évolution des pratiques architecturales,
recèlent des enjeux de différentes natures. Tout d’abord, les éléments partagés des
architectures a permis aux Montagnards, indépendamment de leurs différences ethniques,
de produire le sentiment d’appartenir à un groupe homogène. Il n’existait pas, à proprement 183 Se reporter à cet effet au chapitre III consacré à la manipulation des éléments architecturaux en lien avec la mémoire de la servilité dans les dynamiques identitaires des montagnards.
184John Lonsdale oppose le tribalisme politique (utilisation égoïste des appartenances ethniques à l’ethnicité morale qu’il définit comme « l’instinct courant chez l’homme de construire, à partir des pratiques quotidiennes de la relation sociale et du travail matériel, un ensemble de codes moraux et de références éthiques à l’intérieur d’une communauté plus au moins imaginaire» (Lonsdale, 1996 : 100). L’ethnicité morale, écrit-il, «fait de nous des êtres moraux et partant, sociaux » (Lonsdale, 1996 : 99). Par contre, le tribalisme politique est fonction des intentions et du contexte politique». Dans ce sens, John Lonsdale considère l’ethnicité morale comme une forme de participation politique légitime, dans la mesure où elle encourage l’interaction entre les élites et l’État dans la poursuite du bien-être de la communauté. Elle est bien différente, écrit-il, « de l’absence de principes qui préside au tribalisme politique dont les groupes se servent dans leur lutte pour les ressources publiques» (Lonsdale, 1996 : 99).
270
parler, de communauté montagnarde unique et cohérente, mais une série de groupes
ethniques partageant des réalités historiques et géographiques communes, lesquelles ont
certainement donné lieu à des pratiques architecturales communes. Pourtant, la maison
combinée à la religion et à la montagne, a servi d’une part à la production de ce sentiment
d’homogénéité entre les groupes montagnards et d’autre part, au marquage de la frontière
entre eux et les Wandala de la plaine. Parallèlement, l’absence de la dichotomie
montagnarde versus Wandala a donné lieu à des comparaisons interethniques et à
l’arborescence par chaque groupe de son propre manteau ethnique. Dans ce dernier cas, ce
sont les particularités - et non les ressemblances - des pratiques architecturales qui servent
de marqueurs ethniques.
L’attachement à l’ethnie et à la maison qui en est le symbole le plus marquant était
si fort que la tentative coloniale de redistribuer les cartes ethniques par la création des
cantons n'a pas atteint les résultats escomptés. En créant les cantons et en obligeant les
chefs à descendre en plaine, les autorités coloniales ambitionnaient de socialiser les
Montagnards, de façon à ce qu’ils incorporent les nouvelles lignes ethniques dans leur
système de pensée. Dans le même sens, l’opération forcée de descente en plaine dans les
années 1960, fruit de l’action des politiques locales, a été stratégiquement contournée par
les Montagnards qui n’ont laissé partir en plaine que les individus dont le rôle dans le
déroulement des rites liés à la terre, à la pluie et à la maison était moins important. Tous
ceux qui détenaient une fonction rituelle spécifique et indispensable pour assurer la
continuité de la maison et du culte ancestral sont restés sur leurs massifs. La descente en
plaine des cadets sociaux a certes contribué au renouvèlement du paysage architectural en
plaine (adoption des formes rectangulaires et du toit en tôles notamment par les jeunes).
Cependant, ces transformations ne peuvent pas s’expliquer uniquement par des facteurs
externes, comme si les ex-Montagnards dans leur passivité, n’avaient d’autres choix que de
s’ouvrir à la modernité et à la culture wandala. Leur capacité à reconfigurer leur identité
ethnique par la domestication des formes architecturales extérieures, et par leur
objectivation à l’intérieur des structures symboliques locales doit être prise en compte.
On constate donc que les Montagnards manient des facettes ethniques différentes en
les associant à des aspects architecturaux particuliers dans des contextes sociaux
271
particuliers (Goffman, 1973). Tantôt, ils choisissent de mettre l’accent sur leur identité
ethnique, tantôt ils la réduisent au profit de leur identité montagnarde, et parfois encore, ils
suppriment toute référence à la montagne ou à leur ethnie d’origine. Si dans certains cas,
ces choix dépendent des avantages économiques et politiques qu’offre le contexte
(MacEachern, 1990: 316-17; Hodder, 1982: 83-85), dans d’autres cas ils s’effectuent en
dehors de tout calcul politique et économique. C’est en outre l’interaction avec l’Autre,
appartenant à une tradition culturelle différente, qui leur permet d’objectiver les différences
architecturales existantes en tant que marqueurs identitaires (Jones, 1997: 95; Jenkins,
1997: 76-7; Eriksen, 1993: 34). Tout ceci implique de concevoir l’identité ethnique comme
le produit d’un processus social plutôt que d'une culture donnée, faite et refaite plutôt
qu’allant de soi, choisie en fonction des circonstances plutôt qu’attribuée par la naissance.
Figure 38 : Quelques facettes de l’ethnicité dans les monts Mandara
Ainsi, l’ethnicité ne dépend pas de la culture objectivement définie comme les
approches normatives et primordiales l’ont supposé (par exemple Smith, 2003: 52-53;
Kellas, 1991: 12-13; Scott, 1990: 150; Isaacs, 1974: 15; Geertz, 1963: 109; Shils, 1957:
122). Elle se réfère plutôt aux manières subjectives des acteurs pour se définir comme un
272
groupe cohérent, en choisissant des diacritiques architecturaux spécifiques à même de les
distinguer des autres groupes. L’ethnicité n’est pas non plus, comme certaines approches
instrumentales supposent (Anderson, 2006; Alcoff, 2003; Laitin, 1998; Hardin, 1995;
Cohen, 1974; Barth et al., 1969), entièrement le produit d’une manipulation consciente des
symboles culturels et architecturaux dans la poursuite d’intérêts économiques et politiques.
Suivant la pensée d’Arjun Appadurai (1996) dans laquelle je m’inscris, l’identité ethnique
doit être conçue comme une construction consciente et imaginative de la différence, grâce à
l’utilisation des attributs matériels considérés les plus significatifs pour l’identité du groupe
dans une situation donnée. Elle ne dépend pas entièrement de l’extension des sentiments
primordiaux, et ne suppose pas non plus qu'elle est manipulable à souhait (Appadurai,
1996: 14). Cette logique est donc l’inverse de l’approche primordiale ou normative, mais
prolonge et complète en même temps la conception instrumentale de l’ethnicité.
L’application du concept de Pierre Bourdieu de l’habitus, comme le suggère
Bentley (1987: 173) peut aussi fournir un moyen permettant d’intégrer les deux approches
primordiales et instrumentales dans une théorie cohérente de l’action humaine. En
m’appuyant sur la théorie de la pratique, je postule que l’ethnicité est à lire dans les
dispositions subliminales communes de l’habitus (Bourdieu, 1980: 87-111), lesquelles
dispositions donnent lieu à des pratiques architecturales communes, de même qu’elles sont
façonnées par elles. Si l’on admet cette hypothèse, on peut faire valoir que l’attachement à
l’identité ethnique et à la maison qui en est le symbole, sont générés par le même habitus
(voir Bourdieu, 1980: 88, 91-93; 1977: 78-93). C’est à travers cette pratique quotidienne
des gens que la maison émerge, non seulement, comme une composante des relations
ethniques, mais comme un objet activement impliqué dans l’organisation symbolique de
ces relations et de ces pratiques sociales (Després, 1991). Cette capacité lui provient, très
souvent, comme on l’a vu chez les Mura, de relations ritualisées entre elle, les humains et
les ancêtres; relations dans lesquelles la maison et les objets domestiques agissent comme
des intermédiaires qui encapsulent et symbolisent les identités sociales et ethniques (Blunt
et Dowling, 2006: 23; Gillespie, 2000; 470-475).
Cette conclusion prolonge en la complétant les idées d’Amos Rapoport (2000; 1995;
1990; 1988; 1982; 1972) qui voyait déjà la maison comme un signe et un témoin de la
273
culture de l’individu qui l’habite. Plutôt que d’être simplement l’expression des relations
sociales, la maison s’interpose comme un ingrédient actif dans la récréation quotidienne des
identités dans différents contextes sociaux (Buchli, 2013, 2002, 2000 [1999]; Miller, 2011,
2005; Gell, 1998; Blier, 1987; Appadurai, 1996). L’action de l’homme sur la maison, idée
encore dominante chez Amos Rapoport, rend ici place à ce qu’Alfred Gell (1998) appelle
agency secondaire de la maison, dans la mesure où elle ne subit pas passivement l’action
humaine, mais qu’elle l’influence aussi (Hoskins, 2006 : 74). Cette nouvelle considération
sur l’action sociale de la maison sera davantage explorée dans le chapitre suivant consacré
au rôle de la maison dans la négociation identitaire à un niveau individuel.
275
Chapitre V
« La maison est un miroir dans lequel les gens te regardent » : architecture comme médium d’expression identitaire
Dans sa célèbre introduction à l'ouvrage Housing and Identity, James Duncan
(1982) formulait l’hypothèse selon laquelle dans les sociétés à idéologie individualiste, la
maison est intimement liée à l'identité individuelle reflétant la personnalité, le statut social
et les accomplissements personnels du propriétaire. En revanche, dans les groupes à
idéologie communautariste, la maison symbolise plutôt les valeurs du groupe, et a peu à
voir avec l'idée que l'on se fait de soi (Duncan, 1982 : 2). James Duncan arrive à cette
conclusion à la suite d’une série d'études menées au sein de deux groupes d'élites différents
– ancienne élite et nouveaux riches – vivant dans la même ville à savoir la ville
d’Hyderabad en Inde. Ces deux groupes atteignent le sommet du statut social de manière
fondamentalement différente : la vieille élite le fait à travers la consommation d'objets axés
sur le groupe car ici, écrit Duncan, « la maison ne sert pas à la différentiation entre les
individus et il n'existe aucune hiérarchie visible entre leurs maisons » (1982 : 36).
L'honneur de la maison tire plutôt ses sources de l'existence d'un lignage honorable et
ancien, et le prestige n'est attribué qu'à ceux qui convertissent leur richesse personnelle au
bénéfice de l'ensemble de la communauté. Inversement, la nouvelle élite construit son statut
social à travers des réalisations purement individualistes et personnelles (Duncan, 1982 :
36). Pour se démarquer dans ce nouveau monde social, une personne devrait posséder un
type particulier de maison dans un quartier spécifique de la ville (Duncan, 1982 : 37).
S’il est vrai que les structures sociales qu’on trouve dans les monts Mandara ont des
allures communautaristes et égalitaires (MacEachern, 2002 : 201-203; David, Gavua,
MacEachern et Sterner, 1991 : 171; Hallaire, 1991 : 45; De Colombel, 1986 : 16-22;
Richard, 1977 : 78; Juillerat, 1971 : 75-78), il est difficile de soutenir l'idée d'une stricte
division entre communautarisme et individualisme. D'une part, l'utilisation de la maison
dans la construction de l’identité individuelle n'était pas inexistante chez l’ancienne élite, et
276
d'autre part, le succès de la nouvelle élite qui émerge avec l’exode rural et le fonctionnariat
est sanctionné par la communauté d’origine à laquelle ils appartiennent, et qui apparait
comme l’unique arbitre de la joute de l’honneur (Moisa, 2010). Les deux groupes d’élite,
traditionnelle et moderne, ont toutefois un idéal de réussite qui guide leurs comportements
sociaux de manière différente par rapport à l'espace bâti.
Duncan trace cependant une nouveauté particulièrement intéressante à travers sa
proposition sur l’interconnectibilité entre la maison et l’individu (Duncan, 1982: 1) car,
autant les individus habitent la maison, autant cette dernière habite à son tour les individus
(Casten et Hugh-Jones, 1995). De cette relation dialectale émerge la maison en tant
qu’actant, un statut qui la rend capable de symboliser, de représenter et même de
transgresser les pratiques sociales de ses occupants (Duncan 1973 : 261)185, une idée qui
sera reprise et développée par un certain nombre de théoriciens (Buchli, 2015, 1995;
Turgeon et Debary, 2007; Tilley et al., 2006; Hicks et Horning, 2006; Miller, 2005, 1998,
1994, 1987; Tan, 2001 ; Marcus et Myers, 1995; Appadurai, 1986). Ces derniers explorent
une diversité de questions, notamment la polysémie des objets (Turgeon et Debary, 2007),
les changements biographiques, historiques et culturels de la signification des objets
(Appadurai, 1986) et le rôle actif de la culture matérielle dans la production des réalités
sociales (Buchli, 2013, 1995; Miller, 2005; Tilley, 2002). Les travaux de Daniel Miller
(2005, 1987) sont particulièrement déterminants en ce qu’ils approchent la culture
matérielle comme un phénomène culturel doté d’une autonomie propre, affectant les sujets
de manière significative. Dans ce sens, Miller appelle de ses vœux les chercheurs à insister
non seulement sur la façon dont les individus font et utilisent avec les objets, mais aussi sur
la manière dont les « objets que les individus font, font les individus (2005 : 38), car
185 De l’avis de James Duncan, le souci de standing social est parfois si important qu'il peut amener les individus à ignorer les réalités économiques, les schèmes culturels locaux et même la valeur associée à la forme des maisons (Duncan, 1973 : 261). Dans un autre texte consacré au rapport entre espace domestique et identité, Duncan (1981) va au-delà de la définition dominante de la maison qui avait cours à cette époque et qui approchait celle-ci en tant que faisant partie d'un système de communication. Au lieu de cela, l’auteur attire plutôt l'attention sur la manière dont les identités des individus sont générées par les maisons qu'ils ont construites, produites et utilisées.
277
l’artéfact « joue un rôle essentiel dans la reproduction sociale » (1987 : 107) et dans la
structuration du comportement humain (2005 : 5)186.
Dans la mouvance de ces approches sur la culture matérielle, ce chapitre propose de
voir la maison et les meubles comme une arène particulièrement pertinente pour
l'affirmation et la négociation des identités individuelles tant chez l’ancienne que chez la
nouvelle élite. Il met en évidence le souci de standing social (Roux, 1976) dans deux
époques différentes, à savoir l'avant et l'après 1980. Cette date marque à peu près
l'amplification du phénomène migratoire des montagnards vers les grandes métropoles
camerounaises (Iyebi-Mandjeck, 1993), lequel donnera naissance à l'apparition d’une
nouvelle classe d’élites constituée des migrants urbains et des fonctionnaires. La première
partie approche la maison comme un objet permettant d'acquérir un statut respectable à
l'intérieur de la communauté. Ici, le rang social est donné par des éléments extérieurs de la
maison (situation en altitude, surface occupée par la maison, toits en tiges de mil, nombre
de pièces qui composent le quartier des femmes). Dans ce sens, l’analyse intègre d’une
part, la notion de l'espace et son influence sur la position sociale de l’individu, et d’autre la
notion d’anthropomorphisme et de biographie des maisons en lien avec la biographie de
leurs occupants. La deuxième partie met en évidence les principes qui gouvernent les
nouvelles constructions apparues dans les années 1980 avec la recrudescence de l’exode
rural et de l’entrée des originaires des monts Mandara, devenus fonctionnaires, dans la vie
active nationale. Ces nouvelles maisons représentent des symboles forts de l’aisance et
communiquent ce que Pezeu-Massabuau appelle « les nuances de la fortune » (1983 : 209).
Chez les migrants urbains, les signes de la réussite se greffent, comme chez l’élite
traditionnelle, dans les éléments extérieurs de la maison, mais elle est ici donnée par les
toits en tôle et la forme rectangulaire. Par contre, avec l’émergence des fonctionnaires, la
186 Pour expliquer cette relation dialectale entre objets et sujets, Daniel Miller s'inspire surtout de deux théories, à savoir la pratique de Pierre Bourdieu (1977, 1970) et la structuration de Antony Giddens (1984). Ces deux théories lui permettent de focusser sur l'agency de l'objet-maison, c’est-à-dire sur sa capacité à agir sur le comportement et les attitudes des occupants dans leur quête identitaire (Miller, 2001 : 119). Daniel Miller prend pour exemple une maison hantée, qui écrit-il, « contraint activement » l'agency des habitants et les oblige à transformer la maison (Miller, 2002 :8-9). La construction et l'utilisation des maisons ne sont donc pas seulement destinées à la création des espaces appropriées pour la préparation des aliments, le stockage des biens ou encore pour le repos. Elles influencent également les actions quotidiennes des individus par leur caractère physique et à travers les mobiliers qu'elles contiennent.
278
réussite sera lue à partir de l’intérieur de la maison, à travers l'entassement des meubles au
salon et dans la salle à manger.
I. « Tu es ce que tu construis 187» : maison et rang social avant 1960
De nombreux auteurs (David et al., 1991; MacEachern, 1990; Boutrais et al., 1984;
Seignobos, 1982) qualifient les groupes ethniques des monts Mandara comme des sociétés
acéphales et segmentaires. De fait, les structures sociales montagnardes prennent les
apparences égalitaires, car elles sont centrées autour de la famille ici considérée comme le
niveau le plus local de l’organisation sociale (MacEachern, 2002 : 202). Comme le souligne
Scott MacEachern (1990), les chefs de famille gardent et contrôlent directement l'accès à
leur maison et à leurs champs. Ils sont aussi responsables des rituels qu'ils pratiquent pour
établir des relations intimes avec leurs ancêtres immédiats, et ils le font de manière
indépendante (MacEachern, 2002 : 202). S'il existe des chefs au niveau de clans et de
lignages, ils détiennent davantage un pouvoir religieux que politique, et ne possèdent aucun
pouvoir coercitif sur les chefs de famille placés sous leur autorité (David et al., 1991: 184;
MacEachern, 1990: 286). De ce point de vue, on est bien en face de sociétés segmentaires.
Cependant, les logiques égalitaristes s’entrelacent dans des déploiements
d’ambitions et de recherche ostentatoire du prestige à un niveau individuel qui ne
correspond guère à la perception générale qu’on a d’une société égalitaire. Cette logique
individualiste se traduit par des comparaisons entre individus appartenant à un même clan,
de même qu'entre individus appartenant à des clans différents. L'un des facteurs
régulièrement utilisés pour faire valoir son statut social est la position topographique des
maisons dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle respecte les valeurs qui sont
associées au haut et au bas (Hallaire, 1991 : 50).
187 Ce titre est une référence à l’article de Dominique Malaquais (1994) « You are what you build : Architecture as Identity Among the Bamileke of West Cameroon », publié dans la revue Traditional Dwellings and Settlements Review.
279
A. « Dis-moi où tu as construit et je te dirai quelle est ta position sociale » : dialectique entre haut et bas et situation sociale
L'espace est l'un des concepts les plus complexes élaborés dans les sciences sociales
et les humanités au cours de ces dernières décennies (Lien, 2009 : 149; Kuper, 1972 : 411).
Juste à considérer les définitions offertes par les dictionnaires, il est évident que le mot
révèle toute une gamme de significations liées à différentes approches philosophiques,
scientifiques et sociales (Lien, 2009 : 150; Speller, 2000). Ce qui m’intéresse ici n’est pas
tant l’espace tel que défini et développé par les philosophes et les scientifiques, mais
l’expérience de l’espace, c'est-à-dire les valeurs sociales et identitaires qui lui sont
associées, lesquelles résultent de l'interaction réciproque que les individus développent avec
lui : « les individus touchent et transforment l’espace, mais la manière dont celui-ci est
touché et transformé influence également sur la façon dont les gens se voient eux-mêmes »
(Hauge, 2007 : 2). Dans les monts Mandara, la conception de l’espace priorisant le haut par
rapport au bas influe considérablement sur le choix du site de construction et sur les
attitudes des gens dans et envers la maison (Hallaire, 1991 : 48). Avant de voir comment
les montagnards se servent de ces notions de bas et de haut pour se démarquer les uns des
autres, il parait utile de commencer cette partie par une discussion théorique sur le concept
de l’espace en présentant les approches qui semblent les plus pertinentes pour cette étude.
1. Sur la notion d'espace
Dans un article de synthèse paru dans la revue Annual Review of Sociology, Thomas
Gieryn (2000) propose de conceptualiser l’espace en impliquant trois principales
composantes : la situation géographique, la forme matérielle, le sens et les valeurs d’usage.
Il considère ainsi l’espace comme un lieu situé dans un espace géographique donné,
possédant une physicalité qui est leur forme matérielle, et significatif pour les individus et
les groupes sociaux. L'inclusion de ces trois aspects éloigne l’espace des précédents débats
entre positivistes et phénoménologistes (Johnston et al., 2000: 582-583) qui furent
intensément menés dans les années 1970 (Sime et al., 2009 ; Relph, 1976). Cette opposition
semble aujourd'hui obsolète puisqu’il existe désormais un consensus sur la prise en compte
des aspects subjectifs et objectifs dans la compréhension de la notion d’espace (Gustafson,
2009, 2001 ; Gieryn, 2000 ; Massey, 1995). Les débats portent maintenant sur le rapport
280
entre lieu et identité, et sont tout aussi passionnants car ils mettent en jeu une pléthore de
disciplines et d’auteurs. Dans les sciences sociales et humaines, trois principales théories
sont utilisées pour expliquer l'impact du lieu sur l'identité soient : la théorie du lieu-identité
(space-identity concept) (Proshansky, Fabian et Kaminoff, 1983; Proshansky, 1978), la
théorie de l'identité processuelle (identity process theory) (Breakwell, 1993, 1992, 1986) et
la théorie de l'identité sociale (social identity theory) (Tajfel, 1982). Dans le cadre de cette
discussion théorique, je m'attarderai sur les deux premières car elles fournissent des
explications détaillées sur la façon dont les individus se rapportent socialement à leur
environnement physique afin de construire leur identité.
Le concept de lieu/identité (space-identity concept) met en parallèle l'interconnexion
entre environnement physique et environnement social, et la façon dont ils s’influencent
l’un et l’autre. Le concept vient de Proshansky et ses collaborateurs qui le décrivent comme
une « incorporation de l'espace dans la définition de l'individu » (Proshansky,
Fabian et Kaminoff, 1983: 60)188. Par ce concept, les auteurs appellent à aller au-delà de la
relation entretenue avec leurs maisons pour englober les sentiments, les significations, les
émotions et les relations associés à l'espace, et qui sont très souvent négligés dans les
études sur l'identité en sciences sociales (Proshansky, Fabian et Kaminoff, 1983: 58). Le point
de départ de leur réflexion est l’idée qu’il existe un lien entre le statut social des individus
et les sites sur lesquels leurs maisons sont situées. Cette hypothèse les a par la suite
conduits à penser l'espace, non comme un élément neutre qui ne ferait qu'exprimer
l'identité, mais comme une entité influant considérablement sur le processus même de
formation des identités (Proshansky, Fabian et Kaminoff, 1983). Harold Proshansky et ses
collègues définissent finalement l'espace comme une sous-structure de l'identité, au même
titre que le genre, l’ethnicité, les classes sociales et les classes d'âge (Proshansky,
Fabian et Kaminoff , 1983 : 57-58)189.
188 Dans ce sens, Harold Proshansky et ses collègues pensent que «the development of self-identity is not restricted to making distinctions between oneself and significant others, but extends with no less importance to objects and things, and the very spaces and place in which they are found. The subjective sense of self is defined and expressed not simply by one's relationship to other people, but also by one's relationships to the various physicalsettings that define and structure day-to-day life» (1983: 57-58).
189En définissant le concept de space-identity, Proshansky et al. écrivent que « Place-identity is a substructure of the self-identity of the person consisting of, broadly conceived, cognitions about the physical world in
281
La deuxième théorie qui sert de modèle explicatif est celle de l'identité processuelle
(identity process theory) formulée par Glynis Breakwell (1993, 1992, 1986, 1983), mais
appliquée sur les études relatives à l’espace bâti par Twigger-Ross et Uzzell (1996). Glynis
Breakwell systématise l'identité en termes d'organisme biologique, changeant à travers le
temps et l'espace, mais également à travers l'accommodation, l'assimilation et l'évolution du
monde social. Il élabore quatre principes qui semblent, selon lui, guider le processus de
formation identitaire : la particularité, la continuité, l'estime de soi et l'auto-efficacité
(Breakwell, 1986). Par ailleurs, la vision processuelle stipule que les individus apprennent
de leur environnement en utilisant leur compétence pour construire leur identité en rapport
avec ledit environnement (Twigger-Ross et Uzzell, 1996 : 206) dont la signification se
trouve en permanente renégociation. Il convient toutefois de noter que l'espace n'apparaît
chez Breakwell que comme une étiquette sociale éloignée de sa carapace physique (Hauge,
2007 : 10), et non comme une entité activement impliquée dans la création des sentiments
identitaires (Speller et al., 2002).
La théorie de l'identité processuelle de Glynis Breakwell a tout de même attiré
l'attention de nombreux auteurs (Devine-Wright et Lyon, 2009; Moore, 2002; Spencer,
2002; Twigger-Ross et Uzzel, 1996; Korpela, 1989) qui vont s’inspirer de ses quatre
principes pour repenser le rapport espace/identité. Ce sont surtout les principes du caractère
distinctif et de la continuité qui seront les plus utilisés, dans la mesure où ils rendent le
mieux compte du rôle important de l'espace et du lieu dans le maintien et le renforcement
des sentiments identitaires (Lien, 2009 :156). Twigger-Ross et Uzzel (1996) vont par
exemple s'en servir pour élaborer leur théorie de l'attachement au lieu (place attachment),
laquelle leur permet de défendre l’idée que les lieux sont une source importante d'éléments
d'identité, puisqu’ils possèdent intrinsèquement des symboles qui font sens et qui ont une
signification pour les individus (Twigger-Ross et Uzzell, 1996 : 206). Comme Breakwell,
Twigger-Ross et Uzzel considèrent l'identité individuelle comme le résultat d’une
négociation permanente qui se produit à travers l'attachement au lieu d'implantation de la
maison: « plus les individus sont attachés à leur environnement, plus ils maintiennent la
which the individual’s lives. These cognitions represent memories, ideas, feelings, attitudes, values, meanings and conceptions of behavior and experience which relate to the variety and complexity of physical settings that define the day-to-day existence of every human being» (1983: 59).
282
continuité des valeurs qui lui sont associées et plus ils développent et conservent une estime
de soi positive en relation avec cet environnement » (Twigger-Ross et Uzzell, 1996).
Si le concept du lieu-identité (space-identity concept) de Harold Proshansky et al.
(1983) voit l’espace comme une partie intégrante de l'identité individuelle, les théories de
l'identité processuelle (identity process theory) de Breakwell et d'attachement au lieu (space
attachment) le considèrent comme une partie des différentes catégories identitaires. Chez
Proshansky et al., le lieu est considéré comme une catégorie distincte des autres
composantes identitaires, alors que chez Breakwell, les autres catégories identitaires
revêtent plutôt une dimension physique. Les observations menées dans les monts Mandara
amènent à suivre Proshansky lorsqu’il postule l’idée que les individus utilisent l’espace pour
construire et communiquer leur statut social. Cependant, dans les monts Mandara, ces
divers objets ne remplissent ce rôle d’afficheur identitaire que lorsque la maison elle-même
est construite sur un site en altitude, car l’altitude est ici synonyme d’ascension sociale.
2. Site et sens, altitudes et ascension sociale
Les montagnards du Mandara ont développé un riche bagage de métaphores et
d'allusions à travers lequel le haut et le bas apparaissent comme des entités chargées de
symboles sociaux et identitaires (Chétima, 2010; Hallaire, 1991, 1975; Seignobos, 1984).
Les lieux élevés sont bénéfiques à la vie alors que les basses altitudes sont des endroits peu
propices et apparaissent comme des symboles de la peur, de la pollution et de la mort
(1975 : 22). Les hautes altitudes sont associées à l’idée de la pureté, de la bénédiction et de
la virilité; les plaines et les vallées représentent plutôt la brousse, cet endroit qui effraye et
cause le trouble et est donc intrinsèquement dangereux (Hallaire, 1991 : 47; Boutrais,
1973 : 76). En haut, se pratique le sacrifice aux ancêtres du clan et de la tribu en bas, se
pratique la sorcellerie (Hallaire, 1991 : 50)190. Cette distinction établie entre le haut et le bas
190 D'une façon générale, la relation entre les hommes et les puissances surnaturelles est d'autant plus intense que l'on approche des sommets (Hallaire, 1991: 50). C'est ici que les puissances surnaturelles qui président à la destinée des clans et groupes lignagers (divinités secondaires émanant du Dieu unique ou âmes des ancêtres) habitent. Chez les Mura, les arbres et les rochers qui font l'objet d'un culte se multiplient à mesure que l'on gravite la pente du mont Gude, et les informateurs décomptent jusqu’à neuf lieux de culte sur seulement deux arêtes les plus élevées du massif Gude. C'est sur l'une de ces crêtes que se trouve la tombe de l'ancêtre fondateur du clan. Chez les Podokwo d'Udjila, c'est aussi sur les hauteurs que se déroulent les cultes offerts aux ancêtres. La montagne de Mogode, point culminant des massifs d'Udjila, abrite deux lieux de
283
a laissé une empreinte indélébile sur le paysage architectural : elle régit d’une part les
hiérarchies entre les clans et lignages et d'autre part, les relations entre individus à
l’intérieur et à l’extérieur des murs de la maison.
Dans les trois groupes étudiés, on remarque que les clans prééminents, c'est-à-dire
ceux qui détiennent le pouvoir ou qui se réclament autochtones, habitent au-dessus de ceux
qui en sont dépourvus. Chez les Podokwo d’Udjila, le lignage de Ndabassaka est connu
pour s’être installé tardivement dans les massifs, et sont encore considérés comme des
allogènes191. À cause de leur installation tardive, les Ndabassaka se font appeler par
l'expression nda shəge qui veut dire : les gens du pied (entretien avec Bedje Barama,
homme de 58 ans, le 22 février 2007, à Udjila). Au plan topographique, on remarque
effectivement que ce clan habite au pied d'un massif en l'occurrence le massif dzaŋə
Mededeŋe. Le même principe gouverne l’occupation de l’espace chez les Muktele de
Baldama où les lignages royaux ont systématiquement colonisé les plus hauts sommets du
territoire muktele. Par contre, les vallées et les plateaux internes sont laissés vides, jouant
ainsi le rôle d' « espaces mitoyens » (Boutrais, 1979: 35).
Par ailleurs, dans les récits d’implantation des différents clans et lignages, les
informateurs mentionnent très souvent des conflits autour de l’occupation des sommets
ayant opposé entre eux des groupes montagnards. La tradition historique des gens d’Udjila
mentionne qu’à leur arrivée dans les massifs, ils se seraient d’abord installés sur les
piémonts de Slala-Məndaha, car les sommets étaient déjà occupés par des clans
autochtones, à l’instar des Cabana, des Kəlahəŋa et des Shakala (entretiens avec Namba
Malapa, homme de 57 ans, le 03 mars 2007, à Udjila; Mavaga Bouda, femme de 51 ans, le
23 février 2007, à Udjila). Devenus nombreux, les gens d’Udjila auraient provoqué des
conflits avec des groupes autochtones qu’ils vainquirent afin d’occuper leurs sites. S'ils ne
furent pas tous chassés du territoire, les autochtones durent néanmoins quitter les crêtes
cultes: l'un accueillant des sacrifices solennels accomplis annuellement dans le cadre des rites agraires et l'autre des sacrifices à l'occasion des évènements qui surviennent occasionnellement. 191 Les micro-migrations, conduisant un segment de lignage à quitter son lignage d’origine pour s’installer ailleurs dans les massifs, ont toujours été une constance dans les monts Mandara (voir Juillerat, 1971: 79). Lors de leurs installations sur un site déjà habité, les nouveaux venants occupent en général les parties basses (plateau et plaine internes) avant de défricher un sommet montagneux ou de faire la guerre aux autochtones s’ils s’estiment nombreux (voir aussi Hallaire, 1991).
284
montagneuses pour s’établir sur des piémonts, marquant ainsi topographiquement et
symboliquement la perte de leur pouvoir (Chétima, 2007).
Figure 39 : Quartier de Mogode à Udjila, situé sur une de nombreuses crêtes montagneuses que compte le village
Figure 40 : Maison de Tekuslem à Baldama, située sur un escarpement montagneux
285
Figure 45 : Maison de Kwetcherike à Dume, située sur un escarpement montagneux
La distinction entre le haut et le bas régit en outre l’emplacement topographique des
maisons des individus à l'intérieur d’un clan. La construction d’une maison sur une position
dominante est étroitement liée au fait d'exercer un pouvoir ou d'assumer une responsabilité
(Hallaire, 1975: 23). Les maisons des chefs sont ainsi situées en haut pour exprimer leur
pouvoir et leur prestige au sein de leurs différentes communautés. Les sommets étant les
lieux de communication privilégiés entre les hommes et les puissances de l'au-delà, c'est
naturellement là qu'habitent les principaux chefs religieux qui assistent quotidiennement le
chef du village dans ses fonctions religieuses. Les maisons des notables et des hommes
prestigieux, plus modestes que celles des chefs, sont aussi situées en haut pour créer et
augmenter leur réputation. Éminemment conscients de cette signification hiérarchique des
surfaces élevées dans la promotion sociale d’un individu, les chefs de lignages se sont le
plus souvent livrés à une sorte de bataille pour leur conquête en vue d’établir leurs
habitations. Revenons une fois encore à la tradition historique relative à l’installation du
clan udjila dans les massifs, car elle met en évidence cette relation entre site et pouvoir.
Lorsque les gens d’Udjila vainquirent les autochtones, plusieurs chefs de clan,
avons-nous dit, s’établirent sur les crêtes sommitales pour marquer symboliquement leur
286
prise de pouvoir. Seulement, Guləve qui était à cette époque le chef religieux et politique
du clan, était resté sur les piémonts pour présider aux rites claniques qui s’y déroulaient.
C’est après sa mort que les pouvoirs religieux et politique furent séparés et confiés
respectivement à deux de ses enfants, soient Dəgura et Zhaŋa192. Au premier fut échu la
conduite des rites religieux et au second la chefferie (Chétima, 2007). Le premier est resté
sur les piémonts alors que le deuxième s’installa sur le replat sommital le plus élevé
d’Udjila, à savoir le massif de Mogodé. Un mythe explique les raisons de la construction de
la maison du chef sur cette colline :
Un jour, pendant qu’il pleuvait dans la nuit, il se fit entendre un grand bruit venant du ciel semblable à un écroulement de montagne. Tout le monde fut effrayé car on se demandait ce qui c’était passé et ce qui allait advenir. Au petit matin, quelques vieillards montèrent sur la colline de Mogodé et aperçurent une pierre tombée du ciel. Elle beuglait comme un bœuf. Saisis de frayeur, ils consultèrent un devin pour savoir ce que cela voulait signifier. Celui-ci leur déclara que la pierre pouvait être à la fois un objet de bénédiction et de malédiction. Pour éloigner la malédiction, il leur recommanda de construire la maison du chef derrière la pierre193.
Il est vrai que le mythe met davantage l’emphase sur le bénéfice que les populations
pouvaient tirer de l’installation de la maison du chef non loin de la pierre mythique,
masquant plus ou moins les raisons sociales et identitaires. En expliquant le mythe, les
informateurs ajoutent toutefois qu’il était inapproprié de voir le chef habiter en bas, alors
que la plupart des chefs de lignages avaient leurs maisons établies en haut (entretien avec
Bassaka Kuma, homme de 70 ans, le 07 mars 2007, à Udjila). En quittant les piémonts de
Slala-Məndaha pour s’établir sur le replat sommital le plus élevé du village, il y a une
volonté de marquer la prééminence du chef sur les chefs de lignages et sur les autres
192 Il s’agit évidemment plus d’une tradition orale que d’une réalité historique, mais qui se rapporte tout de même au passé des gens d’Udjila en leur fournissant les raisons du déplacement de la maison du chef sur le site actuel. En tant que tradition orale, le récit revait une dimension mythique évidente, véhiculé de génération en génération et conservé sous une forme plus ou moins invariable selon les villages. Il fait aujourd’hui partie de la mémoire collective du clan udjila et sert de moyen de légitimation du passé. 193 Ce mythe m’a été raconté par plusieurs informateurs au cours de différents entretiens que j’ai eu avec eux sur le déplacement de la maison du chef vers le massif de Mogode. Si les versions diffèrent légèrement d’un informateur à un autre, le fond reste le même, à savoir rapprocher la maison royale de la pierre mythique de façon à attirer la bénédiction des dieux sur le clan. Parmi les informateurs-clés, je mentionne Mozogoum, Kouma Bassaka, Namba Malapa, Ussalaka Duluva et Mejəne Rəgwa. Les entretiens se sont échelonnés entre février 2007 et mars 2012 au cours de trois séjours différents passés à Udjila.
287
villageois. Une fois installé sur la colline de Mogodé, d’autres membres de la famille royale
rejoignirent le chef et construisirent leurs maisons en dessous de la maison royale (entretien
de groupe avec Bassaka Kuma, Namba Malapa et Ussalaka Duluva, le 03 mars 2007, à
Udjila).
Figure 42 : Maison du chef d’Udjila, située sur un replat sommital le plus élevé du quartier de Mogode
Il faut cependant signaler que ce dispositif initial est aujourd’hui brouillé par des
incessants mouvements des populations, qui rendent poreuse la hiérarchie topographique
entre clans. Néanmoins, même dans le contexte actuel, on observe qu'en dehors de toute
préséance clanique, les gens du haut se sentent privilégiés par rapport à ceux d’en bas. Chez
les Muktele, lors de la fête du madvadev qui rassemble les jeunes des différents villages,
Madjagola raconte que les gens de Zuelva adressent parfois des plaisanteries à ceux venant
de Baldama pour se moquer de leur position d’en bas (entretien avec Madjagola, homme de
60 ans, le 26 avril 2013, à Baldama).
288
Par ailleurs, j'ai évoqué dans le chapitre précédent des mesures administratives
prises dans les années 1960 qui imposèrent aux chefs de canton nouvellement promis de
s'installer au bas de leurs montagnes (Boutrais, 1973). Dans le contexte de cette injonction,
le chef Menegue de Zuelva fit construire une maison en contrebas de la montagne, mais il
n’y resta que quelques années d’une part en raison des conflits qui l'opposaient
régulièrement aux Wandala de Kerawa, et d’autre part, à cause de l'effritement de son
autorité sur les chefs des clans et lignages. D'après Madjagola, ces derniers avaient
l’habitude de se plaindre en se disant : « Comment quelqu'un qui habite en bas peut-il
commander, ceux qui habitent en haut? » (entretien avec Madjagola, homme de 60 ans, le
26 avril 2013, à Baldama). Autrement dit, il semble exister une incompatibilité entre
habiter en bas et exercer une autorité. Malgré la volonté des pouvoirs publics de faire
descendre les chefs, ceux-ci optèrent pour la plupart d'entre eux pour une double résidence
afin de répondre aux injonctions de descendre, tout en maintenant leurs prééminences sur
leurs populations194.
Suite à mes observations empiriques, je rejoins celles de Dominique Malaquais
(2002, 1994) qui constate que chez les Bamiléké de l’Ouest du Cameroun, le haut et le bas
dictent les conduites des individus à l’intérieur de la concession. C’est ainsi que dans
n’importe quel rassemblement, observe Malaquais, les hommes importants s’asseyaient
toujours en bas, c'est-à-dire « le plus près, fût-ce symboliquement, de la partie inférieure du
complexe » (2002 : 46). Mes recherches dans les monts Mandara ainsi que celles de
Dominique Malaquais amènent à voir l’espace, non pas comme un simple reflet de la
position sociale d’un individu, comme le pensent les tenants de l’approche de la
sémiologie, mais davantage comme un « agent de socialisation » (Giddens, 1984).
194 La représentation de l’espace qui accorde la priorité aux lieux élevés par rapport aux bas-lieux se trouve totalement à l’opposé de ce qui est observé chez les Bamiléké de l'Ouest Cameroun. Dans cette région, explique Dominique Malaquais (2002, 1994), c’est plutôt à la hauteur qu’est associée l’idée de l’impureté, de la pollution et de la pourriture, et à la bassesse l’idée de la pureté, de la jeunesse et de la croissance (Malaquais, 2002 : 44). Cette distinction entre le haut et le bas laisse ici également une emprunte évidente sur le paysage architectural bamiléké. Comme l’écrit Malaquais, « le statut social de ceux qui se situent aux échelons supérieurs de la hiérarchie sociale se manifeste topographiquement dans le fait qu’ils occupent les lieux les plus bas » (2002 : 48).
289
3. De la sémiologie de l’espace à l’espace comme agent de socialisation
Le haut et le bas apparaissent donc essentiels à la compréhension des relations
sociales entre clans et individus à l’intérieur d’un village et du rapport que les individus
entretiennent avec leur maison. Entités physiques certes, mais ils figurent également
comme des éléments particuliers de l'espace social, des lieux socialement construits et
teintés d'idéologies (Kuper, 1972: 420). Comprendre l’attachement des gens à leur espace
domestique nécessite la prise en compte de la maison et d’un large éventail des lieux situés
en dehors de ses murs physiques. Je pense notamment au site d’habitation, à la situation de
la maison au sein de la communauté d'appartenance, etc. En cela, je rejoins Amos Rapoport
qui considère le choix du lieu d'habitation comme intimement lié à la quête d'un idéal
traduit en images de good life (Rapoport, 1969) et qui oriente activement le comportement
des gens par rapport à leurs maisons (Rapoport, 1973 : 406). Il est évident que les
montagnards des monts Mandara privilégient le haut par rapport au bas pour la construction des
maisons parce qu’il correspond à l'image qu’ils se font d'eux-mêmes. Dans cette
perspective, l’espace en tant que symbole l’emporte sur l'espace en tant qu’entité physique
et naturelle, car c’est bien le meaningfulness (Miller et Tilley, 2011; Miller, 1998) de
l’espace qui détermine et oriente les relations sociales et l'identité des gens qui interagissent
avec lui.
Plusieurs auteurs (Kent, 2000; Lawrence, 2000; Kuper, 1972) mettront en avant cet
aspect poétique (Bachelard, 1957) et symbolique (Rapoport, 1973) et inscriront leur analyse
de l’espace à l’intérieur de l’anthropologie symbolique. Ils vont éloigner l’espace de ses
carapaces matérielles pour l’étudier comme un texte porteur d'une signification dont le
décodage permet la lecture des identités sociales (Tilley, 2004). Désormais ce qui compte le
plus n’est pas la dimension physique ou matérielle de l’espace, mais davantage la valeur de
signe et d'indicateur sociale des individus qui leur est associée. Pourtant, l’observation des
évènements présentés ci-dessus montre que les valeurs ont nécessairement besoin d'une
dimension physique et tangible. Elles ne font sens que lorsqu’elles s’adossent à l’aspect
physique et matériel de l'espace, qui est en fait la matrice sur laquelle elles sont mises en
œuvre. Le constat ainsi fait m’éloigne un peu des acquis de la sémiologie sans toutefois
m’en écarter.
290
En posant la question de la signification du haut et du bas, je me suis surtout
intéressé à voir comment les valeurs qui leur sont associées affectent considérablement le
rapport des personnes vis-à-vis de l’extérieur de la maison et de l’intérieur de celle-ci. À
l’extérieur, la position de la maison en altitude témoigne de l’appartenance d’un individu à
une classe sociale élevée. Dans ce sens, la bataille pour la conquête des sommets signalée
par Antoinette Halaire (1991) et par Christian Seignobos (1982) ne peut être comprise que
lorsqu’on considère le rôle important que joue l’altitude dans la psyché collective des
montagnards. À l’intérieur de la maison, l’image du haut et du bas oriente aussi les rapports
sociaux entre les membres du même ménage. Dans la mesure où les maisons dans les
monts Mandara possèdent une exposition vers le haut et une autre vers le bas, la partie
haute est considérée comme le domaine de l’homme alors que la partie la plus inférieure est
réservée aux femmes et aux enfants en bas âge. Cette règle prévaut en outre lors des
cérémonies (baptême de l’enfant, sacrifice annuel aux ancêtres, funérailles, etc.) réunissant
les membres du ménage. Les hommes s’asseyaient toujours dans la partie haute et les
femmes se rencontraient en bas, c’est-à-dire dans la partie la plus basse de la maison. Aussi,
à l’occasion de l’enterrement d’un mort, les tombes des hommes importants se trouvaient
devant l’entrée principale de la maison, c’est-à-dire dans sa partie la plus en hauteur. Les
femmes, les enfants et les hommes de moindre importance étaient en revanche inhumés
dans des cimetières situés en dehors de l’espace habitable du village, en général dans les
plaines et les plateaux internes (Hallaire, 1991).
De telles observations obligent à élargir les limites de la sémiologie pour considérer
l'espace comme un agent de socialisation (Giddens, 1984) qui produit activement les
identités. Dans ce contexte, le site d’habitation cesse d’être un réceptacle neutre et passif,
pour devenir «une métonymie, un modèle qui oriente activement les modes de pensée et les
rapports sociaux» (Malaquais, 2002: 9). Il cesse d’être un décor dans lequel les gens
expriment leur identité, et en devient une partie intégrante. Il cesse en outre d’être un
langage du silence dans le sens utilisé par Edward Hall (1966, 1959), et devient à des
degrés divers « nourricier ou contestataire des ordres sociaux » (Spencer, 2002). Les
valeurs associées à l'espace sont si ancrées dans les pratiques de la vie quotidienne qu’ils
291
finissent finalement par habiter les individus qui les habitent (Turgeon, 2009 : 343)195.
De ce point de vue, je me réclame de Proshansky et al. qui, grâce à leur concept du
lieu-identité (space-identity concept), soulignent l'importance de l'environnement physique
comme un facteur essentiel pour la communication de l'identité des gens (Gustafson, 2009;
Grauman, 1983). Harold Proshansky postule qu’il serait inapproprié de concevoir l'identité
hors du processus interactionnel entre l'individu et son environnement tant physique que
social, car le lieu est ici un élément prépondérant à la construction de l'identité. Toutefois, au
lieu de définir horizontalement l'espace comme une catégorie identitaire au même rang que
le genre, l'ethnicité et le statut social (Proshansky et al.), il est plus utile de le considérer
verticalement comme un élément important sur lequel les autres catégories identitaires
(ethnicité, statut social, genre, etc.) s’expriment et font système avec lui. Dans ce sens, les
constructions et les modèles proposés par Breakwell dans sa théorie de l'identité
processuelle (Breakwell 1986, 1983) peuvent être utilisés pour recadrer la réflexion émise
par Proshansky. Elles permettent en effet d’éviter le piège du déterminisme physique et de
considérer le rôle de l’espace dans la structuration (Giddens, 1984) et l’orientation
(Hoskins, 2006 : 74 ; Tan, 2001 :170) des rapports sociaux. Ces observations m’amènent
finalement à conclure avec Christopher Tilley que les formes matérielles de la maison « ne
sont pas simplement le reflet préexistant des distinctions sociales, des ensembles d'idées ou
des systèmes symboliques, elles constituent une des caractéristiques qui définissent l'être
humain » (2006: 61)196. On pourrait aller plus loin en suggérant à la façon de Suzanne Blier
(1983) qu’elles possèdent des attributs humains, et en tant que tels, possèdent leurs propres
biographies qu’il est possible de reconstituer (Turgeon, 2009 : 347).
195On est donc ici à la croisée des chemins entre la sémiologie et la praxéologie, entre la valeur-signe de l'espace dans un système de communication d'une part, et la valeur-signe dans un système d'action réciproque des individus sur l'espace et de l'espace sur les individus (Warnier, 2009). D’où toute la signification du dicton déjà populaire : «Montres-moi où tu as bâti ta maison et je te dirai quelle place tu occupes dans la société».
196 Pour les Batammaliba, écrit Suzanne Blier, la maison une fois complétée, est assimilée à un bébé qui vient de naitre (1983 : 373). Au cours de son cycle de vie, elle est à mesure de grandir, de respirer et de se déplacer. Avec des soins appropriés, les maisons, tels les humains, peuvent avoir une espérance de vie pouvant atteindre 56 ans (ou dix cycles d’initiation). A cet âge, tels les humains, elles sont appelées à « mourir pour donner naissance à une autre, construite avec le tissu de la vieille » (Blier, 1983 : 373).
292
B. Maison en tant que modèle du corps humain et problématique de l’anthropomorphisme
Depuis les travaux fondateurs de Marcel Griaule sur les villages dogons (1954),
l’approche anthropomorphique de la maison a représenté une avenue intéressante dans
l’étude de l’architecture africaine. Elle a été utilisée par de nombreux auteurs (Malaquais,
2002, 1994 ; Fassassi, 1997 ; Blier, 1987, 1983 ; Lebeuf, 1961 ; Griaule, 1957) pour
étudier le rapport entre corps et architecture, et dans leurs études se dégagent trois
modèles. Le premier modèle, représenté par les travaux de Marcel Griaule (1954), a pour
point focal l’interconnexion entre village, corps et cosmos. À travers ses analyses de
l’architecture dogon, Marcel Griaule (1954) montre que l’ordonnancement des villages
découlait de leur conception de l’univers, de la ville et de l’homme ici considérés comme
identiques. De fait, un village dogon constituait à la fois un modèle élargi du corps humain
et un modèle réduit de l’univers. Il s’étendait du nord au sud comme un corps d’homme
couché sur le dos : au nord était placée la forge qui, en tant que symbole du forgeron
civilisateur, représentait la tête ; les maisons des femmes en état de menstruation étaient
situées à l’est et à l’ouest pour représenter les mains ; au centre étaient localisées les
grandes maisons de famille personnifiant la poitrine et le ventre, et enfin au sud se
trouvaient les autels communs représentant les pieds. L’autel de sacrifice, qui symbolise
l’organe géniteur de l’homme, était placé à l’extérieur des murs du village, et par le jeu des
correspondances, il représentait l’axe central subdivisant le village en deux régions (le nord
et le sud) (Griaule, 1975). Tout en constituant le modèle élargi du corps humain, le village
dogon était aussi, d’après Griaule, le rabattement du monde sur le plan terrestre avec
l’homme pour pôle central (1954)197.
Le deuxième modèle vient des travaux de Suzanne Preston Blier (1987 ; 1983) sur
les Batammaliba du Togo. Contrairement aux Dogon et aux Sao où la structure du village
intègre le modèle du monde et de l’homme, c’est l’espace intérieur de la maison qui
intègre le corps humain chez les Batammaliba. Ici la maison devient une métaphore 197Le lecteur pourra aussi se référer à l’ouvrage d’Alabi Fassassi sur l’architecture sao qui offre une analyse similaire à celles effectuées par Marcel Griaule chez les Dogon et par Blier chez les Batammaliba. Comme chez les Dogon, la structuration des villages sao est une représentation microscopique de leur conception du cosmos et de l’homme. La ville sao est aussi un monde dans un monde, et dans le même ordre d’extrapolation, l’homme est un monde dans la ville ayant pour centre son organe géniteur (Fassassi 1997 : 33).
293
corporelle dans la position naturelle d’un homme debout sur la terre, formant deux axes
perpendiculaires autour d’une centralité (Blier, 1983 : 374). Le bloc d’entrée situé au
centre de la façade principale représente la tête. Deux orifices identiques et ronds percés
au-dessus de la porte sont considérés comme « les yeux de la maison » (Blier, 1983 : 374-
375). Le ventre est symbolisé par la maison des ancêtres que l’on trouve au centre. L’autel
de la fondation personnifie l’organe géniteur de l’homme, et est placé aux pieds de la
façade principale (Blier, 1983 : 374). Enfin, les murs qui ceinturent la concession sont
couverts de scarifications évoquant la peau et la beauté de la femme (Blier, 1983 : 377).
Le troisième modèle d’analyse est fourni par Dominique Malaquais (2002, 1994)
dans ses travaux sur le rapport entre architecture et pouvoir chez les Bamiléké de
Bandjoun, une ville située à l’ouest du Cameroun. Comme chez les Taberma et les Dogon,
les Bamiléké considèrent la maison et le corps comme deux entités identiques et
interconnectées. Une différence fondamentale particularise cependant
l'anthropomorphisme bamiléké. Contrairement aux deux premiers modèles où la maison
représente le corps humain dans son intégralité, le modèle anthropomorphique bamiléké
est plutôt un recueil de pièces disparates (une tête, un estomac, une bouche) ayant un
rapport direct avec la quête du statut social (1994 : 22). Dominique Malaquais s’intéresse
particulièrement au rapport entre ce que les Bamiléké appellent estomac de la maison et la
montée d’un individu dans la hiérarchie sociale. De même que la croissance d’une
personne est la preuve que son estomac a grandi, la demeure d’un individu s’élargit au fur
et à mesure que celui-ci monte dans la hiérarchie sociale (Malaquais, 1994 : 25).
Deux des trois approches anthropomorphiques retiennent notre attention dans la
mesure où d’une part, la maison comme modèle du corps humain se rencontre chez les
Mura et d’autre part, l’anthropomorphisme, comme recueil de pièces disparates (une tête,
un estomac, une bouche), se rencontre chez les Podokwo et les Muktele198.
198 Le village comme modèle réduit de l’univers et du corps se rencontre cependant chez d’autres peuples dans cette vaste région, notamment chez les Fali. Dans son étude sur l’habitation de ce peuple, Jean-Paul Lebeuf décrivait la maison comme une femme couchée sur le dos que féconde un homme (1961 : 523).
294
1. « Les maisons sont aussi des humains » : maisons et images de la fécondité chez les Mura
Dans la logique de la conception de l’espace associant la hauteur au prestige, j’ai
montré que les structures appartenant à l’homme se trouvent toujours dans la partie haute
de la maison. Il y a cependant une exception à cette règle, à savoir la présence du grenier
central, élément masculin, dans la partie basse de la maison, élément féminin. Alors qu’on
pourrait voir en cela une contradiction, Dəgla insiste sur le fait que la présence de cet
élément masculin dans la partie basse traduit la puissance virile de l’homme. Selon cet
informateur, le père de la famille est « au-dessus de toute la famille », car il est « la
personne qui donne naissance aux descendants » (entretien avec Dəgla, homme de 80 ans,
le 17 novembre 2011, à Dume). Placé au centre de la maison, le grenier central devient une
représentation de son pouvoir sur les femmes et sur le mil (entretien avec Dagabou, homme
de 50 ans, le 03 juin 2012, à Dume). Cette explication n’est pas satisfaisante à première
vue, car elle contredit la symbolique de l’espace développée dans la partie précédente. Elle
a tout de même fourni une piste intéressante pour étudier les désignations symboliques du
grenier, lesquelles permettent d’avancer l’hypothèse que la présence du grenier central dans
la partie basse de la maison est à mettre en lien avec l’idée de la fécondité199.
Bien que les informateurs mura ne connectent pas le grenier à la grossesse, la
relation entre grenier et fertilité est soulignée. Elle s’articule par exemple lors des sacrifices
effectués au pied du grenier central sous lequel sont entassés les pots ancestraux (gerda
lay). Rappelons que lorsqu’un patriarche décède, il était enterré à l’entrée de la concession.
Dəgla (homme de 80 ans, entretien, le 17 novembre 2011, à Dume) explique qu’en réalité,
l’homme de la maison devrait être enterré au pied du grenier central, car il est la tête de la
famille de même que le grenier central est la tête et le poteau central de la maison. Dans la
mesure où l’espace intérieur est trop restreint pour accueillir la foule pendant les
funérailles, le père de la famille se faisait plutôt inhumer à l’entrée de la maison. Une année
plus tard, lors des dernières funérailles, un pot dans lequel résidera son âme lui est fabriqué
et placé symboliquement sous le grenier central. Tout sacrifice concernant la survie des
199 Dans son analyse sur les greniers de l'Afrique de l'Ouest, Labelle Prussin (1972) avait déjà avancé l’idée que la construction du grenier au centre de la concession reflétait le rapport entre la fertilité du sol et la fertilité de la famille. Dans cette correspondance, Prussin note que les greniers étaient une expression formelle de la grossesse elle-même.
295
enfants malades au sein de la maison, l’abondance des récoltes et la fertilité des femmes
doit se tenir au pied du grenier sous lequel se trouvent les gerda lay (entretiens avec
Dagwene, homme de 82 ans, le 14 novembre 2011, à Dume; avec Aje, femme de 70 ans, le
07 juin 2012, à Dume).
En considérant le rapport entre le grenier central et les sacrifices attribués aux gerda
lay aussi considérés comme la force vitale de la famille, il est possible, comme c’est le cas
chez les Tallensi du nord du Ghana étudiés par Labelle Prussin (1972) et chez les Musgum
du Nord-Cameroun étudiés par Steven Nelson (2007), que l'emplacement du grenier
masculin au centre de la maison soit une allusion à la puissance virile de l’homme. Sous le
grenier central, avons-nous dit, sont entassés les pots ancestraux, qui par leur virilité,
fécondent les femmes et les récoltes. Considéré comme la tête de la maison et comme le
poteau central, le grenier central se dresse au milieu de deux autres greniers masculins
représentant les testicules de la maison (entretien avec Dəgla, homme de 82 ans, le 07
novembre 2011, à Dume). Tous les trois se retrouvent dans la partie basse et constituent la
première étape dans la mise en place d’une habitation. De la même manière que les enfants
proviennent de la puissance virile masculine, les autres parties de l'habitation proviennent
de ce poteau central et de la puissance virile des gerda lay placés sous le grenier. De la
puissance virile de l’homme et des ancêtres dépendra l'extension de la maison (entretiens
avec Kwona, homme de 65 ans, le 19 novembre 2011, à Dume; avec Maryam, femme de
55 ans, le 14 novembre 2011, à Dume), qui, à son tour, constituera le premier signe de
l’honorabilité de l’homme au sein de la société.
La symbolique de la fécondité est à l’œuvre dans la société mura, comme chez les
Fali, telle que décrite par Jean-Paul Lebeuf200. Mais contrairement aux Fali chez qui la
symbolique apparait dans l’usage des matériaux, elle est plutôt mise en rapport avec la
répartition du temps en deux saisons chez les Mura, soient : une saison sèche, période mâle
200 La symbolisation de l'union des principes masculin et féminin était à l'œuvre dès la construction de la maison fali par le biais de la symbolique des matériaux utilisés : la pierre sèche, élément mâle, était utilisée pour construire le domaine de l'homme, alors que l'argile humide, élément féminin, entrait dans la construction des structures situées dans la partie basse de la maison (Lebeuf, 1961 : 520). Dans la même veine, la construction des cases d'argile, éléments femelles, que recouvrent les toitures en tiges de mil, éléments mâles, renforçait l’idée symbolique du rapport entre maison et fécondité. Finalement, Jean-Paul Lebeuf compare la maison à un couple procréant (1961 : 523).
296
et une saison pluvieuse, période femelle, dont la combinaison donne naissance aux récoltes
agricoles (entretien avec Dəgla, homme de 80 ans, le 17 novembre 2011, à Dume). De la
même manière, la maison est organisée en deux domaines : une partie mâle, essentiellement
en pierres sèches symbolisant la sècheresse de l'homme, et une partie femelle construite à
base d'argile pétrie dans de l’eau, symbole de l'humidité féminine (entretien avec Kwona,
homme de 65 ans, le 19 novembre 2011, à Dume). Le centre de la maison, désignant
symboliquement le sexe de la femme, est représenté par l'espace circulaire englobant les
greniers, les cases et les cuisines des épouses. La tête de la maison, désignant en langage
symbolique le sexe masculin, est représentée par le grenier de l’homme201. À partir des jeux
de correspondance, on peut émettre l’hypothèse que chez les Mura, la présence du poteau
central au centre de la maison est une allusion voilée à l’union sexuelle entre un homme et
une femme, d’où le fait qu’une maison parvenue à son optimum connote une intense
activité sexuelle202.
Les Mura n'associent pas seulement leurs maisons à la fécondité, mais aussi à
l'aspect psychologique (l'âme) de leur personne. En effet, l’aspect psychologique ressort
dans les diverses formes de thérapie dans lesquelles la maison est parfois partie prenante.
Par exemple, la maison intervient régulièrement dans le processus thérapeutique des
maladies liées aux possessions démoniaques. Dans l’imaginaire mura, le corps physique
d’une personne, de même que le corps physique de la maison, peut abriter des mauvais
esprits créant un déséquilibre aussi bien entre le corps et l’âme de la personne que dans le
processus du développement architectural. Autrement dit, la possession démoniaque d’une
201Chez les Mura, comme chez la plupart des sociétés montagnardes du nord-Cameroun, il n'est pas autorisé à un humain d’épeler les organes sexuels par leurs noms dans des discours publics, car cela s'apparente à de l'impudeur très mal vue au sein de la société. La pudeur recommande de leur trouver des correspondances symboliques. Dans ce sens, le terme ventre de la maison dans le langage symbolique montagnard ne correspond pas au plan anatomique au ventre. Il désigne métaphoriquement le sexe féminin, de même que le grenier, symboliquement appelé tête de la maison, désigne le sexe mâle. Voir aussi (Lebeuf, 1961 : 519-540) pour une description détaillée des correspondances symboliques entre les organes génitaux humains et les parties sexuelles de la maison.
202 Ces observations rejoignent celles faites par Suzanne Blier sur la maison des Taberma au Bénin qu’elle compare à des humains (1987), possédant des caractéristiques masculines et féminines dont l’union aboutit à la fécondation de la maison et des individus qui y vivent (1983 : 379-380). Par ailleurs, lors de rituels marquant la célébration des funérailles des personnes âgées, remarque Suzanne Blier, le chef de la maison est tenu de verser sur le seuil quelques grains de mil pris dans le grenier. Cet acte symbolique est une invite à l'âme de la personne décédée de quitter la maison pour regagner le monde des ancêtres localisés à l'entrée. Chaque maison, conclut Blier, incorpore à travers ses structures corps et âme, tous deux essentiels pour assurer l'équilibre sexuel et mental de l’occupant (1983 : 382).
297
personne affecte le processus du développement de la maison, de même que la possession
d’une maison par les esprits mauvais affecte l’équilibre mental de la personne. Dans ce
sens, le traitement d’une maladie d'ordre mental impliquait, à la fois, la médication de la
personne malade et l'altération partielle ou complète de sa case (entretiens avec Dagwene,
homme de 82 ans, le 13 novembre 2011 et le 03 juin 2012, à Dume; avec Dawcha, homme
de 58 ans, le 17 mai 2012, à Mora-Massif). Dans certains cas, il peut entrainer l'abandon
total de la maison et l’établissement du propriétaire sur un nouveau site (entretien avec
Dawcha, homme de 58 ans, le 17 mai 2012, à Mora-Massif). L’exorcisme du malade seul
ne suffit donc pas, il faut lui adjoindre l’exorcisme de la maison car celle-ci est susceptible
d’abriter le mauvais esprit, qui le rendrait capable de hanter à son tour la victime. En
revanche, en détruisant la maison et en la reconstruisant sur un nouveau site, il y a non
seulement l’impossibilité pour le « mauvais esprit » de posséder à nouveau sa victime, mais
la possibilité pour la victime de voir s’équilibrer la balance entre son corps et son âme203.
Ainsi l’équilibre physique et moral d’une personne est indispensable pour le
développement de la maison tout au long de son cycle de vie. Inversement, l’équilibre entre
l’aspect physique et l’aspect psychologique de la maison permet l’ascension sociale de son
propriétaire. Dans cette perspective, la désharmonie entre corps et âme de la maison influe
sur le bien-être physique et psychologique de l’individu qui peut, à son tour, influer sur la
croissance de la maison. La réussite sociale d'une personne est dès lors tributaire, à la fois,
de son équilibre physique et moral, lequel lui permet de prendre soin de sa famille, et du
bien-être physique et psychologique de la maison qui, en retour, protège ses occupants
contre les forces occultes. L’attribution des caractéristiques humaines à la maison ne
renvoie pas simplement à un anthropomorphisme passif. Elle est lieu de vie, comme le
souligne justement Malaquais (2002 : 117-135), capable elle-même de produire d’autres
vies204.
203 Voir aussi Suzanne Blier (1987 ; 1983) pour une analyse plus ou moins similaire de l’importance de la maison dans le traitement de certaines maladies chez les Batammaliba du Bénin. 204Cette conclusion rappelle l’étude réalisée par Christopher Tilley (2002) sur les implications sociales et symboliques du canoë wala au Vanuatu. Tilley remarque que les Wala ont investi, inscrit et incorporé des propriétés sensorielles humaines à leurs canoës en y sculptant des organes comme des oreilles, des bouches et des moustaches, et en dotant la poupe et la proue de ces embarcations d’organes féminins ou masculins (2002 : 53). Pour Tilley, « le pouvoir de cette métaphore réside dans ses références aux qualités tactiles et sensuelles ainsi que dans ses relations au corps humain » (2002 : 25). En tant qu’humain, le canoë et son usage
298
Ceci permet d'expliquer pourquoi les Mura interprètent la différence entre une
grande maison et une petite maison comme le résultat de l’équilibre (ou du déséquilibre) de
la personne et de la maison elle-même. Rappelons que la réussite sociale est
intrinsèquement liée au fait d'avoir un nombre considérable d'épouses et de les maintenir
dans la maison d'une part, et d'avoir un nombre considérable d'enfants survivants d'autre
part. Or, les Mura butent habituellement sur deux obstacles majeurs sur le chemin de la
réussite. Le premier est la forte propension des femmes au divorce (Vincent, 1980; 1972;
Juillerat, 1971), et le deuxième est le taux élevé de la mortalité infantile (Hallaire, 1976).
D’une part, la mobilité des femmes remet en cause la capacité de l'homme à bien gérer sa
maison et questionne par conséquent son équilibre moral205. D’autre part, la mortalité
infantile, toujours attribuée aux attaques sorcières, remet en cause l'équilibre psychologique
de la maison. Dans cette perspective, une grande maison, c'est-à-dire une maison qui abrite
plus de quatre quartiers206, est considérée à la fois comme le résultat de la capacité de
l'homme à prendre soin de la maison et de la capacité de la maison à assurer la survie de ses
membres contre les attaques sorcières et les possessions démoniaques207. Illustrons cela par
deux maisons au parcours de vie différent soient : la maison de Kwona en guise d’exemple
de la ligne idéale qui mène à la réussite, et la maison de Madu en tant qu’exemple de
l'échec d’un individu dans l’ingénierie sociale208.
Kwona a épousé sa première femme quand il avait seulement 20 ans209, pendant
qu'il vivait encore dans la maison paternelle. L’année où sa femme conçut leur premier fils
deviennent un vrai véhicule du pouvoir, et révèlent les relations sociales qu’ils créent, notamment la relation entre l’homme et la femme. Le pouvoir de l’homme par rapport à celui de la femme est généré par l’imagerie ouverte du canoë, et la distinction entre le haut et le bas (2002 : 51). Plus qu’un simple symbole, le canoë devient alors un médium pour exprimer les contacts sociaux, un agent qui possède la force de « dire ce dont on ne peut pas dire ou écrire » (Tilley, 2002 : 28 ; 1991). 205 Sur la fréquence des divorces dans les monts Mandara, voir des études menées par Jeanne-Françoise Vincent chez les Mofu (1990, 1980, 1972) et par Bernard Juillerat (1971, 1968) chez les Muktele. Les témoignages que j’ai recueillis chez les Podokwo, Muktele et les Mura rejoignent amplement les conclusions de Vincent et de Juillerat. 206 Voir glossaire sur la signification du terme quartier de la maison dans le vocabulaire montagnard. 207 Voir à ce sujet Jeanne-Françoise Vincent (1990). 208 La plupart des informations fournies dans ces deux tranches de vie ont été obtenues suite à des entretiens que j’ai eus avec Kwona (pseudonyme) et Madu (pseudonyme) en novembre 2011 et en juin 2012 dans le village de Dume. Ces informations sont complétées par des données d’entretiens avec d’autres informateurs habitant le même village, notamment Daugwene, Dəgla, Dagabou, Maryam et Lamise au cours de mes deux séjours en novembre 2011 et en juin 2012. 209 Une date à situer approximativement à la fin des années 1950 si on considère l’âge approximatif de 60 ans fourni par Kwona au moment de mon séjour de recherche à Dume en novembre 2011.
299
Dama, Kwona déménagea de chez son père pour construire sa propre maison composée
initialement de deux quartiers pour épouses. À ce stade, les Mura considèrent la maison
comme à sa première période de vie, car une maison n’est jamais censée contenir un seul
quartier, à moins d’être la maison d’un vieillard (entretiens avec Dagwene, homme de 82
ans, le 14 novembre 2011, à Dume; avec Dəgla, homme de 80 ans, le 14 novembre 2011, à
Dume)210. Toujours dans la vingtaine, Kwona épouse une deuxième femme pour occuper le
deuxième quartier qui logeait jusque-là la plus jeune épouse de son père. Entré dans la
trentaine, Kwona épousera encore une nouvelle femme tout en maintenant les deux
premières au sein de la concession. Il construisit dès lors un autre quartier pour abriter la
nouvelle femme, c’est-à-dire sa case à coucher, sa cuisine et son grenier.
Kwona devenait ainsi propriétaire d'une maison à trois quartiers comportant de
nombreuses autres structures masculines, notamment des greniers, des vestibules, des
enclos à bétails et une case abritant son premier fils déjà pubère, éléments qui constituent la
respectabilité. Cette phase du développement de la maison est celle d'un homme bien établi,
mais ne jouissant pas encore d’un statut social enviable. Dans ses 40 ans, la première
femme de Kwona quitte la concession en raison de la venue d’une troisième épouse, mais
laisse derrière elle ses trois enfants qui continuèrent d’occuper le domaine réservé à leur
maman211. L’année suivant le divorce, Kwona contracte un nouveau mariage et construit un
autre quartier pour accueillir la nouvelle femme. Sa maison est désormais à quatre
quartiers, et ce genre de maison, déclare Dəgla, n'appartient en réalité qu'aux gens
distingués, c’est-à-dire à ceux, qui par le biais de leur maison, ont gagné la reconnaissance
sociale au sein du village.
210 Tel un humain, les Mura considèrent que la maison évolue en trois phases avant de régresser pour devenir une habitation de vieillard, correspondant ainsi aux trois phases du développement humain (enfance, adolescence et adulte). 211Une étude réalisée par Jeanne-Françoise Vincent sur l’initiative de divorce prise par les femmes en raison de la polygamie excessive de leur mari montrent que cela n’est pas un cas isolé aux Mura. Dans le groupe ethnique mofu où elle a menée ses enquêtes, cette auteure fournit révèle des cas de femmes qui se sont farouchement opposées à la venue d’une deuxième ou d’une troisième épouse (Vincent, 1972 : 314). La forme de résistance la plus extrême, estime-t-elle, est la menace de quitter définitivement le foyer et de se remarier à un autre homme, en général dans un autre village. Ses enquêtes menées au début des années 1970 établissent ainsi que 334 femmes ont eu dans leurs vies 428 maris (voir Vincent, 1972 : 316), taux beaucoup moins élevé que celui obtenu par Bernard Juillerat (1968) chez les Muktele qui estime à près de 40% le nombre de femmes ayant eu au moins deux maris au cours de leur existence. Ces taux sans doute déjà élevés l’auraient été plus encore, estime Jeanne-Françoise Vincent, n’eut été la croyance en des « esprits d’ancêtres, chargés expressément de frapper de maladie, à la demande d’un mari inquiet, l’épouse cherchant à le quitter » (Vincent, 1972 : 318).
300
C'est vraisemblablement à partir de cette période que Kwona est devenu un homme
distingué dans le village. Désormais, un grand fossé s'est installé entre lui et la majorité des
hommes de son âge: « Kwona a une maison remplie des femmes et d’enfants. Sa
descendance ne disparaitra pas un jour, car les entrailles de ses femmes sont fertiles et sa
maison aussi est fertile » explique Mahama (entretien, homme de 47 ans, le 14 mai 2012, à
Mora-Massif), un Mura déjà parvenu dans la cinquantaine et habitant les piémonts de
Mora-Massif. L'importante production en mil et le nombre important de bétails autorisent
Kwona à donner son opinion sur toutes les questions relatives à la vie du village, comme
l’explique Dəgla :
Il prend toujours la parole le dernier quand tout le monde a donné son opinion. Après lui, personne d'autre ne peut à nouveau parler, car qui peut prononcer des bonnes paroles comme Kwona? C'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Ses enfants ont construit leurs maisons et ses greniers toujours remplis avec les récoltes des années précédentes (entretien avec Dəgla, homme de 80 ans, le 14 novembre 2011, à Dume).
Au moment des recherches sur le terrain, Kwona dit avoir soixante-cinq ans et est
donc à l'apogée de sa force sociale. Ses femmes et ses enfants déjà mariés ont commencé à
le quitter. En effet, à partir de cet âge, les Mura pensent que l’individu a entamé ses
dernières années d’existence et que sa vigueur commence progressivement à diminuer, d’où
le choix des épouses de Kwona, beaucoup plus jeunes que lui, de divorcer pour se remarier
à d’autres hommes. Ce qui est intéressant de souligner est le fait que les informateurs ne
blâment pas ces choix de divorce. Au contraire, ils tentent de les justifier, non seulement
par l’âge avancé de Kwona, mais aussi parce que la durée de vie de la maison qui est aussi
entamée, parce qu’ayant vécu plusieurs étapes au cours de sa vie. Autrement dit, dans le
mouvement d’ensemble qui lie la maison et son occupant, les femmes tiennent un rôle
important : d’une part, elles garantissent l’ascension sociale du chef de famille aussi bien
que la croissance de la maison, et d’autre part, elles provoquent à partir d’un certain âge, la
fin du cycle de vie de la maison en quittant leur époux pour se remarier. La maison reflètera
dans ce cas, « l’âge de son propriétaire, et ressemblera un peu à la mienne » (entretien avec
Dagwene, homme de 82 ans, le 14 novembre 2011, à Dume). La maison de Kwona
comporte toujours quatre quartiers, mais son avenir dépendra désormais de la fécondité de
301
son fils Dama, car « plus il sera fertile comme son père, plus la maison sera aussi fertile
(entretien avec Mahama, homme de 47 ans, le 14 mai 2012, à Mora-Massif). L’histoire de
Kwona montre qu’il a suivi la ligne idéale qui mène à la réussite et au prestige social. Son
âge biologique est donc en corrélation avec la superficie occupée par sa maison. Les Mura
pensent que tout adulte de plus de 50 ans doit idéalement avoir une maison à quatre
quartiers. Seulement, très peu y parviennent en raison de la mortalité infantile et du taux
des divorces relativement élevé.
Comme Kwona, Madu est dans la soixantaine, mais sa maison ne reflète pas son âge
biologique. Elle est située juste en contrebas de la maison de Kwona et ils appartiennent
tous deux à la même lignée. Kwona et les autres Mura de leur génération citent la maison
de Madu comme l’exemple de l'échec d’un individu dans l’ingénierie sociale. Pour cause,
sa maison est restée coincée entre la phase 1 et la phase 2 du cycle de vie d'une maison
normale. Comme Kwona, Madu a épousé sa première femme lorsqu'il n'avait que 20 ans, et
a construit sa maison à deux quartiers (phase 1) immédiatement après la naissance de son
premier fils. Malheureusement ce dernier n'a pas survécu et sa femme dut le quitter
immédiatement après le décès de l'enfant; la mortalité infantile étant ici attribuée à la
sorcellerie au sein de la maison (voir Lyons, 1992). Autrement dit, on pourrait émettre
l’hypothèse que cette femme a divorcé pour se soustraire à la sorcellerie de la maison, pour
utiliser les termes de Peter Geschiere (2013, 2000). Après son départ de la maison, Madu
épousa naturellement une seconde femme en guise de remplacement avec qui il eut deux
enfants. Au sortir de sa vingtaine, il épousa de suite deux nouvelles épouses la même
année, mais ces relations provoquèrent la jalousie de la première femme qui préféra le
divorce. À cette période, la maison comportait trois quartiers qui correspond, selon les
Mura, à la phase 2 de la durée de vie d’une maison.
À partir de ce moment, Madu épousait en moyenne deux femmes tous les cinq ans,
pour accroire la surface de sa maison, mais celle-ci ne se développa pas en raison d’une
série de malheurs. D’abord, sa maison connut un incendie qui provoqua le départ des deux
dernières épouses sur les trois qui vivaient dans la maison. Avec l’aide des voisins et des
membres de son lignage, Madu reconstruisit la maison avec ses trois quartiers, car il
ambitionnait de remplacer les deux départs. Commence cependant une succession rapide de
302
décès au sein de la maison. D’abord, sa dernière femme tomba malade et succomba
brusquement. Madu accusa sa seconde femme de l’avoir empoisonnée en mettant en avant
la jalousie qu’elle lui a toujours manifestée. À moins d’un an, la seconde femme tomba
elle-même malade et succomba. Sa mort provoqua une grande rumeur dans le village
accusant Madu de l’avoir tuée pour se venger de sa défunte femme préférée. Ironie du sort,
Madu tomba lui-même malade et ne fut rétabli que grâce à l’intervention d’un guérisseur
local. Les responsabilités furent à ce moment interverties et on incrimina cette fois-ci les
mauvais esprits de hanter la maison et d’y avoir installé la mort et la maladie. Madu dut
ainsi faire appel à un devin pour exorciser la maison. Malheureusement, il n’a pas pu
retenir l’unique femme qui lui restait, car cette dernière quitta à son tour la maison par peur
de la mort. Les cases de la maison de Madu finirent ainsi par s’écrouler, et au moment de
l’enquête, il ne lui restait que trois cases, ce qui amena Kwona à comparer la maison de
Madu à un « fleuve d’eau empoisonné qui tue les poissons » (entretien avec Kwona,
homme de 65 ans, le 19 novembre 2011, à Dume).
Ce qui précède permet de confirmer l’idée selon laquelle la maison possède une vie
sociale, qu’elle est façonnée en même temps qu’elle façonne la vie sociale de ses
occupants. Elle évolue en tendon avec les personnes qui les occupe et affecte la manière
dont elles interagissent avec elle. Cette conclusion rappelle sans doute les approches
biographiques développées par certains auteurs (Walker and Schiffer, 2006; Thomas, 1991;
Appadurai 1986; Kopytoff 1986; Schiffer 1976, 1972) qui, travaillant dans d’autres
contextes culturels, ont suivi les parcours de vie de certains objets et ont mis à jour les
«voix et détours » (Appadurai, 1986: 16-29) qui les ont marqués à travers le temps et
l’espace (Gosden et Marshall, 1999; Kopytoff 1986: 67). Si la maison n’est pas
transposable d’un lieu à un autre comme le sont les objets étudiés par ces auteurs, elle subit
néanmoins de nombreuses reconfigurations à travers le temps, reconfigurations dont la
marque de fabrique est la dynamique de ce que les Podokwo et les Muktele appellent le
ventre de la maison.
303
2. « Le ventre de la maison est source de vie » : évolution de la maison en lien avec le changement social de l’occupant
À la différence des Mura qui comparent la maison à la forme humaine dans son
intégralité, les Podokwo et les Muktele traitent distinctement la maison en qualifiant
certaines de ses parties par des dénominatifs humains. L’anthropomorphisme podokwo et
muktele s’apparente davantage à celui que l’on trouve chez les Bamiléké de l’Ouest-
Cameroun. Ces derniers ne considèrent pas la maison comme un homme dans son
intégralité. Ils s’intéressent uniquement à certaines parties dont la correspondance avec les
parties du corps permet l’ascension sociale du propriétaire (Malaquais, 2002 : 203). Les
blocs de maisons qui reviennent constamment sont la tête, la bouche et le ventre
(Malaquais, 1994 : 25). De ces trois éléments, le ventre apparait le plus essentiel dans la
croissance de la maison et dans l’ascension sociale de son occupant. C’est par le biais de
son ventre que l’individu trouve une place au sein de la société, et à ce point, il fait l’objet
de nombreuses pratiques rituelles tout au long de la croissance de l’enfant. De la même
manière, le ventre est la partie de la maison qui confère au propriétaire une place au sein de
la société, et des rites sont aussi tenus dans son enceinte pour protéger ses occupants contre
les forces occultes. Compte tenu de l’importance, à la fois, du ventre humain et du ventre
de la maison dans la quête du statut social, il est nécessaire de considérer premièrement
l’imaginaire local du ventre avant de s’intéresser à la manière dont l’élargissement du
ventre de la maison confère à l’individu une place de choix au sein de sa société.
Les Podokwo et les Muktele ont développé des imaginaires du ventre pour souligner
certaines vertus nécessaires à l’encadrement des relations entre les individus. Trois de ces
imaginaires ont retenu mon attention, d’une part, parce qu’ils ressortent simultanément
dans les discours des informateurs issus des deux groupes, et d’autre part, parce qu’ils
permettent de créer un rapport dialectal entre le ventre humain et le ventre de la maison.
Ces imaginaires approchent le ventre en tant que lieu des sentiments communautaristes et
individualistes, siège des connaissances et des secrets, et enfin comme symbole féminin de
la fertilité et de la sorcellerie.
La première métaphore, celle qui porte sur le ventre en tant que siège des sentiments
communautaires, est manifeste autour de la consommation des repas : « c'est lors de la prise
304
des repas qu'on socialise les enfants pour qu'ils aient un bon ventre, en leur apprenant l'idée
de toujours partager leur repas avec une tierce », explique Bassaka Kuma (entretien,
homme de 70 ans, le 09 avril 2007, à Udjila). En effet, celui qui invite un passant pour
partager son repas est une personne qui a un « bon ventre ». En revanche, celui qui mange
seul dans le secret de sa maison est suspecté d’avoir un ventre amer. L’expression podokwo
désignant une personne au ventre amer (dwekə hudə məna) est la même qui qualifie l’acte
antisocial du sorcier. L'égoïsme et la sorcellerie apparaissent tous deux comme des
catégories englobant des vertus opposées à celles des personnes approuvées par la société,
c’est-à-dire ceux qui ont un bon ventre. Paradoxalement, l’imaginaire du ventre traduit
aussi des sentiments égoïstes tels que l’envie et la jalousie. Le fait de toucher le ventre
d'une personne est par exemple considéré par les Podokwo comme la trahison de son
intimité personnelle (entretien avec Zabga Valla, homme de 62 ans, le 09 avril 2007, à
Udjila), car le ventre est ce qu’il y a d’intime. Les Muktele vont jusqu’à suggérer que la
sorcellerie elle-même vivrait dans le ventre de son détenteur sous la forme d’un petit crabe
(voir Juillerat, 1971)212. Les deux groupes ont donc développé à la fois une vision
individualiste et un point de vue communautariste de leurs ventres, une tension soulignée
par l’utilisation d’un terme commun pour désigner le ventre individuel d'une personne et le
groupe ascendant auquel il appartient.
La deuxième métaphore, celle qui porte sur le ventre en tant que siège des
connaissances et des secrets, a trait à la capacité qu’ont certaines personnes à utiliser des
allégories pour tenir un discours. Les paroles vulgaires sortent de la bouche, mais les
bonnes paroles ne peuvent sortir que d’un bon ventre (entretien avec Mozogum, homme de
87 ans, le 13 février 2012, à Udjila). Les bonnes paroles dont il est question font allusion
aux connaissances métaphoriques qu’apprennent les enfants dès le bas âge aux pieds des
212 Il existe d’ailleurs un conte chez les Muktele qui traduit bien le rapport entre sorcellerie et ventre. Voici le conte : « À l’origine du monde, Dieu a crée l’homme, la femme et les arbres. Il créa aussi la sorcellerie qu’il dissimula dans la fente d’un arbre sous la forme d’un crabe, parce qu’il pouvait être porteur de danger pour l’homme. Mais un jour, un homme partit dans ses champs et le découvrit à cause du signal lumineux qu’il émettait. Il le ramena à la maison et le cacha dans le ventre de la marmite. Il recommanda à sa femme de ne pas ouvrir la marmite, et lui dit pour l’en dissuader, qu’elle contenant un objet pouvant nuire à sa santé. À partir de ce moment-là, la femme voulut plutôt savoir ce qui était au fond de la marmite, et l’ouvrit un soir à l’absence de son mari. La sorcellerie s’échappa et entra dans le ventre de la femme. Elle exigea par la suite qu’il soit nourri de la chair humaine viande, et c’est comme ça que les femmes commencèrent à sortir la nuit pour dévorer les gens.
305
sages vieillards. Il est d’ailleurs significatif que les Podokwo et les Muktele mettent en
parallèle ce processus d'acquisition des connaissances avec la consommation du premier
repas de mil par les enfants. En effet, jusqu’à ce qu'ils consomment leurs premiers repas de
mil, les enfants chez les Podokwo et Muktele sont considérés comme des êtres sans
véritable identité, tel que Slagama les compare à des paniers vides (entretien avec Slagama,
homme de 65 ans, le 24 mai 2007, à Udjila). C'est seulement à partir du moment où ils
avalent leur première boule du mil qu’ils s’intègrent dans la société des hommes, et cela
quelque soit le sexe de l’enfant. Dans cette avenue, la consommation du premier repas
constitue la preuve que l’estomac de l’enfant a grandi213 et est devenu solide. Si la
consommation de la boule du mil affecte la croissance physique, la consommation des
connaissances participe plutôt à la fabrique de l’être social : « seuls les enfants qui ont
continuellement mangé les connaissances deviennent des gens respectés et écoutés »
(entretien avec Slagama, homme de 65 ans, le 22 mai 2007, à Udjila). Toutefois, la
connaissance fait souvent la place à son versant obscur qui est l’ignorance. Dans cette
veine, le ventre prend parfois une dimension discrète et mystérieuse, car « nul ne peut
savoir le contenu de son propre ventre, combien à plus forte raison celui de son voisin »
(entretien avec Ussalaka Duluva, homme de 70 ans, le 13 février 2012, à Udjila).
La troisième métaphore, celle qui fait du ventre un symbole féminin, évoque la
fécondité et la grossesse. Contrairement au ventre de l’homme dont l’importance découle
de sa capacité à produire la connaissance, l'importance du ventre comme modèle féminin
est liée à la capacité des femmes à produire des individus. De même que les hommes
dépourvus de connaissances sont réputés être des récipients vides, les femmes sans enfant
sont déconsidérées au sein de la société. Quelque soit son âge, une femme sans enfant est
elle-même vue comme un enfant. Elle est désignée par le nom de son père (fille de… ), et
non par le qualificatif (maman de…). La raison est qu’un ventre féminin vide est une tare
qui met à mal la continuité générationnelle de la maison et de la famille. Si le ventre porte
en lui les symboles de la fécondité et de la vie, il peut aussi produire la mort : « la mort d'un
enfant commence dans son ventre », raconte Ussalaka Duluva, un des nombreux notables
du chef d’Udjila, et les rites de protection de l'enfant sont entre autres centrés autour de son 213 Métaphore employée par Dominique Malaquais (1994) dans son étude anthropomorphique du ventre de la maison chez les Bamiléké.
306
ventre pour le protéger tout au long de sa croissance physique, précise-t-il (entretien, le 13
février 2012, à Udjila). Certains enfants reçoivent à cet effet des amulettes de protection
autour de leur taille.
On se rend donc compte que les différents thèmes élaborés autour du ventre peuvent
se compléter comme ils peuvent s’opposer : le ventre symbolise la générosité de même que
le repli sur soi; il peut être siège de la sagesse et de la parole aussi bien que de l’indicible,
de la confusion et des sentiments non contrôlés de jalousie; il est le lieu de la fécondité, de
la fertilité et de la vie, mais aussi de la dévoration (métaphore liée à la sorcellerie) et de la
mort. L’importance du ventre dans l'imaginaire corporel explique pourquoi il est utilisé
comme véhicule dans l’éducation des enfants. Les contes podokwo et muktele racontant
l’aventure des voleurs et des menteurs terminent toujours sur une même note, à savoir le
ballonnement de leurs ventres. Dans cette même veine, la pratique des ordalies était centrée
autour du ventre. On faisait consommer aux personnes accusées d'un délit une substance
liquide pour déterminer leur culpabilité ou leur innocence. En cas de culpabilité, leur ventre
se dilaterait jusqu’à ce que mort s’en suive (Diyé, 2012). Finalement, le ventre humain est
la fois ce qui confère la distinction sociale à un individu dans le sens où la reconnaissance
de l’identité de l’enfant commence par son ventre. Dans le même temps, il est un lieu où
son éclipse sociale et physique peut avoir lieu dans la mesure où en cas de culpabilité lors
des pratiques des ordalies, c’est par le ventre que la destruction de l’individu débute.
Autrement dit, tout acte posé au cours de l’existence de l’individu peut avoir des
conséquences qui passent par l’effet physique dans le ventre, d’où la place qu’il tient en
tant pilier central dans l’éducation des enfants à travers les contes. Cette importance et cette
ambigüité intrinsèque du ventre a imprimé sa marque sur le ventre de la maison dont le rôle
est tout aussi ambigu; les deux débouchant naturellement à rendre les propriétaires des
grandes maisons des êtres intrinsèquement ambigus.
Comme le ventre humain, le ventre de la maison est intrinsèquement ambigu car il
juxtapose à la fois deux sentiments contradictoires, à savoir la volonté de dissimulation et le
désir d’ostentation. La dissimulation transparait dans le secret qui entoure le quartier des
femmes, en particulier celui des grandes maisons, et l’ostentation apparait à travers les toits
en tiges de mil dont le rôle dans l’affichage public de la richesse de l’occupant est évident.
307
Considérons premièrement l’aspect dissimulateur. S’il est possible aux gens du village et
aux étrangers d’accéder dans le quartier de l’homme et de pénétrer dans les structures qui le
composent, ce n’est pas pareil avec le quartier des femmes dont le moins que l’on puisse
dire est qu’il est tenu à l’écart de tout regard exotique. Une personne qui se retrouverait
dans le ventre de la maison était tout simplement considérée comme un voleur ou une
personne malintentionnée cherchant à provoquer l’infécondité des épouses et la mortalité
infantile (entretiens avec Bedje Barama, homme de 58 ans, le 13 février 2012, à Udjila;
avec Madama Dugdje, femme de 38 ans, le 15 février 2012, à Udjila). Une telle personne
devrait prouver son innocence en se soumettant à l’épreuve de l’ordalie laquelle pourrait
déboucher sur l’éclatement de son ventre en cas de culpabilité (Diyé, 2012).
Lors de mon séjour sur le terrain, la principale difficulté à laquelle je faisais
régulièrement face était l’impossibilité d’entrer dans le ventre des grandes concessions.
Chez le chef de Baldama, par exemple, mes tentatives répétées et l’insistance de mes guides
et interprètes pourtant natifs du village ont été sans succès. Il me permit néanmoins de
visiter toutes les structures de la partie haute, mais en donnant à mes accompagnateurs
l’ordre formel de veiller à ce que je n’arpente pas le couloir vers le ventre de la maison. Ces
derniers m’expliquèrent que seuls les dignitaires de la même lignée que le chef y accédaient
annuellement pour assister aux libations se déroulant au pied du grenier de l’homme. Leur
présence se limitait d’ailleurs à cette zone bien déterminée, la partie la plus inférieure de la
maison, c’est-à-dire l’aire des cases et des cuisines, étant tenue dans le plus grand secret214.
La raison se trouve dans le fait que le ventre de la maison, tel le ventre humain, rêvait une
dimension énigmatique et à ce titre, tel le ventre humain, l’étranger ne doit pas savoir son
contenu (entretien avec Ussalaka Duluva, homme de 70 ans, le 13 février 2012, à Udjila).
Par ailleurs, la maison est configurée de telle sorte que seuls ceux qui en ont une
parfaite connaissance pouvaient y accéder. Comme l’écrit Seignobos, c’est par un passage
discret et obligé, « caractérisé par des ouvertures étroites longeant en parallèle l’entrée du
domaine, que l’on pénètre au sein de la concession » (Seignobos, 1982 : 28). Il faut ajouter
à cette étroitesse des couloirs, les dénivellations du sol et l’obscurité qui rendent difficile le 214 Contrairement au ventre de la maison tenu dans la plus stricte discrétion, la partie haute de la maison est pratiquement dénudée et exposée à la vue de tous, et donc ne requiert aucun secret ni mystère. C’est d’ailleurs dans les vestibules dans la maison du chef de Baldama et dans celle de Slagama que j’étais parfois reçu.
308
mouvement d’un visiteur vers le quartier des femmes. L’unique entrée s’effectue à partir du
domaine de l’homme situé dans la partie haute de la maison, laquelle débouche directement
sur le vestibule qui constitue un lieu stratégique dans la mesure où il est le lieu de repos du
chef de famille (Chétima, 2010; Seignobos, 1982). En plus de protéger les épouses et les
récoltes, l’insistance sur la dissimulation poursuivait visiblement un autre objectif qui est la
création d’un halo de mystère autour du ventre de la maison, et partant, autour du
propriétaire lui-même. Lié de près au rapport entre ventre humain et ventre de la maison, ce
mystère particularise en quelque sorte les propriétaires de vastes maisons les distinguant
des autres gens du village215. Mais plus que cela, il conforte l’idée selon laquelle le ventre
de la maison est un océan de mystères et de secrets. Un informateur muktele précise à cet
effet que « le ventre de la maison est comme le ventre de l’homme. Il cache beaucoup de
choses, bonnes et mauvaises; agréables et désagréables; heureuses et malheureuses »
(entretien avec Kwala, homme de 80 ans, le 27 décembre 2011, à Baldama). Tout comme
dans le ventre humain, toute sorte d’évènements peut s’y produire. C’est dans l’intimité du
ventre de la maison, au pied du grenier central, que les parents prononcent des paroles de
bénédictions pour la prospérité de leurs enfants, aussi bien que des paroles de malédiction
qui les hanteront des années plus tard.
Si le ventre de la maison véhicule un mystère autour des grands dignitaires, c’est
une tout autre image qu’offrent les toits des cases. La dissimulation et le secret sont ici
remplacés par l’ostentation. Alors que le ventre de la maison est inaccessible, les toits sont
accessibles de sorte que tout le monde peut s’en approcher. Lorsque je demandais au chef
de Baldama le nombre des épouses contenues dans sa maison, un des notables anticipait sa
réponse en disant que cela ne me concernait pas. Quelques jours plus tard, le même notable
me confia que si je voulais savoir le nombre des épouses du chef, je n’avais qu’à
contempler les toits contenus dans le mur d’enceinte. Les toits offrent en effet la possibilité
d’avoir une idée sur la vie matrimoniale du propriétaire. Ils soulignent ainsi le prestige d’un
individu car leur nombre est synonyme d’abondance et de richesse, et révèle
l’impressionnante production de mil de l’occupant. C’est sans doute l’importance des toits
215 Voir les annexes 10 et 12 pour visualiser le ventre de la maison du chef de Baldama et le plan de la maison du chef d’Udjila dessinés par Christian Seignobos (1982).
309
dans l’imaginaire local qui fait dire à Christian Seignobos que les montagnards
multipliaient volontiers le nombre des cases pour paraitre prestigieux (1982 : 33)216.
L’accent mis sur l’aspect dissimulateur et ostentatoire du ventre de la maison révèle
une fonction importante du quartier des femmes, à savoir sa capacité à rendre prestigieux le
propriétaire. C’est ici que vivent les femmes qui constituent la plus précieuse source de
prestige qu’un homme peut disposer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les
montagnards ont une inclinaison pour la polygamie. Sans faire l’objet d’une
institutionnalisation, le rêve de tout montagnard est d’avoir un maximum possible de
femmes, et par ricochet une multitude d’enfants. Si cela est vrai pour le paysan ordinaire, il
l’est davantage pour ceux qui détiennent un pouvoir quelconque, et pour ceux qui sont à la
quête de l’honneur et du prestige. On dit du chef Mozogo qu’il a contracté une centaine de
mariages au cours de son règne. Dans certaines chefferies comme celle des Muktele de
Zuelva, la polygamie est en train d’être érigée en une sorte de rite de passage par le biais
duquel le chef prouve son aptitude à régner. Au cours de mon séjour dans ce village en
2011, l’actuel chef, qui fut par ailleurs mon interprète à cette période, n’était marié qu’à une
seule femme. Lorsqu’il fut désigné pour succéder à son père décédé en 2011, il s’engagea
dans des alliances matrimoniales pour assurer, dit-il, la continuité de la maison royale.
216Je ne partage pas entièrement le point de vue de Seignobos, car s’il est vrai que le montagnard multiplie à dessein les cases dans la partie supérieure ici considérée comme le quartier de l’homme, il ne le fait qu’à l’arrivée d’une nouvelle épouse dans la partie inférieure. Chaque nouvelle case dans le ventre de la maison annonce l’arrivée imminente d’une nouvelle femme, et les cases non rénovées signifient indiquent un divorce non compensé. Les domaines des femmes décédées et divorcées obligent systématiquement le père de la maison à en épouser d’autres s’il veut assurer la stabilité et l’équilibre du ventre de sa maison. Les cases vides et non rénovées sont considérées comme le début d’un processus qui conduira la mort de la maison.
310
Figure 43 : Polygamie en tant que facteur important dans l’élargissement de la maison et l’ascension sociale du propriétaire
Si la polygamie bénéficie d’un jugement positif de la part des montagnards, c’est en
partie parce que les femmes tiennent une importance dans la dynamique de la maison.
D’une part, le ventre de la maison est indispensable pour féconder les épouses et assurer la
survie des nouveau-nés. D’autre part, femmes et enfants mettent à la disposition du chef
une main-d’œuvre abondante pour la culture de ses champs de mil. Femmes, enfants et mil
influent en dernier ressort sur le plan et la dynamique du ventre de la maison. Le tout mis
ensemble permet au chef de famille de gagner en prestige grâce à la visibilité des toits en
tiges de mil et à l’élargissement de la maison due à l’abondance des récoltes et au nombre
de personnes toujours croissant qui y vivent.
Il n’est donc pas surprenant que les monts Mandara apparaissent comme l’une des
régions les plus peuplées avec des densités dépassant parfois les 100 hab./km2 et atteignant
les 200 hab./km2 dans certains massifs podokwo et muktele (Hallaire, 1991 : 28). Cette
densité humaine est évidemment célébrée dans l’architecture, et on pourrait même avancer
311
à la suite de Dominique Malaquais (2002 : 127) que la femme et la maison
s’interconnectent dans une relation dialectale et récursive. L’un des thèmes les plus
dominants dans la décoration des cases montagnardes est d’ailleurs l’image des seins que
l’on trouve sur les parois des cuisines et au-dessus de la table meulière. Plus les femmes
sont nombreuses et fécondes, plus le ventre de la maison sera large, et plus le prestige de
l’occupant deviendra évident. La fécondité féminine est importante non seulement parce
qu’il permet de rendre visible et tangible le prestige du chef, mais aussi parce qu’il participe
à la construction même de ce prestige grâce au pouvoir qu’il exerce sur la conception et sur
la vie.
Figure 44 : Océan de toits de la maison du chef de Baldama : un indicateur de son statut
matrimonial et social
312
Figure 45 : toits et mur des cases constituant le ventre de la maison du chef de Baldama, vue de gauche
Ce qui précède amène deux conclusions. Premièrement, il ressort que la maison,
notamment la partie dénommée ventre, et la famille sont mutuellement constitutives et
évoluent en tandem. La maison doit son élargissement au nombre croissant des individus
qui y habitent et qui exercent de ce fait leur agency pour agrandir l’espace domestique de
façon à contenir tous les nouveaux membres et le surplus des récoltes. Le nombre croissant
d’individus est en retour attribué au ventre de la maison qui exercerait un pouvoir
surnaturel sur les esprits maléfiques susceptibles de nuire à l’équilibre familial. Cet
entrelacement entre maison et famille rappelle la notion de «double structuration »
(Giddens, 1984), laquelle met l'accent sur la manière dont des entités distinctes s'incrustent
l’une dans l’autre. La maison devient ainsi un facteur central dans la formation et la
reproduction sociale, économique et même morale de la famille biologique (Birdwell-
Pheasant et Lawrance-Zuniga 1999 : 7; Lévy-Strauss, 1987 : 210).
Deuxièmement, en tant que lieu de vie et d’identité, le ventre de la maison est la
partie de la maison la plus malléable, et c’est son incessante modification qui détermine le
regard que les gens portent sur l’occupant. La malléabilité du ventre de la maison incorpore
313
en lui ce qu’Alfred Gell (1998) appelle l’intentionnalité des acteurs et sert d’intermédiaire à
leur ascension sociale en devenant un agent de différenciation et de hiérarchisation entre
individus. Gell affirme d’ailleurs que les objets, y compris ceux n’ayant aucune fonction
directement identifiable, sont produits pour influencer les pensées et les actions des
individus (1998 : 18-21). Ce postulat est particulièrement important car elle étend l’agency
au-delà de l’action humaine pour embrasser des objets susceptibles d’agir sur leurs
créateurs. Cependant, ici c’est la maison dans toute son entièreté qui doit être considéré
comme un agent et non simplement les objets comme le conçoit Alfred Gell. La maison est
certes un lieu dans le but premier de disposer d’un espace de repos et d’un lieu pour la
préparation des aliments et pour le stockage des biens. Mais en plus de satisfaire à ces
besoins fonctionnels, la maison exerce une influence réelle sur les acteurs en favorisant ou
en limitant leur ascension sociale. En tant que représentation du corps, la maison se trouve
dotée des significations symboliques capables de communiquer, de représenter,
d’influencer et d’enseigner les individus qui l’habitent (Birdwell-Pheasant et Lawrence-
Zuniga 1999), d’où la proposition de Daniel Miller (2005) de considérer l’espace
domestique comme générateur des comportements sociaux. Miller ira encore plus loin en
postulant que: «where we cannot possess we are in danger of becoming possessed» (Miller
2001: 120)217. Autrement dit, l'incapacité de posséder une maison rend l'individu
susceptible d'être continuellement possédé par l'idée de la maison, un comportement surtout
observable dans le contexte de la mobilité des montagnards vers la ville.
217 Dans la lignée de Daniel, Christopher Tilley attribue aussi à la maison le statut d’agent et propose de prendre en compte l’interaction entre individus et objets dans la mesure où « autant les personnes fabriquent et utilisent les objets, autant les objets fabriquent les personnes » (Tilley, 2006 :4). La relation entre individus et objets est donc réciproquement dynamique, estime Christopher Tilley, une conclusion qui l’amène à considérer l’artefact comme « un site multiple pour l’inscription et la négociation des rapports sociaux, du pouvoir et des dynamiques sociales (2002 :28).
314
II. « Partir pour construire » : épidémiologie des comportements bâtisseurs des années 1980 à nos jours218
La mobilité et la maison sont en général considérées comme possédant des attributs
opposés; la mobilité étant associée à un mouvement dans l'espace et la maison à la fixité
dans un lieu particulier (Olwig, 1999 : 73). Par contre, pour de nombreux montagnards du
Cameroun, l'obtention et le maintien d'une belle maison sont tributaires des va-et-vient
permanents entre le village et l’ailleurs. Cette mobilité qui prend de l’ampleur dans les
années 1980, se présente sous deux formes. Premièrement, elle prend la forme de l’exode
rural, plus ou moins prononcé selon les villages, conduisant des jeunes montagnards en
ville pour y travailler dans des secteurs plus ou moins informels (vente à la sauvette,
domestique, veilleur de nuit, etc.). Deuxièmement, la mobilité concerne les fonctionnaires,
considérés par les gens du village comme des individus appartenant à une classe sociale
supérieure, dans la mesure où ils ont, du fait de leurs diplômes (cela concerne17 personnes
en 2011), réussi à obtenir des positions variées dans la fonction publique camerounaise. En
tant que fonctionnaires, ils sont amenés par voie d’affectation à vivre ailleurs, loin de leur
village pour exercer leurs fonctions. Ces deux formes de mobilité ont naturellement conduit
les migrants urbains et les fonctionnaires à développer des notions différentes de la maison
selon leur situation particulière. Pour les premiers, le séjour migratoire en ville est
temporaire, leur véritable chez-soi se trouvant au village dans lequel ils reviendront
construire grâce à l’argent accumulé ailleurs. Les seconds par contre construisent
progressivement leurs maisons dans leurs milieux d’affectation, même s’ils conservent des
liens plus ou moins affectifs et ambigus avec le village.
L’émergence des nouvelles maisons est à situer dans ce double contexte migratoire
dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles participent aujourd’hui à la « fabrique sociale
de la vie quotidienne» (Riggins, 1994) et constituent la nouvelle arène sur laquelle les gens
218 Il aurait été intéressant d’intégrer dans cette partie les comportements bâtisseurs des migrants installés à l’extérieur du Cameroun, notamment en Europe et en Amérique du Nord en guise de comparaisons avec les migrants urbains locaux et les fonctionnaires. Leurs comportements bâtisseurs sont tout à fait différents dans la mesure où ils privilégient à la fois l’extérieur et l’intérieur de la maison, tout le contraire chez les migrants locaux qui mettent l’accent seulement sur l’extérieur, et les fonctionnaires qui mettent davantage le focus sur l’ameublement intérieur. Mais compte tenu du fait que les migrants transnationaux sont peu nombreux et connus de tous, il m’a paru difficile d’intégrer leurs expériences de vie de migrants sans trahir le principe d’anonymat auquel j’ai souscrit dans le cadre de l’approbation de mon projet de recherche par le comité d’éthique de l’Université Laval (voir à cet effet l’annexe 1).
315
déterminent leurs comportements et leurs identités (Miller, 2005 : 5). Au-delà du rôle actif
d'exposition de la richesse du migrant et de l’élite, les nouvelles maisons tiennent surtout un
rôle de communication, ce qui m’amène à les inscrire à l'intérieur des analyses des relations
sociales (Douglas et Isherwood, 1991: 10). Comment ces nouvelles maisons arrivent-elles à
incarner les relations sociales, économiques et politiques entre les migrants, et comment
affectent-elles la relation entre ceux-ci et leurs sociétés d’origine? Quel regard les gens du
village portent sur elles et sur leurs propriétaires de plus en plus mobiles, aussi absents que
présents? Ces questions sont d’autant plus cruciales dans un contexte où la littérature
existante a toujours favorisé d’une part, l'image d’une maison montagnarde, authentique,
ancrée dans un lieu unique et dans un temps ancien et dépassé et d’autre part, l'image d'une
maison porteuse d'une identité montagnarde elle-même caractérisée par une culture
homogène.
En adoptant une démarche croisée sur les deux groupes de migrants présentés ci-
dessus, cette partie ambitionne de montrer que la mobilité n'implique pas seulement un
changement de l'environnement physique, mais aussi et surtout la domestication d'un
nouvel environnement social (Santelli, 2001 : 115), qui à son tour reconfigure les rapports
entre individus et leurs villages. Mon premier niveau d’analyse se focalise sur les maisons
construites par les migrants urbains dans le contexte de l’exode rural. Pour ces derniers, la
maison du village est vécue comme la résidence principale alors que celle de l’ailleurs
prend l’allure d’une résidence secondaire (Rémy, 1999 : 315-345). Le deuxième niveau
d’analyse portera sur les maisons construites par les fonctionnaires locaux qui,
contrairement aux migrants urbains, bâtissent leurs maisons principales dans leurs milieux
de travail; la maison du village devenant dans ce cas la résidence secondaire. Ce « double
espace à l'inverse» (Moisa, 2010; de Villanova et Bonvalet, 1999 : 235-237) atteste d’un
nouveau style de vie défini par un entre-deux et d'une dynamique identitaire (Pinson, 1999 :
85) en cours qui fait des migrants et des fonctionnaires une catégorie sociale à part.
316
A. « Je vais à Yaoundé… chercher là-bas une vie meilleure » : de l’exode rural comme itinéraire d’accumulation
Où vas-tu paysan, avec ton boubou neuf Ton chapeau bariolé, tes souliers éculés Où vas-tu paysan, loin de ton beau village
Où tu vivais en paix, près de tes caféiers […] Je vais à Yaoundé, Yaoundé la Capitale […]
Je vais chercher là-bas une vie meilleure […]
(Extrait d’un disque de Talla André-Marie, chanteur camerounais, 1970)
Cet extrait d’un disque du chanteur camerounais André-Marie Talla révèle
l’imaginaire collectif de la ville qui s’est répandu au Cameroun dans les décennies ayant
suivi l’indépendance. Il met en lumière le désarroi d’une grande partie de la population
vivant dans l’arrière-pays, qui n’a aucune possibilité d’avoir des ressources numéraires
pourtant devenues nécessaires pour s’insérer dans l’économie marchande. Le phénomène
migratoire, commencé vraisemblablement dès le début des années 1960, s’est surtout
généralisé à l’échelle nationale dans les années 1970-80 (Gubry, 1991; Gubry et al., 1991;
Barbier, Courade et Gubry, 1982). Barbier et ses collègues notent qu’au cours de cette
période, la grande majorité des populations rurales camerounaises n’avaient qu’un seul rêve
à l’esprit: fouler le sol de Yaoundé (Barbier, Courade et Gubry, 1982 : 111). C’est dans ce
contexte généralisé de l’exode rural que les jeunes montagnards se lancent très tôt dans la
course effrénée à la vie meilleure et au bonheur recherché dont parle André-Marie Talla. À
en croire certains informateurs, la première colonie des migrants montagnards à Yaoundé
se serait implantée au début des années 1980, longtemps après l’accession du Cameroun à
l’indépendance. Mais c’est seulement vers la fin des années 1980 que le phénomène
migratoire s’amplifie véritablement, à tel point qu’il est devenu une des caractéristiques
majeures des monts Mandara (Boutinot, 1994; Iyebi-Mandjeck, 1993). À observer leur
boulot, leur revenu et leurs conditions de vie à Yaoundé, on découvre pourtant une réalité
qui se situe aux antipodes du crédo de départ qui est celui d’aller chercher là-bas une vie
meilleure.
Leurs maisons de Yaoundé se trouvent en effet dans une condition beaucoup plus
pitoyable que les cases traditionnelles du village. Comment comprendre la dynamique
317
migratoire de plus en plus récurrente des montagnards vers Yaoundé, dès lors qu’ils y
vivent dans un état de précarité? Répondre à cette question nécessite de mettre en parallèle
la misère vécue à Yaoundé et le désir de l’honorabilité lors du retour au village.
1. Yaoundé ou la face cachée d’un ailleurs de misère
Le quartier Bastos, qui figure comme l’un des quartiers résidentiels de Yaoundé, a la
particularité de regrouper la majorité des ambassades et des résidences d’ambassadeurs
étrangers accrédités au Cameroun. Ses avenues propres et ses luxueuses villas construites
sur une colline en cercle concentrique lui donnent un portrait comparable à des quartiers
chics de grandes métropoles nord-américaines et européennes. Pourtant, sur ses flancs et
dans son bas-fond marécageux, vivent des populations constituées pour la plupart des
migrants venus de tous les coins du Cameroun et des pays limitrophes. S’il y a un quartier
où les gens vivent en deçà du seuil de la pauvreté, et que l’on peut présenter comme
l’emblème même de la faillite, c’est bien Bastos-Nylon. Il est d’ailleurs ainsi dénommé
pour, d’une part, marquer la rupture avec le Bastos résidentiel, et d’autre part, pour faire
écho au quartier Nylon connu pour être le quartier le plus insalubre de Douala. Le journal
Le Messager, dans sa livraison du 03 mai 2009 en dresse un portrait captivant :
Au lieu dit Bastos-Nylon, on retrouve un ensemble des maisons délabrées dont les occupants sont en majorité des immigrés venant des pays voisins. Une fois sortis de la grande route, s’orienter dans cette partie du quartier relève de l’exploit pour qui n’est pas du coin. Au fur et à mesure que l’on s’enfonce dans le quartier, les voies d’accès se rétrécissent. Seuls quelques labyrinthes entre des maisons en planches ou en terre battue servent de passage. C’est qu’ici, il n’ y a aucun plan d’urbanisation, les habitations ont été construites en désordre et ont finalement obstrué les principales voies d’accès au quartier. Ces maisons sont en réalité des baraques contigües, étroites et abritant des familles nombreuses. La promiscuité y règne en maitre. Bien que Bastos soit alimenté en eau courante, ici, l’accès à ce bien se fait par l’intermédiaire des revendeurs, détenteurs de bornes-fontaines payantes. En saison des pluies, les latrines mal aménagées débordent et les inondations sont fréquentes […].
Ce portrait tout à fait saisissant est pourtant réel et mérite d’ailleurs d’être complété
par mes propres observations. Un regard jeté sur le Bastos-Nylon à partir de l’une des
collines qui abritent le Bastos résidentiel donne l’impression qu’il ne forme qu’une seule
318
toiture complètement rouillée. Les maisons sont serrées les unes contre les autres à tel point
que le passage par l’une est obligatoire pour atteindre l’autre. Les pistes qu’il faut
nécessairement emprunter pour arriver à l’autre extrémité du quartier débouchent parfois
dans des toilettes et salons privés des particuliers qu’il faut traverser sans gêne. Les eaux
sales et usées desservent quotidiennement les auvents des habitations avec pour seul moyen
de s’en débarrasser leur évacuation vers la maison du voisin qui à son tour doit également
leur créer un passage vers la maison d’une autre personne. Il n’est pas non plus rare de
constater que les latrines du ménage Alpha soient construites à proximité de l’entrée de la
maison du ménage Béta, sans que celui-ci n’ait le droit de protester dans la mesure où elles
se trouvent sur la portion de son terrain. Les maisons, de nature très petites, vétustes et
bruyantes, sont entassées les unes sur les autres, et le plus souvent construites en carabotte.
Dans la mesure où il n’ y a pas de voirie urbaine, toutes les ordures et les déchets ménagers
sont transvasés sur l’auvent de la maison du prochain.
Partout l’habitat et les mobiliers presqu’inexistants sont dérisoires et déficients. La
population ayant ici occupé les bas-fonds marécageux, tous les jours de pluie sont vécus
comme un calvaire. Dans une atmosphère d’une telle insalubrité, les bagarres, les
altercations et les violences sont des faits banals. Les enfants en bas âge apprennent dès lors
très tôt à se défendre, à insulter, à quereller, à se bagarrer, à tel point qu’Abbé Prosper
Abega (1989) les considère comme des agresseurs potentiels en formation. Par ailleurs,
l’entassement des maisons pose un problème d’aération dans le quartier. Qui n’est pas
habitué au secteur aura l’impression de vivre dans une atmosphère d’étouffement, ce
d’autant plus vrai que la puanteur nauséabonde que produisent les caniveaux, les ordures
ménagères, les cacas échappés des latrines, est aggravée par le ruissèlement quotidien d’eau
usée et évacuée par les ménages (Abega, 1989). Dans la mesure où il n’existe aucune
structure de canalisation, ces déchets s’immobilisent devant les maisons en se constituant
en une strate de moisissure.
C’est donc dans ce secteur de Yaoundé que vivent la grande majorité des migrants
montagnards, qui s’y sont établis dans ses plus bas-fonds. Ils reçoivent ainsi
quotidiennement tout ce dépotoir décrit plus haut, et qui, ajouté aux eaux d’inondation des
marécages, produisent un résultat qu’il est difficile de qualifier. La plupart du temps, les
319
jeunes montagnards se regroupent dans des bâtiments plus ou moins exigus dans le but de
minimiser leurs dépenses. Les migrants podokwo se sont par exemple regroupés dans un
bâtiment en état d’avilissement avancé, mais qu’ils appellent affectueusement grand Salon.
Il s’agit d’une construction en terre battue comprenant une chambre, un salon et une petite
cour. Dans cette maison, habite plus d’une trentaine de personnes, qui n’ont pour lits que
des nattes préfabriquées en plastique et posées à même le sol. Ils y dorment là par tour de
rôle, de sorte que ceux qui travaillent de nuit utilisent l’espace domestique en journée, et
inversement.
Figure 46 : Vue des quartiers Bastos résidentiel sur la colline et de Bastos-Nylon dans le bas-fond
320
Figure 47 : « Grand salon », une maison en carabotte logeant plus d’une trentaine des
migrants podokwo habitant au quartier Bastos-Nylon
En plus du grand salon, il existe d’autres maisons louées par les migrants dans
lesquelles ils vivent par lignage et par clan. Les conditions de séjour sont les mêmes que
ceux observés au grand Salon, à savoir l’exigüité de la maison par rapport au nombre de
personnes qui y vivent. Par exemple, le salon des gens du lignage Kazlaŋa est un
appartement à deux chambres situé à l’extrémité nord de Bastos-Nylon. En 2011, la
première chambre était occupée par le plus ancien qui y vivait avec sa femme, et la
deuxième logeait tous les autres migrants qui étaient au nombre de dix-sept. Leur chambre
ne contenait qu’un lit d’une place et demi sur lequel ils venaient se reposer à tour de rôle.
Lorsqu’un migrant désirait faire venir sa femme, il quittait le salon pour louer une chambre
individuelle dans laquelle il habite pendant la durée de séjour de son épouse. Même dans le
cas d’une location à titre individuel, la minimalisation des dépenses restait de mise. Dans la
majorité des cas, les appartements loués ne comportent pas de cuisine et de dépendance.
Les femmes utilisent un réchaud à pétrole qu’elles installent sur une étagère placée dans un
coin de la chambre, et séparée du lit par un petit rideau. La chambre fait donc office, à la
fois, de lieu pour dormir, pour cuisiner et pour recevoir les amis et les parents. Une fois
enceinte, la femme est renvoyée au village, sa venue à Yaoundé n’ayant eu pour raison que
la fécondation. L’homme regagne par la suite ses pairs au salon pour reprendre sa vie
d’austérité indispensable à l’accumulation de l’argent.
321
Figure 48 : Appartements destinés à des locations individuelles ou de groupes. C’est dans ce secteur que vivent la plupart des migrants montagnards qui louent des chambres individuelles
pour accueillir leurs épouses.
Outre ces conditions de logement extrêmement difficiles, les emplois des migrants
relèvent presque toujours de la seconde économie (Iyebi-Mandjeck, 1993). La plupart
d’entre eux se font employer comme veilleurs de nuit chez des hommes d’affaires et autres
diplomates installés à Bastos résidentielle pour un salaire mensuel ne dépassant guère les
50.000 FCFA, soit 100 dollars canadiens qui, selon une étude menée par la Banque
Mondiale (2012), est le salaire moyen national. En 2011, 50% des migrants rencontrés
disent avoir un salaire inférieur à 25.000 FCFA, soit environ 50 dollars canadiens. Prêt de
30% déclaraient avoir un salaire échelonné entre 25.000 et 50.000 FCFA, soit 50 à 100
dollars canadiens. Dans la mesure où ce salaire est moindre que la moyenne nationale, les
migrants montagnards se voient contraints de vivre en communauté pour minimiser les
frais associés au loyer et à d’autres dépenses qu’exige leur séjour en ville. Aussi, pour
accroitre leur potentiel d’accumulation, ils s’adonnent à toute sorte d’activités relevant du
secteur informel (vente à la sauvette, commerce de la friperie, vidange des toilettes, lavage
de la voiture, etc.). De ce point de vue, les enquêtes menées par Foudouop (1991) illustrent
bien l’extrême précarité des conditions d’emploi et de survie dans lesquelles ils vivent :
« Lorsqu’on observe attentivement la vie de ces employés, on croit avoir à faire à une autre
forme d’esclavage. Des caprices de l’employeur aux licenciements abusifs, sans compter le
travail astreignant pour un salaire bas » (Foudouop, 1991 :16).
322
Malgré ces conditions minables, les migrants ne gardent pourtant aucune trace
négative de leur vie précaire de Yaoundé. Même s’ils sont conscients du fait d’être
marginalisés en ville en raison de leur niveau d’éducation, du caractère informel de leurs
boulots et du quartier dans lequel ils vivent, la plupart d’entre eux disent assumer avec
fierté les difficultés de la vie et l’ont d’ailleurs intégrée dans leur projet de réussite. La
raison en est que Yaoundé ne figure pas pour eux comme un chez soi, mais uniquement
comme une source d’enrichissement, laquelle sera mise en valeur une fois retournée au
village. Yaoundé prend ainsi la connotation d’un non-lieu (Augé, 1992), d’un espace non
règlementé socialement et symboliquement (Moisa, 2010 : 218). L’objectif de la mobilité à
Yaoundé est certes la recherche d’une vie meilleure, mais cette vie meilleure ne se trouve
pas là-bas, mais au village (entretien avec Mouche Vaza, homme de 50 ans, le 11 janvier
2012, à Godigong), d’où le fait qu’ils ne se plaignent guère de la manière dont ils logent,
vivent et travaillent en ville. C’est aussi la raison pour laquelle les dépenses pendant toute
la durée de l’exil migratoire sont réduites au strict minimum, car le « plus important est
d’épargner un maximum d’argent nécessaire pour la construction d’une belle maison au
village » explique Sevda Chikoua (entretien, homme de 44 ans, le 16 janvier 2012, à
Godigong). On remarquera que même les migrants qui arrivent à trouver un emploi bien
rémunéré préfèrent loger au quartier Bastos-Nylon, car ici les maisons coutent beaucoup
moins cher que celles situées dans d’autres secteurs de la ville.
Ces remarques sur les conditions de séjour et de logement à Yaoundé vécues avec
fierté amènent à ne voir en l’ailleurs qu’un espace transitionnel (Rémy, 1999) et interstitiel
(Moisa, 2010). De fait, Yaoundé ne s'avère être qu’un rite de passage219, ce qui explique
pourquoi les investissements financiers et affectifs ne sont dirigés que vers le village. Dans
219 Les montagnards comparent leur mobilité à un rite de passage et invoque l’initiation telle qu’elle se pratiquait chez les Tupuri et les Massa du Nord-Cameroun qu’ils côtoient quotidiennement à Bastos-Nylon : « Tu ne seras jamais un homme si tu n’as pas fait Yaoundé. C’est comme chez les Tupuri, là-bas, tu ne peux pas être un homme sans passer par le Gonokaye qui se passé brousse », affirme Lade Ndawaka (entretien, le 16 avril 2014, à Yaoundé). Le Gonokaye tupuri est en fait un rite de passage qui conduit les jeunes en brousse pour subir l’initiation. Là, ils subissent un ensemble d’épreuves rudes les unes que les autres, à tel point que certains adolescents y laissent leurs vies. Telle l’initiation, l’exode rural est interprété comme un rite de passage, un passage obligé vers l’accumulation, laquelle jouera un rôle important dans l’acquisition d’un nouveau statut. Il constitue pour le jeune montagnard le seul moyen de se procurer une « belle maison » devenue l’emblème de la réussite au village, et qui aux yeux de la société actuelle, fait d’un homme un individu à part entière. De même que le départ pour la brousse comporte déjà l’idée de retour, de même, le retour au village figure déjà dans l’objectif du départ.
323
ces conditions, les migrants acceptent volontiers d’être des marginaux en ville en sachant
qu’une fois rentrés au village, ils seront valorisés et surclassés par les gens de chez eux. Il y
a donc une modification qui s’opère dans le rapport au lieu, dans la mesure où la
marginalité de la vie urbaine cède la place à la respectabilité auprès des gens du village, qui
devient pour le migrant le seul endroit où il souhaite se faire un nom.
2. « Se faire un nom au village » : belle maison et matérialisation de la réussite sociale post-migratoire
Une des particularités de l’exode rural montagnard est la nostalgie du « retour au
village » pour y consommer sa réussite migratoire. On part à Yaoundé en sachant qu’on
sera un jour de retour pour exposer et afficher sa réussite. Autrement dit, Yaoundé n’est pas
le but de leur mobilité, mais un moyen d’atteindre un autre but beaucoup plus noble, à
savoir la construction d’une maison de rêve (Moisa, 2010; Bonin et De Villanova, 1999) au
village. Toujours dans la lignée des approches de la culture matérielle (Buchli, 2013, 1995;
Turgeon et Debary, 2007; Tilley et al., 2006; Miller, 2005, 1998; Hodder et Hutson, 2003;
Tan, 2001; Appadurai, 1986), identifions maintenant la marque de fabrique de cette maison
qui, de manière générale, est principalement donnée par la forme rectangulaire et par la
toiture en tôles.
L'incorporation de la forme rectangulaire dans les constructions des maisons est
survenue longtemps après sa première utilisation dans l’architecture publique, d’abord par
l’État islamique du Wandala à Mora, et ensuite par les colonisateurs allemands et français
(Lyons, 1996 : 360; Boutrais, 1973 : 69). Les informateurs podokwo de Godigong
mentionnent que, jusqu’au début des années 1980, toutes les maisons du village étaient
rondes et couvertes de paille (entretiens avec Mouche Vaza, homme de 50 ans, le 27 janvier
2012; avec Sevda Chikoua, homme de 44 ans, le 18 janvier 2012 à Godigong). Les
Muktele de Tala-Mokolo indiquent également que la première maison rectangulaire est
apparue seulement dans les années 1980. La même décennie est indiquée par les Mura de
Mora-Massif qui précisent la fin des années 1980 (entretiens avec Dawcha, homme de 58
ans, le 17 mai 2012, à Mora-Massif; avec Amagaouwe, homme de 55 ans, le 17 mai 2012,
à Mora-Masif; avec Nache, femme de 48 ans, le 18 mai 2012, à Mora-Massif; avec
Mahama, homme de 47 ans, le 22 mai 2012, à Mora-Massif). Si les informateurs ne se
324
souviennent pas de la date exacte de l’introduction des maisons rectangulaires, ils
confirment néanmoins le témoignage d’Antoinette Hallaire (1965: 53) qui écrivait que la
forme rectangulaire n'était pas la norme chez les montagnards jusqu’au début des années
1960. Diane Lyons (1996) fait aussi remarquer que les plus anciens bâtiments
rectangulaires dans les maisons mura de Dela n’apparaissent que dans les années 1970-
1980.
On peut poser la question de savoir pourquoi et comment les maisons
rectangulaires, introduites seulement dans les années 1980, ont connu une telle accélération
au point d’être aujourd’hui la norme en matière de construction des cases? Trois principales
raisons émergent dans les conversations pour expliquer la prolifération des maisons
rectangulaires : la première est le désir de paraitre moderne; la seconde est le besoin
d’accueillir les nouveaux meubles achetés sur les marchés grâce à l’argent accumulé au
cours de l’expérience migratoire; et la troisième est liée au montage de la toiture double
pente en tôles ondulées. Commençons par examiner les deux dernières raisons avant
d’examiner la première qui me parait plus pertinente.
Dans les conversations avec les informateurs issus des trois villages (Godigong,
Tala-Mokolo et Mora-Massif), plusieurs d’entre eux soutiennent l’idée que les maisons
rectangulaires ont été adoptées, entre autres, pour accueillir les nouveaux meubles dont les
plus citées sont le lit-bateau fabriqué en bois, les armoires vitrées pour disposer les
ustensiles de valeur, et un ensemble table-chaises. Mais les observations effectuées entre
2006 et 2011 montrent que cette raison est difficilement soutenable. En effet, on remarque
que, d’une part, les nouveaux mobiliers ne sont pas seulement présents dans des maisons
rectangulaires, ils le sont aussi dans des cases rondes. D’autre part, il existe des maisons de
forme rectangulaire dépourvues de nouveaux meubles contenant plutôt des mobiliers
traditionnels, si non laissées pratiquement vides. Par ailleurs, dans la plupart des ménages
visités, les meubles, s’ils existent, se retrouvent dans la seule maison principale, celle qui
accueille les chambres à coucher des époux. Des structures rectangulaires tels que les
vestibules, les vérandas et les cuisines ne comportent aucun nouvel ameublement. Ces
observations sont en droite ligne avec celles réalisées par Diane Lyons (1996) sur les
325
maisons rectangulaires à Dela, lesquelles observations lui ont permis d’écarter les meubles
comme la raison présidant à la construction des cases rectangulaires.
La deuxième raison, celle qui justifie les constructions rectangulaires pour
accommoder la maison à la toiture en tôles ne résiste pas non plus à l’épreuve des
observations. En effet, dans les trois villages, on remarque qu’un bon nombre de ménages
au revenu modeste ont construit des cases rectangulaires en utilisant le système de toiture à
tiges de mil. À Mora-Massif, les informateurs précisent que la tôle étant un matériau très
cher, une minorité de personnes pouvaient se donner le luxe de l’utiliser avant le début des
années 1980. Pourtant, ils indiquent qu’à cette période, la plupart des maisons dans le
village étaient déjà construites sur un mode rectangulaire, mais elles étaient construites sans
l’aide d’aucun spécialiste et grâce à l’utilisation des briques de terre fabriquées localement.
Elle ne demandait donc aucun investissement financier, et était pour ainsi dire, à la portée
de tout le monde, d’où sa rapide prolifération dès les années 1980. En revanche, la tôle et
les meubles exigeaient d’importants moyens financiers de la part du propriétaire, qui jusque
dans les années 1980, ne pouvait avoir de liquidité que grâce à la vente des produits vivriers
devenus eux-mêmes insuffisants pour assurer la subsistance de la famille (Iyebi-Mandjeck,
1993 : 422). Ces détails amènent à écarter la tôle et les meubles comme des critères initiaux
de l’adoption des structures rectangulaires dans les villages montagnards de la plaine. La
seule raison qui reste donc à examiner est la considération selon laquelle la maison
rectangulaire serait un support d’affirmation du statut d’être un homme nouveau, c’est-à-
dire moderne.
L'explication de la construction des maisons rectangulaires par la volonté de paraitre
moderne peut être mieux comprise si on considère le contexte dans lequel elle a été
adoptée. Dans les années 1960, le jeune État camerounais devenu indépendant se lance
dans une logique de modernisation des institutions nationales qui devrait se traduire par
l’apparition d’un style de vie nouveau qu’on pouvait schématiser à travers la consommation
des biens matériels modernes, en particulier le vêtement, l’alimentation, la maison et
confort (Lyons, 1996). En lien avec ce projet de modernisation de la société, l’État entreprit
de loger les premiers fonctionnaires camerounais dans des bâtiments de forme
rectangulaire, car étant le prototype du nouvel homme, ces derniers devraient vivre dans un
326
nouvel environnement pour se conformer à l’idéal du modernisme et du confort. En tant
que gens modernes, ces fonctionnaires se démarquaient dans l’arrière-pays des autres
villageois par leur style de vie soigné et tout à fait différent. Du cout, le fait de les avoir
loger dans des maisons rectangulaires, à la suite des administrateurs coloniaux qui logeaient
eux également dans des maisons pareilles, a fini par donner l’impression qu’être moderne,
c’est aussi entre autres habiter dans des maisons rectangulaires, qui devient finalement la
preuve de la réussite sociale et de l’ouverture sur le monde (Lyons, 1996; Prussin, 1969).
Par ailleurs, les années ayant précédé la descente des montagnards en plaine ont vu
la mise en place de certaines facilités offertes par l’État, notamment les écoles primaires et
les centres de santé dont la construction épousait également des formes rectangulaires. En
tant que telles, elles étaient vues comme une partie essentielle de la présence matérielle
même de l’État dans la région (Lyons, 1996; Seignobos, 1982; Boutrais, 1973). Sans en
avoir les moyens, les montagnards vont massivement adopter ce modèle de construction, en
fabriquant localement des briques en terre et en utilisant leur système de toiture en tiges de
mil. Le plus important était d’avoir une maison rectangulaire, pareille à celles des
émissaires de l’État. La comparaison avec ces derniers créait chez eux un sentiment de
modernité et d’accomplissement personnel, même si avec l’accroissement des revenus par
le biais de l’exode rural, la tôle déclassera la forme rectangulaire comme preuve de la
modernité et élargira ainsi les géométries identitaires de l’être moderne.
Le deuxième élément par lequel les jeunes montagnards évoquent leur statut
d’hommes nouveaux, c’est la toiture double pente en tôle. Pour avoir une idée sur les
mobiles qui ont facilité son introduction et sa prolifération comme matériau de prédilection,
j’ai effectué un sondage auprès des premiers villageois à avoir construit en tôles dans les
villages étudiés à savoir Godigong, Tala-Mokolo, Mora-Massif. Dix-sept personnes ont été
sollicitées au total et ont toutes donné leur avis en réponse à la question suivante : pourquoi
avez-vous opté pour la tôle dans la construction de votre maison? À cette question, les
informateurs ont avancé trois principales raisons pour justifier le choix de la tôle : seize des
dix-sept personnes interviewées ont souligné que la tôle est un facteur de la joliesse et de la
beauté des maisons; quatorze d’entre eux ont mis l’accent sur la tôle en tant que facteur de
la nouveauté et du changement; et enfin quatorze précisent qu’ils ont adopté la tôle parce
327
que c’est un matériau durable et résistant aux flammes. Les deux premières raisons
renvoient à la valeur esthétique et au rôle de la tôle dans la définition de l’être moderne
dont ils clament désormais appartenir. La dernière raison renvoie à sa valeur fonctionnelle
et pratique. Considérons la dernière raison avant d’en venir aux deux premières qui
semblent les plus importantes.
La première raison fait émerger la tôle comme un matériau capable de résister aux
flammes, et donc durable. À la question posée ci-dessus, la plupart des informateurs ont
soutenu leur réponse en établissant une parallèle avec les toits en tige de mil qui fut jusque
dans les années 1980 le matériau de prédilection dans les trois villages : « La toiture en
tiges de mil, déclare Mouche Vaza, demande un grand travail d’entretien et de réfection
régulière » (entretien avec Mouche Vaza, homme de 50 ans, le 12 janvier 2012, à
Godigong). Ils indiquent que le bois qui constitue l’élément de la charpente se fragilise au
bout de trois ans étant incessamment rongé par des insectes xylophages. En tant que
support principal de la toiture, la fragilisation de la charpente induit une réfection régulière.
Or, l’environnement végétal se fait de plus en plus pauvre en arbres et en bois nécessaire à
la confection des toitures (Chétima, 2010; Seignobos, 1982). Les tiges de mil, autre élément
de la toiture, demandent également un grand travail d’entretien : « tous les trois ans, ils
doivent normalement être renouvelés » affirme Dawcha (entretien, homme de 58 ans, le
09 mai 2012, à Mora-Massif). De même qu’on note la rareté du bois de travail architectural,
les tiges de mil se font aussi de plus en plus rares. Avec la pauvreté du sol qui induit un
faible rendement agricole, il est difficile d’obtenir les tiges de mil en quantité, car leur
disponibilité est intimement liée à l’abondance des récoltes en mil. La tôle apparait donc
doublement comme une solution pratique, car elle réduit la fréquence des travaux
d’entretien et de réfection : « Il suffit de la poser une fois sur le mur et on aura plus besoin
de l’entretenir » (entretien avec Dawcha, homme de 58 ans, le 09 mai 2012, à Mora-
Massif).
Les deux premières raisons sont intimement liées et évoque les idées de l’esthétique
et du prestige : « Quelle que soit la laideur d’une maison, elle deviendra jolie si on la
construit en tôles », soutient déclare Zabga Valla (entretien, homme de 62 ans, le 11 avril
2007, à Udjila). De fait, la tôle jouit d’une telle publicité qu’elle permet de qualifier
328
n’importe quelle maison de jolie. Autrement dit, la joliesse ou la laideur ne traduit pas
forcément pour le montagnard une norme esthétique. Elles tiennent à l’emploi d’un
matériau noble: la tôle. Une maison en tôles ne peut être que belle, quelle que soit la forme
qu’elle prend. Réciproquement, une maison en paille ou en tige de mil incarne le symbole
de la laideur, surtout si son propriétaire est jeune : « quand tu es jeune et construis toute ta
maison en paille, les gens se moquent de toi en disant que tu vis comme les grands-pères du
passé » (entretien avec Tobela, homme de 25 ans, le 12 octobre 2011, à Tala-Mokolo). La
paille et les tiges de mil semblent en effet renvoyer à une autre époque, plus ou moins
stigmatisée par les populations. Si les cases en paille continuent d’être construites par les
migrants, c’est pour servir en général de lieu pour la préparation des aliments.
Figure 49 : Maison en tôle et de forme rectangulaire en chantier à Mora-Massif, symbole de la réussite post-migratoire
Le choix de la tôle dans la présentation du soi moderne n'est donc pas aléatoire. Elle
représente le principal marqueur qui confère à la maison un caractère moderne. Dans le
vocabulaire local, la beauté rime avec la nouveauté, car une belle maison c’est aussi une
nouvelle maison, et l’importance de la tôle vient du fait qu’elle rend les maisons à la fois
jolies et modernes. Le simple fait d’avoir construit une maison en tôle constitue une raison
de satisfaction et d’accomplissement personnel, quelle que soit sa grandeur ou son degré de
329
confort. Dans le village de Mora-Massif, une grande majorité des maisons en tôles étaient
encore inhabitées en 2007, car l’intérieur était encore en chantier et non aménagé. Même
dans ce cas, leur rôle dans l’ascension sociale du propriétaire n’était pas moindre, car ce qui
importe n’est pas tant la fonctionnalité de la maison (lieu pour dormir, lieu pour se reposer,
lieu pour cuisiner, etc.), mais le message qu’elle transmet sur le nouveau statut du
propriétaire : un message d'épanouissement et de réussite sociale. En conférant à la maison
l’empreinte de la modernité, la tôle matérialise en même temps la naissance d'un nouvel
être social du propriétaire, dont le statut n’est plus associé à une identité traditionnelle, mais
à une autre, moderne et centrale, donc vitale et valorisante (Moisa, 2010: 206).
En tant que matériau de prestige, la tôle a représenté un élément important dans le
jaugeage de l’importance d’un individu dans les villages montagnards. Seignobos (1982)
remarque qu’elle était presque toujours liée au pouvoir, et les administrateurs locaux
accordaient fréquemment des dons en tôles aux autorités traditionnelles220. En tant que
symbole du pouvoir, les premières maisons à être tôlées furent naturellement les nouvelles
résidences des chefs de canton construites dans les années 1960. Avant cette période, les
informateurs indiquent que leurs villages ne comptaient aucune maison en tôle. À Tala-
Mokolo, les informateurs indiquent que la première construction en tôle fut l’école primaire
de la localité, construite seulement dans les années 1970. À Godigong, les villageois citent
plutôt le camp missionnaire construit par les missionnaires suisses de la Mission-Unie du
Soudan (MUS) qui accueillit pour la première fois la tôle. Suivront par la suite le
dispensaire de Godigong et l’église construite par ces mêmes missionnaires toujours dans
les années 1970.
À Mora-Massif, la première toiture en tôle fut l’église locale dont la construction
remonte aux années 1980. L’apparition des maisons privées avec toiture en tôles n’apparait
que vers la fin des années 1970 à Godigong et à Tala-Mokolo, et vers la fin des années
1980 à Mora-Massif, si on en croit les informateurs. En dépit de cette introduction tardive,
la tôle ondulée s’est très rapidement démocratisée en devenant la norme de référence de la
nouveauté. Même dans le cas où le propriétaire se trouve absent, la maison en tôle qu’il fait
220 Christian Seignobos, « Transformations architecturales au Nord-Cameroun », cours dispensé à l’université de Ngaoundéré en date du 18 mars 2007.
330
construire au village a vocation de le représenter, d’où la ruée des jeunes montagnards vers
Yaoundé pour accumuler autant d’argent nécessaire en vue de posséder une telle maison.
Par ailleurs, il importe de préciser que ce n’est pas tous les migrants qui ont construit une
maison en tôle qui sont valorisés, mais seulement ceux qui ont construit au village. La
réussite du projet migratoire à Yaoundé ne vaut rien si la communauté d’appartenance,
c’est-à-dire, les gens du village, ne la consomment pas visuellement et ne la confirment pas.
Autrement dit, c’est au village, et non à Yaoundé que la mise en valeur du succès
migratoire doit s’effectuer.
Ce comportement bâtisseur qui apparait effectivement avec l’exode rural, vient
contredire la théorie de la double résidence de Bonin et de De Villanova (1999) qui
concluent, sur la base d’une enquête sur les migrants portugais, que la maison de l’Ailleurs
constitue la résidence principale alors que celle de la communauté d’origine fait office de
résidence secondaire (Bonin et De Villanova, 1999: 213-247). Chez les migrants des monts
Mandara, c’est tout le contraire qui est observé dans la mesure où la maison habitée à
Yaoundé est vécue comme une résidence secondaire et celle du pays d’origine émerge en
tant que la principale, et cela, qu’elle soit habitée ou pas. On peut même aller plus loin en
suggérant à la suite de Daniela Moisa (2010: 222) que cette maison d’origine construite à la
suite de l’exil migratoire n’est pas simplement la résidence principale, elle devient l’unique
dans la mesure où le séjour à Yaoundé n’est que gouverné par la logique du passager et du
provisoire. Dans cette avenue, une maison construite en ville, si moderne soit-elle, est vue
comme un acte de gaspillage. La définition qu’un de mes informateurs donne au terme
gaspillage est particulièrement frappante. Lorsque je lui demandais ce qu’il entendait par
gaspiller, il répondit:
Gaspiller? C’est donner à quelque chose davantage que ce qui est nécessaire. Si une mesure de farine est suffisante pour préparer une boule de mil et qu’une femme en met cinq, c’est du gaspillage de farine qu’elle fait. Si une semaine est suffisante pour labourer un carré de terrain et qu’un homme y met deux semaines, c’est du gaspillage du temps qu’il fait. Le gaspillage, c’est tout ce que tu donnes qui est au-delà de la valeur de la chose (entretien avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 17 février 2012, à Godigong).
331
Cette définition du mot gaspillage, lui fournit une arène pour critiquer le choix de
certains de leurs fils en ville de construire leurs maisons en ville, car « on n'est jamais chez
soi quand on est ailleurs » (entretien avec Zabga Pastou, homme de 40 ans, le 17 février
2012, à Godigong). Autrement dit, construire des belles maisons ailleurs qu’au village,
c’est leur donner plus de valeur qu’il ne faut, et donc c’est du gaspillage. En revanche, une
maison en tôle construite au village sera toujours une source d’honneur et de respectabilité
pour l’individu. En absorbant la force de travail déployée au cours de l’exil migratoire, la
maison en tôles fournit à son tour un pouvoir symbolique (Bourdieu, 2001) et identitaire
nécessaire à l’ascension sociale de l’individu et à la redéfinition de ses rapports de force
avec les autres villageois. Ce souci d’honneur et de respectabilité consomme l’énergie des
migrants, à tel point que certains se prêtent désormais à des activités illicites dans le but de
posséder une belle maison.
3. « Une belle maison vous fait rêver, voici l’envers du décor » : jeux et enjeux de la compétition architecturale
Lorsque j'ai commencé mes enquêtes de terrain dans le village de Mora-Massif en
2006, j’avais été logé dans une chambre individuelle que m’avait offerte ma famille
d’accueil pour me concentrer sur mes recherches. La maison en elle-même était une pièce à
deux chambres avec une toiture en tôle double pente et des entrées individuelles ouvertes
sur la cour principale. Un jardin de fleurs somptueux était planté devant la maison et en
face se trouvaient deux petites cases quelque peu négligées, dont l’une servait de logement
aux enfants, et l’autre d’enclos à chèvres et moutons. Lorsque je suis retourné en 2011 dans
le cadre de mon enquête extensive, j’ai trouvé que deux pièces avaient été ajoutées à la
maison principale, notamment une nouvelle chambre et une salle de bain avec latrine
interne. La transformation de la maison n’a pas nécessité sa destruction. Le propriétaire a
juste adossé la nouvelle chambre à côté des deux précédentes en transformant celle du
milieu en salon. De l’extérieur, le mur qui était jusque-là enduit en ciment a été légèrement
peint à la chaux, qui joue en quelque sorte le rôle de trompe-œil; la peinture étant un autre
élément de la nouveauté intégrée dans le discours local sur la joliesse de la maison.
Au niveau de l’équipement intérieur, rien n’a véritablement changé. Le propriétaire
a simplement placé au salon un fauteuil rembourré avec un oreiller sur lequel était imprimé
332
un emblème chrétien : « Que Dieu bénisse cette maison ». Un bouquet de fleurs
artificielles était accroché au mur, et un créneau pour système stéréo placé sur une petite
étagère. La salle de bain, élément nouveau, n’était pas encore fonctionnelle, et le mur
intérieur de la nouvelle chambre était toujours en chantier. En demandant à mon hôte
pourquoi il a choisi d’agrandir la maison plutôt que de la réfectionner, il expliqua qu’il
s’agit d’une réplique à la transformation d’autres maisons dans le village, notamment celle
de son voisin Mahama. En observant quelques maisons dans le village, je remarquais
effectivement que la plupart des bâtiments à une chambre-salon, modèle dominant en 2006,
ont été transformés en deux ou trois chambres, parfois avec salle de bain interne, modèle
dominant en 2011. Pour couvrir les dépenses liées à la transformation de la maison, la
plupart des propriétaires ont dû effectuer une nouvelle mobilité vers Yaoundé, qui apparait
pour eux comme l’unique moyen de disposer de liquidités.
Figure 50 : Maison en tôle construite en dur à Tala-Mokolo. Point n’est besoin de crépir une telle maison; le parpaing étant synonyme d’ascension sociale.
333
Figure 51 : Maison en tôle construite en dur à Biwana, un village podokwo de la plaine.
Le processus de transformation continue de la maison en tôle n’est pas un fait
unique à Mora-Massif. Elle touche d’autres localités, notamment Godigong et Tala-
Mokolo, où les changements sont perceptibles d’une année à l’autre. Les principales
priorités semblent ici aussi être la couleur du mur, le nombre des pièces et la présence
d’une salle de bain. Si, au début, une maison rectangulaire à toiture double pente en tôle
faisait la satisfaction de mon hôte de Tala-Mokolo en 2007, elle n’était plus la marque de
distinction en 2011, car les ménages modestes possédaient elles aussi ce type de maison. Ce
dernier n’a malheureusement pas pu ajouter des éléments nouveaux en raison, dit-il, de son
âge avancé l’empêchant de faire des va-et-vient entre le village et la ville. Sa maison perdit
dès lors sa valeur car, ce qui était maintenant en vogue était la possession d’une maison à
trois chambres-salon munie d’une douche interne. Dans ce même jeu identitaire,
l’utilisation des parpaings dans la construction est un autre un élément de prestige.
Cependant dans ce cas particulier, la maison n’est plus crépie et peinte car cela empêcherait
le passant de voir que la maison est construite en dur, c’est-à-dire avec des parpaings et non
avec les briques en terre.
Cette concurrence interne très forte a entrainé une transformation graduelle des
maisons initiales qui elles-mêmes ont fini par donner une nouvelle image au village. Pour
rester dans la compétition, les villageois privilégient l’extérieur de la maison au détriment
334
de la finesse des finitions intérieures : « la maison te représente plus à l’extérieur qu’à
l’intérieur. C’est pourquoi, c’est dans l’extérieur que les gens enterrent tout l’argent gagné à
Yaoundé » (entretien avec Madjokfa, homme de 49 ans, le 17 octobre 2011, à Tala-
Mokolo). Autrement dit, c’est l’extérieur et non l’intérieur qui, à travers le toit en tôle et la
forme rectangulaire, autorise une identité visible et prestigieuse. Tandis que l’intérieur n’est
visible que pour les gens de la famille, l’extérieur, lui, est visible pour les gens du village
de même que pour les étrangers qui peuvent évaluer le prestige et l'honorabilité du
propriétaire. L’extérieur expose, attire et incite à la consommation par le regard, mais elle
cache et dissimule aussi le contenu intérieur, laissé dans un état misérable et parfois
transformé en dépotoir pour les objets désuets. L’extérieur joue alors le rôle d' « emballage,
et de trompe œil » (Moisa, 2010: 328), donnant un aperçu inexact de ce que l’intérieur est.
En tant qu’espace interstitiel entre le propriétaire et les autres gens du village, l’extérieur
attire, comme le soulignent les propos de Madjokfa ci-dessus, tous les investissements
financiers et affectifs dans le but de performer son rôle dans l’interpellation des passants sur
la réussite de son propriétaire.
Le tourbillon de la concurrence qui s’est emparé des villageois explique dès lors le
caractère inachevé des maisons. La construction d’une « maison plus grande et plus belle »
(Moisa, 2010) que les autres maisons du village pousse les migrants à transformer, à
adapter et à agrandir leurs maisons initiales. Ce désir les enferme finalement dans un va-et-
vient incessant entre le village et Yaoundé. En tant que bâtiment qui évolue et qu’on
remanie, la maison accompagne en quelque sorte la vie de ses habitants à mesure qu’ils
prennent l’ascenseur social. Elle se prête ainsi à des multiples adjonctions : elle s’élargit,
même si elle reste en partie inhabitée; elle est à moitié finie, mais ne fait l’objet d’aucune
réfection intérieure. Celle-ci est pensée comme un projet à long terme, pour ne pas retarder
dans l’immédiat le propriétaire dans la course à la plus belle maison. En revanche, tel un
caméléon, la maison subit des métamorphoses extérieures prenant constamment la couleur
de la mode. Dans cette avenue, elle n’est jamais pensée comme un produit fini aussi
longtemps que son propriétaire effectuera des va-et-vient en direction de Yaoundé.
Finalement, l’imitation et la différenciation avec la maison du voisin reposent sur
une volonté de lutte et de violence symbolique (Bourdieu, 1997) : la logique de la
335
concurrence amène la personne alpha à reproduire le modèle du voisin béta, tout en
cherchant à le dépasser avec modération pour le rendre en quelque sorte inférieur à soi.
Béta étant humilié cherchera à son tour à relever le défi en ajoutant de nouvelles pièces à sa
maison de façon à défier Alpha et ses autres adversaires du village. Cette logique que
Daniela Moisa qualifie de « jeu du défi et de la riposte » (Moisa, 2010), est soutenue par le
désir d'occuper une place dans la hiérarchie sociale, qui n’est manifeste que par l’imitation
et la distinction d’avec la maison du voisin.
La réussite des migrants en ville qui construisent des maisons au village masque
pourtant l’échec et le revers de fortune de plusieurs d’entre eux. En effet, l’exil migratoire
ne permet toujours pas d'obtenir les moyens financiers et matériels escomptés. Dans ce
contexte, le revers de la médaille est que les migrants qui n’ont pas réussi à construire ou à
transformer leur maison sont stigmatisés, car pour l'entourage resté au village, l’exode rural
doit automatiquement déboucher sur la construction d’une maison en tôle. À quoi aurait
servi l’exil migratoire dès lors qu’il ne permet pas une transformation sociale? Constatant
l'absence de transformation de la situation sociale du migrant, l'entourage se fait moqueur,
qui par toute sorte de petits surnoms, le stigmatise, ce qui amène le migrant à user des voies
illégales dans leur quête de la maison rêvée (De Villanova et Bonvalet, 1999). Deux profils
très connus des migrants ayant connu un revers de fortune illustrent parfaitement cette
situation221.
Le premier profil est celui de Genda (pseudonyme), un ex-migrant bien connu par la
plupart des informateurs interviewés. Il doit son surnom au célèbre terroriste à qui l’on a
attribué les attentats du 11 septembre 2001 ayant détruit les tours jumelles à New York. En
2009, Genda était propriétaire d’une maison à trois chambres-salon dans son village natal
de Godigong. Comme la grande majorité des jeunes, Genda a très tôt abandonné les études
après neuf années passées sur le banc sans jamais terminer le cycle primaire. Il pensait alors
que l’école n’était pas faite pour lui et qu’il ne pourrait pas atteindre le bonheur recherché.
Il se décida d’aller se battre en ville pour voir son rêve d’avoir une maison se réaliser.
221 Les données relatives à ces deux profils ont été collectées lors des entretiens avec certains membres de leurs familles et certains de leurs proches qui reconnaissent avoir été impliqués dans des activités illicites, mais qui les ont abandonnées par la suite. Mais de manière générale, elles ont pris la forme de « rumeurs » dans la mesure où elles sont racontées au sein du village de bouche à oreille.
336
Lorsqu’il qu’il arrive à Yaoundé en 1994, Genda logeait au quartier Bastos-Nylon, dans le
fameux grand salon décrit précédemment, car ses revenus ne lui permettaient pas de louer
une chambre individuelle. Il fut premièrement employé par la SICAM (Cotonnière
industrielle du Cameroun) comme veilleur de nuit jusqu’en 1997. Malheureusement, son
inclinaison à la bonne vie ne lui a pas permis d’accumuler de l’argent pour construire une
maison acceptable. Cette incapacité l’amena à embrasser très tôt la carrière de petit bandit
en commettant ça et là de délicats larcins en compagnie de son gang. Par exemple, les gens
disent de lui qu’il dérobait des vêtements dans le comptoir de son patron qu’il revendait
ensuite à ses clients.
En multipliant les actes de délinquances, Genda est finalement écroué à la célèbre
prison de Nkondengui où il fut détenu pendant trois ans (2002-2006). Une fois libéré,
Genda essaya de réintégrer la vie normale en exerçant quelques métiers dans les périphéries
de Yaoundé. Construire était désormais devenu pour lui plus qu’une nécessité. En effet, une
maison lui permettrait de recouvrer sa dignité après des gens du village, ternie par ces trois
années passées en prison. Elle lui permettrait également de se réinscrire dans la compétition
à la plus belle maison. Ne parvenant toujours pas à accumuler malgré sa débrouillardise, il
se tourne à nouveau vers la délinquance en s’adonnant au vol et à la vente des pièces
détachées de la voiture. En 2009, il parvint à trouver un emploi de domestique dans un
ménage dans lequel il réussit à emporter une mallette d’argent. Ce nouveau coup lui permit
enfin de disposer suffisamment de liquidités que ne lui permettaient pas ses activités
légales. Finalement, il parvint à retourner au village la même année, et y construisit sa belle
maison de trois chambres.
Le deuxième exemple du rapport entre infortune, activités illicites et construction
d’une belle maison est fourni par l’histoire d’un autre migrant très connu à qui nous
donnons le pseudonyme de Mavya. Comme tous les garçons de son âge, il s’est rendu à
Yaoundé à la recherche d’une vie meilleure. Il eut la chance de trouver rapidement un
emploi de veilleur de nuit pour un salaire de 35.000 FCFA, soit environ 70 dollars
canadiens, largement supérieur au revenu mensuel de la plupart des migrants. En plus de
cela, il fit du petit commerce ambulant et ouvrit une petite alimentation au quartier Tsinga à
Yaoundé qui lui permettait d’avoir une entrée d’environ 80.000 FCFA le mois, soit environ
337
160 dollars canadiens. Mavya se fait malheureusement cambrioler par des brigands qui
réussissent à décadenasser sa boutique. Grâce à l’argent collecté par les frères du village, il
s’adonne au petit commerce ambulant, notamment la vente des cigarettes et de bonbons.
Comme il lui était difficile d’accumuler par le biais du petit commerce, il se tourne vers la
vente de la friperie qui s’avérait très prometteuse. Pendant près de deux ans, ses affaires
marchaient normalement jusqu’à ce qu’il se fasse à nouveau cambrioler. Ces deux incidents
malheureux le convainquirent qu’il était victime de masiba, considéré par les Podokwo
comme une tare qui empêche l’accumulation. Sur les conseils de ses amis, Mavya retourna
au village, sans avoir eu le nécessaire pour s’y faire un nom. Pris de jalousie devant la
réussite de ses pairs et de l’honorabilité dont ils jouissaient à leur retour au village, il
intégra un réseau de coupeurs de route (Saibou, 2010) spécialisés dans le rapt des motos.
Son rôle dans le gang était de braquer les motocyclistes et de les placer face à l’alternative
de choisir entre leur vie ou leur moto. Avec l’argent issu de ses activités criminelles, il
parvint à construire une maison à trois chambres et à ouvrir une salle de cinéma dans la
ville de Mora.
Ces deux histoires d’infortune et de revers de fortune, qui ne constituent pas des cas
isolés, montrent que les migrants urbains sont prêts à tout risquer pour satisfaire à
l’exigence d’avoir une belle maison chez soi. Pris dans l’ouragan de la compétition
architecturale, ils combinent activités légales et activités illégales pour accumuler plus vite.
Les populations locales admettent qu’aujourd’hui, le nombre des migrants s’adonnant au
vol et à d’autres activités illégales s’est considérablement accru au point de devenir un
modèle de réussite. Elles relient également la recrudescence du vol à la marginalisation
dont sont victimes les migrants infortunés une fois retournés au village. Leur échec fait en
effet l’objet des spéculations des villageois désireux d’en connaitre les véritables raisons.
On les considérait par exemple comme des gens aux mains percées, c’est-à-dire des gens
dont on est sûr qu’ils vont désacumuler quel que soit le niveau de la richesse qu’ils
atteignent. Tout compte fait, l’échec dans l’itinéraire migratoire était vécu par les migrants
comme un fardeau difficile à supporter. Ceux qui en faisaient l’objet, s’ils n’étaient pas
bannis en tant que tels, étaient néanmoins mis à distance et placés hors solidarité à travers
des chants exécutés lors des évènements populaires.
338
Par ailleurs, l'admiration ou la réprobation des délinquants urbains apparait quelque
peu ambigüe. Si les moyens illicites qui leur permettent de construire leurs maisons sont
désapprouvés, les maisons elles, ne le sont pas forcément. Pour revenir au cas de Mavya,
les villageois admirent le fait qu’il ait pensé à construire une maison dans le village, mais
sans pour autant blanchir ses actions illicites222. Dans ces villages où la concurrence à la
belle maison est désormais de mise, il parait plus dramatique de ne pas posséder une
maison que de la posséder par des moyens peu ou non conventionnels. Comme le montrent
les histoires de Genda et de Mavya, les migrants mettent en œuvre tous les moyens qui
s’offrent à eux, et sont prêts à tout risquer pour construire au village dès lors que la maison
induit des répercussions sociales et symboliques évidentes. Ne pas l’avoir pourrait
compromettre la crédibilité du migrant et provoquer son déclassement à l’intérieur de sa
communauté.
Au demeurant, la maison semble vidée de ses fonctions primaires et se trouve
transformée en un objet d'exposition et de communication de la réussite de son propriétaire
(Buchli, 2002 :209). Celui-ci n’a même plus besoin de vivre au village pour attirer
l'attention sur ce qu'il a réalisé, car sa maison le présentifie malgré son absence. Dans cette
avenue, la maison agit comme un fétiche (Miller, 2001) dans la mesure où parler de la
maison revient à parler automatiquement de son propriétaire (Daniela, 2010). Elle cesse
d’être un espace que l’individu habite pour habiter à son tour l’individu (Douglas, 1991).
Objet de tous les désirs, la maison devient dans ce contexte le principal marqueur d’une
richesse de plus en plus ostentatoire, d’où le fait qu’elle constitue parfois une arène
particulièrement fertile pour les rumeurs de sorcellerie et de pratiques occultes.
L’analyse précédente a permis de voir l’attachement indéfectible des migrants
urbains à leurs villages malgré leur absence plus ou moins longue. Nous avons vu que
l’ailleurs, c’est-à-dire Yaoundé, ne représente pour eux qu’un moyen d’accumulation et non
un but en soi. Il est rare, si non impossible, de rencontrer un migrant montagnard utiliser le
pronom possessif ma ou notre lorsqu’ils parlent de son logis à Yaoundé. Le fait est que
222Cette situation n’est pas spécifique à la région des Monts Mandara. Elle participe de ce que Dominique Malaquais appelle le processus de la « feymanisation de la société camerounaise » (Malaquais, 2002 : 113).
339
pour eux, l’on n’est jamais propriétaire d’une maison en dehors de chez soi, tout le
contraire pour la nouvelle élite composée pour la plupart des fonctionnaires qui, eux, font
partie intégrante des villes dans lesquelles ils vivent et travaillent.
B. «De l’autre côté du miroir » : nouvelles élites, nouveau comportement bâtisseur et rapports inversés avec le village
Contrairement aux migrants urbains qui n’ont pour résidence principale que la
maison du village, la nouvelle élite possède une double résidence (Moisa, 2010; Bonvalet,
1999: 213; De Villanova et Bonvalet, 1999 : 235-237), avec la principale dans leurs
milieux de travail et la secondaire au village. Ils vivent ainsi dans un système dual (Gugler,
1991 : 400), car malgré leur intégration à la vie citadine, ils maintiennent des liens affectifs
avec leurs villages d’origine dans lesquels ils se rendent pour y chercher leurs épouses. La
plupart d’entre eux conservent également leurs droits fonciers et ambitionnent de construire
leur maison de retraite au village.
Cette dualité semble être un trait général en Afrique subsaharienne. J’ai déjà évoqué
dans le chapitre précédent l’ouvrage de Joseph Gugler (1971, 1961) consacré aux élites ibo
du Nigéria. Dans cette étude, Gugler montre comment les Ibo vivant en ville fournissent un
effort considérable pour entretenir leurs liens affectifs avec le village. Si les communautés
d’origine disposent d’une vaste gamme de sanctions obligeant les élites à respecter le
principe de réciprocité, Joseph Gugler précise qu’en pratique, il ne semble guère nécessaire
d’imposer de telles sanctions, car la plupart des cadres ibo s’efforcent effectivement de
réaliser des investissements financiers et affectifs au village (1961 : 412).
L’engagement de l’élite ibo présente quelques points de similitudes et de variantes
avec celui de l’élite montagnarde du Mandara. Comme chez les Ibo, le lien entre élites et
village est souligné, mais il est ici miné d’une grande ambigüité. Les membres de l’élite
montagnarde, malgré leur attachement, prétendent qu’une certaine distance avec le village
est nécessaire et vitale. Cette prise de distance n’est assurément pas appréciée par les gens
du village qui se plaignent régulièrement du comportement hédoniste et individualiste de
leurs élites, sauf que, contrairement aux Ibo, ils ne disposent pas de sanctions susceptibles
d’obliger les élites à respecter leur solidarité primaire. En dépit de leur mécontentement, les
340
villageois sont tout de même fiers du succès de leurs fils en ville, et sont d’accord sur le
rôle important qu’ils peuvent jouer dans le développement du village. Parallèlement, les
élites se targuent d’une part de leur attachement à leur village natal, mais préfèrent en
même temps éviter une certaine intimité avec les villageois, par peur d’être mangés, une
expression qui revient couramment dans leurs discours et qui se réfère directement à la
sorcellerie (voir Geschiere, 2013, 2012, 2000, 1995). Même ceux d’entre les élites qui
tiennent des postes à caractère politique se plaignent régulièrement de la mendicité sans
limite des ressortissants du village, tout en ayant conscience du fait que leurs carrières
dépendent aussi de leurs relations avec le village. On se retrouve en face d’une relation
ambivalente marquée par la distance aussi bien que par la proximité entre élites et gens du
village, comme l’illustrent les deux cas de figure suivants.
1. Les Blancs de montagne et l’ethos de consommation ostentatoire : deux profils
Le feu Matsama (pseudonyme), ingénieur pétrochimiste de formation, est né à la fin
des années 1960. Après des études secondaires au lycée de Mora, il obtient son
baccalauréat C (option mathématiques) et figure comme l’un des premiers podokwo à avoir
obtenu un baccalauréat. Boursier du gouvernement camerounais pendant quatre ans, il fit
toutes ses études universitaires en France, où il obtint son diplôme d’ingénieur. Revenu au
Cameroun, il est tout d’abord engagé comme ingénieur à la sous-direction des
hydrocarbures au Ministère des Mines de l’Eau et de l’Énergie au début de 1984 avant
d’être recruté contrôleur de navire au port autonome de Douala pendant près de douze ans
(1989-2003). Il perdit par la suite ce prestigieux poste, mais se fit recruté comme chef de
service au ministère du commerce à Yaoundé jusqu’au moment de son décès survenu en
2006.
Vraisemblablement c’est son recrutement au port de Douala qui lui a permis de
s’offrir un luxe supérieur à celui de ses compairs montagnards. Situé sur la côte atlantique,
le port de Douala constitue un des services les plus stratégiques et les plus juteux de
l’économie camerounaise, puisqu’il contrôle toutes les entrées et sorties des marchandises
341
vers et en provenance de l’Europe. Des milliers de conteneurs y transitent chaque jour, ce
qui constitue une aubaine pour certains employés qui n’hésitent pas à solliciter des pots de
vin en échange de services. En faisant partie du lucratif contrôle de marchandises, il est
certain que le feu Matsama avait un revenu enviable grâce auquel il s’est offert une
luxueuse maison à Yaoundé. Cette maison que sa veuve m’a fait visiter est une pièce à
quatre chambres et salon dotée de toutes les commodités modernes. Si l’extérieur ne parait
guère luxueuse, l’intérieur jouit d’une commodité bien supérieure à celle des migrants
urbains. Il est bien arrangé, propre et doté d’un l’équipement ultramoderne. Le salon est
grand et occupe une bonne partie de la surface de la maison. L’ameublement comprenait
entre autres quatre canapés de valeur, un buffet vitré pour vaisselles et ustensiles, une table
de salle à manger équipée de six chaises. Des photographies de mariages et des messages
bibliques sont fixées au mur, et des bouquets des fleurs disposés çà et là dans les coins du
salon. Une télévision pourvue des haut-parleurs complétait le décor déjà impressionnant.
Malgré le luxe dans lequel il vivait en ville, le feu Matsama n’avait pas construit
une maison au village, ce qui heurte visiblement les montagnards qui n’ont pour explication
que des soupçons de sorcellerie. Des rumeurs circulent sur le fait qu’il aurait été charmé et
ensorcelé par sa première épouse d’origine bassa, laquelle est accusée d’être responsable de
sa mort dans le but de posséder ses biens immobiliers, notamment la luxueuse maison de
Yaoundé. D’autres villageois incriminent plutôt Matsama et le soupçonnent d’avoir signé
un pacte avec des forces occultes pour s’enrichir. Ils soutiennent que sa mort serait liée à
son choix d’avoir refusé de livrer des parents pour purger sa dette vis-à-vis de ces forces
occultes223. Tout compte fait, le rapport entre le feu Matsama et son village d’origine était
parsemé d’un tel quiproquo que la simple évocation de son nom suscite encore des remous
dans le village. Bien qu’il soit décédé, Matsama incarne toujours l’image de quelqu’un qui
223 Comme le souligne une fois encore Peter Geschiere, la notion de dette (2000 : 24) est un autre élément très récurrent dans la fantasmagorie de la sorcellerie, une dette de laquelle on ne peut s’acquitter qu’en vendant un parent (2000: 21).
342
ayant réussi, a rompu le lien de réciprocité qui constitue pourtant l’un des éléments clés de
la matrice morale (Schatzberg, 2001) montagnarde.
Quant à Moussa (pseudonyme), il est né dans les années 1970 dans une famille de
catéchistes. Contrairement aux jeunes de son village, il eut la chance d’être très tôt inscrit à
l’école et de terminer son cycle secondaire au lycée de Mora. Malgré les moyens limités de
ses parents provenant essentiellement du travail agricole, il rejoint l’Université où obtient
sa licence. L’année d’obtention de sa maitrise coïncidant avec les élections présidentielles
au Cameroun, Moussa fut sollicité par le Rassemblement démocratique du peuple
camerounais (RDPC), parti au pouvoir, pour faire partie de l’équipe de campagne dans les
villages de montagne relevant de la circonscription administrative du Mayo-Sava. À l’issue
des élections, le RDPC s’en est sorti avec 91,76% de voix dans cette région224. Ce résultat
honorable lui ouvre de la fonction publique en dépit du contexte camerounais marqué par le
difficile accès à l’emploi. Moussa fut ainsi recruté en 2004 dans une grande société
d’État225. À partir de ce moment, il connut une ascension fulgurante jusqu’à atteindre le
grade de directeur de service. Son succès, pourrait-on dire, est lié à son itinéraire éducatif
plus ou moins long, mais aussi à son rôle dans la mobilisation des électeurs en faveur du
parti au pouvoir.
Moussa est propriétaire d’une grande villa à Yaoundé. La villa de Yaoundé est un
appartement à quatre chambres et deux salons lesquels sont entièrement meublés. La
qualité de l’ameublement est incontestablement une indication de l’importance de son
patrimoine personnel. Le premier comporte quatre fauteuils en cuir, un buffet vitré, une
table basse, une salle à manger moderne, une télévision à écran plasma, et un ensemble
lecteur VCD. La partie faisant office de salle à manger est séparée du salon proprement dit
par une étagère basse directement intégrée à la construction. Beaucoup plus modeste en
224 Le document établissant les pourcentages obtenus par la liste RDPC dans les départements et dans les provinces a été obtenu via le lien suivant : www.camerounlink.net/publications/resultatsrdpc.doc 225Dans le but de protéger l’identité de l’intéressé, j’ai choisi de ne pas révéler le nom de la société dans laquelle il travaille. En effet, étant donné qu’il y a peu d'originaires des monts Mandara qui sont parvenus à son statut dans l’administration publique, il est possible qu’en dépit du pseudonyme, que les populations locales puissent l’identifier si le nom de la société est dévoilé.
343
qualité et en quantité, le second salon est néanmoins doté de certaines commodités
modernes tels qu’une télévision, un lecteur DVD, un mobilier de salon et de salle à manger,
un congélateur, un réfrigérateur, une radio ainsi qu’un tapis qui orne le sol pourtant carrelé.
En plus de la maison de Yaoundé, Moussa dispose aussi d’une maison construite en étage
au village, mais se trouve encore en chantier et est dépourvue d’ameublement intérieur.
Les cas esquissés ci-dessus ont été volontairement choisis pour illustrer les
principales caractéristiques de la culture matérielle du succès chez la nouvelle figure
émergente de ce que les montagnards considèrent comme leurs élites226. En dépit de leur
absence, les villageois essaient toujours de connaitre leur opinion avant de mettre un projet
en exécution. Même les chefs de canton semblent pris de court par l’émergence de ces
fonctionnaires au point où ils admettent, à l’instar du chef d’Udjila que « nos fils en ville
sont plus écoutés que nous qui sommes les chefs », des propos qui donnent raison à Jean-
Pierre Warnier (1993) qui caractérisait les chefferies en territoire bamiléké comme des
coquilles vidées de leur substance, mais de nouveau remplies par les élites urbaines.
Un point commun dans les profils de ces Blancs de montagne est le rôle
déterminant de l’éducation, qui pourtant s’est démocratisée tardivement dans la région. Les
premières écoles primaires n’émergent que dans les années ayant précédé l’indépendance,
et les collèges sont de création récente. Dans ce contexte, le simple fait d’avoir franchi le
seuil de l’université était en soi une distinction sociale pour la première génération de l’élite
montagnarde. Or, ce sont en général les enfants des pauvres qui firent de longues études;
les enfants issus des familles royales étant épargnés car on avait de l’école l’image d’un
lieu où on punissait à coup de fouet227. Quelques années plus tard, ces jeunes nantis de leurs
diplômes, firent leur entrée dans la fonction publique camerounaise, à l’instar de Matsama
226 Se référer à l’introduction sur la notion d’élite telle qu’utilisée dans le cadre de ce travail. 227 Dans certaines localités des monts Mandara, des qualifications modestes suffisaient pour atteindre des positions impressionnantes. On dit par exemple de Fetekwe Made, l’emblématique député d’origine muktele qu’il n’était muni que d’un certificat d’études primaires élémentaires (CEPE). Des exemples pareils peuvent être trouvés dans d’autres ethnies des monts Mandara. Par exemple, chez les Mafa, le député Gonondo, instituteur de l’enseignement primaire de formation n’avait que son CEPE. Et pourtant, il est député à l’Assemblé nationale pendant une vingtaine d’année et avait même siégé au bureau de l’Assemblée nationale en tant que questeur numéro 2. On pourrait aussi citer le cas de Cavaye Yegué Djibril, actuel président de l’Assemblée nationale du Cameroun depuis 1992 qui ne détient qu’un certificat d’étude primaire, lui aussi. L’avènement de cette première génération d’élites était donc marqué par une mobilité sociale très remarquable, mais aussi pleine d’incertitudes.
344
et de Moussa. En raison de la politique de l’équilibre régional, les diplômés montagnards
étaient très recherchés pour combler le supposé retard que leur région accusait par rapport à
d’autres. Leur succès inattendu a inévitablement contribué à la réévaluation de
l’enseignement, tel qu’aujourd’hui les villages mènent une âpre compétition pour disposer
de leur propre école, parfois financée par des fonds de développement local. Tout porte à
croire que l’école a déclassé la migration et se présente aujourd’hui comme le principal
moyen d’ascension sociale. En dépit de l’effet de la crise économique qui limite
considérablement l’insertion des diplômés dans la vie active, l’école reste vénérée dans
toutes les localités montagnardes.
L’ascension sociale des jeunes diplômés a naturellement accentué les inégalités
sociales, rendant le rapport élites/villages plus ou moins équivoque. Dans le même sens, le
fossé entre les revenus des fonctionnaires et ceux des migrants urbains emboite le pas à la
logique du « défi et de la riposte » (Moisa, 2010), dans la mesure où « leurs maisons sont
d’une autre classe » (entretien avec Lade Ndawaka, homme de 27 ans, le 11 avril 2014, à
Yaoundé). Leur style de vie est tout aussi différent, et comme le disent les villageois eux-
mêmes, ils sont plus civilisés, d’où l’épithète de Blancs de montagne qu’on leur colle à la
peau. De fait, l’élite intellectuelle participe d’une culture matérielle du succès de façon tout
à fait différente des migrants urbains; une culture matérielle du succès marqué par un
besoin de consommer pour acquérir du confort. Le salon est la partie de la maison qui
illustre bien ce processus.
2. Maison, salon, télé : de l’ordre privé au verdict public
Dans les deux cas de figure présentés ci-dessus, on reconnait immédiatement les
éléments matériels du répertoire africain de la réussite et de l’aisance, à savoir un salon
entièrement décoré et meublé, une télévision écran plasma, et un tapis de préférence
d’origine orientale (Warnier, 1993 : 181).
Le salon figure comme le principal cadre privilégié de la maison, et à ce titre, il
apparait comme la partie la plus fournie et la plus ordonnée de toute l’habitation. Dans
toutes les maisons visitées, les salons présentent la même physionomie et la disposition des
meubles est plus ou moins identique. Premièrement, ils sont pourvus de nombreux
345
fauteuils, en général quatre, dont un sofa à trois places, un autre à deux places et les deux
derniers à une place chacun. Dans les ménages les moins fortunés, les fauteuils étaient de
fabrication locale achetés auprès des tapissiers garnisseurs. Ces derniers offrent des
ensembles salon/salle à manger de style uniforme aux finitions qui paraissent
irréprochables. Cependant, comme le souligne fort bien Jean-Pierre Warnier (1993), le
rembourrage des fauteuils cache en réalité la misère de son cadre en bois et la pauvreté de
son assemblage. Les fauteuils sont complétés par des chaises en grand nombre, disposés çà
et là dans le salon. Elles sont acquises en prévision des rencontres entre « frères du village
habitant la même ville ». Pour se limiter au cas de Moussa, il dit recevoir mensuellement la
rencontre de l’association des ressortissants muktele de Yaoundé. En sa qualité d’élite
principale de son village, Moussa reçoit aussi des visites spontanées, et parfois
imprévisibles, de tel ou tel montagnard venant « saluer leur grand », mais profitant aussi
pour lui exposer des problèmes financiers. À cela il faut ajouter des réunions familiales
avec des cousins et oncles vivant à Yaoundé, ce qui amène souvent Moussa à se plaindre de
la situation :
On reçoit beaucoup des gens à la maison, ce n’est pas du tout facile, mais on fait avec. Madame est obligée de tout ranger chaque matin en prévision à des visites imprévues. Ce qui est plus gênant, ce sont des gens qui se réclament être tes cousins. On dirait que j’ai 100 cousins qui vivent ici à Yaoundé. Ils sont toujours là, surtout les dimanches […]. Ils ne viennent pas seulement pour te rendre visite, mais pour créer un lien affectif de sorte que, quand ils vont te soumettre un problème, que tu sois obligé d’y répondre financièrement. Si tu ne fais rien ça va chanter dans tout le village que tu as renié tes frères (entretien avec Moussa, homme de 39 ans, le 17 décembre 2011, à Yaoundé).
Le rangement à effectuer quotidiennement dont parle Moussa fait par ailleurs
émerger le salon comme un lieu réservé à l’intimité familiale d’une part, et comme un
« espace transactionnel avec le monde extérieur » (Rigins, 1994), d’autre part228. De fait, le
salon, en plus de remplir les fonctions de pièce à vivre (Foucarde, 2007), se fait aussi lieu
de rassemblement familial et espace de réception des autres (Pezeu-Massabuau, 1983 : 228En parlant des sociétés modernes contemporaines, Stephens Rigins écrit que : « this architectural feature that is found in practically every house and apartment constitutes a transactional space for the household as well as a stage for selective contacts with the outside world ».
346
118), d’où le rôle qu’il tient en tant que lieu interstitiel et transitionnel entre le dedans et le
dehors (Foucarde, 2007 :161; Pezeu-Massabuau, 1983 :118). Ce double statut lui permet
d’être à la fois le point névralgique de l’intimité familiale et le lieu où se construit et se
communique la réussite du propriétaire (Pezeu-Massabuau, 1983 : 118). Sa configuration
mobilière nettement plus fournie et plus contrôlée que dans le reste de la maison ne peut
être pensée en dehors de cette dialectique qu’elle crée entre le monde intérieur et le monde
extérieur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est toujours gardé dans une propreté
impeccable car, comme Jean-Pierre Warnier le précise, l’identification du statut moderne se
mesure aussi à la propreté des objets domestiques disposés au salon (1993 : 188). Une
stricte discipline était ainsi observée dans le lavage quotidien du sol et le nettoyage régulier
du salon dans les ménages visités. Au côté du salon, la salle à manger qui lui est
directement accolée fait aussi l’objet de toutes les considérations se traduisant elle aussi par
le soin particulier accordé à l’ordonnancement des meubles.
Figure 52 : Salon et salle à manger de la maison d’une fonctionnaire originaire des monts Mandara vivant à Maroua
347
Idéalement, le salon comprend presque toujours les éléments ci-après : des
immenses fauteuils, de préférence en cuir sinon en tissu ou en synthétique, une table basse
vitrée, des buffets individuels chacun placé à côté d’un fauteuil, des nappes à dentelle pour
recouvrir fauteuils et tables, des tables et chaises de la salle à manger, une armoire vitrée
pour vaisselles précieuses, une horloge murale, un téléphone fixe de l’opérateur CAMTEL,
et une télévision écran plasma équipée d’un lecteur DVD, le tout placé sur une table sur
roulette. Une bibliothèque et une table pour ordinateur intègrent de plus en plus ce confort
déjà somptueux, surtout dans les salons de ceux qui se réclament intellectuels. Quant à la
salle à manger, elle est pourvue d’une table et de plusieurs chaises. C’est là que la famille et
les visiteurs de marque prennent les repas, ce qui veut dire qu’elle remplit également le rôle
de l’entre-deux, et à ce titre, un soin particulier lui est accordé pour répondre à la fois à la
logique de repli familial et d’ouverture au monde. Autrement dit, le salon et la salle à
manger n’ont pas pour seule fonction psychologique de réassurer le propriétaire sur la
qualité de son ameublement, ils remplissent aussi la fonction sociologique de l'affilier à
toute la classe des individus qui possèdent les mêmes meubles et de la même façon
(Baudrillard, 1969 : 34). Un élément de l’ameublement du salon mérite qu’on s’y attarde :
il s’agit de la télévision à écran plasma.
348
Figure 53 : Salon d’un haut fonctionnaire originaire des monts Mandara vivant à Yaoundé
En décembre 2011, j’ai initié une tournée dans quatre métropoles camerounaises
(Yaoundé, Douala, Maroua, Garoua) pour rencontrer des membres de l’élite nouvelle
podokwo, muktele et mura afin d’échanger avec eux autour du sujet de ma thèse. J’ai pu
visiter la maison de quatorze personnes au total occupant des postes variés dans
l’administration camerounaise. En tant que lieu de réception et d’accueil des étrangers, j’ai
toujours été accueilli au salon pour nos discussions. Sur les quatorze ménages, 12
disposaient d’une télévision à plasma présentant parfois des images à haute définition. Le
premier réflexe des gens de la maison était d’allumer la télévision qui restait pendant toute
la durée de ma visite. Dans les familles fortunées, comme celle de Matsama et de Moussa,
le téléviseur était câblé à canal satellite permettant de suivre une variété de programmes des
chaines étrangères, notamment françaises. Lorsque le programme semblait de peu d’intérêt,
on éteignait la télévision pour la remplacer naturellement par un lecteur VCD distillant des
clips de danse africaine. Le fait que l’écran soit toujours allumé ne signifie pas que nous y
étions intéressés, car dans la plupart des cas, nous ne prêtions aucune attention aux
programmes qui s’y déroulaient.
349
Figure 20 : Télévision au salon d’une élite montagnarde de Yaoundé : un élément important dans la mise en scène du soi.
Figure 55 : Télévision au salon d’une élite montagnarde de Maroua : un élément important dans la mise en scène du soi.
350
Ces observations confirment les enquêtes menées par Jean-Pierre Warnier (1993) au
début des années 1990 sur l’itinéraire d’accumulation de l’élite moderne camerounaise.
D’après l’auteur, le simple fait de posséder un téléviseur était perçu à cette époque comme
un élément de confort. Dans certains ménages dans lesquels il fut logé, Jean-Pierre Warnier
remarquait que la télévision n’était éteinte que lorsqu’il n’y avait plus personne au salon
(1993 :182). Même lorsque l’écran ne montrait qu’un motif multicolore aux heures creuses,
il n’était pas rare, remarquait t-il, qu’il restait allumé aussi longtemps que les gens
trainaient au salon (1993 :182). Plus que la quête de l’’information ou de la distraction, la
mise en marche de la télévision servait surtout pour attirer le regard du visiteur afin de
l’orienter vers les caractéristiques et la taille de l’écran.
Le temps n’a visiblement pas rendu caduque les remarques de Warnier, à la seule
différence que chez l’élite montagnarde actuelle, la distinction sociale ne se joue plus
seulement dans la seule possession de la télévision, que la distinction sociale, mais
également dans les nouvelles gammes que favorise aujourd’hui le développement
technologique. Ainsi, est-ce logiquement que les élites, même les moins fortunées
participent à la course au plus grand écran plasma. Dans certaines maisons, il n’était pas
rare de remarquer la présence d’un écran géant dans un salon pourtant de dimension très
restreinte. Sa présence donne en effet l'apparence d'un certain niveau de vie, vu que son
achat est communément reconnu comme une forte dépense. C’est d’ailleurs son coût
d’acquisition plus ou moins qui en fait un objet réservé à une élite, surtout dans les villes
secondaires où son usage ne s’est pas encore vulgarisé.
En tant qu’innovation récente, le téléviseur à écran plasma fait en outre figure
d’entrée dans l’ère de la technologie et de la modernité, et est parfois sacralisé au-delà de sa
fonction de communication. Exposant social, elle ne fait pas seulement fonction d'objet,
mais aussi et surtout fonction de preuve (Baudrillard, 1969), d’où le fait qu’elle soit mise en
valeur et exposée à la vue du visiteur. Quand bien même elle serait dysfonctionnelle et
cesserait d’émettre des images et des sons, elle est rarement mise hors d’usage, car sa
dysfonctionalité ne lui enlève pas son potentiel de prestige. Quoiqu’en panne, elle restera
au salon jusqu’à l’acquisition d’une nouvelle télévision. Comme l’écrit Jean Baudrillard
(1969), l’important n’est pas de posséder, mais de « souligner deux fois, trois fois ce qu'on
351
possède » et « c’est dans cette redondance des signes, dans leurs connotations et leur
surcharge » que se joue la distinction sociale. La valeur d’usage de la TV (émettrice
d’images) n’est donc pas ce qui compte le plus, car celle-ci est supplantée par la valeur
sociale et symbolique. Dans certains cas, la valeur d'usage ne sert d’alibi qu’à la valeur
d'échange symbolique. Dans ce contexte, le fait de mettre la télévision en marche n’est pas
seulement une invite à regarder les programmes qui y sont proposés, mais plutôt un acte qui
permet de (re)cadrer l’attention des visiteurs pour qu’ils contemplent cet objet de prestige
au sein de la maison.
Contrairement aux migrants urbains chez qui la représentation de soi se joue à
l’extérieur de la maison par le biais de la façade (toit en tôle et mur rectangulaire), on
s’aperçoit que chez cette nouvelle élite, elle se joue plutôt à l’intérieur des murs de la
maison. En tant que lieux pour soi et lieux pour l'autre (Foucarde, 2007; Pezeu-Massabuau,
2002), salon et salle à manger constituent les deux principaux lieux d’étalage du confort.
D’où la qualité de l’ameublement qui devient ici le symbole de la réussite individuelle
(Chevalier, 1998: 507). Pourtant, le salon et la salle à manger n’ont rien de spécifiquement
montagnard, ils participent plutôt de la négociation, sinon du bricolage de l’idéal véhiculé
par la société postmoderne caractérisé par la consommation d’objets modernes et de
nouvelles factures (Perrot, 1993 :145).
En dehors des maisons qu’ils construisent en ville, certains grands, à l’instar de
Moussa, possèdent des résidences secondaires au village, construites parfois en étage, mais
qui sont loin d’être terminées et inhabitées. Contrairement aux maisons de la ville où
l’intérieur est priorisé par rapport à l’extérieur, ici c’est l’extérieur qui gagne en
importance. De fait, les élites s’inscrivent dans la même logique qui guide les constructions
de manière générale au village, laquelle privilégie toujours l’extérieur de la maison au
détriment de l’intérieur. En jouant le rôle d’emballage (Moisa, 2010 : 328), la façade
extérieure, le plus souvent en béton, participe de la culture d’exposition et de séduction
(Baudrillard, 1988) en incitant les passagers à consommer le statut social du propriétaire
tout en dissimulant un intérieur sale, délaissé et ignoré. Finalement, ce n'est plus le passant
qui regarde, mais c'est la façade qui oriente et attire son regard (Moisa 2010 : 331), ce
d’autant plus qu’elle contient des éléments nouveaux que sont la terrasse et le balcon. Dans
352
cette avenue, les maisons construites au village par les fonctionnaires perdent de leurs
fonctions habituelles d’abri pour devenir un fétiche (Miller, 2005). À ce titre, elles
n’accueillent pas les propriétaires, mais elles les remplacent en les représentant (Nicolau et
Althabe, 2002 : 2) pendant la période de leur absence. La maison du village devient ainsi
une projection de soi (Chétima, 2011; Nicolau et Althabe, 2002) pour soi et pour les autres,
à tel point qu’il ne vaut plus la peine que l’homme soit présent pour savoir qui il est et ce
qu'il représente (Daniela, 2010).
En construisant des maisons inhabitées au village, l’objectif n’était certainement pas
la possession d’un abri, mais plutôt la quête de l’honorabilité auprès des gens du village, de
sorte que « quand ils passent par là, ils puissent dire: ça c’est la maison de Madjokfa qui
travaille en ville » (entretien avec Madjokfa, homme de 49 ans, le 17 octobre 2011, à Tala-
Mokolo). Toutefois, le comportement bâtisseur des élites semble produire un résultat
inverse, car tout en admirant et enviant leur réussite, les gens du village posent un certain
nombre de questions quant à l’origine réelle de leur richesse. Ils se demandent d’où leur est
venu l’argent qui leur a permis de s’offrir une pareille maison? Ce genre de
questionnements varie certes d’une élite à une autre, mais permet dans la plupart des cas,
d’articuler les discours actuels sur la dialectique entre richesse et sorcellerie.
3. Élites, un danger ou élites en danger? Les paradoxes de la nouvelle relation élites/village
Dans de nombreuses régions d’Afrique, de puissantes rumeurs ont circulé sur les
causes profondes et secrètes de l’apparition de richesses nouvelles, que les gens associent à
de pratiques occultes. Une série d’études ont permis d’éclairer ce phénomène, notamment
les travaux passionnants d’Éric de Rosny (1992, 1982), de Michael Rowlands et Jean-
Pierre Warnier (1988) ou et surtout de Peter Geschiere (2000, 1996, 1995). Contrairement à
l’ancienne forme de sorcellerie toujours associée au malheur et à la mort, comme le montre
l’étude classique d’Evans-Pritchard (1937), la nouvelle sorcellerie, aussi appelée
« sorcellerie de la richesse » (Geschiere, 2000 : 21) explique quant à elle la bonne fortune
(Warnier, 1993 : 74). Les significations qui lui sont associées sont d’une telle ambivalence
que Patrick Chabal et Jean-Pascal Daloz (1999) la considèrent comme l’une des
caractéristiques, sinon la principale, de ce qu’ils appellent la « modernité africaine ».
353
Cette ambivalence du discours sur la sorcellerie est observable dans les monts
Mandara, et reflète le conflit structurant les rapports entre élites et villages229. Dans le
chapitre précèdent, j’ai montré que la sorcellerie avait une connotation particulièrement
restreinte et surtout négative. Avec l’émergence de la nouvelle élite, la conception ancienne
se trouve nettement élargie, intégrant désormais d’autres paramètres notamment
l’acquisition des biens mobiliers et de la richesse. Chez les Podokwo par exemple, deux
expressions marquent la différence entre l’ancienne et la nouvelle conception de la
sorcellerie, à savoir mede pour la dimension anthropophagique et nafa pour l’aspect
accumulateur. Les mede agissent dans une logique purement individualiste et antisociale
avec pour principale motivation la jalousie, alors que les gens qui pratiquent le nafa sont
dans une logique d’accumulation et d’enrichissement. Dans la pratique par contre, la
différence n’est pas si tranchée dans la mesure où les élites qui réussissent sont aussi
soupçonnées de vendre leurs proches à des fins d’accumulation, et ce succès suscite
inversement la jalousie des cadets sociaux qui se servent du mede pour niveler la
différence.
Tout compte fait, les discours actuels sur la sorcellerie offrent un idiome de
prédilection, à la fois pour les nouvelles élites et pour les cadets sociaux du village
(Geschiere, 1996: 85). Le confort des premiers, matérialisé par la possession des
maisons hors pair fascine les gens du village, mais les laisse tout aussi perplexes et déçus
dans la mesure où ils ne peuvent y accéder. Dans cette avenue, les nouveaux riches font
l’objet de rumeurs et sont soupçonnés de devoir leur richesse, non pas à leur itinéraire
éducatif plus ou moins long, mais surtout au fait qu’ils pratiquent le nafa dont la phase-clef
est la vente des parents. D’où l’angoisse des cadets sociaux du village qui, craignant d’être
sacrifiés par leurs grands préfèrent parfois les éviter. Le revers de cette fantasmagorie de la
richesse est en retour la crainte des élites d’être la cible de la jalousie des gens du village
229Peter Geschiere montre par exemple qu’au Cameroun, le nouveau discours articule à la fois la sorcellerie comme un mal primordial et comme une force surnaturelle pouvant être canalisée à des fins constructives, notamment à des fins d’accumulation de pouvoir et de richesse, d’où la tendance d’associer les nouvelles élites à cette sorcellerie de la richesse qu’ils appellent aussi « sorcellerie des Blancs » (1995 : 177). Alors que les sorciers locaux sont destructeurs de l’ordre social, la sorcellerie des Blancs contribue plutôt à la production des formes de richesse. Les sorciers locaux agissent dans une logique purement individualiste alors que les sorciers blancs sont dans une logique communautariste.
354
qu’ils soupçonnent d’utiliser le mede pour les éliminer. Cette situation les oblige à faire un
compromis entre la réussite et « l’accusation d’ingratitude, toujours lourde de menaces
sorcières » (Marie, 1997 : 256). Les élites se trouvent en réalité en face d’un dilemme :
rompre le lien de réciprocité en construisant une maison loin du village - ce qui alimentera
davantage les rumeurs sur leur réussite -, ou maintenir les rapports avec le village en
bravant la peur de se faire ensorceler230. De cette alternative émerge une troisième
signification de la sorcellerie en tant que force protectrice dont les élites peuvent se
prévaloir si elles souhaitent construire et vivre au village. Un cas de figure peut servir à
illustrer ces trois mouvances du discours sorcellaire.
Vigue Vaza (pseudonyme) est un cadre militaire qui a connu un succès croissant
dans les milieux podokwo étant le premier d’entre eux à avoir atteint le grade de sergent-
chef. En plus de son emploi, il participait aussi au commerce des voitures en provenance du
Bénin. L’argent issu de l’épargne sur son salaire et de ses activités commerciales lui a
permis de bâtir un duplex à Yaoundé et un autre dans son village d’origine. Des rumeurs
autour de sa fortune ont très tôt circulé et plusieurs versions divergent. Certains pensent
qu’il pratique le nafa et aurait signé un pacte avec des forces occultes qui lui exigeraient
des sacrifices humains en retour desquels il recevrait de leur part d’importantes sommes
d’argent. Lorsque dans le cadre de mes travaux, je demandais à un informateur ce qu’il
pensait de la maison de Vigue Vaza, il regarda autour de lui avant de chuchoter à voix
basse qu’il s’agit d’une maison du sang. Un autre informateur est allé jusqu’à le qualifier
de sorcier, car « chaque fois qu’il rentre au village, quelque chose de grave arrive à un
membre de sa famille » (entretien avec Mezhəne, homme de 35 ans, le 11 mars 2012, à
Udjila).
Les villageois en prennent pour preuve un accident de voiture que Vigue Vaza eut
en 2004 au cours d’un voyage effectué sur Maroua qui aurait provoqué des fractures plus
ou moins ouvertes à deux des personnes qui l’accompagnaient. Les gens du village auraient
230Les accusations réciproques montrent qu’on est en réalité en présence d’un discours dialectique sur l’usage de la sorcellerie dans le rapport entre élites et village, et ces accusations récursives reflètent la tension entre ambition de l’élite et jalousie des gens du village (Geschiere, 1996 : 85). Comme le montre les études de Peter Geschiere (2013, 2011, 2000, 1996, 1995), la sorcellerie a un versant égalisateur pour les villageois et leur sert comme une arme contre les ambitions démesurées des nouveaux riches. Inversement, elle sert aussi à l’élite pour conforter son ascendance sociale.
355
aussitôt accusé Vigue Vaza d’être lui-même à l’origine de cet accident, car « il lui fallait
fournir du sang humain à son fétiche » (entretien avec Sevda Chikoua, homme de 44 ans, le
27 janvier 2012, à Godigong), condition sine qua non pour purger sa dette envers les forces
occultes. Lorsque je rencontrais Vigue Vaza, toujours dans le cadre de mes recherches, je
constatais qu’il prenait lui-même ces accusations suffisamment au sérieux, car il ne
manquait pas de se référer à son accident alors même que nous discutions des
caractéristiques des nouvelles maisons. Il m’expliqua au cours d’une rencontre son envie de
quitter le village et de s’établir dans sa maison de Yaoundé pour sortir de la bouche du
village, c’est-à-dire pour être à l’abri des rumeurs le concernant.
Des histoires pareilles qui font le lien ente succès des élites et sorcellerie font légion
dans les villages montagnards. À Tala-Mokolo, un jeune cadre d’administration est
soupçonné d’avoir vendu ses cheveux pour acquérir de l’intelligence à l’école, laquelle lui
aurait permis d’être plus tard admis au concours de l’École nationale d’administration et de
magistrature (ENAM). Un officier de police d’origine podokwo aurait vendu quant à lui
son propre papa en échange duquel on lui aurait promis un avancement rapide dans le
grade. Ces accusations sont évidemment difficiles à vérifier et leur provenance est peu ou
pas du tout connue. En suivant la suggestion de Luise White (1993)231, le but n’est pas de
s’en tenir à leur crédibilité, mais plutôt de mettre en lumière le mécanisme de nivèlement
social (social levelling mechanism) (Geschiere, 1997) et de régulation des rapports
élites/villages. Dans la partie précédente, j’ai brièvement évoqué deux principes qui
encadrent la concurrence à laquelle se livrent les migrants dans la construction des belles
maisons, à savoir le respect de l’adversaire et l’obligation de construire au village.
Revenons à ces deux logiques en les prenant à tour de rôle comme point de départ de
l’articulation de nouveaux discours sur la sorcellerie.
Dans la logique du défi et de la riposte, il y a implicitement une obligation pour le
constructeur à prendre en compte la capacité des autres à répondre au défi. De fait, la
231En général, les personnes qui rapportent des rumeurs ne citent que rarement leurs sources d’information et n’offrent presque jamais de preuves empiriques. D’ailleurs, quand bien même il s’agirait des rumeurs, les gens ont tendance à parler à très basse voix, en chuchotant dans les oreilles, de peur que le vent n’emporte les paroles pour les porter aux oreilles de la personne accusée. Toutefois, comme l’écrit Peter Geschiere (1995: 29), ces rumeurs, à force d’être répétées, finissent par devenir vraies pour ceux qui les racontent (White, 2000: 31).
356
construction d’une belle maison sonne comme un défi lancé au voisin232. Ce dernier se
sentant avili, doit laver l’affront en construisant une maison plus ou moins semblable, mais
un peu plus grande. Autrement dit, la logique qui gouverne la compétition architecturale
voudrait que les adversaires aient des armes égales pour permettre la réciprocité de la
réplique233. Or, les nouvelles élites semblent faire fi de cette logique dans la mesure où,
quand bien même ils construisent des maisons au village, ils le font démesurément de sorte
que l’argent épargné par les migrants ne permet pas la riposte. Étant parfois construites à la
verticale, les maisons de ces Blancs du village surpassent en hauteur les modestes
constructions des autres villageois, ce qui ébranle visiblement les relations de sociabilité
qu’ils entretiennent avec le village. Tout en suscitant l’émerveillement des villageois, ces
maisons donnent lieu à des suspicions, car ces derniers s’interrogent sur les moyens
d’acquisitions qui ont permis de construire une telle maison, ce qui constitue une arène
particulièrement fertile à des accusations réciproques de sorcellerie.
Comme le montre l’histoire de Vigue Vaza, les élites sont régulièrement accusées
d’avoir vendu tel ou tel parent décédé à des buts d’accumulation. Dans la mesure où la
maison représente l’objet d’investissement par excellence, les rumeurs de sorcellerie
produisent une peur généralisée de ceux qui possèdent des maisons ostentatoires au village.
Pour revenir à l’exemple de Vigue Vaza, plusieurs personnes me confièrent qu’ils évitent
d’accepter tout don venant de lui, car dans l’imaginaire local, cela pourrait les transformer
en moyen de paiement de sa dette vis-à-vis des forces occultes. Dans cette même avenue, la
plupart des belles maisons construites par les élites restent vides, car personne n’ose y
rester. Habiter une telle maison rendrait automatiquement le bénéficiaire vulnérable aux
forces occultes. De fait, les grandes maisons étaient considérées comme dangereuses et
plaçaient dès lors le propriétaire forcément dans l’aire de la sorcellerie.
La pression lourde qu’exercent les gens du village sur les élites à travers des
rumeurs de sorcellerie a pour principal objectif la redistribution de leurs nouvelles richesses
et la redéfinition des structures et des hiérarchies sociales, devenues de plus en plus
232 Voir aussi l’intéressante étude menée par Daniela Moisa (2011; 2010; 2009) sur les principes qui rythment les constructions des nouvelles maisons en contexte migratoire, et dans lesquels elle explique amplement comment s’effectue cette dialectique du défi et de la riposte chez les Certeze de Roumanie. 233 Une comparaison s’impose ici avec la logique qui préside aux constructions des nouvelles maisons chez les Certeze de la Roumanie étudiés par Daniela Moisa (2010) dans le cadre de sa thèse de doctorat.
357
inégalitaires. En effet, l’élite locale, à l’instar de Matsama, Moussa et Vigue Vaza dont j’ai
présenté le profil, a réussi à dépasser de façon très ostentatoire le niveau de vie de leurs
pairs du village. Or, dans l’imaginaire local, on ne devient fortuné que par la dépossession
de quelqu’un d’autre, « puisque l’enrichissement de tous n’est pas concevable » (Muller,
2003 : 499). La fortune des élites est d’autant plus suspecte qu’elle est accumulée ailleurs,
loin du regard de la communauté qui est la seule habilitée à arbitrer la « joute de
l’honneur » (Moisa, 2011; 2010).
Dans cette avenue, on peut dire que les rumeurs fonctionnent comme un processus
de nivèlement (Geschiere, 1996) des inégalités entre les cadets sociaux du village et les
fonctionnaires de la ville. Autrement dit, les gens du village disposent des rumeurs
comme « arme égalisatrice » (Geschiere, 2013, 2011; Fisiy et Geschiere, 1993) pour
obliger les élites à la distribution. Toutefois, les rumeurs semblent produire exactement le
contraire de l’objectif recherché, car loin d’obliger les élites à la distribution, ils suscitent
chez elles la peur du village. Prise à son tour de panique, elles pensent que la jalousie des
villageois leur pourrait être mortelle s’ils maintiennent leurs liens affectifs avec le village,
d’où leur forte tendance à s’établir ailleurs, pour se soustraire, à la fois, aux accusations et
aux attaques de sorcellerie. Or, il y a un second principe qui règlemente la concurrence
architecturale, à savoir l’obligation de construire au village.
L’individu qui souhaite être reconnu comme un homme qui a réussi doit construire
une maison dans son village. C’est seulement au village, sous le regard de la communauté,
que la belle maison peut devenir une source d’honneur et de respectabilité pour l’individu.
Or l’élite montagnarde d’aujourd’hui, à l’instar de Matsama et de Moussa, choisit de plus
en plus de construire leurs maisons en villes pour se soustraire à la menace et à la jalousie
de leurs parents. En construisant avec ostentation en ville, loin du regard de la bouche du
village, les élites s’inscrivent en faux contre la structure sociale de la communauté à
laquelle elles appartiennent, et ne peuvent faire l’objet d’un classement dans la hiérarchie
sociale. En retour, les villageois interprètent ce comportement bâtisseur comme un message
de rejet, ce qui affecte considérablement la relation élites/villages. À travers un discours
plus ou moins moralisateur, les gens du village stigmatisent leurs maisons de la ville qu’ils
considèrent comme une dilapidation ostentatoire et injustifiée. De fait, construire en dehors
358
de l’ordre microsocial du village est catalogué comme une dilapidation folle, irrationnelle
et absurde de la richesse. Du coup, l’élite locale, propriétaires de belles maisons en ville,
est marginalisée et placée à l’intérieur d’un discours purement négatif. Les villageois
pensent alors que l’intéressé aurait pu investir dans la construction d’une pareille maison au
village, devant laquelle il pourra être enterré le jour de sa mort234.
À côté de ces deux lectures ambivalentes dans lesquelles la sorcellerie sert à la fois
de mécanisme d’accumulation de richesse et de principe de nivèlement de différence
(Geschiere, 1996 : 85), émerge un troisième discours. Celui-ci concerne les élites qui
construisent et qui rentrent régulièrement au village. Elles sont certes citées en exemple et
admirées pour leur attachement au village, mais l’admiration s’accompagne d’une nouvelle
interprétation de l’usage des forces occultes. Comme le précise Peter Geschiere (1995 :147-
163), le respect qui leur est manifesté ne signifie pas que les croyances en la sorcellerie sont
révolues. Suivant les villageois, ces Blancs doivent avoir des soutiens forts dans la
sorcellerie leur permettant de braver la jalousie mortelle du village. Par exemple, le fait que
Vigue Vaza continue de vivre dans sa maison du village malgré les accusations portées
contre lui est la preuve qu’il détient un fétiche lui fournissant la protection nécessaire contre
la jalousie et l’envie des villageois : « il doit pratiquer un nafa beaucoup plus puissant que
le mede du village, sinon comment expliquer sa résistance face à ses détracteurs ? », se
demande Madjokfa (entretien, homme de 49 ans, le 17 octobre 2011, à Tala-Mokolo),
pourtant ayant construit lui-même une belle maison au village grâce à l’argent issu de
l’exode rural. Dans ce nouveau cas de figure, la sorcellerie devient un objet vital, donc
positif, dont les élites peuvent se prévaloir si elles désirent maintenir la relation avec leurs
communautés. L’ambigüité actuelle du discours sur la sorcellerie reflète finalement la
plasticité des dynamiques des relations élites/villages dans le cadre de nouveaux rapports
sociaux à une échelle plus ou moins large.
234 En 2007, il y eut à N’Gaoundéré un exemple âprement discuté d’un infirmier diplômé d’État de la région de Mokolo, décédé sans avoir terminé la construction de sa maison qu’il venait à peine de commencer. La discussion concernant le fait de savoir s’il devait être enterré à N’Gaoundéré ou être ramené au village. Les membres de sa famille penchèrent finalement pour la seconde solution, mais durent collectés de l’argent pour achever la construction de la maison avant son enterrement, ceci pour éviter aux proches de porter l’opprobre du défunt.
359
Conclusion : Maisons traditionnelles, maisons modernes : regards croisés
Dans ce chapitre, mon argumentation a consisté à mettre en exergue le fait que la
possession d’une maison et sa transformation constitue un rite de passage par lequel un
individu atteint le statut de membre à part entière de la société. Jusque dans les années
1980, considérées comme la période porteuse de changements, chaque homme marié devait
confirmer son statut d’homme par la construction d’une maison. À partir des années 1980,
les formes architecturales et les modes de l’habiter se sont considérablement transformés.
Malgré ce changement, deux principes sont encore de règle : premièrement, toute personne
qui veut être reconnue comme un homme doit construire une maison, de préférence au
village, qu’il y réside ou non. S’il omet de le faire, il est suspecté de renier ses origines ou
de pratiquer la sorcellerie. Deuxièmement, indépendamment du qualificatif traditionnel ou
moderne, la maison est vécue comme un symbole fort de la réussite ou de l’échec d’une
personne dans la vie. Autrement dit, on a à faire à un changement qui prend une double
vitesse : celle qui touche les matériaux et les formes architecturales s’effectue plus
rapidement et est perceptible d’une année sur l’autre à l’échelle du village; la seconde, celle
qui touche les pratiques et les usages relatifs à l’espace habité, s’effectue beaucoup plus
lentement. Dans les deux groupes, on voit aussi que la fonction classique de la maison (lieu
pour habiter, manger, se reposer, etc.) est prise de vitesse par la fonction purement
identitaire et sociale.
Par ailleurs, les changements architecturaux introduisent la question de la « limite
du consensus » (Duncan, 1973) dans le rapport entre l’ancienne et la nouvelle élite. Ces
deux groupes vivent dans une relation minée d’ambigüités, découlant de la lecture
controversée du sens identitaire associé aux maisons. Pour mieux comprendre ce manque
de consensus, il est nécessaire de se référer à la distinction que James Duncan établit entre
deux niveaux de sens identitaire, l’un dénotatif et l'autre connotatif (1973 : 391-392). Le
premier dénotatif, est la signification générale que la société dans son ensemble affecte à un
objet ou à un paysage. Il transcende, selon Duncan, les groupes sociaux pour s’étendre à
travers toute la société. L’identité dénotative d’un objet permet, de ce fait, une large
interaction entre les mondes sociaux (social worlds), car les gens comprennent le sens
général qui lui est attribué. Cependant, précise cet auteur, le même objet peut revêtir
360
d'autres significations résultant des cadres culturels différents, et pouvant briser la
communication et la compréhension du sens dénotatif235.
Cette réflexion de James Duncan permet de faire une lecture croisée des
significations différentes données aux maisons traditionnelles et aux maisons modernes par
l’un et l’autre groupe. Rappelons qu’avant la rupture induite par l’exode rural, les éléments
qui traduisaient la richesse et le rang social étaient le nombre de pièces (cases et greniers
surtout), la grandeur de la maison et l’effilement excessif en tige de mil. Par contre, à
l'époque moderne, le nouveau statut social se lit dans les maisons bâties par ceux qui ont
émigré en ville, notamment à Yaoundé, et qui rentrent afficher leur réussite au village
(Brettell, 2002). Les caractéristiques de ces nouvelles maisons s'expriment entre autres par
la toiture en tôle et la forme rectangulaire. Ce qui rapproche les migrants urbains de l’élite
traditionnelle est leur tendance à prioriser l’extérieur de la maison au détriment de
l’intérieur, parfois laissé dans un état de misère. Avec l’émergence de la nouvelle élite, la
perspective sur la maison change à nouveau; la réussite s’exprimant, non par le biais de
l’extérieur, mais davantage par l'entassement des objets nouveaux et des meubles dans un
espace parfois restreint. C’est dans cette avenue que le salon et la salle à manger sont
devenus de véritables lieux de séduction et d’envoutement des visiteurs. En revanche, ils
construisent des grandes maisons qu’ils appellent maisons en dur dont le but évident est
d’inscrire le nouveau statut social en dur. Si les membres de l’ancienne élite voient en la
vaste maison traditionnelle un symbole de richesse, la plupart des migrants et des
fonctionnaires montagnards la perçoivent comme la mémoire d'un style de vie passéiste et
comme une source de honte surtout pour des jeunes, et ne la revendiquent que dans le cadre
des stratégies touristiques et des manifestations à caractère politique236. Parallèlement, les
membres de la nouvelle élite regardent leurs maisons et surtout les meubles comme le
signe évident du bien-être social et comme la preuve qu’ils sont devenus modernes, sauf
que réciproquement, ces mêmes maisons suscitent à la fois émerveillement, soupçon et
235Duncan écrit ce qui suit : «this connotative identity is not shared by members of the Beta landscape who view the Alpha landscape as run-down and badly in need of repair, and its residents as downwardly mobile. Similarly the large, spanking new, colonial-style houses and symmetrically arranged gardens which to the Bata symbolize prosperous country living are viewed by the Alphas as cheap, ostentatious, and generally in dubious taste » (Duncan, 1973: 394).
236 Voir chapitre IV pour plus de détails à ce sujet.
361
réticence chez les gens du village. Aussi, le confort dans lequel les grands vivent en ville
est ridiculisé et considéré comme une dépense inutile et injustifiée.
En comparant ainsi les sens identitaires associés aux maisons traditionnelles et aux
maisons modernes, on revient sans doute à la question posée dans l’introduction sur le
contraste entre société égalitaire et société hiérarchique. Les chercheurs ont eu souvent
tendance à qualifier les sociétés comme celles des monts Mandara d’égalitaires, une idée
aussi défendue par James Duncan dans son introduction à l'ouvrage Housing and Identity.
Cette étude ne permet pas de justifier une telle division stricte, dans la mesure où bien avant
1980, les accents égalitaires se combinaient déjà avec un déploiement ostentatoire
d’ambition et de prestige personnels. Rappelons que « le souci de différenciation » (Roux,
1976) se faisait en rapport avec la maison des chefs qui, aux yeux de gens simples,
constituaient le degré le plus accompli en matière d’architecture et traduisaient le niveau de
richesse et des pouvoirs économiques. Cependant, dans les discours aussi bien que dans la
pratique, les gens ont davantage tendance à mettre l’accent sur l’achievment plutôt que sur
l’ascription237. De fait, les chefs et les notables sont à maints égards des gens au statut
social enviable, mais ils doivent les confirmer par une série de réalisations personnelles,
notamment l’élargissement de la maison héritée par leurs prédécesseurs. La frontière est
donc floue entre égalitarisme de la société traditionnelle et individualisme des nouvelles
élites, et c’est d’ailleurs ce flou qui constituera une arène particulièrement favorable à
l’interprétation divergente de l’utilisation des forces occultes dans la production des
nouvelles richesses notamment avec l’avènement de fonctionnaires d’origine montagnarde.
En réussissant à accumuler et à équiper leurs maisons au-delà de la capacité des migrants
urbains, ces derniers font constamment l’objet d’accusation de sorcellerie, qui en retour, les
contraint à prendre une certaine distance avec les gens du village. Cette prise de distance est
parallèlement interprétée comme la confirmation de l’implication des élites dans des
pratiques occultes. Par ailleurs, ceux d’entre elles qui continuent d’entretenir des rapports
237 Suivant les traces de Talcott Parsons, les sociologues ont souvent tendance à opposer achievment et ascription, qui sont deux statuts sociaux fondés respectivement sur les réalisations personnelles et sur l’hérédité. Dans une société à tendance égalitaire et communautaire, le statut social serait fixé par la position héréditaire alors qu’il est fixé par les réalisations personnelles dans une société à tendance individualiste. Même si cela comporte une part de vérité, cette assimilation entre ascription et achievement peut induire en erreur, car là où le statut social semble fixé par la parenté, on observe aussi une propension à la célébration des réalisations personnelles.
362
étroits avec le village et qui y construisent de grandes maisons ne sont pas non plus
dédouanés : ils sont tout aussi suspectés de pratiques occultes, lesquelles les protègent de la
jalousie des gens du village.
363
Conclusion générale
Agency de la maison ou comment les gens construisent (ou désirent construire) des maisons qui les dévorent
En conclusion à son ouvrage The materiality of Stone, Christopher Tilley fait
remarquer que les objets sont comme des « agents qui produisent des identités » (2004 :
217), et qui sont impliqués dans le maintien et la transformation des statuts sociaux (2004 :
222). Ce faisant, il emprunte une avenue déjà tracée par Bruno Latour (1991) et par Daniel
Miller (1987) qui ont souligné la nécessité à considérer les objets au même titre que les
humains et à mettre l'accent sur les relations réciproques qui se produisent entre eux. Bruno
Latour a suggéré par exemple que notre monde n’est pas constitué des humains en tant
qu’actifs et des objets en tant que passifs, mais de deux types d’agents que sont les humains
et les objets. En prenant comme point de départ de sa réflexion les idées de Latour et de
Miller, Christopher Tilley théorise les objets comme des moyens par lesquels les rapports
sociaux sont constamment produits, reproduits, légitimés et transformés (2004 : 217-225).
Cette approche a pourtant reçu très peu d’attention chez les chercheurs francophones, mis à
part quelques travaux provenant entre autres de Jean-Pierre Warnier (2010, 2009, 2007),
Marie-Pierre Julien et Céline Rosselin (2009), Octave Debary et Laurier Turgeon (2007).
Pour ma part, il a paru pertinent de m’inscrire dans cette approche pour deux raisons.
La première est qu’elle met en lumière ce que Janet Carsten et Stephen Hugh-Jones
qualifient de « nature processuelle » (1995: 39) de la maison. Dans cette perspective, j’ai
exploré les processus architecturaux dans les monts Mandara en prenant en compte certains
épisodes importants qui ont introduit des ruptures tant au niveau des pratiques de l’habiter
que de celui des discours identitaires qui leur sont associés. Les analyses ont été ainsi
structurées autour des périodes suivantes : création des cantons en 1940, descente en plaine
en 1963, exode rural et fonctionnariat à partir de 1980, démocratisation à partir de 1990.
Ces événements ont permis de réévaluer la place de la maison en tant qu’entité relationnelle
et dynamique et de souligner l’entrelacement des rapports entre elle et les individus qui
l’habitent. Au plan méthodologique, ils ont permis de bouger d’une période donnée à une
364
autre, et de suivre les mouvements architecturaux et identitaires à travers des espaces
montagneux et de plaine. La deuxième raison du choix de l’approche développée au sein de
l’archéologie post-processuelle découle de l’importance accordée à l’étude de la maison en
tant qu’objet activement impliqué dans la production des identités (Olsen, 2003: 91). Au-
delà de ce que sont les objets, les auteurs invitent en effet à s’intéresser également à ce
qu’ils font (Turgeon, 2009 : 342; Hoskins, 2006 : 74). Webb Keane (1997) postule par
exemple que les objets sont avant tout immatériels avant d’être matériels, car leurs formes
physiques ne sont que le reflet d’une réalité immatérielle qui les précède. Cette idée
trouvera un certain écho chez Chan-Kwo Tan qui attribue la valeur d’agency à la maison
car, « elle réagit et modifie ses propriétaires » (2001 : 170). Daniel Miller ira encore plus
loin en soulignant que « la longévité temporelle d’une maison peut la rendre active,
indépendamment de l’action des gens qui l’occupent » (2001 : 119).
En usant de cette approche, j’ai mis en évidence le rôle actif de la maison dans les
constructions identitaires et les effets qu’elle produit sur les rapports entre les groupes
sociaux et les individus. Que ce soit en plaine ou en montagne, chez l’ancienne élite ou
chez la nouvelle, la maison est apparue comme une institution centrale et comme la pierre
angulaire du tissu social. Les propos de Slagama cités en début de l’introduction générale
expriment métaphoriquement cette importance lorsqu’il compare la maison à un « miroir
dans lequel les gens te voient » (entretien avec Slagama, homme de 65 ans, le 23 mai 2007,
à Udjila). C’est la raison pour laquelle la dynamicité de la maison et les changements qui
interviennent dans les formes et les matériaux, provoquent, en même temps qu’ils sont
provoqués, par l’évolution des discours identitaires. D’où la nécessité d’avoir mis l’accent
sur la maison et les mobiliers en tant que matrice relationnelle, activement impliquée dans
la structuration du comportement humain. Globalement, les analyses ont porté sur deux
catégories identitaires, à savoir l’identité ethnique et l’identité individuelle. Le chapitre IV
a été essentiellement dévolu à l’étude des différentes facettes ethniques arborées par les
montagnards grâce à l’utilisation des traits architecturaux dans trois contextes historiques
données, soient : la période précédant la descente massive en plaine en 1963; la période
comprise entre 1963 et 1990 marquée par la création des villages en bordure des massifs; et
enfin la période d’après 1990 marquée par la transition démocratique et le retour au
multipartisme. Le chapitre V a, quant à lui, porté sur les représentations identitaires à
365
l’échelle individuelle à l’intérieur d’un groupe ethnique donné. Il a permis de croiser les
différentes façons dont la maison entre en jeu dans la production du statut social chez trois
groupes d’individus à savoir l’ancienne élite, les migrants urbains et les fonctionnaires.
Afin de mieux souligner le statut de la maison en tant qu’agent, il convenait
d’inscrire mon analyse dans le contexte général du travail de mémoire grâce auquel les
Montagnards passent sous silence certains aspects de leur passé servile, à tel point que
certains auteurs (Marliac, 1991; Boutrais, 1973; Lembezat, 1961 : Urvoy, 1949) ont parlé
d’amnésie collective. Tout en constatant l’absence de références liées à la servilité, j’ai
avancé l’idée qu’il s’agit plutôt d’un refoulement volontaire, planifié et véhiculé à travers
les traditions historiques, lesquelles ont à leur tour permis la construction un autre type de
mémoire centrée autour de la résistance et de l’identité montagnarde. Cette capacité à
présentifier le passé (Hartog, 2003) et à le recycler (Spiegel, 2002 :162) se poursuivra
d’ailleurs au cours de la période coloniale. L’architecture locale, qui avait pourtant servi à
la définition des Montagnards en tant que peuples sauvages et authentiques dans le cadre de
la politique coloniale, sera utilisée pour véhiculer le mythe de la résistance et de l’amour du
travail. Autrement dit, ce qui était au départ symbole du primitivisme va devenir un outil
activement utilisé pour apprivoiser le passé colonial, et pour l’incorporer dans un registre
mémoriel positif, avec pour finalité la transmission d’une nouvelle identité. Par ailleurs,
suivant leurs intérêts économiques, les Montagnards vont mimer l’imaginaire colonial
d’authenticité en réinventant leurs traditions (Ranger, 1993). C’est dans cette logique
d’« invention des traditions » (Hobsbawm et Ranger, 1983) qu’il faut comprendre les
dynamiques identitaires à l’œuvre dans les monts Mandara et dans lesquelles la maison est
partie prenante. Le contexte de l’étude étant spécifié, il convient maintenant de revenir
brièvement sur les enjeux de l’usage de la maison dans les politiques d’appartenance
ethnique d’une part, et dans la construction de soi à l’échelle individuelle, d’autre part.
1. La maison et l’ethnicité comme des palimpsestes
De toutes les formes d’identité, l’ethnicité est celle qui a reçu le plus d’attention de
la part des chercheurs, notamment des historiens, des archéologues et des politologues
(Lucie, 2005). Les débats ont surtout opposé dans les années 1960/1970 ceux qui liaient
366
l'ethnicité à des aspects primordiaux et ceux qui la considéraient comme un objet construit,
dynamique et situationnel (Hakenbeck, 2007). En empruntant cette dernière approche, j’ai
formulé l’hypothèse que la maison est manipulée pour représenter, dénaturer et parfois
perturber les limites ethniques dans différents contextes historiques donnés. Mon intérêt
était de voir les constances et les ruptures dans les représentations matérielles de l’ethnicité
plutôt que de voir celle-ci comme une entité statique et figée. Pour cela, j’ai pris en compte
trois facteurs qui ont orienté les discours identitaires ethniques, à savoir la création des
cantons dans les années 1940, la descente en plaine à partir de 1963, et la transition
démocratique de l’après 1990.
Avant 1963, les populations mettaient en œuvre deux principales facettes ethniques
à travers la manipulation de quelques éléments architecturaux : la première est l’identité
montagnarde, notamment lorsqu’il s’agit des rapports entre gens de la montagne et gens de
la plaine - les Wandala en particulier - ; la deuxième est l’identité ethnique, en particulier
lorsque la situation d’interaction opposait un groupe ethnique montagnard à un autre.
S’agissant de la première facette, il ressort que les montagnards, indépendamment de leurs
appartenances ethniques, ont tendance à se considérer comme un ensemble cohérent en
s’appuyant sur certains trais architecturaux communs. Chaque ethnie a, certes, sa propre
portion de territoire possédant des limites plus ou moins précises, mais ces limites ne leur
apparaissent pas rigides, dans la mesure où elles sont régulièrement franchies sans que cela
ne constitue un problème (MacEachern, 2002). En revanche, les limites entre gens de la
montagne et gens de la plaine sont plus que de simples phénomènes physiques et
géographiques car elles ne pouvaient être franchies sous peine de connaitre une mort
sociale et symbolique de l’individu (Hallaire, 1991: 25). Les différences architecturales
entre ces deux groupes sont soulignées à travers l’opposition pierre = montagnard versus
argile = wandala. Toutefois, l’identification à la montagne perd de sa pertinence lorsque la
situation d’interaction oppose un groupe montagnard à un autre. Dans ce cas de figure, ce
ne sont plus les éléments partagés de la maison qui sont mis en valeur dans la définition du
soi montagnard, mais plutôt les différences architecturales tant au niveau du plan que des
formes des maisons, lesquelles permettent la mise en œuvre des distinctions ethniques
entre les Podokwo, les Muktele et les Mura.
367
La descente massive en plaine intervenue à la suite des mesures autoritaires mises
en place par les pouvoirs publics en 1963 a constitué le deuxième contexte d’interaction.
Cette descente a suivi deux modalités différentes : la première a été l'installation des
populations sur les piémonts et sur la portion de la plaine située en contrebas de leurs
massifs ; la deuxième a été leur installation dans les villes wandala à la suite de leur
islamisation. Dans les deux cas, il en a résulté des changements dans les formes et dans les
pratiques architecturales qui vont à leur tour donner lieu à de nouvelles configurations
identitaires. Globalement s’observe les trois schémas suivants : l'attachement plus marqué à
la montagne et à la maison ethnique chez ceux qui continuent de vivre en montagne,
l'hybridation architecturale et identitaire chez ceux vivant dans les villages de la plaine, et
enfin l'adoption des traits architecturaux wandala chez ceux vivant dans les bourgs
musulmans.
La conception de l'espace montagne versus plaine est avancée par les populations
vivant encore en montagne pour justifier la raison d’avoir refusé de descendre en plaine. En
effet, tout en étant intégrée à leur univers en plaine, la plaine demeure pour ces populations
comme un lieu dangereux, comme le montrent cette prière recueillie par Antoinette Hallaire
et prononcée lors des rites précédant les semailles : «Voici le moment où nous allons
descendre en plaine pour cultiver nos champs, fais qu'il ne nous y arrive aucun mal, que le
serpent ne nous morde pas, que la ronce ne nous pique pas, et que nos récoltes soient
belles» (1991 : 47). En vertu de cet imaginaire, de nombreux chefs de famille ont réussi à
braver les injonctions administratives de les faire descendre en plaine et sont restés dans
leurs maisons de montagne. Comme l’a souligné Christian Seignobos (1982: 81), seuls les
cadets qui n’exerçaient aucun rôle dans la continuité de la maison et dans le déroulement
des rites claniques sont descendus établir leurs demeures en plaine. L’installation d’une
partie de la population en plaine a donné lieu à des nouveaux replis identitaires. Désormais,
les dichotomies pierre/argile et montagne/plaine n’opposent pas simplement les
montagnards aux Wandala. Elles opposent également les montagnards restés dans les
massifs à ceux descendus en plaine. La dichotomie montagne/plaine est d’ailleurs si
présente qu'un participant d’origine mura vivant en montagne s'est vu culturellement plus
proche d'un Podokwo de la montagne que d'un Mura de la plaine (entretien avec Menague,
homme de 86 ans, le 26 avril 2012 à Baldama).
368
Par contre en plaine, les attitudes envers la maison ethnique et les discours
identitaires qui en résultent divergent selon les classes d'âges : les personnes âgées, en
particulier ceux descendus au cours des premières vagues migratoires, essayent autant que
faire se peut de reproduire le plan ethnique en plaine et de maintenir ainsi leurs différences
culturelles avec les Wandala. Autrement dit, le rapprochement géographique avec ces
derniers n’a pas conduit à l’effacement de la frontière. Au contraire, il a parfois accentué
l’attachement à la maison ethnique et à la montagne malgré la nouvelle vie en plaine. En
revanche, le refus d’assimilation des vieillards contraste avec le regard des jeunes vers la
nouveauté et vers un style de construction qu’ils considèrent comme celui des Wandala. Il
s’agit des maisons de forme rectangulaire définies comme nouvelles ou belles en
opposition aux maisons ethniques de montagne définies comme anciennes et dépassées.
L’importance de la maison rectangulaire dans le nouveau discours identitaire est à situer
dans le contexte colonial. Comme cela a été analysé dans le chapitre III, les pouvoirs
coloniaux français ont de tout temps opposé les structures sociales des Kirdi aux structures
politiques centralisées des Wandala : celles des montagnards sonnaient comme la preuve de
leur primitivisme et de leur anarchie (Boutrais, 1973 : 69) alors que celles des Wandala
bénéficiaient d’un traitement favorable parce que proches de la civilisation (Lyons, 1996 :
352). Or, au moment de la descente des montagnards en plaine, les Wandala avaient plus
ou moins adopté et domestiqué les maisons rectangulaires qu’ils ont sans doute empruntées
aux administrateurs coloniaux (Lyons, 1996 : 364). En optant ainsi pour la construction des
maisons suivant une forme rectangulaire, les jeunes ex-montagnards essayent de s’extirper
symboliquement aussi bien que physiquement de l’image coloniale de primitifs pour
arborer une identité sociale valorisante - celle des Wandala - dont le symbole le plus
évident est la maison rectangulaire. Toutefois, en dépit de cette volonté de brouiller la
frontière symbolique entre eux et les Wandala, la conscience ethnique reste encore présente
chez les montagnards de la plaine, et est constamment manipulée en fonction des enjeux en
présence. La preuve la plus évidente est le fait qu’ils se font toujours inhumer en montagne,
notamment à l'entrée de leurs concessions ancestrales, en cas de décès (Hallaire, 1991 : 47).
Les jeunes montagnards présentent finalement une identité duale (Laurent et Lee, 2007;
Gugler, 1991, 1971), dont l’une est liée à leur culture ethnique d’origine et l’autre à la
culture wandala ou moderne avec lesquelles ils sont désormais en interaction. Cette identité
369
duale est restée une constante jusqu’en 1990, période marquée par la transition
démocratique et le retour au pluralisme politique au Cameroun.
La transition démocratique a provoqué le retour à la thématique de l’identité
montagnarde dont les aspects définitionnels sont la maison et à la montagne. Ces deux
labels ne sont pas cependant vus dans leur aspect physique, mais davantage dans leur rôle
en tant que « symboles en action » (Hodder, 1982) et en tant que médiums exprimant
activement les identités (Buchli, 2013 : 149). Autrement dit, leur manipulation poursuit
ouvertement la conquête d’une visibilité au sein de l’appareil d’État. Par exemple, à travers
l’utilisation du terme montagne, les élites locales font la promotion de l’image d’un groupe
montagnard homogène. Des cases de pierres aux toits en tiges de mil sont de plus en plus
(re)construites, non pas pour y être habitées, mais pour marquer l’attachement des gens à
leur milieu d’origine. Des symboles architecturaux sont également utilisés à travers des
créations artistiques et des pages Facebook des différentes associations montagnardes. Les
discours et les usages métaphoriques de l’architecture et de la montagne finissent par
générer la différence avec l’Autre musulman, et constituent donc ce qu’Arjun Appadurai
(1996) appelle des stratégies identitaires. Ces observations sur l’usage contextuel et
situationnel de la maison dans les politiques d’appartenance ethnique a permis de
m’inscrire au cœur de deux principaux débats sur l’ethnicité, à savoir les débats ayant
opposés primordialistes versus constructivistes d’une part, et les débats autour de
l’invention coloniale de l’ethnie d’autre part.
S’agissant du premier débat, les données présentées et analysées m’ont amené à
inscrire l’ethnicité dans l’approche constructiviste, un chemin tracé par Fredrik Barth
(1969) à la fin des années 1960. Toutefois, malgré son caractère dynamique et situationnel,
j’ai fait valoir l’idée qu’elle ne doit pas être considérée comme un simple épiphénomène
politique dans la mesure où elle est activement connectée à la culture matérielle du groupe.
En tant que telle, l’idée de l’appartenance ethnique possède parfois une dimension
psychologique importante (Appadurai, 1996 ; Hodder, 1982). C’est pourquoi l’usage des
symboles architecturaux dans la promotion de l’identité montagnarde reçoit parfois des
échos favorables auprès des gens de la montagne, et suscite chez eux un effet
psychologique évident. Ainsi, si l’ethnicité est une création contextuelle plus ou moins
370
consciente, elle se greffe sur des attaches primordiales qui sont elles-mêmes activées par
l’usage des traits architecturaux. Un tel postulat suit sans doute les idées d’Ian Hodder qui
considère les objets comme des organes constitutifs même de l’ordre social, utilisés pour
souligner ou refuser, maintenir ou perturber les distinctions ethniques (1982: 85).
Tout en reconnaissant le caractère construit de l’ethnicité, cette thèse prend
néanmoins une certaine distance avec les théories de l’invention coloniale de l’ethnie dans
les monts Mandara. En effet, les concepteurs de ces théories se sont à mon avis un peu trop
rapidement prononcés dans leur effort de déconstruction de la notion d’ethnie en
généralisant à l’ensemble des monts Mandara les conclusions issues de l’observation des
phénomènes ethniques chez quelques groupes ethniques. Les analyses des traits
architecturaux tels que le shəma chez les Podokwo et le mawnik chez les Muktele ont
montré que l’intervention coloniale n’a pas toujours été à l’origine de la création des
ethnies. En revanche, la construction des résidences des chefs de cantons en plaine dans les
années 1940 et les mesures autoritaires visant à décongestionner les massifs à partir de
1963 ont bricolé les cartes ethniques et contribué à l’émergence de nouvelles politiques
d’identification, opposant dorénavant montagnards restés dans les massifs versus
montagnards descendus en plaine. Autrement dit, le rôle des pouvoirs coloniaux et
postcoloniaux n’a pas été de créer les ethnies podokwo, muktele et mura, mais d’impulser
de nouvelles dynamiques identitaires lesquelles reposent aussi sur la manipulation des traits
et symboles architecturaux. En cela, les thèses émises par Jean-Loup Amselle (1999; 1990)
sur la création coloniale des ethnies sont peut-être valables pour certains groupes (Mafa,
Mofu et Kapsiki en particulier), mais ne peuvent pas être élargies à l’ensemble des monts
Mandara. Seule une approche micro-régionale des phénomènes ethniques pourrait donner
lieu à une diversité des cas à mesure que l’on passe d’un groupe ethnique donné à un autre.
2. Maison-homme, maison hantée, maison anthropophage
Les travaux remarquables d’Igor Kopytoff (1986) et d’Arjun Appadurai (1986) ont
souligné le fait que les objets téléguident la vie sociale des individus parce qu’étant eux-
mêmes investis d’une vie sociale. En m’appropriant leurs idées, j’ai montré comment les
maisons et les personnes sont si fermement entrelacées qu’ils finissent par faire partie d’un
371
seul et même processus. Dans les trois groupes ethniques (Podokwo, Muktele et Mura), la
maison est vécue comme une extension même de la personne (Carsten et Hughes, 1995 : 2).
Pour montrer cela, il a semblé important de déployer l’analyse sur trois groupes d’individus
(élites traditionnelles, migrants urbains et fonctionnaires) appartenant à deux époques
différentes, à savoir l'avant et l'après 1980. Cette date qui marque la montée de l’exode
rural et l’entrée des originaires des monts Mandara dans la fonction publique a en effet
produit deux autres classes sociales au côté de l’élite traditionnelle, soient la classe des
migrants urbains et celle des fonctionnaires. Le regard croisé sur les comportements
bâtisseurs au sein de ces trois groupes d’individus a permis de voir que le souci du standing
social (Roux, 1973) ne se retrouve pas seulement chez les nouveaux riches (migrants et
fonctionnaires), il oriente aussi les pratiques architecturales des gens au sein des sociétés
dites traditionnelles. La différence réside plutôt dans la façon dont ce standing social se
donne à voir au sein de ces trois groupes et selon les époques.
Avant 1980, le rang social était perçu au travers des éléments extérieurs de la
maison, notamment sa situation en altitude, la surface occupée par la maison, les toits en
tiges de mil et le nombre de pièces qui composent le quartier des femmes. La
communication de l’identité par l’extérieur de la maison semble se perpétuer avec les
migrants urbains qui, à l’issue de leur séjour à Yaoundé, construisent des maisons
rectangulaires et en tôles au village, constituant ainsi la preuve de la réussite de leur projet
migratoire. Avec l’entrée des originaires des monts Mandara dans la fonction publique,
notamment à partir de 1980, la situation change et s’inverse : ce n’est plus l’extérieur qui
fait l’objet de désir et d’enchantement, mais l’intérieur, plus particulièrement le salon et la
salle à manger. Dans tous les cas, l’observation des pratiques architecturales a permis de
confirmer l’hypothèse de départ selon lequel la maison n’est pas simplement un espace ou
une série d'espaces dans lesquels vivent les gens. Elle participe activement à la construction
de leur existence sociale, laquelle se maintient et se modifie constamment à mesure que la
maison change et se transforme (Miller, 2001 : 119; Tan, 2001 : 170; Buchli, 1999: 77-98).
En tant qu’entité malléable, la maison inscrit les individus dans une relation de pouvoir à
l’intérieur des sociétés.
372
L'implication plus large de cette conclusion autorise l’inscription de la maison dans
une position relationnelle à l'égard des sujets humains. Revêtu de son statut d’actant elle
symbolise, représente et parfois transgresse les pratiques sociales des individus (Duncan
1973 : 261). Les tranches de vie analysées, à la fois chez l’ancienne élite (tranche de vie de
Kwona et de Madu), chez les migrants urbains (tranches de vie Genda et de Mavya) et chez
les fonctionnaires (Tranche de vie de Moussa et de Vigue Vaza entre autres) ont montré
que le souci d’ascension sociale par le biais de la maison est parfois si important qu'il
pousse les individus à tout faire pour posséder une qui soit capable de traduire l’image
prototypique qu’ils ont ou qu’ils souhaitent avoir au sein de la communauté. Autrement dit,
les gens, indépendamment de leurs statuts sociaux, sont conscients du fait que leurs
identités sont générées et maintenues par la possession et/ou la transformation continue de
la maison. La non-possession de celle-ci ou l’incapacité de la transformer les empêche à
s’inscrire dans la logique de la concurrence et les places sous les effets dévastateurs de la
maison qui finit parfois par les dévorer au sens symbolique et littéral du terme (Moisa,
2010). Les propos de mon accompagnateur Tsetsefa lors de mon séjour dans le village de
Zuelva (voir chapitre II) montrent que la question de la maison et de l'identité devient un
sujet sensible lorsqu’elle est vécue comme un signe de l’échec de son occupant dans la vie
sociale. C’est la raison pour laquelle il était parfois difficile pour les participants de parler
directement de leurs maisons lorsque celles-ci ne traduisaient pas l’image qu’ils ont
souhaité avoir au sein de la société.
Il existe donc un revers de la médaille dans la relation qui unit l’individu à la
maison. Si de nombreux auteurs ont insisté sur l’agency de la maison pour montrer son rôle
dans la production et la recomposition des identités des gens, l’accent sur ses effets presque
destructeurs a été négligé, mis à part la réflexion de Daniel Miller sur la maison hantée
(2001). Pourtant, c’est justement en étudiant les effets nuisibles de la maison sur ceux qui
ont le sentiment d’avoir échoué que son agency peut-être davantage mis en évidence. Je
voudrais ainsi revenir sur cet aspect en prenant appui sur des exemples pris au sein des trois
groupes d’acteurs (élite traditionnelle, migrants urbains et fonctionnaires) étudiés dans le
chapitre V.
373
J’ai montré que chez les Mura, la maison est comparée à un humain qui subit des
transformations au cours de sa trajectoire de vie au point de régresser et de disparaitre.
Seulement, toutes les maisons ne suivent pas le même parcours, car une maison n’atteindra
son apogée que lorsqu’il existe une relation plus ou moins harmonieuse entre elle et ses
occupants (le cas de la maison de Kwona par exemple). Or, cette harmonie n’est jamais
considérée comme un acquis car plusieurs facteurs (divorce, mortalité infantile, maladie,
possessions démoniaques, etc.) peuvent la remettre en cause en créant un déséquilibre entre
la personne et la maison. Le principal facteur est sans doute le choix des femmes à divorcer.
Dans les trois groupes, j’ai montré que la métamorphose, la transformation et la régression
de la maison sont intimement liées à la mobilité des femmes qui en raison de la venue
d’une nouvelle épouse ou des décès répétitifs de leurs enfants décident de quitter leurs
conjoints pour se remarier à d’autres hommes dans d’autres villages. Autrement dit, le
pouvoir qu’a la maison de construire ou de détruire la réputation sociale d’un individu
dépend plus ou moins de l’agency des femmes.
Le deuxième obstacle sur le chemin du prestige sont les possessions démoniaques
de l’individu ou de la maison. Les Mura pensent que la possession de l’une de ces deux
entités par les forces occultes finit par empoisonner l’autre entité, d’où le fait que la maison
soit partie prenante des processus thérapeutiques de certaines maladies. Ainsi, tel un être
humain, la maison en tant qu’entité physique peut être hantée et stoppée dans son processus
de développement. Plus que cela, et dans la mesure où son aspect psychologique est
enchevêtré dans l’aspect psychologique de l’occupant, la maison hantée affecte l’équilibre
mental de l’individu et le rend à son tour vulnérable aux mauvais esprits (entretiens avec
Dagwene, homme de 82 ans, le 13 novembre 2011 et le 03 juin 2012, à Dume; avec Dəgla,
homme de 80 ans, le 17 novembre 2011, à Dume). Cependant, les Mura ne confirment
qu’une maison est hantée que lorsqu’ils voient ses effets nuisibles tels que la constance du
divorce au sein du ménage, la mortalité infantile et les fissures au niveau des murs des
cases. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Mura enduisent annuellement leurs
maisons avec de l’argile et de l’ocre rouge pour empêcher les mauvais esprits d’utiliser ces
trous pour s’introduire dans la maison (entretiens avec Dagwene, le 13 novembre 2011 et le
03 juin 2012, à Dume).
374
Figure 56 : Fissures sur les parois d’une case de l’ancienne maison de Duniya, preuves de sa possession par les esprits malveillants (photographie prise en 2007 par moi).
Symptôme d’une maison hantée, les fissures précédant ou suivant certaines
calamités vécues par les individus fournissent aussi la preuve que la maison est devenue
incompatible avec son occupant, ce qui provoque parfois sa relocalisation sur un nouveau
site. Une illustration de cela est fournie par la relocalisation de la maison de Duniya, un
Podokwo de Tala-Dabara habitant jusqu’à la fin des années 1990 le quartier Dagwagwara,
mais qui se serait installé dans le quartier Vadi-Meteke. La raison avancée pour justifier
l’abandon du site est que la maison étant devenue oppressante, provoquait des décès
injustifiés. Duniya, de même que ses épouses et ses voisins, s’appuient en outre sur les
fissures des murs des cases, preuve que des esprits malveillants se seraient introduits au
sein de sa maison (voir figure 55). En leur suggérant l’éventualité que ces fissures
pourraient être dues aux effets de la chaleur accablante caractéristique de la région, ce
d’autant plus que la maison est restée longtemps inhabitée, les participants ont objecté en
réitérant l’hypothèse de l’infiltration des forces occultes. Si les cases présentant des fissures
sont attribuées à des facteurs climatiques dans certaines maisons, cela n’est pas le cas pour
la maison de Duniya dans la mesure où elles ont été suivies par deux cas de décès au cours
de la même année. Après divination, il est apparu que la maison n’était plus un lieu de
repos, mais une entité devenue vulnérable parce que prise d’assaut par des esprits
375
malveillants. Or, une maison devenue vulnérable rend à son tour les résidents tout aussi
vulnérables dans la mesure où la vie sociale de ces derniers est liée à celle de la maison.
Ce cas et d’autres semblables amènent à suivre et à m’écarter de l’étude menée par
Janet Hoskins sur les objets biographiques (1998). Hoskins a en effet réalisé qu'elle était
incapable de recueillir les histoires de vie des personnes indépendamment de l'histoire de
vie de leurs objets domestiques, car dit-elle, les participants avaient tendance à centrer leurs
biographies autour de leurs objets. En montrant comment les objets sont ré-imaginé en
termes d'expériences subjectives, Hoskins offre une analyse tout à fait convaincante de la
façon dont les objets deviennent des métaphores de soi. Cependant, plus qu’une idée de
métaphore, les tranches de vie présentées dans le cadre de ce travail obligent à voir la
maison comme une entité activement impliquée dans l’ascension sociale, mais aussi dans
les ennuis sociaux de ses occupants. En reprenant le cas de Duniya évoqué ci-dessus, on
remarque que l’interprétation des fissures apparues dans le mur des cases a débordé l’aspect
purement climatique pour être connectée à des aspects mystiques, c’est-à-dire
incontrôlables. Dans la mesure où une telle maison avait cessé d’être un bouclier protecteur
contre les forces occultes, sa relocalisation sur un nouveau site sonnait comme l’ultime
solution. On voit donc que l’attribution des caractéristiques humaines à la maison ne
renvoie pas simplement à son rôle positif dans la promotion sociale de l’individu, elle
révèle aussi son aspect pervers, lequel oblige parfois les individus à abandonner le site.
La deuxième illustration du caractère machiavélique de la maison est fournie par
l’apparition de nouvelles maisons, construites par les jeunes migrants à partir de 1980. Une
de leurs caractéristiques majeures est qu'elles sont construites avec des matériaux non
locaux (tôles et ciment en particulier). Comme ces matériaux ne peuvent être acquis que par
le pouvoir de l'argent, ils sont perçus comme des indices de la richesse accumulée par le
propriétaire au cours de son itinéraire migratoire. Par ailleurs, à la différence des maisons
traditionnelles construites grâce au réseau d’entraide entre parents et voisins, les nouvelles
maisons sont quant à elles construites par des maçons locaux en contrepartie d’un salaire,
ce qui leur donne davantage de la valeur en tant que bien de consommation moderne. En
tant que tels, les migrants investissent de grandes ressources, tant émotionnelles
qu’économiques, pour les construire dans le but de s’inscrire dans la logique de la
376
concurrence et d’arborer le statut d’homme nouveau qui leur est associé.
Or, dans un contexte de précarité économique et d’absence de travail salarial au
village, le seul moyen d’accumulation est l’exode rural vers les grandes métropoles,
notamment Yaoundé. Si le crédo de départ est la recherche d’une vie meilleure là-bas, c’est
paradoxalement à Yaoundé que les migrants vivent dans un état de marginalité et de
pauvreté extrême. Cependant, et dans la mesure où Yaoundé n’apparait que comme lieu
d’enrichissement et non de consommation, les dépenses sont réduites au strict minimum
d’où le choix de vivre entassés dans des maisons étroites et parfois en état de putréfaction
avancée. S’ils sont conscients de cet état de misère, ils se sentent obligés de l’assumer
puisque l’exode rural leur parait comme l’unique moyen pour la réussite de leur rêve
d’avoir une belle maison au village. Il y a donc lieu de considérer qu’ils sont aussi victimes
de l’effet machiavélique de la maison, c’est-à-dire de son aspect démoniaque, selon les
termes de Daniela Moisa (2010).
Par ailleurs, si l’exode rural fait office de rite de passage vers l’acquisition d’un
statut nouveau, ce n’est pas tous les migrants qui réussissent à le braver avec succès. Ceux
qui, à l’instar de Genda et de Mavya, échouent dans cette traversée migratoire sont
continuellement stigmatisés au sein des groupes d’origine, ce qui les incite à s’adonner à
des activités illicites pour réaliser leur rêve en dépit des risques d’encourir la prison. Cette
dernière n’est d’ailleurs stigmatisée que lorsque leurs larcins sont restés improductifs et ne
leur ont pas permis de construire leurs belles maisons au village. Ainsi, la non-possession
de la maison agit sur celui qui rêve de l’avoir au même titre que sa possession, mais avec
des conséquences contradictoires. En effet, la possession de la maison confère une identité
honorable, car elle vient légitimer la force de travail réalisé tout au long de l’exil
migratoire. Mais pour se maintenir dans la course, l’individu est obligé de faire des va-et-
vient permanents entre le village et Yaoundé, ce qui le fait pratiquement prisonnier de son
rêve d’ascension sociale. De même, l’incapacité de posséder une belle maison prédispose
l’individu à des activités peu ou pas légitimes, et l’idée de la maison ne le quitte que
lorsqu’elle sera matérialisée et consommée visuellement par le regard des gens du village.
Autrement dit, l’aiguille de la pendule régulant le rapport de force entre individu et maison
finit par changer de direction : l’homme n’est plus le chef de la maison, il en subit les effets
377
méphistophéliques, car obligé de travailler sans relâche pour disposer des moyens
nécessaires pour la construction et/ou pour la transformation de sa dite maison. Comme le
dit si bien Daniela Moisa pour le cas des Oseini de la Roumanie, les gens ne se rendent pas
compte des effets presque pervers de leur propre maison qui, « en révélant son côté
démoniaque, ne leur permet pas de profiter pleinement de ses bénéfices » (2010 : 485).
Enfin, la troisième illustration des effets machiavéliques de la maison est donnée par
les comportements bâtisseurs des originaires des monts Mandara devenus fonctionnaires,
notamment à partir des années 1980. Contrairement aux migrants urbains, les éléments
matériels du répertoire de la réussite sont ici mis en évidence par un salon/salle à manger
entièrement décoré et meublé, et surtout par une télévision écran plasma. Sa présence est
profondément intériorisée, à tel point qu’elle constitue aujourd’hui un élément central de
l’écologie de l’intérieur domestique. Ce constat m’a conduit à voir, à la suite de Jean-Pierre
Warnier (1993), la télévision à écran plasma au sein de la maison, non seulement comme
un réceptacle générant des informations destinées à être écoutées, mais surtout comme un
élément central de la culture matérielle servant à concrétiser le statut social des gens. En
tant qu’innovation récente, elle fait figure d’entrée dans l’ère de la modernité, et est parfois
sacralisée au-delà même de sa fonction de communication (Baudrillard, 1969). C’est la
raison pour laquelle elle est toujours allumée en présence d’un visiteur pour orienter son
regard afin de l’obliger à consommer visuellement la marque et la taille de l’écran. En plus,
comme cela peut être remarqué sur les figures 53 et 54, l’emplacement de la télévision n’est
jamais neutre, il est toujours établi par rapport à d'autres objets, et constitue le point focal
vers lequel s’orientent les différents meubles, notamment les canapés et les chaises (voir
figure 52). En acquérant surtout un poste téléviseur qui soit des plus récents, le propriétaire
fait une déclaration importante sur sa participation à un ordre social nouveau et donc
enviable.
Cependant, ce qui est vu comme étant la norme chez les fonctionnaires est perçu
comme anormal par les gens du village, d’où les soupçons et les rumeurs de toutes sortes
qui pèsent sur les élites. Ces dernières sont non seulement accusées de vouloir rompre les
liens primaires avec leurs communautés d’origine, mais aussi de dilapider excessivement
leurs richesses en vue d’équiper leurs maisons en ville. Mais l’accusation la plus constante
378
et la plus sérieuse est liée à des pratiques occultes. Les fonctionnaires sont régulièrement
accusés de pratiquer le nafa dont la phase-clef est la vente des parents. Cette fantasmagorie
a bien sûr son côté inverse dans la mesure où les élites imputent aussi aux gens du village
l’utilisation du mede pour les éliminer. Autrement dit, les nouvelles pratiques
architecturales, si elles contribuent effectivement à l’ascension sociale des élites, créent
néanmoins des zones de turbulences dans leurs relations avec le village, ce qui les place
devant un dilemme : rompre le lien de réciprocité en construisant une maison loin du
village ou construire au village en bravant la peur de se faire ensorceler. L’une et l’autre
décision n’épargne malheureusement pas le fonctionnaire des accusations de sorcellerie. En
effet, si celui-ci choisit de construire en ville, il fait l’aveu de son implication dans la vente
des proches ; l’éloignement avec le village étant interprété comme la peur de la répression
du mede. En revanche, s’il décide de construire au village, son choix apportera la preuve
qu’elle détient une sorcellerie plus puissante que celle des gens du village, laquelle le
protège de la jalousie de ces derniers. Les nouveaux comportements bâtisseurs rendent ainsi
les fonctionnaires orphelins de leurs liens de solidarités primaires car, en construisant des
maisons auxquelles ne peuvent prétendre les migrants urbains, ils ont détruit les
fondements sur lesquels reposent leurs rapports avec la communauté d’origine. Ils sont
donc finalement obligés de vivre, telle Alice au pays des merveilles, une relation inversée
avec leurs propres communautés laquelle est constamment minée d’ambiguïté et
d’accusation réciproque de sorcellerie.
Les accusations de sorcellerie n’articulent pas seulement les rapports entre élites et
communautés d’origine, elles articulent aussi les jeux de rôles et de pouvoir entre hommes
et femmes au sein de l’espace domestique, notamment dans les localités de montagne. On
ne peut d’ailleurs que regretter de n'avoir pas pu explorer ce pouvoir au féminin dans
l’ascension sociale ou dans les turbulences quotidiennes de leurs époux en raison des
limites imposées par les sources. Tout en étant conscient du pouvoir féminin sur et dans
l’espace domestique, il m’était difficile, si non impossible de l’articuler à l’intérieur d’un
chapitre en absence des données comparatives, notamment chez les Muktele et les
Podokwo. Toutefois, l’agency des femmes apparait en filigrane tout au long de la thèse,
notamment à travers les analyses de la notion de l’anthropomorphisme chez les Mura et de
la symbolique du ventre chez les Podokwo et les Muktele. Il y a cependant un aspect
379
nouveau qui constituera sans doute un axe privilégié de mes travaux de post-doctorat. Il
s’agit du rapport entre sorcellerie, pouvoir et relations de genre dans l’espace domestique.
De fait, la sorcellerie fait partie des pratiques sociales très complexes qui
reproduisent la perception selon laquelle les femmes seraient des êtres à la fois antisociaux
et impermanents (Lyons, 1998, 1992; Vincent, 1991, 1985). D’une part, la représentation
de la femme en tant que sorcière suscite une vigilance constante des hommes contre leurs
attaques. Chez les Mura par exemple, cela implique l'enterrement rituel et périodique des
objets magiques dans le sol de la maison. D’autre part, la représentation de la femme en
tant qu’étrangère intime au sein de la maison conduit à l’utilisation des matériaux moins
durables dans la construction de leurs cases, contrairement à celles des hommes construites
en matériaux permanents. On pourrait avancer l’hypothèse que cette double perception
semble être des moyens utilisés par les hommes pour limiter l’accès des femmes aux
ressources-clés, notamment à la terre et l’héritage. Faut-il alors conclure que les femmes
sont dépourvues de pouvoir et de capacité d’action?
À mon avis, la relation de genre au sein de la maison fait appel au concept de
pouvoir développé par Anthony Giddens (1989; 1984). Selon Giddens, il y a toujours une
relation dialectique entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent. Alors que
les hommes possèdent et héritent de tout ce qui est socialement utile, ce sont les femmes
qui, par leur travail, et par leur rôle dans la production des biens et dans la reproduction des
personnes, sous-tendent la réussite masculine liée à ces ressources. En outre, l’élément sur
lequel la négociation de pouvoir repose est la mobilité des femmes (Lyons, 1992; Vincent,
1985; Juillerat, 1971). Parce qu’elles sont conscientes de leur importance dans l’ascension
ou dans la regréssion sociale des hommes, les femmes manipulent activement les
représentations pour restreindre le pouvoir masculin et pour assurer leur autonomie
personnelle au sein de la maison. Dans la mesure où la société leu reconnait le droit de
divorcer, elles le font régulièrement, surtout lorsqu’elles ne peuvent pas tolérer l’arrivée
d’une coépouse au sein de la maison. Ainsi, s’il est certain que les hommes contrôlent les
ressources en écartant les femmes, celles-ci participent activement à l'objectivation des
perceptions négatives à leur propre avantage.
380
Un deuxième prolongement de cette thèse serait de mettre l’accent sur les maisons
des migrants transnationaux, lesquelles par leur nature ambigües, articulent à la fois leur
connexion et leur séparation avec le village238. Dans la société traditionnelle montagnarde,
j’ai montré qu’écrire la biographie d'une maison implique de raconter deux histoires
connexes. Une est la biographie matérielle de la maison, et l'autre est l’histoire des gens qui
habitent cette maison. Dans le cas des maisons des émigrés érigées au village, on a affaire à
une autre situation dans la mesure où elles sont rarement, si non pas du tout occupées.
L’absence de vie dans ces maisons ne signifie pourtant pas qu’elles sont passives et moins
dynamiques que les maisons habitées. Loin de là. La différence est qu’ici les relations
sociales sont externes à la maison plutôt qu’internes à elle. Elles sont là parce que leurs
propriétaires sont hors du village. Autrement dit, c’est à travers elles que les migrants
transnationaux restent présents dans le village tout en étant déconnectés. Mais en même
temps, leur vacuité est un symbole clair de la séparation et de la rupture entre eux et le
village.
Finalement, la maison n’est pas n’est pas que le foyer des relations sociales, comme
l’a théorisé Claude Lévi-Strauss dans son étude sur les « sociétés à maison » (2002; 1991).
Elle est également le lieu des tensions. Il convient d’ailleurs de faire remarquer dans
l’imaginaire montagnarde, fissure et fracture font partie de toute relation de parenté, et les
maisons vides des émigrés sont une matérialisation de ce paradoxe. En articulant à la fois
les relations de parenté et les relations tendues par la distance, les maisons vides
médiatisent en quelque sorte les contradictions inhérentes même à la vie des émigrés,
laquelle est marquée, à la fois, par leur présence et par leur absence, par leur connexion et
par leur séparation, par leurs intérêts individuels et par leurs redevances communautaires.
Les maisons vides pourraient ainsi fournir des éléments importants pour étudier une autre
forme de biographie culturelle, différente de celle étudiée par Roxana Waterson (2003),
puisqu’elles sont déterminées, non par la présence des relations humaines internes, mais par
leur absence. Elles permettent en outre d'étendre l'analyse de «la vie sociale des objets»
(Appadurai 1986) et par Janet Hoskins (2006; 1998) même à des objets qui ne sont pas
fonctionnels.
238 J’entends par migrants transnationaux ceux d’entre les Montagnards, qui ont réussi à s’installer en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi dans d’autres pays africains notamment le Gabon, le Nigéria et le Tchad.
381
Au demeurant, la maison et l’individu ne forment pas forcément deux entités
séparées ou radicalement opposées (maison = passive versus individu = actif par exemple),
mais davantage comme deux types d’agents impliqués dans un processus unique dans
lequel ils s’influencent l’un et l’autre. D’un côté, les individus construisent et transforment
sa maison, mais de l’autre, l’existence et la longévité de la maison recomposent leur statut
en tant que gens ayant réussi ou ayant échoué dans la vie sociale. L’agency n’est donc pas
unidirectionnelle, car l’homme et la maison évoluent dans le même processus, lequel
produit dans son sillage des sujets autonomes aussi bien que des objets autonomes. Par
ailleurs, les données empiriques recueillies sur le terrain me permettront d’aller plus loin
que Daniel Miller et de me tracer une trajectoire théorique propre à l’intérieur de ce vaste
domaine d’étude qu’est la culture matérielle. Daniel Miller écrit que : « We cannot know
who we are, or become what we are, except by looking in a material mirror » (2005 : 8). En
prenant appui sur l’hypothèse que les propriétés physiques de la maison les prédisposent à
agir au-delà des fonctions pour lesquelles ils ont été destinés, mes travaux ultérieurs
s’attèleront à prolonger la réflexion de Daniel Miller. Cela est d’autant plus nécessaire
qu’ils se fondent sur des recherches empiriques menées au sein des sociétés dites
« traditionnelles » alors que Miller et son équipe travaillent davantage au sein des sociétés
contemporaines et postmodernistes. Ce que je partage en commun avec Daniel Miller est
cependant l’idée que la maison, dans des circonstances imprévues, peut incarner une
agency qui la rend oppressive, d’où le fait qu’elle soit souvent personnifiée par les
Montagnards en tant que maison hantée qui hante à son tour ses occupants les obligeant à
se délocaliser.
383
Sources
Les sources de cette thèse s’organisent autour de trois principales parties. Est
d’abord fournie la liste des informateurs ayant participé à la recherche et auprès de qui les
données orales ont été collectées. Suivent ensuite les sources écrites, subdivisées en trois
sections, soient : 1. Archives coloniales; 2. Journaux; et 3. Sources électroniques. Enfin,
s’inscrivent les ouvrages et articles généraux cités dans le texte ainsi que ceux qui ont
nourri la réflexion. Ils sont repartis en 8 axes différents, soient : 1. Ouvrages de
méthodologie; 2. Théories de la maison et de la culture matérielle; 3. Monts Mandara :
généralités; 4. Identité, ethnicité et démocratie; 5. Théories de l’espace, esclavage et
mémoire servile; 6. Colonisation, post colonialisme et tourisme; 7. Migration, rapports
élites/villages et sorcellerie.
I. Sources orales- Liste des participants à la recherche
Podokwo
Udjila
Participants Sexe Age Mozogoum H 87
Montagne
Bedje Barama H 58 Chetima Diya H 65
Ussalaka Duluva H 70 Bassaka Kuma H 70 Namba Malapa H 57 Mesləpe Ragwa H 24
Mezhəne H 35 Namba Walla F 40 Zabga Valla H 62
Mavaga Bouda F 51 Hadjara F 84
Madama Doudje F 38 Kwarissa F 65
Vaza Kamba F 50 Zamana F 81
Wassa Badja F 70
384
Godigong
Duluva Mouche H 27
Plaine
Sevda Chikoua H 44 Zabga pastou H 27 Vigue Vaza H 30
Hadjara Gwada F 58 Mouche vaza H 50
Lade Ndawaka H 40 Gouada H 39
Kurbe Estera F 32
Muktele
Baldama
Madjagola H 60
Montagne
Menague H 86 Tsetsefa H 53 Kwala H 80
Tengola H 25 Damatala H 66 Tekuslem H 75 Kourbe F 57
Massadao F 60 Waoussa F 50 Kaoula F 45
Tekushele F 75
Tala-Mokolo
Madjokfa H 49
Plaine
Moussa H 39
Damakolo H 18 Tobela H 25
Lamissa F 47 Dougzum F 40
Zara F 33 Ndefidje F 47
Mura
Dume
Daugwene H 82
Montagne
Dəgla H 85
Madu H 62 Tacha Dia H 13 medyokwa H 60
Kwona H 65 Kwetcherike H 60
Dagabou H 50
385
Maryam F 55 Lamise F 58
Amaya Rachya F 43 Aje F 70
Mora-Massif
Mahama H 47
Plaine
Amagouwe H 55 Dawcha H 58 Nache F 48
Ambaya F 35 Lydia Mahama F 36
Montagnards islamisés
Ville de Mora
Talikoue H 75 Bukar H 40 Omar H 45 Ana F 45
Amada H 35 Lima F 38
Autres informateurs
Tala-Dabara Mtsa Chikoua H 55 Montagne Tala-Dabara Matsama Buda H 70 Montagne
Zuelva Gamnaga H 35 Montagne Uzlama Dugdje Duluva H 35 Montagne Uzlama Gigla Kamba H 60 Montagne
Makulahe Matsama H 65 Plaine Uvada Ngalewa H 69 Plaine
II. Sources écrites
1. Archives coloniales
Audoin, de Corvette, Commandant de la région du Nord, 1919, « Lettre au Commissaire de la République en daté du 08 septembre », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11306/C.
Billant, Lieutenant, Chef de subdivision de Mora, 1934, « Rapport d’une tournée effectuée du 25 mai au 11 juin 1934 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11881/F.
Blanvillain, Lieutenant, Chef de la Subdivision de Maroua, 1917, « Rapport des tournées de reconnaissance du chef de la subdivision de Maroua du 7 au 9 juillet 1917 »,
386
Archives Nationales de Yaoundé, APA 11787/0.
Blanvillain, Sous-Lieutenant, Chef de la Subdivision de Maroua, Juillet, 1917, « Rapport de l’opération de police effectuée du 6 au 23 juillet 2017 contre le groupement Méri », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11787/0.
Chabral, Colonel, Chef de la Subdivision de Mokolo, 1931, « Rapport du chef de circonscription de Mokolo à la suite d'une tournée effectuée du 20 au 26 juillet 1931 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11876/D.
Coste, Capitaine, Chef de la Subdivision de Mokolo, 1923, « Rapport annuel adressé au Chef de la circonscription de Maroua datée du 5 octobre», Archives de l’Institut des Sciences Humaines.
David, Lieutenant, chef de la subdivision de Mora, 1933, « Rapport d’une tournée effectuée du 27 novembre au 4 décembre 1933 dans la région de Ouarba », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10036.
David, Lieutenant, chef de la subdivision de Mora, 1934, « Rapport d’une tournée effectuée dans les monts Mandara du 31 mai au 28 juin », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10036.
Gröllemund, Lieutenant, chef de la subdivision de Mokolo, 1938, « Rapport d’une tournée effectuée du 9 au 16 août 1938 au nord-ouest de Mokolo », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11880.
Gröllemund, Lieutenant, chef de la subdivision de Mokolo, 1939, « Rapport d’une tournée effectuée du 4 au 14 février 1939 dans le canton de Bourrha », Archives Nationales de Yaoundé, 11764/E.
Kerbellec, Chef de la subdivision de Mora, 1943, « Rapport d’une tournée effectuée 13 au 24 février 1943 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10095/F.
Kerbellec, Chef de subdivision de Mora 1943, « Rapport de tournée du 9 au 19 juin 1943 dans les régions de Ouarba et d’Ouldémé », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10095/F.
Kerbellec, Chef de subdivision de Mora 1943, « Rapport de tournée du 13 au 24 février 1943 dans les rmassifs kirdis de Tala-Dabara, Oudjila, Mouktélé et Zoulgo », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10095/F.
Lavergne, Georges, Chef de la subdivision de Mokolo, 1941, « Rapport de deux tournées effectuées au 2e trimestre 1941 dans le canton de Mozogo », Archives Institut des Sciences Humaines.
Lembezat, Bertrand, 1949, « Admnistrations des primitifs du Nord-Cameroun. Centre des hautes études d’admnistration musulmane », Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence, Dossier no 366.
Mahoux, Sous-Lieutenant, Chef de la Circonscription de Maroua, 1918, « Rapport de l’Opération de Police menée dans la partie nord des monts Mandara en mai 1918 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 12037.
Major Dominik, Hans, 1915, « De l’Atlantique au Tchad », Archives Nationales de
387
Yaoundé, TA No 58.
Margerel, Lieutenant, Chef de la subdivision de Mora, 1937, « Rapport d’une tournée effectuée du 1er au 13 mars 1937 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11881/C.
Maronneau, Capitaine, Chef de la Circoncscription de Mokolo, 1934, « Rapport d’une tournée effectuée du 2 au 25 juillet à Bourrha à Gaouar », Archives Nationales de Yaoundé, APA 1AC5141.
Nicloux, Capitaine, Chef de la circonscription de Mokolo, 1932, « Rapport d’une tournée effectuée du 25 janvier au 16 février », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11876/C.
Panon, Capitaine, Chef de la Circonscription de Maroua, Juin 1917, « Rapport de juin 1917 de la circonscription de Maroua », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11787/0.
Petit, Capitaine, Chef de la Circonscription de Maroua, 1920, « Rapport de tournée du 20 février au 24 mars effectuée dans la partie nord des monts Mandara de maroua à Mora », Archives Nationales de Yaoundé, APA 12033.
Quoquereaux, Chef de la subdivision de Maroua, 1948, « Rapport de tournées effectuées en juillet 1948 dans les régions de Méri et Mayo-Mangafé », Archives de l’Institut des Sciences Humaines.
Remiré, Capitaine, Chef de la subdivision de Mokolo, 1929, « Rapport d'une tournée de prise de contact du 4 au 19 mars 1929 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10036.
Remiré, Capitaine, Chef de la subdivision de Mokolo, 1929, Rapport d’une tournée effectuée du 11 au 17 février 1929 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11832/J.
Salasc, chef de la subdivision de Mokolo, 1939, « Rapport des tournées effectuées en avril-mai 1939 », Archives de l’Institut des sciences Humaines.
Sergent Primas, Agent special de subdivision de Mora, 1934, « Rapport d’une tournée effectuée du 3 au 13 avril 1934 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11881/F.
Vallin, Capitaine, 1929, « Rapport d’une tournée effectuée du 22 septembre au 5 octobre 1929 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 10036.
Vallin, Capitaine, 1929, Chef de la subdivision de Mokolo, 1927, « Rapport d’une tournée effectuée du 15 au 26 juin 1927 », Archives Nationales de Yaoundé, APA 11893/D.
2. Journaux
Areguema, Jean, 2014, « Maroua: Une affaire de sorcellerie secoue la ville”, Œil du Sahel du 24 février.
Bowa, Nadège Christelle, 2014, « Secteur informel: Difficile pour les ‘débrouillards’» CamerounLink-Social, du 2 mai.
388
Gamdji, Mohamadou, 2010, « Cameroun: L'instrumentalisation des concepts de Kirdi et d'Islamo-Peul : un danger pour le Septentrion (Revisité) », Le Messager, No 3061 du 13 avril.
Mazda, Alain, 2013, « Les minorités écrivent à Paul Biya. Des associations pygmées, montagnardes et mbororo l’interpellent sur le respect des composantes sociologiques », Mutations, No 3367 du 26 mars.
Nzouankeu, Anne Mireille, 5 mars 2009, « A la découverte de la face cachée du quartier Bastos », Bonabéri.com, du 5 mars.
Patrick, D., 2012, « La friperie, un business lucratif et plein de surprises », Mboa News, du 14 juin.
Tabouli, Célestin Succès 2012, « Mémorandum : les montagnards chrétiens et animistes reviennent à la charge », du 03 mars.
Tabouli, Célestin Succès, 2013, « Mémorandum : Les Kirdis dénoncent Ibrahim Talba et Abba Boukar », Le Septentrion, du 19 septembre.
Zelao Alawadi, 2006, «Nord-Cameroun. Pouvoir des chefs traditionnels et inhibition de la ‘rationalité démocratique’», Œil du Sahel, No 207.
3. Sources photographiques et filmiques
Colombel (de), Véronique, 2001, Nord-Cameroun : musique des Ouldémé : au rythme des saisons, Maison des Cultures du Monde, Paris, Auvidis.
David Nicholas, 1995 Black Hephaistos: exploring culture and science in African iron working, Calgary, University of Calgary, Department of Communications Media.
David Nicholas, Maureen, Thomas, et Le Bléis, Yves, 1990, Vessels of the spirits: pots and people in North Cameroon, Calgary, University of Calgary, Department of Communications Media.
David Nicholas, Sterner, Judith et Gregs Phillips, 1999, Regenerating Sukur: male initiation in the Mandara Mountains, Alberta, Advanced Media for Learning.
David, Nicholas, 1988, Dokwaza: last of the African iron masters, Calgary, University of Calgary, Department of Communications Media.
Fernando, Nathalie et Marandola, Fabrice 1999, Une harpe ouldémé, Meudon, CNRS Diffusion.
Ferrandi, Jean, 1928, Conquête du Cameroun-Nord (1914-1915), Paris, Lakauzelle.
Forkl, Hermann, 1988, « Innerafrikanische Akkulturation bei den Wadèla, einem Stamm der Kerdi-Murá (Nordkamerun) », Münchner Beiträge Zur Völkerkunde, Vol. 1, pp. 63-77.
Forkl, Hermann, 1983, Die Beziehungen der zentral-Sudanischen Reiche Bornu, Mandara und Bagirmi sowie der Kotoko-staaten zu ihren südlichen Nachbarn unter besonderer Berücksichtigung des Sao-problems, München, Minerva Publication.
389
Gardi, René, 1953, Mandara: unbekanntes Bergland in Kamerun, Zürich, Orell Füssli Verlag.
Gardi, René, 1955, Kirdi unter den heidnischen Stämmen in den Bergen und Sümpfen Nord Kameruns, Zürich, Bücherglide Gutenberg.
Gardi, René, 1973, Indigenous African architecture, New York, Van Nostrand Reinhold Company.
Hinderling, Paul, 1955, « Versuch einer Analyse der sozialen Struktur der Matakam », Africa, Vol. 25, No 4, pp. 405-26.
Hinderling, Paul, 1984, « Die Mafa: Ethnographie eines Kirdi-Stammes in Nordkamerun. Band 3 – Materialien, Hanover, Verlag für Ethnologie.
Hinderling, Paul, 1984, Die Mafa: Ethnographie eines Kirdi-Stammes in Nordkamerun. Band 1 - Soziale und religiöse Strukturen, Band 3 – Materialen, Hanover, Verlag für Ethnologie.
Hinderling, Paul, 1984, Die Mafa: Ethnographie eines Kirdi-Stammes in Nordkamerun. Book 3 – Materialien, Hanover, Verlag für Ethnologie.
Lauwe (de), Paul-Henri, 1937, « Pierres et poteries sacrées du Mandara (Cameroun) », Journal De La Société Des Africanistes, Vol. 7, pp. 53-67.
Lavergne, Georges, 1944, « Le pays et la population matakam », Bulletin De La Société D'Études Camerounaises, Vol. 7, pp. 7-73.
Lavergne, Georges, 1949, Folklore africain : un peuplade du Haut-Cameroun - Les Matakam, Paris, Imprimerie Servant-Crouzet.
Lembezat, Bertrand, 1948, « Les rites du serment chez les animistes de Mora », Bulletin De La Société Des Études Camerounaises, Vol. 21-22, pp. 91-104.
Lembezat, Bertrand, 1950, Kirdi - les populations païennes du Nord Cameroun, Yaoundé, Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire, Série Populations.
Lembezat, Bertrand, 1952, Mukulehe - un clan montagnard du Nord-Cameroun, Paris, Berger-Levrault.
Leo, Africanus, 1896, The history and description of Africa and of the notable things therein contained, New York, Burt Franklin.
Lukas, Renate, 1973, Nicht-islamische Ethnien im südlichen Tschadraum, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
Mary, Henry, 1969, « Kirdis of Cameroon », Vogue, Vol. 154, No 10, pp. 174-81.
Schaller, Yves, 1973, Les Kirdi du Nord Cameroun, Strasbourg, Imprimerie des Dernières Nouvelles de Strasbourg.
Strümpell, Kurt F, 1923, « Wörterverzeichnis der Heidensprachen des Mandara Gebirges (Adamaua) », Zeitschrift Für Eingeborenen-Sprachen, Vol. 13, 47-74.
390
4. Liens internet
Association culturelle podokwo (ACPO): http://podoko.afrikblog.com/, lien vérifié le 07 janvier décembre 2015.
Association pour la promotion de la culture mafa (ACulmaf): http://aculmaf.e-monsite.com/pages/activites-de-l-aculmaf/organigramme-de-l-aculmaf.html, lien vérifié le 07 janvier décembre 2015.
David, Nicholas, « Translation of the Diarry of Hamman Hadji of Madagali 1912-1927 » : http://www.sukur.info/Mont/HammanYaji%20DIARY.pdf, lien vérifié le 23 décembre 2014.
Kirk-Greene Anthony, « A close reading of Hamman Hadji’s diary : slave raiding and montagnard responses in the mountains around Madagali (Northeast Nigeria and Northern Cameroon » : http://www.sukur.info/Mont/HammanYaji%20PAPER.pdf, lien vérifié le 23 décembre 2014.
Mandara Homepage :http://www.mandaras.info/ : lien vérifié le 23 décembre 2014.
Organisation des minorités ethniques au Cameroun (Laimaru Network) : http://laimaru.org/about-us/, lien vérifié le 07 janvier décembre 2015.
Petit Côte (non daté) « Waza-Grassfield-Ultramarine circuit combiné », Busclub tours, <http://busclubtours.ifrance.com/pages/wazaultramarine.htm>, consulté le 21 février 2010.
Sukur : a culture of the Mandara Mountains : http://www.sukur.info/: lien vérifié le 27 décembre 2014.
Sukur Worl Heritage : http://www.worldheritagesite.org/sites/sukur.html, lien vérifié le 23 décembre 2014.
http://doualafil.canalblog.com/archives/p10-10.html
http://nirvatravel.com/fra/46-cameroun/75-safari-dans-le-nord-du-cameroun-circuit-3
http://www.dentrodeafrica.com/fr_extremenord.php;
http://www.fagusvoyages.eu/plaintext/franais/circuits/24jours.html
http://www.guide.mboa.info/guide-touristique/chefferies-et-royaumes/fr/content/actualite/867,la-chefferie-oudjilla.html
http://www.guide.mboa.info/guide-touristique/chefferies-etroyaumes/fr/visiter/actualite/2702,la-chefferie-doudjilla-le-sa-re-du-chef.html
http://www.nomade-aventure.com/fiches-techniques/CMR02F.pdf
www.delcampe.net
391
III. Ouvrages et articles généraux
1. Ouvrages de méthodologie
Aktouf, Omar, 1987, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations: une introduction à la démarche critique, Québec, Presses de l'Université du Québec.
Alex Mucchielli, 1991, Les méthodes quantitatives, Paris, Presses universitaires de France.
Barthes, Roland, 1980, La chambre claire – notes sur la photographie, Gallimard, Le Seuil.
Beaud, Jean Pierre, 1997, «L'échantillonnage », dans Gauthier, Benoît (dir.), Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données, Québec, Les Presses de l'Université du Québec, pp. 133-142.
Becker, Howard, 1974, « Photography and Sociology », Studies in the Anthropology of Visual Communication, Vol. 1, No 1, pp. 3-26.
Bensan Alban, 1996, « De la micro-histoire vers une anthropologie critique », dans Revel, Jacques (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard/Le Seuil, pp. 37-70.
Berger, Laurent, 2004, Les nouvelles ethnologies. Enjeux et perspectives. Paris, Nathan.
Bertaux, Daniel, 1980, «L'approche biographique: sa validité méthodologique, ses potentialités », Cahiers Internationaux de Sociologie, Vol. 69, pp. 198-225.
Bertaux, Daniel, 1997, Les récits de vie, perspective ethnosociologique, Paris, Nathan.
Chanlat, Jean-François, 1990, « Stress, psychopathologie du travail et gestion », dans Chanlat, Jean-François (dir.), L’individu dans l’organisation: les dimensions oubliées, Québec, Presses de l’Université Laval, pp. 709-721.
Chauchat, Hélène, 1985, L'enquête en psychosociologie, Paris, Presses Universitaires de France.
Clifford, James, 2003, On the Edges of Anthropology: Interviews, Chicago, Prickly Paradigm Press.
Collier, Jean et Collier, Malcolm, 1986, Visual anthropology – photography as a research method, Albuquerque, University of New Mexico Press.
Collier, Jean, 2003, « Photography and visual anthropology », dans Hockings, Paul, Principles of Visual Anthropology, Mouton de Guyter, pp. 235-254.
Copans, Jean, 2002, L’enquête ethnographie de terrain, Paris, Nathan.
Denise, Jodelet, 2003, « Aperçus sur les méthodologies qualitatives », dans Moscovici, Serge et Buschini, Fabrice (dirs.), Les méthodes des sciences humaines, Paris, PUF, pp. 139-162.
Depelteau, François, 1998, La démarche d'une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la communication des résultats, Québec, Presses de l'Université Laval.
392
DesChene Mary, 1997, « Locating the Past », dans Gupta, Akhil et Ferguson, James (dirs.), Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley, University of California Press, pp. 66-85.
Deslauriers, Jean-Pierre et Poliot, Hermance, 1982, Les groupes populaires à Sherbrooke: pratique, financement et structure, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, coll. « Recherche sociale », pp. 89-91.
Deslauriers, Jean-Pierre, 1991, Recherche qualitative: guide pratique, Montréal, McGraw Hill.
Diagne, Mamoussé, 2006, Critique de la raison orale : Les pratiques discursives en Afrique noire, Paris, Karthala.
Dibwe, Donatien, 2006, « La collecte des sources orales », Civilisations, Vol. 54, pp. 45-55.
Dion, Delphine et Ladwein, Richard, 2005, « La photographie comme matériel de recherche », Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, [en ligne], http://www.nachez.info/meth21f/La_photographie_comme_materiel_de_recherche.pdf (consulté le 14 octobre 2012).
Duncan, James, 1985, « The house as a symbol of social structure », dans Altman, Irwin et Werner, Carol (dirs.), Home Environments, New York, Plenum Press, pp. 133-151.
Ellis, Pat, 1986, «Methodologies for doing research on women and development », Women in Development: Perspectives from the Nairobi conference, Ottawa, IDRC-MR, Vol. 137, pp. 136-143.
Fernando, Nathalie, et Marandola, Fabrice, 1999, Une harpe ouldémé, Paris, CNRS.
Fernando, Nathalie, et Marandola, Fabrice, 2002, Nord Cameroun - Musique des Ouldémé. Au rythme des saisons, Paris, Maison des Cultures du Monde.
Garfinkel, Harold, 2007 [1967], Recherches en ethnométhodologie, Paris, PUF.
Ghasarian, Christian, 2002, « Sur les chemins de l'ethnographie réflexive », dans Ghasarian, Christian (dir), De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive, nouveaux terrains, nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, Paris, Armand Colin, pp. 5-33.
Giorgi, Amadeo, 1985, Phenomenological and psychological research, Pittsburgh, Duquesne University Press.
Giorgi, Amadeo, 1989, « One type of analysis of descriptive data: Procedures involved in following a scientific phenomenological method », Methods, Vol. 1, pp. 39-61.
Giorgi, Amadeo, 1994, « A phenomenological perspective on certain qualitative methods », Journal of Phenomenological Psychology, Vol. 25, pp. 190-220.
Giorgi, Amadeo, 1997, « The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure », Journal of Phenomenological Psychology, Vol. 28, pp. 235-260.
Glaser, Barney, et Strauss Anselm, 1967, The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine.
393
Goffman, Erving, 1959, The presentation of self in everyday life, New York, Doubleday.
Goffman, Erving, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, vol. I : La présentation de soi, Paris, Minuit.
Goffman, Erving, 1974 [1967], Les rites d’interaction, Paris, Minuit.
Grawitz, Madeleine, 1996, Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz.
Gullestad, Marianne, 1992, The art of social relations: Essays on culture, social action and everyday life in modern Norway, Oslo, Scandinavian University Press.
Heisley, Deborah, 2001, « Visual research: current bias and future directions, Advances in Consumer Research », Vol. 28, pp. 45-46.
Husserl, Edmund, [1927] 1970, The crisis of European sciences and transcendental phenomenology, Evanston, Northwestern University Press.
Jodelet, Denise, 2003, « Aperçus sur les méthodologies qualitatives » dans Moscovici, Serge et Buschini, Fabrice (dirs.), Les méthodes des sciences humaines, Paris, Presses universitaires de France, pp. 55-71.
Kandem, Emmanuel, 2010, « Itinéraire de recherche qualitative sur les temporalités en Afrique », Recherches qualitatives, Vol. 8, pp. 61-75.
Kandem, Emmanuel, 2010, « Itinéraire de recherche qualitative sur les temporalités en Afrique », Recherches qualitatives, hors-série, Vol. 8, pp. 61-75.
Kaufmann, Jean-Claude, [1997] 2000, Le cœur à l'ouvrage. Théorie de l'action ménagère, Paris, Pocket.
Kaufmann, Jean-Claude, 1996, L'entretien compréhensif, Paris, Nathan.
Kuzel, Anton, 1992, «Sampling in qualitative inquiry », dans Crabtree, Benjamin et Miller, William (dirs.), Doing qualitative research, Newbury Park, Sage, pp. 31-44.
Le Breton, David, 2004, L’interactionnisme symbolique, Paris, PUF.
Legavre, Jean Baptiste, 1996, « La ‘neutralité’ dans l’entretien de recherche », Politix, n°35, pp.207-225.
Marcus, Georges, 1995, « Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography », Annual Review of Anthropology, Vol. 24, pp. 95-117.
Maso, Ilja, 2007, « Phenomenology and Ethnography », dans Atkinson, Paul (dir.), Handbook of Ethnography, London, Sage Publications.
Mayer, Robert, et Ouellet, Francine, 1991, «L'analyse des besoins d'une population », dans Ouellet, Francine et Mayer, Robert (dirs.), Méthodologie de recherche pour les intervenants sociaux, Boucherville, Gaëtan Morin, pp. 60-100.
Miles, Matthew et Huberman, Michael, 1991, Analyse des données qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes, Bruxelles, De Boeck.
Miles, Matthew et Huberman Michael, 1984, «Drawing Valid Meaning from Qualitative Data: Toward a Shared Craft », Educational Research, Vol. 13, No 1, pp. 20-30.
394
Miles, Matthew et Huberman Michael, 2003, Analyse des données qualitatives, Bruxelles, De Boeck.
Mondanda, Lorenza, 2001, « L’entretien comme événement interactionnel », dans Grosjean, Michel et Thibaud, Jean-Paul (dirs.), L’espace urbain en méthodes, Marseille, Parenthèses, pp.197-214.
Moore, Jeanne, 2000, « Placing home in context », Journal of Environmental Psychology, Vol. 20, pp. 207-212.
Mucchielli, Alex, 2003, Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin.
Myers, David, 2002, Social psychology, New York, McGraw-Hill.
Okely, Judith, 1996, Own or Other Culture. London and New York, Routledge.
Olivier de Sardan, Jean-Pierre, 1995, « La politique du terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, Vol. 1, pp. 71-109.
Olivier de Sardan, Jean-Pierre, 1996, « La violence faite aux données. De quelques figures de la surinterprétation en anthropologie », Enquête, Vol. 3, pp. 31-59.
Ouellet, Francine et Saint-Jacques, Marie-Christine, 2000, «Les techniques d'échantillonnage », dans Robert Mayer et al., Méthodes de recherche en intervention sociale, Montréal, Éd. Gaëtan Morin, pp. 71-90.
Paillé, Pierre (dir.), 2006, La méthodologie qualitative : postures de recherche et travail de terrain, Paris, Armand Colin.
Paillé, Pierre, 1994, «L'analyse par théorisation ancrée», Cahiers de recherche sociologique, Vol. 23, pp. 141-181.
Paillé, Pierre, et Mucchielli, Alex, 2003, L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, A. Colin.
Piette, Albert (1986), Ethnographie de l’action, l’observation des détails, Paris, Métaillé.
Piette, Albert, 1992a. « La photographie comme mode de connaissance anthropologique », Terrain, Vol. 18, (En ligne), http://terrain.revues.org/index3039.html (consulté le 13 octobre 2012).
Piette, Albert, 1992b, Le mode mineur de la réalité. Paradoxes et photographies en anthropologie, Louvain, Peeters.
Pires, Alvaro, 1997, «Échantillonnage et recherche qualitative: essai théorique et méthodologique », dans Poupart, Jean et al. (dirs.), La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques. Boucherville, Gaëtan Morin, pp. 113-169.
Poupart, Jean, et al., 1997, La recherche qualitative. Enjeux épistémologiques et méthodologiques, Boucherville, Gaëtan Morin.
Sadalla, Edward et Sheets, Virgil, 1993, « Symbolism in Building Materials. Self presentation and cognitive components », Environment and Behavior, Vol. 25, No 2, 155-180.
395
Seignobos, Christian, 1982, Montagnes et hautes terres du Cameroun, Paris, Parenthèses.
Serfaty-Garzon, Perla, 2003, Chez soi : les territoires de l'intimité, Paris, Armand Colin.
Smith, Jonathan et Dunworth, Fraser, 2003, « Qualitative Methodology », dans Valsiner, Jaan et Connolly, Kevin (dirs.), Handbook in developmental psychology, London, Sage, pp. 603-621.
Smith, Jonathan et Osborn, Mike, 2004, « Interpretative phenomenological analysis », dans Smith, Jonathan (dir.), Qualitative psychology, a practical guide to research methods, London, Sage, pp. 51-79.
Smith, Jonathan, (dir.), 2004, Qualitative psychology, a practical guide to research methods, London, Sage.
Thomas, David R., 2006, “A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data”, American Journal of Evaluation, Vol. 27, No 2, pp. 237-246.
Tremblay, André, 1991, Sondages: histoire, pratique et analyse, Boucherville, Gaëtan Morin.
Trudel, Robert, et Antonius, Rachad, 1991, Méthodologies quantitatives appliquées aux sciences humaines, Montréal, Éd. Centre éducatif et culturel.
Turcotte, Daniel, 2000, «Le processus de la recherche sociale », dans Robert Mayer et al. Méthodes de recherche en intervention sociale, Boucherville, Gaëtan Morin, pp. 39-68.
Urbain, Jean-Didier, 2003, Ethnologue, mais pas trop : ethnologie de proximité, voyages secrets et autres expéditions minuscules, Paris, Paillot/Rivages.
Van Der Maren, Jean-Marie, 2010, « Le souvenir et le bouleversement du temps dans la reconstruction du passé. Réflexions méthodologiques », Recherches qualitatives, hors-série, Vol. 8, pp. 37-50.
2. Théories de la maison et de la culture matérielle
Ames, Kenneth, 1996, « Life in the Big House: Household Labour and Dwelling Size on the Northwest Coast », dans Gary Coupland and Edward Banning (dirs), People who Lived in Big Houses: Archaeological Perspectives on Large Domestic Structures, Madison, Prehistory Press, pp. 131-150.
Ammann, Aguste et Garnier, Charles, 1889, Guide historique à travers l’exposition [universelle] des habitations humaines, Paris, Albin Michel.
Amsden, Jon (dir.), 1979, « The spatial dimension of history », Radical History Review, Vol. 1, pp. 3-247.
Anderson, Eugene, 1973, Some Chinese methods of dealing with crowding, Urban Anthropology, Vol. 1, pp. 141-50.
396
Anderson, James et Weidemann, Sue, 1997, « Developing and utilizing models of resident satisfaction », dans Zube, Ervin et Moore, Gary (dirs.), Advances in Environment, Behavior and Design, New York, Plenum Press, pp. 287-315.
Appadurai, Arjun (dir.), 1986, The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge, Cambridge University Press.
Appadurai, Arjun, 1986, « Introduction », dans Appadurai Arjun (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-63.
Appadurai, Arjun, 1987, « Street Culture », The India Magazine, Vol. 8, pp. 2-23.
Appadurai, Arjun, 2001 [1996], Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot.
Appadurai, Arjun, 2006, «The Thing Itself», Public Culture, Vol. 18, No 1, pp. 15-22.
Ardener, Shirley, 1981, Women and space: ground rules and social maps, London, Croom Helm.
Bachelard, Gaston, 2004 [1957], La poétique de l’espace, Paris, Quadrige/PUF.
Bailey, Douglass, 1990, « The Living House: Signifying Continuity », dans Samson, Ross (dir.), The Social Archaeology of Houses, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp.19-48.
Barrett, John, 1994, Fragments from Antiquity: An Archaeology of Social Life in Britain, Blackwell, Oxford.
Barthes, Roland, 1973, Le plaisir du texte, Paris, Seuil.
Barthes, Roland, 1983, Système de la mode, Paris, Seuil.
Barthes, Roland, 1993, L’empire des signes, Genève, A. Skira.
Barthes, Roland, 2001, Le bleu est à la mode cette année, Paris, Institut Français de la Mode.
Basso, Keith, 1984, « Stalking with stories: names, places and moral narratives among the Western Apache », dans Bruner, Edward (dir.), Text, Play and Story: The Construction and Reconstruction of Self and Society, Washington DC, Proceedings of the American Ethnological Society.
Bastien, Joseph, 1985, « Qollahuaya-Andean body concepts: a topographical-hydraulic model of physiology », American Anthropology, Vol. 87, pp. 595-611.
Baudrillard, Jean, 1968, « La morale des objets », Communications, Vol. 13, pp. 23-50.
Baudrillard, Jean, 1981 [1968], Le système des objets. La consommation des signes, Paris, Gallimard.
Baudrillard, Jean, 1986 [1970], La société de consommation. Ses mythes, ses structures, Paris, Denoël.
397
Berman, Marshall, 1983 [1982], All That Is Solid Melts Into Air. The Experience of Modernity, New-York, Simon and Schuster.
Birdwell-Pheasant, Donna et Lawrence-Zuniga, Denise (dirs.), 1999, House Life: Space, Place and Family in Europe, Oxford, Berg.
Bjornar, Olsen, 1990, « XXX », dans Tilley, Christopher (dir.), Reading material culture: structuralism, hermeneutics, and post-structuralism, Oxford/Cambridge, B. Blackwell.
Bjornar, Olsen, 2003, « Material culture after text: re-membering things », Norwegian Archeological Review, Vol. 36, No 2, pp. 87-104.
Bjornar, Olsen, 2006, « Scenes from a troubled engagement: post-structuralism and material culture studies », dans Tilley, Christopher et al. (dirs.), Handbook of material culture, London, Thousand Oaks; Calif., Sage, pp. 85-103.
Blanton, Richard, 1994, Houses and Households: A Comparative Study, New York, Plenum Press.
Blier, Suzanne P., 1987, The anatomy of architecture: Ontology and Metaphor in Betammaliba Architectural Expression, Chicago, University of Chicago Press.
Blier, Suzanne, 1983, « Houses are human: architectural self-images of Africa's Tamberma », Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 42, No 4, pp. 371-382.
Blier, Suzanne, 2000, « The Functions of Things: A philosophical perspective on materialculture », dans Graved-Brown, Paul (dir.), Matter, Materiality and Modern Culture, Routledge, London, pp. 22-49.
Blier, Suzanne, 2006, « Vernacular architecture », dans Tilley, Christopher et al. (dirs.), Handbook of material culture, London/ Thousand Oaks, Sage, pp. 230-253.
Blunt, Alison et Dowling, Robyn, 2006, Home, Abingdon, Routledge.
Boas, Franz, 1897, The social organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians, Washington, Government Printing Office.
Boas, Franz, 1920, « The Social Organization of the Kwakiutl », American Anthropologist, Vol. 22, pp. 111-126.
Boas, Franz, 1964 [1888], The Central Eskimo, Lincoln, University Nebraska Press.
Bonnin, Philippe et De Villanova, Roselyne (dirs.), 1999, D’une maison à l’autre : parcours et mobilités résidentielles, Grâne, Créaphis.
Bonnot, Thierry, 2002, La vie des objets, d'ustensiles banals à objets de collection, Paris, La Maison des sciences de l'homme.
Bourdieu, Pierre, 1970, « La maison kabyle ou le monde social renversé », dans Pouillon, Jean et Maranda, Pierre (dirs), Mélanges offerts à C. Lévi-Strauss, tome II, Paris, Mouton, pp. 739-758.
398
Bourdieu, Pierre, 1972, Esquisse d'une théorie de la pratique précédée de Trois études d'ethnologie kabyle, Paris/Genève, Droz.
Bourdieu, Pierre, 1977, Outline of a Theory of Practice, Cambridge, Cambridge University Press.
Bourdieu, Pierre, 1979, La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Minuit.
Bourdieu, Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris, Minuit.
Bourdieu, Pierre, 1994, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit.
Bourdieu, Pierre, 1996, Raisons pratiques sur la théorie de l’action, Paris, Seuil.
Bourdieu, Pierre, 2000, Esquisse d’une théorie de la pratique : précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Paris, Seuil.
Bretell, Caroline, 1999, « The Casa of José dos Santos Caldas : Family and Household in a Northwestern Portuguese Village, 1850-1993 », dans Birdwell-Pheasant, Donna et Lawrence-Zuniga, Denise (dirs.), House life : space, place and family in Europe, Oxford, Berg, pp. 39-69.
Bromberger, Christian, 1980, « Espace public, espace privé, espace sauvage en Provence », Annales du Centre Régional de Documentation Pédagogique, Marseille, pp. 71-108.
Buchli, Victor (dir.), 2002, The material Culture Reader, New York, Berg.
Buchli, Victor, 1995, « Interpreting Material Culture: the Trouble With Text», dans Hodder, Ian et al. (dirs), Interpreting Archeology, London, Routledge, pp. 181-193.
Buchli, Victor, 2000 [1999], An Archeology of Socialism, Materializing Culture, New Yok, Berg.
Buchli, Victor, 2006, « Architecture and modernism », dans Tilley, Christopher et al. (dirs.), Handbook of material culture, London, Thousand Oaks, Calif. Sage, pp. 254-267.
Buchli, Victor, 2013, An Anthropology of Architecture, London, Berg Publishers.
Buchli, Victor, 2015, An Archeology of the Immaterial, New York, Routledge.
Calvet, Georges, 1975, « La maison témoin majeur mais ambigu des sociétés rurales, exemple de la France du Sud-Ouest », Communautés du Sud, T.1, Ed. UGE, pp. 120-150.
Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), 1995, About the house. Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, Cambridge University Press.
Carsten, Janet, et Hugh-Jones, Stephen, 1995, « Introduction », dans Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the House: Lévi-Strauss and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-46.
Chapman, Tony et Hockey, Jenny (dirs.), 1999, Ideal Homes? Social change and domestic life, London, Routledge.
399
Chevalier, Sophie, 1994, «Au-delà d'une apparente banalité et d'un standard; des décors domestiques particuliers », Archives suisses des traditions populaires, Vol. 90, No 2, pp. 165-85.
Chevalier, Sophie, 1998, « From woollen carpet to grass carpet: bridging house and garden in an English suburb », dans Daniel Miller (dir.), Material Culture: Why some Things Matter, Chicago, University of Chicago Press, pp. 47-72.
Clifford, James, 1988, The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Litterature, and Art, Cambridge, Harvard University Press.
Clifford, James, 1997, Routes: travel and translation in the late twentieth century, Cambridge, Havard University Press.
Coiffier, Christian, 1990, « Sepik River architecture: changes in cultural traditions », dans Lutkehaus, Nancy et al. (dirs.), Sepik heritage: tradition and change in Papua, New Guinea, Durham, Carolina Academic Press, pp. 491-4997.
Coolen, Henny ; Kempen, Elizabeth et Ozaki, Ritsuko, 2002, « Experiences and meaning of dwellings. Workshop reports », Housing, Theory and Society, Vol. 19, p. 114-116.
Csikszentmihalyi, Mihaly et Rochberg-Halton, Eugen, 1981, The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self, Cambridge, Cambridge University Press.
Cunningham, Clark, 1964, « Order in the Atoni house », Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, Vol. 120, No 1, pp. 34-68.
Dant, Tim, 1999, Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, Buckingham/Philadelphia, Open University Press.
Dant, Tim, 2003, Critical Social Theory, London, Sage.
de Villanova, Roselyne, Leite, Carolina et Raposo, Isabel, 1994, La maison de rêve au Portugal, Paris, Créaphis.
de Villaonva, Roselyne et Bonvalet, Catherine, 1999, « Immigrés propriétaires ici et là-bas», dans Bonnin, Philippe (dir.), D’une maison l’autre : parcours et mobilités résidentielles, Paris, Créaphis.
Desprès, Carole, 1991, « The meaning of home: Literature Review and Directions for Further Research and Theoretical Development », Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 8, pp. 96-115.
Douglas, Mary et Baron, Isherwood, 1979, The world of Goods, London, A. Lane.
Douglas, Mary, 1991, « The Idea of a Home: A Kind of Space », Social Research, Vol. 58, No 1, pp. 287-307.
Doxtater, Dennis, 1984, « Spatial opposition in non-discursive expression: architecture as ritual process », Canadian Journal of Anthropology, Vol. 4, No 1, pp. 1-17.
Drewal, Margaret, 1990, « Portraiture and the construction of reality in Yorubaland and beyond», African Arts, Vol. 23, No 3, pp. 40-49.
400
Duncan, James (dir.), 1981, Housing and identity: Cross-cultural perspectives, London, Croom Helm.
Duncan, James, 1973, « Landscape taste as a symbol of group identity: a Westchester country village », Geographical Review, Vol. 63, No. 3, pp. 334-355.
Duncan, James, 1976, « Landscape and the communication of social identity », dans Rapoport, Amos (dir.), The mutual interaction of people and their built environment. A cross-cultural perspective, Paris, Mouton, p. 391-401.
Duncan, James, 1981, « From container of women to status symbol: the impact of social structure on the meaning of the house », dans Duncan, James (dir.), Housing and Identity: Cross- Cultural Perspectives, London, Croom Helm, pp. 36-59.
Duncan, James, 1985, « The house as a symbol of social structure », dans Altman, Irwin et Werner, Carol (dirs.), Home Environments, New York, Plenum Press, pp. 133-151.
Duncan, James, 1989, « Getting respect in the Kandyan Highlands: the house, the community and the self in a Third World Society », dans Low, Setha et Chambers, Erve (dirs.), Housing, Culture and Design. A comparative perspective, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 229-52.
Durkheim, Emile et Mauss, Marcel, 1963 [1888], Primitive Classification, Chicago, University of Chicago Press.
Durkheim, Emile, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Alcan.
Eco, Umberto, 1972, « The componential analysis of the architectural sign/column », Semiotica, Vol. 5, No 2, pp. 97-117.
Eco, Umberto, 1976, A Theory of Semiotics, Bloomington, University of Indiana Press.
Eco, Umberto, 1980, « Function and sign: the semiotics of architecture », dans Broadbent, Geoffrey, Bunt, Richard et Jencks, Charles (dirs.), Signs, Symbols and Architecture, Chichester, John Willer, p. 11-69.
Eliade, M., 1983, « Architecture sacrée et symbolisme », dans Damian, Horia et Raynaud, Jean-Pierre (dirs.), Les symboles du lieu : l’habitation de l’homme, Paris, L’Herne, pp. 57-75.
Erny, Pierre (dir.), 1999, Douze contributions à une ethnologie de la maison, Paris, L’Harmattan.
Fernandez, James, 1977, Fang architectonics, Philadelphia, Institute for the Study of Human Issues.
Fernandez, James, 1986, Persuasions and Performances: the Play of Tropes in Culture, Bloomington, Indiana University Press.
Fernandez, James, 1988, « Andalusia on our minds: two contrasting places in Spain as seen in a vernacular poetic duel of the late 19th century », Cultural Anthropology, Vol. 3, pp. 21-35.
Fogelin, Lars, 2006, Archaeology of Early Buddhism, California, Altamira Press.
401
Foucarde, Marie-Blanche, 2007, Habiter l’Arménie au Québec : Ethnographie d’un patrimoine domestique en diaspora, Thèse de Doctorat en ethnologie, Université Laval.
Foucault, Michel, 1975, Surveiller et punir, naissance de la prison, Paris, Gallimard.
Foucault, Michel, 1977, Language, counter-memory, practice: selected essays and interviews, Ithaca, Cornell University Press.
Foucault, Michel, 1984, « Des espace autres », Architecture, Mouvement, Continuité, Vol. 5, pp. 46-49.
Garabuau-Moussaoui, Isabelle et Desjeux, Dominique, 2000, Objet banal, objet social. Les objets quotidiens comme révélateurs des relations sociales, Paris, L’Harmattan.
Geertz, Clifford, 1973, The interpretation of cultures ; selected essays, New York, Basic Books.
Geertz, Clifford, 1983, Bali, interprétation d’une culture, Paris, Gallimard.
Gell, Alfred, 1986, « Newcomers to the World of Goods », dans Appadurai, Arjun (dir.), The Social Life of Things, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 110-138.
Gell, Alfred. 1998, Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford, Clarendon Press.
Giddens, Anthony, 1979, Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis, Berkeley, University of California Press.
Giddens, Anthony, 1984, Constitution of Society: Outline of a Theory of Structuration, Cambridge, Polity Press.
Giddens, Anthony, 1989, Structuration Theory: Anthony Giddens and the Constitution of Social Life, New York, St Martin’s Press.
Gilchrist, Roberta, 2000, « Archaeological Biographies: Realizing Human Lifecycles, -courses and histories » World Archaeology, Vol. 31, No 3, pp. 325-328.
Giles, Katherine, 2000, An Archaeology of Social Identity, Oxford, Archaeopress.
Gillespie, Susan, 2000, « Beyond kinship. An introduction », dans Rosemary, Joyce et Gillespie, Susan (dir.), 2000, Beyond Kinship. Social and material reproduction in house societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 1-21.
Gillespie, Susan, 2000, « Lévi-Strauss Maison and société à maisons », dans Rosemary, Joyce, et Gillespie, Susan (dir.), 2000, Beyond Kinship. Social and material reproduction in house societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 22-52.
Gillespie, Susan, 2000, « Rethinking ancient Maya social organization: replacing lineage with house », American Anthropologist, Vol. 102, No 3, pp. 467-484.
Gilmore, David, 1977, « The social organization of space: class, cognition and space in a Spanish town », American Ethnology, Vol. 4, No 3, pp. 437-52.
402
Gilmore, David, 1987, Honor and shame and the Unity of the Mediterranean, Washington, Anthropological Association Special Publication.
Glück, Julius, 1959, «Afrikanische Architektur», Tribus, Vol. 6, pp. 65-82.
Goffman, Erwin, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit.
Gosden, Chris et Marshall, Yvonne, 1999, « The Cultural Biography of Objects », World Archaeology, Vol. 31, No 2, pp. 169-178.
Griaule, Marcel, 1954, «The Dogon of the French Sudan (Mali) », dans Forde, Daryll (dir.), African worlds. Studies in the cosmological ideas and social values of African peoples, London, Oxford University Press, pp. 83-110.
Guidoni, Enrico, 1978, Primitive architecture, Milan, Electa.
Halbwachs, Maurice, 1925, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Alcan.
Hallaire, Antoinette, 1975, « L’habitat d’une « montagne-refuge », les monts Mandara », Études Scientifiques, num. spéc, pp.17-24.
Hamberger, Klaus, 2010, « La maison en perspective. Un modèle spatial de l’alliance », L’Homme, Vol. 194, pp. 7-40.
Hauge, Ashild et Kolstad, Arnulf, 2007, « Dwelling as an expression of identity: A comparative study among residents in high-priced and low-priced neighbourhoods in Norway », Housing, Theory and Society, Vol. 24, pp. 272-292.
Hauge, Ashild, 2007, « Identity and place: a comparison of three identity theories », Architectural Science Review, Vol. 50, No 1, pp. 44-51.
Hegel, Friedrich, 2009 [1807], La phénoménologie de l’esprit, Paris, PUF.
Heidegger, Martin, 1958, Essais et conférences, Paris, Gallimard.
Hillier, Bill et Hanson, Julienne, 1984, The Social Logic of Space, Cambridge, Cambridge University Press.
Hodder, Ian (dir.), 1978, The Spatial organisation of culture. New approaches in archaeology, London, Duckwort.
Hodder, Ian et Hutson, Scott, 1986, Reading the Past, Cambridge, Cambridge University Press.
Hodder, Ian et Hutson, Scott, 2003, Reading the Past: Current Approaches to Interpretation in Archaeology, Cambridge, Cambridge University Press.
Hodder, Ian, 1982, Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture, Cambridge, Cambridge University Press.
Hodder, Ian, 1989, « This is not an article about material culture as text », Journal of Anthropological Archaeology, Vol. 8, pp. 250-69.
Hodder, Ian, 1992, Theory and practice in archaeology, London, Routledge.
Hodder, Ian, 1999, The archaeological process. An introduction, Oxford, Blackwell.
403
Hodder, Ian, 2006, The leopard’s tale. Revealing the mysteries of Çatalhöyük, London, Thames and Hudson.
Hodder, Ian, 2012, Entangled. An archaeology of the relationhips between humans and things, Oxford, Wiley and Blackwell.
Hoskins, Janet, 1998, Biographical Objects, How things tell the stories of people’s Lives, London: Routledge.
Hoskins, Janet, 2006, « Agency, Biography and Objects », dans Tilley, Christopher et al. (dirs.), Handbook of material culture, London, Thousand Oaks; Calif., Sage, pp. 74-84.
Hugh-Jones, Stephen, 1985, « The Maloca: world in a house », dans Carmichael, Elizabeth, Hugh-Jones, Stephen, Moser, Brian et Taylor, Donald, The hidden peoples of the Amazon, London, British Museum Publications, pp. 78-93.
Hugh-Jones, Stephen, 1993, « Clear Descent or Ambiguous Houses? A Re-examination of Tukanoan Social Organisation », L’Homme, Vol. 126-128, p. 95-120.
Hugh-Jones, Stephen, 1995, « Inside-Out and Back-to-Front: The Androgynous House in Northwest Amazonia », dans Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the house. Lévi-Strauss and beyond, Cambridge/New York, Cambridge University Press, pp. 226-252.
Humphrey, C.aroline, 1988, « No Place Like Home in Anthropology: The Neglect of Architecture », Anthropology Today, Vol. 4, No 1, pp. 16-18.
Hurcombe, Linda, 2007, Archaeological Artefacts as Material Culture, London, Routledge.
Ingold, Tim, 2000, The Perception of the Environment: Essays in Livelihood, Dwelling and Skill. London, Routledge.
Johnson, Norris, 1988, « Temple architecture as construction of consciousness: a Japanese temple and garden », Architecture and Behavior, Vol. 4, pp. 229-50.
Jones, Andrew, 2002, Archaeological Theory and Scientific Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Jonhson, Matthew, 1993, Housing Culture : traditional architecture in an English landscape, London, UCL Press.
Jopling, Carol, 1988, Puerto Rican Houses in Sociohistorical Perspective, Knoxville, University of Tennessee Press.
Julien, Marie-Pierre et Rosselin, Céline, 2005, La culture matérielle, Paris, La Découverte.
Kajaj, Khalid, 1999, «L’architecture et le « populaire » ou le projet urbain à l’épreuve de la valeur d’usage », dans Erny, Pierre (dir.), Cultures et habitats. Douze contributions à une ethnologie de la maison, Paris, L’Harmattan, pp. 268-285.
Keane, Webb, 1997, Signs of recognition, Berkley, University of California Press.
Kent, Susan (dir.), 1987, Method and Theory for Activity Area Research, New York, Columbia University Press.
404
Kent, Susan, 1984, Analyzing Activity Areas: An Ethnoarchaeological Study of the Use of Space, Albuquerque, University of New Mexico Press.
Kent, Susan, 1990, Domestic Architecture and the Use of Space: an Interdisciplinary Cross Cultural Study, Cambridge, Cambridge University Press.
Kent, Susan, 1991, « Partitioning Space: Cross-cultural Factors Influencing Domestic Spatial Segmentation », Environment and Behavior, Vol. 23, pp. 438-473.
Kent, Susan, 2000, «The Cultural Revolution in Architecture », dans Moore, Keith (dir.), Culture, Meaning, Architecture. Critical reflections on the work of Amos Rapoport, Sydney, Burlington/Aldershot/Ashgate, pp. 268-277.
Kenyion, Lyz, 1999, « A home from home: students’ transitional experience of home », dans Tony et Hockey, Jenny (dirs.), Social homes? Social change and domestic life, London, Routledge, pp. 84-95.
King, Anthony, 1976, «Values, science and settlement: a case study in environmental control », dans Rapoport, Amos, The mutual interaction of people and their built environment. A cross-cultural perspective, Paris, Mouton, pp. 365-390.
King, Anthony, 1979, Colonial Urban Development: Culture, Social Power and Environment, London, Routledge/Kegan Paul
King, Anthony, 1980, «A time for space and a space for time: the social production of the vacation house », dans King, Anthony (dir.), Buildings and society: essays on the social development of the Built Environment, London, Routledge/Kegan Paul, pp. 193-227.
King, Anthony, 1984, « The social production of building form: theory and research », Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 2, No 4, pp. 429-446.
King, Anthony, 1987, « Cultural production and reproduction. The political economy of societies and their built environment », dans Canter, David, Krampen, Martin et Stea, David (dirs.), Environmental Perspectives ; Ethnoscapes ; Current Challenge in the Environmental Social Sciences, London, Grower, pp. 72-98.
Knapp, Ronald, 1989, China's Vernacular Architecture: House Form and Culture, Honolulu, University of Hawaii Press.
Kopytoff, Igor, 1986, « The Cultural Biography of Things: Commodization as Process », dans Appaduraï, Arjun (dir.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 64-71.
Kuper, Hilda, 1972, « The language of sites in the politics of space », American Anthropologist, Vol. 74, pp. 411-425.
Kyung, Wook Seo, 2012, « DNA of the House A Hidden Dimension in the Development of Domestic Space in Seoul », Home Cultures, Vol. 9, No, pp. 77-98.
Lamaison, Pierre, 1987, « La notion de maison. Entretien avec Lévi-Strauss », Terrain, Vol. 9, pp. 34-39.
Latour, Bruno, 1993, We have never been modern, New York, Harvester Wheatsheaf.
405
Latour, Bruno, 2007, « Une sociologie sans objet ? Remarques sur l’interobjectivité », dans Débary, Octave et Turgeon, Laurier (dirs.), Objets et Mémoires, Paris/Québec, MSH/Presses de l’Université Laval, pp. 37-57.
Lawrence, Denise, 1988, « Suburbanization of house form and gender relations in a rural Portuguese Agro-town », Architecture and Behavior, Vol. 4, No 3, pp. 197-212.
Lawrence, Denise et Low, Setha, 1990, «The built environment and spatial », Annual Review of Anthropology, Vol. 19, pp. 453-505.
Lawrence, Roderick, 1981, « The social classification of domestic space: a cross-cultural study », Anthropos, Vol. 76, No 5/6, pp. 649- 64.
Lawrence, Roderick, 1983, « The interpretation of vernacular architecture », Vernacular Architecture, Vol. 14, pp. 19-28.
Lawrence, Roderick, 1987, « What makes a home? », Environment and Behavior, Vol. 19, No 2, pp. 154-168.
Lawrence, Roderick, 1987, Housing, dwellings and homes: designs theory, research and practice, New York, Willey.
Lawrence, Roderick, 1989, « Structuralist theories in environment-behavior-design research: applications for analyses of people and the built environment », dans Zube, Ervin et Moore, Gary (dirs.), Advances in Environment, Behavior and Design, New York, Plenum, pp. 38-70.
Lawrence, Roderick, 1990, « Public collective and private space: a study of urban housing in Switzerland », in Kent, Susan (dir.), Domestic architecture and the use of space: an interdisciplinary cross-cultural study, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 73-91.
Lawrence, Roderick, 2000, Sustaining human settlement: a challenge for the new millennium, Gateshead, Urban International Press.
Lea, Vanessa, 1995, « The Houses of the Mebengokre (Kayapo) of Central Brazil. A New Door to their Social Organization », dans Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the House: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 206-225.
Lee, David, 1969, « Factors influencing choice of house-type: a geographic analysis from the Sudan », Professional Geographer, Vol. 21, No 6, pp. 393-397.
Leroi-Gourhan, André, 1973, Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes, Paris, Albin Michel.
Lévi-Strauss, Claude, 1982, The Way of the Masks, Seattle, University of Washington Press.
Lévi-Strauss, Claude, 1983, « Histoire et ethnologie », Annales, Vol. 38, No 2, pp. 1217-1231.
Lévi-Strauss, Claude, 1984, Paroles données, Paris, Plon.
406
Lévi-Strauss, Claude, 1987, Anthropology and Myth: Lectures 1951-1982, Oxford, Blackwell.
Lévi-Strauss, Claude, 1991, « Maison », dans Izard, Michel et Bonte, Pierre (dirs.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF.
Lévi-Strauss, Claude, 2002 [1947, 1967], Les structures élémentaires de la parenté, Berlin/New York, Mouton.
Lévi-Strauss, Claude, 2004 [1979], La voie des masques, Paris, Pocket.
Lien, Laura, 2009, « « Home as identity: Place-making and its implications in the built environment of older persons », Housing and Society, Vol. 36, No 2, pp. 149-170.
Locock, Martin, 1994, « Meaningful Architecture », dans Locock, Martin (dir.), Meaningful Architecture: Social Interpretations of Buildings, Avebury, Ashgate Publishing, pp 1-13.
Loyd, Bonnie, 1981, « Women, home and status », dans Duncan, James (dir.), Housing and identity: Cross-cultural perspectives, London, Croom Helm, pp. 181-97.
Lussault, Michel, 2000, « Action(s) !», dans Levy, Jacques et Lussault, Michel (dirs.), Logiques de l’espace, esprit des lieux. Géographies à Cerisy, Paris, Belin, pp. 11-36.
Macdonald, Charles (dir.), 1987, De la hutte au palais : sociétés « à maison » en Asie du Sud-Est insulaire, Paris, CNRS.
Malaquais, Dominique, 1994, « You are what you build: architecture as identity in the Highlands of West Cameroon», Traditional Dwellings and Settlements Review, Vol. 5, No 11, pp. 21-35.
Malaquais, Dominique, 2002, Architecture, pouvoir et dissidence au Cameroun, Paris, Karthala/Presses de l’UCAC.
Mallet, Shelley, 2004, « Understanding home: a critical review of the literature », The Sociological Review, Vol. 52, pp. 62-89.
Marcus, Cooper, 1995, House as a mirror of self: Exploring the deeper meaning of home. Berkeley/California, Conari Press.
Marie-Pierre, Julien et Warnier, Jean-Pierre (dirs.), 1999, Approches de la culture matérielle. Corps à corps avec l'objet, Paris/Montréal, L'Harmattan.
Marshall, Yvonne, 2000, « Transformations of Nuu-chah-nulth Houses », dans Rosemary, Joyce et Gillespie, Susan (dirs.), Beyond Kinship. Social and material reproduction in house societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 73-102.
Marututyan, Haruthyn, 2001, « Home as the World », dans Levon, Abrahamian (dir.), Armenian Folk Arts, Culture and Identity, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, pp. 73-97.
Massudi Alabi Fassassi, 1997, L’architecture en Afrique noire. Cosmoarchitecture, Paris, L’Harmattan.
407
Mauss, Marcel, 1935, « Les techniques du corps », Journal de Psychologie, No 32, pp. 271-293.
Mauss, Marcel, 1968, « Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos », Sociologie et Anthropologie, Paris, pp. 389-477.
Mauss, Marcel, 2007 [1923-1924], Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, Presses universitaires de France.
Mauss, Mauss et Beuchat, Henri, 1979 [1906], Seasonal Variations of the Eskimo, London, Routledge/Kegan Paul.
McKinnon, Susan, 1995, « Houses and hierarchy: the view from a South Moluccan society», dans Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the House: Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 170-188.
McKinnon, Susan, 2000, « The Tanimbarese Tavu. The Ideology of Growth and the Material Configurations of Houses and Hierarchy in an Indonesian Society », dans Rosemary, Joyce et Gillespie, Susan (dirs.), Beyond Kinship. Social and Material Reproduction in House Societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 161-176.
Meskell Lynn, 2004, Object Worlds in Ancient Egypt: Material Biographies Past and Present. Oxford, Berg.
Miller, Daniel (dir.), 1995, Worlds apart: modernity through the prism of the local, London, Routledge.
Miller, Daniel (dir.), 1998, Material Cultures. Why some things matter, Chicago, The University of Chicago Press.
Miller, Daniel (dir.), 2001, Home possessions: material culture behind closed doors, Oxford/New York, Berg.
Miller, Daniel et Tilley, Christopher, 1996, « Editorial », Journal of Material Culture, Vol. 1, No 1, pp. 5-14.
Miller, Daniel et Tilley, Christopher, 2011, « Replies to Mitch Rose: 'Secular materialism: a critique of earthly theory' », Journal of Material Culture, Vol 16, No 2, pp. 107-129.
Miller, Daniel, 1987, Material Culture and Mass Consumption, Oxford, Basil Blackwell.
Miller, Daniel, 1994, Modernity, Oxford, Berg.
Miller, Daniel, 2001b, « Possessions », dans Miller, Daniel (dir.), Home Possessions. Material culture behind the closed doors, Oxford, Berg, pp.107-122.
Miller, Daniel, 2005, Materiality, Durham, Duke University Press.
Miller, Daniel, 2006, « Things that bright up the place », Home Cultures, Vol. 3, No 3, pp. 235-249.
Miller, Daniel, 2007, « Why the best furniture goes to the house you can’t live », Ethnologia Europaea: Journal of European Ethnology, Vol. 37, pp. 45-50.
408
Miller, Daniel, 2008, « Migration, Material Culture and Tragedy: Four Moments in Caribbean Migration », Mobilities-UK, Vol. 3, No 3, pp. 397-413.
Miller, Daniel, 2008, The Comfort of Things, Cambridge, Polity.
Miller, Daniel, 2010, « Le blue-jean ou Pourquoi la technologie vient en dernier », Technique et Culture, Vol. 52/53, pp. 232-255
Miller, Daniel, 2011, « Reply to Mitch Rose `Secular Materialism », Journal of Material Culture, Vol.16, No 3, pp. 325-329.
Miller, Danuel, 2011, « Power of making », Crafts, Vol. 232, pp. 86-93.
Moisa, Daniela, 2009, « Amener l’ailleurs chez soi. Pratiques architecturales domestiques au Pays d’Oas », Ethnologies, Vol. 31, No 1, pp. 77-109.
Moisa, Daniela, 2010, Maisons de rêve au pays d'Oas: (Re)construction des identités sociales à travers le bâti dans la Roumanie socialiste et postsocialiste, Thèse de doctorat, Université Laval.
Moore, Alexander, 1981, « Basilicas and king-posts: a proxemic and symbolic event analysis of completing public architecture among the San Blas Cuna », American Ethnologist, Vol. 8, pp. 259-77.
Moore, Henrietta, 1986, Space, Text, and Gender. An Anthropological Study of the Marakwet of Kenya, Cambridge, Cambridge University Press.
Moore, Jeanne, 2000, « Placing home in context », Journal of Environmental Psychology, Vol. 20, pp. 207-212.
Morgan, Lewis, 2003 [1881], Houses and House-Life of American Aborigines, Salt Lake, The University of Utah Press.
Myers, Fred (dir.), 2001, The Empire of Things, Albuquerque, School of American Research Press.
Nelson, Steven, 2007, From Cameroon to Paris: Mousgoum Architecture In and Out of Africa, Chicago, Chicago University Press.
Nicolau, Irana, et Althabe Gérard, 2002, « Les gens et les choses: intimité et consommation », Martor, Vol. 7, pp. 7-21.
Orser, Charles, 1994, « The archeology of African American slave religion in Antebellum South », Cambridge Archeological Journal, Vol. 4, No 1, pp. 33-45.
Otterbein, Keith, 1975, Changing house types in Long Bay Cays: the evolution of folk housing in an out island Bahamian community, New Haven, Human Relations Area Files.
Paadam, Katrin, 2003, Constructing residence as home: Homeowners and their housing histories, Tallin, Kirjastus.
Padenou, Guy-Hermann et Barrué-Pastor, Monique, 2006, Architecture, société et paysage bétammaribé au Togo. Contribution à l’anthropologie de l’habitat, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
409
Parker Pearson, Mike et Richards, Colin, 1994, « Ordering the world: perceptions of architecture, space and time », dans Parker Pearson, Mike et Richards, Colin, Architecture and Order: Approaches to Social Space, Routledge, London, pp.1-37.
Pezeu-Massabuau, Jacques, 2007, Produire l'espace habité, Paris, L'Harmattan.
Pratt, Geraldine, 1981, « The house as an expression of social worlds », dans Duncan, James (dir.), Housing and Identity: Cross- Cultural Perspectives, London, Croom Helm, p. 135-80.
Propp, Vladimir, 1970, Morphologie du conte, Paris, Seuil.
Prussin, Labelle, 1969, Architecture in northern Ghana: A study of forms and functions, Berkeley, University of California Press.
Prussin, Labelle, 1972, « West African mud granaries », Paideuma, Vol. 18, pp. 144-169.
Prussin, Labelle, 1974, « An introduction to indigenous African architecture », Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 33, No 3, pp. 182-205.
Prussin, Labelle, 1985, Hatumere: Islamic Design in West Africa, Berkeley, University of California Press.
Prussin, Labelle, 1995, African nomadic architecture: space, place and gender, Washington, Smithsonian Institution Press.
Rapoport, Amos, 1969, « The pueblo and the hogan : a cross-cultural comparison of two responses to an environment », dans Oliver, Paul (dir.), Shelter and society, London, Barrie/Rockliff, pp. 66-70.
Rapoport, Amos, 1969, House form and culture, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
Rapoport, Amos, 1972, Pour une anthropologie de la maison, Paris, Dunod.
Rapoport, Amos, 1973, The Mutual Interaction of People and Their Built Environment. A Cross- Cultural Perspective, Paris, Mouton.
Rapoport, Amos, 1977, Human Aspects of Urban Form, Oxford, Pergamon.
Rapoport, Amos, 1980, « Cross-cultural Aspects of Environmental Design », dans Altman, Irwin (dir.), Advances in Theory and Research, IV, New York, Plenum Press, pp. 7-46.
Rapoport, Amos, 1981, « Identity and environment », dans Duncan, James (dir.), Housing and Identity: Cross-Cultural Perspectives, London, Croom Helm, pp. 6-34.
Rapoport, Amos, 1982, The meaning of the built environment: a non-verbal communication approach, Beverly Hills, Sage.
Rapoport, Amos, 1985, «Thinking about home environments: a conceptual framework », dans Irwin Altman et Carol Werner (dirs), Home environments, New York, Plenum, pp. 255-286.
Rapoport, Amos, 1987, «On the cultural responsiveness of architecture », Journal of Architectural Education, Vol. 41, No. 1,pp. 10-15.
410
Rapoport, Amos, 1988, « Levels of meaning in the built environment », dans Poyatos, Fernando (dir.), Cross-cultural Perspectives in Non verbal Communication, Toronto, Hogrefe, pp. 317-336.
Rapoport, Amos, 1990 The Meaning of the Built Environment: A Non verbal Communication Approach, Tuscon, University of Arizona Press.
Rapoport, Amos, 1995, « A critical look at the concept “home” », dans Benjamin, David et al. The home: Words, interpretations, meanings, and environments, Avebury, Ashgate Publishing, pp. 25-52.
Rapoport, Amos, 2000, « Culture and Built Form. A reconsideration », dans Moore, Keith (dir.), Culture, Meaning, Architecture. Critical reflections on the work of Amos Rapoport, Burlington/Aldershot/Sydney, Ashgate, pp.175-216.
Remy, Jean, 1999, « Dédoublement des espaces sociaux et problématiques de l’habitat», dans Bonnin, Philippe et de Villanova, Roselyne (dirs.), D’une maison à l’autre. Parcours et mobilité résidentielle, Paris, Créaphis, p. 315-345.
Riggins, Stephen, 1994 (dir.), The Socialness of things. Essays on the socio-semiotics of objects, Berlin/New York, Mouton de Gruyter.
Riggins, Stephen, 1994, « Fieldwork in the living room : an autoethnographic essay », dans Rigins, Stephen (dir), The Socialness of Things, Essays on the Socio-Semiotics of Objects, Berlin/New York, Mouton de Gruyter, pp. 101-147.
Rivière, Peter, 1995, «Houses, places and people : Community and continuity in Guiana», dans Casten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the house. Lévi-Strauss and beyond, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 119-205.
Robinson, Julia, 2006, Institution and home: Architecture as cultural medium, Amsterdam, Techne Press.
Rosemary, Joyce et Gillespie, Susan (dirs.), 2000, Beyond Kinship. Social and material reproduction in house societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press
Roux, Simon, 1976, La maison dans l’histoire, Paris, Albin Michel.
Rudofsky, Bernard, 1964, Architecture without architects, New York, Museum of Modern Art.
Ruegg, François, 2011, La maison paysanne. Histoire d’un mythe, Gollion, Infolio.
Sadalla, Edward et Sheets, Virgil, 1993, « Symbolism in Building Materials. Self presentation and cognitive components », Environment and Behavior, Vol. 25, pp. 155-180.
Saegert, Susan, 1985, « The role of housing in the experience of dwelling », dans Altman, Irwin et Werner, Carol (dirs.), Home Environments, New York, Plenum Press, pp. 287-309.
Sandoz, Jean Pierre, 1998, Le grenier dans l’histoire culturelle, Viège, Imprimerie Mengis Druck und Verlag.
411
Sandstrom, Alan, 2000, « Toponymic Groups and House Organization: The Nahuas of Northern Veracruz, Mexico », dans Rosemary, Joyce et Gillespie, Susan (dirs.), Beyond Kinship. Social and material reproduction in house societies, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, pp. 53-72.
Schiffer, Michael, 1972, « Archaeological Context and Systemic Context », American Antiquity, Vol. 37, No. 2. pp. 156-165.
Schiffer, Michael, 1976, Behavioral Archeology, New York, Academic Press.
Schiffer, Michael, 1992, Technological Perspectives on Behavioral Change, Tucson, University of Arizona Press.
Schiffer, Michael, 2010, Behavioral Archaeology: Principles and Practice, London, Equinox.
Schiffer, Michael, et Miller, Andrea, 1999, The Material Life of Human Beings: Artefacts, Behavior, and Communication, London, Routledge.
Segaud, Marion, 2010, Anthropologie de l'espace: habiter, fonder, distribuer, transformer, Paris, Armand Colin.
Semprini, Andréa, 1995, L’objet comme procès et comme action. De la nature et de l’usage des objets dans la vie quotidienne, Paris, L’Harmattan.
Sommerville, Peter, 1997, « The social construction of home », Journal of Architectural and Planning Research, Vol. 14, pp. 226-245.
Speller, Gerda, 2000, A community in transition: a longitudinal study of place attachment and identity processes in the context of an enforced relocation, Guildford, University of Surrey.
Speller, Gerda, et Twigger-Ross, Clare, 2009, « Cultural and social disconnection in the context of a changed physical environment », Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, Vol. 91, No 4, pp. 355-369.
Speller, Gerda, Lyons, Evanthia, and Twigger-Ross, Clare, 2002, « A community in transition: the relationship between spatial change and identity », Social Psychological Review, Vol. 4, Vol. 2, pp. 39-58.
Tan, Chang-Kwo, 2001, « Building Conjugal Relations: The Devotion to Houses amongst the Paiwan of Taiwan », dans Miller, Daniel (dir.), Home Possessions. Material culture behind the closed doors, Oxford, Berg, pp. 149-170.
Tilley, Christopher et al., 2006 (dirs.), Handbook of material culture, London, Thousand Oaks, Calif., Sage.
Tilley, Christopher, (dir.), 1990, Reading Material Culture, Oxford, Blackwell.
Tilley, Christopher, 1994, A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments, Oxford, Berg.
Tilley, Christopher, 1996, « The power of rocks: topography and monument construction on Bodmin Moor », World Archaelogy, Vol. 28, No 2, pp. 161-176.
412
Tilley, Christopher, 1997, A Phenomenology of landscape, London, Berg.
Tilley, Christopher, 1999, Metaphor and Material Culture, Oxford, Blackwell.
Tilley, Christopher, 2002, « Metaphor, Materiality and Interpretation. The Metaphorical Transformations of Wala Canoës », dans Buchli, Victor (dir.), The material Culture Reader, New York, Berg, pp. 22-55.
Tilley, Christopher, 2004, The Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology, Oxford, Berg.
Tilley, Christopher, 2006, « Objectification », dans Tilley, Christopher et al. (dirs.), Handbook of material culture, London, Thousand Oaks; Calif., Sage, pp. 60-73.
Tilley, Christopher, 2010, Interpreting landscapes. Geologies, topographies and identities. Explorations of landscape phenomenology, Walnut Creek, Left Coast Press.
Tony et Hockey, Jenny (dirs.), Social homes? Social change and domestic life, London, Routledge.
Turgeon, Laurier (dir.), 2009. Spirit of Place : Between Tangible and Intangible Heritage / L’esprit du lieu : entre le patrimoine matériel et immatériel, Québec, Presses de l’Université Laval.
Turgeon, Laurier, 2003, « L'objet : exhumer les chemins croisés du chaudron de cuivre en Amérique », dans Turgeon, Laurier (dir.), Patrimoines métissés. Contextes coloniaux et postcoloniaux, Paris/Québec, Maison des sciences de l'homme/Presses de l'Université Laval, pp. 59-94.
Turgeon, Laurier, 2007, « Introduction », dans Fourcade, Marie-Blanche (dir.), Patrimoine et patrimonialisation : entre le matériel et l’immatériel, Québec, Presses de l’Université Laval.
Turgeon, Laurier, 2009, « La culture matérielle : du témoignage à la mémoire », dans Ndaywel è Nziem, Isidore et Mudimbe-Boyi, Élisabeth (dirs.), Images, mémoires et savoirs. Une histoire en partage avec Bogumil Koss-Jewsiewicki, Paris, Karthala, pp. 333-353.
Turgeon, Laurier, 2010, « Du matériel à l’immatériel. Nouveaux défis, nouveaux enjeux », Ethnologie française, tome XL, no 3, pp. 389-399.
Turner, Terence, 1995, « Social body and embodied subject: bodiliness, subjectivity and sociality among the Kayapo », Cultural Anthropology, Vol. 10, No 2, pp. 143-170.
Walker, William et Schiffer, Michael, 2006, « The Materiality of Social Power: The Artifact-Acquisition Perspective », Journal of Archaeological Method and Theory Vol. 13, No 2, pp. 67-88.
Warnier, Jean-Pierre, 1999, Construire la culture matérielle. L'homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF.
Warnier, Jean-Pierre, 2007, The Pot-King. The Body and Technologies of Power, Boston/Leiden, Brill, African Social Studies Series.
Warnier, Jean-Pierre, 2009, Régner au Cameroun. Le roi-pot, Paris, CERI-Karthala.
413
Waterson, Roxana, 1995, « Houses and hierarchies in island Southeast Asia », dans Carsten, Janet et Hugh-Jones, Stephen (dirs.), About the House: Lévi-Strauss and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, pp.47-68.
Waterson, Roxana, 2003, « The immortality of the house in Tana Toraja », dans Sparkes, Stephen et Howell, Signe (dirs.), The House in Southeast Asia. A Changing Social, Economic and Political Domain, Curzon/London/New York, Routledge, pp. 34-52.
3. Monts Mandara et bassin tchadien : généralités
Abubakar, Sa'ad, 1977, The Lamibe of Fombina. A political history of Adamawa 1809-1901, Zaria, Amadu Bello University Press.
André, Gide, 1995 [1926], Voyage au Congo, le retour du Tchad, Paris, Gallimard.
Barkindo, Bawuro, 1973, Outline of Mandara history, from early times to 1900 A.D, Thèse de doctorat, Ahmadu Bello University.
Barkindo, Bawuro, 1979, « Islam in Mandara: its introduction and impact upon the state and the people », Kano Studies, Vol. 1, No 4, pp. 24-51.
Barkindo, Bawuro, 1980, « Mandara-Fombina relations before 1900 », Kano Studies, Vol. 2, No 1, pp. 84-95.
Barkindo, Bawuro, 1985, « Political centralization in the south of Borno: the case of Sukur in the 18th and 19th centuries », dans Ajayi, Ade et Ikara, Bashir (dirs.), Evolution of political culture in Nigeria, Ibadan, University Press, pp. 50-66.
Barkindo, Bawuro, 1989, The Sultanate of Mandara to 1902, Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
Barreteau, Daniel, Breton, Roland et Dieu Michel, 1984, «Les langues», dans Boutrais, Jean et al., (dirs), Le Nord du Cameroun: des hommes, une région, Paris, ORSTOM, pp. 159-80.
Barth, Heinrich, 1965 [1857-1859], Travels and discoveries in North and Central Africa, London, Frank Cass and Company, Ltd.
Beauvilain, Alain, 1989, Nord-Cameroun: crises et peuplement, 2 tomes, Caen, Editions Alain Beauvilain.
Benoist, Jean, 1957, Kirdi au bord du monde, Paris, René Juillard.
Boisseau, Jean, 1974, La femme dans sa communauté territoriale: clef du cosmos mafa (Cameroun septentrional), Paris, Bureau d'Études Coopératives et Communautaires.
Boulet, Jean, 1975, Magoumaz - pays Mafa (Nord Cameroun), Paris, ORSTOM.
Boutrais, Jean et al., 1984, Le Nord-Cameroun. Des hommes, une région, Paris, IRD.
Boutrais, Jean, 1973, La colonisation des plaines par les montagnards au Nord-Cameroun (Monts Mandara), Paris, ORSTOM.
414
Breton, Roland, and Maurette, Guy, 1993, Montagnards d'Afrique noire: les hommes de la pierre et du mil (Haut-Mandara, Nord-Cameroun), Paris, L'Harmattan.
Chétima, Melchisedek , 2006, Patrimoine architectural podokwo dans le département du Mayo-Sava du XIXe-XXe siècle, mémoire de Maitrise d'histoire, Université de Ngaoundéré.
Chétima, Melchisedek et Gaimatakwon Alexandre, 2015, « Re-appropriating the Repressive Past through. Memories of Slavery in the Mandara Mountains», dans Lovejoy, Paul, Oliveira, Vanessa, et Velazquez, Maria (dirs.), Slavery, Memory, Citizenship, Trenton, African World Press (sous presse).
Chétima, Melchisedek, 2007, Architecture et histoire des mafa, mofu et podokwo des monts Mandara du Cameroun, mémoire de DEA d'histoire, Université de Ngaoundéré.
Chétima, Melchisedek, 2010, « Pratiques architecturales et stratégies identitaires dans les Monts Mandara du Cameroun », Kalio. Revue pluridisciplinaires de l’École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun), Vol. 2, No 4, pp. 41-62.
Chétima, Melchisedek, 2011, « La pierre, le bois et l’argile dans l'habitat podokwo. Essai sur le traitement des matériaux locaux de construction par un peuple du Nord-Cameroun », Annales de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré, Vol. 12, No 1, pp. 57-66.
Chétima, Melchisedek, 2011, « Par ici l’authenticité! Tourisme et mise en scène du patrimoine culturel dans les monts Mandara du Cameroun, Téoros. Revue de Recherche en Tourisme, Vol. 30, No 1, pp. 44-54.
Colombel (de), Véronique, 1986, Phonologie Quantitative et Synthématique avec Application à l’Ouldémé, Langue Tchadique du Nord-Cameroun, Paris, Société d’Études Linguistique et Anthropologiques de France.
David, Nicholas et MacEachern, Scott, 1988, «The Mandara Archaeological Project: preliminary results of the 1984 season», Barreteau, Daniel et Tourneux, Henri (dirs.), Le milieu et les hommes: recherches comparatives et historiques dans le bassin du Lac Tchad (Actes du 2éme colloque Méga-Tchad, 1985), Paris, ORSTOM, pp. 51-80.
David, Nicholas, 1972, « On the life span of pottery, type frequencies and archaeological inference », American Antiquity, Vol. 37, pp. 141-42.
David, Nicholas, 2014, « Patterns of slaving and prey-predator interfaces in and around the Mandara mountains (Nigeria and Cameroon) », Africa, Vol. 84, No 3, pp. 371-397.
David, Nicholas, Gavua, Kodzo; MacEachern, Scott et Sterner, Judith, 1991, «Ethnicity and material culture in North Cameroon», Canadian Journal of Archaeology, Vol. 15, pp. 171-178.
David, Nicholas, Sterner, Judith et Gavua, Kodzo, 1988, «Why pots are decorated? », Current Anthropology, Vol. 29, No 3, pp. 365-89.
415
Denham, Dixon, Clapperton, Hugh et Oudney, Walter, 1826, Narrative of Travels and discoveries in Northern and Central Africa in the years 1822, 1823, and 1824, London, John Murray.
Diyé, Jérémie, 2012, « Mangala Douvangar et la résolution endogène des conflits dans les monts Mandara », dans Kouosseu, Jules et Tchouaké, Noumbissie, Figures de l'histoire du Cameroun - XIXe-XXe siècle, Paris, L’Harmattan, pp. 145-148.
Ela, Jean-Marc, 1994, « Le Kirdi et la kirditude », Le Kirdi, Vol. 1, pp. 8-14.
Froelich, Jean-Claude, 1964, « Les problèmes posés par les refoulés montagnards de culture paléonigritique », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 15, No 4, pp. 383-99.
Froelich, Jean-Claude, 1968, Les montagnards paléonigritiques, Paris, Berger et Levrault/ORSTOM.
Fuchs, Peter, 1997, La Religion des Hadjeray., Paris, L’Harmattan.
Garakchémé, Gigla, 2011, « Le butin féminin de guerre comme stratégie d’humiliation et de dérision de l’ennemi dans les monts Mandara (Nord-Cameroun) », Dynamiques Internationales, No 5, Site Internet visité le 26 septembre 2013: http://dynamiques-internationales.com/wp-content/uploads/2011/07/DI5-Garakcheme-G11.pdf
Garakchémé, Gigla, 2011, « Références violentes et toponymie des quartiers à Tokombéré », Enjeux, No 25, pp. 30-35.
Garakchémé, Gigla, 2014, La résistance Kirdi à l’autorité coloniale dans les Monts Mandara (Nord-Cameroun) : Fondements et modalités (1920-1960), Thèse de doctorat, Université de Maroua.
Gavua, Kodzo, 1990, Style in Mafa material culture, Ph.D. Thesis, University of Calgary.
Genest, Serge, 1974 « Savoir traditionnel chez les forgerons Mafa », Revue Canadienne des Études Africaines, Vol. 8, No 3, pp. 495-516.
Hallaire, Antoinette, 1965, Les monts du Mandara au nord de Mokolo et la plaine de Mora: étude géographique régionale, Yaoundé, ORSTOM.
Hallaire, Antoinette, 1991, Les paysans montagnards du Nord-Cameroun. Les Monts Mandara, Paris, ORSTOM.
Juillerat, Bernard, 1971, Les bases de l’organisation sociale chez les Mouktélé (Nord-Cameroun). Structures lignagères et mariage, Paris, Mémoires de l’Institut d’ethnologie.
Kirk-Greene, Anthony, 1960, « The kingdom of Sukur - a Northern Nigerian Ichabod. Nigerian », Field, 25, Vol. 2, pp. 67-96.
Kirk-Greene, Anthony, 1969, Adamawa past and present: an historical approach to the development of a Northern Cameroons province, London, Oxford University Press.
Lebeuf, Jean-Paul, 1938, « Les rites funéraires chez les Fali », Journal De La Société Des Africanistes, Vol. 8, pp. 103-22.
416
Lebeuf, Jean-Paul, 1941, « Vocabulaires comparés des parles de seize villages Fali du Cameroun septentrional », Journal De La Société Des Africanistes, Vol. 11, pp. 33-60.
Lebeuf, Jean-Paul, 1960, L'habitation des Fali, montagnards du Cameroun septentrional, Paris, Hachette.
Lembezat, Bertrand, 1961, Les populations païennes du Nord-Cameroun, Paris, PUF.
Lestringant, Jacques, 1964, Les pays de Guider au Cameroun: essai d'histoire régionale. Paris, Privately printed.
Lyons, Diane, 1992, Men's houses: women's spaces. An ethnoarchaeological study of gender and household design in Dela, North Cameroon, Ph.D. Dissertation, Simon Fraser University.
Lyons, Diane, 1996, «The politics of house shape: round vs rectilinear shaped domestic structures in Dela households, northern Cameroon», Antiquity, Vol. 70, No 268, pp. 341-367
Lyons, Diane, 1998, «Witchcraft, gender, power and intimate relations in Mura compounds in Dela, northern Cameroon», World Archaeology, Vol. 29, No 3, pp. 344-362
MacEachern, Scott, 1990, Du Kunde: ethnogenesis in North Cameroon, Ph.D. Thesis, University of Calgary.
MacEachern, Scott, 1991, «Les gens de Ngolélé: an examination of prehistoric ethnic relations in the northern Mandara Mountains», dans Boutrais, Jean (dir.), Du politique a l'économique: études historiques dans le bassin du Lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 165-192.
MacEachern, Scott, 1992, «Ethnicity and ceramic variation around Mayo Plata, Northern Cameroon», dans Sterner, Judith et David, Nicholas (dirs.), An African commitment: papers in honour of Peter Lewis Shinnie, University of Calgary Press, Calgary, pp. 211-230.
MacEachern, Scott, 1993, «Selling the iron for their shackles: Wandala-montagnard interactions in northern Cameroon», Journal of African History, Vol. 34, No 2, pp. 247-270.
MacEachern, Scott, 1998, «Scale, style and cultural variation: technological traditions in the northern Mandara Mountains», dans Stark, Miriam (dir.), The archaeology of social boundaries, Washington, Smithsonian Institution Press, pp. 107-131.
MacEachern, Scott, 2001, «Montagnard ethnicity and genetic relations in northern Cameroon. Comment on The peopling of sub-Saharan Africa: the case study of Cameroon», American Journal of Physical Anthropology, Vol. 114, No 4, pp. 357-360.
MacEachern, Scott, 2001, «Setting the boundaries: linguistics, ethnicity, colonialism and archaeology south of Lake Chad», dans Terell, John (dir.), Archaeology, language, and history: essays on culture and ethnicity, Westport, Bergin and Garvey, pp. 79-102.
417
MacEachern, Scott, 2002, «Beyond the belly of the house: space and power in the Mandara Mountains», Journal of Social Archaeology, Vol. 2, No 2, pp. 197-219.
MacEachern, Scott, 2011, « Enslavement and everyday life: living with slave raiding in the northern Mandara Mountains of Cameroon », dans Lane, Paul et MacDonald, Kevin (dirs.), Slavery in Africa: archaeology and memory, Oxford, Oxford University Press, pp. 109-124.
Marliac, Alain, 1991, De la préhistoire à l’histoire du Cameroun septentrionale, Paris, ORSTOM.
Martin, Jean-Yves, 1970, Les Matakam du Cameroun: essai sur la dynamique d'une société pré-industrielle, Paris, ORSTOM.
Martin, Jean-Yves, 1981, « Essai sur l'histoire de la société matakam. Contribution de la recherche ethnologique a l'histoire des civilisations du Cameroun », dans Tardits, Claude, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 551, Paris, CNRS, pp. 219-227.
McIntosh, Roderick, 1989, « Middle Niger terracottas before the Symplegades gateway », African Arts, Vol. 22, p. 74-83.
Mohammadou, Eldridge, 1982, Le royaume du Wandala ou Mandara au XIXe siècle, Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.
Morin, Serge, Le haut et le bas. Signatures sociales, paysages et évolution des milieux dans les montagnes d'Afrique centrale (Cameroun et Tchad), Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux.
Morrissey, Stephen, 1989, Clients and Slaves in the Development of the Mandara Elite: Northern Cameroon in the Nineteenth Century, Michigan, Ann Arbor.
Mouchet, Jean, 1947, « Prospection ethnologique sommaire dans les montagnes du Mandara », Bulletin De La Société D'Études Camerounaises, No 19-20, pp. 93-104.
Müller-Kosack, Gerhard, 1997, « Water and the Mafa » dans Jungraithmayr, Herrmann; Barreteau, Daniel, et Siebert, Uwe (dirs.), L'homme et l'eau dans le bassin du Lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 279-304.
Müller-Kosack, Gerhard, 2003, The way of the beer: ritual reenactment of history among the Mafa, terrace farmers of the Mandara mountains (North Cameroon), thèse de doctorat, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität.
Njeuma, Martin, 2012 [1878], Fulani hegemony in Yola (Old Adamawa) 1809-1902, Yaounde, CEPER.
Nyssens, Olivier, 1986, « Éléments d'histoire des Vamé du massif du Mora», dans Barreteau, Daniel et Tourneux, Henry, (dirs.), Relations interethniques et culture matérielle dans le bassin du lac-Tchad (Actes du 3è Colloque Méga-Tchad, 1986), Paris, ORSTOM.
Richard, Madeleine, 1977, Traditions et coutumes matrimoniales chez les Mada et les Mouyeng, Nord-Cameroun, St. Augustin, Anthropos-Institut, Haus Völker und Kulturen.
418
Saibou Issa et Mangmadi Ngouyoum, 2009, « Banditisme et contestation de l’ordre allogène au Nord-Cameroun », Afrique et Histoire, Vol. 7, No 1, pp. 99-118.
Saïbou Issa, 2006, « La prise d’otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », Polis, Vol. 13, No 1-2, pp. 119-146.
Seignobos, Christian et Iyebi-mandjek, Olivier, 2000, Atlas de la province de l’Extrême Nord-Cameroun, Paris, IRD.
Seignobos, Christian, 1976, L'habitat traditionnel au Nord- Cameroun, Paris, UNESCO.
Seignobos, Christian, 1977, « Les systèmes de défense végétaux : paysages de parcs et civilisations agraires (Tchad et Nord-Cameroun) », Annales de l'Université du Tchad, Numéro spécial, pp. 3-59.
Seignobos, Christian, 1982, Montagnes et Hautes terres du Cameroun, Paris, Parenthèses.
Smith, Adam et David, Nicholas, 1995, «The production of space and the house of Xidi Sukur», Current Anthropology, Vol. 36, No 3, pp. 441-71.
Sorin-Barreteau, Liliane, 1996, Le langage gestuel chez les Mofu-Gudur au Cameroun, Thèse de Doctorat, Paris, Université Paris V – René Descartes.
Spedini et al., 1999, «The peopling of Sub-Saharan Africa: the case study of Cameroon», American Journal of Physical Anthropology, Vol. 110, pp. 143-162.
Sterner, Judith et David, Nicholas, 1991, «Gender and caste in the Mandara Highlands: northeastern Nigeria and northern Cameroon», Ethnology, Vol. 30, No 4, pp. 355-69.
Sterner, Judith, 1992, « Sacred pots and 'symbolic reservoirs' in the Mandara highlands of northern Cameroon », dans Sterner, Judith et David, Nicholas (dirs.), An African commitment: papers in honour of Peter Lewis Shinnie, Calgary, University of Calgary Press, pp. 171-80.
Urvoy, Yves, 1949, Histoire de l'empire du Bornou, Paris, Larose.
Van Andel, Annette, 1998, Changing security. Livehood in the Mandara mountains region in North-Cameroon, Leiden, ASC.
Van Beek, Wouter, 1986, «The ideology of building: the interpretation of compound patterns among the Kapsiki of north Cameroon», dans Fokkens, Harry (dir.), Op Zoek Naar Mens en Materiële, Groningen, Rijks Universiteit Groningen, pp. 147-162.
Van Beek, Wouter, 1987, The Kapsiki of the Mandara Hills, Ney York, Waveland Press.
Van Beek, Wouter, 1988, The flexibility of domestic production: the Kapsiki and their transformations, Leiden, African Studies Centre.
Van Beek, Wouter, 2001, « Left-right as political categories; an exercise in ‘not-so-primitive’ classification », Anthropos, vol. 96, pp. 169-178.
419
Van Beek, Wouter, 2002, « Why a twin is not a child: symbols in Kapsiki birth rituals », Journal de la société des africanistes, vol. 72, no. 1, pp. 119-147.
Van Beek, Wouter, 2012, « Intensive slave-raiding in the colonial interstice: Hamman Yaji and the Kaspsiki/Higi of North Cameroon and Northeastern Nigeria », Journal of African History, Vol. 53, No 03, pp. 301-323.
Van Santen, José et Schaafma Juliette, 1999, « Se faire pleurer comme une Femme », la signification symbolique du taureau et l'introduction récente de la vache chez les Mafa (Nord-Cameroun) », dans Barroin, Catherine et Boutrais, Jean (dirs), L’homme et l’animal dans le bassin du Lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 427-447.
Van Santen, José et Schaafsma Juliette, 2001, « Mafa Women and Migration: Historical Context and Recent Forms », dans Knorr, Jacqueline et Meier, Barbara (dirs), Women and Migration: Anthropological Perspectives, New York, St. Martin´s Press, pp. 21-63.
Van Santen, José, 1993, They leave their jars behind: the conversion of Mafa women to Islam (North Cameroon), Leiden, Centrum Vrouwen.
Van Santen, José, 1995 « We attend but no longer dance: Changes in Mafa funeral practices due to Islamization », dans Barroin, Catherine, Barreteau, Daniel et Von Graffenried, Charles (dirs), Mort et rites funéraires dans le Bassin du Lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 161-187.
Van Santen, José, 1996, « Islamization and Changes in Social Arrangements among the Mafa of North Cameroon », dans Risseeuw, Carla et Parliwana, Rajni (dirs), Negotiation and Social Space, New Delhi/London, Sage Publications, pp. 324-345.
Van Santen, José, 1997, « Regional Balance and National Integration: A historical overview of Mafa Integration in National Politics », dans Nkwi, Paul et Nyamjoh, Francis (dirs), Regional Balance and National Integration in Cameroon. Lessons learned and the uncertain future, Yaoundé, ICASSRT, pp. 242 -260.
Van Santen, José, 1998, « Islam, Gender and Urbanisation among the Mafa of North-Cameroon: the differing Commitment to ‘'home'’ among Muslims and non-Muslims », Africa, Vol. 68, no 3, pp. 403-424.
Van Santen, José, 2000, « ‘’Garder du bétail, c'est aussi du travail’’: des relations entre pasteurs fulbe et agriculteurs du Centre du Bénin et du Nord-Cameroun », dans Diallo, Youssouf et Günther, Schlee (dirs), L’ethnicité peule dans des contextes nouveaux, Paris, Karthala, pp. 129-160.
Van Santen, José, 2002, «Islamisation in North Cameroon: Political Processes and individual Choices», Annales de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Ngaoundéré, Vol. 7, pp. 67-96.
Van Santen, José, 2006, « "I had eleven children, ten have died’’. Child mortality, rites and childcare in North Cameroon », dans Van Beek, Wouter (dir), Een handvol kolanoten. Antropologische opstellen aan, Maastricht, Shaker Publishing, pp. 111-143.
420
Vaughan, James et Kirk-Greene, Anthony (dirs.), 1995, The diary of Hamman Yaji: chronicle of a West African Muslim ruler, Bloomington, Indiana University Press.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1971, « Divination et possession chez les Mofu montagnards du Nord-Cameroun », Journal De La Société Des Africanistes, Vol. 61, No 1, pp. 71-132.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1972, « Données sur le mariage et la situation de la femme Mofu », Cahiers O.R.S.T.O.M., Vol. 9, No 3, pp. 309-23.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1975, «Le chef et la pluie chez le Mofu, montagnards du Nord-Cameroun: contribution à l'étude des formes du pouvoir politique», Systèmes de Pensée en Afrique Noire, Vol. 1, pp. 137-64.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1976, « Conception et déroulement du sacrifice chez les Mofu", Systèmes de Pensée en Afrique Noire, Vol. pp. 177-203.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1978, « Sur les traces du major Denham: le Nord-Cameroun il y a cent cinquante ans. Mandara, 'Kirdi' et Peul », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 18, No 4, pp. 575-606.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1985, « Neveu utérin et oncle maternel: de la parenté au soupçon (Mofu, Cameroun du Nord) », dans Barbier, Jean-Claude (dir.), Femmes du Cameroun. Mères pacifiques, femmes rebelles, Paris, ORSTOM/Karthala, pp. 73-103.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1987, « Le prince et le sacrifice: pouvoir, religion et magie dans les montagnes du Nord-Cameroun», Journal De La Société Des Africanistes Vol. 2, pp. 89-121.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1990, « Des rois sacrés montagnards? Hadjeray du Tchad et Mofu-Diamaré du Cameroun" Systèmes de Pensée en Afrique Noire, Vol. 10, pp. 121-44.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1991, « Un pour trente, toutes pour un: la grande polygamie des princes montagnards Mofu-Diamaré », dans Echard, Nicole, Les relations hommes-femmes dans le bassin du lac Tchad. Paris, ORSTOM, pp. 249-63.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1995, « Contribution à l'étude des rites funéraires dans les montagnes mofu-diamaré», dans Baroin, Catherine, Barreteau, Daniel et Von Graffenried, Charlotte, (dirs.), Mort et rites funéraires dans le bassin du lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 103-13.
Vincent, Jeanne-Françoise, 1997, « Prince, pluies et puits dans les montagnes Mofu-Diamaré (Nord-Cameroun) » dans Jungraithmayr, Herrmann, Barreteau, Daniel et Siebert, Uwe, (dirs.), L'homme et l'eau dans le bassin du Lac Tchad (Séminaire du Réseau Méga-Tchad, J.W. Goethe-Universität, 13-14 mai, 1993), Paris, ORSTOM, pp. 337-49.
Vossart, Jacques, 1953, « Histoire du sultanat du Mandara», Études Camerounaises, Vol. 35/36, pp. 19-52.
421
Zra, Jean-Rémi, 1993, Traditions Kapsiki et Mafa du Nord Cameroun (Monts Mandara), Paris, ORSTOM.
4. Identité, ethnicité et démocratie
Alcoff, Linda, 2003, «Introduction: Identities: Modern and Postmodern», dans Alcoff, Linda et Mendieta, Eduardo, (dirs.), Identities: Race, Class, Gender, and Nationality, Oxford, Blackwell, pp. 1-8.
Amselle, Jean-Loup et M'Bokolo, Elikia, (dirs.), 1985, Au cœur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique, La Découverte, Paris.
Amselle, Jean-Loup, 1990, Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, Payot, Paris.
Amselle, Jean-Loup, 1999 [1985], « Ethnies, espaces : pour une anthropologie topologique », dans Amselle, Jean-Loup et M'Bokolo, Elikia, (dirs.), 1985, Au cœur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et État en Afrique, La Découverte, Paris, pp. 11-48.
Anderson, Benedict, 1991, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, New York, Verso.
Anderson, Benedict, 2006, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (New Edition), New York, Verso.
Anderson, James et Weidemann, Sue, 1997, « Developing and utilizing models of resident satisfaction », dans Zube, Ervin et Moore, Gary (dirs.), Advances in Environment, Behavior and Design, New York, Plenum Press, pp. 287-315.
Anignikin, Sylvain, 2001, « Histoire des populations mahi. À propos de la controverse sur l’ethnonyme et le toponyme “Mahi”», Cahiers d’Études Africaines, Vol. 41, No 2, pp. 243-66.
Banock, Michel, 1992, Le processus de démocratisation en Afrique : le cas du Cameroun, Paris, L'Harmattan.
Barth, Fredrik, (dir.), 1969, Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little Brown.
Barth, Fredrik, 1969, « Introduction », dans Barth, Fredrik, (dir.), Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little Brown, pp. 9-38.
Barth, Fredrik, 1969, «Pathan identity and its maintenance», dans Barth, Fredrik, (dir.), Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little Brown, pp. 117-34.
Barth, Fredrik, 1994, «Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity», dans Vermeulen, Hans et Covers, Cora, (dirs.), The Anthropology of Ethnicity: beyond "Ethnic Groups and Boundaries", Amsterdam, Het Spinhuis, pp. 11-32.
422
Barth, Heinrich, 1965[1857-59], Travels and discoveries in North and Central Africa, London, Frank Cass & Co. Ltd.
Bayart, Jean-François, 1985, L'État au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
Bayart, Jean-François, 1985, L'État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Librairie Fayard, coll. L'espace du politique.
Bentley, Carter, 1987, « Ethnicity and practice», Comparative Studies in Society and History, Vol. 29, pp. 24-55.
Bigombe Lobé, Patrice, 1993, Construction de l’ethnicité et production du politique au Cameroun septentrional, logiques hégémoniques musulmanes et dynamiques de résistance des Kirdi, Yaoundé, GRAP.
Bigombe Lobé, Patrice, 1999, «Changement politique et dynamiques d’instrumentalisation de l’ethnicité kirdi » : l’ingénierie ethnopolitique», dans Sindjoun, Luc (dir.), La révolution passive au Cameroun : État, société et changement, Dakar, CODESRIA, pp. 230-268.
Chabal, Patrick et Daloz, Jean-François, 1999, L’Afrique est partie! Du désordre comme instrument politique, Paris, Economica.
Chrétien, Jean-Pierre et Prunier, Gérard (dirs.), 2003, Les ethnies ont une histoire, Paris, Karthala.
Cohen, Abner, 1974, «Introduction: the lesson of ethnicity», dans Cohen, Abner, (dir.), Urban Ethnicity, London, Tavistock Publications, pp. IX-XXIV.
Cohen, Ronald, 1978, «Ethnicity: problem and focus in anthropology», Annual Review of Anthropology, Vol. 7, pp. 379-403.
Collectif Changer le Cameroun, 1992? Le Cameroun éclaté. Anthologie commentée des revendications ethniques, Yaoundé, Éditions C3.
Comaroff, John, 1987, «Of Totemism and Ethnicity: Consciousness, Practice, and the Signs of Inequality», Ethnos, Vol., 52, pp. 301-323.
Conversi, Daniel, 2007, «Mapping the field: Theories of nationalism and the ethnosymbolic approach», dans Leoussi, Athena et Grosby, Steven, (dirs.), Nationalism and Ethnosymbolism: History, Culture and Ethnicity in the Formation of Nations, New York, Cambridge University Press, pp. 15-30.
Darbon, 1995, Dominique (dir.), Ethnicité et nation en Afrique du Sud. Imageries identitaires et enjeux sociaux, Paris, Karthala.
De Waal, Alex, 2005, «Who Are the Darfurians? Arab and African Identities, Violence and External Engagement», African Affairs, Vol. 104, No 415, pp. 181-205.
Eidheim, Harald, 1969, «When ethnic identity is a social stigma», dans Barth Fredrik, (dir.), Ethnic Groups and Boundaries, London, George Allen & Unwin, pp. 39-57
Epstein, Arnold L., 1958, Politics in an Urban Community, Manchester, Manchester University Press.
423
Eriksen, Thomas, 1993, Ethnicity and Nationalism. Anthropological perspectives, London, Pluto Press.
Fendjoungue, Houli, 1993, Le cumul d’une identité contradictoire : majorité démographique et minorité politique, les Kirdi du Cameroun septentrional dans la vie politique nationale de 1940 à nos jours, thèse de Doctorat en sciences politiques, Université de Yaoundé II.
Fendjoungué, Houli, 2006, « La construction et la politisation de l’ethnicité ‘kirdi’ au nord du Cameroun », Polis /revue camerounaise des sciences politiques, Vol. 13, No 1-2, pp. 81-102.
Fogui, Jean-Pierre, 1990, L'intégration politique au Cameroun. Une analyse centre-périphérie, Paris, LGDJ.
Gaillard, Philippe, 1994, Ahmadou Ahidjo. Patriote et despote, bâtisseur de l'État camerounais, Paris, Jeune Afrique livres.
Geertz, Clifford, 1960, The Religion of Java, New York, Free Press of Glencoe.
Geertz, Clifford, 1963, «The integrative revolution: primordial sentiments and civil politics in the new states», dans Geertz, Clifford, (dir.), Old Societies and New States, New York, The Free Press, pp. 105-57.
Geertz, Clifford, 1973, The interpretation of cultures: selected essays, New York, Basic Books.
Goffman, Erwin, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit.
Haaland, Grønhaug, 1969, «Economic determinants in ethnic processes», dans Barth Fredrik, (dir.), Ethnic Groups and Boundaries, London, George Allen & Unwin, pp. 58-73.
Hardin, Russell, 1995, One for All: The Logic of Group Conflict, Princeton, Princeton University Press.
Hughes, Christopher, 1997, Taiwan and Chinese Nationalism: National Identity and Status in International Society, London, Routledge.
Isaacs, Harold, 1974, «Basic group identity: idols of the tribe», Ethnicity, Vol. 1, pp. 15-41.
Jenkins, Richard, 1982, «Pierre Bourdieu and the reproduction of determinism. [Critical Note] », Sociology, Vol. 16, No 4, pp. 270-81.
Jewsiewicki, Bogumil, et Letourneau, Jocelyn, (dirs.), Construction identitaire: questionnements théoriques et études de cas, Québec, CELAT, Université Laval, 1992.
Joireman, Sandra, 2003, Nationalism and Political Identity, New York, Continuum.
Jones, Siân, 1997, The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and the present, Routledge, London.
Kago, Jacques, 1995, Tribalisme et exclusions au Cameroun, le cas des Bamiléké, Yaoundé, CRAC.
424
Kellas, James, 1991, The Politics of Nationalism and Ethnicity, London, Macmillan.
Konings, Piet, 2002, «University students revolt, ethnic militia and violence during political liberalization in Cameroon», African Studies Review, Vol. 45, No 2, pp. 179- 204
Laitin, David, 1998, Identity in Formation: The Russian-Speaking Populations in the Near Abroad, New York, Cornell University Press.
Laurent, Pierrette et Lee, Yueh-Ting, 2007, « Les composants et effets des compétences culturelles : perspectives d’identité duelle », projet dans le cadre du programme ‘Réserve stratégique de la HES-SO’, Centre de compétences en leadership et ressources humaines, Montréal, Canada.
Laurier, Turgeon, Letourneau, Jocelyn et Fall, Khadiyatoulah, 1997, Les espaces de l'identité, Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1997.
Leach, Edmund, 1954, Political Systems of Highland Burma, London, Althone Press.
Lonsdale, John, 1996, « Ethnicité morale et tribalisme politique », Politique Africaine, Vol. 61, pp. 98-115.
MacEachern, Scott, 2007, «Where in Africa does Africa start? Identity, genetics and African Studies from the Sahara to Darfur», Journal of Social Archaeology, Vol. 7, No, 3, pp. 393-412.
MacEachern, Scott, 2011, «The concept of race in contemporary anthropology», dans Scupin, Raymond (dir.), Race and ethnicity: the United States and the world, 2nd edition, New York, Prentice Hall, pp. 34-57.
Marcus, George et Myers, Fred, 1995, « The Traffic in Art and Culture: An Introduction », dans Marcus, George et Myers, Fred (dirs.), The Traffic in Culture, Berkeley, University of California Press, pp. 1-51.
Marriot, Mckim, 1955, « Little Communities in an Indigenous Civilization», dans Mario, Mckim, (dir.), Village India, Memoirs, American Anthropological Association, pp. 171-222.
Mbembe, Achille, 1991, « Notes provisoires sur la postcolonie », Politique Africaine, No 60, pp. 76-109.
Mbembe, Achille, 2000, De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine, Paris, Karthala.
Mbembe, Acille, 1993, « Crise de légitimité, restauration autoritaire et déliquescence de l'État», dans Geschiere, Peter et Konings, Piet (dirs.), Itinéraires d'accumulation au Cameroun, Paris et Leiden, ASC-Karthala.
Médard, Jean-François, 1991, « L’État néo-patrimonial en Afrique noire », Médard, Jean-François (dir.), États d’Afrique Noire : Formations, mécanismes et crises, Paris, Karthala.
Meintel, Deirdre, 1993, « Nouvelles approches constructivistes de l'ethnicité », Culture, vol. XIII, pp. 5-9.
425
Meskell Lynn, 2004, Object Worlds in Ancient Egypt: Material Biographies Past and Present, Oxford, Berg.
Morrison, James, 1976, Jos Plateau Societies: Internal Change and External Influences 1800–1935, PhD dissertation, University of Ibadan.
Mouiche, Ibrahim, « Mutations socio-politiques et replis identitaires en Afrique: le cas du Cameroun », Revue Africaine de Science Politique, vol. 1, No 2, 1996, pp. 31-56.
Mouiche, Ibrahim, 1996, « Mutations socio-politiques et replis identitaires en Afrique: le cas du Cameroun », Revue Africaine de Science Politique, Vol. 1, No 2, pp. 31- 56.
Mouiche, Ibrahim, 1997, « Ethnicité et pouvoir au Nord-Cameroun », Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, vol. 30, No 2, pp. 182-216.
Mouiche, Ibrahim, 2000, « Ethnicité et multipartisme au Nord-Cameroun », African Journal of Political Science, Vol. 5, No 1, pp. 46-91.
Olsen, Bjørnar et Kobylinski, Zbigniew, 1991, «Ethnicity in anthropological and archaeological research: a Norwegian - Polish perspective», Archaeologia Polona, Vol. 29, pp. 5-27.
Otayek, Réné, 2001, « L'Afrique au prisme de l'ethnicité : perception française et actualité du débat », La Revue internationale et stratégique, Vol. 43, 129-142.
Otayek, Réné, 2000, Identité et démocratie dans un monde global, Paris, Presses de Sciences Po.
Redfield, Robert et Singer, Milton, 1954, «The Cultural Role of Cities», Economic Development and Cultural Change, Vol. 3, pp. 63-73.
Rudolph, Joseph, 2006, Politics and Ethnicity: A Comparative Study, New York, Palgrave Macmilan.
Saibou, Issa, 2005, « Arithmétique ethnique et compétition politique entre Arabes Choa et Kotoko dans le contexte de l’ouverture démocratique au Cameroun », Africa Spectrum, vol. 40, No 2, pp. 197-220.
Schilder, Kees, 1993, « La démocratie au champ. Les présidentielles d’octobre 1992 au Nord-Cameroun », Politique Africaine, Vol. 50, pp. 115-122.
Schilder, Kees, 1994, Self-esteem: state, Islam, and Mundang ethnicity in northern Cameroon, Leiden, African Studies Centre.
Scott, George, 1990, «A resynthesis of the primordial and circumstantial approaches to ethnic group solidarity: towards an explanatory model», Ethnic and Racial Studies, Vol. 13, pp. 147-71.
Shils, Edward, 1957, Center and Periphery: essays in macrosociology. Selected papers of Edward Shils, Vol. II, Chicago, Chicago University Press, pp. 111-26.
426
Sindjoun, Luc, 1996, « Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l’État », Politique Africaine, Vol. 62, pp.57-67.
Sindjoun, Luc, 1997, « Élections et politique au Cameroun : concurrence déloyale, coalitions de stabilité hégémonique et politique d’affection », African Journal of Political Science, Vol. 2, No 1, pp. 89-121.
Sindjoun, Luc, 1999, «Le paradigme de la compétition électorale dans la vie politique : entre tradition de monopole politique, État parlementaire et État seigneurial», dans Sindjoun, Luc (dir.), La révolution passive au Cameroun : État, société et changement, Dakar, CODESRIA, pp. 269-330.
Smith, Anthony, 2003, Nationalism: Theory, Ideology, History, Concepts, Cambridge, Polity Press.
Socpa, Antoine, 1999, « L’hégémonie ethnique cyclique au Nord-Cameroun », Afrique et Développement, Vol. 24, No 1-2, pp. 57-81.
Socpa, Antoine, 2003, Démocratisation et autochtonie au Cameroun, Münster, Lit Verlag.
Socpa, Antoine, 2009, « Les dons dans le jeu électoral au Cameroun », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 40, pp. 91-108.
Van den Berghe, Pierre, 1978, "Race and ethnicity: a sociobiological perspective», Ethnic and Racial Studies, Vol. 1, pp. 401-11.
Van den Berghe, Pierre, 2005, «Ethnics and nations: Genealogy indeed», dans Uzelac, Gordana, et Atsuko, Ichijo, (dirs.), When is the Nation? Towards an Understanding of Theories of Nationalism, London, Routledge, pp. 113-118.
Vincent, Joan, 1974, «The structuring of ethnicity, Human Organisation, Vol. 33, 4, pp. 375-9.
Zélao Alawadi, 2012, « Contexte de démocratisation et conduites politiques des ‘peuples de montagnes’ au Nord-Cameroun : le ‘charisme identitaire’ à l’épreuve des mutations sociopolitiques », dans Zélao, Alawadi, et Hamman Bouba, (dirs.), Le Cameroun septentrional en transition. Perspectives pluridisciplinaires, Paris, L’Harmattan, pp. 188.
5. Théories de l’espace, esclavage et mémoire servile
Adam, Mahamat, 2008, « L’esclavage en bordure du Logone : le cas des Mousgoum du Nord-Cameroun (XVIIIe-XXe siècle) », dans Mandé, Issiaka et Rajaonah, Faranirina (dirs.), Histoire africaines en Afrique. Travaux de jeunes historiens africains, Paris, L’Harmattan, pp. 10-23.
Araujo, Ana Lucia (dir.), 2009, Living History: Encountering the Memory of the Heirs of Slavery, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
Araujo, Ana Lucia (dir.), 2014, Shadows of the Slave Past: Memory, Heritage, and Slavery, New York, Routledge.
427
Araujo, Ana Lucia, 2009, « De victime à résistant : mémoires et représentations de l’esclavage dans les monuments publics de la Route des esclaves », Les Cahiers des Anneaux de la Mémoire, Vol. 12, pp. 84-102.
Araujo, Ana Lucia, 2010, « Mémoire de l’esclavage et les enjeux politiques de la patrimonialisation en République du Bénin », dans Cottias, Myriam, Cunin, Elisabeth, et Mendes, Antônio de Almeida (dirs.), Les traites et les esclavages. Perspectives historiques et contemporaines, Paris, Karthala, pp. 357-369.
Araujo, Ana Lucia, 2010, Public Memory of Slavery: Victims and Perpetrators in the South Atlantic, Amherst, Cambria Press.
Araujo, Ana Lucia, 2011, « Forgetting and Remembering the Atlantic Slave Trade: The Legacy of Brazilian Slave Merchant Francisco Félix de Souza », dans Araujo, Ana Lucia, Candido, Mariana, et Lovejoy, Paul (dirs.), Crossing Memories: Slavery and African Diaspora, Trenton, Africa World Press, pp. 79-103.
Araujo, Ana Lucia, 2012, « Introduction », dans Araujo, Ana Lucia (dir), Politics of Memory: Making Slavery Visible in the Public Space, New York, Routledge, pp. 1-11.
Araujo, Ana Lucia, 2012, « Transnational Memory of Slave Merchants: Making the Perpetrators Visible in the Public Space », dans Araujo, Ana Lucia (dir.), Politics of Memory: Making Slavery Visible in the Public, New York, Routledge, pp. 15-34.
Ardener, Shirley, 1981, Women and Space: Ground Rules and Social Maps, London, Croom Helm.
Bachelard, Gaston, 2004 [2001], La poétique de l’espace, Paris, Quadrige/PUF.
Bah, Thierno Mouctar et Taguem Fah, Gilbert, 1993, « Les élites musulmanes et la politique au Cameroun sous administration française: 1945-1960», dans Boutrais, Jean et al. (dirs), Peuples et cultures de l'Adamaoua, Paris, ORSTOM, pp.103-133.
Bah, Thierno Mouctar, 1976, « The impact of wars on housing in pre-colonial black Africa », African Environment, Vol. 76, No 3, pp. 3-18.
Bah, Thierno Mouctar, 1993, « Le facteur peul et les relations dans l'Adamaoua au XIXe siècle», dans Boutrais, Jean et al. (dirs), Peuples et cultures de l'Adamaoua, Paris, ORSTOM, pp. 61-86.
Bah, Thierno Mouctar, 2003, « Slave-raiding and defensive systems south of Lake Chad from the sixteenth to the nineteenth century», dans Diouf, Sylviane (dir), Fighting the Slave Trade: West African Strategies, Athens, Ohio University Press, pp. 15-30.
Balfet, Hélène et al., 1976, Pratiques et représentations de l’espace dans les communautés méditerranéennes, Paris, CNRS.
Barth, Heinrich, 1965 [1857-1859], Travels and discoveries in North and Central Africa, London, Frank Cass and Company, Ltd.
Birdwell-Pheasant, Donna et Lawrence-Zuniga, Denise (dirs.), 1999, House Life: Space, Place and Family in Europe, Oxford, Berg.
428
Blustein, Jeffrey, 2008, The Moral Demands of Memory, New York, Cambridge University Press.
Breakwell, Glynis, (dir.), 1983, Threatened Identities, Chichester, Wiley.
Breakwell, Glynis, 1986, Coping with threatened identities, London, Metheun.
Breakwell, Glynis, 1988, « Strategies adopted when identity is threatened », Revue Internationale de Psychologie Sociale, Vol. 1, No 2, pp.189-204.
Breakwell, Glynis, 1992, Socal psychology of identity and the self-concept, London, Surrey University Press.
Brevié, Jules, 1923, Islamisme contre “Naturisme” au Soudan français, Paris, Ernest LeRoux.
Bromberger, Christian et Guyonnet, Marie-Hélène, 2008, De la nature sauvage à la domestication de l’espace : enquêtes ethnologiques en Provence et ailleurs : hommage à Annie-Hélène Dufour, Provence, Publications de l’Université de Provence.
Charlick, Robert, 1991, Niger: Personal Rule and Survival in the Sahel, Boulder, Westview Press.
Chétima, Melchisedek et Gaimatakwon Alexandre, 2015, « Re-appropriating the Repressive Past through. Memories of Slavery in the Mandara Mountains», dans Lovejoy, Paul; Oliveira, Vanessa, et Velazquez, Maria (dirs.), Slavery, Memory, Citizenship, Trenton, African World Press (sous presse).
Choay, Françoise, 2006, Pour une anthropologie de l’espace, Paris, Seuil.
Colomina, Beatriz (dir.), 1992, Sexuality and Space, New York, Princeton Architectural Press.
Cooper Frederick, 1980, From Slaves to Squatters: Plantation Labour and Agriculture in Zanzibar and Coastal Kenya, 1890-1925, New Haven, Yale University Press.
Cooper, Barbara, 1994 « Reflections on Slavery, Seclusion and Female Labor in the Maradi Region of Niger in the Nineteenth and Twentieth Centuries », Journal of African History, Vol. 35, pp. 61-78.
Cooper, Barbara, 1998, « Gender and Religion in Hausaland: Variations in Islamic Practice in Niger and Nigeria », dans Bodman, Herbert et Tohidi, Nayereh (dirs.), Women in Muslim Societies: Diversity Within Unity, Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp. 21-37.
Cooper, Frederick, 1977, Plantation Slavery on the East Coast of Africa, New Haven, Yale University Press.
Cottias, Myriam, 2006, La mémoire manipulée (1848-1900). Esclavage et liberté dans les Antilles françaises, Paris, Desclée de Brouwer.
Cottias, Myriam, 2007, La question noire : histoire d’une construction coloniale, Paris, Bayard
429
De Radkowski, Georges-Hubert, 2002, Anthropologie de l’habiter. Vers le nomadisme, Paris, Presses Universitaires de France.
Devine-Wright, Patrick et Lyons, Evanthia, 2009, « Rethinking Nimbyism: The Role of Attachment and Place Identity in Explaining Place-protective Action », Journal of Community & Applied Social Psychology, Vol. 19, pp. 426-441.
Dibwe, Donatien, 2006, « La collecte des sources orales », Civilisations, Vol. 54, pp. 45-55.
Eltis, David et Richardson, David (dirs.), Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, New Haven, Yale University Press.
Eltis, David, 1999, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge, Cambridge University Press.
Erll, Astrid, 2011, « Travelling Memory », Parallax, Vol. 17, No 4, pp. 4-18.
François Hartog, 2003, Régimes d’historicité: présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil.
Gieryn, Thomas, 2000, « A Space for Place in Sociology », Annual Review of Sociology, Vol. 26, pp. 463-496.
Grâce, John, 1975, Domestic Slavery in West Africa, New York, Barnes et Noble.
Grauman, Carl, 1983, « On multiple Identities », International Social Science Journal, Vol. 35, pp. 309-321.
Gustafson, Per, 2001, « Meanings of Place: everyday experience and theoretical conceptualizations », Journal of environmental psychology, Vol. 21, pp. 5-16.
Gustafson, Per, 2009, « Mobility and territorial belonging », Environment and Behavior, Vol. 41, pp. 490-508.
Halbwachs, Maurice, 1968 [1950], La mémoire collective, Paris, PUF.
Halbwachs, Maurice, 1996 [1925], Les cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel.
Hall, Edward, 1959, The Silent Language, New York, Doubleday.
Hall, Edward, 1966, The Hidden Dimension, New York, Doubleday.
Hauge, Åshild, 2007, « Identity and place: a comparison of three identity theories », Architectural Science Review, Vol. 50, No 1, pp. 44-51.
Hauge, Åshild, et Kolstad, Arnulf, 2007, « Dwelling as an expression of identity: A comparative study among residents in high-priced and low-priced neighbourhoods in Norway », Housing, Theory & Society, Vol. 24, pp. 272-292.
Hegel, Friedrich, 1965 [1822], La Raison dans l’Histoire, Paris, Plon.
Hill, Polly, 1976, « From Slavery to Freedom: The Case of Farm Slavery in Nigerian Hausaland », Comparative Studies in Society and History, Vol. 18, No. 3, pp. 395-426.
430
Hill, Polly, 1977, Population, Prosperity and Poverty: Rural Kano, 1900 and 1970, New York, Cambridge University Press.
Hirsh, Marianne, 1997, Family Frames, Photography Narrative and Postmemory, Cambridge, Harvard University Press.
Inikori, Joseph et Engerman, Stanley (dirs), 1992, The Atlantic Slave Trade: Effects on Economies, Societies, and Peoples in Africa, the Americas, and Europe, Durham, Duke University Press.
Iyebi-Mandjek Olivier, 1993, « Les migrations saisonnières chez les Mafa, montagnards du Nord-Cameroun : une solution au surpeuplement et un frein à l’émigration définitive. », Cahiers des Sciences Humaines, Vol. 29, No 2-3, pp. 419-437.
Jewsiewicki, Bogumil, 2006, Travail de mémoire et d’oubli dans les sociétés postcommunistes, Bucarest, Editura unviersitatii din bucresti.
Jewsiewicki, Bogumil, 2008, « Patrimonialiser les mémoires pour accorder à la souffrance la reconnaissance qu’elle mérite », dans Jewsiewicki, Bogumil et Vincent Auzas Traumatisme collectif pour patrimoine: Regards croisés sur un mouvement transnational, Québec, Presses de l’Université Laval.
Jewsiewicki, Bogumil, 2009, « Lieux d’identité. Quelques réflexions sur le devoir de porter témoignage face à l’impératif de construire au présent le lien social », Ethnologies, Vol. 31, No 2, pp. 21-42.
Jewsiewicki, Bogumil, 2010, « Historical Memory and Representation of New Nations in Africa », dans Diawara, Mamadou, Lategan, Bernard, et Rusen, Jorn (dirs.), Historical Memory in Africa, New York, Berghan Books, pp. 53-66.
Jewsiewicki, Bogumil, 2010, «Mémoires et débats présents », dans Pétré-Grenouilleau, Olivier, Dictionnaire des esclavages, Paris, Larousse, pp. 18-27.
Jewsiewicki, Bogumil, 2011, « In the Empire of Forgetting: Collective Memory of the Slave Trade and Slavery », dans Araujo, Ana Lucia, Candido, Mariana et Lovejoy, Paul (dirs.), Crossing Memories: Slavery and African Diaspora, Trenton, Africa World Press, pp. 1-13.
Johnson, Ronald, et al., 2000, The Dictionary of Human Geography, Oxford, Blackwell.
Justin, Willis, 1993, « Feedback as a “problem” in oral history: an example from Bonde », History in Africa, Vol. 20, pp. 353-360.
Klein, Martin et Lovejoy, Paul, 1979, « Slavery in West Africa », dans Gemery, Henry et Hogendorn, Jan (dirs.), The Uncommon Market: Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade, New York, Academic Press, pp. 181-212.
Klein, Martin, 1983, « Women and Slavery in the Western Sudan », dans Robertson, Claire et Klein, Martin (dirs), Women and Slavery in Africa, Madison, University of Wisconsin Press, pp. 67-92.
Klein, Martin, 1986, « Towards a Theory of Slavery », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 104, pp. 693-697.
431
Klein, Martin, 1998, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge, Cambrigde University Press.
Konaté, Doulaye, 2006, « Traditions orales et écritures de l’histoire africaine – sur les traces pionniers », Présence Africaine, Vol. 173, pp. 91-106.
Konaté, Doulaye, 2006, Travail de mémoire et construction nationale au Mali, Paris, L’Harmattan.
Kopytoff, Igor et Miers, Suzanne, 1977, « African ‘slavery’ as an institution of marginality », dans Miers, Suzanne et Kopytoff, Igor (dirs.), Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives, Madison, University of Wisconsin Press, pp. 3-81.
Korpela, Kalevi, 1989, « Place-identity as a product of environmental self-regulation », Journal of Environmental Psychology, Vol. 9, pp. 241-256.
Law, Robin, 2003, « The Atlantic Slave Trade in local history writing in Ouidah (Republic of Bénin) », Communication présentée au colloque « Literacy manifestations of the African diaspora », University of Cape Coast, Ghana du 10 au 14 novembre 2003. Site Internet visité le 26 septembre 2013: http://tubman.info.yorku.ca/files/2013/01/Law_paper.pdf
Lee Klein, Kerwin, 2000, « On the Emergence of Memory in Historical Discourse », Representations, Vol. 69, pp. 127-150.
Lefebvre Henri, 1970, La production de l’espace, Paris, Ed. Anthropos.
Le Goff, Jacques, 1988, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard.
Létourneau, Jocelyn et Jewsiewicki, Bogumil, « Politique de la mémoire », Politique et Sociétés, Vol. 22, No 2, 2003, pp. 3-15.
Lovejoy, Paul et Hogendorn, Jan, 1993, Slow Death for Slavery. The Course of Abolition in Northern Nigeria, 1897-1936, Cambridge, Cambridge University Press, African Studies Series.
Lovejoy, Paul et Richardson, David, 1995, « Competing Markets for Male and Female Slaves: Slave Prices in the Interior of West Africa, 1780-1850 », International Journal of African Historical Studies, Vol. 28, No 2, pp. 261-93.
Lovejoy, Paul, 1978, « Plantations in the Economy of the Sokoto Caliphate », Journal of African History, Vol. 19, No 3, pp. 341-68.
Lovejoy, Paul, 1981, « Slavery in the Sokoto Caliphate », dans Lovejoy, Paul (dir.), The Ideology of Slavery in Africa, London, Sage Publications, pp. 201-243.
Lovejoy, Paul, 1986, Salt of the Desert Sun. A History of Salt Production and Trade in the Central Sudan. Cambridge, Cambridge University Press, African Studies Series.
Lovejoy, Paul, 1988, « Concubinage and the Status of Women Slaves in Early Colonial Northern Nigeria », Journal of African History, Vol. 29, No 2, pp. 245-266.
Lovejoy, Paul, 1989, « The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the Literature », Journal of African History, Vol. 30, No 3, pp. 365-394.
432
Lovejoy, Paul, 1990, « Concubinage in the Sokoto Caliphate », Slavery and Abolition, Vol. 21, No 2, pp. 159-189.
Lovejoy, Paul, 2000, Transformations in Slavery. History of Slavery in Africa, Cambridge, Cambridge University Press.
Lovejoy, Paul, 2002, « Islam, Slavery, and Political Transformation in West Africa: Constraints on the Trans-Atlantic Slave Trade », Outre-Mers: Revue d’histoire, Vol. 89, pp. 247-82.
Lovejoy, Paul, 2004, Slavery on the Frontiers of Islam, Princeton, Markus Wiener Publisher.
Lovejoy, Paul, 2005, Slavery, Commerce and Production in West Africa: Slave Society in the Sokoto Caliphate, Trenton, Africa World Press, The Harriet Tubman Series on the African Diaspora.
Maier, Charles, 1993, « A Surfeit of Memory? Reflections on History, Melancholy and Denial », History and Memory: Studies in Representation of the Past, Vol. 5, pp. 136-152.
Massey, Doren, 1995, Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production, New York, Routledge.
Meillassoux, Claude (dir.), 1975, L’esclavage en Afrique précoloniale, Paris, Maspero.
Meillassoux, Claude, 1978, « Rôle de l'esclavage dans l'histoire de l'Afrique occidentale », Anthropologie et Sociétés, Vol. 2, No 1, pp. 117-48.
Meillassoux, Claude, 1986, Anthropologie de l'esclavage : le ventre de fer et d'argent. Paris, P.U.F.
Miller, Joseph, 2012, The Problem of Slavery as History: A Global Approach, New Haven, Yale University Press.
Moore, Henrietta L., 1986, Space, Text and Gender, Cambridge, Cambridge University Press.
Moore, Jeanne, 2000, « Placing home in context », Journal of Environmental Psychology, Vol. 20, pp. 207-217.
Morrissey, Stephen, 1989, Clients and Slaves in the Development of the Mandara Elite: Northern Cameroon in the Nineteenth Century, Michigan, Ann Arbor.
Nora, Pierre (dir.), 1984-1992, Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, Tome I : La République ; Tome II : La Nation ; Tome III : Les France [III-1 : Conflits et partages ; III.2 : Les traditions ; III-3 : De l’archive à l’emblème].
Nora, Pierre, 1984, « Entre Mémoire et histoire. La problématique des lieux », dans Nora, Pierre (dir.), Les Lieux de mémoire, Tome I, Paris, Gallimard, pp. 23-43.
O’Toole, James, 2003, Passing for White: Race, Religion, and the Healy Family, 1820-1920, Boston, University of Massachusetts Press.
433
Olwig, Karen, 1999, « Travelling makes a home: mobility and identity among West Indians », dans Chapman, Tony et Hockey, Jenny (dirs), Social homes? Social change and domestic life, London, Routledge, pp. 73-83.
Orlando, Patterson, 1982, Slavery and Social Death: A Comparative Study, Cambridge, Harvard University Press.
Perrot, Claude-Hélène (dir.), 1993, Sources orales et histoire de l’Afrique, Paris, CNRS.
Proshansky, Harold, 1978, « The City and Self-Identity », Environment and Behaviour, Vol. 10, No 2, pp. 47-169.
Proshansky, Harold, Fabian, Abbe et Kaminoff, Robert, 1983, «Place Identity: Physical world socialization of the self », Journal of Environmental Psychology, Vol. 3, pp. 57-83.
Relph, Edward, 1976, Place and Placelessness, London, Pion.
Ricachardson, David, 1989, « Slave exports from west and west-central Africa, 1700-1810 : new estimates of volume and distribution », The Journal of African History, Vol. 30, No 1, pp. 1-22.
Robertson, Claire, 1983, « Post-Proclamation Slavery in Accra: A Female Affair? », dans Robertson, Claire et Klein, Martin (dirs), Women and Slavery in Africa, Madison, University of Wisconsin Press.
Robin Law, 1993, Constructing the pre-colonial history of West-Africa: reflections on the methodology of oral and written historiography, Leiden, African Studies Centre.
Saïbou, Issa, 2005, « Paroles d’esclaves au Nord-Cameroun », Cahiers d'Études Africaines, Vol. 179-180, pp. 853-878.
Salau, Mohammed Bashir, 2011, « Voices of Those Who Testified on Slavery in Kano Emirate », dans Araujo, Ana Lucia, Candido, Mariana et Lovejoy, Paul (dirs), Crossing Memories: Slavery and African Diaspora, Trenton, Africa World Press, pp. 129-145.
Segaud, Marion, 2007, Anthropologie de l'espace : habiter, fonder, distribuer, transformer, Paris, Armand Colin.
Shaw, Brent, 1998, « A wolf by the ears: M. I. Finley's Ancient Slavery and Modern Ideology in historical context », dans Finley, Moses et Brent, Shaw, Ancient Slavery and Modern Ideology, Princeton, Markus Wiener Publishers, pp. 3-74.
Sims, Rebecca, et al., 2009, « When a ‘Home’ becomes a ‘House’: Care and Caring in the Flood Recovery Process », Space and Culture Vol. 12, pp. 303-316.
Speller, Gerda, 2000, A community in transition: a longitudinal study of place attachment and identity processes in the context of an enforced relocation. PhD thesis, Guildford, University of Surrey.
Speller, Gerda, 2012, Working for change: a case study of the relationship between place and sense of community on a deprived London housing estate, communication
434
présentée à International Association for People-Environment Studies 22nd Conference, Glasgow, June 2012 www.iaps.org.uk
Speller, Gerda, et Twigger-Ross, Clare, 2009, « Cultural and social disconnection in the context of a changed physical environment, Geografiska Annaler, Series B », Human Geography, Vol. 91, No 4, pp. 355-369.
Speller, Gerda, Lyons, Eventhia, et Twigger-Ross, Clare, 2002, « A community in transition: the relationship between spatial change and identity », Social Psychological Review, Vol. 4, No 2, pp. 39-58.
Spencer, Christopher, 2002, « Arkwright town rebuilt: But a sense of community lost. A commentary on Speller, Lyons & Twigger-Ross (2002), A community in transition », Social Psychological Review, Vol. 4, No 2, pp. 23-24.
Spiegel, Gabrielle, 2002, « Memory and History: Liturgical Time and Historical Time », History and Theory, Vol. 41, No 2, pp. 149-162.
Tajfel, Henri, 1981, Human groups and social categories, Cambridge, Cambridge University Press.
Tajfel, Henri, 1982, Social identity and intergroup relations, Cambridge, Cambridge University Press.
Thioub, Ibrahima (dir.), 2007, Patrimoine et sources historiques en Afrique, Dakar, Presse Sénégalaise de l’Imprimerie.
Twigger-Ross, Clare Bonaiuto, Marino, et Breakwell, Glynis, 2003, « Identity theories and environmental psychology », dans Bonnes, Mirilia, Lee, Terence, et Bonaiuto, Marino (dirs.), Psychological theories for environmental issues, Ashgate, Aldershot, pp. 203-233.
Twigger-Ross, Clare, et Uzzell, David, 1996, « Place and identity processes », Journal of Environmental Psychology, Vol. 16, pp. 205-220.
Vansina, Jan, 1985, Oral tradition as history, Madison, University of Wisconsin Press.
Vansina, Jan, 1961, De la tradition orale : essai de méthode historique, Tervuren, Musée royal de l’Afrique centrale.
Vergès, Françoise, 2006, La mémoire enchainée : questions sur l’esclavage, Paris, Albin Michel.
Vinitzky-Seroussi, Vered and Teeger, Chana, 2010, « Unpacking the Unspoken: Silence in Collective Memory and Forgetting », Social Forces, Vol. 88, No. 3, pp. 1103-1122.
Weiss, Holger, 2000, « The illegal trade in slaves from German northern Cameroon to British northern Nigeria », African Economic History, Vol. 28, pp. 141-97.
435
6. Colonisation, études postcoloniales et tourisme
Abwa, Daniel, 1991, « Code noir et Code de l’indigénat ou la permanence d’une attitude », Dans Kom, Ambroise et Ngoué Lucienne (dirs.), Le Code noir et l’Afrique, Paris, Nouvelles du Sud, pp. 52-59.
Abwa, Daniel, 2000, Commissaires et Hauts-Commissaires de la France au Cameroun de 1916 à 1960 : Ces hommes qui ont façonné politiquement le Cameroun, Yaoundé, Presses Universitaires de Yaoundé.
Abwa, Daniel, 2007, « Peut-on parler de la revanche des Kirdi du Nord-Cameroun aujourd’hui? », Annales de la FALSH, vol. 1, No 6, pp. 41-65.
Augé, Marc, 1997, L’impossible voyage. Le tourisme et ses images, Paris, Payot.
Auzias, Dominique et Labourdette, Jean-Paul, 2012, Petit futé Cameroun, Paris, Petit Futé, Collection Country Guide
Bancel Nicolas et al., (dirs.), 2004, Zoos Humains. Au temps des exhibitions humaines, Paris, La Découverte, coll. De poche « Sciences humaines et sociales ».
Bancel, Nicolas et Blanchard, Pascal, 1998, « L’invention de l’’indigène’. Entre imaginaire collectif et pensée républicaine », Passerelles, No 16, pp. 161-176.
Bancel, Nicolas et Blanchard, Pascal, 2001, « Les pièges de la mémoire colonial », Les Cahiers Français/La documentation française, No 303, pp. 75-83.
Bancel, Nicolas, 2001, « Stigmates. Archétypes coloniaux », La Mazarine, No 15, pp. 11-21.
Bancel, Nicolas, 2003, « Le bain colonial: aux sources de la culture colonial populaire », Autrement, No 86, pp. 179-190.
Bancel, Nicolas et Blanchard, Pascal, 1999, De l'indigène à l’immigré, Paris, Gallimard.
Bancel, Nicolas, Blanchard, Pascal, et Gervereau, Laurent (dirs.), 1993, Images et Colonies, Iconographie et propagande coloniale sur l’Afrique française de 1880 à 1960, Paris, La Découverte.
Bancel, Nicolas, Blanchard, Pascal et Vergès, Françoise, 2003, La République coloniale. Essai sur une utopie, Paris, Albin Michel.
Beringuier, Philippe et Saadi, Allaoua, 2010, « Quels paysages dans les images produites autour de l’itinéraire touristique Estrada Real (Minas Gerais, Brésil) ? », Confins, Vol. 9, No 1, pp. 86-106.
Bhabha, Homi, 1994, The Location of Culture, London-New York, Routledge.
Bhabha, Homi, 2007, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot.
Blanchard, Pascal et al. (dir.), 2011, Zoos humains et exhibitions coloniales : 150 ans d’inventions de l’autre, Paris, La Découverte.
Blanchard, Pascal et al. (dirs), 1995, L’Autre et Nous, Paris, Syros.
436
Bourdieu, Pierre, 1997, « The Forms of Capital », dans Halsey, Albert et al., (dirs.) Education: Culture, Economy and Society, Oxford, Oxford University Press.
Brevié, Jules, 1923, Islamisme contre “Naturisme” au Soudan français, Paris, Ernest LeRoux.
Brown, David, 1999, « Des faux authentiques. Tourisme versus pèlerinage », Terrain, Vol. 33, No 3, pp. 41-56.
Bruner, Edward, 1994, « Abraham Lincoln as authentic reproduction », American Anthropologist, Vol. 96, No 2, pp. 397-415.
Cohen, William, 1981, Français et Africains : Les Noirs dans le regard des Blancs, 1530-1880, Paris, Gallimard.
Cooper Frederick, 2010, Le Colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot.
Cravatte, Céline, 2009, « L’anthropologie du tourisme et l’authenticité : catégorie analytique ou catégorie indigène ? », Cahiers d’Études Africaines, Vol. 193-194, No 1/2, pp. 603-620.
De Certeau, Michel, 1980, L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, Union générale des Éditions.
Decoret-ahiha, Anne, 2005, « L’exotique, l’ethnique et l’authentique : Regards et discours sur les danses d’ailleurs», Civilisations, Vol. 53, No 1, pp. 149-166.
Deroo, Éric, 2005, L'illusion coloniale, Paris, Tallandier.
Douglass, William et Raento, Paulina, 2004, « The Tradition of Invention: Conceiving Las Vegas », Annals of Tourism Research, Vol. 31, No 1, pp. 7-23.
Eco, Umberto, 1986, Travels in Hyperreality, London, Picador.
Evans, Martin, 2004, Empire and culture: the French experience, 1830-1940, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Fuglestad, Finn, 1983, A History of Niger 1850-1960, Cambridge, Cambridge University Press.
Gervereau, Laurent, 2000, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XXème siècle, Paris, Seuil.
Goffman, Erwin, 1973, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éditions de Minuit.
Hale, Dana, 2008, Races on display: French representations of colonized peoples 1886-1940, Bloomington, Indiana University Press.
Hobsbawm, Eric et Ranger, Terence (dir.), 1983, The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press.
Hobsbawm, Éric et Ranger, Terence, 2006, L’Invention de la tradition, Paris, Amsterdam.
Lecour Grandmaison, Olivier, 2005, Olivier. Coloniser, Exterminer : Sur la guerre et l’État colonial, Paris, Fayard.
437
Lecour Grandmaison, Olivier, 2009, La République impériale : politique et racisme d'État, Paris, Fayard.
Maccannell, Dean, 1973, « Staged authenticity: arrangements of social space in tourist settings », American Journal of Sociology, Vol. 79, No 3, pp. 589-603.
Maccannell, Dean, 1976, The Tourist: a new theory of the leisure class, New York, Schocken Books.
Maccannell, Dean, 1992, Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers, London et New York, Routledge.
Manning, Patrick, 1998, Francophone Sub-Saharan Africa 1880-1995, Cambridge, Cambridge University Press.
Mbembe, Achille, 1986, « Pouvoir des morts et langages des vivants », Politique Africaine, No 22, pp. 37-72.
Merle Isabelle, 2004, De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l'indigénat en question », Politix, Vol. 17, N° 66, pp. 137-162.
Murray, Last, 1997, « The Colonial Caliphate of Northern Nigeria », dans Robinson, David et Triaud, Jean-Louis (dirs.), Le temps des marabouts: Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française v. 1880-1960, Paris, Karthala, pp. 67-82.
Pauchant, Étienne, 2000, « Vous avez dit authentique ? », Espace, No 169, pp. 13-14.
Pétré-Grenouilleau (dir.), 2004, From Slave Trade to Empire. Europe and the Colonisation of Black Africa (1780s-1880s), Londres, Routledge.
Pétré-Grenouilleau (dir.), 2005, Abolitionnisme et société (France, Suisse, Portugal, XVIIIe-XIXe siècles), Paris, Karthala.
Pétré-Grenouilleau, 2010, Dictionnaire des esclavages, Paris, Larousse.
Pétré-Grenouilleau, 2014, Qu'est-ce que l'esclavage ? Une histoire globale, Paris, Gallimard.
Ranger, Terrence, 1993, «The Invention of Tradition Revisited : the Case of Colonial Africa », dans Ranger, Terrence et Vaughan, Olufemi (dirs), Legitimacy and the State in Twentieth Century Africa, London, MacMillan, pp. 62-107.
Reynaud Paligot, Carole, 2006, La république raciale : paradigme racial et idéologie républicaine, 1860-1930, Paris, P.U.F.
Robert, Charlick, 1991, Niger: Personal Rule and Survival in the Sahel, Boulder, Westview Press.
Saïd, Edward, 1978, Orientalism, London, Penguin.
Saïd, Edward, 1980, L’Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident, Paris, Seuil.
Said, Edward, 2000, Culture et imperialisme, Paris, Fayard.
438
Saidi, Habib, 2007, Sortir du regard colonial. Politique du patrimoine et du tourisme en Tunisie depuis les indépendances, thèse de doctorat en ethnologie, Université Laval.
Segalen, Victor, 1978, Essai sur l’exotisme (Réed.), Montpellier, Fata Morgana.
Selwyn, Tom, 1996, “Introduction”, dans Selwin, Tom (dir.), The tourist image. Myths and myth making in tourism, Londres, Wiley, pp. 1-32.
Shurmer-Smith, Pamela et Hannam, Kevin, 1994, Worlds of Desire, Realms of Power: A Cultural Geography, London, Arnold.
Spivak, Gayatri Chakravorty et Harasym, Sarah, 1990, The Postcolonial critic: Interviews, strategies, dialogues, New York, Routledge.
Spivak, Gayatri Chakravorty, 1999, « Les subalternes peuvent-ils s'exprimer? », dans Diouf, Mamadou (dir.), L’historiographie indienne en débat: colonialisme, nationalisme et sociétés postcoloniales, Paris, Karthala, pp. 165-229.
Stewart, Charles, 1997, « Colonial Justice and the Spread of Islam in the Early Twentieth Century », dans Robinson, David et Triaud, Jean-Louis (dirs.), Le temps des marabouts: Itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française v. 1880-1960, Paris, Karthala, pp. 53-66.
Todorov, Tristan, 2002, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Seuil.
Triaud, Jean-Louis, 2000, « Islam in Africa Under French Colonial Rule », dans Levtzion, Nehemia et Pouwels, Randall (dirs.), The History of Islam in Africa, Athens, Ohio University Press, pp. 169-187.
Turner, Bryan, 1994, Orientalism, Post-Modernism and Globalism, Londres, Routledge.
Urry, John et Crawshaw, Carol, 1997, « Tourism and the photographic Eye », dans Rojek, Chris et Urry, John (dirs.), Touring cultures: Transformations of travel and theory, London, Routledge, pp. 176-195..
Urry, John, 1990, The tourist gaze. Leisure and travel in contemporary societies, London, Sage.
7. Migration, rapports élites/village et sorcellerie
Abega, Prosper, 1989, « Prêtre à la Briqueterie », Politique Africaine, Vol 35, pp. 39-49.
Aldrin, Pap, 2003, « Penser la rumeur, une question-clef dans les sciences sociales », Genèses, Vol. 50, pp. 126-141.
Amselle, Jean-Loup, 1987, « Fonctionnaires et hommes d’affaires au Mali », Politique africaine, Vol. 26, pp. 63-72.
Augé, Marc, 1992, Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil.
Balandier, Georges, 1955, « La situation coloniale », Sociologie actuelle de l’Afrique
439
Noire, Paris, P.U.F.
Barbier, Jean-Claude, Courade, Georges et Gubry, Patrick, 1982, L’exode rural au Cameroun, Paris, ORSTOM.
Bascom, William, 1969, Ifa Divination: Communication between Gods and Men in West Africa, Bloomington, Indiana University Press.
Bonhomme, Julien, 2005, « Voir par derrière. Sorcellerie, initiation et perception au Gabon», Social Anthropology, Vol. 13-3, pp. 259-273.
Bonnin, Philippe et De Villanova, Roselyne (dirs.), 1999, D’une maison l’autre : parcours et mobilités résidentielles, Grâne, Créaphis.
Boutinot, Laurence, 1994, Le migrant et son double: migration, ethnie, religion au Nord-Cameroun, ORSTOM.
Bretell, Caroline, 1986, Men Who Migrate, Women Who Wait: Population and History in a Portuguese, Parish, Princeton.
Bretell, Caroline, 2002, Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York et London, Routledge.
Callier-Boisvert, Colette, 1999, Soajo entre migrations et mémoire, Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian.
Comaroff, Jean et Comaroff, John, 1993, « Introduction », dans Comaroff, Jean, et Comaroff, John (dirs.) Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa, Chicago, Chicago University Press, pp. 11-37.
Comaroff, Jean et Comaroff, John, 1999, « Occult Economies and the Violence of Abstraction: Notes from the South African Postcolony », American Ethnologist, 26, Vol. 2, pp. 279-303.
Diminescu, Dana (dir.), 2003, Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris, Éd. Maison des Sciences de l’Homme.
Diminescu, Dana et Lagrave, Rose-Marie, 2001, Faire une saison. Pour une anthropologie des migrations roumaines en France. Le cas du pays d’Oas, Paris, EHESS.
Douglas, Mary (dir.) 1972, Witchcraft, Confessions and Accusations, London, Tavistock publication.
Englund, Harri, 1996, « Witchcraft, Modernity, and the Person: The Morality of Accumulation in Central Malawi », Critique of Anthropology, Vol. 16, No 3, pp. 257–79.
Fisiy, Cyprian et Geschiere, Peter, 1991, “Sorcery, Witchcraft and Accumulation. Regional variations in South and West Cameroon », Critique of Anthropology, Vol. 11, No 3, pp. 251-278.
Fisiy, Cyprian, et Geschiere, Peter, 1996, « Witchcraft, Violence and Identity: Different Trajectories in Post-Colonial Cameroon », dans Werbner, Richard et Ranger, Terence (dirs.), Postcolonial Identities in Africa, London, Zed Books, pp. 193-210.
440
Foucarde, Marie-Blanche, 2006, Habiter l’Arménie au Québec : Ethnographie d’un patrimoine domestique en diaspora, Thèse de Doctorat en ethnologie, Université Laval.
Foudoup, Kengne, 1991, Les petits métiers de rue et emploi: le cas de Yaoundé, Yaoundé, SOPECAM.
Geschiere, Peter, 1988, « Sorcery and the State: Popular Modes of Action among the Maka of Southeastern Cameroon », Critique of Anthropology, Vol. 8, No 1, pp. 35-63.
Geschiere, Peter, 1992, « Kinship, Witchcraft and ‘the Market’: Hybrid Patterns in Cameroonian Societies », dans Dilley, Roy (dir.), Contesting Market: Analyses of Ideology, Discourse and Practice, Edinburgh, Edinburgh University Press, pp. 16-27.
Geschiere, Peter, 1995, Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres, Paris, Karthala.
Geschiere, Peter, 1996, « Sorcellerie et politique, les pièges du rapport élite-village », Politique africaine, Vol. 63, pp. 82-96.
Geschiere, Peter, 1997, The Modernity of Witchcraft: Politics and the Occult in Postcolonial Africa, Virginia, University of Virginia Press.
Geschiere, Peter, 1998, « Sorcellerie et modernité. Les enjeux des nouveaux procès de sorcellerie au Cameroun », Annales. Histoire, sciences sociales, Vol. 53, No 6, pp. 1251-1279.
Geschiere, Peter, 2000, « Sorcellerie et modernité : retour sur une étrange complicité », Politique africaine, Vol. 79, pp. 17-32.
Geschiere, Peter, 2010, « Witchcraft and modernity: perspectives from Africa and beyond », dans Parés, Nicolau et Sansi, Roger (dirs.), Sorcery in the black Atlantic, Chicago, University of Chicago Press, pp. 233-258.
Geschiere, Peter, 2010, « Sorcellerie... comment guérir le mal qui vient de l'intérieur? », dans Lado, Ludovic, (dir.), Le pluralisme médical en Afrique: colloque international de Yaoundé, 3-5 février 2010: hommage à Éric de Rosny, Paris, Karthala, pp. 429-448.
Geschiere, Peter, 2012, « The political economy of autochthony: labour migration and citizenship in Southwest Cameroon », dans Abbink, Jon (dir.), Fractures and reconnections: civic action and the redefinition of African political and economic spaces: studies in honor of Piet J.J. Konings, Leiden, African Studies Centre, pp. 15-36.
Geschiere, Peter, 2013, Witchcraft, intimacy and trust: Africa in comparison, Chicago, University of Chicago Press.
Geschiere, Peter, et Konings, Piet (dirs.), 1993, Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Paris, Karthala.
Gubry, Patrick et al., 1991, Enquête sur la pression démographique et l’exode rural dans le nord et l’ouest du Cameroun. Méthodologie, Yaoundé, CRED.
441
Gubry, Patrick et al., 1996, Le retour au village. Une solution à la crise économique au Cameroun?, Paris, L’Harmattan.
Gubry, Patrick, 1991, « Rétention de la population et développement en milieu rural : À l’écoute des paysans mafa des monts Mandara (Cameroun) », dans Boutrais, Jean (dir.), Du politique à l’économique. Études historiques dans le bassin du lac Tchad, Paris, ORSTOM, pp. 119-163.
Gugler, Joseph, « 1975, « Migration and Ethnicity in Sub-Saharan Africa: Affinity, Rural Interests and Urban Alignments », dans Safa, Helen et Du Toit, Brian (dirs.), Migration and Development: Implications for Ethnic Identity and Political Conflict, World Anthropology, Paris, Mouton, pp. 295-309.
Gugler, Joseph, 1968, « The Impact of Labour Migration on Society and Economy in Subsaharan Africa: Empirical Findings and Theoretical Considerations », African Social Research, Vol. 6, pp. 463-486.
Gugler, Joseph, 1971, « Life in a Dual System: Eastern Nigerians in Town, 1961 », Cahiers d’Études Africaines, Vol. 11, pp. 400-421.
Gugler, Joseph, 1976, « Migrating to Urban Centers of Unemployment in Tropical Africa », dans Richmond, Anthony et Kubat, Daniel (dirs.), Internal Migration: The New World and the Third World, Sage, London/Beverly Hills, pp. 184-204.
Gugler, Joseph, 1991, « Life in a Dual System Revisited: Urban-Rural Ties in Enugu, Nigeria, 1961-1987 », World Development, Vol. 19, pp. 399-409.
Iyebi-Mandjek, Olivier, 1993, « Les migrations saisonnières chez les Mafa, montagnards du Nord-Cameroun : une solution au surpeuplement et un frein à l’émigration définitive. », dans Cahiers des Sciences Humaines, Vol. 29, No 2-3, pp. 419-437.
Iyebi-Mandjek, Olivier, 2005, « Typologie des mouvements migratoires », communication présenté au XIIIème Colloque International du Réseau Méga-Tchad, Migrations et mobilités dans le bassin du lac Tchad, Maroua, 31octobre – 2 novembre 2005, Maroua, IRAD-IRD.
Loubes, Jean-Paul, 2005, « La mémoire de l’architecture nomade dans la maison d’Asie Centrale », dans de Villanova, Roselyne et Vermès, Geneviève (dirs.), Le métissage interculturel: Créativité dans les relations inégalitaires, Paris, L’Harmattan, pp. 177-197.
Malaquais, Dominique, 2001, « Arts de feyre au Cameroun », Politique Africaine, Vol. 82, pp. 101-118.
Mandel, Jean-Jacques, 2008, « Les rétrécisseurs de sexe. Chronique d’une rumeur sorcière», Cahiers d’Études Africaines, Vol. 189-190, No 1-2, pp. 185-208.
Marie, Alain, 1997, « Avatars de la dette communautaire. Crise des solidarités, sorcellerie et procès d’individualisation », dans Marie, Alain (dir.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, pp. 249-328.
Marie, Alain, 1997, «Du sujet communautaire au sujet individuel», dans Marie, Alain, (dir.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, pp. 53-54.
442
Marie, Alain, 2002, « Une anthropo-logique communautaire à l’épreuve de la mondialisation. De la relation de dette à la lutte sociale », Cahiers d’Études Africaines, Vol. 166, No 2, pp. 207-255.
Meyer, Birgit, 1995, «’Delivered from the powers of darkness’. Confessions of satanic riches in christian Ghana », Africa, Vol. 65, No 2, pp. 236-255.
Miaffo, Dieudonné, et Warnier, Jean-Pierre, 1993, « Accumulation et notabilité chez les Bamiléké », dans Geschiere, Peter et Konings, Piet (dirs.) 1993, Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Paris, Karthala, pp. 33-69.
Moore, Henrietta et Sanders, Todd (dirs.), Magical Interpretations, Material Realities: Modernity, Witchcraft and the Occult in Postcolonial Africa, London, Routledge
Muller, Bernard, 2003, «Nos ancêtres les Yoruba : Splendeur et misère de la bourgeoisie yoruba du Nigeria », Cahiers d’Études Africaines, Vol. 171, pp. 483-503.
Parish, Jane, 1999, « The Dynamics of Witchcraft and Indigenous Shrines among the Akan », Africa, Vol. 69, No 3, pp. 426-47.
Perianez, Manuel, et al., 1978, L’autre habitat. L’habitat bilocal des résidents secondaires en France, Paris, CSTB.
Rosny (de), Eric, 1981, Les yeux de ma chèvre, Paris, Plon.
Rosny (de), Eric, 1992, L’Afrique des guérisons, Paris, Karthala.
Rowland, Michael et Warnier, Jean-Pierre, 1988, « Sorcery, Power and the Modern State in Cameroon », Man, Vol. 23, pp. 118-132.
Santelli, Emmanuelle, 2001, La mobilité sociale dans l’immigration: itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne, Toulouse, Presses universitaires du Mirail.
Sayad Abdelmalek, 1999, La double absence: Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil.
Sayad, Abdelmalek, 2006, L’immigration ou les paradoxes de l’altérité. Les illusions du provisoire, Paris, Ed. Raisons d’Agir.
Schatzberg, 2001, Political Legitimacy in Middle Africa: Father, Family, Food, Bloomington, Indiana University Press.
Shaw, Rosalind, 2001, « Cannibal Transformations: Colonialism and Commodification in the Sierra Leone Hinterland », dans Moore, Henrietta et Sanders, Todd (dirs.), Magical Interpretations, Material Realities: Modernity, Witchcraft and the Occult in Postcolonial Africa, London, Routledge, pp. 50-70.
Tonda, Joseph, 2008, « La violence de l’imaginaire des enfants sorciers », Cahiers d’Études Africaines, Vol. 189-190, No 1-2, pp. 325-343.
Urry, John, 2005, Sociologie des mobilités, Paris, Armand Colin.
Van der Geest, Sarlin, 1997, « Money and Respect: The Changing View of Old Age in Rural Ghana », Africa, Vol. 67, pp. 560-82.
443
Villanova (de), Roselyne et Bonvalet, Catherine, 1999, « Immigrés propriétaires ici et là-bas. Un système résidentiel? », dans Bonnin, Philippe et De Villanova, Roselyne (dirs), D’une maison à l’autre : parcours et mobilités résidentielles, Paris, Créaphis, pp. 213-249.
Villanova (de), Roselyne, 2006, « “Double Residence”: A Space for Intergenerational Relations. Portuguese Immigrants in France in the Twentieth and Twenty-First Centuries », Portuguese Studies Review, Vol. 14, No 2, pp. 241-261
Warnier, Jean-Pierre, 1988, « L’économie politique de la sorcellerie », Revue de l’Institut de sociologie, Vol. 3-4, pp. 259-270.
Warnier, Jean-Pierre, 1993, L’esprit d’entreprise au Cameroun, Paris, Karthala.
White, Bob, 2000, « La quête du : rumeurs, réussite et malheur en République démocratique du Congo », Anthropologie et Sociétés, Vol 39, No 2, pp. 61-77.
White, Luise, 1993, « Cars Out of Place: Vampires, Technology and Labor in East and Central Africa », Representations, no 43, p. 27-50.
White, Luise, 2000, Speaking With Vampires: Rumor and History in Colonial Africa, Berkeley, University of California Press.
445
Annexe 1
Formulaire de consentement verbal
Présentation Je m’appelle CHETIMA Melchisedek, et cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de doctorat. Je suis étudiant sous la direction de Mme Muriel Gomez-Perez au département d’histoire de la faculté des Lettres de l’Université Laval (Québec, Canada). Nature de l’étude Avant d’accepter de participer à ce projet de recherche, je vais vous expliquer le but de ce projet de recherche, ses procédures, avantages, risques et inconvénients. Je vous invite à poser toutes les questions que vous jugerez utiles. Je voudrais en effet réaliser une entrevue à propos de votre opinion sur la maison. Les résultats seront utilisés dans le cadre d’un projet de recherche dont l’objectif est d’expliquer les relations que les gens développent avec leurs maisons. Toutes les informations vont rester anonymes.
Mes objectifs principaux sont :
- étudier la maison comme un outil que les personnes utilisent pour souligner, négocier, bricoler, et dans une certaine mesure, mettre en parenthèse leur identité ethnique au gré du contexte dans lequel ils agissent ;
- explorer l'expression de l'être - ou du vouloir être - par le biais de la maison et des objets peuplant les intérieurs domestiques dans deux contextes différents à savoir l’avant et l’après 1980;
- comprendre les relations de pouvoir à travers la lecture que les personnes font de l’extérieur et de l’intérieur de l’espace habitable chez l’élite traditionnelle et chez la nouvelle élite (les personnes devenues fonctionnaires surtout à partir de 1980) ;
- comprendre les changements qui interviennent dans les formes de la maison en
rapport avec les changements qui interviennent au niveau du statut social du
propriétaire et inversement.
J’ai restreint le cadre géographique de la recherche à trois peuples à savoir : les Podokwo, les Mouktele et les Mura. Déroulement de la participation Si vous acceptez de prendre part à notre recherche, nous souhaitons vous poser des questions sur quatre thèmes, à savoir :
446
1. les traditions orales évoquant la migration et l’installation des peuples dans les monts Mandara 2. le rapport entre l’architecture, la mémoire, le statut social et de l’identité ethnique dans les monts Mandara 3. Les caractéristiques matérielles et immatérielles de l’architecture dans les monts Mandara 4. Les mutations de l’architecture et du mode d’habiter dans les monts Mandara Les entretiens devraient durer entre 1h et 1h30. Vous pouvez choisir de répondre à nos questions à votre domicile, à votre lieu de travail ou à tout autre lieu de votre choix. Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation Les études sur l’histoire des Podokwo, des Mouktele et des Mura, ainsi que sur leurs relations à la maison sont très rares. Cette étude vous offre donc l’occasion de réfléchir et de discuter, en toute confidentialité, sur la façon d’approcher votre propre histoire via l’étude de la maison. Aucune rétribution ne vous sera remise au cours de cette recherche. Chaque participant n’encourt aucun risque à participer à cette étude, car ses propos seront prononcés et recueillis sous le couvert de l’anonymat. Participation volontaire et droit de retrait Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation sans conséquence négative ou préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important d’en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. Vous pouvez également refuser de répondre à certaines questions, sans que cela soit préjudiciable pour vous. Confidentialité et gestion des données - la règle de l’anonymat sera respectée ; ceci sera notifié dans les cahiers de prise de notes et souligné en notes infrapaginales lors de la rédaction d’articles. Il sera dès lors inscrit, dans la note, les éléments suivants : pseudonyme, lieu et la date d’entrevue. - la date approximative de la destruction de toute référence concernant votre identité est le 30 septembre 2012. - Seule moi et ma directrice de recherche aurons accès aux entrevues - Seul moi j’aurai la liste des noms des personnes interrogées. Elles ne seront divulguées à qui que ce soit. -les données seront consignées dans des cahiers de prise de notes auxquels seul moi j’aurai accès,
447
-les données seront conservées dans ces cahiers qui seront rangés dans un lieu que seul moi connais et auquel j’ai accès, Renseignements supplémentaires Toute question concernant le projet pourra être adressée au chercheur Melchisedek Chétima via son courrier électronique [email protected], ou au numéro de téléphone suivant : 1 (418) 656 7777 poste 18200
Signature Connaissant la valeur de la parole donnée en Afrique, et particulièrement dans la région des monts Mandara du Cameroun, ce formulaire fait acte d’entente tacite entre le chercheur et l’ensemble des interlocuteurs qu’il rencontrera. Les signatures (des participants et du chercheur) ne sont donc pas nécessaires. Le consentement verbal suffit.
Plainte ou critique Toute plainte ou critique relativement à ce projet de recherche pourra être adressée, en toute confidentialité, au bureau de l’Ombudsman de l’Université Laval dont les coordonnées sont les suivantes : Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 2325, rue de l’Université Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Renseignements - Secrétariat : 1 (418) 656-3081 Courriel : [email protected] Copie de ………………………………
Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : No d’approbation 2011-238 / 30-11-2011.
448
Annexes 2
Protocole d’entretien pour les participants vivant dans les villages de montagne
Introduction
- Éthique : lecture du formulaire de consentement
- Visite de l’environnement extérieur de la maison
-Visite guidée de l'intérieur de la maison (si permis par les occupants)
- Position de la maison sur le site (altitude, plateau interne, piémonts, etc.)
Section 1: Informations personnelles et trajectoires de vie de la maison
1. Nom-prénom (s’il y en a):
2. Date et lieu de naissance :
3. Situation matrimoniale (célibataire, marié à une femme, marié à plusieurs femmes) :
4. Quelles langues parlez-vous et dans quel contexte en faites-vous usage?
5. De quelle religion êtes-vous?
6. Combien des gens vivent-ils dans la maison (adultes et enfants)?
7. Est-ce qu’il y a des gens qui vivent d’habitude dans le ménage et qui l’ont quitté au cours des trois dernières années ?
9. Généalogies familiales : Êtes-vous en mesure de raconter votre arbre généalogique? La racontez-vous souvent à vos enfants ?
10. La maison a-t-elle été construite par vous ou vous a t-elle été transmise par votre père?
11. Si elle a été construite par vous, où viviez-vous avant d’être ici? Pourquoi avez-vous quitté l’ancienne maison? Quel type de maison avez-vous quitté (maison à deux quartiers, à trois quartiers, à quatre quartiers, etc.).
11. Si elle vous a été transmise, j’aimerais savoir comment s’est effectuée la transmission. Y a-t-il eu des oppositions de la part d’une tierce?
12. Depuis quand à peu près avez-vous construit (ou occupé) votre maison actuelle? (Si vous ne vous souvenez pas de la date exacte, servez-vous des évènements importants tels que le mariage ou la naissance d’un enfant).
449
Section 2 : Origine, itinéraire migratoire et installation dans les massifs
1. Qu’est-ce que la tradition orale raconte au sujet de l’origine, du processus migratoire et de l’installation de votre peuple dans les montagnes ?
2. Avez-vous entendu parler de Waza ? Y a-t-il des légendes et/ou des chants qui parlent de comment les ancêtres ont quitté Waza ? Si oui, pourriez-vous me les raconter ?
3. Avez-vous entendu parler de Borno et de Wandala ? Pouvez-vous me parler du genre de rapports qu’il y avait entre votre groupe et eux ?
4. On raconte à leurs propos qu’ils achetaient et prenaient des gens pour les vendre ? Est-ce que cela pourrait être vrai selon vous ? Avez-vous entendu les aînés parler de cela?
5. Avez-vous entendu parler d’un homme appelé Hamman Hadji ? On dit de lui qu’il était très connu des gens de la montagne, est-ce le cas pour vous? Qu’est-ce que les gens de chez vous racontent à son sujet?
6. Avez-vous entendu parler de l’existence d’un marché d’esclaves à Mora dans le passé? On dit que ce sont les Blancs qui sont venus mettre fin au marché. Quelle est votre opinion là-dessus?
7. Quels étaient les types de rapport que votre groupe entretenait avec les Blancs ? Étaient-ils aimés ou combattus ? Pourquoi ?
8. On dit qu’ils venaient avec des fusils et faisaient travailler les gens pour construire les routes dans les montagnes ? Connaissez-vous des gens qui sont encore vivants et qui ont participé à ces travaux ?
Section 3 : Place de la maison dans les constructions identitaires
A. Identité ethnique
1. On dit souvent que la maison participe à la construction de l’identité d’une ethnie, peut-on en dire autant chez vous ? Si oui, comment?
2. Est-ce que les peuples voisins construisent leurs maisons de la même manière que vous ? Si oui, comment expliquez-vous les similitudes ? Si non, comment expliquez-vous les différences ?
3. Quelles sont, selon vous, les différentes pièces qu’on trouve dans une maison (podokwo, muktele ou mura)? Quelles sont celles que les gens considèrent comme typiquement (podokwo muktele ou mura)? Y’a t-il des chants et des proverbes qui valorisent ces formes ou ces techniques?
4. Aujourd’hui on constate que les maisons traditionnelles sont en train de changer même dans les massifs? Comment expliquez-vous ces transformations ?
450
5. On constate aussi que les gens préfèrent construisent leurs maisons en plaine plutôt que dans les massifs, comment expliquez-vous cette situation ?
6. A quand remontent exactement les premières descentes en plaine ?
7. Certains estiment qu’au début, ces descentes étaient contraintes par l’administration, est ce votre avis ?
9. Si on vous offrez une belle maison rectangulaire et en tôle en plaine, allez-vous abandonner la maison de montagne pour aller vivre en plaine?
B. Statut social
1. J’aimerais poser quelques questions sur les aspects qui font dire qu’une maison est belle. Premièrement, je voudrais avoir votre compréhension de la beauté.
2. Qu’est-ce qui en général fait dire à une maison qu’elle est une belle maison?
3. Selon les critères qui définissent une belle maison, qu’est-ce qui a particulièrement de l’importance pour vous? Et pourquoi?
4. Pensez-vous que le type de maison et du site que les gens occupent ont avoir avec leur statut, leur goût et leurs intérêts?
5. Si je prends votre cas personnel pour illustration, pensez-vous que votre maison - sa position et les quartiers qui la composent – communique-t-elle quelque chose sur vous? En la regardant, les gens peuvent-ils connaître des choses sur vous, par exemple le nombre des femmes, d’enfants, etc.?
6. Lorsque vous avez occupé cette maison pour la première fois, était-elle pareille à celle-ci? Était-elle plus grande ou plus petite? S’il y a eu des changements quelles sont-ils et pourquoi?
7. Dans le processus de développement de la maison, y a-t-il des choses qui ne changent pas? Si oui, lesquelles et pourquoi?
8. Est-il possible à un individu de posséder une maison à trois ou quatre quartiers dès sa sortie de la maison parentale ? Si oui, en connaissez-vous quelques-uns dans le village? Si non, pourquoi ?
9. Pourquoi les maisons des chefs et des notables sont-elles situées en haut et non en bas. Pensez-vous que le haut et le bas définissent l’identité des gens?
10. Y a-t-il à votre connaissance des gens qui ne sont ni chefs ni notables, mais qui ont leurs maisons sur des altitudes? Pouvez-vous me parler un peu de leurs histoires de vie?
11. Quelles sont les pièces que chaque femme est censée avoir au sein de la maison ? Les femmes ont-elles droit de construire leurs propres maisons ? Pourquoi ?
451
12. J’ai remarqué que les grandes maisons appartiennent à des gens qui ont de nombreuses épouses. Pourquoi selon vous?
13. À partir de quel âge un individu est-il censé posséder sa propre maison ?
14. Pourquoi considère-t-on le fait de posséder une maison comme la preuve qu’on est devenu un homme?
452
Annexe 3
Protocole d’entretien pour les participants
vivant dans les villages de la plaine et à Mora
Introduction
- Éthique : lecture du formulaire de consentement
- Visite de l’environnement extérieur de la maison
-Visite guidée de l'intérieur de la maison (si permis par les occupants)
Section 1: Informations personnelles et trajectoires de vie
1. Nom et prénom (s’il y en a):
2. Date et lieu de naissance :
3. Situation matrimoniale (célibataire, marié à une femme, marié à plusieurs femmes)
4. Quelles langues parlez-vous et dans quel contexte en faites-vous usage?
5. De quelle religion êtes-vous?
6. Combien des gens vivent dans la maison (adultes et enfants)?
7. Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui vivent habituellement dans le ménage et qui ne sont pas des membres de la famille, comme des domestiques et des visiteurs par exemple?
8. Est-ce qu’il y a des gens qui vivent d’habitude dans le ménage et qui l’ont quitté au cours des trois dernières années ?
9. Généalogies familiales : Vos grands-parents sont-ils nés en plaine ou dans les montagnes? Qu’en est-il de vos parents et de vos enfants ? Êtes-vous en mesure de raconter votre arbre généalogique? La racontez-vous souvent à vos enfants et comment ?
10. Votre maison actuelle a-t-elle été construite par vous? Si oui, à quand remonte la date de sa construction?
453
Section 2 : Origine, itinéraire migratoire et installation dans les massifs
1. Qu’est-ce que la tradition orale raconte au sujet de l’origine, du processus migratoire et de l’installation de votre peuple dans les montagnes ?
2. Avez-vous entendu parler de Waza ? Y a-t-il des légendes et/ou des chants qui parlent de comment les ancêtres ont quitté Waza ? Si oui, pourriez-vous me les raconter ?
3. Avez-vous entendu parler de Borno et de Wandala ? Pouvez-vous me parler du genre de rapports qu’il y avait entre votre groupe et eux ?
4. On raconte à leurs propos qu’ils achetaient et prenaient des gens pour les vendre ? Est-ce que cela pourrait être vrai selon vous ? Avez-vous entendu les aînés parler de cela?
5. Avez-vous entendu parler d’un homme appelé Hamman Hadji ? On dit de lui qu’il était très connu des gens de la montagne, est-ce le cas pour vous? Qu’est-ce que les gens de chez vous racontent à son sujet?
6. Avez-vous entendu parler de l’existence d’un marché d’esclaves à Mora dans le passé? On dit que ce sont les Blancs qui sont venus mettre fin au marché. Quelle est votre opinion là-dessus?
7. Quels étaient les types de rapport que votre groupe entretenait avec les Blancs ? Étaient-ils aimés ou combattus ? Pourquoi ?
8. On dit qu’ils venaient avec des fusils et faisaient travailler les gens pour construire les routes dans les montagnes ? Connaissez-vous des gens qui sont encore vivants et qui ont participé à ces travaux ?
Section 3: place de la maison dans les constructions identitaires
A. Identité ethnique
1. Êtes-vous né en plaine ou êtes-vous descendus de la montagne? Si vous êtes descendus de la montagne, pourquoi et dans quel contexte êtes-vous quitté? Pourriez-vous nous dire quand est-ce que vous êtes descendus?
3. Comment vivez-vous avant lorsque vous étiez dans la montagne (sentiment d’appartenance ethnique, vie au sein de la maison de montagne, rites et autres pratiques associés à l’habitat)?
4. Avez-vous une idée des premiers habitants de votre village? Sont-ils tous descendus de la montagne? Avez-vous une idée de la date approximative et du contexte de leur descente?
5. Comment maintenez-vous la relation avec les gens qui vivent encore en montagne? Y allez-vous régulièrement là-bas? Si oui à quelle fréquence?
6. Y a t-il des choses que vous faites en commun avec les gens restés en montagne? Si oui lesquelles?
454
7. En regardant en arrière, comment voyez-vous aujourd’hui la vie en montagne et au sein de la maison de montagne? Quels sont les souvenirs que vous en gardez ?
8. Votre maison actuelle est-elle si différente de celle dans laquelle vous viviez en montagne? Si oui en quoi est-elle différente? Quels commentaires faites-vous sur la maison de montagne et sur votre actuelle maison?
9. On dit que la maison de la montagne traduit l’appartenance à un groupe ethnique. Qu’en est-il de la maison en plaine? Y a t-il des éléments de votre maison qui renseigne sur votre appartenance au groupe ethnique (podokwo, muktele ou mura)?
10. Vous considériez-vous toujours comme un (Podokwo, Muktele ou Mura)? Si oui comment exprimez-vous cela étant donné que vous êtes maintenant en plaine? Si non, pourquoi?
11. Y-a-t-il des objets que vous avez apportés de la montagne et que vous gardez avec vous? Si oui, quelle valeur leur accordez-vous et qu'est-ce qu'ils représentent pour vous?
12. Est-il possible de me les montrer et de me raconter un peu à quoi ils servaient dans la maison de montagne et à quoi ils servent maintenant?
13. Longue vie à vous et à votre famille239, mais s’il arrivait que Dieu vous rappelle un jour à lui, où souhaiteriez-vous qu’on vous enterre : devant la maison de montagne ou devant celle-ci? Pourquoi?
2. Statut social
1. Que représente la maison pour vous? Au-delà du fait qu’elle vous abrite, est-elle un endroit important? Pourquoi ?
2. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour construire votre maison?
3. J’ai appris qu’en montagne les pièces les plus importantes d’une belle maison sont les quartiers d’épouses et les greniers. Quelles sont selon vous, les pièces les plus importantes pour qu’une maison attire le regard en plaine?
4. Si je prends votre cas personnel pour illustration, y a t-il des choses qui font votre fierté au sein de la maison? Si oui lesquelles?
5. Y a t-il des endroits privilégiés dans la maison, à l’extérieur et à l’intérieur? Si oui lesquels et pourquoi?
6. Si on vous demandez de changer quelque chose à votre maison, que changeriez-vous? Pourquoi?
239 Formule tenue lorsqu’on aborde des questions liées à la mort et à l’au-delà dans les massifs pour ne pas paraître suspect.
455
7. J’ai remarqué que les gens construisent beaucoup des maisons rectangulaires et en tôle dans votre village? Pourquoi selon vous?
8. Depuis que vous avez construit cette maison, y a t-il des choses qui ont changé? Si oui lesquelles et pourquoi?
9. J’aimerai savoir si vous avez été une fois à Yaoundé ou dans d’autres villes? Combien de fois y êtes-vous allés? Vous souvenez-vous des dates, même approximatives de vos séjours en ville? Pourriez-vous raconter les raisons de votre mobilité?
10. Si vous avez été à Yaoundé, comment viviez-vous là-bas? Êtes-vous restés au ‘Grand-Salon’?
11. Êtes-vous satisfait de votre séjour à Yaoundé? Si oui pourquoi? Si non pourquoi?
456
Annexe 4
Protocole d’entretien pour les originaires des monts Mandara devenus fonctionnaires et vivant en ville
Introduction
- Éthique : lecture du formulaire de consentement
- Visite de l’environnement extérieur de la maison
-Visite guidée de l'intérieur de la maison (si permis par les occupants)
Section 1: Informations personnelles et trajectoires de vie
1. Nom et prénom :
2. Date et lieu de naissance :
3. Situation matrimoniale (célibataire, marié à une femme, marié à plusieurs femmes) :
4. langues parlées :
5. Religion :
6. - Pourquoi avez-vous choisi d’habiter dans cette ville et dans cette maison?
7. Qu’est-ce qui vous semble diffèrent entre cette ville/cette maison et les autres lieux où vous avez vécu jusque-là?
8. Depuis combien de temps à peu près vivez-vous ici? Vous sentez-vous chez vous ici?
9. Combien des gens vivent-ils dans la maison (adultes et enfants)?
10. Est-ce qu’il y a d’autres personnes qui vivent habituellement dans le ménage et qui ne sont pas des membres de la famille, comme des domestiques ou des gens venus du village par exemple?
Section 2: Origine, itinéraire migratoire et installation dans les massifs
1. Avez-vous une idée des traditions historiques concernant votre groupe ethnique (par exemple une légende qui raconte le processus migratoire et l’installation dans les monts Mandara ? Si oui, pourriez-vous me les raconter? Racontez-vous cela à vos enfants? Pourquoi?
4. On sait en lisant des documents que la plupart des groupes montagnards se sont installés
457
dans les massifs dans le contexte de l’émergence des hégémonies telles que le Borno et le Wandala. Pouvez-vous me raconter un peu ce que vous savez de ces évènements?
5. Beaucoup des fonctionnaires montagnards se réclament aujourd’hui Kirdi. Pourtant avant, les gens ne voulaient pas porter ce qualificatif. Qu’est-ce qui explique selon vous le fait qu’ils se revendiquent aujourd’hui comme étant des Kirdi?
Section 3 : place de la maison dans les constructions identitaires
A. Ethnicité et rapports avec le village
1. Avez-vous construit une maison au village? Si oui pourriez-vous me la décrire? Si vous n’avez pas jusque-là construit, le feriez-vous? Pourquoi?
2. Comment maintenez-vous la relation avec les gens de votre groupe ethnique ou de votre village? Y allez-vous régulièrement là-bas? Si oui, à quelle fréquence?
3. Que faites-vous pour promouvoir le développement de votre village? Les gens du village sont-ils conscients de ce que vous faites pour eux? Selon vous, sont-ils fiers de vous?
4. Comment recevez-vous les gens de votre village quand ils viennent vous rendre visite?
5. Vous considérez-vous toujours comme un (Podokwo, Muktele ou Mura)? Comment exprimez-vous cela étant donné que vous êtes en ville?
6. Y-a-t-il des objets qui vous rappellent le village que vous gardez avec vous? Si oui quels sont-ils et pourquoi tenez-vous à cela?
7. J’aimerais avoir votre avis sur le mémorandum des Montagnards chrétiens et animistes du Mayo-Sava. Selon vous, l’unité des Montagnards est-elle réelle? Quelle est votre propre opinion dessus?
8. Avez-vous participé à des rencontres dans lesquelles les gens font la promotion de l’identité montagnarde? Pouvez-vous m’en parler?
B. Maison et statut social
1. Cette maison vous semble t-elle comme votre chez-soi? Pourquoi?
2. Quelle est la pièce que vous appréciez le plus dans votre maison (chambre, cuisine, salon/salle à manger, douches, aires communes, etc.). Pourquoi?
-Comment trouvez-vous votre maison? La changeriez-vous si l’opportunité vous est offerte? Si oui pourquoi et quel type de maison souhaiteriez-vous avoir? Si non pourquoi?
3. Quels sont les changements apportés à la maison depuis que vous êtes propriétaire (ou locataire)?
458
4. Quels sont les meubles qui vous paraissent les plus importants? Pourquoi?
5. Comment trouvez-vous les meubles au salon? Sont-ils à votre goût? Qu’est-ce que vous changerez si l’opportunité vous est offerte?
6. Y a-t-il des endroits privilégiés au sein de la maison, à l’extérieur et à l’intérieur? Si oui pourquoi?
7. Lorsque vous recevez les visiteurs chez vous, dans quelle pièce de la maison les recevez-vous? Pourquoi?
8. Vos goûts en matière de confort et de l’aisance sont-ils si différents de ceux des gens du village et des migrants? Si oui en quoi sont-ils différents?
459
Annexe 5
Extrait du journal d’Hamman Hadji sur ses raids
en territoire animistes entre 1912 et 1920
La version complète de ce journal peut être trouvée dans l’ouvrage publié sous la direction de James Vaughan et Anthony Kirk-Greene en 1995, sous le titre The diary of Hamman Yaji: chronicle of a West African Muslim ruler. Elle a été également mise en ligne par Nicholas David en 2012 et est disponible via le site: http://www.sukur.info/Mont/HammanYaji INDEX.pdf. Enfin, certains auteurs ont produit des travaux consacrés au journal d’Hamman Hadji, entre autres Nicholas David (2014), Wouter Van Beek (2012), James Vaughan et Anthony Kirk-Greene( 1995) et José Van Santen (1993).
[1912]
16-9-12 On Monday the 3rd of Juldandu there came to me some pagans of the Matakam tribe from Buba Magawa's village, who brought me a female slave.
20-9-12 On Friday the 8th of Juldandu Umar returned from his journey to Garua and informed me that a new Governor had arrived. I also received news that I had won my case against Moda.
22-9-12 In the morning one of the women of my household refused to give me any food.
On Sunday the 10th of Juldandu I raided Sukur and we killed two men. Kaunga was killed.
1-10-12 On Tuesday the 19th of Juldandu I bought a suit of chain-armour at the price of a horse, and on the same day raided Mufuli. There we captured two calves, a cow and 14 sheep and goats, a result which displeased me.
3-10-12 On Thursday the 21st of Juldandu the soldiers returned to Mufuli and found four men dead. They captured a few cattle, which, however, scattered and escaped from them.
7-10-12 On Monday the 25th of Juldandu I got back two rifles which were in Mufuli.
20-10-12 On Sunday the 9th of Siutorandu I sent some soldiers to Sukur. They found three boys and managed to reach the Arnado's house.
22-10-12 On Tuesday the 10th of Siutorandu I divided my soldiers into two parties, one to go to Muduvu and the other to go to Sukur and Juyel. Alhamdu was killed.
1-11-12 On Friday the 20th of Siutorandu the Mandara people attacked the pagans of Kona with rifle fire.
18-11-12 On Monday the 8th of Laihaji Gajo returned from his journey to Ngaundere
460
bringing 20 cartridges.
21-11-12 On Thursday the 11th of Laihaji I sent Atiku and Madi Kelo to Garua in regard to a complaint and I gave them a horse as a present for the Governor.
23-11-12 On Saturday the 13th of Laihaji I sent to Garua to make a complaint against my Duhu people.
24-11-12 On Sunday the 14th of Laihaji I sent Madi Kucheb on a journey to Maifoni and I gave the Sheikh 5 dollars. On the same day I gave the Emir of Uba 15 shillings.
7-12-12 On Saturday the 27th of Laihaji I sent two messengers, Buba and Muhammad, to Ngaundere with two horses for the White Man; one was a present for him and the other was for sale. There was also a female slave for the interpreter.
10-12-12
On Tuesday the 30th Laihaji the pagans called Shikawa brought me 10 slave-girls. I also sent soldiers to Kamale, but they did not reach the Arnado's compound and only got a female slave whose hand had been cut off and who was a stupid as a goat. This made me very angry with them.
19-12-12
On Thursday the 9th of Haram Awwal Lawan 'Aji came and made his peace with me.
On the 8th day of Haram Awwal and the night of the 9th I dreamt that I rode a horse into water.
27-12-12 On Friday the 17th of Haram Awwal the pagans of Sukur brought me two cows as a peace-offering.
[1913]
8-1-13 On Wednesday the 29th of Haram Awwal the pagans of Sina killed 3 of my soldiers and captured 3 rifles. My people killed 5 of the pagans.
29-1-13 On Wednesday the 20th of Tumbindu Haramji the Christian sent back my horse because it was sick.
23 [sic]-1-13 On Thursday the 15th of Haram Wasti I started, that is to say I adopted, the practice of the Thursday and the Monday fasts, while I was in Bugel.
4-2-13
On Tuesday the 27th of Haram Tumbindu Haramji I found that my slave-girl in the absence of her fellow slaves had said that she would not prepare my food for me. Why she would not cook my food I do not know, but anyway the result was that I got no food from her and was obliged to buy it.
10-2-13 On Monday the 4th of Haram Akhir I gave a friend of mine, who is a clerk in Yola, 55 shillings.
17-3-13 On Monday the 8th of Banjaru Awwal I sent Mahawonga to hunt out slaves for me from the pagans called Dugupchi and they found 11 slave-girls and one cow.
23-3-13 On Sunday the 14th of Banjaru Awwal my people came back from Sinagali, and I heard that they had captured 7 pagans, 15 cattle and 30 sheep, and they returned safely.
30-3-13 The night of Monday the 21st of Banjaru Awwal the soldiers brought me 11 slaves.
461
3-4-13 The night of Friday the 26th of Banjaru Awwal Atiku brought me news that the Christian wanted labourers and ordered me to get them from the pagans willingly and obediently, even though it might be by fighting them.
8-4-13 On Tuesday the 30th of Banjaru Awwal Ahmadu and Jauro Abba went off with my people to Mokolo and captured 23 and killed 3.
15-4-13 On Tuesday the 7th of Banjaru raided in my territory from Duruk to Matakam and captured 13 slaves and 13 cattle.
4-5-13 On Sunday the 26th of Banjaru Sakitindu (sic) the Governor returned to me 410 shillings of the tax, and there remained with him 490 shillings.
12-5-13 On Monday the 5th of Banjaru Sakitindu I sent my soldiers to Sukur and they destroyed the house of the Arnado and took a horse and 7 slave-girls and burnt their houses. This was on Tuesday.
21-5-13 On Wednesday the 14th of Banjaru Sakitindu I sent soldiers to Hudgudur and they captured 20 slave-girls.
3-6-13 On Tuesday the 27th of Banjaru Sakitindu Abd Mubi arrived and with him my friend, who gave me 551 cartridges.
11-6-13 On Wednesday the 5th of Sumatendu Waube I sent Barde to Wula, and they captured 6 slave-girls and 10 cattle, and killed 3 men.
14-6-13 On Saturday the 8th of Sumatendu Waube Barto, Muhammadu and Buba Towo returned from their journey and brought goods which the Christian sent me - namely 32 lengths of cloth.
18-6-13 On Wednesday the 12th of Sumatendu Waube a Hausaman brought me 21 cartridges.
19-6-13 On Thursday the 14th of Sumatendu Waube Musa Kufur brought me 400 cartridges.
21-6-13 On Saturday the 16th of Sumatendu Waube I sent Barde to Mokolo and he captured 31 slave-girls and 8 cattle.
25-6-13 On Wednesday the 20th of Sumatendu Waube I sent my people to the pagans of Midiri and Bula and they captured 48 slave-girls and 26 cattle and we killed 5 persons.
6-7-13
On Sunday the 1st of Wairordu Sumarye I sent my people to Sina and they captured 30 cattle and 6 slave-girls.
On Sunday the 3rd of Wairordu Sumaye (sic) the Ober-Lieutenant entered Mubi and met with Yunus.
12-7-13 On Saturday the 7th of Sumatendu Waube (sic) I sent soldiers to Sina and the Sina pagans drove them off.
20-7-13 On Sunday the 15th of Wairordu Sumaye I sent my people to Sukur and we killed 15 and wounded very many and captured 15.
23-7-13 On Wednesday the 18th of Wairordu Sumaye I returned the people of Sina 6 of their pagans.
12-8-13 On Tuesday the 9th of Ramadhan the Arnado of Tur, Tada, died, and on the same day the Arnado of Bedel also died. So I ordered them to pay 3 calves and 30
462
goats, and I ordered the people of Tur to pay 2 slave-girls.
14-8-13 On Thursday the 11th of Ramadhan Nadi Kachab arrived from Maifoni with 700 cartridges.
18-8-13 On Monday the 15th of Ramadhan Oberleutnant Faizi visited the pagans of Pellam and stopped there.
23-8-13 On Saturday the 20th of Ramadhan the Oberleutnant arrived in Madagali and spent 5 days there.
28-8-13
On Thursday the 25th of Ramadhan he left Madagali and went to Duhu.
In the month of Juldandu (no date) the Governor and the Oberleutnant departed and I took leave of them safely. He sent Kobawim and Rizku to Gaur, and God be praised for that.
28-9-13 On Sunday the 26th of Juldandu Masa and two White Men arrived.
30-9-13 On Tuesday the 28th of Juldandu I heard that the Christian Masa had lost his way on the road.
30-10-13 On Thursday the 29th of Siutorandu Muhammadu returned from his journey to Ngaundere to the Christian named "Mutamfania", who gave me 50 shillings.
20-12-13 On Friday the 20th of Haram Awwal my son Yaya finished the Quran, and I gave him a slave-girl and a cow.
[1914]
20-1-14 On Thursday the 4th of Tumbindu Haramjui I sent Masin on a journey to Ngaundere and sent the Governor a black horse. I also gave them 4 horses to sell.
20-2-14 On Friday the 24th of Haram Akhir Oberleutnant Ruskis began to build a Rest House on the top of the Wurdere hill, but whether it will be finished by nightfall I do not know.
23-2-14 On Monday the 27th of Haram Akhir I left the Christian and he went on to Duhu.
28-2-14 On Saturday the 12th of Banjaru Awwal Hunus and Kaigamma Bakari went to see the Christian and brought back altogether from him 950 shillings.
12-3-14 On the night of the 14th of Banjaru Awwal there was an eclipse of the moon.
12-5-14 On Tuesday the 15th of Banjaru Sakitindu I heard that the Oberleutnant had arrived at Wandei. I left Nyibango and went to Mayo Tapare.
13-5-14 On Wednesday the 16th of Banjaru Sakitindu the Oberleutnant arrived at the Rest House at Wandei. He gave me 140 shillings.
2-6-14 On Tuesday the 7th of Sumatendu Waube I appointed Takma Arnado Pellam and he gave me his daughter.
13-6-14 On Saturday the 18th of Sumatendu Waube I received a letter from the Christians telling me that they had taken away from me the pagans of Sirak, Mufuli and Midiri.
4-7-14 On Saturday the 10th of Wairordu Sumatendu Waube (sic) I sent the clerk (?presumably at Marua) a horse, but I do not know whether he will accept it.
18-8-14 On Tuesday the 25th of Ramadhan Headman Umaru arrived with the news that there had been a battle between the English and the Germans. On the German side
463
500 were killed and on the English 443.
1-9-14 On Tuesday the 10th of Juldandu Atiku returned from Garua with news of a fight between the English and the Germans.
6-9-14 On Sunday the 15th of Juldandu a letter arrived from Garua to inform me that the Germans had driven back the English and scattered them. He ordered me to send him 100 carriers.
7-9-14 On Monday the 16th of Juldandu I sent Ardo Yaji and 10 horsemen with the 100 carriers.
12-9-14 On Saturday the 21st of Juldandu I received some news that the English had sent Ardo Michika back to Michika. On the same day a messenger arrived with the news that the Christians had fined Audu 300 shillings.
16-9-14 On Wednesday 25th of Juldandu an Englishman arrived in [from ?] Mandara and ordered horses from me, taking 22. I accompanied them to Jenge and then returned to my house owing to the lying of the Sultan of Mandara.
25-9-14 On Friday the 4th of Siutorandu I sent the remaining 5 horses to the English at Mandara.
28-9-14 On Monday the 7th of Siutorandu I sent Maliki to the Emir of Yola.
7-10-14 On Wednesday the 16th of Siutorandu news arrived from Mubi that Musa Malam Bawa had arrived with soldiers to look at the Rest House at Mubi.
11-10-14 On Sunday the 20th of Siutorandu Hamma Abdullah returned from Mandara with the price of the horses - 3192/6d. [3192 shillings and 6 pence]
12-10-14 On Monday the 21st of Siutorandu an Englishman named Mr. Lyon arrived.
18-10-14 On Sunday the 27th of Siutorandu Mr. Lyon left Madagali.
20-10-14 On Tuesday the 29th of Siutorandu Mr. Lyon left Madagali and went to Mandara.
26-10-14 On Monday the 5th of Laihaji I sent the Christians at Mandara a present valued at 40 shillings (? the Arabic is a little obscure)
6-11-14
On Friday the 17th of Laihaji I sent soldiers to Jenge and they arrested the Bulama on account of certain things, and I gave the Sergeant-Major 100 and some of them 20 and some of them 10 and some of them 20 and some of them 7. (the articles given are not stated)
7-11-14 On Saturday the 18th of Laihaji we counted the number of my horsemen who had no horses, and they came to 47. On the same day the pagans of Subala ransomed their women at 36 shillings a woman.
23-11-14 On Monday the 4th of Haram Awwal the Governor sent me 500 shillings.
28-11-14 On Saturday the 11th of Haram Awwal I raided Gumasi and took 20 cattle.
3-12-14 On Thursday the 15th of Haram Awwal I raided Tur and captured 50 cattle.
12-12-14 On Saturday the 24th of Muharram Awwal the French Christian arrived in Madagaliand the people of Madagali all ran away. There were 4 White Men.
14-12-14 On Monday the 25th of Muharram Awwal I returned with my people to Madagali.
16-12-14 On Wednesday the 28th of Maram Awwal I sent the Frenchmen 77 shillings.
[1915]
464
16-1-15 On Saturday the 29th of Tumbindu Haramji we counted the cattle and found that in two months I had acquired 379.
19-1-15 On Tuesday the 2nd of Haram Akhir the Christians came to Mandara.
22-1-15 On Friday the 5th of Haram Akhir a Christian arrived in Madagali from Michika and ordered me to proceed to Mandara, but I refused.
23-1-15 On Saturday the 6th of Haram Akhir the Christian Colour-Sergeant started off for Mandara with my son Ahmad.
2-2-15 On Tuesday the 18th of Haram Akhir we raided Kurang and got 100 cattle. Governor Diri (? Duhring) fought with the English and killed two Whitemen of the English. This occurred on Friday the 12th (sic) of Haram Akhir.
(No date) [very likely the same day] I raided Humumzi and captured 4 slave-girls and 20 cattle.
27-2-15 On Saturday the 11th of Banjaru Awwal in the middle of the night I heard that a Christian named Mr. Gaya had arrived from Duhu.
10-3-15 On Wednesday the 22nd of Banjaru Awwal the Christian named Mr. Gaya left Madagali and went to Duhu.
31-3-15 On Wednesday the 14th of Banjaru Tumbindu the Christian Mr. Gaya arrived in Madagali and stayed one night.
1-4-15 On Thursday the 15th of Banjaru Tumbindu the Christian Mr. Gaya left for Mandara.
28-4-15 On Wednesday the 13th of Banjaru Sakitindu 12 soldiers arrived at Mandara.
15-5-15 On Saturday the 30th of Banjaru Sakitindu I took on the devotional practices of the Mahdist sect under Malam Muhammad's instruction.
5-6-15 On Saturday the 21st of Sumatendu Waube Magaji and Sarkin Hausawa returned from their journey to the Christian at Mandara. Everything had turned out successfully and I was very pleased with them.
17-6-15 On Thursday the 3rd of Wairordu Sumaye I received news that the English had captured Garua.
24-6-15 On Thursday the 11th of Wairordu Sumaye I sent Kachella Suleiman to the Captain with 40 chickens.
25-6-15 On Friday the 12th of Wairordu Sumaye I raided Tufu and captured 8 slave-girls.
30-6-15 On Wednesday the 16th of Sha'aban I raided Kamale and captured 56 cattle and 40 slaves.
. On Wednesday the 13th of Juldandu I sent 200 labourers to Garua.
30-11-15 On Tuesday the 22nd of Haram 13 soldiers came from Garua to investigate into the lies that Bakari and Yaji had been telling.
3-12-15 On Friday the 25th of Haram I set off with the soldiers on a journey to Garua.
17-12-15
On Friday the 9th of Tumbindu Haramji I entered Garua and stopped in the Government Station in order that I might be treated for my illness by the doctor. I remained there 4 days. On Tuesday I had to fight cases against Rufa'u, Abdu, Jabril and Bakara [?Bakari]
465
Duhu, but I defeated them all. I then stayed two more days there.
23-12-15 On Thursday the 14th of Tumbindu Haramji I left the Government Station and went to my own house.
28-12-15 On Tuesday the 19th of Tumbindu Haramji I left Garua safely.
[1916] 18-1-16 On Tuesday the 12th of Haram Akhir I sent off 370 labourers.
23-1-16 On Sunday the 17th of Haram Akhir Midaina died killed by Bulama Hamad's witchcraft, so I sentenced Bulama after trying him.
30-1-16 On Sunday the 24th of Haram Akhir at night Salman's house was burnt down and at the same time 1000 cartridges of mine were burnt. In the month of Banjaru Awwal I raided Kanikela and captured 5 slave-girls, whom I let go, and 20 cattle.
12-2-16
On Saturday the 8th of Banjaru Awwal I arrived in Garua and saw the Captain, who told me to wait until the Colonel came back. He told me he would send labourers to put up a house for me, until the Colonel arrived. Then he said: "You are a big chief; I will not make you stay here with us, but go to your house and settle down. You know what is befitting a chief".
14-2-16 On Monday the 10th of Banjaru Awwal I went to see the Captain and found Jauro Kova had also come there from Yola. I then left the Captain safely.
15-2-16 On Tuesday the 11th of Banjaru Awwal I left Garua.
17-2-16 On Thursday the 13th of Banjaru Awwal I heard that Jauro Kova had also left and gone to Yola.
23-2-16 On Wednesday the 19th of Banjaru Awwal I reached Mubi and the same day sent Bula Soja to the Captain with three cows.
15-3-16 On Wednesday the 10th of Banjaru Tumbindu I made a raid and captured cattle from Mokolo, and on Friday I captured cattle from Lamsa and Dubur. The total number of cattle was 167.
25-3-16 On Saturday the 20th of Banjaru Tumbindu I burnt down the house of a pagan named Dufai.
21-3-16 On Tuesday the 16th of Banjaru Tumbindu I sent Jauro to the pagans of Loko and captured 9 slave-girls and 11 cattle.
1-4-16 On Saturday the 27th of Banjaru Tumbindu Kabala returned from his journey to Garau with news that the Captain had refused the calves.
4-4-16 On Tuesday the 30th of Banjaru Tumbindu Bakari Banel brought me a German rifle.
9-4-16 On Sunday the 5th of Banjaru Sakitindu I raided Hida and captured 30 cattle and 30 slave-girls.
16-4-16 On Sunday the 12th of Banjaru Sakitindu Ardo Yaji and Bula returned from their journey to Garua with news of a quarrel between the English and the French.
22-4-16 On Saturday the 18th of Banjaru Sakitindu Barde raided Mokolo and captured 40 cattle and (rest deleted).
7-5-16 On Sunday the 4th of Sumatendu Waube I heard that the Christians with Sheikh
466
Sanda had arrived at Isge.
16-5-16 On Tuesday the 13th of Sumatendu Waube I sent my men to Kekele, but on Wednesday they made a mess of the expedition, and my slave Audu Wemgo was killed, as also were 7 pagans of Humuchi together with some pagans of Pellam.
31-5-16 On Wednesday the 27th of Sumatendu Waube the Christians collected all the chiefs at the Government Station, and the Colonel gave me a saddle with a high pommel.
18-6-16 On Sunday the 16th of Wairordu Sumaye I left Mayo Tapere and met the Christian named Sarsar (?Sergeant) at Duhu.
19-6-16 On Monday the 17th of Wairordu Sumaye we marked out the boundary between me and Bakari Duhu.
23-7-16 On Sunday the 22nd of Ramadhan I raided the pagans of Hindu and captured 12 slaves.
27-7-16 On Thursday the 26th of Ramadhan I heard that the Commandant of Garua had left and had been succeeded by a Colonel. So I sent Kachella Suleiman the same day to Garua to offer my greetings.
7-8-16 On Monday the 7th of Juldandu we raided Mokolo and captured 30 slaves and 3 cows. Barde died on the Mokolo expedition.
18-8-16 On Friday the 18th of Juldandu I appointed as chief of my soldiers a man named Fadhl al Nar. We reckoned up the possessions of Barde which came to 40 slaves and 10 horses.
27-8-16 On Sunday the 27th of Juldandu my son Yahya was killed by the pagans of Gaur and his slave wounded.
25-9-16 On Monday the 26th of Siutorandu the Christians Itina and Sarsar (?Lieutenant and Sergeant) arrived and I gave them 14 goats and 3 cows. He gave me 6 more villages - Mugil and Humuchi and others. He also gave me 60 shillings.
27-9-16 On Wednesday the 28th of Siutorandu the Lieutenant left for Mandara and the Sergeant with Yerima Baba went off to raid the pagans of Gaur.
29-9-16 On Friday the 30th of Siutorandu Yerima Baba returned from raiding Gaur. The pagans had driven off my people, wounding 4 men and 1 horse.
6-10-16 On Friday the 8th of Laihaji I sent my soldiers against the Sina pagans in the Daba area, and they captured 34 slaves and 7 cows. They killed 5 people.
19-10-16 On Thursday the 21st of Laihaji I sent my soldiers to Sukur and they captured 18 slaves.
19-10-16 On Thursday the 21st of Laihaji Mumun came and said that the Germans had gone.
28-10-16 On Saturday the 30th of Laihaji I raided Mufuli and killed 4 men and 10 cattle.
4-11-16 On Saturday the 7th of Haram Awwal I sent Sarkin Hausawa Audu to Yola to offer my condolences on the death of Bobbo Ahmadu, and I sent the Emir of Yola a horse.
7-11-16 On Tuesday the 10th of Haram Awwal we divided 40 shillings on all the houses.
467
(? the tax was fixed at 40 shillings a house).
1-12-16 On Friday the 5th of Tumbindu Haramji I sent my people to raid the pagans named Tille and they killed 5 men and captured 8 slaves and 18 cattle.
9-12-16
On Saturday the 13th of Tumbindu Haramji Muhammad Bintu and Audu Sarkin Hausawa returned from their journey to Yola, bringing a gown which the Emir of Yola gave me.
The same day I sent my son Abd al Rahman to the school of the Christians at Garua.
14-12-16 On Thursday the 13th of Tumbindu Haramji I raided Hindu and captured 53 slaves and 7 cattle, and killed 3 men.
19-12-16 On Tuesday the 23rd of Tumbindu Haramji my uncle brought me a few cartridges.
[1917]
2-1-17 On Tuesday the 7th of Haram Akhir I arrived at Garua and had a discussion concerning 2 slaves. There was also talk about rifles.
3-1-17 On Wednesday the 16th of Haram Akhir Jauro returned with the rifles.
14-1-17 On Sunday the 18th of Haram Akhir the Christians and all the horsemen had horse-races.
17-1-17 On Wednesday the 22nd of Haram Akhir in the evening the Captain returned me my rifles and also my slave from Libam. He also decided the case between me and Bakar Duhu concerning our boundary, in which I won.
18-1-17 On Thursday the 23rd of Haram Akhir I left Garua early in the morning.
28-1-17 On Sunday the 4th of Banjaru Awwal I raided Bedel and captured 2 cows and 2 boys.
2-2-17 On Friday the 9th of Banjaru Awwal I raided Midiri and captured 4 slaves and 7 cattle.
4-2-17 On Sunday the 11th of Banjaru Awwal I received news of the death of Sheikh Sanda.
25-2-17 On Sunday the 2nd of Banjaru Tumbindu I received 50 shillings and 2 gowns for a slave-girl.
12-3-17 On Monday the 17th of Banjaru Tumbindu I raided Hindu and captured 20 slaves.
8-4-17 On Sunday the 15th of Banjaru Sakitindu I raided Mokolo and captured 30 slaves and 13 cattle.
20-4-17 On Friday the 27th of Banjaru Sakitindu Buba Jam returned from Garua with an order for me to go to Marua.
7-5-17 On Monday the 15th of Sumatendu Waube Fadhl al Nar raided the Uba pagans and captured 4 slaves, 27 cattle, 62 goats, 11 gowns and a fez. We killed 12 men.
12-5-17 On Saturday the 20th of Sumatendu Waube I sent Fadhl el Nar to Libam and he captured 25 cattle.
468
21-5-17 On Monday the 29th of Sumatendu Wabue I entered Marua and gave the Captain 8 cows. He refused to accept them, however, and took a calf.
24-5-17 On Thursday the 2nd of Wairordu Sumaye I left Marua.
5-6-17 On Tuesday the 14th of Wairordu Sumaye my people raided Sinegali and captured 10 cattle and 40 goats.
8-6-17 On Friday the 17th of Wairordu Sumaye Bajam and Harun returned from Garua and said that the Commandant instructed me that I should deal with Garua and not Marua.
21-6-17 On Thursday the 30th of Wairordu Sumaye I raided Hindu and captured 11 slaves.
4-7-17 On Wednesday the 13th of Ramadhan I went to Guzum and met the Christian named "Lisdan".
6-7-17
On Friday the 15th of Ramadhan Lisdan rode along the French border and the following day along the German border (? Arabic obscure). He told me not to have anything to do with Jauro until the Captain at Marua arrived.
The same day the pagans of Duhu marked out their boundary as passing by the other side of my house. So Lisdan arrested Arnado Usmanu for his offence in regard to this matter of my house.
On the same day I left him and went to Zu and he ordered me to proceed to Marua.
13-7-17 On Friday the 22nd of Ramadhan I had a short talk with the Captain (i.e. in Marua).
14-7-17 On Saturday the 23rd of Ramadhan the Captain had some horse-races.
15-7-17 On Sunday the 24th of Ramadhan the Christian collected the people and explained the administration of justice and criminal law.
16-7-17
On Monday the 25th of Ramadhan I went to the Government Station and talked over my case against Bakari Duhu. They said they would leave the matter until after the 'Id, when the Captain would go to Gulak and Duhu. I left Bulama and Bekari Duhu to talk over the matter with the Lieutenant.
17-7-17 On Tuesday the 26th of Ramadhan I departed from Marua, leaving Bulama and Ardo Yaji to fight the case of Bakari Duhu. They defeated him.
19-7-17 On Thursday the 28th of Ramadhan I raided the pagans of Lamsha and got 50 slaves.
1-8-17 On Wednesday the 12th of Juldandu I sent my people to the Emir [of Uba] to raid the pagans called Mijilu.
8-8-17 On Wednesday the 29th (sic) of Juldandu I raided the pagans called Fakara and got 27 slaves from my own territory and 23 from Fakara together with 7 cows.
12-8-17 On Sunday the 23rd of Juldandu 2 rifles arrived.
16-8-17 On Thursday the 27th of Juldandu I sent Fadhl al Nar with his men to raid Sukur and they captured 80 slaves, of whom I gave away 40. We killed 27 men and women and 17 children.
469
On the same day I sent a force to raid Dufur and they killed 8 pagans. The pagans killed the leader of my forces and captured one rifle.
26-8-17 On Sunday the 8th of Siutorandu I fixed the penalty for every slave who leaves me without cause at 4 slave-girls and if he is a poor man 200 lashes.
6-9-17 On Thursday the 19th of Siutorandu I sent Fadhl al Nar to raid Hindu and we captured 2 women.
15-9-17 On Saturday the 27th of Siutorandu I sent Liman and Misau to the Christian with 2 horses.
21-9-17 On Friday the 3rd of Laihaji I raided Gedel and captured 8 slaves.
27-9-17 On Thursday the 10th of Laihaji the Captain arrived and stopped at the Rest House without my knowing.
4-10-17 On Thursday the 17th of Laihaji I sent Bula with my soldiers to raid Midiri and other places. They captured 3 slaves.
9-10-17 On Tuesday the 22nd of Laihaji I sent Fadhl al Nar to raid the pagans of Wula and they captured 10 slaves and killed 2 men.
16-10-17 On Tuesday the 29th of Dhahaiya I heard news from Mubi that the Lieutenant had arrived at Mubi.
19-10-17 On Friday the 2nd of Muharram I raided the pagans of Hindu and captured 8 slaves and killed 5 men.
1-11-17 On Thursday the 15th of Haram Awwal I raided Gumusi and captured 3 slaves.
6-11-17 On Tuesday the 20th of Haram Awwal I raided Dufur and killed 2 people.
7-11-17 On Wednesday the 21st of Haram Awwal Bula gave me a slave-girl as the price of his getting the pagans of Dubulum. I do not think that they will be in his control for 12 months, for he is a mischief-maker in the land.
8-11-17 On Thursday the 22nd of Haram Awwal a letter arrived summoning me to Marua and God is knowing.
13-11-17 On Tuesday the 27th of Haram Awwal I left Madagali to go to Marua and stopped at my house at Mayo Tapare. On the same day I sent Yerima Abba to raid Garta and he captured 20 cattle and 8 slaves.
19-11-17 On Monday the 4th of Tumbindu Haramji I went to the Government Station (in Marua) with the tax money and other things and gave them to the Lieutenant. Two Fulani had a complaint against me but I won.
21-11-17 On Wednesday the 5th of Tumbindu Haramji I took my leave of the Captain. He told me that the Bau pagans belonged to me.
24-11-17 On Saturday the 8th of Tumbindu Haramji I sent Fadhl al Nar to raid with his people and they captured 8 cattle.
25-11-17 On Sunday the 9th of Tumbindu Haramji I went myself and raided Mokolo and captured 30 cattle but we did not count the dead.
1-12-17 On Saturday the 15th of Tumbindu Haramji we counted the tax of the whole land of Madagali and it came to 1803 shillings and 144 cattle.
11-12-17 On Tuesday the 25th of Tumbindu Haramji the Captain arrived from Wandei and said he wanted to tour my land. I gave him 2 oxen and he gave me 20 five-franc
470
pieces.
12-12-17 On Wednesday the 26th of Tumbindu Haramji the Captain left Madagali and went to Durei.
25-12-17 On Tuesday the 10th of Haram Akhir the Captain returned at night and gave me 11 five-franc pieces.
28-12-17 On Friday the 13th of Haram Akhir I left Madagali to go to Marua.
30-12-17 On Sunday the 15th of Haram Akhir I reached Mokolo and sent Fadhl al Nar to raid Dufur. They captured 8 cattle and killed 2 men.
[1918]
3-1-18 On Thursday the 19th of Haram Akhir I went to the government Station (in Marua) and then returned home.
4-1-18 On Friday the 20th of Haram Akhir I had a case with the Mokolo pagans which I won.
9-1-18
On Wednesday the 25th of Haram Akhir I had a case with Bakari Duhu and defeated him. He swore a false oath on the Qur'an. On the same day the Captain returned the Mokolo pagans to me once more. I then took my leave and left Marua.
18-1-18 On Friday the 4th of Banjaru Awwal I sent Gora to Yola with 60 shillings.
19-2-18 On Tuesday the 7th of Banjaru Tumbindu I sent Fadhl al Nar to raid the Moda pagans named Dubugu. They captured 30 cattle of the humpless variety, 5 slaves and 44 goats.
26-2-18 On Tuesday the 14th of Banjaru Tumbindu some pagans fled from English territory and entered my land. They numbered 15 houses.
21-3-18 On Thursday the 8th of Banjaru Sakitindu I went to Mokolo and sent my people to raid the Mokolo pagans. They captured 9 slaves and 10 cattle.
25-3-18 On the 12th day of Banjaru Sakitindu at night a man named Umaru Banu came to me and I made an agreement with him either that he would kill Arnado Mokolo or that he would ruin him.
26-3-18 On Tuesday the 23rd (sic) of Banjaru Sakitindu I went in person and raided Mokolo. I captured 120 persons and had 3 of my men wounded. We killed a large number of them.
4-4-18 On Thursday the 22nd of Banjaru Sakitindu I received information that the tax was to be 4 shillings a man and if English money was paid 3 shillings and 3 pence.
11-4-18 On Thursday the 28th of Banjaru Sakitindu my people raided the pagans of Dinlim and captured 14 slaves, 33 cattle, 68 sheep and 45 goats, the total of the livestock being 118.
27-4-18 On Saturday the 15th of Sumatendu Waube I sent my horsemen and Fadhl al Nar's people to raid Bau. They captured 28 cattle.
29-4-18 On Monday the 17th of Sumatendu Waube my people returned to Bau and captured 40 cattle.
471
18-5-18 On Saturday the 7th of Wairordu Sumaye Umaru Shamaki returned from selling my cattle in Mubi. He got 370 shillings for them, 99 shillings being English money.
23-5-18 On Thursday the 12th of Wairordu Sumaye the pagans of Wakka fought with the pagans of Ngenge and they killed two Wakka men and burnt the Ngenge houses.
3-7-18 On Wednesday the 23rd of Ramadhan I fixed the price of Yerima Baba's horse at 3 slave-girls.
11-7-18 On Thursday the 2nd of Juldandu I sent my people to raid Midiri and they captured 31 cattle and 3 slaves.
15-7-18 On Monday the 6th of Juldandu I entered Marua and met Captain "Duru". I gave him a horse and 5 calves.
16-7-18 On Tuesday the 7th of Juldandu I went to the Government Station and had a dispute with Bakari Duhu in which I defeated him. I found there a pagan named Badima. On the same day I left Marua.
19-7-18 On Friday the 10th of Juldandu I sent Fadhl al Nar off at night to raid the pagans of Ramdere. They captured 33 cattle and 17 slaves and 65 sheep.
24-7-18 On Wednesday the 15th of Juldandu the pagans of Mugudi raided Ardo Harun and wounded him.
25-7-18 On Thursday the 16th of Juldandu I raided the pagans of Wulunku, capturing 15 slaves and 60 livestock. The son of Joda was killed.
20-8-18 On Tuesday the 12th of Siutorandu Jauro and Wanga raided Arnado Muduvu, named Suvu, and killed him and his son and captured 13 of the people of his house.
31-8-18 On Saturday the 23rd of Siutorandu Bajam and Maliki returned from their journey to Marua and said they had fought the case against Bakari Duhu and had defeated him and had got back for me the pagan girl. So I gave them a slave-girl.
5-9-18 On Thursday the 28th of Siutorandu the Lieutenant marked out the boundary at Ghania and they took away from me some land in Mandara territory. The same day they arrived in Madagali and spent 3 days and collected the tax.
8-9-18 On Sunday the 1st of Laihaji I went out with the Christian and I stopped at my house in Wuro Alhamdu while the Christian stopped at Gulak.
9-9-18 On Monday the 2nd of Laihaji the Christian started off and marked the boundary. We got possession of the whole of the Duhu "bush", and as a result Bakari Duhu ran away and crossed over the river.
11-9-18 On Wednesday the 5th of Laihaji the Lieutenant went off to Moda.
15-9-18 On Sunday the 7th of Laihaji Jauro raided the pagans named Wudila and captured 21 slaves.
29-9-18 On Sunday the 22nd of Laihaji Fadhl al Nar raided Futu in the morning and captured 23 cattle, 22 gowns, 3 red fezzes and 15 goats.
4-10-18 On Friday the 27th of Laihaji I heard that the people of Michika had sent to Marua to complain about the Futu affair.
472
16-10-18 On Wednesday the 9th of Haram Bakr Guldum brought me the stocks (?) of two rifles and I gave him 10 shillings. I decided I would give him a slave-girl.
19-10-18
letter from the Lieutenant in which he ordered me to arrest Bakari Duhu. He also told me to collect the tax from the pagans of Isge. This I will do willingly and obediently. On the same day the pagans of Midiri brought me a calf. The pagans of Bau, after running away from fear, also brought me a calf.
28-10-18 On Monday the 21st of Haram Awwal Bello and Gora came to me from their journey to Fort Lamy. The daughter of Rabeh sent me a rifle, which I bought for 50 five-france pieces.
1-11-18 On Friday the 25th of Haram Awwal at night news about the tax arrived from the Lieutenant. In the morning I sent off Muhammad Kobo and Buba to Marua regarding the lying news of a fight between the French and the Germans.
5-11-18 On Tuesday the 29th of Haram Awwal we heard that Moda and Michika had had a fight in which one man was wounded.
10-11-18 On Sunday the 5th of Tumbindu Haramji we raided Zakura and captured 18 cattle and 3 slaves.
18-11-18 On Monday the 14th of Tumbindu Haramji I sent Bula and Wanga to raid the Isge pagans and they captured 22 cattle, 18 slaves and 10 goats.
23-11-18 On Saturday the 18th of Tumbindu Haramji a letter arrived from the Captain in which he told us that our news regarding the French and the Germans was incorrect.
6-12-18
On Friday the last day of Haram Tumbindu I sent some honey and 50 shillings to the Captain.
(The rest of the page contains records of his own movements, details of presents given him by various pagans and others, and an entry regarding a trading expedition to Kano).
25-12-18 On Wednesday the 20th of Haram Akhir I raided Bau and captured 52 cattle, 29 slaves and 63 goats.
26-12-18 On Thursday the 21st of Haram Akhir I sent Muhammad Bindiga to Marua with 30 cattle and 40 goats representing the Bau tax.
28-12-18 On Saturday the 23rd of Haram Akhir I sent mounted men and footmen to Sugel and they captured 21 cattle and 4 persons and killed one horse.
31-12-18 On Tuesday the 26th of Haram Akhir I received a horse from Hayatu of Mubi.
[1919]
27-1-19
On Monday the 24th of Banjaru Awwal on my arrival in Madagali I heard that while I was in Tongo the pagans of Lamsha had killed Abbo and his horse and his slave. Then I sent Fadhl al Nar with his people to raid the Dufur pagans. They spent 3 nights there on the hill and on Friday came down again. The same day Yerim Baba returned from his journey to Marua regarding the tax. There remained 2020 German shillings outstanding. They captured 19 of the Dufur pagans.
473
5-2-19 On Wednesday the 3rd of Banjaru Tumbindu I sent Fadhl al Nar with his people to the area of the Tekem people and they captured 120 and killed one man.
14-2-19 On Friday the 12th of Banjaru Tumbindu I received a letter from the Captain demanding soldiers from me.
20-2-19 On Thursday the 18th of Banjaru Tumbindu my people and Moda's people raided Tur and captured 70 slaves, 14 cows and 90 sheep and goats.
21-2-19 On Friday the 19th of Banjaru Tumbindu I gave the Emir of Moda 3 slaves and his soldiers 2 cows and 10 goats.
22-2-19 On Saturday the 20th of Banjaru Tumbindu I sold one of my slaves for 260 shillings in Mubi.
25-2-19 On Tuesday the 23rd of Banjaru Tumbindu Gora brought me 50 cartridges.
26-2-19 On Wednesday the 24th of Banjaru Tumbindu Bello brought me 20 cartridges.
1-3-19
On Saturday the 27th of Banjaru Tumbindu Jarma Bajam arrived with news that the Commandant had spent the night at Disa. So the same day I sent off Jarma and Barade to the Commandant regarding my pagans in Gwoza and others. I promised them that if they got what I wanted from him I would give them a slave-girl each. I told Malam Muhammad something so that Kaigamma Bakr may hanker after something. The same day I made an arrangement with my scribe Amin by which if I do a certain thing the Christian will not stop at Madagali. I gave him a slave for this, and if God does prevent him from staying here I will give him 2 slaves.
2-3-19 On Sunday the 28th of Tumbindu Haramji (sic) the Commandant arrived at Madagli and stayed for two nights. He paid 50 shillings.
4-3-19 On Tuesday the 1st of Banjar Sakitindu the Commandant left Madagali.
12-3-19 On Wednesday the 9th of Banjaru Sakitindu I sent Dakare to Garua to buy cartridges from Hama Yadam. I gave him 30 shillings.
13-3-19
On Thursday the 10th of Banjaru Sakitindu I raided in the Uba hills and captured 31 slaves and gave the Emir of Uba 20 of them. I also got 17 cows and gave the Emir of Uba 8, and 160 sheep, giving the Emir of Uba 80. I also captured 34 articles of various kinds.
20-3-19 On Thursday the 17th of Banjaru Sakitindu Moda's people were badly defeated in a raid on their pagans. There were 24 of them, their leaders being Waziri Kadiri, Durtu and Kachella Abdu.
21-3-19 On the 18th of Banjaru Sakitindu I went down to my house in the direction of Mugudi [i.e., Nyiburo] and sent my soldiers to the pagans of Moda in order to bury their dead.
13-4-19 On Saturday the 10th of Sumatendu Wabue Hamman Dakare brought me 25 cartridges.
14-4-19 On Sunday the 11th of Sumatendu Waube the Emir of Mubi sent me 10 cartridges.
17-4-19 On Thursday the 15th of Sumatendu Waube I heard that the Emir of Kano had died, may God pardon him.
474
The same day Madi Kuchab sent me 22 cartridges from Fort Lamy.
21-4-19 On Monday the 20th of Sumatendu Waube my uncle arrived from Dikwa with 16 cartridges.
26-4-19
On Saturday the 24th of Sumatendu Waube I took over the Beit al Mal, and there will be a fine for everyone who leaves the Mahdist sect: and I started with Bakari Hamarwabe. (The Arabic is a little obscure, but there seems little doubt that this is the meaning).
29-4-19 On Tuesday the 27th of Sumatendu Wabue I raided the pagans of Rowa and captured 50 cattle and 33 slaves. We calculated my fifth share as 17 slaves and 25 cattle. Fadhl al Nar broke his rifle.
7-5-19 On Wednesday the 6th of Wairordu Sumaye I raided Sir with Lawan Aji of Gaur and we captured 8 slaves, 144 cattle and 200 sheep. We divided them as follows: I got 72 cattle, 5 slaves and 100 sheep and Gaur the same.
17-5-19 On Saturday the 16th of Wairordu Sumaye I sent Burza and Ardhunga on a long journey with 1500 shillings to buy me rifles and cartridges. I gave them a slave so that they might sell him to buy themselves food.
6-6-19 On Friday the 7th of Ramadhan news arrived that the Christians had arrested Emir Garga of Michika.
19-6-19 On Thursday the 20th of Ramadhan Audu Hausa came from Kano with 600 cartridges, 7 rifles and 3 red fezzes. He also stole 200 shillings.
1-7-19 On Tuesday the 2nd of Juldandu Madi Kusab brought a rifle which fired nine cartridges, which he had bought for 170 shillings.
8-7-19 On Tuesday the 7th of Juldandu the Lieutenant arrived at Madagali to mark the boundary between me and Isge and I gave him a horse.
9-7-19 On Wednesday the 10th of Juldandu I went off with the Lieutenant and climbed the Wandei hill. I stopped at my house in Tongo and the Lieutenant stopped in Mugudi on the other side of the boundary between me and the Emir of Marua.
10-7-19
On Thursday the 11th of Juldandu I left Tongo and stopped at my land named Koshehi, while the Lieutenant left Mugudi and met me in Koshehi.
That night a letter arrived from the Captain calling me in to the celebrations of the Christians.
11-7-19 On Friday the 12th of Juldandu I sent Yerima Abba to Marua to see the celebrations of the Captain.
12-7-19 On Saturday the 13th of Juldandu I received news that the pagans of Mugudi had robbed a caravan of Zira Bugel and had killed one man and captured his people and two horses.
15-7-19 On Tuesday the 16th of Juldandu I raided Sinagali capturing 40 cattle and 40 sheep and goats. Fadhl al Nar's rifle got broken.
16-7-19 On Wednesday the 17th of Juldandu Captain "Shukuga' arrived in Madagali.
18-7-19 On Friday the 19th of Juldandu Yerima Abba returned from the Captain's celebrations. He brought two horses belonging to the pagans of Mugudi, which he had captured from them.
475
24-7-19 On Thursday the 25th of Juldandu I sent Fadhl al Nar to raid Kamale and he captured 34 slaves, 26 cows and 130 goats.
7-7-19 On Sunday the 28th of Juldandu I caused the name of my land to be changed and gave away two slave-girls on the occasion of changing the name, and I fixed a fine of 5s. for anyone who made a mistake in this name.
12-8-19 On Tuesday the 15th of Siutorandu I bought 2 female slaves for 160 shillings. On the same day Babal arrived with 70 cartridges.
21-8-19 On Thursday the 23rd of Siutorandu I sentenced Wurduru to 12 months' imprisonment for killing a man of the Sina pagans.
26-8-19 On Tuesday the 29th of Siutorandu I sent off Jauro Bazza with 150 shillings for my own requirements and 30 shillings as a present for a clerk in Bornu.
28-8-19 On Thursday the 1st of Laihaji a Christian of the English came and put up in the town. So I left Mayo Tapare and went to meet him.
29-8-19 On Friday the 2nd of Laihaji I paid Babel Burmatali a slave for 60 cartridges. In future I shall buy them with cash.
13-9-19 On Saturday the 17th of Laihaji I left Wuro Alhamdu in order to meet the Captain at Duhu.
14-9-19 On Sunday the 18th of Laihaji I left Guram and the Captain left Duhu and we went to Madagali. I gave him 3 well-bred horses and the same day he went off to the Wandei hill and spent the night at Tongo.
16-9-19 On Tuesday the 20th of Laihaji I raided the pagans of Kara, who are between me and the Mandara people named Dhunfa, and we captured 4 slaves, of whom I returned 2 and kept 2. We got a cow and killed 4 men.
1-10-19 On Wednesday the 5th of Haram the soldiers returned from raiding Bau and brought 25 slaves and 27 cattle. They killed 4 men. Sheep and goats came to 124.
5-10-19 On Sunday the 9th of Haram I received a letter from the Captain telling me about the tax. Each Muslim and pagan, man and woman, have to pay 3 francs.
30-10-19 On Thursday the 5th of Tumbindu Haramji I raided the Mokolo area and captured 14 people. Jauro was wounded.
5-11-19 On Wednesday the 11th of Tumbindu Haramji the Captain ordered me to go to Marua.
12-11-19
On Wednesday the 18th of Tumbindu Haramji (after arriving in Marua the previous day) I went to the Government Station and met the Commandant and the Captain. The same day I left Marua. I bought a horse from Lawan Ania for 900 shillings English plus 100 shillings which I gave him as a present.
17-11-19 On Monday the 23rd of Tumbindu Haramji I sent Jauro to Bau and they captured 15 slaves.
26-11-19 On Wednesday the 2nd of Haram Akhir the Emir of Rei sent me 7 gowns.
30-11-19 On Sunday the 6th of Haram Akhir at night I raided Waru and we captured 23 slaves and killed 17 men.
2-12-19 On Tuesday the 8th of Haram Akhir I gave the Emir of Rei a horse, 2 six-year old cows and a female slave.
476
30-12-19 On Tuesday the 7th of Banjaru Awwal I raided Wula and we captured 20 slaves.
[1920]
6-1-20 On Tuesday the 13th of Banjaru Awwal I sent Fadhl al Nar off at night to raid the area of Zira Kumbura.
14-1-20 In the month of Banjaru Awwal I sent Musa off with three slave-girls to sell them and bring me back cash. This was on Wednesday.
15-2-20 On Sunday the 24th of Banjaru Tumbindu I raided the pagans of Gulak and captured 22 cattle, and from Mildu we took 13 cattle.
28-2-20 On Saturday the 7th of Banjaru Sakitindu I received a letter from the Captain saying he had raided the pagans of Kuhum and had captured a large quantity of cattle and sheep and had also taken 70 prisoners and killed 10.
11-3-20 On Thursday the 17th of Banjaru Sakitindu I sent Fadhl al Nar to raid the Gaur pagans. They captured 2 slaves, one of whom died, and 30 goats.
16-3-20 On Tuesday the 24th of Banjaru Sakitindu the Captain arrived in Madagali and at once sent soldiers to round up the Bororo cattle in Duhu. They captured 100 cattle.
28-3-20 On Sunday the 7th of Sumatendu Waube I sent Fadhl al Nar to raid Zugun and they captured 25 slaves. They also captured 8 slaves from the Mandara pagans and killed 4 men. In addition they got 8 cattle and 22 sheep.
29-3-20 On Monday the 8th of Sumatendu Waube the pagans of Mugudi raided the Kamale pagans and killed one man and wounded two. Then the Kamale pagans fought them and killed two and wounded two.
6-4-20
On Tuesday the 15th of Sumatendu Waube I sent Fadhl al Nar to raid the Futu pagans. They captured 4 slaves and 30 cattle, and killed one man. On the same day one of my rifles was damaged while in the charge of Jauro. It was an 11-round rifle.
10-4-20 On Saturday the 20th of Sumatendu Waube I sent Fashakha and Kalifa to raid the pagans of Lamsha and they captured 8 slaves. I left them their livestock.
13-4-20 On Tuesday the 23rd of Sumatendu Waube I sent Fadhl al Nar against the Kalo pagans and they captured one slave and 44 cattle, and killed 25 men.
14-4-20 On Wednesday the 24th of Sumatendu Waube I sent Jauro and Bula against the Isge pagans and they captured 16 slaves, 2 horses, 2 donkeys, and 20 goats.
20-4-20 On Tuesday the 30th of Sumatendu Waube I sent Fadhl al Nar to raid the pagans of Gumusi and they captured 40 cattle.
1-5-20
On Saturday the 11th of Wairordu Sumaye I sent Jauro Soji to the Sergeant and the soldiers of the Captain collected together and raided Gaur Habe and Shir. He gave me 3 cows. Because of him I found that many of my pagans ran away.
I gave Malam Muhammad 2 slaves as a deposit.
8-5-20 On Saturday the 18th of Wairordu Sumaye I sent Fadhl al Nar with his people to raid the Gusdo pagans. They captured 69 slaves, 50 cattle and 160 goats.
12-5-20 On Wednesday the 22nd of Wairordu Sumaye I sent Jauro Soji against the Fatawi
477
pagans. They raided them and captured 37 slaves, 100 goats and 17 cattle.
15-5-20 On Saturday the 25th of Wairordu Sumaye I sent Jauro Soji to raid the pagans of Gumasi. They took from them 70 slaves, 48 cattle and 90 goats.
19-5-20 On Wednesday the last day of Wairordu Sumaye I sent Fadhl al Nar to raid the Muktu pagans. They captured 11 slaves and 13 cattle. They killed 9 of the pagans and 2 Michika men. One of our men was wounded.
28-5-20 On Friday the 9th of Sumaye a letter arrived from the Captain telling me to return the property of Isge. He added that I do not own all of the Isge land.
2-6-20 On Wednesday the 14th of Sumaye I sent Fadhl al Nar against the Kiria pagans. They raided them and captured 50 slaves, 88 cattle and 50 gowns.
3-6-20 On Thursday the 18th of Sumaye I sent Jauro Soji against the Gatahurki pagans. They raided them and captured 77 slaves and 40 cattle.
18-6-20 On Friday the last day of Sumaye on the Id al Fitr I gave my scribe Amin ibn Nakashiri a gown on my appointing him Alkali.
2-7-20 On the night of the 16th of Shawwal I sent an expedition under the command of Jauro against Bau.
3-7-20 On Saturday the 16th the expedition under Jauro returned with 12 prisoners and 8 cows.
7-7-20 On Wednesday the 20th of Shawwal I raided Wula Digel and took 75 prisoners and 10 cows.
23-7-20 On Friday the 6th of Siutorandu I heard that the pagans of Bau had sent a deputation to me and that the party was waylaid on the road by pagans of Wusfu, who killed one of them
24-7-20
On Saturday the 8th of Siutorandu I heard news that Abangu's pagans had raided his brother, the pagans of Wangila, and had had two men killed and wounded. Three of Wangila's men were killed. When I heard this I sent an expedition under Fadhl al Nar to capture Abangu and his people, and they captured him and everyone with him.
30-7-20 On Friday the 13th of Siutorandu my messenger Gora returned from his journey with 130 cartridges, some good and some bad.
2-8-20
On Monday the 16th of Siutorandu a letter arrived from the Captain saying that the English were coming: this is what he wrote. (? 4 words of the Arabic being half-obliterated). Then on Wednesday another letter arrived saying that my land has been transferred from the French to the English. Let us hope that the French are telling lies. There are three days between the two letters.
7-8-20 On Saturday the 21st of Siutorandu Dangadi returned from Marua with a letter from the Captain saying that he now had no authority in my land.
16-8-20 On Monday the last day of Siutorandu I sent Jauro Soji with my men to raid between Sina and Mala. They captured 23 slaves, & 100 goats and killed 4 men. We had one wounded and one killed.
23-8-20 On Monday the 8th of Laihaji I sent Bula Soji to raid the pagans of Wudala and they captured 30 slaves and goats.
478
4-9-20 On Saturday the 20th of Laihaji I received a letter from the Captain in which was a complaint made by the pagans of Gaur and the people of Mandara against me.
10-9-20
On Friday the 26th of Laihaji between the two hours of prayer of the evening and the sunset I received two letters, one from the Emir of Yola and the other from the Captain. They concerned the coming of the English, and said that an Englishman from Yerwa and the Captain of Marua were to meet in my land between Waha and Habada in order to fix the boundary of my land.
14-9-20 On Tuesday the last day of Dhu al Hijjah the Emir of Bornu returned me three of my slaves.
15-9-20 On Wednesday the 1st of Muharram I sent Fadhl al Nar with my horsemen to Mandara in order to fix the boundary.
22-9-20 On Wednesday the 8th of Muharram the Captain arrived.
26-9-20
On Sunday the 14th of Muharram we heard of the coming of the English and their carriers and labourers. Then Ajia gave me a horse and 100 shillings, Wakalta 100 shillings, Yerima Abba 100 shillings, Sarkin Arewa 8 shillings, Wambai the same, Mayau Shamaki and Kofa 90 shillings, Lamido Chudde a horse, Sarkin Fada, Sarkin Shanu, Bulama Abba, Hamman Fedo, Baraya, Ardo Wula, Yerima Karm and Sa'id 8 cows.
27-9-20
On Monday the 14th of Muharram I started off and met the English Judge, who had some of the chiefs with him. The Captain then left and stopped at Humuchi for a few days and then went off. I bought from Interpreter Adamu an extraordinarily fine gown and he gave me 15/- for a cow and 6/- for chickens.
10-10-20 On Sunday the 27th of Muharram I left Holma and stopped at my house in Zummu, where I met the Emir of Yola and gave him two horses. I stayed three nights there.
23-10-20
On Saturday the 10th of Tumbindu Haramji while I was at Nyibango I heard that the pagans named Diskin had raided Wappara, so I made arrangements and sent Fadhl al Nar with his men to raid the pagans of Sukur. They captured from them 39 slaves and 24 goats and killed 5 men.
26-10-20 On Tuesday the 13th of Tumbindu Haramji I gave the Emir of Yola two horses and his messenger, Maliki, a woman and a gown.
6-11-20
On Saturday the 24th of Tumbindu Haramji my son Abd al Rahman returned from the school of the French Christians and I told him: "There are three things for you to look after - the mosque, your dress and your food".
I gave the messenger Samaki Yola 90s/-.
At the same time I bought a chestnut horse from Yerima Audu Marua for 8 cattle and 300s/-. I bought it to seal the compact between us.
17-12-20 On Friday the 5th of Banjaru Awwal I heard that the Judge with the spectacles was coming. (Mai Madubi)
19-12-20 On Sunday the 7th of Banjaru Awwal I welcomed the Judge Mai Madubi. He spent the night and then on Monday I met him and he told me what he had to say.
25-12-20 On Saturday the 13th of Banjaru Awwal the Judge Mai Madubi ordered me to go with him to look at the boundary of my land. I refused, so he went and came back
479
and told me that he had cut the boundary through my land and given my land back to Bornu.
27-12-20 On Monday the 15th of Banjaru Awwal I left the Judge Mai Madubi in view of his evil words and conversation and his mischief-making in cutting off my land.
31-12-20
On Friday the 19th of Banjaru Awwal my messenger Magaji returned and according to what he said the Judge Mai Madubi ordered that there should be a decision made in the case between my pagans and my chieftainship over the Duhu land, that is to say the chief of Duhu.
480
Annexe 6
Quelques extraits des guides touristiques sur Udjila
Guide touristique 1 : Mboa info
Lien internet : http://www.guide.mboa.info/guide-touristique/chefferies-et-royaumes/fr/content/actualite/867,la-chefferie-oudjilla.html
Oudjila est une grande chefferie de l'Extrême-Nord. Elle est entièrement construite en matériaux locaux qui présentent l'architecture des peuples des montagnes. Les habitants sont en majorité animistes, mais on y trouve quelques chrétiens. On y arrive par route et la chefferie est située à 15 km de Mora et 60 km de Maroua. La saison sèche est la période conseillée.
À visiter :
Paysage avec une culture en terrasses sous forme d'escalier
Arbre mystique
Piste de danse en plein air
Pièce des bœufs
Salle de prière
Tombe du père du chef
Domaine des 50 épouses du chef. Chaque épouse dispose d'une case, d'un grenier et d'une cuisine
Zone de la 1 ère épouse du chef
Domaine du chef
Véranda et salle de réception
Marché de dimanche.
481
Saré de l'Extrême-Nord
Dans la partie de l'Extrême-Nord, les habitations montagnardes sont variées en fonction des ethnies. Chaque concession est appelée saré. Les murs sont faits en voute de terre et le toit en paille tissée. La case du chef de famille contrôle le plus souvent l'entrée de chaque saré. Les constructions commencent le plus souvent par le grenier qui est l'élément capital de chaque famille. Chaque épouse dispose de deux ou trois cases, d'une chambre, d'une cuisine et d'un grenier. En général, les cases sont très exigües et leurs ouvertures étroites.
Informations pratiques
Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur un terrain pierreux
Prévoir 10.000 f CFA (par groupe de visiteurs) pour les danses spontanées organisées par les épouses du chef
Prévoir 500 f CFA par personne pour visiter toute la chefferie. Respecter les consignes du guide en ce qui concerne les prises de vue photographiques.
Véhicule 4 x 4 conseillé
Prévoir une somme de 4.000 à 5.000 f CFA pour le transport de Mora Oudjilla en moto-taxi
2. Guide touristique 2 : Doualafil
Lien Internet: http://doualafil.canalblog.com/archives/p10-10.html
Piquenique dans la savane et visite d’Oudjila. C’est un petit village dans les montagnes. Les paysages sont magnifiques et les villages de cases ont beaucoup de charme (à défaut de confort…!!!). D’ailleurs dès qu’on sort des villes, il n’y a pas de maisons, seulement des cases en terre au toit de paille ou de roseaux. Le peuple a fui dans les montagnes pour échapper à la conversion forcée à l’islam lors des invasions arabes. Aujourd’hui encore, les musulmans n’ont pas droit de cité dans ces villages et les habitants sont ou animistes (dans leur grande majorité) ou chrétiens. Dans ce petit village, nous avons visité le ‘saré’ du chef et ses 47 épouses. Nous n'avons vu que 5 (les plus vieilles), avachies sur des tas de briques!!!
Le chef est un vieil homme (dans les 70 ans). Dans cette enceinte, chaque épouse possède sa chambre et sa cuisine. On y trouve aussi la salle des ancêtres et l’étable où sont engraissés les bœufs pour le sacrifice annuel. Les conditions sont plus que rudimentaires tant au niveau du confort que de la vie quotidienne (toute l’année, à tous les repas, ils mangent la même chose : de la bouillie de mil. Il n’y a que la sauce qui chance…). Il y a
482
des enfants partout; le chef a eu 1112 ou 113 enfants (il ne sait plus…) et possèderait environ 500 petits-enfants…!!!
3. Extrait d’un ouvrage de promotion touristique (Source, Auzias et Labourdette, 2012, p. 258-259).
À partir de Mora, une piste sinueuse vous emmène vers les montagnes. Elle traverse
quelques ruisseaux, asséchés en dehors de la saison des pluies et de jolies cultures en
terrasse, les plus impressionnantes du Cameroun, avant de parvenir, une dizaine de
kilomètres plus loin, à la fameuse chefferie d’Oudjilla, vieille de plus de 200 ans. Ce
village Podoko constitue une autre étape touristique incontournable dans l’extrême nord
du pays. Là vous attendent de nombreux villageois, tous plus désireux les uns que les
autres de vous emmener au sa ré du chef, construit au sommet de la colline, moyennant
quelques centaines de francs. La visite du saré coûte 6 000 F et dure environ une heure et
demie. Vous pourrez en outre assister à un spectacle intéressant de danses traditionnelles.
À proximité de la place du marché se trouvent les tombes et les habitations traditionnelles
: les cases sont rondes, couvertes d’enduit en terre et disposées autour des greniers,
réserves alimentaires des familles du village. Les fondations des cases sont en pierre, le
reste est en terre. Les toits de chaume sont de forme conique et sur certaines cases, des
poteries sont exposées. À l’intérieur de la chefferie, on distingue le saré du chef, protégé
par une muraille, où se trouvent notamment le grenier du chef, la salle du tribunal
coutumier, la salle de prière et la salle du bœuf sacré, celle du compartiment des épouses.
La case de la première femme est retirée de celles des autres épouses. Chaque femme
dispose d’une case, de greniers et d’une cuisine. Pour des questions d’intimité, les
chambres des femmes ne font pas face à la muraille comme les autres pièces, mais sont
orientées vers l’arrière, sans vis-à-vis.
De nombreuses traditions et superstitions sont observées dans la région. Par exemple, un
bœuf de deux ans est placé chaque année dans l’une des pièces sacrées du chef, dans une
totale obscurité. Il s’agit d’un animal sacré qui pendant un an reste ainsi enfermé sans voir
le jour, avant d’être sacrifié juste avant les récoltes, le jour de la fête Podoko, pour
garantir la prospérité du village. Les récoltes terminées, un nouveau bœuf prend la place
de l’ancien jusqu’à l’année suivante. La coutume veut aussi que le chef soit enterré dans
la case où il a vécu. Une seule de ses femmes a alors l’autorisation de dormir dans la
pièce où il repose, à condition qu’elle n’ait pas eu d’enfants. Si toutes les femmes du chef
ont eu d’enfants, seule la mère du successeur aura le droit de dormir dans cet endroit.
485
Annexe 9
Mémorandum : Les Kirdis dénoncent Ibrahim Talba et Abba Boukar
(source : http://www.leseptentrion.net/memorandum-les-kirdis-denoncent-ibrahim-talba-et-abba-boukar/)
À Messieurs El Hadj. Ibrahim Talba Malla et El Hadj. Aba Boukar.
Le crédit que nous avons longtemps placé en vous semble désormais s’émousser. Depuis toujours nous vous avons donné notre soutien comme héritage de la confiance qu’avaient placée nos parents en vous. Cette confiance qui s’exprimait par un vote massif en faveur de vos choix politiques, choix qui vous a profité à vous seulement ; à vos familles, à vos ethnies et à vos coreligionnaires. Mais les données ont changé. Nous avons ouvert les yeux ! Nos parents et nous, ne sommes plus ce bétail électoral qu’on mène à la boucherie sans avoir engraissé ou tout au moins abreuvé. Ce bétail qui n’a pas son mot à dire. Cinquante ans d’oppression, de mise à l’écart des affaires de la cité c’est trop ! Quel est le problème ? Vous avez reconduit Salomon Douvogo comme candidat aux législatives, représentant les Massifs. Ce dernier ne nous a jamais représentés, nous ne l’avons jamais vraiment connu. Six ans d’usurpation étaient suffisants pour ce parachuté qui n’avait aucun fait politique lorsqu’il nous a été imposé. Le comble est venu lorsqu’il a été fait membre du Comité Central. Il existait bien ceux qui avaient depuis 1992 mouillé le maillot et qui pouvaient mieux nous représenter en l’occurrence : Hayang André (Président de la Section OJRDPC), Hoche Mozogo (membre du comité central depuis plus de 20 ans) ou encore le Professeur Gwoda Adder Abel.
En choisissant Salomon, nous comprenons que votre but est de nous retarder dans la conquête dans la conquête développement. Douvogo doit aux peuples du Massif 48 millions de Francs CFA de microcrédits. La misère de ces peuples de montagne n’est-elle pas assez criarde pour que vous les sacrifier à ce rapace ? Depuis toujours cette majorité démographique de plus de 60% de l’arrondissement de Mora semble ne pas compter dans l’échiquier du RDPC, tout son rôle est un faire-valoir. Dans les années 90 quand tout le monde quittait le bateau, nous sommes restés fermes contre vents et marrées pour soutenir Paul Biya. Tout ce que nous avons eu comme récompense, c’est votre indifférence, l’indifférence des élites de Mora et du parti. Les parvenus qui nous ont rejoints par la suite dans le parti sont promus à des postes administratifs et politiques. Même lorsque l’élite a eu la possibilité de donner l’emploi à la jeunesse du département, nous avions toujours été oubliés et laissés pour compte parce que nous n’avions pas d’élites dans les montagnes pour venir au secours et répondre en nos lieux et places. Un mémorandum des chrétiens avait décrié cette situation il y a 4 ans, mais rien n’a été suivi d’effet. Nous savons finalement que nous ne pouvons pas compter sur ce régime. Le RDPC n’a jamais pu jeter un regard compatissant sur ces fidèles électeurs des Massifs de Mora que nous sommes. Pourquoi donc continuer à nous battre pour cette machine sans cœur ?
486
Cette indifférence s’est aggravée avec les investitures. Aucun Podoko ni Moura ne figure sur la liste des législatives (titulaires et suppléants confondus). Sur la liste des municipales, la présence des peuples des massifs est marginale, elle devrait même être rejetée par ELECAM, car ne respectant pas les composantes sociologiques. Cette situation est restée telle depuis la démocratisation. Puisque nous ne comptons pas à vos yeux, nous avons décidé d’agir pour notre destin. Notre instruction, nous permet désormais de comprendre ce qui est meilleur pour nous. Nos parents ne peuvent que suivre nos directives et nos chefs de cantons sont sensibilisés et vos menaces de destitution à leur égard n’auront plus véritablement d’effets. Même le Professeur Gwoda sur qui nous avons mis beaucoup d’espoir pour nous aider à changer notre situation ne pourra pas nous empêcher de suivre notre destin comme il a l’habitude. D’ailleurs, il semble de plus en plus jouer votre jeu. Il donne l’impression d’une indépendance d’esprit, mais en fait il vous courtise. L’église chrétienne qui soutenait sa candidature aux législatives a décidé de prendre fait et cause pour notre combat. Ne comptez donc plus sur nous pour ces élections qui s’annoncent! Nous ne voterons plus pour ceux qui ne nous considèrent pas. Nous ferons un vote utile L’UNDP par ses choix semble nous convenir et nous allons nous jeter dans la bataille, peut-être qu’enfin la justice sera de notre côté.
Ont signé :
Sevda Jacob Mativé Jean Mavia Thomas Mérima Marie Marabaï Jonas
PLEG Instituteur Infirmier Animatrice ONG Instituteur
Laraba Paul Moussa Mathieu Koftélé Mahama Hassana Jean Doué Mahama
Etudiant UMA Taxi moto Etudiant PLEG Clergé
Achi Suzane Marava Luc Talaka Gali Moïse Talba Jonas Abdou Maya
Commerçante Infirmier Etudiant UMA Etudiant Électricien
Anonymes : Président S/s OJRDPC Pasteur Pasteur PLEG
Présidente S/s OFRDPC
488
Annexe 11
Ligne généalogique des chefs d’Udjila
Gul�ve (premier à migrer dans la région) Installation sur les piémonts de Slala-Mendaha
Haya
D�gura (Resté sur les piémonts)
Mbega (Deuxième fils et héritier du trône)
Dagwa (Premier fils)
Zhana (Premier chef du clan et bâtisseur de la concession cheffale à Mogodé vers le XVIIIe siècle)
Gedje Negde
Keda (Rend le trône à Defuwa)
Defuwa
Zlambala
Daouka (Promu chef de canton dans les années 1940)
Maya









































































































































































































































































































































































































































































































































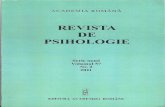

![[2013] Un contrat de location d’une maison en arabe (P. Brux. Inv. E. 8449)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6333b4e4e9e768a27a0fb310/2013un-contrat-de-location-dune-maison-en-arabe-p-brux-inv-e-8449.jpg)














