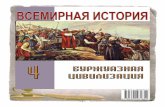La Convention sur la diversité biologique à la croisée de quatre discours
Discours politique, discours social : de l’instantané et de l’éphémère vers la pérennité....
-
Upload
univ-reims -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Discours politique, discours social : de l’instantané et de l’éphémère vers la pérennité....
Discours politique, discours social : de l’instantané et de
l’éphémère vers la pérennité. Les discours de Léon Bourgeois (1851-1925), la théorie du solidarisme exprimée dans
Solidarité (1896) et l’envie de synthèse. Analyse d’une source manuscrite inédite conservée aux Archives départementales de la Marne.
Cicéron est, aujourd’hui encore, plus connu pour ses plaidoiries et ses discours politiques
que pour la publication de certaines de ses œuvres, aussi pouvons nous assurément affirmer que le discours en politique est un média essentiel utilisé par les politiciens et qu’en tant que tel il est une source fondamentale pour l’historien. Le discours politique relève de la sphère de l’oralité, celui-ci est prononcé et reçu par un auditoire en un lieu marqué (souvent symbolique au demeurant) et en un temps donné. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, les discours politiques relèvent aussi du monde de l’écrit quand ceux-ci sont retranscrits en totalité ou partiellement dans le Journal officiel de la République française, dans les procès-verbaux ou dans les colonnes des quotidiens mais aussi et surtout lorsqu’ils sont publiés dans des recueils spécifiques. Dès lors, l’éphémère (l’oral) devient pérenne (l’écrit). Rares sont les documents qui nous permettent d’analyser la prise de décision de ce passage loin d’être anodin et qui nous permettent de mettre l’accent sur les axes privilégiés d’une réflexion politique surtout si celle-ci peut s’envisager à long terme, au regard de la durée d’une vie, particulièrement d’une vie en politique. Quelques pages autographes de Léon Bourgeois nous permettent de tenter cette analyse. La cote J 1110 est ainsi constituée de quarante-cinq feuillets dont quelques-uns (feuillets 42 et 43 : faire-part de mariage) n’intéressent pas directement notre étude et peuvent être qualifiés de « feuillets hors sujet ».
Conservées aux Archives Départementales de la Marne, ces pages volantes issues d’un cahier sont donc une source précieuse. Véritable brouillon préparatoire à la publication de certains de ses discours, parus sous le titre La politique de la prévoyance sociale aux éditions Fasquelle entre 1913 et 1919, ce document est riche d’enseignement à plusieurs titres. D’abord, il permet de mieux comprendre Léon Bourgeois en sa qualité d’élu et surtout dans la perception qu’il peut lui-même avoir de son rôle et de son action politique puisqu’il dresse un recensement des discours politiques (généralement à vocation sociale) qui lui semblent les plus intéressants et les plus pertinents. Ensuite, et pourrions nous dire au regard de cette étude, il permet surtout de s’interroger sur la nature même du discours dont le but premier n’est pas d’être lu mais d’être entendu et qui n’a pas vocation à être publié et donc à n’être qu’un acte éphémère, alors que Léon Bourgeois le conçoit, à la lecture de ses notes manuscrites et de la publication qui en a été tirée, comme un élément pérenne.
La figure même de Léon Bourgeois compte pour beaucoup dans la valeur de ce document. Engagé dans la défense de Paris face aux armées prussiennes en 1870, il achève brillamment ses études de droit à Paris où il est né en 1851. Reconnu rapidement pour ses qualités de juriste, il opte pour la carrière administrative et préfectorale en devenant secrétaire de la préfecture de la Marne puis est nommé successivement sous-préfet de Reims, préfet du Tarn, préfet de Haute-Garonne avant de se voir confier l’un des plus haut poste de la République : la préfecture de police de Paris. C’est en 1888 qu’il se présente pour la première fois au suffrage de ses concitoyens qui l’envoient à la Chambre des Députés. À partir de cette date, il devient l’une des figures de proue du courant radical. Député de la Marne de 1888 à 1905, sénateur du même département de 1905 à 1925, il est rapidement reconnu par ses pairs comme un homme de grande valeur. Quelques mois seulement après avoir intégré la Chambre, il est Secrétaire d’État à la Présidence du Conseil et au Ministère de l’Intérieur. De nombreux portefeuilles ministériels lui sont alors confiés : l’Intérieur, la Justice, l’Instruction publique et les Beaux-Arts, le Travail et la prévoyance sociale. Président des deux chambres parlementaires, il est même chef du gouvernement mais refuse continûment de briguer le poste de président de la République que lui proposent ses amis radicaux. Véritable chantre de la paix, il développe publiquement lors des
conférences internationales pour la paix de La Haye de 1899 et 1907, au cours desquelles il représente la France, l’idée d’un arbitrage international dans le cadre d’une société des nations. Ce n’est qu’après la Grande Guerre que son projet voit le jour. Promoteur de la Société des Nations, il en devient le premier président et obtient le prix Nobel de la paix en décembre 1920. Figure d’importance, sa pensée politique a un véritable impact sur la politique française et internationale de la fin du dix-neuvième siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale ; aussi ces quarante-cinq feuillets et la publication des deux tomes de La politique de la prévoyance sociale prennent un relief différent.
Si la datation de la publication est assez aisée, il n’en est pas de même pour l’ensemble de ces notes manuscrites. Il semble néanmoins évident que nous sommes en mesure de donner une fourchette chronologique, que nous voudrons la plus restreinte possible et ce au regard des éléments fournis par les sources elles-mêmes. Il convient de constater que les listes de discours dressées par Léon Bourgeois ne respectent pas toujours l’ordre chronologique de leur énonciation. Aussi, il semble important de croire que ces notes manuscrites ont été rédigées dans un court laps de temps. L’ensemble a été constitué, et cela semble une évidence, avant la date de parution du premier tome dans le but précis d’établir une publication. Le dernier discours mentionné par Léon Bourgeois, dans son brouillon, date du 2 octobre 1911, discours prononcé à Roubaix lors du congrès de l’Alliance d’Hygiène sociale. Or, le premier tome sort en 1913 et voit la publication du discours d’ouverture du Congrès de l’Alliance d’Hygiène sociale prononcé à Paris le 14 mai de la même année. Par conséquent nous sommes en mesure de penser que la rédaction de ces pages volantes intervient entre ces deux termes chronologiques : 2 octobre 1911-14 mai 1913. Cependant, nous devons nous interroger sur la présence dans le premier tome de la publication du discours de Léon Bourgeois effectué en décembre 1911 au Musée Social. En effet celui-ci n’est pas mentionné dans les notes manuscrites de Léon Bourgeois. Se présentent alors à nous deux hypothèses. Primo, est-il possible que Léon Bourgeois en dressant la liste des discours potentiellement utiles à la préparation ait oublié ou omis l’un d’entre eux, à moins qu’il ne l’ait, dans un premier temps, pas jugé d’une qualité suffisante pour intégrer une publication ? Nous pourrions bien évidemment répondre par l’affirmative, surtout si le discours en question est assez ancien. Or ce n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’un discours très récent au regard du dernier mentionné par Léon Bourgeois à savoir celui d’octobre 1911. Secundo, il est probable que Léon Bourgeois n’en ait pas fait mention dans son brouillon tout simplement parce que celui-ci n’était ni prononcé, ni même écrit (partiellement ou totalement d’ailleurs). Cela signifierait donc que le document manuscrit conservé aux Archives Départementales de la Marne sous la cote J 1110 aurait été écrit de la main de Léon Bourgeois entre octobre et décembre 1911. Cette hypothèse peut se justifier non seulement par les éléments indiqués ci-dessus : aspect matériel de la source qui indique que celle-ci a été constituée en un bref laps de temps et présence/absence de discours dans le brouillon à une date charnière, mais aussi par un élément constitutif de la publication elle-même. En 1913, l’éditeur prend le soin d’écrire un avertissement destiné au lecteur dans lequel il mentionne : « Depuis quelques temps déjà, bien avant que M. Léon Bourgeois fût appelé au Ministère du Travail, nous lui avons demandé l’autorisation de réunir et de publier ses travaux les plus récents sur les questions d’Hygiène sociale. Son passage aux affaires en 1912-1913 a retardé l’impression du présent ouvrage, mais nous a permis, en revanche, de l’accroître de plusieurs discours, dont quelques-uns semblent bien nous donner la plus complète expression de sa pensée. »1 Si nous nous en tenons à la lettre de cet avertissement, celui-ci nous explique la présence de discours des années 1912 et 1913 non mentionnés dans le brouillon de Léon Bourgeois, brouillon constitué avant son arrivée au ministère du Travail avec le premier gouvernement Poincaré le 14 janvier 1912, poste qu’il quitte à la chute du ministère le 21 janvier 1913. Dès lors l’hypothèse d’une rédaction des notes manuscrites préparatoires à un ouvrage de
1 « Avertissement de l’éditeur », in Léon Bourgeois, La politique de la prévoyance sociale, Paris, Fasquelle, 1913, tome 1, p. VII.
synthèse sur la pensée de Léon Bourgeois en matière de politique sociale entre octobre et décembre 1911 semble pouvoir se confirmer.
L’ensemble de ces données permet de nous demander en quoi ces documents, pour une grande part, inédits, mis en relation avec l’ouvrage La politique de la prévoyance sociale, montrent-ils une évolution de la pensée politique et sociale de Léon Bourgeois entre 1882 et 1913, mais surtout dans quelle mesure peuvent-ils être confrontés à la théorie première exprimée dans Solidarité paru en 1896.
Pour répondre à plusieurs degrés différents à cette problématique, il convient de définir très brièvement le solidarisme en tant que philosophie politique et d’en donner les tenants et les aboutissants aux yeux de Léon Bourgeois lui-même, puis de s’interroger sur la volonté, plus ou moins explicite, de Léon Bourgeois lorsqu’il accepte ou décide la publication d’une partie de ses discours (analysant ainsi un passage à l’acte qui n’est pas anodin), enfin de considérer cette volonté de synthèse au regard de la théorie initiale et de mesurer le cheminement intellectuel, philosophique, social et politique de Léon Bourgeois, homme politique d’envergure de la Belle Époque. Nous pourrions aussi analyser, mais c’est évidemment l’objet d’une autre question, l’impact de ces discours, réflexions et philosophie sur la politique sociale de la France sous la Troisième République et au-delà.
Qu’est-ce que le solidarisme ? Nous ne nous appesantirons pas outre mesure sur cette question, pour laquelle nous
renvoyons à la très courte analyse effectuée par Serge Berstein.2 A la lecture de l’ouvrage de référence, écrit par Léon Bourgeois en 1896 et intitulé Solidarité, nous sommes en mesure de considérer que le solidarisme correspond, dans la plume de celui-ci, à une philosophie politique, économique, sociale et morale qui s’insinuerait entre socialisme et libéralisme, une troisième voie dans laquelle l’humanité s’engage naturellement, celle-là permettant de réguler les sociétés contemporaines. Mais bien plus qu’une nouvelle voie, Léon Bourgeois considère cette philosophie comme « une synthèse entre libéralisme et socialisme. »3 Il démontre qu’ « il y a entre chacun des individus et tous les autres un lien nécessaire de solidarité [dont] les conditions et les limites peut donner la mesure des droits et des devoirs de chacun envers tous et de tous envers chacun. »4 Selon cette conception, le monde est régi par des lois naturelles, qui au dix-neuvième siècle dans l’élan du courant positiviste et de la révolution scientifique sont en passe d’être démontrées, et le monde social n’est en rien différent puisqu’il s’appuie lui aussi sur des lois sociales naturelles contre lesquelles l’homme et en premier lieu l’homme politique ne peut rien. Cependant ce faisant, Léon Bourgeois opte pour un présupposé lourd de conséquence pour la théorie du solidarisme, selon lui en effet, l’homme, « être de raison, cherche le vrai ; être de conscience, il cherche le bien »5 non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres puisque le premier terme est indissociable du deuxième. Dès lors le rôle de la « science sociale [est] de s’efforcer à résoudre (…) cette question des rapports de l’individu et de la société humaine. »6 Influencé par la conception scientifique positiviste du monde, Léon Bourgeois considère alors l’homme et la société humaine à l’image de celle du monde biologique. La personne humaine, être de passion, de raison et de conscience n’est pas une figure abstraite créée d’un seul coup, mais est née d’une suite d’ancêtres, est soumise à leur hérédité et est vivante en un milieu avec lequel elle est en interaction. « L’humanité est composée de plus de morts que de vivants ; notre corps, les produits de notre travail, notre langage, nos pensées, nos institutions, nos arts, tout est pour nous
2 Serge Berstein, « Le solidarisme », in Alexandre Niess, Maurice Vaïsse (dir.), Léon Bourgeois, Langres, Dominique Guéniot, 2006, pp. 3 Léon Bourgeois, Solidarité, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, « Sociologie », 1998 (Paris, Armand Colin, 1912), p. 14. 4 Idem., p. 15. 5 Idem., p. 19. 6 Idem., p. 20.
héritage, trésor lentement accumulé par les ancêtres. »7 Et tout ceci n’est possible que parce qu’il y a association humaine et solidarité entre les hommes. Dès lors la solidarité n’apparaît pas aux yeux de Léon Bourgeois comme réductrice de liberté mais bien comme une condition sine qua none du développement humain. Aussi cette solidarité doit permettre le développement de chacun dans une commune mesure afin que tout individu progresse et se développe, et se faisant les hommes permettent le développement naturel de la solidarité humaine, de l’association humaine elle-même. Cela étant, les hommes dans l’association humaine doivent en tirer d’égales peines et d’identiques avantages afin de réunir les conditions morales d’une juste association. Cette association doit permettre de faire « le compte des charges et des avantages, des apports et des prélèvements, des doits et des avoirs »8 afin de déterminer justement les droits et les devoirs de chacun des individus constituant cette association humaine considérée comme une loi sociale naturelle.
Léon Bourgeois va même plus loin, puisque l’homme étant le produit de ses ancêtres, eux-mêmes associés et solidaires par nature, il considère alors que « l’obéissance au devoir social n’est que l’acceptation d’une charge en échange d’un profit. C’est la reconnaissance d’une dette. »9 L’homme a donc naturellement une dette envers la société puisqu’il « naît débiteur de l’association humaine »10 et en intégrant l’association humaine il y prend sa part de l’héritage accumulé par les ancêtres et « chaque génération qui passe ne peut vraiment se considérer que comme étant l’usufruitière [du legs de tout le passé à tout l’avenir], elle n’en est investie qu’à charge de le conserver et de le restituer fidèlement. Et l’examen le plus attentif de la nature de l’héritage conduit à dire en outre : à charge de l’accroître. »11 Un quasi-contrat est alors tacitement passé entre celui qui intègre l’association humaine et l’association humaine elle-même, quasi-contrat directement passé et contracté au jour de la naissance et dont les termes courent jusqu’à celui de la mort de l’individu.
De l’oral à l’imprimé, de l’éphémère au pérenne : analyse d’une
pratique A travers la pratique de Léon Bourgeois, il convient de s’interroger sur un phénomène
d’une ampleur toute autre. Le passage de l’oral à l’écrit et donc de l’éphémère au pérenne, puisque « les paroles s’envolent et les écrits restent » comme le veut le proverbe, est surtout pour l’historien le passage de ce qu’il ne peut ni saisir ni étudier à un support-source analysable et critiquable. Les hommes politiques ont pour coutume de faire publier leurs discours afin qu’ils restent et demeurent des monuments de l’histoire politique. N’est-ce finalement pas à une de leur propre volonté, fusse-t-elle secrète ou inavouée, qu’a répondu Jean Garrigues en 2004 en publiant Les grands discours parlementaires de la Troisième République et auquel quelques-uns ont reproché de ne pas mettre en lumière la notion de débat et considérant le discours comme « une forme édulcorée de la joute parlementaire ».12 Certes le discours n’est pas le débat, mais le discours construit et provoque débat ; le discours est à considérer comme une pierre angulaire dans la politique française de la Troisième République, c’est en tout cas ainsi qu’il est perçu par les hommes politiques « fin de siècle » influencés par la politique révolutionnaire, post-révolutionnaire et quarante-huitarde. Aussi, les hommes politiques de la Troisième République n’ont pas attendu Jean Garrigues pour que soient publiés leurs discours. Ainsi, nombre de discours de Georges Clemenceau, qu’ils aient été prononcés au sein des chambres parlementaires (comme celui sur les affaires du Tonkin du 27 novembre 1884 ou celui sur l’antipatriotisme le 22 juillet 1917) ou en province lors d’occasion particulières (tel le discours prononcé à Amiens le 6 octobre 1907 lors
7 Idem., p. 24. 8 Idem., p. 37. 9 Idem., p. 39. 10 Idem., p. 43. 11 Idem., p. 45. 12 Éric Thiers, note de lecture parue in Mil neuf cent, n°24, 2006, pp.207-208.
de l’inauguration du monument à la mémoire de René Goblet), ont été publiés quelques mois après avoir été lus et prononcés.
Néanmoins, Léon Bourgeois ne fait pas publier un discours plus particulièrement mais plusieurs dans la volonté de dresser une sorte de synthèse fidèle de sa pensée et de sa politique. Dès lors, la pratique est nettement moins courante. Les anthologies sont souvent posthumes et émanent d’une tierce volonté, comme pour les Discours de guerre de Clemenceau publiés sous l’égide de la Société des Amis de Clemenceau en 1935 (soit 6 ans après la mort du Tigre) ou les discours et interventions à la Chambre des Députés de Pierre Forgeot rassemblés sous le titre de Sa pensée politique par une proche parente en 1975, près de vingt ans après le décès de l’ancien ministre des Travaux publics. En 1913, Léon Bourgeois est bel et bien vivant, est extrêmement actif dans la politique française et loin de lui l’idée de prendre une quelconque retraite ; dès lors le processus de passage du discours au livre de synthèse pose question. Cette publication ne peut alors pas être considérée comme un testament politique, ni comme des mémoires et en cela il s’écarte de la figure de Joseph Caillaux et de ses Mémoires13 qui bien que posthumes ont été rédigées avant 1944, ni comme des documents privés rendus publics par la volonté d’un éditeur comme ce fut le cas pour Gabriel Hanotaux et ses Carnets14. Il s’agit donc d’une pierre supplémentaire posée à l’édifice de la pensée politique de leur auteur, et la démarche est alors bien plus singulière même si elle n’est pas unique puisque Charles Floquet (1828-1896), député de la Seine (1876-1882 et 1889-1893), député des Pyrénées-Orientales (1882-1889) fait publier en 1885 ses Discours et opinions.15 Il est intéressant de noter que Léon Bourgeois accède à son premier poste ministériel sous la direction de ce même Charles Floquet, alors président du Conseil et ministre de l’Intérieur. Léon Bourgeois devient en effet le 19 mai 1888, un mois et demi après l’entrée en fonction du cabinet Floquet, sous-secrétaire d’État à la Présidence du Conseil et à l’Intérieur. En ce sens, Léon Bourgeois est alors le plus proche collaborateur du président du Conseil et ministre, et il n’est pas à mettre en doute que Charles Floquet, l’aîné de Léon Bourgeois et en quelque sorte le parrain en politique ministérielle, ait eu une influence sur la politique de Léon Bourgeois bien sûr, mais surtout sur la manière de voir, de penser, de réfléchir et de vivre la politique. Si nous devions chercher un modèle dans la démarche de Léon Bourgeois nous pourrions sans doute dire avec assurance que celui-ci est à chercher auprès de Charles Floquet.
Ainsi, la pratique de Léon Bourgeois est loin d’être inédite, néanmoins elle n’est pas parmi les plus couramment utilisées par les hommes politiques pour synthétiser leurs pensées et leur politique, eux qui préfèrent et de loin écrire des traités, des essais et autres livres de philosophie politique. C’est donc à travers ses discours, reflets de sa pensée et témoins de son action que Léon Bourgeois invite le lecteur à quelques réflexions ayant trait à la solidarité entre les hommes, membres de l’association humaine. En ce sens nous sommes en mesure de considérer ce passage à l’acte comme une volonté réelle de synthèse de l’œuvre de Léon Bourgeois, dans une vision solidariste. Quels sont donc les rapports entretenus entre la philosophie première et les messages véhiculés par Léon Bourgeois dans ses discours ?
La cote J 1110, La politique de la prévoyance sociale (1913-1919) et
Solidarité (1896) : un projet de synthèse avorté ?
Se poser la question, c’est en quelque sorte y donner une réponse. En effet, les notes manuscrites sont en ce sens assez claires, puisque Léon Bourgeois dresse la liste de l’ensemble des discours qu’il a eu à prononcer et qui ont pour lui un sens primordial, voire patrimonial, ou une importance suffisamment notable à ses yeux pour pouvoir constituer un reflet fidèle de sa pensée
13 Joseph Caillaux, Mes Mémoires, 1 – Ma jeunesse orgueilleuse (1865-1909) ; 2 – Mes audaces. Agadir… (1909-1912) ; 3 – Clairvoyance et force d’âme dans les épreuves (1912-1930), Paris, Plon, 1947. 14 Gabriel Hanotaux, Carnets 1907-1925, Paris, Pédone, 1982. 15 Pierre Forgeot, Sa pensée politique, Paris, Ateliers Henri-Georges Joli, 1975, 367 pages.
politique et sociale. Or, les différences entre les listes autographes et la publication effectuée par l’éditeur Fasquelle sont d’importance et utiles à analyser.
Les brouillons présentent deux cent trois discours répartis dans différentes rubriques. Le plan du futur ouvrage de synthèse est soigneusement consigné sur le premier feuillet et se retrouve aisément dans les listes de discours qui comportent toutes un titre.
Figure 1. feuillet 1 - cote J 1110 - AD Marne.
Ce plan est très proche de celui adopté dans l’édition Fasquelle, et nous pouvons considérer qu’il s’agit du dernier plan préparatoire prévu par Léon Bourgeois lui-même. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse du premier plan envisagé par Léon Bourgeois pour dresser une synthèse de ses opinions, pensées et actions politiques en terme de vie sociale, d’harmonisation des relations inévitables et nécessaires pour gérer l’association humaine. Dans les éditions Fasquelle, voici le plan développé :
1. La Doctrine et la Méthode 2. Les moyens de lutte contre les maux sociaux * L’éducation * Les initiatives privées 1- La coopération 2- La Mutualité * L’action de l’État 3. L’Action A – L’enfance B – L’habitation C – Les maladies évitables
1- L’alcoolisme 2- La tuberculose D – Le travail 1- Hygiène du travail 2- Le chômage E – L’invalidité et la vieillesse
La différence entre les deux plans est assez nette. D’une part la présence d’une sous partie concernant l’alcoolisme n’est plus mise en doute, elle est bel et bien présente dans la publication. D’autre part la sous partie sur les anormaux passe dans une catégorie intitulée « l’enfance » dans laquelle la mortalité infantile disparaît totalement et qui ne laisse qu’une petite place (1/3) à l’assistance à l’enfance. Sur ces seuls thèmes Léon Bourgeois avait recensé cinq discours, trois seulement sont retenus dans la publication. Mais là ne se situe pas les seules coupes effectuées par Léon Bourgeois ou l’éditeur.
Il est, en effet, à noter que les cinq feuillets suivants de la cote J 1110 mettent en avant les discours purement politiques de Léon Bourgeois. Or, les quarante-huit discours sélectionnés par Léon Bourgeois pour donner une image fidèle de ce qu’il appelle ses « Vues politiques » n’intègrent pas la publication. Ainsi La politique de la prévoyance sociale est privée du volet politique de la question, volet politique pourtant considéré comme important par Léon Bourgeois lui-même puisqu’il a sélectionné quarante-huit discours sur ce thème ; ne trouvant d’ailleurs au moment de son brouillon que deux références ayant trait aux questions du chômage. Si nous poursuivons cette étude purement quantitative nous nous rendons compte que ce volet politique est par ailleurs parmi les plus importants pour Léon Bourgeois (quarante-huit occurrences), seulement précédé, très largement au demeurant, par les questions liées à l’enseignement ou à l’éducation (cent deux occurrences – elles mêmes subdivisées entre enseignement laïque, enseignement primaire, secondaire, supérieur, professionnel, artistique, féminin, des adultes…) et devançant très largement le thème des questions sociales en général (dix-sept occurrences), la coopération et la mutualité (neuf), la tuberculose (sept), le devoir social (sept), l’hygiène (six), les assurances et la retraite (cinq), l’éducation sociale (trois), la mortalité infantile (trois), le chômage, les taudis, les anormaux (deux chacun) et l’alcoolisme (seul le titre de cette section est indiqué et aucun discours n’y est mentionné).
Par ailleurs, il faut convenir que Léon Bourgeois ne met pas en avant deux cent trois discours, mais que nous possédons deux cent trois occurrences dont certaines sont récurrentes, telle la première mention concernant le chômage, qui est déclinée dans la publication puisque lors de la Conférence internationale sur le Chômage s’étant tenue à Paris entre le 18 et le 21 septembre 1910, Léon Bourgeois à l’honneur d’effectuer les discours d’ouverture et de clôture et y remet un rapport sur « le mal du chômage ». Cette première mention sur le brouillon est donc décliné trois fois dans La politique de la prévoyance sociale, tandis que la seconde (discours prononcés à Gand les 31 août et 1er septembre 1911) n’y figure pas. D’autre part, parmi les cent deux discours ayant un rapport avec l’éducation et l’enseignement aucun n’intègre les quatre discours constituant la sous partie intitulée « Éducation » du premier tome. La dernière mention est ajoutée a posteriori puisque datant de 1913. Les discours du 16 mai 1897, du 5 mai 1900 et du 30 octobre 1910 sont de leur côté retenus dans ses brouillons sous la mention « Éducation sociale », et ne sont mentionnés qu’une seule fois dans les brouillons de Léon Bourgeois ; par conséquent, aucun des discours inscrit dans les rubriques « Enseignement » et ses déclinaisons n’intègre la publication. Dès lors la part des discours publiés effectivement en guise de synthèse se réduisent à une partie infime de ce qui est jugé par Léon Bourgeois comme fondamental. Certes, nous ne pouvons nous laisser abuser par quelques données chiffrées et il faut remettre à sa juste place chacune des valeurs que nous indiquons. En effet, dans ses pages manuscrites, nous recensons deux cent trois occurrences, mais nous sommes loin de recenser un total de deux cent trois discours choisis par Léon Bourgeois puisque nous pouvons considérer que la prévision de la
publication s’appuie sur cent trente-deux discours différents, auxquels il faut ajouter les quinze prononcés après le mois d’octobre 1911. La politique de la prévoyance sociale permet la publication de quarante-huit discours accompagnés de deux conclusions, dont la première est également un discours. En ôtant les quinze discours postérieurs à octobre 1911, l’éditeur ne fait donc paraître que 16% des occurrences et qu’un quart des références.
Même s’il paraît évident que la publication de l’ensemble des contributions sélectionnées par Léon Bourgeois aurait été impossible sur le plan matériel et peut être tout simplement inutile et improductive sur le plan commercial, il n’en demeure pas moins vrai que nous devons, en tant qu’historien, nous interroger sur cette inévitable opération.
Léon Bourgeois n’est donc pas parvenu à ses fins, il n’a pu réellement dresser une synthèse complète de son œuvre, de son action et de sa pensée en matière de politique sociale, mais que reste-t-il de son écrit de référence, à savoir Solidarité dans les discours choisis pour figurer dans La politique de la prévoyance sociale et dans les discours non sélectionnés pour la parution ?
Il est sans doute à retenir de cette tentative de synthèse, l’envie de Léon Bourgeois de mettre l’accent non pas sur la méthode et la doctrine mais sur les moyens de lutte contre les maux sociaux et les actions possibles. Ainsi, à comparer Solidarité et La politique de la prévoyance sociale nous pouvons dire sans ambages que le premier constitue le socle théorique permettant les travaux pratiques illustrés ou souhaités et espérés parus dans le second volet.
Néanmoins, il est des thèmes qui prennent une acuité toute particulière au regard de l’expérience politique et personnelle de Léon Bourgeois. Parmi ceux-ci, nous en retiendrons trois pour exemple. Le premier concerne la place et le rôle laissés à l’État par la pensée solidariste et l’application pratique de cette doctrine. Le deuxième est la place accordée à l’éducation. Le troisième est contenu dans la « nécessaire égalité des peines et des avantages »16, socle de la « condition morale d’une juste association humaine »17, confrontée à la réelle inégalité engendrée de fait par des maux, non pas sociaux, mais médicaux, telle que la tuberculose.
Ainsi, la part laissée à l’État dans la philosophie solidariste se réduit à très peu de choses, puisque pour Léon Bourgeois, « l’État est une création des hommes : le droit supérieur de l’État sur les hommes ne peut donc exister. »18 Il dit aussi qu’ « aucune puissance extérieure, aucune autorité, politique ou sociale, État ou société, ne peut intervenir autrement que pour reconnaître les conditions naturelles de [la] répartition »19 des charges et des avantages. Dès lors la pensée solidariste laisse une faible place à l’État et condamne de fait au nom des libertés individuelles la vision socialiste de l’État. Néanmoins, il apparaît à la lecture des discours de Léon Bourgeois que celui-ci donne à l’État une liberté d’action nécessaire pour lutter contre les maux sociaux et notamment grâce aux travaux du ministère du Travail et de la prévoyance sociale. Nous ne devons pas être dupes sur cette mise en avant de ce ministère créé sous l’impulsion de la théorie solidariste comme l’a souligné Isabelle Moret-Lespinet dans son intervention « La création du ministère du Travail » au cours du colloque s’étant tenu au palais du Luxembourg à Paris au mois de mai 2006 intitulé Les questions sociales au Parlement, et ce d’autant plus que Léon Bourgeois a détenu le fauteuil principal de ce ministère. Ainsi la théorie est assez loin de la pratique exercée par Léon Bourgeois lui-même, mais les théories ne sont-elles pas là pour être éprouvées et testées en grandeur nature, les lois ne sont-elles pas faites pour être outrepassées. Dès lors, la théorie solidariste n’est pas à prendre au pied de lettre, peut-être même n’est-ce qu’une vision idéale de la société au même titre que l’était La Cité idéale de Platon.
Ensuite, l’éducation et l’enseignement sont des axes primordiaux aux yeux de Léon Bourgeois pour mener à bien le projet solidarsite, or aucune mention n’y est faite dans la théorie solidariste, à peine sont-ils sous-entendus quand il affirme que l’homme naît débiteur de
16 Léon Bourgeois, op. cit., p. 36. 17 Ibidem. 18 Op. cit., p. 35. 19 Ibid., p. 53.
l’association humaine et qu’il est redevable vis-à-vis de son hérédité et de la société puisqu’il est le récipiendaire de tous les progrès jusque là accomplis, des institutions, des arts et lettres, etc. En effet si la dette est innée, le reste ne l’est pas et relève non pas de la nature mais bien de la culture, celle-ci étant dispensée par l’intermédiaire de l’enseignement et de l’éducation. Donc, dans Solidarité, Léon Bourgeois ne fait pas mention de ces aspects, mais ils sont bien évidemment sous-entendus, implicitement présents. Dès lors, les discours sont là pour passer de l’implicite à l’explicite. Néanmoins il est très étonnant que Léon Bourgeois n’ait pu insister auprès de l’éditeur pour insérer cette vision dans le recueil de discours publié à partir de 1913. Dès lors, il semble que la tentative de synthèse échoue véritablement et que l’écueil de l’enseignement et de l’éducation soit le plus important entre tous. Nous pouvons néanmoins soulever une hypothèse à laquelle nous n’avons à ce jour de réponse : il est possible que Léon Bourgeois ait alors envisagé de faire paraître un autre volume pour parachever son œuvre, mais aucune trace n’existe, en dehors des feuillets manuscrits de la cote J 1110 sur cet aspect. Enfin, il convient de mettre en lumière la question de l’objectivité de Léon Bourgeois sur les questions d’enseignement et d’éducation. Il est fort probable que la vision de Léon Bourgeois soit là encore biaisée par son rôle au ministère de l’Instruction publique, même s’il n’en demeure pas moins vrai que l’ensemble de ces théories éducatives s’appuient sur la théorie solidariste.
Enfin, il faut reconnaître qu’en dehors des expériences politiques, les expériences personnelles de Léon Bourgeois guident son action et sa théorie solidariste. Ainsi il en va de sa lutte inconditionnelle menée contre les maladies évitables et lorsqu’il insiste sur l’alcoolisme (1 occurrence dans la publication) et sur la tuberculose (8 occurrences). Son combat contre la seconde est fondamental pour comprendre l’œuvre et la vie de Léon Bourgeois. Il ne faut pas oublier que Léon Bourgeois perd en quelques mois, entre 1902 et 1903, sa femme Marguerite Virginie et sa fille Hélène à cause de ce mal. Bien loin d’une vision claire et sereine de la situation sociale telle que celle dont il fait preuve dans Solidarité, Léon Bourgeois par la publication de La politique de la prévoyance sociale fait montre d’une action politique et sociale emprunte de sentiments de révolte, compréhensible d’un point de vue purement humain mais qui échappe à la raison politique ou à la raison d’État. Certes, le combat contre la tuberculose est un combat juste, justifié et justifiable, mais il n’est en rien un point essentiel et nécessaire pour permettre l’équilibre de l’association humaine, elle-même battue en brèche par des maux plus importants encore. La place accordée à cette question dans la publication est purement et simplement démesurée puisque la tuberculose constitue près de 17% des discours publiés, alors que l’alcoolisme n’en représente que 2%, l’éducation sociale 8%.
Dès lors, la synthèse sans doute voulue par Léon Bourgeois ne voit pas le jour sous les presses de l’éditeur Fasquelle en 1913, puisque l’ensemble de la vision solidariste et des applications solidaristes dans la société française de la Belle Époque n’est pas présent dans ce recueil de discours. Les éléments personnels interfèrent sans doute beaucoup trop pour dresser une synthèse globale et détachée.
CONCLUSION Il est à noter que le congrès de l’Alliance d’Hygiène sociale d’octobre 1926 (soit un an
après le décès de Léon Bourgeois) s’est tenu à Reims, non loin de son fief électoral dans son département d’adoption. Cette décision rend hommage à la personne de Léon Bourgeois, politicien hautement préoccupé par les questions sociales, qui toute sa vie durant fit de ses discours sur le sujet des armes de lutte et des moyens d’action. Aussi, il n’est pas étonnant de voir paraître une partie de ses discours prononcés sur le thème. Ils montrent les moyens de mise en œuvre d’une théorie politique : le solidarisme explicité dans l’ouvrage de référence de Léon Bourgeois Solidarité. Mais bien plus qu’une mise en lumière rhétorique, au-delà de l’énonciation de pistes de réflexion sur la réalité solidariste, Léon Bourgeois par la publication d’une partie de ces discours nous permet de mesurer l’évolution même de la théorie au regard des réalités du terrain. Aussi basique que soit la conception du solidarisme, celle-ci s’enrichit de la réflexion personnelle et permanente de Léon Bourgeois qui s’enrichit lui-même des expériences de sa vie personnelle et
des propositions et travaux de certains de ses confrères, qu’ils soient politiciens ou membres des associations de mutualité, de secours mutuels ou de prévoyance. Finalement l’œuvre de synthèse voulue par Léon Bourgeois ne voit pas le jour, mais au-delà de cet échec patenté, il nous faut retenir que les travaux pratiques mis en lumière dans La politique de la prévoyance sociale explicitent et traduisent dans la réalité des faits les thèses théoriques énoncées dans Solidarité. Et tous ces éléments conduisent à s’interroger sur la postérité de la pensée solidariste dans les politiques sociales récentes de nombre de démocraties.