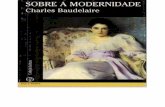Adraha (Deraa) romaine et byzantine : développement urbain et monuments
Développement, créativité et création collective: parallèles entre la pensée de François...
Transcript of Développement, créativité et création collective: parallèles entre la pensée de François...
1
Développement, créativité et création collective: parallèles entre la pensée de François Perroux et celle de Celso Furtadoi
Gustavo Britto (Cedeplar/UFMG)
Alexandre Mendes Cunha (Cedeplar/UFMG)
I. Introduction
Malgré sa contribution indéniable majeure en économie du développement,
François Perroux ne figure pas dans le club exclusif des auteurs classiques de la théorie
de l’économie du développement. Son œuvre extensive n’est pour ainsi dire pas
mentionnée dans les références principales de ce champ, durant la deuxième moitié du
XX siècle.
Perroux, tout comme Gunnar Myrdal et Alfred Hirschman ne figurent pas dans
la collection d’articles et de contributions originales intitulée « The Economics of
underdevelopment », organisée par Agarwala et Singh, dans les années soixante. Plus
notable encore est le manque total d’attention donné à l’auteur par Gerald Meier dans
Pioneers in Development [1984] et dans Biography of a Subject: An Evolution of
Development Economics [2005], où sont abordés des thèmes comme la croissance et le
développement, la culture, le capital social, les institutions, le commerce et les impacts
de la mondialisation.
Cette tendance s’inverse quand il s’agit d’économie régionale et urbaine où
Perroux est une référence constante pour les économistes régionaux qui placent son pôle
de développement à la base de l’échelle de la connaissance [Higgins, B. (1988)].
Cette interprétation anglocentriste pourrait même s’étendre à l’ensemble du
domaine économique, vu que le reste de l’Europe, les Amériques et bien d’autres
endroits encore ne sont pas restés insensibles à cette vision de plus en plus étroite de la
profession sous sa forme traditionnelle.
2
Mais le malentendu qui persiste sur les concepts les plus connus de Perroux est
encore plus important en économie régionale. Les concepts de pôles de développement
et de croissance, par exemple, font partie d’une théorie plus générale à laquelle l’auteur
consacra ses efforts, comme l’expriment clairement ses derniers écrits:
(…)[T]he concept of pole of development cannot be considered in isolation from the general theoretical interpretation to which it belongs. On the contrary, it is an integral part of the analysis of development, as distinct from growth [Perroux, F. (1988), p.50].
Ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres du manque d’intérêt notable pour le
travail de Perroux aux débuts de l’économie du développement. Cette négligence
entraîna d’importantes conséquences dans le domaine. D’un côté, elle cache l’influence
majeure qu’eurent ses idées sur nombre d’auteurs connus. De l’autre, étant donné
l’originalité de sa quête d’un nouveau concept de développement, cette négligence nuit
au débat contemporain sur les nouvelles lignes de recherche visant à élargir les horizons
de l’économie de développement en particulier et de la théorie économique en général.
L’objectif de cet article est donc de rendre à François Perroux sa véritable
dimension en proposant une lecture exploratoire de Celso Furtado, auteur qui fait
exception à la règle mentionnée ci-dessus. En effet, l’œuvre de Furtado sur les
mécanismes internes des systèmes économiques, le sous-développement et la possibilité
d’instaurer le développement révèle des points de convergence et, dans certains cas,
l’influence de Perroux.
Furtado reconnut d’ailleurs ouvertement l’influence de Perroux. Le parallélisme
de leur parcours intellectuel et des thèmes abordés indique bien la portée de cette
influence. Cependant, le style écrit de Furtado, ainsi que son référencement
parcimonieux des normes modernes rend ce travail plus ardu. Malgré cette difficulté,
nous croyons néanmoins que leur comparaison permet de poursuivre des recherches
3
fécondes. Ce chapitre analyse deux domaines qui montrent une remarquable
convergence entre les deux auteurs.
Le premier domaine concerne quelques concepts et idées partagés par les
auteurs, tels le concept et les dynamiques du développement. La manière dont ils
définissent le développement présente des similitudes. En effet, leur œuvre défie en
théorie économique, impute les conditions du sous-développement aux dynamiques du
système économique en général et souligne le besoin de changer les structures
économiques et sociales pour activer les processus de développement et de croissance.
Le second domaine se définit par l’amplitude du champ d’étude qu’ils décrivent
dans leur poursuite d’une compréhension originale du système économique et des
déterminants des dynamiques de développement et de croissance, ainsi que dans leur
refus d’analyser la réalité socio-économique en se confinant à la théorie économique en
vigueur. Leurs analyses introduisent toujours des concepts issus d’autres domaines afin
d’améliorer et de perfectionner le concept de développement qui, dans les deux cas,
aboutit à une discussion sur la créativité et sur la culture.
II. Développement, Sous-développement et Croissance
Leur premier terrain de convergence concerne le concept de développement lui-
même. Cette perception peut, à première vue, paraître évidente mais elle révèle une
vision plus large qui permettra de rapprocher et de préciser d’autres concepts et idées.
Dans L’économie du XXème siècle, Perroux définit le développement comme “la
combinaison de changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à
faire croître, cumulativement et durablement, son produit réel global” [Perroux, F.
(1964a), p. 158)]. Cette définition ressemble à celle d’autres auteurs, y compris celle
4
de Furtado sur l’augmentation de la production nationale d’un pays. C’est pourquoi les
premiers théoriciens du développement dédièrent temps et énergie à des questions
comme la productivité et le gain de productivité.
Perroux abordait aussi des thèmes qui étaient et, jusqu’à un certain point, sont
encore, en marge de l’économie. Pour plusieurs raisons, souvent d’ordre pragmatique,
la plupart des théoriciens du développement se concentraient sur des variables
économiques. Les préoccupations liées à l’urgence d’élever le taux de croissance de la
production au-dessus de celui de la population dans les pays à très bas revenus, ainsi
que la nécessité de construire des indicateurs à partir de données restreintes ne laissaient
pas beaucoup de manœuvre à ces pionniers.
Perroux, lui, choisit un chemin plus tortueux qui le mena à d’autres types de
facteurs. Cela peut s’expliquer par sa compréhension précoce de la croissance qui
implique toujours un développement pouvant être interprété comme un processus
permanent et possible pour n’importe quel pays, à n’importe quelle époque, quel que
soit son niveau de production.ii
La différence entre les deux processus devient claire quand Perroux décrit le
processus de développement en termes strictement économiques [Perroux, F. [1983], p.
33-34]. Pour lui, cela implique trois niveaux. Le premier concerne la création, dans un
pays donné, de réseaux d’agents (entreprises, industries, régions) dont les liens se
resserrent de plus en plus. Le deuxième concerne l’intensification des interactions entre
secteurs et la réorganisation résultant des actions et rétroactions. Le troisième tient à
l’amélioration de l’efficience et de la qualité des ressources humaines, avec comme
corollaire des produits plus sophistiqués.
Soit par manque de flux économiques, soit à cause d’un système de transport
déficient, le sous-développement empêche que les différentes parties de l’économie se
5
relient entre elles. Ceci provoque des économies enclavées, un manque d’interaction
entre secteur et agents, doublé d’une asymétrie des relations économiques extérieures
qui tend à être déterminée unilatéralement, ainsi qu’une mauvaise utilisation des
ressources humaines.
Par conséquence, l’augmentation en termes absolus des parties existantes et des
agents, dans une économie déconnectée des variations d’une ou de plusieurs
caractéristiques mentionnées ci-dessus, exemplifie bien la distinction entre croissance et
développement. Dans le cadre de cet article, une telle différenciation est cruciale car
elle expose à la fois le développement parallèle de la pensée des deux auteurs autour
d’un même axe (développement/sous-développement) et la possible pollinisation
croisée des idées, de Perroux à Furtado, à la fin des années soixante et au début des
années soixante-dix.
La distinction entre croissance et développement est aussi une marque
constitutive de l’œuvre de Furtado. Celui-ci utilise d’abord la dialectique entre
développement et sous-développement. Toutefois, comme les cycles de croissance et
d’industrialisation ne réussirent pas à vaincre le sous-développement en Amérique
Latine, l’auteur élargit ses horizons en repoussant les limites de la théorie économique.
En termes conceptuels, trois domaines sont particulièrement intéressants.
Premièrement, la dynamique du développement doit être appréhendée dans le cadre
élargi du fonctionnement des systèmes économiques. Le besoin d’une analyse
systémique repousse constamment les auteurs en dehors des limites de la théorie
économique traditionnelle. Aussi, le débat concernant le développement et le sous-
développement part d’une tentative plus audacieuse de dévoiler les mécanismes internes
des systèmes économiques.
6
Deuxièmement, cette vision élargie renvoie à un autre concept du sous-
développement, conséquence du fonctionnement des systèmes économiques et non
stade temporaire vers le développement ou ensemble hétéroclite de caractéristiques
définissant un cas particulier. Autrement dit, des niveaux de développement plus élevés
peuvent coexister indéfiniment avec des niveaux plus bas.iii
Troisièmement, le concept de structure, intimement lié aux deux points
précédents, semble essentiel pour saisir la dynamique du développement - en opposition
à la croissance. La structure économique reflète le niveau de développement d’un pays
et détermine aussi ses possibilités à y accéder. Le processus de développement est donc
le processus de changement structurel lui-même.
Les dynamiques du développement et du sous-développement et la pertinence
des structures socio-économiques sont imbriquées chez ces deux auteurs. Pour Perroux,
l’impossibilité d’utiliser la théorie économique traditionnelle pour décrire la dynamique
des systèmes économiques fait évoluer la théorie générale de l’économie. Dans cette
théorie, le concept de dominance est un point central de sa perception selon laquelle les
relations socio-économiques sont essentiellement asymétriques et irréversibles. Compte
tenu de cela, les marchés ne fonctionnent pas dans un régime de concurrence parfaite
présentant une homogénéité technologique et informationnelle, et les degrés de
puissance des agents économiques demeurent particulièrement variables.
C’est dans ce contexte que surgirent les concepts d’entreprise, de secteur et
d’économie dominants. Les relations économiques les régissant sont principalement de
nature asymétrique et cette asymétrie se reproduit entre pays qui dépendent de leur
propre capacité à innover [Perroux, F. (1964a)].
Comme les activités économiques se matérialisent dans l’espace, le processus de
croissance et de développement, encouragé par les agents dominants, est à l’origine des
7
concepts de pôles de croissance et de développement. Le premier pouvant induire une
augmentation quantitative de la production dans d’autres secteurs et le dernier une
amélioration qualitative.
Les entreprises actives lancent en permanence des événements pouvant conduire
à des changements durables dans le système économique. Leur connaissance permet la
coercition, c’est-à-dire qu’un agent peut essayer de changer le système économique en
imposant sa dominance. Cette perception est primordiale en ceci qu’elle conduit à
l’idée de macrodécisions. Les unités dominantes, l’État par exemple, peuvent anticiper
les effets de la coercition et l’utiliser à discrétion pour aligner l’action de groupes
d’agents qui, autrement, seraient incompatibles avec elles.
Dans un sens, les macrodécisions correspondent à la planification chez les
pionniers de l’économie du développement car elles impliquent une interférence avec le
système économique. Toutefois, le concept de macrodécision est plus difficile à
appliquer par les groupes d’agents dominants, tels que les industries, les secteurs, les
nations ou les fractions de nations [Perroux (1964a)].
Furtado part aussi d’une critique de la théorie économique traditionnelle.
Premièrement, il la critique à cause de son échec à rendre compte de la dynamique du
sous-développement.
Initialement, l’auteur travaille avec le même concept de développement que les
pionniers du développement économique. Pour ceux-ci, le développement s’assimilait
largement à une production de gains, associée à une accumulation du capital. La
méthode analytique historico-structurelle utilisée par Furtado donne une bien meilleure
idée du sous-développement. Étant donné que les nouvelles techniques de production
utilisant l’accumulation du capital sont, en réalité, introduites dans des structures
économiques préexistantes, le rôle principal de la théorie du développement est
8
d’analyser les impacts de l’introduction de nouvelles méthodes de production et leurs
répercussions en termes de gains de productivité, de modes de distribution et de résultat
social.
Furtado passe ensuite à une analyse historique pour expliquer comment les
diverses structures économiques ont surgi de l’expansion du capitalisme après la
révolution industrielle. Il distingue trois phases : la première, celle de la dissémination
des nouvelles méthodes de production en Europe de l’Est ; la deuxième, leur
élargissement aux colonies de climat tempéré à travers le commerce international ; dans
la troisième, les technologies créées par cette révolution atteignent des régions à forte
population où un système précapitaliste était déjà établi même s’il n’était
qu’instrumental à la structure capitaliste.
Cette distinction est cruciale à ses concepts de développement et de sous-
développement. Pour lui, ces phases définissent le type d’impact exercé par les
nouvelles techniques de production sur l’économie locale, ainsi que sa profondeur.
Plus encore, elles définissent la relation entre les gains de productivité associés au
processus de développement et le processus du changement technologique lui-même.
La déconnection entre la structure économique d’un pays et le processus de création
technologique génère des structures hybrides où des méthodes de production archaïques
et modernes coexistent.
Cette importation de nouvelles technologies et machinerie permit donc de
nouvelles combinaisons de facteurs de production. La hausse des revenus en découlant
se concentra dans le secteur commercial, ce qui créa un surplus économique croissant
pouvant servir à augmenter, non seulement le processus d’accumulation, mais aussi le
niveau de concentration des revenus.
9
La dynamique de croissance n’est donc jamais conventionnelle dans les pays
sous-développés. Dans les pays développés qui suivirent les processus décrits dans les
deux premières phases, les gains de productivité associés à l’accumulation du capital
conduisirent à un processus cumulatif de croissance des revenus, des profits et des
salaires (en fonction de la demande), dirigeant les ressources vers de nouveaux
investissements. Dans les pays sous-développés, où les revenus sont concentrés entre
les mains de groupes restreints, les salaires continuent à stagner et le processus
d’accumulation du capital diminue. La cadence du développement est donc liée à la
distribution fonctionnelle des revenus.
Aussi, pour Furtado, un pays développé est un pays où le plein emploi peut être
atteint avec la pleine utilisation des facteurs. Dans ce cas, la croissance économique,
tout comme les gains de productivité sont indissociables du processus d’introduction de
nouvelles techniques de production. Dans une économie sous-développée, au contraire,
les facteurs sont constamment sous-employés. Une basse productivité peut résulter ou
d’une inadéquation entre le capital et le travail ou, plus fréquemment, du manque relatif
de capital. Aussi, le processus de croissance économique est associé à un chômage
structurel, caractéristique des pays sous-développés.
III. Créativité, Création Collective et Culture
La partie antérieure établit quelques liens entre le concept de développement de
Perroux, dans le cadre de sa théorie de la domination, et la perspective de Furtado avec
ses idées concernant le sous-développement, l’hétérogénéité sociale et la planification.
Leurs travaux sur ces thèmes ont été publiés dans les années 1950 et 1960.
10
C’est au début des années 1970 qu’une nouvelle dimension apparaît dans leur
réflexion avec la question de la créativité, prise au sens large, qu’ils introduisent dans
leur argumentation de base sur les conceptions du développement. Chez Furtado, ce
nouvel ensemble d’idées prend définitivement forme en 1978, avec la publication de
Créativité et Dépendance. Malgré la cohérence des thèmes abordés par l’auteur durant
tout son travail, son argumentation sur le sous-développement prend, à cette époque, un
tournant décisif et osé avec l’inclusion des dimensions de culture et de créativité. Dans
ces derniers écrits, Furtado suggéra qu’un type de linéarité post facto soit adopté pour
lire son œuvre, mais nous avons pu observer qu’au début des années 1970, l’auteur,
ayant atteint les limites de son cadre théorique, se sentit obligé de franchir un pas plus
audacieux pour élargir son champ d’analyse.
Perroux, quant à lui, ne repositionna pas sa réflexion sur le développement
durant cette période. En fait, les principes de son argumentation concernant le
phénomène de développement étaient déjà présents dans son énonciation du problème
dès les années 1960. Il est cependant visible que, tout comme Furtado, Perroux s’ouvra
délibérément aux thèmes de la créativité et de la culture.
C’est cette similarité des thèmes concernant la compréhension des dynamiques
des systèmes économiques qui nous permet d’établir un lien entre eux, même si leurs
trajectoires restent autonomes. Notre argumentation cherche à montrer que Furtado,
ancien étudiant de Perroux et son lecteur assidu, s’inspira de ce dernier pour recentrer
son cadre théorique et que, dans les années 1970, son travail était fortement lié à
l’environnement intellectuel français, l’approche analytique et le style bien particuliers
de Créativité et Dépendance en sont une preuve excellente.
Même si Furtado fait peu de références explicites à l’œuvre de Perroux, il
reconnaît néanmoins son influence décisive dans son travail autobiographique et dans
11
un texte préparé pour la sixième Conférence François Perroux, tenue au Collège de
France en 1994, où il place l’influence de Perroux au même niveau que celle de Raul
Prebish.
Effectivement, Furtado cite peu Perroux. Quelques références apparaissent dans
Théorie du développement économique (1970), un de ses principaux livres, où il
mentionne comment Perroux percevait le processus de développement. Dans un article
plus analytique, portant principalement sur l’économie régionale, Furtado se réfère aussi
au concept de pôle de croissance développé par Perroux [Furtado, C. (1967)].
Dans un autre texte écrit en l’honneur de Perroux, en 1994, il est plus intéressant
d’observer ce que Furtado omet sur l’influence de Perroux plutôt que ce qu’il en dit. Il
lui attribue sa vision globale de l’économie, vision inclusive et non réductrice [Furtado,
C. (1994)]. Il ne mentionne cependant pas le rapport entre sa compréhension du rôle de
l’état et celle de Perroux, ce qu’il fera plus tard au cours d’un entretien [Furtado, C. in
Vieira, R. M. (2007), p. 420]. Le manque de références le plus étonnant concerne
toutefois le concept de créativité, point où leurs idées se rejoignent pourtant le plus.
Il est important ici de remarquer que le concept de développement mis en avant
par Perroux dans L’économie du XXème siècle inclut une autre ligne de raisonnement:
celle de la construction (ou production) des hommes par les hommes. Très tôt, ce
concept allait dépasser la question de la croissance de l’économie réelle et considérer les
changements sociaux et mentaux, indispensables au processus de développement
[Perroux, F. (1964a), p.157-8]. Perroux introduisit aussi la dynamique de création, qu’il
préfère au terme innovation dont il prend ses distances à cause de la compréhension très
individualiste de la dynamique d’innovation faite par Schumpeter.
Pour Perroux, l’idée de création collective était centrale. Dans L’économie du
XXème siècle, son approche de la question était plus étroitement liée à un raisonnement
12
économique et directement connectée à sa propre théorie de la domination. Il présente
l’aspect collectif de la création économique comme ce qui dépasse le simple cadre des
personnalités innovantes et peut être associé à la création collective de la réalité
économique, dans le contexte de la société industrielle moderne. Cela fait partie d’un
plan très complexe où les alliances politiques et administratives sont imbriquées et la
recherche scientifique organisée par l’État. Tous ses aspects sont essentiels pour
promouvoir et propager les innovations [Perroux (1964a), p. 650].
Perroux propose aussi un cadre élargi de l’analyse de la créativité en insistant
sur l’idée que la création collective appartient à l’imagination humaine. En dialoguant
avec les écrits de Gaston Bachelard, Perroux argumente que la création collective est la
pièce maîtresse de l’invention d’une vie nouvelle (“c’est-à-dire des types inédits
d’équilibre et de développements humains”) et un nouvel esprit (“c’est-à-dire des
nouvelles significations de la vie économique et un renouvellement de la notion
habituelle de vie ‘économique’”) [Perroux, F. (1964a), p. 651].
Cette vision particulière du développement et de la pensée économique crée des
mécanismes qui dépassent le cadre analytique de l’individualisme et se comprend
d’autant mieux que l’on sait que Perroux était un humaniste. Le cadre humaniste donne
tout son sens à sa vision globale de l’économie. D’intéressantes connections sont
possibles entre son œuvre et celle de Louis-Joseph Lebret. Ainsi, dans une notice
nécrologique faisant l’éloge de la « présence » de ce dernier, Perroux résume la devise
de sa propre vision humaniste de l’économie en décrivant l’héritage que Lebret lui a
laissé:
L’animateur d’Économie et Humanisme qui a su réunir et former des équipes nombreuses et ardentes, a été l’un des premiers à comprendre que l’économie de tout l’homme et de tous les hommes, c’est l’économie elle-même [Perroux, F. (1966), p. 459-60].
13
Néanmoins, ce n’est pas dans L’économie du XXème siècle que les thèmes de la
créativité et de la création collective atteindront leur position définitive. Quelques
années plus tard, en 1964, la publication de la seconde édition augmentée de
L’économie du XXème siècle, coïncide avec celle d’Industrie et création collective : I
Saint-simonisme du XXème siècle et création collective. Dans ce livre, Perroux présente
les idées de Saint-Simon, qu’il considère un auteur moderne, afin d’examiner la
question de la création collective. Il y propose une réflexion sur les “virtualités” des
questions dérivées du Saint-Simonisme, applicable au dernier tiers du vingtième siècle,
qu’il définit à partir du phénomène de l’industrialisation à l’ère atomique et spatiale.
Saint-Simon sert aussi de contrepoint à Perroux dans son appréciation de Marx.
Perroux note que, dès les Manuscrits de 1844, Marx expliquait l’idée de la « création de
l’homme par le travail humain » (ce qu’il développera ensuite dans toute son œuvre).
Chez Marx, néanmoins, cette perspective reliant la création de l’homme au travail tend
à exclure toute dimension divine [Perroux, F. (1965), p. 157].
L’idée de création chez Perroux va au-delà de la perspective marxiste et repose
sur la complexité et la multiplicité des possibles, contenus dans l’unicité irréductible de
chaque être humain. Aussi, apparaît un scénario où les hommes et l’humanité sont en
état de « création virtuelle », dans un mouvement créatif permanent. Dans cette
perspective, ni celui qui crée, ni celui qui reçoit le fruit de la création ne perdent leur
énergie en travaillant [Perroux, F. (1965), p. 164-5].
Perroux reprend constamment ici l’idée d’une dimension virtuelle, d’un futur
possible. Autrement dit, il s’intéresse aux « virtualités », à ce qui existe potentiellement
dans la réalité, ainsi qu’au contraste entre la réalité et l’approfondissement de ces
possibilités dans le futur. Il est important de mentionner, tout au moins de suggérer,
14
qu’en termes d’influences, cette perspective de travail avec les virtualités se rapproche
du cadre analytique et de la méthode d’Henri Lefebvre.
Perroux abandonna alors la question de la « production » de l’homme par
l’homme pour se dédier à la compréhension de la « création » de l’homme par l’homme.
Pour lui, il s’agit finalement d’une « reconnaissance » de l’homme par l’homme, à
travers leur humanité partagée, seule chose qui évoque le vrai progrès humain, en toute
liberté et conscience [Perroux, F. (1965), p. 183].
En 1964, Perroux publia aussi un article dont le titre et le contenu préfigurent la
thématique du prochain volume d’Industrie et Création Collective. Il y explore l’idée
d’un nouvel homme, à la fois réalité et virtualité. L’auteur part de la perception que
notre époque n’est pas seulement marquée par les créations collectives, mais qu’elle est
aussi animée par l’esprit de création collective. Il développe une réflexion spécifique
sur l’image de ce nouvel homme qu’il reprendra en détail dans son prochain livre à
différents niveaux d’analyse: l’homme et ses réalisations terrestres, l’homme du
progrès, l’homme planétaire.
Autrement dit, le point final est encore la réaffirmation de l’identité entre
création et liberté, et c’est précisément chez les artistes et les poètes qu’il puisera son
inspiration pour ce mouvement analytique, à travers les images les plus passionnantes
de la créativité artistique.
C’est en 1970, avec la publication du deuxième volume d’Industrie et création
collective: II - Images de l’homme nouveau et techniques collectives et celle
d’Aliénation et société industrielle, que les principaux arguments de Perroux concernant
la créativité et la création collective seront finalement présentés.
Dans le deuxième volume d’Industrie et création collective, Perroux continue à
explorer le phénomène de la créativité et de la création collective en se penchant sur les
15
questions qui sont pour lui les plus fondamentales de la deuxième moitié du 20e siècle,
en particulier celles concernant les techniques de recherche collective sur la production,
l’information et le rôle de l’Etat dans la société industrielle.
Dans ce texte, il est manifeste que Perroux incarne une vision bien particulière
du développement, pris comme développement collectif et partant d’un engagement
humaniste: “Dès qu’on n’accepte plus la destruction d’êtres humains, voisinant avec des
progrès ambigus et concentrés, on est engagé dans la voie de ce développement
collectif ” [Perroux, F. (1970b), p. 115].
Son argumentation générale demeure marquée par l’usage des ‘virtualités’, dans
l’intention de traiter la réalité actuelle pour la construction du monde de demain. Pour
l’auteur, la substance de la création collective est toujours l’homme lui-même et tous les
hommes, ce qui, dans son essence, mène à une création pleine de potentialités, de
« virtualités »: “Les hommes sont en état de création virtuelle: ils sont porteurs
d’images projetantes et désirantes sans cesse renouvelées, et de techniques rationnelles
qui en font des ouvrages et des œuvres” [Perroux, F. (1970b), p. 281].
Dans Aliénation et société industrielle, Perroux fait un pas essentiel. Il débute
ce livre par un dialogue avec Marx et une enquête sur les processus d’aliénation dans la
civilisation industrielle. Son objectif est de relier la création collective et l’aliénation
pour ensuite montrer qu’en rompant avec l’aliénation, on aboutirait à l’humanisation de
la société.
Les termes généraux construisant ce raisonnement sont: la création, située à
l’opposé de l’aliénation, l’auto-conscience, et la capacité de prendre des décisions
librement, condition nécessaire à une réelle humanisation [Perroux, F. (1970a), p. 121].
Il est particulièrement intéressant d’observer le parallèle que Perroux établit
entre la sortie de l’aliénation et l’éveil social : “La désaliénation intime et la
16
désaliénation sociale s’entre-conditionnent donc étroitement, comme la création
personnelle et la création collective. Le dialogue est le moyen privilégié de cette
création, parce qu’il désubjective sans chosifier, parce qu’il est une collaboration pour
l’éveil et l’autonomie réciproques, et parce qu’il est inépuisable comme la spontanéité
de l’esprit et comme les valeurs que l’esprit vise” [Perroux, F. (1970a), p. 124].
Le résultat de cet éveil social engendré par la sortie de l’aliénation serait
l’émancipation de l’homme de tous les automatismes sociaux. Pour Perroux, trois
« comportements typiques » se profilaient à l’horizon : 1) la destruction collective de
l’homme ; 2) la « fabrication » collective de l’homme ; et 3) la création collective de
l’homme. Il éclaire cette troisième perspective en disant que: “C’est bien l’invention et
la découverte de conditions favorables à la prise de conscience de soi et à la formation
de décisions autonomes par les hommes et par les groupes humains qui sont
revendiquées, en fin d’analyse, par tous les systèmes sociaux qui se forment à l’âge
industriel » [Perroux, F. (1970a), p. 132].
Pour mieux comprendre le dialogue sur la créativité entre Perroux et Furtado, on
doit rappeler que ce dernier n’adopte pas une perspective humaniste. Sans aucun doute,
avait-il une culture humaniste, principalement acquise par les contacts intellectuels qu’il
eut en France durant ses études. Cependant, ce point ne semble pas être celui qui relie
les deux auteurs. On ne peut que suggérer l’inclination humaniste de Furtado, tout en
sachant qu’elle ne constitue pas l’élément essentiel de son analyse. En outre, le
brésilien n’est en rien associé à la pensée religieuse, différent en ceci de Perroux.
Créativité et Dépendance, publié en 1978, illustre bien le chemin parcouru par
Furtado concernant les thèmes de la culture, de la créativité et de la création. Bernis y
voit un “détour productif, trop original et trop riche pour que je ne m’y arrête pas
maintenant. Se posant implicitement les questions : ‘pourquoi l’innovation ici et pas
17
ailleurs ?’, ‘pourquoi ce type d’innovation et pas un autre qui aurait donné un autre
cours à l’histoire ?’, il répond par une rupture totale et originale avec l’économisme,
introduisant au sein de l’économie le concept de ‘culture’ ” [Bernis, G. D. (1998), p.
64].
Dans la préface de l’édition originale de Créativité et Dépendance, Furtado
définit ce livre comme étant « anti-académique », s’intéressant à des problèmes trop
vastes pour tenir dans les éprouvettes des sciences sociales. Les chapitres deux et trois
de cet ouvrage constituent son épine dorsale (l’émergence et l’essor de la civilisation
industrielle : 1 et 2), comme Alfredo Bosi le souligne à juste titre [Bosi, A. (2008), p.
13]. Dans ces chapitres, Furtado analyse historiquement et structurellement le
processus qui, à long terme, déboucha sur le capitalisme industriel et l’hégémonie
bourgeoise européenne. On est ici au sein de l’idée de civilisation industrielle telle que
Furtado la conçoit. Le texte révèle aussi comment la diffusion de ce type de société
repose sur la propagation du modèle occidental d’industrialisation, même si, parfois, ce
processus a résulté d’un comportement réactif de la part de pays dont la souveraineté ou
la position géographique dominante étaient menacées.
C’est dans le deuxième chapitre, par exemple, que Furtado développe sa
perception de l’interrelation entre progrès et déshumanisation dans la civilisation
industrielle. Sans aucun doute, un rapprochement est ici à faire avec le cadre analytique
de Perroux.
Dans le quatrième chapitre et à travers une élaboration sophistiquée, Furtado
montre que les pays sous-développés ont remplacé l’idée de progrès par celle de
développement. Il se confronte aussi au problème d’une industrialisation qui, dans un
contexte de dépendance, ne constitue pas seulement une étape historique conduisant les
pays sous-développés à un processus de développement, mais qui ne garantit pas non
18
plus que ce processus conduise à des structures sociales stables. L’exemple principal
d’un tel processus est évidemment le Brésil, même si aucune référence explicite n’est
faite à ce sujet. Au lieu de la stabilité, Furtado décrit un scénario d’hétérogénéité
sociale croissante qui se reflète dans la marginalisation urbaine et l’instabilité politique
et ouvre la porte à un autoritarisme « préventif ».
Dans ce contexte, l’auteur dévoile les pièges idéologiques particulièrement
pertinents pour son pays et son époque véhiculant la fausse idée que l’autoritarisme, pris
comme instrument, peut favoriser l’accumulation rapide de biens. D’après lui, le
développement exprime la capacité à créer des solutions originales pour résoudre les
problèmes de société, et l’autoritarisme frustre le véritable développement en bloquant
les processus sociaux qui favorisent effectivement la créativité [Furtado, C. (1981)].
À partir du cinquième chapitre, Perroux se met à réfléchir sur le futur et les
possibilités de transformer la réalité actuelle. Son style analytique est proche de celui
de Perroux quand ce dernier traite des « virtualités » et tous deux adoptent une attitude
que l’on peut qualifier d’utopie réaliste. Le mot créativité devient dès lors le mot-clé et
l’argument se prolonge dans le chapitre suivant (Dépendance dans un monde unifié) où
l’interrelation entre la dépendance culturelle et la dépendance technologique est mise au
clair.
Après l’analyse introspective développée dans le septième chapitre, le chapitre
« À la recherche d’une vision globale » vient conclure le livre : il s’agit d’une
investigation philosophique motivée par la question de la liberté. Furtado y envisage
une myriade de possibilités de résistance à l’oppression que l’expansion planétaire de la
civilisation industrielle a imposée. Différentes formes d’organisation sociale et
d’activisme politique y sont envisagées et considérées comme les manifestations les
19
plus authentiques de la créativité. Ce chapitre est le plus original de cette œuvre déjà
peu conventionnelle.
C’est dans ce dernier chapitre que les idées de Furtado et de Perroux se
ressemblent le plus. L’influence de l’auteur français y est claire, d’une part dans la
conduite de l’argumentation d’« à la recherche d’une vision globale » (des années plus
tard, cela sera repris par le titre du texte que Furtado rédigea en l’honneur de Perroux),
d’autre part dans le contenu de l’argumentation qui relie la créativité et le vrai
développement que la liberté rend possible. Telle est la direction souhaitée par la
conclusion de ce chapitre et de ce livre : en insistant sur l’essence même de l’humain on
exprime, en fait, un désir de liberté [Furtado, C. (1983)].
Même s’il ne reconnaît pas explicitement l’influence exercée par Perroux sur ses
propres idées concernant la créativité et la culture, Furtado présente, dans “Retour à la
vision globale de Perroux et Prebisch”, quelques considérations, sans mentionner si
elles sont de lui ou de Perroux, qui l’aidèrent à élaborer son dialogue. Il identifie, par
exemple, le rapport entre l’idée de nouvelles valeurs culturelle et celle de
développement :
Dans sa double dimension de force génératrice de nouveaux excédents et d’impulsion créatrice de nouvelles valeurs culturelles, ce processus libérateur d’énergies humaines représente la dernière source de ce que nous considérons comme le développement [Furtado, C. (1994), p. 172].
Pareillement, Il établit un rapport entre la créativité et les potentialités multiples
et insondables de l’homme :
La merveilleuse gamme de cultures qui ont surgi sur la terre témoigne du fabuleux potentiel de créativité de l’homme. Si nous savons quelque chose du processus de créativité culturelle, c’est exactement ceci : le possibilité de l’homme sont insondable ; a des niveaux d’accumulation qui nous paraissent aujourd’hui extrêmement vas ont jailli des civilisations qui, sous de nombreux aspects, n’ont pas été dépassées [Furtado, C. (1994), p. 172].
20
Enfin, une intention avouée est ici émise clairement et directement, celle de
participer du même type d’utopie réaliste qui relie Perroux à la tradition humaniste
française.
IV. Considerations finales
Il existe, en fait, de nombreux points communs entre Furtado et Perroux
concernant leur perception des questions du développement, et leur vision non
conventionnelle de la pensée économique est de grande importance. Ils exprimèrent, à
plusieurs reprises, des réactions innovantes en réponse au réductionnisme du discours
économique. Derrière ce cadre d’influences réciproques, celle que Perroux exerce sur
Furtado est indéniable, mais on peut aussi identifier Perroux comme lecteur de son
ancien élève.
Un des liens fondamentaux qui les unit est aussi l’influence de Perroux
concernant la dynamique économique systémique et ses répercussions directes sur la
question du développement. Mais c’est surtout dans le champ de la créativité, de la
culture et de la création collective, comme nous espérons avoir su le montrer, que leur
connexion est importante et inédite.
Même si Furtado ne reconnaît pas explicitement l’influence générale de Perroux,
il porte en lui les leçons apprises à l’Université de Paris, tout en développant sa propre
originalité et autonomie. Leçons que Furtado n’eut de cesse de renouveler durant les
décennies suivantes, en lisant les livres de Perroux (que l’on peut trouver dans sa
bibliothèque personnelle), dont la marque est perceptible dans son économie créative
du développement.
21
L’analyse ci-dessus suggère donc que cet ordre du jour pour penser les questions
de développement, basé sur les contributions de Celso Furtado et François Perroux, est
toujours valable et chaque fois plus urgent, en particulier ce qui touche à la créativité et
à la culture.
i Nos sincères remerciements au soutien financier du CNPq (Conseil National de Développement Scientifique et Technologique) et de la FAPEMIG (Fondation d’appui à la Recherche de l’État de Minas Gerais). ii Le concept est semblable à celui de Schumpeter, même si, chez Perroux, sa dynamique est beaucoup plus complexe. Pour une discussion plus détaillée, voir Higgins (1989). iii Ici, Perroux et Furtado se distancient de Rosenstein-Rodan, Hirschman, et Lewis qui, fréquemment, analysaient séparément les régions développées des régions sous-développées.
Références
Agarwala, A. N., Sing, S. P. (ed.) [1958], The Economics of Underdevelopment. Oxford University Press, London.
Alcouffe, A. [2009], “Furtado, o Brasil e os economistas franceses: influências cruzadas” In: Coelho, F. S. and Granziera, R. G. (eds.), Celso Furtado e a Formação Econômica do Brasil (Edição Comemorativa dos 50 anos da publicação 1959-2009), Atlas, São Paulo.
Bernis, G. D. de [1998], “Furtado et l’économie mondiale”, Cahiers du Brésil Contemporain, n° 33-34, p. 59-67.
Bernis, G. D. de [2000], “François Perroux (1903-1987)” In: Arestis, P. and Sawyer, M. (eds.), A Biographical Dictionary of Dissenting Economists, 2nd edition, Edward Elgar, Northampton, MA.
Bosi, A. [2008]. “Prefácio - Celso Furtado: Rumo a uma visão holística” In Furtado, C. Criatividade Dependência na Civilização Industrial (Edição Definitiva), Companhia das Letras, São Paulo.
Cunha, A. M., Britto, G. [2011], “When Development meets Culture: the contribution of Celso Furtado in the 1970s”, Texto para discussão (Documents de travail), nº 429, Cedeplar/UFMG, Belo Horizonte.
Furtado, C. [1954], A economia brasileira, A Noite, Rio de Janeiro. Furtado, C. [1961], Desenvolvimento e subdesenvolvimento, Fundo de Cultura, Rio de
Janeiro. Furtado, C. [1970], (édition originale en portugais 1978) Théorie du développement
économique, Trad.: Abilio Diniz Silva & Janine Peffau, Presses Universitaires de France, Paris.
Furtado, C. [1967], “Intra-country discontinuities: Towards a theory of spatial structures”. Social Science Information, v. 6, p. 7-14.
Furtado, C. [1981] (édition originale en portugais 1978), Créativité et dépendance, Presses Universitaires de France, Paris.
22
Furtado, C. [1994], “Retour à la vision globale de Perroux et Prebisch”, Economie Appliquée, Tome XLVI, nº 3, p.171-180.
Furtado, C. [2000], “Celso FURTADO (born 1920)” In: Arestis, P. and Sawyer, M. (eds.), A Biographical Dictionary of Dissenting Economists, 2nd edition, Edward Elgar, Northampton, MA.
Higgins, B. [1988]. “François Perroux” In: Higgins, B. and Savoie, D., Regional Economic Development: Essays in honour of François Perroux, Unwin Hyman, Boston.
Mallorquin, C. [2005], Celso Furtado: um retrato intelectual. Contraponto, Rio de Janeiro.
Meier, G. M. [2005], Biography of a Subject: An Evolution of Development Economics, Oxford University Press, New York.
Meier, G. M., Seers, D. [1984], Pioneers in Development, Oxford University Press, New York.
Perroux, F. [1964a] (édition originale 1961), L’économie du XXème siècle (Deuxième Edition Aumentée), Presses Universitaires de France, Paris.
Perroux, F. [1964b], “L’image de ‘l’homme nouveau’ et les techniques collectives du second XXe siècle”, Tiers-Monde, Volume 5, nº 20, p. 637-648.
Perroux, F. [1965] (édition originale 1961), Indústria e Criação Coletiva: I Sain-Simonismo do Século XX e Criação Coletiva, Livraria Moraes Editora, Lisboa.
Perroux, F. [1966], “Présence du R. P. Lebret”, Tiers-Monde, Volume 7, nº 27, p. 457-460.
Perroux, F. [1970a], Aliénation et société industrielle, Gallimard, Paris. Perroux, F. [1970b], Industrie et création collective : II - Images de l’homme nouveau et
techniques collectives, Presses Universitaires de France, Paris. Perroux, F. [1983], A New Concept of Development. Unesco, Paris. Vieira, R. M. [2007], Celso Furtado: Reforma, Política e Ideologia (1950-1964),
EDUC, São Paulo.