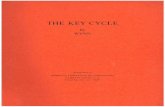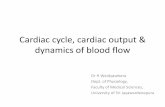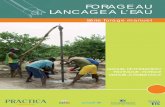Influence de l'eau sur le décollement d'une ... - TEL - Thèses
CYCLE DE L'EAU
-
Upload
ensa-tanger -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of CYCLE DE L'EAU
1
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
CYCLE DE L’EAU
CYCLE DE L’EAU 1
INTRODUCTION 2
CARACTÈRISTIQUES PHYSIQUES 2
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 2
BASSIN VERSANT 3 MORPHOLOGIE 3 LEXIQUE 5
BILAN HYDRIQUE 6
PRÉCIPITATIONS 7 ÉVAPOTRANSPIRATION 7 ÉCOULEMENT 7 CRYOSPHÈRE 8 LEXIQUE 9
ÉCOULEMENT ET RÉGIME HYDROLOGIQUE 10
DÉBITS 10 ÉCOULEMENT 10 RÉGIMES D’ÉCOULEMENT 11 LEXIQUE 12
MORPHOGENÈSE FLUVIALE 13
MORPHOGENÈSE FLUVIALE 13 LEXIQUE 16
CARTE TOPOGRAPHIQUE 17
ÉVOLUTION DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE 17 ÉLABORATION DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE 19 LIRE ET INTERPRÉTER LA CARTE TOPOGRAPHIQUE 20 LA CARTE GÉOLOGIQUE ET AUTRES DOCUMENTS 21 INTERPRÉTATION DE DOCUMENTS EN GÉOPHYSIQUE 22
2
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
INTRODUCTION
Le cycle de l’eau c’est le fonctionnement d’une des quatre sphères physiques composant le système Terre ou géosystème, l’hydrosphère (appelé aussi cycle hydrologique). Il est actionné par l’énergie solaire et la gravitation qui provoque des changement d’état de l’eau : gazeuse, liquide, solide. Il concerne 1% de l’eau de la planète et à une fonction très importante pour la vie à la surface de la Terre.
CARACTÈRISTIQUES PHYSIQUES
LIQUIDE
● Océans (95% de la totalité) ● Eaux de surface (lacs, rivières) ● Nappes souterraines
Fusion : solide à liquide ( + 0 °C)
SOLIDE
● La cryosphère
○ Glacier ○ Banquise ○ Permafrost/pergélisol
A partir de 0 °C
GAZEUX
● Atmosphère
○ Nuage (humidité de l’air) ○ Evapotranspiration (végétale, animale, sol)
Vaporisation : liquide à gazeux Sublimation : solide à gazeux
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
● Fleuve important, continu, fin océan ou mer ● Rivière moyen, continue ● Torrent forte pente, spasmodique ● Ruisseau faible mais pérenne ● Oued spasmodique
3
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
BASSIN VERSANT C’est la surface d’alimentation d’un cours d’eau :
● Bassin versant jusqu’à l’exutoire
Attention, le bassin versant réel ≠ topographique : si il y a une couche Karstique, l’eau provenant de l’autre versant peut venir alimenter le bassin versant > émergence
Bassin versant réel : bassin versant topographique + émergences
La ligne de partage des eaux se détermine avec le bassin versant topographique (pas toujours exact !)
EAUX SOUTERRAINES
Eau des nappes phréatiques
● En milieu humide, la nappe alimente les cours d’eau de surface ● En milieu aride, les cours d’eau de surface alimentent la nappe
MORPHOLOGIE ● Les cours d’eau modifient leur lit par érosion ou par dépôt pour avoir un équilibre entre la force et la
résistance ● La pente du cours d’eau varie selon la résistance du lit et inversement au débit ordinaire du cours d’eau ● Si le niveau de base est abaissé, l’érosion régressive augmente pour ajuster le profil d’équilibre ● S’il est relevé, l’érosion diminue et le cours d’eau dépose des sédiments dans la partie avale
4
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
HIÉRARCHISATION
● Horton et Strahler:
Tout cours d’eau primaire : rang 1 Confluence de 2 cours d’eau de rang 1 : rang 2 La confluence de 2 segments de rangs différents garde l’ordre du segment d’ordre supérieur Longueur moyenne croît en function du rang (segment “n” généralement 2 à 3 fois plus long que “n-1”) Taille du bassin de 3 à 6 fois entre (n et n-1)
DENSITÉ
Rapport entre la somme de la longueur de tous les cours d’eau de différents ordres d’un bassin versant et sa surface. Elle dépend de plusieurs facteurs :
● Relation inverse avec la surface du bassin versant (diminue avec l’augmentation de la surface drainée) ● Augmente avec l’énergie du relief
● Relation avec % de sol nu (elle diminue si le sol est couvert→imperméabilité) ● Variation avec la lithologie (élevé sur des substratums imperméables et diminue sur des roches perméables) ● Variation avec les conditions climatiques (faible dans les régions arides)
MODIFICATION, OU PAS, DE LA DIRECTION COURS D’EAU
Modification
● Par capture
○ Recule de tête (source) par érosion régressive ○ Induisant une vallée morte
● Par déversement
Inadaptation
● Par antécédence :
○ Existe avant n événement tectonique, il s’encaisse dans les nouvelles structures sans dévier de son cours initial
● Par surimposition :
Erosion d’une couverture sédimentaire déposée sur une structure géologique préexistante
5
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
LEXIQUE Ecoulement : Pérenne : Ecoulement permanent Sporadique : Ecoulement temporaire Spasmodique : Ecoulement très irrégulier Bassins hydrographiques Exoréique : Ecoulement vers la mer Endoréique : Ecoulement vers un lac ou un bassin fermé Aréique : Pas d’écoulement Bassin versant : Surface d’alimentation d’un cours d’eau Exutoire ou émissaire : Sortie (goulet) du bassin versant, (dépend de l’échelle d’analyse) Talweg : Ligne symbolique qui suit la partie la plus basse du lit Interfluve : Un interfluve est un relief compris entre deux talwegs Affluent : Cours d’eau qui se tournent le dos Confluent : Jonction de plusieurs cours d’eau, point de jonction Embouchure : Endroit ou le cours d’eau se jette dans un lac Nappe phréatique : Volume d’eau sous le sol Perméabilité d’un terrain : Capacité d’un matériau à laisser transiter de l’eau Perméabilité de porosité : Vide qu’on a dans une roche, l’eau peut s’infiltrer dans les trous (calcaire) Porosité totale : Somme de la porosité utile et de la porosité résiduelle Porosité efficace : L’eau est récupérable Aquifère : Zone saturée en eau Aquifère libre : Limité par un niveau imperméable en dessous Aquicludes : Couche étanche Aquifère confiné : Limité par des aquicludes en dessous et en dessus Puits artésiens : L’au sort sous pression du sol : forage dans un aquifère confiné = pression Karstique: Couche calcaire perméable Erosion régressive : Erosion vers l’amont, remontée Profil d’équilibre : Tendance à tendre vers une courbe le plus plat possible, le plus proche possible du niveau de base
6
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
BILAN HYDRIQUE
GÉNÉRALITÉS
Précipitation = Ecoulement + Evapotranspiration + variation du stock solide
Rappel : une année hydrologique : 1er octobre au 30 septembre
Mesure des composantes du bilan hydrique :
Les valeurs mesurées ne correspondent qu’à l’endroit où il y a la station de mesure.
● Le bassin versant : unité spatiale de base pour l’hydrologie, étendu et drainé par un cours d’eau et des affluents. L’exutoire permet de savoir l’écoulement à la sortie du système.
● Le coefficient d’écoulement :
○ Indique la proportion des précipitations qui participe à l’écoulement. = écoulement/précipitation
● La pluie est mesurée par le pluviomètre, mais les mesures peuvent être perturbées par le vent, l’évaporation et le gel. Les valeurs correspondent à une surface très restreinte.
● L’évapotranspiration d’un sol couvert est difficile à établir. Mesure directe ou estimation à partir de modèle.
A travers le monde :
● Les continents :
○ Antarctique : évaporation nul à cause de la température ○ Afrique : taux d’écoulement très bas ○ Amérique du Sud : précipitations donne 31% du ruissèlement mondial et 23% d’évaporation ○ Europe : plus de précipitation que d’évaporation et de ruissèlement
● Les pays :
○ 12 pays : 65% des réserves totales d’eau douce ○ 54 pays : 1% des réserves totales
● Le stress hydrique : indice de pénurie d’eau, représente la quantité d’eau utilisée par an dans un pays par rapport aux réserves totales disponibles :
○ <10% pas de pression ○ 10-20% stress hydrique modéré (Italie) ○ 20-40% stress hydrique marqué, = problèmes au niveau de la gestion des ressources (USA, Chine) ○ >40% véritable pénurie d’eau
La Suisse : château d’eau de l’Europe, principale source de stockage mais cela régresse
7
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
PRÉCIPITATIONS ● Convectives :
○ Ascension rapide des masses d’air dans l’atmosphère ○ Cumulus et cumulo-nimbus ○ En général orageuse, de courte durée, de forte intensité et de faible extension spatiale
● Orographique :
○ Rencontre entre une masse d’air chaude et humide et une barrière topographique ○ L’altitude, la pente, l’orientation, et aussi de la distance séparant l’origine de la masse d’air chaud du lieu
de soulèvement. Intensité et fréquence assez régulières
● Frontales (ou cycloniques) :
○ Surfaces de contact entre deux masses d’air de température, de gradient thermique, d’humidité et de vitesse de déplacement différents, que l’on nomme « fronts »
● Les fronts froids
○ Une masse d’air froide pénètrant dans une région chaude, peut créer des précipitations brèves, peu étendues et intenses.
● Les fronts chauds
○ Une masse d’air chaude pénètre dans une région occupée par une masse d’air plus froide génèrent des précipitations longues, étendues, mais peu intenses.
ÉVAPOTRANSPIRATION Passage de l’eau liquide à la phase gazeuse. Le principal facteur est la radiation solaire.
● Evapotranspiration réelle :
○ Somme des quantités de vapeur d’eau évaporée par le sol et par les plantes pour des conditions spécifiques d’humidité du sol et un développement physiologique et sanitaire spécifique des végétaux.
● Evapotranspiration de référence :
○ Quantité maximal d’eau susceptible d’être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert végétal continu spécifié, bien alimenté en eau et pour un végétal sain en pleine croissance.
● Diminue de 22mm/100m
ÉCOULEMENT ● De surface, de subsurface, de souterrain :
○ Ecoulements qui gagnent rapidement les exutoires pour constituer les crues se subdivisent en écoulement de surface (mouvement de l’eau sur la surface du sol)
○ Ecoulement de subsurface (mouvement de l’eau dans les premiers horizons du sol) ○ L’écoulement souterrain désigne le mouvement de l’eau dans le sol ○ Ecoulement Hortonien (dépassement de capacité d’infiltration) ou par saturation du sol.
Pérennes, temporaire, sporadique : caractérisent les cours d’eau Laminaire et turbulent : caractérisent les cours d’eau
● Le coefficient d’écoulement :
○ Ecoulement / Précipitation
S’il est élevé en Suisse (0.68 > 68%), c’est à cause des Alpes (évapotranspiration faible)
8
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
CRYOSPHÈRE Englacement de la Terre aujourd’hui : 16 millions Km2.
BANQUISE
Actirque (nord) Antartique (sud)
PERMAFROST/PERGÉLISOL
● Zone de sol gelé en permanence ● 50 m de profondeur dans les Alpes ● Jusqu'à 500m en sibérie ● Augmente avec les latitudes ● Augmente avec l’altitude
Dans les Alpes :
○ Permafrost continu à partir de 3000m sur l’adret ○ Permafrost continu à partir de 2500m sur l’ubac ○ Discontinu environ 500m en dessous des limites continues
GLACIERS
● Zone d’alimentation/acculmulation ● Ligne d’équilibre : marque la limite de la zone d’accumulation et d’ablation ● Zone d’ablation
Bilan de masse :
● Somme des pertes et des gains de masse pour une période donnée, suivant l’année hydrologique.
○ Exprimée en hauteur d’eau ○ Accumulation et ablation peuvent avoir lieu sur toute la surface du glacier et n’importe quand
FACTEURS DE VARIATIONS
● Echelle d’un glacier :
○ Températures d’été et précipitation en hiver
● Echelle régionale :
○ Climat : ○ Altitude/latitude ○ Continentalité ○ Topo : ○ Exposition ○ Morphologie
9
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
LEXIQUE ● Année hydrique : 1er octobre au 30 septembre ● Flux d’entrée : Précipitations (liquide, solide…) ● Flux de perte : Evapotranspiration, écoulements superficiels souterrains… ● Stress hydrique: Quantité d’eau utilisée par rapport aux réserves totales
Précipitations
● Pluies convectives: Ascension d’air chaud, il se refroidit (forte intensité) ● Pluies orographiques: Air bloqué par barrière topographie doit monter. La pluie dépend de
caractéristique (altitude, orientation…) ● Pluies frontales/cyclonique: Contact entre 2 masses d’air de T° et humidité différente ● Front froid : Air froid rentre dans zone chaude (pluie brève, peu étendue mais intense) ● Front chaud : Air chaud rentre dans zone froide (pluie longue, étendue, peu intense)
Écoulements :3 caracteristiques :
○ Surface Ecoulement qui gagne l’exutoire (eau sur surface sol) ○ Subsurface Ecoulement qui gagne l’exutoire (eau dans premiers horizons du sol) ○ Souterraine Mouvement d’eau souterraine
● Ecoulement Hortonien capacité d’infiltration dépassé ou saturation) ● Effet piston Ecoulement par macropores, intrumescence de la nappe (elle gonfle):
Ecoulement de retour
Ecoulements
● Coefficient d’écoulement; Quantité d’eau écoulée par rapport aux précipitations. ● Pérenne : Ecoulement permanent ● Sporadique : Ecoulement temporaire ● Spasmodique : Ecoulement très irrégulier ● Laminaire Veines liquides parallèles,sans échanges latéraux et verticaux ● Turbulent Echanges verticaux et latéraux entre veines liquides ● Lame d’eau : Quantité écoulée (sur une échelle temporelle et régionale définie)
CH : lame d’eau annuel = 991 mm (moyenne de 1961-1990) Evapotranspiration :
● Réel Quantité d’eau rejetée par les végétaux et évaporée du sol (réel) ● De référence Quantité théorique d’eau rejetée par des végétaux d’un certain type, en
pleine croissance et d’eau évaporée du sol à une certaine température.
Cryosphère :
● Zone alimentation/accumulation: Dans le haut du glacier, zone où le glacier grandit ● Zone d’ablation Dans le bas du glacier, zone ou le glacier fond/diminue
Il y a aussi alimentation et ablation dans les autres parties du glacier.
● Langue glaciaire Bas du glacier ● Bilan de masse Informe si un glacier fond plus qu’il ne reçoit de neige ou si il fond moins
qu’il reçoit de neige. ● Pergélisol, permafrost : Sol gelé en permanence, sol imperméable ● Adret : Versant sud ● Ubac : Versant nord
10
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
ÉCOULEMENT ET RÉGIME HYDROLOGIQUE
DÉBITS C’est le volume d’eau écoulé en une seconde en un point donné du cours d’eau, dépend de l’alimentation en
eau et de la superficie du bassin versant.
Débit brut
● Mesuré au limnimètre, il y a beaucoup de stations de mesure en Suisse.
○ Représenté sur un hydrogramme
Les débits bruts varient beaucoup, on fait alors des moyennes.
Variations de débits :
● Crues:
○ Augmentation importantes du débit d’un cours d’eau. C’est un événement hydrologique ponctuel qui dépend des précipitations ou des fontes des stocks solides. Elles sont liées à des situations météorologiques exceptionnelle.
La pointe de crue est décalée par rapport au moment des précipitations les plus intenses.
La forme du bassin versant influence le déroulement de la crue.
○ Un bassin arrondi : grosse amplitude ○ Bassin étroit et allongé : crue d’une durée plus longue avec une amplitude plus réduite
● Autres influences :
○ Nature géologique, topo, affectation des sols, degré de saturation des sols, urbanisation, etc.
● Les hautes eaux ne sont pas des crues mais des débits supérieurs au débit annuel moyen. ● L’étiage : Plus faible débit d’un cours d’eau. Influence les biotopes et peuvent aller jusqu'à poser des
problèmes pour l’alimentation en eau des collectivités. ● Les basses eaux : débits inferieurs au débits annuel moyen
ÉCOULEMENT ● De surface ou souterrain
○ Hortonien : lorsque l’intensité des précipitations dépasse la capacité d’infiltration dans le sol ○ De surface saturée : lorsque le niveau de la nappe phréatique atteint la surface du sol ○ Concentré : lorsque l’écoulement se concentre dans des talwegs ○ Turbulent : écoulement de rivières naturelles, flux chaotique, fluctuation de vitesse, brassage de
particules. ○ Laminaire : arrivée d’une lame (grosse intensité d’un coup) ○ Pérenne, temporaire, spasmodique ○ Torrentiel : lorsque les ondes de gravité sont stationnaires sur l’obstacle, des vagues se créant sur
l’obstacle peuvent se briser et créer un déferlement.
● La vitesse d’écoulement :
○ Epaisseur de la lame d’eau (donc du débit) ○ La pente ○ Profondeur et distance aux berges (effet de la rugosité), l’état des berges et du lit provoque un frottement
ralentissant. La valeur de la rugosité dépend des matériaux composant le fond du lit et de la végétation.
11
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
RÉGIMES D’ÉCOULEMENT ● Qualifie la répartition saisonnière des débits (comportement hydrologique global d’un cours d’eau), calculé
sur l’année hydrologique et qualifié sur une moyenne pluriannuelle.
○ Naturel ○ Influencé par l’activité humaine ○ Mixtes : plusieurs types d’alimentation ○ Complexe : pour les grands fleuves alimentés par des cours d’eau à régimes différents ○ Peu pondéré : débit entre les crues et étiages sont très différents ○ Pondéré : les débits varient peu ○ Régulier : débit varient peu d’une année à l’autre ○ Irrégulier : variations inter-annuelles importantes
Pour les régimes simple et mixte : 2 types d’alimentation
● Solide
Peu pondéré et régulier, pas de relation entre le régime pluviométrique et le régime hydrologique :
○ Régime nival : faible pondération, pointe en début de saison, pas de pointe secondaire ○ Glaciaire : pondération élevée, pointe max en 2
ème partie de l’été (fonte des glaces)
● Liquide
Dépendant du régime des précipitations :
○ Régime pluvial océanique ○ Pluvial méditerranéen ○ Pluvial tropical
Les régimes des cours d’eau suisses sont classés en fonction de la région géographique et du mode d’alimentation. Il n’y a plus beaucoup de régimes naturels car il y a beaucoup de régime influencé (exploitation hydroélectrique).
○ Régimes alpins : alimentés par la fonte des glaces et de neige, peu pondéré, très irrégulier, écoulement minimal en saison froide, pic d’alimentation nival en mai-juin.
○ Régimes du Moyen-Pays et du Jura : pluie, peu pondéré ○ Régime sud-alpins : précipitations abondantes en automne
12
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
LEXIQUE ● Débit brut : Quantité d’eau s’écoulant pdt une seconde (m3/s) ● Débit spécifique: Quantité d’eau qui s’écoule tenant compte de la superficie du bassin
versant (l/s/km2) ● Hydrogramme : Répartition temporelle des débits ● Crue : Augmentation importante du débit. Evénement hydrologique ponctuel,
dépend de fonte de glace ou des précipitations. Niveau de crue est atteint ou dépassé 9 jours par année.
● DC 9 Débit de crue (atteint pendant 9 jours sur l’année) 12 étant un exemple ● Etiage Plus faibles débits. Evénement hydrologique ponctuel, dépend de
l’absence de précipitations. Niveau d’étiage est atteint ou dépassé 9 jours par année
● DC 347, DCE 347 ou Q 347 Débit d’étiage atteint ou dépassé pendant 347jours
Ecoulement :
● Concentré Eau s’écoule dans le talweg ● Non-concentré Hortonien ou surface saturée, eau s’écoule aussi en dehors du talweg ● Tranquille Onde de gravité supérieur à force d’inertie de l’eau. (obstacle dans l’eau
provoque déformation de l’eau avant l’obsacle) ● Torrentielle Onde de gravité sont stationnaire sur l’obstacle. ● Régime d’écoulement Qualifie la répatition saisonnière des débits ● Coefficient De Pardé Comparaison des régimes (débit mensuel/débit annuel)
Régime :
● Naturel Ecoulement naturellement ● Influencé Influencé par l’homme ● Simple Un seul type d’alimentation (nival par ex.) ● Mixte Plusieurs types d’alimentation (glacio-nival par ex.) ● Complexe Grands fleuves alimentés par cours d’eau de régimes différents ● Pondéré Peu de variation de débit entre étiage et crue ● Peu pondéré Débits entre crue et étiage sont très différents ● Régulier Débits varient peu d’une année à l’autre ● Irrégulier Variation inter-annuelle importante ● Régime pluvial Dépend du régime pluviometrique ● Océanique Pondéré forte irrégularité. Hautes eaux en saison froide, basse eaux en
saison chaude ● Méditerranéen Moins pondéré, très irrégulier. Hautes eaux en saison froide, étiage en
saison chaude car forte évapotranspiration+manque de précipitations. ● Tropical Peu pondéré, assez régulier car peu amplitude thermique d’une année à
l’autre. Hautes eaux durant saison des pliuies (aout-nov. En hémisphère nord), basse eaux durant saison sèche
● Taux d’englacement Influence sur la répartition des régimes d’écoulement (TE élevé > débit max plus tard dans l’été)
● Régime nival Faible pondération, pointe en début de saison (mai-juin) ● Régime nivo-glaciaire TE max 3% (point en juin) ● Régime glacio-nival TE max 12% (pointe juin juillet) altitude du bassin versant 1500 et 2300 ● Régime glaciaire TE supérieur à 20% (pointe juillet-aout et différence jour/nuit)
13
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
MORPHOGENÈSE FLUVIALE
RAPPEL : NOTION DE MORPHOGENÈSE :
Ensemble des processus qui amène à la création d’un relief, dépendant de 2 forces antagonistes.
● Formation du relief, facteurs endogènes :
○ Pétrogenèse ○ Tectonique des plaques
● Destruction du relief, facteurs exogènes :
○ Gravité ○ Processus d’érosion ○ Altération : modification de la roche (eau, contact entre roche et agents atmosphérique ) ○ Arrachement ○ Transport ○ Sédimentation (dépôt)
● + Facteurs anthropogènes, érosion créée par l’homme.
MORPHOGENÈSE FLUVIALE ● Profil en long (ou longitudinal) :
○ Profil topographique le long du talweg d’un cours d’eau, tend vers un profil concave (profil d’équilibre)
RUPTURES TOPOGRAPHIQUES DU PROFIL
La structure géologique, se regroupe en 2 formes :
● Lithologie : pierres, nature des roches ● Tectonique : déformation des roches par movement des plaques tectoniques
○ Ductile : Ca donne des plis si la roche est assez souple ○ Cassante : Casse si la roche est dure. Ca donne des failles
Ces déformations fragilisent les roches, favorise l’érosion
Présence d’anciens niveaux de base plus élevé que le niveau de base actuel Présence de niveau de base régionaux Profil en travers (transversal), mesuré perpendiculairement à la direction d’écoulement u cours d’eau.
● Les cours d’eau s’écoulent dans 2 types de vallée :
○ Incision directement dans la roche (gorge, canyon,…)
○ Ecoulement sur leurs propres sédiments ou sur leurs dépôts sédimentaires anciens→plaine alluviale
● L’encaissement du cours d’eau dépend de la structure géologique et sa capacité érosive
○ Les gorges se forment lorsque l’incision verticale est très rapide ○ La vallée en V, vallée érodée par un cours d’eau, incision verticale importante tout comme l’érosion des
versants qui amènent du matériel dans le fond du talweg ○ Les canyons se forment dans des situations de roches sédimentaires à pendage peu important et à
résistances différentes à l’érosion
14
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
COURS D’EAU À ÉCOULEMENT LIBRE
Plaines alluviales
○ Dans une vallée à fond plat : Lit mineur (ou l’eau s’écoule toute l’année même à l’étiage) Lit majeur (où l’eau s’écoule lors des hautes eaux) Plaine alluviale (inondée que par les crues extrêmes)
○ 3 niveaux décalés les uns par rapport aux autres, mais il n’y a pas de ruptures topographiques, incision lente, le cours d’eau a alors le temps de s’écouler et éroder latéralement
● Terrasses : Au bord du lit majeur, on peut trouver des terrasses, témoins d’anciens nivaux du cours d’eau
○ Terrasses construites : Formé par le dépôt d’alluvions transportés, résulte du dépôt de la charge solide puis de l’incision du cours d’eau dans sa propre charge
○ Terrasses d’érosion : Le cours d’eau à éroder des surfaces et créé des surfaces planes, enfoncement du cours d’eau directement dans la roche
○ Plusieurs terrasses peuvent être emboitées, on les distingue par rapport à leur altitude par rapport au lit actuel, les terrasses peuvent être pairs ou impairs
● Tracés et morphologie des chenaux : les cours d’eau naturels ont des tracés très variés
○ Rectiligne : plus la pente augmente plus le tracé est rectiligne ○ Tressé : forte dynamique, matériaux transportés très gros, laisse des petites îles ○ Sinueux ○ A méandres ○ Anastomosés : peu de charge solide transportée, plus petit, moins de dynamique
L’indice de sinuosité se calcule en divisant la longueur développé du talweg entre 2 inflexions de même sens par la longueur d’onde du train de méandre
○ Tracé rectiligne <1,05 ○ Tracé sinueux >1,05 et <1,5 ○ Tracé à méandres >1,5
● Plusieurs facteurs influencent la morphologie des chenaux et du tracé :
○ La pente ○ La charge solide et son mode de transport ○ La cohésion des berges ○ Les caractéristiques hydrologiques du cours d’eau (pondération, débits, puissance, …)
MÉTAMORPHOSE FLUVIALE : CHANGEMENT DE TRACÉ
● Plusieurs moyens de transport des charges :
○ Par charriage ○ Par saltation ○ Par suspension
● Les méandres
○ Encaissés : la vallée elle-même forme des méandres ○ Libres : le fond de la vallée est large et la rivière crée des méandres librement dans la plaine alluviale
● L’érosion se concentre sur la plus forte courbure des lignes de grandes vitesses, à ces endroits, le cours d’eau affouille le lit, créant des mouilles
○ Le cours d’eau dépose le surplus de charge la où la vitesse diminue, créant un seuil
● Entre 2 bras le pédoncule devient de plus en plus petit, ensuite le cours d’eau va aller tout droit, c’est l’auto-capture, cela va donner un bras mort, lac, car plus d’alimentation
15
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
MORPHOGENÈSE
Charge sédimentaire :
Masse de sédiments transportés par unité de temps à travers une section transversale. En fonction de leur taille, les particules sont transportées par différents mécanismes
● Le cours d’eau transporte le matériel arraché à ses bassins versants et à son lit
○ Plus on augmente la vitesse, plus il y a d’érosion régressive. ○ Matériaux plus gros transportés par roulement/charriage ou par saltation ○ Particules plus fines par suspension ○ Solution, les matériaux sont dissous dans l’eau
● Figures de sédimentation : déplacement de l’eau sur le lit provoque la formation de figures de sédimentation : forme dépend de l’intensité du flux
○ Vitesse faible : rides du courant se forment ○ Dynamique un peu plus importante : des dunes se forment ○ Augmentation de la dynamique : les dunes s’aplatissent et se superposent : on a donc une structure
planaire
Si la vitesse augmente encore on a des vagues de courant qui forment des antidunes
● Plaine alluviales : dépôt d’alluvions a lieu lorsque la compétence du cours d’eau diminue ● Torrents : cours d’eau de montagne à écoulement spasmodique, comporte trois parties :
○ Le bassin de réception : situé à l’amont, en forme d’entonnoir, eau de pluie et de fonte des neiges recueillis dans des talwegs, suivent la pente jusqu’au chenal principal
● Chenal d’écoulement : étroit et souvent encaissé, toutes les eaux récoltées du bassin de réception se rassemblent pour s’écouler vers l’aval
○ Le cône de déjection : situé à l’aval, à l’endroit où la pente diminue provoquant une diminution de la compétence du cours d’eau, et donc le dépôt de la charge sédimentaire transportée depuis l’amont, forme d’éventail
● Lave torrentielles : déclanchement pas défini mais dépend de plusieurs conditions :
○ Paramètre météorologique: intensité et durée des pluies ○ Topographie : pente supérieur à 15% ○ Géomorphologie : activité des processus fluviatiles et gravitaires ○ Thermique : présence de pergélisol ○ Géologie : réseaux de failles, lithologie ○ Hydrologique : régime d’écoulement
Ecoulement d’eau et de matériaux solides de toutes tailles = pouvoir destructif
16
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
LEXIQUE ● Morphogenèse Ensemble des processus qui amènent à la création d’un relief ● Exogène Destruction du relief : gravité, érosion régressive. ● Endogène Formation du relief. La pétrogenèse (formation des roches), tectonique
des plaques (volcan, formation des montagnes).
Structure géologique :
● Compétence d’une roche Solidité de la roche, résistance à l’érosion ● Lithologie Nature des roches. ● Ducile Donne plis si roche souple ● Cassante Casse si roche dure ● Faille Décrochement vertical ● Décrochement Décrochement horizontal ● Diaclase Fracture de petite taille (sur le sommet d’un pli anticlinal par ex.)
Cour d’eau encaissé
● Gorge Forte érosion verticale (incision verticale dans roche homogène et résistante)
● Canyon Roche sédimentaire à pendange peu important et à résistances différentes ● Vallée en V Vallée érodée, incision verticale et érosion des versants important
Cour d’eau à écoulement libre
● Lit mineur L’eau y coule tout l’année, même pendant l’étiage ● Lit majeur L’eau y coule lors de hautes eaux mais pas de crue. ● Plaine alluviale L’eau y coule lors de crues extrêmes. ● Terrasses construites Formé par le dépôt d’alluvions transportés ( dépôt de charges solides puis
incision du cours d’eau) ● Terrasses d’érosion Formé par l’érosion de la surface dû au cours d’eau (s’enfonce directement
dans la roche) ● Terrasse paire Incision rapide du cours d’eau dans les rives ● Terrasse impaire Incision beaucoup plus lente
Tracés et morphologie des chenaux
● Multiplicité Chenal unique ou chenaux multiples ● Sinuosité Rectiligne ou sinueux ● Rectiligne Chenal unique rectiligne. Souvent anthropisé (plus de courant) ● En tresse Chenaux multiples rectilignes. Bancs de gravier (lit majeur), ovale en
direction aval. Beaucoup de charge solide qu’il n’arrive pas à déplacer ● À méandre Chenal unique et sinueux, pente faible, forte cohésion (proche du profil
d’équilibre) ● Anastomosé Chenaux multiple sinueux, cas particulier de « à méandre », faible
cohésion des berges ● Méandre encaissé La vallée elle même forme le méandre ● Méandre libre Fond de vallée large, la rivière se promènent librement dans la pleine
alluviale ● Mouille Endroit d’un méandre où le courant est le plus fort et ou se passe l’érosion
(extérieur) ● Pédoncule Entre deux inflexions de même sens (entre 2 bras) ● Bras mort/Ox-bow Lorsqu’il y a disparition du pédoncule, formation d’un lac plus irrigué ● Auto-capture Phénomène qui fait naître un bras mort, plus irrigué
Indice de sinuosité :
● Is<1.05 = rectiligne
17
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
● Is>1.05<1.5 = sinueux ● Is<1.5 = à méandre
Déplacement des charges sédimentaires :
● Compétence d’un cours d’eau capacité à transporter des matériaux ● Charge sédimentaire Masse de sédiments transportés par unité de temps ● Compétence Diamètre du plus gros caillou transporté (varie en fonction de vitesse selon
Hjulström) ● Capacité Débit solide maximum que peut transporter cour d’eau ● Roulement/charriage Matériaux les plus grossier, transportés sur le fond ● Saltation Matériaux de taille moyenne, transportés sur le fond (petits sauts) ● Suspension Particules plus fines ● Solution Particules très fines dissoutes dans eau minérale ● Flottaison Matériaux à faible densité (bois) ● Seuil La charge solide se dépose où le courant est le moins fort (intérieur)
CARTE TOPOGRAPHIQUE
CARTOGRAPHIE
Discipline chargée d’établit des cartes en faisant appel à différentes techniques graphiques et sémiologiques
Plusieurs cartes :
● Géologique (failles) ● Géomorphologique (glaciers) ● Thématique (densité) ● Géotouristique ● Topographique : représentation exacte et détaillée de la surface terrestre concernât la position, la forme, les
dimensions et l’indentification des accidents du terrain, ainsi que des objets concrets qui s’y trouvent en permanence
A quoi sert une carte ?
● Représenter ● S’orienter ● Communiquer des résultats ● Outil d’analyse
ÉVOLUTION DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE Les cartes sont très anciennes : la plus vieille connue : Carte de Soleto 500 ans avant JC
HISTOIRE DES CARTES FRANÇAISES
La cartographie topographique ou géométrique
● 17em siècle : « la carte de France corrigée par l’ordre du roi » ● 1666 Création de l’Académie des Sciences et de son annexe, l’Observatoire de Paris
○ Mission confiée à l’Abbé Picard, La Hire et Jean Cassini
● Carte pas précise : Paris au centre, aucune route qui relie les villages, …
18em siècle : « Carte Cassini »
Dans ces années, les mesures effectuées montrent que la Terre a une forme d’un ellipsoïde de révolution aplatie aux pôles, la carte a un usage militaire
18
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
● 1747 Cassini III est chargé par Louis XV de faire la carte de la France à échelle 1 :86’400 ● 19em siècle : « Carte de L’Empereur »
○ Activités cartographiques hors des frontières par Napoléon au gré de ses conquêtes
1802 création de la Commission de topographie pour uniformiser les signes et les conventions
● 19em siècle : « Carte d’état-major »
1817 Louis XVIII crée la commission royale de la carte de France: 1818-1866 nouveaux levés de triangulation et nivellement
○ 1880 parution de la dernière feuille
Géodésie imprécise, nivellement et orographie en hachure trop peu dense et imprecise 1878 création d’une commission centrale du nivellement, il faut une meilleure qualité de la représentation du relief, permet de construire des cartes en courbes de niveau
● 20em siècle : « 3em carte de France » ● Les cartes de l’Institut Géographique National (1940)
○ Développe ses activités dans les colonies ○ Photographies aériennes ○ Territoire français est couvert par 4 séries de cartes suivant les échelles
LES CARTES SUISSES
Comme la France jusqu’au 18em siècle, elles sont très imprécises. En Suisse, il y a beaucoup de canton pas unifié, la structure n’est pas centralisée et ca a retardé le développement d’une cartographie nationale unifiée.
● Cartes pré-scientifique
○ 15em siècle première carte de Suisse ○ Cartes à partir du 18em siècle : Atlas Meyer-Weiss (1764-1802)
● Entreprise privée
Premier Atlas à hachures verticales, montagnes représentée en vue plongeante verticale
Première carte véritablement précise de la Suisse par le Général Guillaume Henri Dufour 1:100000
● 1832 premiers travaux dirigé par l’armée et une commission décide :
1 :25'000 en plaine et 1 :50'000 en montagne
○ Projection conique de la carte ○ Origine des coordonnées à l’Observatoire de Berne ○ Achèvement de la triangulation Suisse
1832 Dufour nommé directeur des travaux topographiques, il décide d’adopter le mètre
● Adopter la hauteur du chasseral déterminée par les ingénieurs français comme altitude de départ
○ 1839 création d’un bureau topographique fédéral ○ 1845-1864 publication des diverses feuilles
La carte a reçu beaucoup de distinctions et la Hochste Spitze a été rebaptisée en 1863 la Pointe Dufour par le conseil fédéral
● Dufour a été influencé par la cartographie française, il a fait ses études à Paris
19
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
Atlas Siegfried
● 1866 Atlas Siegfried succède à Dufour
○ Courbes de niveaux pour représenter le relief sinon même carte ○ 1870 publication des premières feuilles
Depuis 1935 loi fédérale sur l’établissement de nouvelles cartes nationales, meilleures qualités et mise a jour assez fréquentes
● Dès 1940 cartes basées principalement sur prises de vues aériennes ● 1952 remplacement de la gravure sur cuivre par du verre ● 1978 ensemble des cartes nationales publiées
1989 première carte numérique
ÉLABORATION DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE
3 ÉTAPES
● Mensuration des points fixes, avec le réseau des coordonnées du globe, on peut désigner chaque lieu selon sa longitude et sa latitude
○ Plusieurs pensées sur la forme de la Terre : ○ Newton (1643-1727) Terre sphérique, légèrement aplatie aux pôles ○ Géographes français Terre allongée, suivant l’axe des pôles (citron)
En fait la vrai forme de la Terre est géoïde
Une des difficulté de la cartographie est de représenter en plan la surface de la Terre, on arrive pas à conserver les angles ou les formes ou les longueurs. Avec une projection on peut réduire ces déformations
SYSTÈMES DE PROJECTION
● Conforme Conserve les angles ● Equivalente Conserve les surfaces ● Aphylactique Réalise un compromis entres les divers distorsions
Surfaces de projection
Position de ces surfaces cylindriques, cône, plan, les plus fréquentes
● Projection directe Projection centrée sur un pôle, l’équateur ou un parallèle ● Proj. transverse ou méridienne Surface centrée sur un point de l’équateur ou sur un méridien ● Projection oblique Surface de projection centrée sur un point ou un cercle quelconque de la
sphère ● Tangente Envelopper l’ellipsoïde ● Sécante Couper l’ellipsoïde
Position du point de vue
● Projection centrale Point de vue au centre de la Terre ● Projection stéréographique Point de vue diamétralement opposé au centre de projection ● Projection orthograhique Point de vue infini ● Cartes nationales suisses Projection cylindrique
20
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
MENSURATION
Pour commencer la mensuration d’un pays il faut
● Définir la projection ● Déterminer la longitude et la latitude de différents points du territoire pour les utiliser comme point de base
2 méthodes pour la mensuration
● La triangulation (déjà utilisée en 1600)
○ Consiste à couvrir le territoire d’un réseau hiérarchisé de triangle, dont on connaît la position exacte des points. Elle se base sur la mesure d’angle à partir d’une ligne de longueur connue.
○ A partir des extrémités de cette ligne, on mesure avec un théodolite (appareil pour calculer les angles) l’angle formé avec un 3e point
○ Le nivellement, altitudes mesurées avec ce procédé. Il se base sur un transfert des hauteurs. Mais ce procédé est très contraignant pour mesurer les cotes des sommets, les altitudes sont alors déterminées par mesures trigonométrique. Ces calcules tiennent compte de la courbure de la Terre, déviation de rayon de lumière, déviation de l’aplomb
○ Procédé moderne par satellites GPS de positionnement (qui tournent autour de la Terre)
● Levé de terrain
○ La photogrammétrie (mesure des images) ○ D’abord des photographies terrestres puis aérienne
CONFECTION ET REPRODUCTION DES ORIGINAUX
Toutes les informations sont rassemblées :
○ Relief ○ Hydrographie ○ Végétation ○ Infrastructures ○ Toponymes
LIRE ET INTERPRÉTER LA CARTE TOPOGRAPHIQUE
LES ÉLÉMENTS DE LA CARTE :
● L’échelle indique le rapport de réduction
○ Grande échelle : 1 :25'000, 1km = 4 cm sur la carte ○ Petite échelle : 1 :100'000, 1km = 1cm sur la carte
Le choix de l’échelle se fait en fonction de l’utilisation prévue de la carte S’orienter en milieu alpin : grande échelle En espace vaste : petite échelle
Le Nord
Le nord de la carte : se situe toujours en haut de la carte
● Le nord géographique : se situe à 90° latitude nord, il est donné par le méridien du lieu ● Le nord magnétique : indiqué par l’aiguille de la boussole. Il dépend du champ magnétique terrestre variable
dans le temps et l’espace. Il est actuellement situé au Canada, il ne correspond pas au nord géographique
○ La divergence entre le nord géographique et le magnétique s’appelle la déclinaison (figure sur le bord inférieur des cartes)
○ La divergence entre le nord de la carte et le géographique s’appelle la convergence du méridien
21
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
● Les coordonnées : quadrillage kilométrique est le système de référence national
Signes conventionnels : manque de place sur la carte, les objets sont simplifiés, ce sont des symboles normalisés, généralisation est une schématisation raisonnée des détails, il y a plusieurs niveaux de généralisation :
○ Oro-hydrologique, réseaux de communication, habitat avec un maximum de précision D’autres objets sont fortement généralisé (la végétation en 4 catégories : forêt, vignes, buissons, verger)
La généralisation dépend de l’échelle de la carte
○ Représentation du relief : pour se rendre compte de la topographie sur une représentation plane : les courbes de niveaux et les hachures ont été introduites.
○ La distance verticale entre les courbes : équidistance ○ Tout les 100m il y a une courbe en plus gras
Mesures et calculs
Tracés rectilignes à faible dénivelé : mesurer avec une règle puis convertir Longueur de la pente: distance Tracé rectiligne à fort dénivelé : Tracé sinueux : beaucoup de changement de direction, on ne tient pas compte du dénivelé, il faut mesurer avec un fil Pente et déclivité : inclinaison d’un versant ou d’un tracé linéaire, mais en 2 unité de mesures différente :
Inclinaison ou Pente (en °): INV Tang(∆H /Dhorizontal) Déclivité (en %): (100 x ∆H)/Dhorizontale Distance de la pente : √(Dhorizontale2 + ∆H2)
Orientation
● Les coordonnées
○ xxx’xxx/yyy’yyy
On calcule : exemple : 3cm x 25000 /100 = 750m > xxx’750/yyy’yyy
● Indiquer l’orientation d’un versant et du vent :
○ Versant sud c’est celui qui regarde en direction du sud ○ Vent du sud c’est celui qui vient du sud
● Donner l’orientation d’un axe : on utilise 2 points cardiaux opposé, on les donne en suivant la rose des vents dans le sens des aiguilles d’une montre
○ Donner une direction d’écoulement (s’écoule en direction de…)
LA CARTE GÉOLOGIQUE ET AUTRES DOCUMENTS
LA STRUCTURE GÉOLOGIQUE
La structure géologique a souvent une grande influence sur la formation et l’évolution d’un relief
● Caractéristique lithologiques, déformations tectoniques des roches
○ La carte géologique peut nous aider à comprendre le développement d’un relief et l’évolution géomorphologique d’un bassin versant
● Il y est représenté : les roches affleurant à la surface ● Informations données par la carte :
○ Chronologie ○ Nature des roches : lithologique ou scatographique ○ Tectoniques (changement de la roche)
22
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
● L’âge des roches est classé du plus vieux au plus jeune, de bas en haut, elle est distribuée en en ère et en période puis en époque :
○ Paléozoïque : primaire ○ Trias ○ Mésozoïque : secondaire ○ Jurassique ○ Lias ○ Dogger ○ Cénozoïque : tertiaire ○ Crétacé
Légende et chronologie des roches :
○ Age des roches : indication de l’ère, période, époque, âge, avec des couleurs pour chaque âge
● Chaque roche a un code pour la retrouver facilement sur la carte
Informations par un graphique et une légende sur le faciès : aspect et environnement ou contexte de formation de la roche
Légende du Quaternaire : important pour l’interprétation géomorphologique
● Donne des informations sur les dépôts récents ou actuels ● Même organisation de légende que pour la chronologie
Cette ère est très importante, marqué par un climat important et une phase glaciaire, les roches du quaternaire sont marquées par la glaciation et ces roches ne sont pas consolidées entre elles
Coupe stratigraphique
● Montre la superposition des différentes couches de terrain ● Esquisse tectonique : donne des informations sur l’architecture tectonique : les principales déformations des
roches :
Principaux âges des roches affleurantes
● Principaux accidents tectoniques
Les axes des plis (anticlinaux Ω, synclinaux U, plans axiaux)
Coupe géologique
Important pour la connaissance du relief, c’est une coupe topographique sur laquelle on a reporté l’organisation des couches géologiques situées à proximité de la surface
INTERPRÉTATION DE DOCUMENTS EN GÉOPHYSIQUE
L’ÉTUDE EN GÉOPHYSIQUE
● Consiste à analyser la dynamique naturelle de l’activité d’un territoire
Cette dynamique est le résultat de l’activité et de l’interaction de différents processus climatique, hydrologique, géomorphologique et tectonique L’analyse de ces processus passe autant par l’observation de terrain que par l’étude de différents documents
Récolter les données brutes
● Réunir l’information, sélectionner les documents adéquats
○ La description et la mise en forme de ces données : description des éléments figurants sur les documents, traitement statistique des données
23
Olivier Brand, mineure Géo, cycle de l’eau 1
● L’analyse des données ● Interprétation d’une carte topographique ● Représentation exacte et détaillée de la surface terrestre dans ses caractéristiques physiques permanentes
○ Une carte au 1 :25000 ou au 1 :50000 permet de voir avec précision les formes du terrain, la position des infrastructures et la forme du relief (info sur la morphologie)
○ Avec d’autres sources d’informations (carte géologique par exemple) on peut comprendre les processus liés à la formation et à l’évolution d’une région donnée
○ On peut aussi comprendre l’organisation des éléments anthropiques d’un territoire (emplacements des villages, développement des axes de communication)
○ Avec des cartes historiques on peut voir l’évolution des glaciers, le développement des régions habitées.
4 PHASES
Observation
○ Définir le document : nom de la carte, N° de feuille, année d’édition, échelle, feuilles adjacentes ○ Observer
Localisation spatiale et temporelle
○ Contexte géographique ○ Région ○ Altitude ○ Echelle spatiale : réduite ou vaste ○ Echelle temporelle : donne des informations sur l’aménagement du territoire et du climat, peut changer
avec le temps : carte récente ou historique
Description
● Situer les éléments pertinents et décrire leur forme
○ Coordonnées, altitude, toponymie ○ Eléments pertinents ○ Topo, forme du relief, tout ce qui est lié avec les courbes de niveau ○ Réseau hydrographique ○ Distribution et type de végétation ○ Infrastructures, bâtiments, voies de communication, liens en les reliefs et emplacement d’un village
● Décrire en fonction de :
○ La forme (longueur, concave… ○ Type, distribution, densité
● Structurer la description :
○ Du général au détail ○ Selon les différents plans (photo) ○ Le long des directions générales ○ Selon les différentes unités ou zones homogènes
Explication
● Interprétation géomorphologique des éléments décrits
○ Les formes du relief (morphologie) : origine naturelle ou artificielle ○ Les processus qui sont à l’origine des formes du relief (dynamique) : par ex , vallée en U=cours d’eau ○ Logique de la distribution ou de la localisation : par ex, végétation pas homogène, ravin, avalanche ○ Evolution des formes
Il faut des fois émettre des hypothèses !