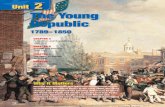Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire : analyse des résultats de 69 lambeaux
Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Oxfordien inférieur) versus Creniceras crenatum...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Oxfordien inférieur) versus Creniceras crenatum...
ISSN 0253-6730
1 20 rue basse du château, F-79400 Saint-Maixent l’Ecole. E-mail : [email protected]
I. INTRODUCTION
La littérature paléontologique concernant l’Oxfordien, fait état de l’attribution du nom Creniceras crenatum (Bruguière, 1789), à deux espèces d’ammonites (Oppe-liidae, Taramelliceratinae), certes morphologiquement quasi identiques, mais situées dans des niveaux stratigra-phiques différents.La première est présente dans l’Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum, la seconde se trouve dans l’Oxfordien moyen, Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis. (Tabl. 1)Le genre Creniceras regroupe des ammonites de pe-tite taille, plus ou moins largement ombiliquées, peu
épaisses, très peu ou pas costulées, dont l’aire ventrale est surmontée d’une carène médiane constituée de créne-lures de force et de direction variables ; des apophyses ju-gales prolongent l’ouverture. Ce dernier caractère laisse à supposer que l’ammonite est adulte. Les espèces du genre Creniceras étant pressenties être des microconques d’autres espèces classées dans la sous-famille des Tara-melliceratinae, Spath, 1928. Peu d’auteurs ont tenté de créer des couples dimorphes (palframan, 1966 ; page, 1994).Les espèces du genre sont (Tabl. 1) :• Crenicerasaudax (Oppel, 1863), Callovien supérieur,
Zone à Athleta. BOnnOt etal. (1995) ont trouvé dans la sous-zone à Collotiformis (Zone à Athleta, Callovien
RevuedePaléobiologie, Genève(juillet 2012) 31 (1) : 51-61
Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Oxfordien inférieur)versus Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Oxfordien moyen)
Philippe Quereilhac1
RésuméDans l’Oxfordien (Jurassique supérieur), deux espèces de Creniceras (Ammonoidea, Ammonitina, Oppeliidae, Taramelliceratinae) portent le même nom d’espèce : Creniceras crenatum (Bruguière, 1789). La première est située stratigraphiquement dans l’Oxfordien inférieur (Zone et sous-zone à Cordatum), la seconde dans l’Oxfordien moyen (Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis).Après étude des différentes publications traitant de ces espèces, il est apparu nombre d’incohérences : imprécision de la position stra-tigraphique de l’ammonite prise pour type de l’Ammonites crenata Bruguière, 1789 ; disparition de ce même type ; date de création de l’espèce (1789) erronée ; lecture de la diagnose imparfaitement interprétée ; attribution approximative, selon les auteurs, à l’une ou l’autre des deux espèces.Une des espèces doit être renommée (Creniceras boreki nov. sp., Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum) et l’autre, qui est aussi celle que l’on associe, par habitude à l’espèce crenatum, est attribuée, en conservant le nom d’espèce, à l’auteur ayant apporté des indications fiables concernant cette ammonite (Creniceras crenatum [Oppel, 1863]), Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis).
Mots-clésJurassique, Oxfordien, Taramelliceratinae, Creniceras.
AbstractCreniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Lower Oxfordian) versus Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) (Middle Oxfor-dian).- There are two species of Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) with the same name both recognized in the Oxfordian (Jurassic) genus Creniceras (Ammonoidea, Ammonitinae, Oppeliidae, Taramelliceratinae). The first one is from the Lower Oxfordian (Cordatum Subzone) and the second one is from the Middle Oxfordian (Luciaeformis Subzone of the Transversarium Zone).After studying the various publications dealing with these species, it appeared many inconsistencies : imprecision in the stratigraphic position of the type-specimen which have disappeared, erroneous introduction date of the species (1789), imperfectly understood diag-nosis and approximate assigning to one or the other species by the authors.It appeared that one of these species have to be necessary renamed (here Creniceras boreki nov. sp., Cordatum Subzone of the Corda-tum Zone, Lower Oxfordian) and the second one (from the Luciaeformis Subzone of the Transversarium Zone), which is also usually named C. crenatum should be attributed to the author who has provided reliable information regarding this ammonite (Oppel, 1863).
KeywordsJurassic, Oxfordian, Taramelliceratinae, Creniceras.
52 Ph. Quereilhac
supérieur de Côte-d’Or, France) une ammonite qu’ils ont attribuée (avec doute) à l’espèce Crenicerasaudax (Oppel). Ils indiquent : « Ces formes sont classiquement attribuées à Crenicerasaudax(Oppel) qui est actuellement la seule espèce décrite du Callovien supérieur. Les spécimens originaux ayant disparu, Dietl a désigné un néotype …/… Les caractères de notre spécimen …/… sont compatibles avec ceux de l’espèce d’Oppel. »
• Creniceras piae Jaeggi, 2008, Oxfordien inférieur, Zone à Mariae, sous-zone à Scarburgense.
• Creniceras renggeri (Oppel, 1863), Oxfordien inférieur, Zones à Mariae et Cordatum pars.
• Crenicerascrenatum(Bruguière, 1789) in BukOwski, 1887, Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum.
• Creniceras lophotum (Oppel, 1863), base de l’Oxfordien moyen, Zone à Plicatilis, sous-zone à Antecedens.
• Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in Oppel 1863, Oxfordien moyen, Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis.
• Crenicerasdentatum (reinecke, 1818) est le dernier représentant du genre, il est situé dans le Kimméridgien, mais son attribution au genre laissant à désirer, il n’est pas considéré dans ce travail (enroulement proche du type proscaphitoïdal, modification de la denticulation ventrale qui, sur la dernière partie de l’ammonite est remplacée par une légère carène).
De grOSSOuvre (1922) crée l’espèce Creniceras gour-binei. Quereilhac et al. (2009) classent cette espèce dans le genre Hecticoceras, car elle présente des carac-tères qui l’écarte du genre Creniceras : les tubercules ventraux ne correspondent pas à ceux des Creniceras s.st., la ligne de suture est simplifiée et le siphon est déje-té, particularité qui n’est connue que dans la sous-famille des Hecticoceratinae. maire (1928) crée deux nouvelles espèces (apparem-ment chacune à partir d’un seul individu) rapportées au genre Creniceras : Creniceras petitclerci et Creniceras champagnolensis. Les descriptions et les photographies de ces deux taxons (costulation, sillon spiro-latéral, cré-nulation) sont en contradiction avec les caractères du genre Creniceras, c’est pour ces raisons qu’elles ne sont pas prises en considération dans ce travail.gygi (1991a) crée une nouvelle espèce, Creniceras infractum. Il indique ainsi la position stratigraphique : « Transversarium-Zone, Parandieri-Subzone (Bir-menstorfer Schichten, Profil RG51, Schicht 4 (siehe gygi, 1977, Taf. 11) Zementstreinbuch bei Oberehren-dingen. AG ». Le rappel qu’il fait à la figure 11 de cette publication n’apporte aucun élément permettant de situer ce taxon, par contre la lecture des successions fauniques (p. 446) permet de voir que dans les bancs 3a et 6 appa-rait l’espèce « Glochiceras » (« Coryceras ») crenatum (Oppel, 1863) [= Creniceras crenatum (Oppel, 1863)], située dans la sous-zone à Luciaeformis). Cette espèce n’est pas prise en compte dans ce travail (1 seul exem-
Tableau 1 : Répartition stratigraphique des représentants du genre Creniceras.
Zone sous-zone Ancienne dénomination Nouvelle dénomination
LuciaeformisC. "crenatum"
(BRUGUIERE, 1789) in OPPEL 1863
C. crenatum (OPPEL, 1863)
ParandieriAntecedensVertebrale
CordatumC. "crenatum"
(BRUGUIERE,1789) in BUKOWSKI 1887
C. boreki nov. sp.
CosticardiaBukowskii
PraecordatumScarburgense
Lamberti
Poculum
Athleta (pars ) CollotiformisCallo
vien
supé
rieu
r
C. lophotum (OPPEL, 1863)
C. audax (OPPEL, 1863)
C. renggeri (OPPEL, 1863)
Transversarium
Etage
Lamberti
Mariae
Cordatum
Plicatilis
moy
enIn
féri
eurO
xfor
dien
C. piae JAEGGI, 2008
Creniceras crenatum versus Creniceras crenatum 53
plaire ; position stratigraphique imprécise). Il est à noter que le déroulement de la coquille s’apparente fortement à celui de l’espèce Creniceras renggeri (Oppel, 1863).
II. HISTORIQUE
II.1. Origine du nom d’espèce (XVIIIe siècle)
Ce serait Bruguière en 1789 qui serait à l’origine du nom d’espèce crenatum, en évoquant une ammonite pa-rue dans un ouvrage de langiuS C.N. (1708) (de son vrai nom lang ) : Ammonis cornu spina dentata, Taf. 23, figs. 1-2. Historia lapidum figuratorum Helvetiae ejusque viviniae, qu’il dénomme Ammonites crenata langiuS, p. 37.Cette date est reconnue, mais elle est erronée. En fait, Bruguière intervient dans le volume 1 de l’Histoire des vers, parue en 1792 (et non en 1789, date de parution du Tome 6 de l’Histoire Naturelle des Insectes de Guillaume Antoine Olivier). Le vol. 1 de l’Histoire Naturelle des Vers, commence ainsi : « AVIS IMPORTANT. La première partie de cette Histoire Naturelle des Vers est en vente, et c’est par erreur qu’elle porte au Frontispice (Note de l’auteur : « Introduction », bas de page à gauche) Tome Sixième, au lieu de Tome Premier. L’Histoire Naturelle des Insectes, par M. Olivier, forme réellement le Tome Sixième ».Extraits de cette publication (orthographe originale) :Page 28.« Suite à l’introduction de l’Histoire Naturelle des Co-quillages.AMMONITES. – Ammonites, auct.Genre de la fammilie des vers testacées qui a pour carac-tere une coquille discoïde, dont la cavité est coupée par des cloisons sinueuses, presque articulées, & percées par un syphon, qui se continue jusqu’au sommet de la spire.Espèces dont la surface est lisse.7. Amm. crenelée.Tours de la spire lisses, carène aiguë & crenelée. »Page 37.« 7. Ammonite crénelée.« Ammonites crenata.Ammonites anfractibus lœvibus, carina acuta crenata ; Nob.Ammonis cornu lœve, spina eminente seu crista dentata marcassitacum minus compressum daorum anfractuum ; Lang. hist. lap. pag. 92, tab. 23, num. 2.Ammonis cornu lœve, spina eminente seu crista dentata marcassitacum minus compressum daorum anfractuum, glebâ minerali obductum ejusd. pag. cad.Ammonis cornu lœve, spina eminente seu crista dentata marcassitacum minus compressum, ejusd. pag. 93, tab. 23, num. 1.Schenchzer. oryc. helvet. num. 19.Corne d’Ammon à dos crénelé, trait. des pétrif. tab. 93, n. 258, 259, planche mauvaise, copiée d’après Langius. »
Description. Je n’ai jamais vu celle-ci plus grande qu’une pièce de douze sous ; on lui trouve au plus deux tours de spire dont la surface est lisse, & la forme semblable à celle de l’espèce précédente ; le tour extérieur a deux fois plus de largeur que le second ; la carène est aiguë et crénelée comme la lame d’une scie, mais les dents sont obtuses & arrondies, & ne commencent à paroitre que quatre lignes au-dessus de l’ouverture ; celle-ci a la forme d’un cœur allongé, la pointe est très prolongée en avant, & ressemble à un bec dans les individus bien conservés.Ceux que je possède ont été trouvés dans le territoire de Boulene, petite ville du comté Venaissin, qui est déjà célèbre par la variété & la belle conservation des co-quillages fossiles qu’on y rencontre.langiuS l’indique en Suisse aux mêmes lieux que l’es-pèce précédente. » (note de l’auteur : la provenance de plusieurs espèces citées dans cet article est : « Suisse sur les Alpes, Sub-Sylvaniæ »).
II.2. XIXe siècle
D’OrBigny (1847) décrit et figure un Ammonites cre-natus Bruguière 1791, qui représente bien l’espèce. Il indique ensuite : « Localités : Propre exclusivement à l’étage Oxfordien dont elle est caractéristique …/… Niort et Saint-Maixant (Deux-Sèvres) ».Oppel (1863) décrit, p. 203, Ammonites crenatus Bru-guière, Oppel. Il indique la provenance de son exem-plaire : « Zone des Amm. Arolicus oder des Amm. trans-versarius in der untern Scyphien-Kalken von Birmens-dorf bei Baden (Canton Aargau) ». De plus il indique que l’ammonite décrite par lang proviendrait, peut-être, de la même localisation stratigraphique (et géographique) que celle qu’il vient de décrire : « woher zweifelsohne die schon von Lang beschreibenen Exemplare stammen. »Oppel & Waagen (1866) situent l’espèce dans la Zone à Transversarium.mOeSch (1872) indique (sans figuration) : « Birmendor-ferschichte (Zone des Ammonites transversarius, Oppel) Ammonites crenatus Bruguière ».BukOWSki (1887) est l’auteur qui a donné la descrip-tion la plus complète de l’espèce crenatum située dans l’Oxfordien inférieur, il la décrit sous le nom d’Oppelia crenata Brug. Il est intéressant de noter que les ammo-nites provenant de la Zone à Cordatum étudiées dans son ouvrage (Czentochau = Częstochowa, Silésie, Pologne) sont constituées de calcaire et non de pyrite.SiemiraDzki (1891), évoque (sans figuration) Oppelia crenata Bruguière, qu’il signale dans la zone à Peltoce-ras transversarium.De lOriOl (In De lOriOl & kOBy, 1896) décrit et fi-gure un exemplaire de l’Oppelia crenata Brug. Il écrit en outre : « Ainsi qu’Oppel l’a fort clairement démontré, l’A. crenatus, dont le type serait représenté par la figure de lang, prise très probablement d’après un exemplaire de Birmensdorf …/… Ainsi que M. BukOWSki l’a déjà
54 Ph. Quereilhac
fait remarquer, la figure citée par d’OrBigny paraît se rapporter très bien à l’A. crenatus mais pas à l’A. reng-geri comme Oppel le croyait avec doute. » Pas de locali-sation stratigraphique.
II.3. XXe siècle
petitclerc (1917) décrit et figure plusieurs exemplaires de Creniceras crenatum Bruguière sp. de l’Oxfordien inférieur = couches à C. renggeri. Ses interrogations se portent surtout sur la longévité de l’espèce du Crenice-ras crenatum (Bruguière, 1789) in BukOWSki, 1887, apparaissant en même temps que le Creniceras renggeri (Oppel, 1863) et qui persisterait dans la Zone à Transver-sarium, sous-zone à Luciaeformis : « car on le trouve en-core dans les marnes à spongiaires à Peltocerras toucasi, Ochetoceras canaliculatum, etc. ». (Note de l’auteur : l’espèce située dans la sous-zone à Luciaeformis est Cre-niceras crenatum [Bruguière, 1789] in Oppel, 1863).De grOSSOuvre (1922), décrit et figure des ammonites trouvées dans les environs de Niort (Deux-Sèvres), il indique que les deux espèces renggeri et crenatum sont présentes dans l’Oxfordien inférieur, mais que seule sub-siste dans l’Oxfordien moyen (et supérieur) la seconde.Extraits de cette publication : « Plus haut, immédiatement sous les couches à spongiaires de l’Oxfordien supérieur, des marnes grises bleuâtres ont été entamées à la base des tranchées de Grosses-Terres et d’Aiffres. Elles ren-ferment une faune abondante de petites ammonites pyri-teuses de sorte qu’au premier abord et surtout à cause de l’abondance d’un Creniceras qu’on a rapporté au C. renggeri, on les a parallélisées avec les marnes de l’Est. Mais cette apparence est trompeuse, car le Creniceras en question n’est pas le renggeri, mais le crenatum. » …/… Le Creniceras crenatum est très abondant dans les marnes oxfordiennes des environs de Niort, mais il y est de petite taille, 17 mm de diamètre au plus. La grosseur des tubercules siphonaux est très variable. Alors que M. P. petitclerc a observé dans les marnes de l’Oxfordien inférieur de l’est des Creniceras crenatum associés aux Creniceras renggeri prédominants, je n’ai pu trouver au-cun échantillon de ce dernier dans les marnes de l’Oxfor-dien moyen de l’Est. Jeannet (1951) indique Creniceras renggeri au niveau D1 (Callovien entre Z. Athleta et Z. Lamberti) et Creni-ceras crenatum, présent dans les niveaux F3 (Cordatus Schichten) et G (Birmensdorfer Schichten = ? Z. Plicati-lis et Z. Transversarium). Toutes les photos sont inexploi-tables, le texte est peu explicite.ziegler (1956) indique que Creniceras crenatum (Bru-guière) provient de la Zone à Transversarium.SchirarDin (1958) indique avoir trouvé dans la sous-zone à Praecordatum un exemplaire de Creniceras cre-natum Bruguière à propos duquel il écrit : « les tuber-cules siphonaux sont peu nombreux et assez larges ; ils disparaissent sur la loge ». Pas de figuration : la position
stratigraphique donnée, la description de la tuberculation siphonale ainsi que leur disparition sur la loge excluent cet individu de l’espèce située dans l’Oxfordien inférieur.ziegler (1958, p. 120 et passim) invalide le genre Creniceras, et reclasse l’espèce crenatum (Oppel, non Bruguière, 1863) dans la Famille des Glochiceratidae hyatt, 1900 (1913), Sous-famille des Glochiceratinae hyatt, 1900 (1913), Genre Glochiceras hyatt, 1900 (1913), Sous-genre Coryceras ziegler 1958. Glochice-ras (Coryceras) crenatum (Oppel, 1863) est une espèce de la Zone à Transversarium. En outre il indique (p. 121), que l’un des type de l’espèce (lang, 1708, S. 92, Taf. 23, Fig. 2) se rapporterait au Creniceras renggeri (Oppel, 1863). Il dissocie cette espèce, en l’attribuant à Oppel, de celle placée dans l’Oxfordien inférieur.malinOWSka (1963) présente la répartition stratigra-phique de C. crenatum (Brug.) identique à celle de Cre-niceras renggeri (Tab. 2, p. 17). Certaines de ses figura-tions de C. crenatum (in BukOWSki) ont bien les carac-tères de l’espèce, d’autres sont de trop mauvaise qualité pour leur attribuer ce nom d’espèce.tarkOWSki (1984), évoque 6 exemplaires en provenance de Podleze – sous-zone à Bukowskii. Si ses exemplaires ont bien les caractères de l’espèce, ils sont placés trop bas dans la stratigraphie (base de la Zone à Cordatum).matyJa (1986) évoque le genre Creniceras, il écrit et propose un tableau de répartition des espèces qui ne cor-respond pas à la position stratigraphique des espèces. Il indique : « in the Lamberti Zone through the Cordatum Zone, it is represented by Creniceras renggeri (Oppel) and Creniceras crenatum (Bruguière) ».Pour gygi (1991a), l’espèce crenatum (Bruguière, 1789) est toujours classée, (à l’égal de ziegler, 1958), dans le genre Glochiceras hyatt, 1900 (1913), sous-genre Coryceras ziegler, 1958. La position stratigra-phique qu’il donne de l’espèce n’est pas bonne « Jüngere Antecedens-Subzone bis Parandieri-Subzone der Trans-versarium-Zone in der Schweiz, in Süddeutschland, in Frankreich und in Polen. » (Note de l’auteur : position stratigraphique de l’espèce Creniceras lophotum [Oppel, 1863]).gygi (1991b) indique qu’il n’a trouvé ni trace du lieu de récolte, ni même les niveaux (il évoque même l’Oxfordien inférieur) des ammonites de la collection Bruguière, qui ont été trouvées dans le Territoire de Boulene, comté Venaissin. Le terme « territoire » est assez vague et ne donne aucune idée de sa superficie : s’agissait-il d’un comté, d’une région ? Les ammonites de la collection Bruguière n’ont aucun rapport avec celles de la collection langiuS (à l’origine du nom d’espèce) qui proviennent de la « Suisse sur les Alpes, Sub-Sylvaniæ » et non de Bollène dans le département du Vaucluse (France).Lors de la révision des céphalopodes jurassiques de la collection D’OrBigny, enay & gauthier (1994), ayant en charge la révision de l’espèce Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) indiquent qu’une partie de la collec-
Creniceras crenatum versus Creniceras crenatum 55
tion a disparu (certainement détruite par l’oxydation de la pyrite) et que l’original figuré par D’OrBigny ne se trouve pas dans ceux restant. Les exemplaires conser-vés sont alors rapportés à l’espèce Creniceras renggeri (Oppel, 1863), ils invalident l’espèce Creniceras cre-natum (Bruguière, 1789) au fait que sa description ne correspond ni à la figuration ni au texte originel de lang. Ils valident le nom d’espèce Creniceras renggeri (Oppel, 1863) (et non Glochiceras (Coryceras) crena-tum (Oppel, 1863) in ziegler 1958) pour l’espèce située stratigraphiquement dans la Zone à Marie et dans la base de la Zone à Cordatum (Oxfordien inférieur), ainsi que le nom d’espèce Creniceras crenatum (Oppel, 1863) pour celle présente dans la Zone à Transversarium, suivant en cela l’opinion de ziegler (1958).
III.4. XXIe siècle
Quereilhac (2009) dans son étude sur la sous-famille des Taramelliceratinae discute de l’espèce crenatum (Bruguière, 1789) en lui conservant son classement dans le genre Creniceras munier-chalmaS, 1892. Il précise sa position stratigraphique (collectes personnelles et position stratigraphique in gygi, 1991a et ziegler, 1956, 1958) : Oxfordien moyen, Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis.Quereilhac et al. (2009) « retrouvent » un gisement similaire (et peu éloigné) de celui dans lequel de grOS-SOuvre en 1922 avait collecté, décrit et figuré un cer-tain nombre d’ammonites de la sous-zone à Cordatum (confirmée par l’association des faunes collectées). La collecte de l’espèce Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in BukOWSki, 1887 (892 individus) a permis une étude assez poussée.JarDat (2010) dans sa publication sur les faunes de l’Oxfordien inférieur du Jura, n’a pas évoqué l’espèce Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in BukOWSki 1887, malgré l’étude de plus de 40 coupes s’étendant sur la totalité de l’Oxfordien inférieur et la récolte de plu-sieurs dizaines de milliers d’ammonites.
III. RÉVISION
A la lecture des informations données par Bruguière (1792), il apparaît que les auteurs successifs ont mal in-terprété celles-ci.La date d’édition du volume 1 de l’Histoire naturelle des vers, est 1792 et non 1789 comme généralement indiquée et de ce fait, la date de création de l’espèce Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) est fausse.Une autre lacune des différents auteurs est la non-lecture (hormis ziegler, 1958), dans la synonymie de Bru-guière, de la retranscription des descriptions données par lang pour les ammonites qu’il a représentées (1708, Taf. 23, figs. 1-2) dans l’ouvrage Historia lapidum figu-
ratorum Helvetiae ejusque viviniae. En effet, les descrip-tions originales mentionnent (entre autres) : « Ammonis …/… marcassitacum », ce terme est sans ambigüité, les ammonites présentées sont donc fossilisées en marcassite (pyritisées). Les faciès de la sous-zone à Luciaeformis (Oxfordien moyen), dans lesquels se trouve le Crenice-ras crenatum (Bruguière, 1789) in Oppel 1863, sont constitués de calcaires.Les types de l’espèce Ammonites crenata lang, 1708 in Bruguière, 1792 auxquels l’auteur se réfère (langiuS, Taf. 23, figs. 1-2), du fait de leur constitution (marcas-site), pourraient être des Creniceras renggeri (Oppel, 1863), au contraire des informations données par Oppel (1863) et De lOriOl (1898), ces deux auteurs rapportant l’espèce de lang à Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in Oppel, 1863. Par contre, Bruguière indique, sans que l’on sache s’il décrit les ammonites de lang ou les siennes, « on lui trouve au plus deux tours de spire ». Il pourrait donc s’agir d’une espèce à ombilic ouvert, ce qui exclut de fait le Creniceras renggeri (Oppel, 1863). Par contre, la description (?) de la carène qui ne couvrirait pas la totalité de la loge est en contradiction avec celle de Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in BukOWSki, 1887.Il s’agit donc d’espèces « nomina dubia » (terme des-criptif concernant un nom d’application inconnue ou douteuse). En vertu de l’article 70bii (p. 138) (non article 49, p. 90) du Code International de Nomenclature Zoolo-gique (1985), il est donc préférable de changer de types, de nom d’auteur et de date de création de chacune de ces espèces. Toutefois le nom d’espèce « crenatum » sera conservé pour l’une d’entre elles : l’auteur à laquelle elle sera attribuée (Oppel, 1863) étant celui auquel on associe le plus aisément l’espèce située stratigraphiquement dans la Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis.De tout ceci, il résulte que :- Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in BukOWSki
1887, Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum, est considérée comme une nouvelle espèce et est renommée, dans ce travail Creniceras boreki nov. sp.
- Creniceras crenatum (Bruguière, 1789) in Oppel 1863, Oxfordien moyen, Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis, est renommée Creniceras crena-tum (Oppel, 1863).
IV. SYSTÉMATIQUE
Ordre Ammonoidea Zittel, 1884Sous-ordre Ammonitina Hyatt, 1889
Super-famille Haploceratoidea Zittel, 1884Famille Oppeliidae Douvillé, 1890
Sous-famille Taramelliceratinae SpatH, 1928Genre Creniceras Munier-CHalMaS, 1892
Type species : Ammonites Renggeri Oppel, 1863
56 Ph. Quereilhac
IV.1. Oxfordien inférieur
Creniceras boreki nov. sp.Text-Fig. 1, figs 1-7
Locus typicus : Frywald, région Zalas, Pologne.Derivatio nominis : espèce dédiée aux membres de la famille BOrek, (Iwona, Karolinae et Robert - Dabrowa Górnicza, Pologne) en remerciement pour leur contribu-tion à ce travail.Stratum typicum : Oxfordien inférieur, Zone à Corda-tum, sous-zone à CordatumHolotype : Text-Fig. 1, fig. 1 a-c, spécimen n°IKR01, D = 25 mm, en provenance de Frywald, région Zalas, Pologne (legs Famille Borek)Recherche et désignation d’un holotype :Ainsi qu’évoqué ci-dessus, les espèces décrites (ou évo-quées) et figurées par lang (1708), Bruguière (1792), D’OrBigny (1847), De lOriOl (1896) ont disparu ou ne présentent pas de fiabilité stratigraphique assez pré-cise pour être considérées comme valables. Seul l’un des individus figurés par BukOWSki (1887), Taf. XXV [1], fig. 9, individu pourvu de l’ouverture que prolongent les départs d’apophyses jugales, aurait pu être pris comme type de l’espèce. L’auteur a appris que les fossiles figurés dans la publication de BukOWSki (1887) pouvaient être dans les collections du Muséum de Vienne (Autriche). Monsieur lukeneDer, qui a été contacté à cet effet, a aimablement répondu, après avoir recherché en vain ces ammonites, que la collection BukOWSki devait être
déposée à l’Université de Vienne (Autriche). L’auteur a alors contacté sans succès les responsables de cette Uni-versité. Il a ensuite recherché où pouvait être déposée la collection petitclerc (1917), il était apparu que celle-ci avait été déposée au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, mais qu’elle aurait ensuite été déplacée, en partie, à la Faculté de Jussieu (Paris). De guerre lasse, l’auteur a décidé de prendre pour holotype l’une des ammonites léguées par la famille BOrek (IKR 01), ammonite en cal-caire blanchâtre pourvue du départ d’apophyses. Les ammonites figurées et étant propriétés temporaires de l’auteur (IKR 01, IKR 02, IKR 03, DS1, DS 2) seront déposées au Musée “Les Rives d’Auron, 18000 Bourges”.Synonymie1708. nonAmmoniscornuspinadentata langius, pl. 23, figs
1-2.1789. nonAmmonitescrenata langius.- Bruguières p. 37.1887. Oppelia crenata Brug.- BukOwski, p. 122-123, pl.
XXV [1], figs 8-10.1896. (?) Oppeliacrenata Brug.- De lOriOl & kOBy, p. 17,
pl. 1, fig. 7.1917. Crenicerascrenatum Bruguière sp. petitclerc, p. 33,
pl. 4, figs. 4-6, 8-9.1922. Taramelliceras (Creniceras) crenatum Brug.- De
grOssOuvre, p. 300-301.1922. pars Taramelliceras(Creniceras)crenatumBrug.- De
grOssOuvre, p. 311.1963. pars CrenicerascrenatumBruguière.- MalinOwska,
p. 17, pl. 4, figs. 21-28.2009. Crenicerascrenatum Bruguière.- Quereilhac etal.,
p. 3-4, pl. 3, figs. 3-7.
Text-Fig. 1 : Creniceras boreki nov. sp. : 1 a-c - n°IKR01, holotype, D = 25 mm (Zalas rég. Frywald, Pologne, legs Famille BOrek) ; 2 - D = 23 mm (nucleus [x2] 1,7 mm) (Doubs, France, coll. M. Barkat ) ; 3 – D = 23,5 mm (Doubs, France, photo et coll. M. clerc) ; 4 - IKR02, D = 24 mm (Ogrodzienec reg. Bzow Kam, Pologne, legs Famille BOrek) ; 5 - IKR03, D = 20,5 mm (Zalas rég. Frywald, Pologne, legs Famille BOrek) ; 6 - DS1 – D = 11 mm (Deux-Sèvres, France) ; 7 - DS2, D = 13,5 mm (Deux-Sèvres, France).
1a-c
5a-c 1 cm
2 3
4
6
1 cm
7
Creniceras crenatum versus Creniceras crenatum 57
Diagnose : Ammonite de taille réduite, peu épaisse, à ombilic ouvert laissant apparaître les tours internes. Les flancs lisses, sont parfois marqués de rides, ou côtes peu en relief, la crénulation médio-ventrale est de force va-riable et orne la quasi-totalité de la loge d’habitation. La section est ogivale élevée.Description : Ammonite de petite taille, peu épaisse, involute, à déroulement régulier. Flancs peu convexes généralement lisses possédant leur plus forte épaisseur en leur milieu. La chambre d’habitation occupe environ ½ tour.La région ventrale arrondie est ornée de crénelures indi-viduelles, peu épaisses, non aiguës, très souvent spatu-lées, qui, sur les individus les mieux conservés, semblent partagées en deux parties par un sillon vertical plus ou moins fortement exprimé. Leur force est variable et fonction du diamètre final de l’adulte. Elles sont pré-sentes sur plus des trois-quarts de la coquille et couvrent la quasi-totalité de la chambre d’habitation. Ouverture munie d’apophyses jugales spatulées.Certains individus présentent à mi-flanc, sur le dernier quart de tour, une impression de sillon spiral. Celui-ci semble constitué d’une série de très légers chevrons pro-verses. La costulation sur les individus les mieux conservés ap-paraît souvent, en plus du « sillon », sous forme de légères côtes. petitclerc (1917) indique quant à lui que l’un de ses spécimens aurait une costulation très marquée. La variabilité de la taille adulte constatée à Niort est grande : de 9 mm à 19 mm (Quereilhac et al., 2009).
IV.2. Oxfordien moyen
Creniceras crenatum (oppel, 1863)Text-Fig. 2, figs 1-6
Derivatio nominis : En rapport aux crénelures larges et espacées de la carèneLocus typicus : Birmensdorf bei Baden (Canton Aargau)Stratum typicum : Zone à TransversariumNéotype : (Text-Fig. 2, fig. 1a-b) désigné par ziegler (1958) : Ammonites dentatus QuenSteDt, 1887, Tab. 85, Fig. 31 (Unterer Weissjura alpha, Birmensdorf). Staat-liches Museum für Naturkunde, 70191 Stuttgart, Ger-many, exemplaire référencé SMNS no. 28419 : D =21,3 mm, e = 4,8 mm ; reproduit ici grâce à l’obligeance du Dr Günter SchWeigert.
Synonymie1708. nonAmmoniscornuspinadentata langius, pl. 23,
figs 1-2.1789. non Ammonitescrenata langius.- Bruguière, p.
37.1863. Ammonitescrenatus Bruguière.- Oppel, p. 203. 1866. Ammonites crenatus Bruguière.- Oppel &
waagen, p. 217, 232, 244, 247, 248, 269, 258.1886-1887. Ammonites dentatus QuensteDt, p. 740, pl. 85,
figs 31-32.1888. Ammonitesdentatus, QuensteDt, p. 844, pl. 92,
figs 19-21.1956. Creniceras crenatum (Bruguière).- Ziegler, p.
570, Abb 12 a-b ; Abb. 13, Fig. g.1958. Glochiceras (Coryceras) crenatum (Oppel non
Bruguière).- Ziegler, p. 42, pl. 12, fig. 9.
Text-Fig. 2 : Creniceras crenatum (Oppel, 1863) : 1 - Ammonites dentatus QuenSteDt, 1887, SMNS no. 28419 D = 21,3 mm (Photo G. SchWeigert) ; 2 - D = 22 mm (Poitou) ; 3 - D = 20,5 mm (Poitou), 4 - D = 20,5 mm, 5 - D = 23 mm (Suisse, photos et coll. C. Jaeggi)
1a-b
1 cm
2
3 4 5
58 Ph. Quereilhac
1991a. (?) Glochiceras (Coryceras) crenatum (Bru-guière).- gygi, p. 16-17, pl. 4, figs 2-6.
2009. Creniceras crenatum (Bruguière, 1789).- Que-reilhac, p. 13-15, pl. 13, figs 1-8.
Description : Ammonite de petite taille (qui ne dépas-serait pas 25 mm), peu épaisse, involute, à déroulement régulier. Flancs peu convexes généralement lisses possé-dant leur plus forte épaisseur en leur milieu. La chambre d’habitation occupe d’environ ½ tour. La région ventrale arrondie est ornée de crénelures fortes, épaisses et espa-cées présentes sur environ 120° dont 90° sur la chambre d’habitation, qui, de ce fait, n’est pas totalement ornée de cette carène. Ouverture munie d’apophyses jugales spatulées.Certains individus présentent, à mi-flanc sur le dernier quart de tour, une impression de sillon spiral. Celui-ci semble parfois constitué d’une série de très légers che-vrons proverses. Si costulation il y avait, celle-ci ne paraît pas. Le mode de conservation dans ce niveau (moules internes en calcaire), n’a pas conservé une éventuelle livrée, au contraire des individus de l’Oxfordien inférieur dont la fossilisation sous forme de fossiles pyriteux (hormis en Pologne où la Zone à Cordatum est constituée de cal-caires) est plus délicate.
Discussion commune aux deux espècesIl est peu probable de confondre ces deux espèces, la ca-rène ventrale sur la chambre d’habitation étant présente jusqu’à l’ouverture chez Creniceras boreki nov. sp., alors qu’elle disparaît dans la seconde moitié de loge chez Cre-niceras crenatum (Oppel, 1863). Il n’est pas possible de les confondre avec Creniceras renggeri (Oppel, 1863) qui présente avec l’apparition de la loge un déroulement, alors que les tours internes sont involutes et l’ombilic réduit à un point.Il est possible de confondre ces deux espèces avec Cre-niceras lophotum (Oppel, 1863), espèce de position stra-tigraphique intermédiaire (Zone à Plicatilis, sous-zone à Antecedens), qui possède une crénulation ventrale relati-vement plus fine que celle de Creniceras crenatum (Op-pel, 1863). Les crénelures de Creniceras boreki nov. sp. étant plus proches de celles de l’espèce Creniceras reng-geri (Oppel, 1863) que de celles des espèces Creniceras lophotum (Oppel, 1863) et Creniceras crenatum (Oppel, 1863) sont radiales et aiguës. Une collecte globale des faunes présentes dans les gisements (associations fau-niques) permet en outre d’éviter toute confusion.
V. CONCLUSIONS
Depuis la création de l‘espèce crenatum par Bruguière en 1789, existait une forte confusion. En effet, deux es-
pèces attribuées au même genre (Creniceras), portant le même nom, mais se trouvant dans des niveaux stratigra-phiques différents, fort éloignés temporellement l’un de l’autre, étaient attribuées au même auteur.Le fait d’avoir renommé ces deux espèces permet dès lors de les différencier. Leur position stratigraphique n’ayant jusqu’alors pas été suffisamment prise en compte, cha-cune de ces deux espèces aura désormais son propre nom associé à une position stratigraphique stricte : Creniceras boreki nov. sp. (Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum) et Creniceras crenatum (Oppel, 1863) (Oxfordien moyen, Zone à Transversarium, sous-zone à Luciaeformis).Reste le problème du dimorphisme sexuel envisageable Creniceras/Taramelliceras (qui dépasse cependant le cadre de cet article). palframan (1966) et page (1994) ont créé des couples dimorphes. Si palframan associe Creniceras renggeri (Oppel, 1863) avec Taramelliceras richei (De lOriOl, 1898), page indique que Creniceras renggeri (Oppel, 1863) pourrait être le microconque soit de Taramelliceras richei (De lOriOl, 1898) soit de Tara-melliceras oculatum (phillipS, 1829).Certains couples dimorphes de Taramelliceratinae ont été reconnus (Quereilhac, 2009). Les microconques adultes possèdent des caractères morphologiques simi-laires à ceux des jeunes macroconques présentant un tour de spire entièrement costulé ; costulation très proche, voire commune aux deux dimorphes, qui, parfois accen-tuée, persiste chez le microconque jusqu’à la fin de l’in-dividu.Cette similitude ornementale n’est plus observable chez les macroconques adultes du fait que, dans la majorité des cas, la costulation de la loge d’habitation, qui occupe le dernier demi tour de coquille, est très atténuée voire absente.Les macroconques de Taramelliceratinae ayant une évo-lution rapide avec changement brusque de morphologie en relation avec l’environnement (facteurs écologiques : transgression ou régression marine, température du mi-lieu ambiant, épaisseur de la tranche d’eau (profondeur), pression, pénétration du rayonnement lumineux, salinité du milieu, présence d’éventuelles turbulences, vitesse des courants, richesse en oxygène, profusion plus ou moins grande de nourriture) et les Creniceras n’évoluant que très peu (au niveau de la coquille), on pourrait penser que les microconques supposés (Creniceras s.st.) ne subis-saient pas l’influence de leur environnement et/ou, tant que le couple dimorphe ne sera pas reconnu, qu’ils n’oc-cupaient pas les mêmes niches écologiques (biotopes).Certains auteurs ont émis des hypothèses sur l’occupa-tion possible de biotopes différents, par les dimorphes :- cariOu et al. (1987, Taramelliceratinae, p. 509) : « Il
se peut que le dimorphisme n’ait pu être établi faute d’un matériel insuffisant ou tout simplement à cause du nombre limité de localités qui ont fourni des exem-plaires. En effet, les dimorphes conspécifiques ne sont pas toujours associés dans les gisements (tri hydrody-
Creniceras crenatum versus Creniceras crenatum 59
namique, facteurs écologiques ?) ».- BOnnOt (1995, Thèse, p. 426), indique pour la sous-
famille des Peltoceratinae : « Les dimorphes sont tou-jours récoltés dans les mêmes niveaux et …/… qu’il est envisageable que les dimorphes restaient ensemble jusqu’au stade adulte ». Pour ceux de la sous-famille des Eusapidoceratinae, il indique que les dimorphes se trouvent parfois dans des faciès différents, et il suppose que les microconques pourraient être plus pélagiques et, vu leur petite taille, inféodés au plancton : « Leur absence ou leur rareté dans les formations de plate-forme peu profonde, trouverait ainsi une explication suffisante ».
Si la morphologie des Creniceras ne change pratique-ment pas, pour la totalité des espèces du genre, il est concevable de penser que leurs supposés macroconques respectifs, au sein de la sous-famille des Taramellicerati-nae pourraient avoir certaines caractéristiques morpho-logiques comparables entre elles, durant la « durée de vie » du genre Creniceras.Sur quels critères pourrait-on se baser pour définir le di-morphisme (supposé) Creniceras [m]/Taramelliceratinae [M] ? :• Les Creniceras ne sont pas (ou très peu) costulés ;
les tours internes des Taramelliceratinae possèdent, dans la majorité des cas, une costulation marquée, constituée de côtes soit falciformes rebroussées à mi-hauteur du flanc, soit sigmoïdes. Ceci pourrait en partie expliquer la particularité évoquée dans la description des espèces C.boreki nov sp. et C.crenatum (Oppel, 1863) : « Certains individus présentent à mi-flanc, sur le dernier quart de tour, une impression de sillon spiral. Celui-ci semble constitué d’une série de très légers chevrons proverses ».
• Les Creniceras sont ornés d’une carène médio-ventrale constituée de crénelure plus ou moins fortes, individualisées, présentes sur tout ou partie sur la loge d’habitation ; de nombreux Taramelliceratinae sont ornés d’une carène médio-ventrale sur leurs tours jeunes, mais en général elle est soit punctiforme, soit constituée de crénelures aigues, de nombre et de force variable qui apparaît peu de temps avant la loge d’habitation, et très souvent persiste et se renforce sur celle-ci.
• La section des Creniceras est ogivale plus ou moins épaisse, jamais globuleuse ; la section des Taramelliceratinae peut être ogivale aigüe (Taramelliceras richei [De lOriOl, 1898]) ; ovoïde (Taramelliceras (Proscaphites) anar [Oppel, 1863]) ; subrectangulaire (Taramelliceras (Taramelliceras)maximei Quereilhac, 2009) ou globuleuse (Sphaerodomitesglobulus [De lOriOl, 1900]).
• Le phylum « Creniceras » est parfois interrompu, serait-ce à dire que dans les niveaux ou n’apparaît pas le genre, les espèces auraient pu adopter une morphologie « Taramelliceratinae [m] » ?
• Chaque espèce du genre Creniceras pourrait-elle être
commune à différentes espèces de Taramelliceratinae [M] ?
• Les différentes espèces de Taramelliceratinae [M] sont elles réelles, la notion de polymorphisme a-t-elle été suffisamment prise en compte ?
• On peut aussi plus simplement supposer qu’une même population renferme des microconques appartenant en fait à plusieurs espèces mais que, vues leur petite taille et l’absence de caractères réellement discriminants (on ne dispose souvent que du moule interne de la coquille, et on ne connaît rien des parties molles), on ne sache tout simplement pas les distinguer (on se rapproche de la notion générale d’espèces jumelles).
Il est aussi possible qu’au sein du genre Creniceras puisse exister un dimorphisme sexuel, non encore défini :- taille, - diamètre relatif de l’ombilic, - apophyses vraies vs apophyses « atrophiées », mais cela
entrerait en contradiction avec le fait que les individus de ce genre sont tous pourvus d’apophyses jugales, apparat généralement attribué uniquement aux ammo-nites microconques.
Actuellement, trop d’incertitudes subsistent pour créer des couples dimorphes Creniceras [m]/Taramellicerati-nae [M] ; la recherche prioritaire devant s’orienter (après avoir vérifié le non polymorphisme intraspécifique au sein des macroconques de Taramelliceratinae [M] exis-tants) vers la possibilité de créer des couples dimorphes dans les espèces (hors Creniceras) de Taramelliceratinae présents dans les « niveaux à Creniceras ». La restric-tion (argumentée) du nombre d’espèces macroconques (« célibataires ») pourrait alors permettre d’envisager plus sereinement des couples dimorphes Creniceras [m]/Taramelliceratinae [M].
REMERCIEMENTS
L’auteur remercie les scientifiques qui lui ont prêté leur concours dans la recherche d’éléments relatifs aux ammonites des anciennes collections déposées dans les Universités, ainsi que les amateurs qui ont aimablement collaboré à l’élaboration de cette étude : Dr. Andrzej WierzBOWSki ; Dr. Günter SchWeigert ; Pr. Alexandre lukeneDer ; Rémi JarDat ; Marc Barkat ; Michael clerc ; Iwona, Karolinae et Robert BOrek (Pologne) ; Christoph Jäggi (Suisse).
BIBLIOGRAPHIE
BOnnOt, A. (1995, inédit) - Les Aspidoceratidae (Ammonitina) en Europe occidentale au Callovien supérieur et à l’Oxfor-dien inférieur. Thèse Université de Bourgogne, Centre des Sciences de la Terre : 1-454.
BOnnOt, a., D. marchanD & p. neige (1999) - Les Oppelii-dae (Ammonitina) de l’horizon à Collotiformis (Callovien
60 Ph. Quereilhac
supérieur, zone à Athleta) de la région dijonnaise (Côte-d’Or, France). Annales de Paléontologie, 85 (4) : 241-263.
Bruguière, J.-G. (1792) - Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle des vers. Tome 1. Chez Panckoucke, Imprimeur-Libraire, Paris, i-xviij et 1-757.
BukOWSki, G. (1887) - Über die Jurabildungen von Czensto-chau in Polen. Beiträge zur Paläontologie Österreich-Hungarns, Stuttgart, 5 : 1-111.
cariOu E. & A. SeQueirOS (1987) - Les Taramelliceras (Ammonitina, Taramelliceratinae) du Callovien : décou-verte de formes ancestrales et origine progénétique présu-mée à partir du genre Paralcidia (Oppeliinae). Geobios, Villeurbanne, 20 (4) : 495-515.
Del campana, A. (1905) - Fossili del Giura superiore nei sette Communi. Atti della reale Accademia dei Lincei Classe di scienze fisiche e matematica natura, 12 (2), 5(9) : 382-387.
De grOSSOuvre, A. (1922) - L’Oxfordien moyen des environs de Niort. Bulletin de la Société Géologique de France, Paris, 4 (21) : 297-316.
De lOriOl, P. & E. kOBy (1896) - Étude sur les mollusques et brachiopodes de l‘Oxfordien supérieur et moyen du Jura bernois. 1ère partie. Mémoires de la Société paléontolo-gique Suisse, Genève, 23 : 4-77.
De lOriOl, P. & E. kOBy (1898) - Étude sur les mollusques et brachiopodes de l‘Oxfordien inférieur ou Zone à Ammo-nites renggeri du Jura bernois par P. De lOriOl, accompa-gnée d’une notice stratigraphique par E. kOBy, professeur. Mémoires de la Société paléontologique Suisse, Genève, 25 : 1-115.
Dietl, g. (1993) - Der punctulatum-Horizont- ein neuer Ammonitenfaunen-Horizont aus dem schwäbischen Orna-tent-Ton (Ober-Callovium, Mittlerer Jura). Geologische Blätter für Nordost-Bayern, Erlangen, 43 (1-3) : 15-32.
D’OrBigny , A. (1847) - Paléontologie française. Description de tous les animaux mollusques et rayonnés, fossiles de France, comprenant leur application à la reconnaissance des couches. Terrains jurassiques. Tome premier (1842/1851), comprenant les céphalopodes. Paris, Masson V., Libraire-Editeur : 1-642.
DOuville, H. (1890, inédit) - Note pour le cours de paléonto-logie professé à l’École des Mines.
enay, R. & T. gauthier (1994) - Révision critique de la Paléontologie française d’Alcide d’Orbigny. Volume I - Céphalopodes jurassiques. In : fiScher J.C. (Dir.). Masson ed., Paris, 1-340.
gygi, R.A. (1977) - Revision der Ammonitengattung Gregory-ceras (Aspidoceratidae) aus dem Oxfordian (Oberer Jura) der Nordschweiz und von Süddeutschland. Taxonomie, Phylogenie, Stratigraphie. Eclogae Geologicae Helvetiae, Basel, 70 (2) : 435-542.
gygi, R.A. (1991a) - Die vertikale Verbreitung der Ammoni-ten-Gattungen Glochiceras, Creniceras und Bukowskites im Späten Jura der Nordschweiz und im angrenzenden Süddeutschland. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Stuttgart, Ser. B, 179 : 1-41.
gygi, R.A. (1991b) - Proposed validation of the specific names crenatus BruguièreS, 1789 and renggeri Oppel, 1863 (Class Cephalopoda, order Ammonoidea) from the Oxford-ian stage of the Upper Jurassic. Paläontologische Zeits-chrift, Stuttgart, 65 : 119-125.
hyatt, A. (1889) - Genesis of the Arietidae. Smithsonian
Contributions to Knowledge, Washington D.C., 673 : i-xi et 1-238.
hyatt, a. (1913) - Text-book of paleontology. 2nd edition revised and enlarged by the editor in collaboration with the following-named specialists. In : zittel K.A. Eastman editor, London : 1-839.
Jäggi, C. (2008) - Creniceras ? piae n. sp. (Ammonoidea, Oppeliidae) aus der Scarburgense-Subzone des Wey-mouth-Members von Warboys Clay Pit, England. Revue de Paléobiologie, Genève, 27 (1) : 113-122.
internatiOnal cOmmiSSiOn On zOOlOgical nOmencla-ture (1985) - Code International de nomenclature paléon-tologique. 3e édition. Adopté par la XXe assemblée générale de l’Union Internationale des Sciences Biologiques. The International trust for Zoological Nomenclature, London : 1-181.
JarDat, R. (2010) - L’évolution des peuplements d’ammonites au cours de l’Oxfordien inférieur (zone à Mariae et zone à Cordatum) du Jura (Est de la France). Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Article 2010/07 (CG2010_A07) : 1-15.
Jeannet, A. (1951) - Die Eisen- und Manganerze der Schweiz. Stratigraphie und Palaeontologie des oolithischen Eisen-erzlagers von Herznach und seiner Umgebund. Beiträge zur Geologie der Schweiz. Geotechnische, Zürich, 13, 5(5) : 1-238.
langiuS, C.N. (1708) - Historia lapidum figuratorum Helve-tiae ejusque viviniae.
maire, V. (1928) - Contribution à la connaissance de la faune des marnes à Creniceras renggeri, dans la Franche-Comté septentrionale. Étude sur les Oppeliidés. Travaux du Labo-ratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon, 12(10) : 1-60.
malinOWSka, L. (1963) - Stratygrafia Oksfordu jury Czesto-chowskiej na Podstawie amonitow. Instytut Geologiczny, Prace, Warszawa, 36 : 1-122.
matyJa, B.A. (1986) - Developmental polymorphism in oxfordian ammonites. Acta Geologica Polonica, Wars-zawa, 36(1-3) : 37-67.
mOeSch, C. (1872) - Der Jura in den Alpen der Ost-Schweiz. Druck von Zürcher & Furrer, Zürich : 1-33.
munier-chalmaS (1892) - Sur la possibilité d’admettre un dimorphisme sexuel chez les ammonitidés. Bulletin de la Société Géologique et Minière, 3, 25(1) : 107.
Oppel, A. (1863) - Über jurassische Cephalopoden. Paleontol-ogische Mittheilungen aus dem Museum des Koeniglischen Bayerischen Staates, Stuttgart, 1(3) : 127-266.
Oppel, A. & W. Waagen (1866) - Uber die Zone des Ammo-nites Transversarius. Geognostische paläontologische Beiträge, München, 1(2) : 207-318.
page K.N. (1994) - 5. Ammoniten. In : martill, D.m. & W. riegraf, Fossilien des Ornatenton und Oxford-Clay. Ein Bestimmungsatlas. Goldschneck, Korb : 117-149.
palframan, D.F.B. (1966) - Variation and ontogeny of some oxfordian ammonite : Taramelliceras richei (De lOriOl) and Creniceras renggeri (Oppel), from Woodham, Buc-kinghamshire. Paleontology, Glicester, 9(2) : 290-311.
petitclerc, P. (1917) - Note sur les fossiles nouveaux rares ou peu connus de l’Est de la France. Vesoul : 1-52.
QuenSteDt, F.A. (1887) - Die Ammoniten des Schwäbischen Jura. 3. Der Weisse Jura. (1887-1888). Stuttgart (Schwei-zerbart) : 816-1140.
Quereilhac, P. (2009) - La Sous-Famille des Taramellicerati-
Creniceras crenatum versus Creniceras crenatum 61
nae (Ammonitina, Haploceratoidea, Oppeliidae) de l’Ox-fordien moyen et supérieur (Zone à Plicatilis, sous-zone à Vertebrale - Zone à Bimammatum, sous-zone à Berrense) du Nord de la Vienne, France (Province subméditerra-néenne). Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Mémoire 2009/02 (CG2009_M02) : 1-101.
Quereilhac, P., D. marchanD, R. JarDat, A. BOnnOt, D. fOrtWengler & P. cOurville (2009) - La faune ammo-nitique des marnes à fossiles ferrugineux de la région de Niort, France (Oxfordien inférieur, Zone à Cordatum, sous-zone à Cordatum). Carnets de Géologie / Notebooks on Geology, Brest, Article 2009/05 (CG2009_A05) : 1-21.
reinecke, J.C.M. (1818) - Maris Protogaei Nautilos et Argo-nautas vulgo Cornua Ammonis in agro corbugica et vicino reperiundos, simul observationes de Fossilium Protypis. Coburgi, ex Officina et in Commissis L.C.A. Ahlii. : 1-89.
SchirarDin, J. (1958) - Les ammonites de l’Oxfordien du Jura Alsacien de la région de Ferrette. Bulletin Service Carte Géologique Alsace Lorraine, 11, 1. Part 1 - Notions strati-graphiques : 75-119 ; Part 2 - Les ammonites des marnes oxfordiennes : 3-50.
SiemiraDzki, J. (1891) - Fossil fauna of Oxfordian and Kim-meridgian strata of the Cracow region and ajoining parts of the Polish Kingdom. Pamietnik Wydziatu, matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetnosci w Krakowie, 18 (1) : 1-91.
Spath, L.F. (1928) - Revision of the Jurassic cephalopod fauna of Kachh (Cutch). Paleontologica Indica, Calcutta, Nou-velle Série, 9 (1927-1933), 2 (I-VI) : 1-945.
tarkOWSki, R. (1984) - Biostratigraphie ammonitique de l’Oxfordien inférieur et moyen des environs de Cracovie. Zeszyty Naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, n° 925. Geologia. Kwartalnik. 9 (2) : 1-57.
ziegler, B. (1956) - Creniceras dentatum (Ammonitacea) in Mittel-Malm Südwestdeutschlands. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Stuttgart, Heft 1 : 553-575.
ziegler, B. (1958) - Monographie der Ammonitengattung Glo-chiceras im Epikontinentaln Weissjura Mitteleuropas. Paläontographica, Stuttgart, Abt. A., 110 (4-6) : 93-164.
zittel, K.A. (1884) - Handbuch der Palaeontologie. München und Leipzig, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1881-1885 : 1-893.
Accepténovembre2011














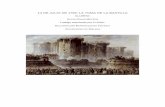

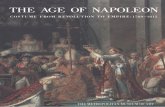

![MA [History] 321 23 - History of Europe 1789 to 1945 AD](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632806f4cedd78c2b50dde4b/ma-history-321-23-history-of-europe-1789-to-1945-ad.jpg)