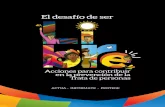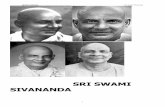Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire : analyse des résultats de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire : analyse des résultats de...
ARTICLE ORIGINAL
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstructionmammaire : analyse des résultats de 69 lambeauxThe inferior gluteal musculocutaneous flap: Short and long-term results for69 patients
V. Duquennoy-Martinot *, R. Le Pendeven, P. Patenôtre, C. Calibre,P. Guerreschi
Service de chirurgie plastique et reconstructive, hopital Salengro, CHRU de Lille, 59037 Lille cedex, France
Recu le 10 avril 2009 ; accepte le 21 decembre 2009
MOTS CLÉSReconstructionmammaire ;Lambeaufessier inférieur ;Microchirurgie
Résumé Le lambeau fessier inférieur libre décrit par Shaw puis par Le-Quang permet d’obtenirune grande quantité de tissus au prix d’une cicatrice du site donneur très discrète. Le but decette étude a été d’évaluer les résultats à court et long terme de 69 lambeaux réalisés entre1996 et 2005 par deux opérateurs seniors chez 64 patientes pour 57 reconstructions mammairessecondaires unilatérales (51 après mastectomies totales, trois mastectomies partielles, troisasymétries constitutionnelles), cinq reconstructions bilatérales, une radiodermite thoraciqueulcérée, une perte de substance de la face interne du bras. Le poids et la taille moyenne deslambeaux étaient respectivement de 360 g et 18 � 7 cm. L’évaluation à court terme était baséesur la survie du lambeau et l’étude des complications. Pour l’évaluation à long terme ont éténotés le résultat mammaire (forme, volume, symétrie, texture et couleur de peau) et l’aspect dusite donneur (cicatrice, forme et symétrie des fesses, fonction musculaire, troubles sensitifs). Lerésultat global apprécié par la patiente et par le chirurgien était comparé. Le recul minimal étaitde trois ans pour 61 patientes, deux sont décédées (métastases), une est perdue de vue. Nousdéplorons cinq nécroses de lambeaux, une par complication d’une embolie pulmonaire, quatrepar thrombose veineuse au début de notre expérience. Quarante patientes ont eu un gestecomplémentaire sur le lambeau, 25 sur le sein controlatéral (pexie). Le résultat global évalué parla patiente était excellent 20 fois, bon 32 fois, moyen neuf fois et par le chirurgien excellent13 fois, bons 32 fois, moyen 13 fois, médiocre trois fois. Concernant le site donneur, seule unepatiente se plaignait d’une discrète asymétrie fessière. La cicatrice placée dans le sillon sous-fessier était le plus souvent très discrète. Cinq cas ont cependant nécessité une reprisechirurgicale pour cicatrice élargie et/ou déprimée. Cinq patientes décrivent une gêne fonc-tionnelle (vélo et accroupissement) et 23 signalent l’hypoesthésie de la face postérieure de la
Annales de chirurgie plastique esthétique (2010) 55, 512—523
* Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (V. Duquennoy-Martinot).
0294-1260/$ — see front matter # 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.anplas.2009.12.006cuisse. Malgré une courbe d’apprentissage assez longue, ce lambeau constitue pour nous une trèsbonne alternative pour une reconstruction mammaire, en particulier pour une reconstructionbilatérale, en cas de contre-indication au deep inferior epigastric perforator (DIEP) et chez lespatientes au morphotype adapté.# 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
KEYWORDSBreast reconstruction;Inferior gluteal flap;Microsurgery
Summary The inferior gluteal musculocutaneous flap described by Shaw then Le-Quang offersthe possibility of harvesting a large amount of tissue with a well-concealed scar in the inferiorfold. Since 1996, we used this flap for breast reconstruction without implant. The purpose of thisstudy was to assess short and for long-term results in our patients. Between 1996 and 2005,64 patients underwent 69 musculocutaneous flaps by two seniors surgeons, for secondaryunilateral reconstruction (57 cases, 51 total mastectomy, three partial mastectomy, threeconstitutional breast asymmetry), five bilateral reconstruction or one thoracic skin ulcerationafter radiotherapy. The average flap weight and size was respectively 360 g and 18 � 7 cm. Forshort results, the assessment was based on flap success and surgical morbidity. For long-termresults, the assessment was based on breast result (shape, volume, symmetry, skin and scar) anddonor-site morbidity (scar, contour deformity, muscle function and sensation). Patients andsurgeons global satisfaction were compared. Minimal follow-up was three years for 60 patients.Two patients died with metastasis. Sixty-three flaps succeeded. We had five flap necrosis, oneafter general complication (pulmonary embolism), four after venous thrombosis during the firstperiod of our experience. Forty patients underwent a second procedure on the flap or on theother breast (25 cases). For the patients, the global result was excellent in 20 cases, good in32 cases, fair in nine cases. For surgeons the global result was excellent in 13 cases, good in32 cases, fair in 13 cases and poor in three cases. Concerning the donor-site, only one patient hadan asymmetry of the buttock. Mostly, the scar of the donor site was good. Five cases needed anew surgery for poor scar. Five patients had functional complaints (for bicycle and squatting).Twenty-three patients noticed the hypoesthesia in the territory of the posterior femoralcutaneous nerve. For breast reconstruction, the gluteal region is an acceptable donor site withlow morbidity and stable results. This technique needed a relative long learning curve, especiallyfor the venous pedicle. We recommend to use a large vein dissected from the arm and axillaryvessels. We also reduce the harvesting volume of the muscle to preserve the function. Thereconstructive breast had a good shape, sufficient volume and acceptable symmetry.# 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 513
Introduction
En 2001, le ministère de la santé annonçait 33 867 nouveauxcas de cancer du sein par an en France et ce chiffre ne cessed’augmenter. Rare avant 30 ans, il est très fréquent autourde 60 ans. Dans ce contexte, la demande de reconstructionmammaire ne cesse d’augmenter d’autant qu’elle ne modifiepas le pronostic de la maladie [1]. Les procédés sont multi-ples faisant appel tantôt à des lambeaux, tantôt à desprothèses, parfois à l’association des deux. Néanmoins, lescontraintes générées par le matériel prothétique [2], domi-nées par la nécessité de changement du matériel, ont incitéde nombreux chirurgiens à utiliser d’autres solutions pure-ment autologues, d’autant que ces méthodes aboutissent àune reconstruction pérenne.
Le lambeau utilisant le muscle latissimus dorsi élargi à lagraisse du dos a été largement utilisé, notamment en cas deconservation de l’étui cutané lors de la mastectomie [3,4]Cependant, certaines patientes jugent inacceptable larançon cicatricielle dorsale et le retentissement fonctionnelsur l’épaule, minime mais non nul [5].
L’abdomen est également une zone donneuse privilégiéecar la qualité de la peau et la texture de la graisse abdo-minale sont très voisines de celles d’un sein naturel. Laméthode la plus utilisée a longtemps été le lambeau abdo-minal pédiculé sur le muscle grand droit de l’abdomen
(TRAM) [6]. Mais les séquelles pariétales avec le risqued’éventration font hésiter certains même lorsque la répara-tion pariétale a été soigneuse [7]. Pour beaucoup, le TRAMest aujourd’hui détrôné par le lambeau perforant dit de deepinferior epigastric perforator (DIEP) qui permet de minimi-ser ces séquelles pariétales en préservant le muscle etl’aponévrose du grand droit [8,9]. Le DIEP impose cependantun repérage minutieux des perforantes disponibles, par dop-pler ou mieux par imagerie avec injection vasculaire. Enoutre, il n’est réalisable qu’en l’absence de cicatrice abdo-minale préalable. Enfin, bien qu’en théorie réalisable cheztoutes les patientes quel que soit leur morphotype, sonprélèvement laisse une cicatrice abdominale longue et sur-tout assez haut située quand la patiente n’avait pas d’excèscutanéo-graisseux préalable.
Par préférence pour un procédé purement autologue etdans le souhait du minimum de séquelles induites par leprélèvement du lambeau, en particulier cicatricielles, nouspensons que le lambeau fessier (glutéal) inférieur libreconstitue une alternative intéressante et trop souventoubliée. D’abord rapporté par Fujino et al. puis Shaw[10,11], il a ensuite été repris par Le-Quang [12] puis pard’autres auteurs [13,14]. Même si la lourdeur relative induitepar le temps microchirurgical peut effrayer certains, il resteun procédé à défendre et qui a toute sa place dans l’arsenalthérapeutique du plasticien. Nous présentons les résultats à
514 V. Duquennoy-Martinot et al.
court, moyen et long terme d’une série rétrospective de69 lambeaux du muscle fessier inférieur.
Patientes et méthode
Patientes
Nous présentons une étude rétrospective sur une série cli-nique consécutive de 69 lambeaux chez 64 patientes opéréesentre 1996 et 2005. Cinquante-huit lambeaux ont été réalisésentre 1998 et 2003. Le recul minimum est de trois ans pour60 patientes. Une patiente a été perdue de vue, deux sont enpoursuite évolutive et deux sont décédées.
Cette technique a été réalisée principalement pour desreconstructions mammaires unilatérales (57 cas), dont 51 casaprès mastectomie totale pour cancer, trois fois après mas-tectomies partielles, trois cas pour asymétrie mammaire soitconstitutionnelle (deux cas), soit acquise après infection (uncas). Cinq patientes ont eu une reconstruction mammairebilatérale en deux temps (un cas) ou en un temps (quatre cas)dont une pour séquelle d’infection et les quatre autres pourcancer ayant imposé une mastectomie bilatérale. Unepatiente a eu une reconstruction thoracique antérieure aprèsexcision d’un placard de radiolésion ulcérée. Enfin unepatiente a eu une reconstruction de la face médiale aprèsexérèse d’un dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand.
L’âge des patientes était compris entre 21 et 72 ans dont27 patientes entre 40 et 50 ans et 16 patientes entre 50 et60 ans. La corpulence des patientes était moyenne avec unpoids compris entre 50 et 68 kg chez 53 patientes sur 64.
La reconstruction était primaire chez 53 patientes, etsecondaire chez 11 patientes ayant déjà eu une reconstruc-tion avec un autre procédé. Neuf patientes présentaient unecoque sur prothèse avec un résultat jugé insuffisant et deuxpatientes avaient eu une exposition de l’implant ayantimposé la dépose du matériel.
Technique opératoire [12,15]
Première installation : levée du lambeau
L’installation se fait d’abord en décubitus dorsal pour induirel’anesthésie puis la patiente est retournée en décubitusventral. Le sillon fessier inférieur (ou sillon sous-fessier)est le repère de base du dessin de la palette cutanée tracéeà cheval sur ce sillon avec une répartition asymétrique : deuxtiers au-dessus du sillon, un tiers en dessous. Le tracé estglobalement fusiforme avec une extrémité médiale se pro-longeant vers le périnée. Les dimensions de la palette serontde 20 à 25 cm de large sur 10 cm de hauteur. En fait, degrosses variations peuvent être observées selon la morpho-logie de la patiente, le facteur limitant étant bien sûr lecaractère nécessairement auto-fermant du site donneur.
La peau est incisée jusqu’au muscle sur la totalité ducontour de la palette. Puis, le pédicule est recherché enplongeant à la partie médiale et inférieure de la palette. Lenerf petit sciatique constitue un excellent fil conducteur, endehors des muscles adducteurs. Selon les dispositions ana-tomiques, la section de ce nerf est souvent nécessaire avecéventuellement une réparation par suture microchirurgi-cale. Une fois le pédicule repéré à la face profonde du
lambeau, on peut remonter vers l’échancrure ischiatiqueen liant pas à pas les collatérales, notamment veineuses,qui sont en nombre variable. Deux collatérales sont impor-tantes, l’une descendante et médiale destinée au nerf scia-tique, l’autre ascendante et externe formant une anse àconcavité supérieure. Cette dernière est parfois intramus-culaire, alors difficile à distinguer du pédicule du lambeau.Cette ligature de collatérales, souvent délicate, est impéra-tive pour obtenir une longueur de pédicule suffisante à desbranchements ultérieurs sans tension dans le creux axillaire,seul garant d’un bon positionnement du lambeau. On obtientsans difficulté un pédicule de 8 à 10 cm, au prix parfois d’undiamètre vasculaire, en particulier veineux, souvent impor-tant, source d’éventuelle incongruence lors des branche-ments vasculaires. Cette dissection du pédicule est facilitéepar l’ouverture du ligament sacrococcygien qui augmente lavisibilité vers le haut. La section musculaire n’est faitequ’après le repérage vasculaire. Elle débute par la bergeinférieure, puis se poursuit par la partie latérale. Ce prélève-ment musculaire préserve les muscles gluteus minor etmajor et peut même être très partiel sur le grand fessierafin de limiter les conséquences fonctionnelles. Seule lasection de la partie supéro-médiale du muscle comportequelques risques de lésions vasculaires pédiculaires et doitdonc être prudente. Le site donneur est fermé par rappro-chement des berges sans réparation musculaire, sur undrainage aspiratif. Une contention cutanée par bandes col-lantes disposées verticalement est souhaitable afin d’éviterla traction excessive de la plaie en position assise.
Deuxième installation : temps axillaire etmammaire
La patiente est retournée en décubitus dorsal avec lesprécautions d’usage. L’abord reprend l’incision de mammec-tomie dont la position est variable et peut se poursuivre en Lvers le creux axillaire (Fig. 1). Dans certains cas, le lambeaun’est pas placé dans la cicatrice antérieure mais dans le sillonsous-mammaire. Le décollement des tissus se fait habituel-lement sous le plan des muscles pectoraux pour éviter ladévascularisation de la peau fragilisée par la radiothérapie.Une désinsertion des fibres du muscle grand pectoral fixéesau sternum et aux cartilages costaux est parfois utile pouraméliorer le galbe de la partie supérieure du sein reconstruit.La dissection du creux axillaire constitue le temps le plusdifficile de l’intervention surtout quand il y a eu un curageganglionnaire suivi d’une radiothérapie. Les tissus remaniéssont volontiers fibreux, parfois déplacés par la rétraction,souvent hémorragiques. Il est préférable de commencer parla dissection à distance des zones les plus fibreuses. Danscertains cas, on commence par repérer le bord antérieur dumuscle grand dorsal permettant ainsi de situer le pédiculethoracodorsal. Celui-ci doit impérativement être disséquéjusqu’au sommet du creux axillaire. On poursuit égalementla dissection vers le pédicule circonflexe qui plonge versl’arrière et, dans la mesure du possible, les branchementsvasculaires sont faits sur ce pédicule. En effet, en casd’échec de la technique du lambeau fessier inférieur libre,on peut effectuer une reconstruction en rattrapage par unlambeau de grand dorsal pédiculé. Il est donc important depréserver son pédicule. Le problème concerne plutôt lebranchement veineux. La veine du pédicule du lambeau
[(Figure_1)TD$FIG]
Figure 1 Reconstruction mammaire chez une patiente de52 ans ; a : tracé de l’incision se prolongeant vers le creuxaxillaire ; b : dessin de la palette cutanée du lambeau fessier àcheval sur le sillon sous-fessier ; c : résultat à cinq ans.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 515
est quasi constamment de gros diamètre (4 à 6 mm, voiredavantage) alors que les veines thoracodorsales sont souventpetites. Dans ce cas, on choisit de se reporter sur une veineaxillaire ou céphalique détournée de son trajet habituel.Généralement, on peut individualiser au moins deux veinesqui se réunissent autour du plexus brachial. Il est alors simplede longer l’une d’elles vers la face médiale du bras pour ladérouter vers le thorax en conservant le maximum de lon-gueur. Cet artifice permet de régler le problème de l’incon-
gruence, mais aussi de réaliser les anastomoses artérielles etveineuses sur le même site. Les branchements microchirur-gicaux sont réalisés par des points séparés de crin 10.0 pourl’artère et 9.0 pour la veine.
Modelage du lambeau et fermeture
Ce temps est important pour avoir le minimum de retouchesà envisager ultérieurement. Naturellement, la forme dulambeau prélevé est plate et transversale alors que celledu sein est conique et projeté. Il faut donc essayer de replierle lambeau sur lui-même pour lui conférer cette formeconique. Le facteur limitant est la longueur du pédiculevasculaire et les tractions induites sur les anastomosesque l’on surveille soigneusement pendant ce temps de mode-lage. Il est également important d’essayer de mettre levolume plutôt vers la ligne médiane (vers le sternum) afinde « remplir » la zone du décolleté. Celle-ci peut aussi êtreaméliorée par un enfouissement de la partie distale dulambeau après désépidermisation. Quand le sacrifice cutanéde la mammectomie a été très limité ou en cas de conserva-tion de l’étui cutané, il est possible de désépidemiser latotalité du lambeau pour ne conserver que son volume. Onpréserve cependant une petite palette dite « témoin » quipermet de surveiller la vitalité du lambeau enfoui. Le plussouvent, notamment en reconstruction secondaire, lesacrifice cutané a été important. On conserve alors toutela palette cutanée du lambeau.
La fermeture du site donneur a été réalisée avant leretournement de la patiente. Les drains sont laissés enaspiration pendant le temps antérieur. On peut donc vérifierl’absence de saignement anormal avant le réveil complet dela patiente.
Le creux axillaire est fermé après vérification de l’hémos-tase. On s’assure également que le pédicule a un trajetharmonieux sans coude, plicature ou torsion (twist) dans cecreux axillaire. On vérifie une dernière fois les anastomoses etl’absence de reprise hémorragique sur une collatérale vei-neuse de la veine du lambeau fessier. Une lame souple dedrainage est mise en place en prenant soin de ne pas la mettreau contact direct des anastomoses. Les incisions sont ferméesen deux plans avec des surjets intradermiques.
Interventions secondaires
Le premier temps a donc permis d’apporter un volumeconstitué principalement par la graisse fessière et trèsaccessoirement par une portion du muscle grand fessier.Idéalement, on aura tenté de placer ce lambeau de tellemanière à ce qu’il ait le plus possible la forme conique d’unsein. Néanmoins, des ajustements sont souvent nécessaires,et pas toujours faciles à réaliser.
Les temps ultérieurs du protocole de reconstructionconsistent habituellement à assurer une meilleure symétrieentre les deux côtés avec des gestes sur le sein restant(pexie, réduction), associés à des remodelages du lambeaupar des greffes de graisse autologue et reconstruction de laplaque aréolo-mamelonnaire par greffe plastie locale et/outatouage [16]. Enfin, la peau fessière transférée est parfoispileuse, en particulier lorsque la palette a été prélevée versla région périnéale. On propose alors une épilation électriquedéfinitive.
516 V. Duquennoy-Martinot et al.
Évaluation
Les patientes ont été revues en consultation avec un reculminimum de trois ans par un des chirurgiens de l’équipe. Lesdonnées ont été recueillies lors de ces consultations maisaussi par l’analyse des dossiers, des comptes rendus opéra-toires et des documents photographiques de chaquepatiente. Les données ont été rassemblées dans une basede données.
Données préopératoires
Outre les données générales (âge, poids et taille), nous avonsnoté l’indication de la reconstruction (mastectomie totaleou partielle, infection, asymétrie, radiolésion, autre motif),le caractère uni ou bilatéral, le motif de la demande dereconstruction mammaire évoqué par la patiente et la raisondu choix de cette technique par le chirurgien. Enfin, le délaientre la mutilation et la reconstruction a été recherché.
Données opératoires
Outre la date de réalisation du lambeau, ont été notés le nomde l’opérateur, les caractéristiques du lambeau (poids,dimensions, côté prélevé), le type de branchement réalisé(artère et veine donneuses et receveuses) et la durée del’intervention.
Données postopératoires immédiates
Nous avons évalué le taux de reprise des anastomoses, avecsuccès ou échec et le taux de succès global de la micro-chirurgie. En cas d’échec, nous avons recherché les causes decelui-ci. Les autres complications quelles soient générales(accident thrombœmbolique) ou locales (hématome, épan-chement, troubles de cicatrisation) sur le site donneur etreceveur ont également été notées.
Gestes complémentaires
Le nombre et la nature des gestes complémentaires mam-maires (à l’exception des reprises pour raisons vasculairesimmédiates) ont été précisés : retouche et remodelage dulambeau (réduction, désépidermisation, déplacement),reconstruction de la plaque aréolo-mamelonaire, gestecontrolatéral (pexie mammaire, réduction), greffe degraisse autologue complémentaire. Ont également été notésles éventuels gestes de reprise cicatricielle sur le site don-neur fessier.
Qualité du résultat à long terme
Dans la plus grande majorité des cas, il s’agissait d’unereconstruction mammaire. Nous avons demandé au chirur-gien réalisant l’évaluation et à la patiente de noter lerésultat global de l’intervention. Cette note globale devaittenir compte du résultat mammaire et du site donneur. Lerésultat global était ainsi noté excellent, bon, moyen oumauvais. Les deux notations ont été comparées. Une évalua-tion analytique de chaque cas a également été réaliséeconcernant la forme globale, le volume (et sa répartition
dans les différents quadrants), la symétrie, la qualité de lapalette cutanée (couleur, pilosité), la position du sillon sous-mammaire, la texture du sein reconstruit. Le recul étaitprécisé.
Qualité du site donneur
Ont été évaluées la qualité de la cicatrice finale de la fesse,la symétrie fessière après prélèvement et les séquellesfonctionnelles du site donneur ainsi que les éventuellesperturbations de la vie quotidienne. L’appréciation desséquelles fonctionnelles a été faite par l’interrogatoire àla recherche de limitation d’activités précises : marche,course, position assise, pratique de la bicyclette et accrou-pissement. En consultation, la mobilité de la hancheconcernée était vérifiée. Les reprises chirurgicales du sitedonneur ont été dénombrées et analysées.
Résultats
Les motifs de demande de reconstruction étaient souventmultiples. Pour 50 patientes la restauration de l’imagecorporelle était invoquée. Les autres motifs étaient lademande d’amélioration vestimentaire (30 cas), le souhaitde se passer de l’épithèse jugée gênante (20 cas) et enfin lesperturbations de la vie sexuelle et conjugale (sept cas)notamment chez les patientes les plus jeunes. Pour11 patientes, la demande reposait sur une insatisfactiond’une première reconstruction faite par prothèse avec expo-sition du matériel (deux cas) ou coque importante (neuf cas)(Fig. 2).
Le choix du lambeau a été fait en collaboration avec lespatientes et après avoir étudié les autres possibilités tech-niques. La reconstruction par lambeau de latissimus dorsi(avec ou sans prothèse) était contre-indiquée chez septpatientes pour des raisons techniques (pédicule détruit,lambeau déjà prélevé), médicales (scoliose, hernie discale)ou professionnelles (sportive de haut niveau, manutention).Neuf patientes avaient refusé cette solution soit par peur desconséquences fonctionnelles pour le rachis ou l’épaule, soitpar crainte de la qualité de la cicatrice du site donneur. Leslambeaux prélevés dans la région abdominale (TRAM ou DIEP)étaient contre-indiqués chez 15 patientes principalementpour des raisons pariétales ou des antécédents de chirurgieabdominale. Sept patientes refusaient le principe d’unerançon cicatricielle abdominale. Ainsi chez la plupart despatientes (48 pour le lambeau de latissimus dorsi, 42 pour leslambeaux abdominaux) toutes les techniques autologuesétaient réalisables. Le choix du lambeau fessier inférieur aété principalement motivé par la discrétion de la séquellecicatricielle.
Les lambeaux ont été réalisés principalement par deuxopérateurs seniors, respectivement 37 par l’un, 24 parl’autre et huit réunissant les deux opérateurs pour les recon-structions bilatérales en un temps. Le lambeau a été princi-palement prélevé du côté gauche, plus facile pour unopérateur droitier. Le poids moyen du lambeau prélevé étaitcompris entre 300 et 400 g, avec un minimum de 157 g et unmaximum d’1 kg100. Les branchements microchirurgicauxartériels ont été faits sur l’artère thoraco-dorsale (32 cas),sur la circonflexe scapulaire (35 cas), sur la mammaire
[(Figure_2)TD$FIG]
Figure 2 Reprise d’une reconstruction mammaire par prothèse bilatérale avec coques ; conversion par un lambeau fessier inférieurlibre chez une femme de 50 ans ; a : aspect préopératoire avec coque et radiodermite ; b : résultat mammaire à huit ans sansreconstruction de la PAM ; c : cicatrice fessière adhérente après lymphorrhée ; d : cicatrice fessière après reprise.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 517
interne (un cas), ou sur l’humérale en terminolatérale (uncas). Aucun branchement artériel n’a été fait sur l’artèreaxillaire. Les branchements veineux ont été faits sur uneveine thoracodorsale (14 cas), sur l’axillaire (trois cas), surl’humérale (trois cas) sur une veine du bras déroutée vers larégion axillaire et mammaire (49 cas). La durée de l’inter-vention a été de trois heures trente à dix heures avec unemoyenne de cinq heures trente.
Soixante-quatre lambeaux ont été un succès vasculaire.Nous déplorons cinq échecs, quatre thromboses veineuses etun cas d’embolie pulmonaire massive ayant imposé l’utilisa-tion de drogues vasoactives conduisant à la nécrose dulambeau. Dix-huit patientes ont eu une reprise des anasto-moses microchirurgicales entre j0 et j5 dont quatre cas pourune thrombose artérielle (chaque fois avec succès), une foispour un arrachement du pédicule (en décrochant letéléphone sur la table du chevet), une fois pour un héma-tome par défaut d’hémostase d’une collatérale du pédicule.Douze patientes ont eu une reprise de l’anastomose vei-neuse, dont huit cas avec succès et quatre suivis d’échecs.Trois des quatre échecs veineux sont survenus dans les troispremières années d’expérience de cette technique. Le prin-cipal problème constaté était une importante incongruencede diamètre des veines donneuses et receveuses. La veine dulambeau était le plus souvent deux ou trois fois plus large queles veines du pédicule thoracodorsal ou circonflexe. Aucunereprise des microanastomoses n’a été faite après cinq jours.
Des gestes secondaires ont été réalisés chez 49 patientessur 54. Il s’agissait de 25 gestes sur le sein controlatéral(principalement des pexies) et 40 retouches du lambeau (en
particulier des réductions de volume global, des quadrantsexternes et des desépidermisations complètes pour neconserver que le volume ou d’une partie de la palettecutanée pour améliorer le galbe d’un des quadrants). Cesdesépidermisations permettaient de supprimer la peau tho-racique gardée en excès volontairement pour éviter d’aggra-ver la situation locale en cas d’échec du lambeau fessier.Chez huit patientes, une ou deux séances de lipostructureselon le procédé de Coleman ont permis d’améliorer lescontours notamment à la jonction entre le lambeau fessieret la peau thoracique du décolleté. Concernant la plaquearéolomamelonaire, seulement 32 ont été reconstruites. Sil’on exclut les patientes sorties de l’étude (échec du lam-beau, décédée et perdue de vue) et celles ayant une PAMconservée (six cas), on note 13 patientes ayant refusé lareconstruction de la PAM. Elles estimaient le résultat dulambeau suffisant, apportant volume, symétrie et facilitévestimentaire.
Au niveau du site donneur, trois cas d’hématomes ontnécessité une reprise chirurgicale et 16 cas de lymphocèleont été traités par ponctions itératives. Quatre cas se sontcompliqués de désunion aboutissant à une cicatrice élargieet adhérente. L’aspect morphologique final du site donneur aété jugé excellent ou bon chez 53 patientes d’emblée et chezcinq patientes après reprise de la cicatrice. Chez cinqpatientes, il a été jugé moyen principalement du fait del’aspect de la cicatrice élargie et/ou adhérente mais sansasymétrie fessière, sauf pour une patiente d’origine afri-caine (avec une asymétrie très relative, plus subjective queréellement constatée). Aucun site donneur n’a été jugé
[(Figure_3)TD$FIG]
Figure 3 Reconstruction mammaire chez une patiente de 38 ans ; a : aspect thoracique préopératoire ; b : aspect fessierpréopératoire ; c : résultat à quatre ans jugé très bon ; d : aspect postopératoire du site donneur.
518 V. Duquennoy-Martinot et al.
d’aspect médiocre. Pour les cinq patientes ayant bénéficiéd’une reprise chirurgicale de la cicatrice fessière, il s’agis-sait de deux autogreffes de graisse (lipofilling selon Coleman)et trois reprises pour cicatrice élargie. Cinq patientes signa-lent des difficultés fonctionnelles résiduelles, trois pour laposition assise prolongée et deux pour l’accroupissement (enparticulier pour le jardinage). Pour la moitié des patientes ledélai de récupération était de trois à six mois pour certainesactivités telles que la bicyclette et l’équitation du fait dedouleurs modérées et/ou paresthésies à l’appui sur l’ischion.L’hypoesthésie de la face postérieure de la cuisse étaitsignalée par 23 patientes, même dans certains cas de conser-vation du nerf petit sciatique (fémorocutané postérieur). Enfait cette hypoesthésie est constamment retrouvée quand onla recherche mais peu de patientes la signalent spontané-ment. Deux patientes chez qui le nerf petit sciatique avaitété préservé ont présenté des névralgies durables et gênan-tes.
À la fin du protocole, concernant le sein reconstruit, lespatientes ont jugé le résultat global excellent 20 fois, bon32 fois, moyen neuf fois, et aucun cas mauvais (en excluantune perdue de vue et les deux décédées des suites de leurnéoplasme). Les chirurgiens ont jugé le résultat global excel-lent 13 fois (Fig. 3), bon 32 fois (Fig. 4), moyen 13 fois etmauvais trois fois. Le résultat n’était noté qu’une fois pourles reconstructions bilatérales (Fig. 5). Les défauts constatés(plusieurs défauts possibles chez une même patiente)étaient une asymétrie de forme (neuf cas), un excès devolume latéral du sein et/ou ne remplissant pas suffisam-ment le quadrant supéro-médial, un défaut de position dusillon sous-mammaire (11 cas) (sillon trop haut ou doublesillon), une dyschromie de la palette (quatre cas), une
pilosité gênante et excessive (cinq cas). Dix patientesjugeaient le sein reconstruit de consistance trop dense. Troispatientes avaient un volume insuffisant, dont deux patientesdiabétiques avec fonte progressive du volume.
Discussion
Le lambeau fessier inférieur libre nous a permis d’obtenir unvolume constamment suffisant, un pédicule de longueurmoyenne compatible avec des branchements microchirurgi-caux au creux axillaire, et des tissus de qualité compatibleavec une reconstruction mammaire autologue correcte pourla majeure partie de nos patientes.
Les avantages de cette technique sont dominés par lafaiblesse des séquelles du site donneur (Fig. 6). On pouvaitlégitimement craindre une asymétrie fessière postopéra-toire. En fait, dans notre étude, une seule patiente sur les64 se plaignait d’une petite asymétrie, par ailleurs jugéediscrète par le chirurgien. Ce résultat est conforme auxrésultats de Dupéré et collaborateurs chez 15 adolescentestraitées pour asymétrie mammaire [17]. Pour garantir cettediscrétion de la rançon cicatricielle, il est cependant essen-tiel de bien positionner le tracé de la palette à cheval sur lesillon sous-fessier, deux tiers au-dessus, un tiers en dessous.Ce tracé permet d’obtenir une palette d’une largeur de10 cm en moyenne pour un site auto-fermant. Si le tracéétait fait plus haut, il risquerait d’altérer la forme de lafesse, en générant alors une asymétrie.
Par ailleurs, le prélèvement doit être relativementmédial, vers le périnée et l’ischion, et non vers la régiontrochantérienne où la cicatrice serait nécessairement plusvisible. En respectant ce critère de tracé, la palette peut
[(Figure_4)TD$FIG]
Figure 4 Reconstruction mammaire chez une patiente de 56 ans ; a : aspect thoracique préopératoire ; b : aspect fessierpréopératoire ; c : résultat avant remodelage du lambeau ; d : aspect postopératoire du site donneur ; e : résultat à six ans jugé bon.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 519
atteindre 25 cm de long, selon la morphologie de la patienteet la largeur de son bassin. Avec ce positionnement médial dulambeau, on obtient une quantité de tissu, cutané et grais-seux toujours abondante, même chez les patientes les plusmaigres. Ce tracé est d’ailleurs en partie utilisé par leséquipes utilisant le muscle gracilis et une palette cutanéesituée à la partie supérieure et médiale de la cuisse [18].Cependant, dans cette localisation, la peau est parfois detexture moyenne ou médiocre pour le sein, trop grenue, troppigmentée et souvent recouverte de duvet, voire de poils.Cette zone médiale périnéale sera alors préférentiellementdesépidermisée et placée sous la peau thoracique afin deconserver le volume sous-jacent sans la peau inadaptée à larégion mammaire. La dissection du pédicule poussée dansl’échancrure ischiatique permet dans tous les cas d’obtenirune longueur de pédicule très confortable pour la réalisationdes microanastomoses en région axillaire. Cependant, lepoint de pénétration du pédicule dans le muscle se situehabituellement au milieu du lambeau, ce qui peut expliquerles difficultés relatives de positionnement de celui-ci. En
outre, la relative rigidité de la graisse fessière explique lafaible plasticité de ce lambeau.
Les séquelles fonctionnelles du prélèvement musculairesont également modestes (cinq patientes sur 64). Cepen-dant, le délai de récupération est assez long (en moyenne sixmois) et doit être signalé à la patiente, en particulier, pourles plus actives ou sportives qui peuvent mal accepter cesbaisses de performances transitoires. Entre le début de notrepratique et notre prélèvement actuel, nous avons considéra-blement réduit la portion musculaire prélevée, s’approchantdes techniques de lambeaux perforants. Certaines équipesont même décrit le prélèvement uniquement sur les per-forantes, respectant totalement le muscle [19,20]. Lavariante supérieure (S-GAP) est la plus utilisée car plus fiablesur le plan vasculaire [21]. Cependant, il nous semble que lacicatrice du site donneur est alors plus visible que celleplacée dans le sillon sous-fessier comme nous le proposons.En effet, cette cicatrice fessière haute est certes masquéepar le sous-vêtement mais elle reste très visible nue, ce quin’est pas le cas de la cicatrice sous-fessière.
[(Figure_5)TD$FIG]
Figure 5 Reconstruction mammaire bilatérale en un temps ; a : aspect thoracique préopératoire ; b : aspect avant remodelage etreconstruction de la PAM ; c : résultat à sept ans jugé très bon ; d : aspect postopératoire des deux sites donneurs.
520 V. Duquennoy-Martinot et al.
L’hypoesthésie de la face postérieure de la cuisse estcependant très fréquente même si elle n’est pas toujoursremarquée par les patientes [17]. Sa surface a tendance àdiminuer au fil des années après l’intervention. Certainspréconisent de conserver le nerf petit sciatique mais dansnotre pratique, nous avons eu deux cas de névralgie durableen le préservant [22]. À l’inverse, l’hypoesthésie est toujourstrès bien tolérée comme en témoigne le nombre relative-ment faible de patientes le signalant spontanément.
Le deuxième intérêt essentiel de cette méthode concerneles reconstructions bilatérales. En effet, les deux fessespermettent aisément de reconstruire deux seins, en un oudeux temps [21,23]. Certes, le temps opératoire est inévita-blement allongé de deux heures environ. Cet allongementest acceptable lorsqu’il est possible de travailler à deuxéquipes. Ce choix technique est en concurrence avec unereconstruction par DIEP bilatéral. Ce dernier a le mérite dene pas imposer de changement de position opératoire et de
permettre le travail à plusieurs équipes sur les sites donneurset receveurs. Cependant, il existe des contre-indications,notamment en cas de cicatrices abdominales, d’antécédentsde liposuccion ou encore chez une patiente très mince sansexcès abdominal disponible. Dans ces situations, le lambeaufessier bilatéral trouve toute sa place. De même le morpho-type de la patiente peut intervenir dans ce choix technique,en particulier chez une patiente ayant des fesses de volumegénéreux alors que l’abdomen n’est ni dégradé ni plétho-rique [24].
La reconstruction bilatérale permet plus aisémentd’obtenir un résultat symétrique en particulier si la situ-ation préopératoire est similaire des deux côtés commechez une de nos patientes (Fig. 5). En revanche, une posi-tion asymétrique des cicatrices de mastectomie, dessacrifices cutanés différents ou encore une souplesse tis-sulaire régionale modifiée par une radiothérapie unilatéralealtèrent la symétrie du résultat. A fortiori, lorsque la
[(Figure_6)TD$FIG]
Figure 6 Aspect du site donneur après prélèvement d’un lambeau fessier ; a et b : prélèvement unilatéral ; c et d : prélèvementbilatéral.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 521
reconstruction est unilatérale la symétrie parfaite est plusdifficile à obtenir et ce constat n’est pas l’apanage dulambeau fessier [25]. La conservation de l’étui cutané offredes conditions idéales rarement rencontrées dans notrepratique du fait de notre type de recrutement. En effet,la plupart de nos patientes venaient pour une reconstruc-tion différée. L’un des principaux défauts rencontrés étaitla relative densité de la graisse fessière pouvant compliquerla mise en place de celui-ci et son modelage. Il a égalementsouvent été noté un excès de volume dans les quadrantsexternes du sein reconstruit (Fig. 4c) imposant plusieursréductions secondaires toujours un peu délicates car réali-sées à proximité du pédicule. Cependant, même en cas delésion de celui-ci, on peut espérer compter sur une auto-nomisation vasculaire, en particulier si le délai après lepremier geste a été suffisant. Les autres défauts concer-naient la palette cutanée qui peut être un peu grenue,pileuse ou dyschromique (Fig. 7). L’épilation électriquesecondaire est un moyen simple de régler le problème duduvet. En revanche, le volume apporté a été constammentsuffisant, du moins en première intention. Deux patientesont présenté une fonte progressive du volume imposant lamise en place secondaire d’une prothèse, constat d’échecrelatif dans une situation où l’on avait opté pour unereconstruction autologue. L’une d’elle était diabétiquesévère, les deux ont observé une diminution du volumeaprès un geste de remodelage mettant en doute l’hypo-thèse d’une autonomisation vasculaire. Chez ces patientes,un transfert de graisse selon Coleman aurait pu être discutédans cette indication où il ne reste plus de tissu mammaire.Enfin, nous avons noté chez certaines patientes une dys-
chromie de la palette cutanée. Celle-ci est gênante si lacicatrice de mammectomie est haut située et donc visibleen dehors du soutien-gorge. Dans ces cas, il est possible dechoisir de placer le lambeau dans le sillon plutôt que dans lacicatrice initiale.
Les principaux détracteurs de ce lambeau insistent sur lesaléas de la microchirurgie et il est vrai que notre courbed’apprentissage a été relativement longue. La principaledifficulté rencontrée a concerné le drainage veineux insuffi-sant qui a abouti à des nécroses du lambeau au début denotre expérience. L’utilisation d’une veine de gros diamètre(une des axillaires déroutées ou la basilique) a résolu ceproblème. En outre, cet artifice nous permet de ne pas êtrelimités par la longueur du pédicule. Celle-ci a d’ailleursconstamment été suffisante si l’on utilise cet artifice deveine déroutée et si la dissection est poussée loin dansl’échancrure ischiatique. Dans tous les cas, nous avonspréféré le branchement en région axillaire plutôt que surles vaisseaux mammaires internes qui restent, cependant,une alternative [26]. Le choix du branchement en régionaxillaire était motivé principalement par une plus grandehabitude de la dissection de cette zone. En outre, les vais-seaux mammaires internes, et en particulier la veine, sont depetits calibres. Or, nous avons vu que la veine du lambeau estde gros diamètre. Nous pensons que le branchement mam-maire interne ne permettrait pas d’assurer un drainageveineux optimal. Enfin, la durée de l’intervention est équi-valente à celle d’autres auteurs et reste proche de cellenécessaire pour la réalisation d’un DIEP mais ce derniern’impose pas de changement de position en peropératoire[23].
[(Figure_7)TD$FIG]
Figure 7 Reconstruction mammaire chez une patiente de37 ans ; a : aspect thoracique préopératoire ; b : résultatpostopératoire avec dyschromie de la palette.
522 V. Duquennoy-Martinot et al.
Conclusion
Malgré ces quelques défauts, la faiblesse des séquelles dusite donneur et la bonne qualité des tissus transférés nousincitent à proposer ce lambeau en reconstruction mam-maire. En cas d’échec lié aux aléas vasculaires, toutes lesautres solutions restent réalisables surtout si le chirurgien apris soin de ne pas léser le pédicule thoracodorsal. Actuel-lement nos principales indications sont les reconstructionsbilatérales chez les patientes à morphologie gynoïde nette(bassin large, fesses généreuses), les contre-indications aulambeau de DIEP et en cas de choix délibéré de ne pastoucher à l’abdomen. Le choix de la technique se faittoujours en accord avec la patiente qui doit accepter lerisque d’un échec microchirurgical toujours vécu comme undrame surtout dans le contexte de reconstruction aprèscancer [24]. Le lambeau fessier inférieur libre vient enrichirl’arsenal technique du chirurgien qui doit cependant tou-jours rester à l’écoute des souhaits de la patiente sans luiimposer un choix technique dogmatique.
Conflit d’intérêt
Aucun.
Références
[1] Petit JY, Le MG, Mouriesse H, Rietjens M, Gill P, Contesso G,et al. Can breast reconstruction with gel-filled silicone increasethe risk of death and second primary cancer in patients treatedby mastectomy for breast cancer? Plast Reconstr Surg 1994;94:115—9.
[2] Desouches C, Aharoni C, Magalon G. Analyse descriptive desdifférents implants mammaires disponibles sur le marché euro-péen en 2005. Ann Chir Plast Esthet 2005;50:694—701.
[3] Delay E, Gounot N, Bouillot A, Zlatoff P, Comparin JP. Recon-struction mammaire par lambeau de grand dorsal sans pro-thèse, expérience préliminaire à propos de 60 reconstructions.Ann Chir Plast Esthet 1997;42:118—30.
[4] Delay E, Gounot N, Bouillot A, Zlatoff P, Rivoire M. AutologousLatissimus breast reconstruction. A 3-year clinical experience.Plast Reconst Surg 1998;102:1461—78.
[5] Legré R, Boghossian V, Servant JM, Magalon G, Bureau H.Analyse des séquelles du prélèvement du lambeau de granddorsal. À propos de 44 cas revus et testés. Ann Chir Plast Esthet1990;35:512—7.
[6] Hartrampf CR, Scheflan M, Balck PW. Breast reconstructionwith a transverse abdominal island flap. Plast Reconstr Surg1982;69:216—25.
[7] Petit JY, Rietjens M. Complications et séquelles de la paroiabdominale dans la reconstruction mammaire par TRAM pédi-culé. Ann Chir Plast Esthet 1997;42(2):131—7.
[8] Blondeel PN. One hundred free DIEP flap breast reconstruction:a personnal experience. Br J Plast Surg 1999;52:104—11.
[9] Bottero L, Lefaucheur JP, Fadhul S, Raulo Y, Collins ED, LantieriL. Electromyographic assessment of rectus abdominis musclefunction after deep inferior epigastric perforator flap surgery.Plast Reconstr Surg 2004;113:156—61.
[10] Fujino T, Harashina T, Aoyagi F. Reconstruction for aplasia ofthe breast and pectoral région by microvascular transfer of afree flap from the buttock. Plast Reconstr Surg 1975;56:178—83.
[11] Shaw WW. Breast reconstruction by superior gluteal microvas-cular free flaps without silicone implants. Plast Reconstr Surg1983;72:490—501.
[12] Le-Quang C. Les reconstructions microchirurgicales secondai-res du sein et le lambeau libre fessier inférieur. Ann Chir PlastEsthet 1992;37:723—41.
[13] Patenôtre P, Duquennoy-Martinot V, Capon N, Dumortier R,Pellerin P. Reconstruction mammaire par lambeaux fessiersinférieurs libres. À propos de 34 cas chez 30 patients. Ann ChirPlast Esthét 2001;46:103—11.
[14] Paletta CE, Bostwick J, Nahai F. The inferior gluteal free flap inbreast reconstruction. Plast Reconstr Surg 1989;84(6):875—83.
[15] Duquennoy-Martinot V, Pâtenotre P. Reconstruction mammairepar lambeau glutéal inférieur libre. EMC (Elsevier Masson SAS,Paris). Techn Chir-Chir Plast Reconstr Esthet 2007. 45-665-L.
[16] Bodin F, Bruant-Rodier C, Lutz JC, Himy S, Wilk A. La recon-struction de la plaque aréolomamelonnaire : résultats à longterme. Ann Chir Plast Esthet 2008;53(4):334—41.
[17] Dupéré S, Bergeron L, Bortoluzzi P, Del-Duca T, Caouette-Laberge L. Donor-site morbidity of the inferior musculocuta-neous flap for breast reconstruction in teenagers. Ann PlastSurg volume 2007;59(6):617—20.
[18] Fansa H, Schirmer S, Warnecke IC, Cervelli A, Frerichs O. Thetransverse myocutaneous gracilis muscle flap: a fast andreliable method for breast reconstruction. Plast Reconstr Surg2008;122(5):1326—33.
[19] Kankaya Y, Ulusoy MG, Oruc M, Yildiz K, Kocer U, Tuccar E.Perforating arteries of the gluteal region : anatomic study. AnnPlast Surg 2006;56(4):409—12.
Le lambeau fessier inférieur libre en reconstruction mammaire 523
[20] Allen RJ, Levine JL, Granzow JW. The in-the crease inferiorgluteal artery perforator flap for breast reconstruction. PlastReconstr Surg 2006;118(2):333—9.
[21] Guerra AB, Metzinger SE, Bidros RS, Gill PS, Dupin CL, Allen RJ.Breast reconstruction with gluteal artery perforator (GAP) flaps:acritical analysis of142cases.AnnPlast Surg2004;52(2):118—25.
[22] Zenn MR, Millard JA. Free inferior gluteal flap harvest withsparing of the posterior femoral cutaneous nerve. J ReconstrMicrosurg 2006;22(7):509—12.
[23] DellaCroce FJ, Sullivan SK. Application and refinement of thesuperior gluteal artery perforator free flap for bilateral simulta-neous breast reconstruction. Plast Reconstr Surg 2005;116(1):97—103.
[24] Forme N, Capon-Degardin N, Martinot-Duquennoy V, Pellerin P.Reconstructions mammaires différées, quelles stratégies ? AnnChir Plast Esthet 2008;53:22—8.
[25] Blondeel PN, Hijjawi J, Depypere H, Roche N, Van Landuyt K.Shaping the breast in aesthetic and reconstructive breast sur-gery: an easy three-step principle. Part II-Breast reconstructionafter total mastectomy. Plast Reconst Surg 2009;123(3):794—805.
[26] Moran SL, Nava G, Benham AB, Serletti JM. An outcome analysiscomparing the thoracodorsal and internal mammary vessels asrecipient sites for microvascular breast reconstruction: a pros-pective study of 100 patients. Plast Reconstr Surg 2003;111(6):1876—82.