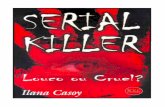Couronnes ou cornes
-
Upload
univ-reims -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Couronnes ou cornes
1
Poitiers, 14 février 2007
Le retour du roi ou la couronne et les cornes
Dans les nuits noires du décembre dauphinois, bien des enfants, et d’anciens enfants
devenus grands et vieux depuis longtemps, évitent d’aller dehors. Ecoutez bien, ils redoutent
le retour du roi Hérode et de sa troupe. En effet, tous les ans à pareille époque, il s’en revient,
cherchant à emporter les âmes égarées dans la nuit. Il a une prédilection pour les Douze Jours,
et plus particulièrement – on ne s’en étonnera pas – pour le jour même de l’Epiphanie :
Le soir du six janvier, tous les enfants « se ramassaient » (rentraient dans les maisons) pour ne pas être
pris par le Roi Hérode qui, ce soir-là, se promenait avec une poule sous le bras (juin 1962). Pour leur faire manger la soupe, on disait aux enfants que le Roi Hérode sortait de la forêt à la nuit
tombante et cherchait à les attraper. On leur montrait à l’appui, la première étoile qui apparaissait au-
dessus de la forêt et qui était censée être la lanterne du Roi Hérode (juin 1962)1.
Jusque dans un passé proche de nous, l’on continue ainsi d’évoquer des figures royales ou du
moins de grands seigneurs devenus des revenants, devenus des chasseurs sauvages, parfois
pour expier un crime comme Hérode, sillonnant le ciel ou la terre sans trouver le repos : le roi
Salomon, le seigneur Gallery dans le Poitou2 en particulier ; au pays de Retz, c’est le roi
David en personne qui conduit la chasse pour s’être livré à son passe-temps favori tous les
dimanches sans tenir compte ni de la messe, ni des plaintes des paysans. Autre figure plus
savante celle-ci que vous connaissez peut-être ; celle de l’Erlkönig, immortalisé par Goethe,
qui vient lui aussi chercher un enfant, dans les bras même de son père !
J’ai dit tout à l’heure que c’est en particulier lors des Douze Jours que ces retours de rois
légendaires s’observent. En fait, d’autres variantes veulent que ce retour royal se situe plutôt à
la Chandeleur – qui annonce Carnaval, ce qui a son importance comme nous allons le voir - ,
ou encore au solstice d’été de la Saint-Jean. Ce qui est constant, c’est la régularité immuable
de ce mouvement.
Nous allons donc chercher à explorer ce retour cyclique d’une figure royale dans
l’imaginaire, la littérature, le folklore, en nous appuyant sur une figure emblématique qui a
concentré sur elle-même l’essentiel de ce qu’il faut bien considérer comme un mythe
dépassant les seuls enjeux de la souveraineté : il s’agit du roi Arthur, plus précisément de sa
famille, de son lignage. En effet, depuis le Brut de Wace (1155 ; v. 13681-13686) au moins on
sait que le roi Arthur parti en Avalon y attend l’heure de son retour.
Ensi se fist Artus porter en Avalon et dist a ses gens que il l’atendissent et que il revenroit. Et li Breton
revinrent a Carduel, et l’atendirent plus de quarante ans ains qu’il fesissent roi, car il cuidoient tos dis
que il revenist. Mais tant saciés vos que li auquant l’ont puis veü es forés cacier, et ont oï ses chiens
avuec lui ; et li auquant i ont eü esperance lonc tans que il revenist3. »
1 Ch. Joisten, op. cit., p. 177, n° 28-30. Voir aussi p. 44, 71, 147, 375, 520, et 524.
2 Cf. J.L. Le Quellec, « La Chasse-galerie. Du Poitou à l’Arcadie », in Iris, n°18, Centre de recherche sur
l’imaginaire, Université de Grenoble 3, 1999, p. 125-146. 3 Didot-Perceval, éd. W. Roach, University of Pennsylvania Press, 1941, p. 277 (ms E).
2
Une autre histoire que nous devons à Gervais de Tilbury (v. 1209-1214)4 situe son
séjour d’outre-monde non pas dans l’île, mais dans l’Etna. Dans cette histoire, un cheval en
fuite conduit un groupe d’hommes au volcan où ils découvrent, stupéfiés, Arthur dans la
magnificence de sa royauté, mais malheureusement « méhaignié », blessé par son propre fils
Mordred.
Il y a en Sicile le mont Etna, dont le cratère vomit des flammes sulfureuses ; (il est proche de la ville
de Catane, où l’on montre le trésor du très glorieux corps de sainte Agathe, vierge et martyre, la
bienfaitrice de la ville qui la préserve de ces flammes ; les gens du peuple appellent cette montagne le
mont Gibel. Les habitants de la région content que le grand Arthur est apparu, de nos jours, dans ce
désert.) Un jour en effet, un palefrenier de l’évêque de Catane laissa échapper, pendant qu’il l’étrillait,
le cheval dont il avait la charge : celui-ci (…) prit sa liberté et s’enfuit. Le domestique partit à sa
recherche au milieu des escarpements et des ravins, sans le trouver ; de plus en plus inquiet, il poussa
sa recherche du côté des cavernes obscures de la montagne. Que dire de plus ? Un sentier fort étroit
mais plat se présenta ; le garçon parvint dans une très large plaine, agréable et pleine de délices, et là,
dans un palais de merveilleuse facture, il trouva Arthur allongé sur un lit d’apparat royal. (…)Il
raconta (…) comment il avait été blessé jadis au cours d’une bataille livrée contre son neveu Mordred
et Childéric, le duc des Saxons, et qu’il restait là depuis déjà longtemps, ses blessures se renouvelant
chaque année5.
D’autres versions disent que c’est sa sœur Morgane qui le soigne, elle qui dans certaines
traditions est appelée « la fée de Montgibel », c’est-à-dire de l’Etna6, mais malgré la
« sagesse7 » légendaire de celle qui connaît « l’utilité de toutes les plantes pour guérir les
corps malades » d’après la Vita Merlini de Geoffroi de Montmouth, ses blessures se rouvrent
tous les ans à nouveau : retour cyclique éternel, chaque année à nouveau le roi meurt, le temps
ne progresse pas, il ne peut revenir encore. Ces blessures qui se rouvrent tous les ans à
nouveau, renvoyent donc à une problématique liée à l’écoulement du temps. E. Faral8
démontre l’importance de la diffusion de la croyance en un retour du roi Arthur et cherche à
établir son origine.
I. Un figure royale emblématique : Hellequin ou de l’analogie
Or, son nom renvoie à une figure mythique ancestrale, Hellequin, avec laquelle
d’ailleurs son nom peut être interchangeable.
4 Gervais de Tilbury, Otia imperialia, trad. française par A. Duchesne, Le Livre des Merveilles, Les Belles
Lettres, 1992, p. 151-152. Cf. aussi G. de Monmouth, Vita Merlini, éd. Faral, in La légende arthurienne. Etudes
et documents, t. 3, Paris, Champion, 1929, v. 929-940. 5 Gervais de Tilbury, op. cit. p. 151-152.
6 Le Conte du Papegau, publié par H. Charpentier et P. Victorin, Paris, Champion Classiques Moyen Age, 2004,
§ 8, 20, p. 94 : « Sire, ce dist la Dame sans Orgueil, je suis seur Morgaine, la fee de Mont Gibel. » Dans le
Roman de Jaufré, nous rencontrons aussi une fée de Gibel, qui cependant ne porte pas le nom de Morgane. Un
peu plus tard, vers 1380 le Catalan Guillem de Torroella écrit un poème intitulé La Faula dans lequel le
narrateur fait un voyage merveilleux dans le pays de Morgane : le poète le situe dans une caverne de l’Etna, où,
dit-il, séjourne également le roi Arthur. Cf. M. Stanesco et M. Zink, Histoire européenne du roman médiéval,
Paris, P.U.F. , 1992, p. 65. 7 Morgue la sage », i.e. la savante, Yvain, v. 2949, éd. M. Roques, Champion, 1982. G. de Monmouth, Vita
Merlini, éd. citée, t. 3, v. 920-921 : « Morgen ei nomen, didictque quid utilitatis / Gramina cuncta ferant, ut
languida corpora curet ». 8 E. Faral, La légende arthurienne: études et documents, 3 t, Paris, Champion, 1929, t. 1, p. 225 .
3
Les démons se font parfois un jeu de se transformer et de prendre l’aspect extérieur (…) de chevaliers
partant pour la chasse ou s’amusant à divers exercices. On dit couramment qu’ils sont de la famille
d’Allequin ou d’Arthur (qui dicuntur de familia Allequini vulgariter vel Arturi). Etienne de
Bourbon († 1261)9.
« Qui dicuntur de familia Allequini vulgariter vel Arturi » : Etienne de Bourbon n’est
pas le seul a faire cet amalgame entre ces deux noms. Gervais de Tilbury lui encore10
par
exemple évoque lui aussi cette « famille du roi Arthur » qui est en réalité une troupe de
démons sillonnant l’air et se livrant en particulier à la chasse. Vel…vel : nous sommes donc en
présence d’une analogie. L’analogie est certainement un outil fondamental de l’argumentation
médiévale, qui ne se contente pas de poser des équivalences par ressemblances, mais qui en
tire aussitôt des déductions en cascade, permettant l’édification d’un réseau de signification
tout à fait fascinant, qui ne cesse d’influer sur la manière de voir et d’interpréter le réel.
Arthur, Charles Quint, Hellequin
Essayons donc de voir de plus près le nom de Hellequin auquel renvoie celui d’Arthur.
Dans la nuit du premier janvier 1091, quelque part en Normandie du côté de Bonneval, un
prêtre du nom de Walchelin s’en revient d’une visite qu’il vient de faire à un malade, on peut
imaginer un mourant. Voilà qu’il devient le témoin d’une apparition extraordinaire et
terrifiante : un géant muni d’un gourdin le retient et l’oblige à assister au défilé d’un cortège
immense de piétons, de chevaliers et de clercs, de femmes et de personnes qu’il reconnaît
comme étant récemment défuntes. Il y a aussi des créatures étranges, des nains aux grosses
têtes, des Ethiopiens, et des chevaux d’étrange façon. Orderic Vital11
, qui rapporte comme
authentiquement avenu cet événement, conclut en rapportant les propos du prêtre :
Voilà sans doute la Mesnie Herlequin (Haec sine dubio familia Herlechini est). J’ai ouï-dire que
plusieurs personnes l’ont déjà vue dans le passé mais, incrédule que j’étais, je me suis moqué de ceux
qui m’en faisaient le récit parce que jamais je n’avais eu sous les yeux des preuves certaines d’un tel
événement. Maintenant, ce sont les âmes des morts (manes mortuorum) que je vois réellement, mais
personne ne me croira lorsque je raconterai ce que j’ai vu si je ne montre pas aux hommes une preuve
certaine.
Cette hardiesse a failli mal tourner pour lui puisque sans intercession d’un membre du
cortège, il aurait été à son tour emporté. - C’est le premier témoignage écrit que nous
possédions sinon sur le roi Hellequin qui nous occupe ici, du moins sur sa mesnie, sa suite.
Hellequin est donc ici le meneur d’un cortège de revenant. Dans d’autres textes, postérieurs
dans le temps mais dont certains comportent des réminiscences mythiques plus anciennes que
la version fortement christianisée d’Orderic, la dimension royale du géant est tantôt soulignée,
tantôt implicite à travers notamment la mention de sa mesnie, terme qui renvoie en particulier
à la suite d’un grand seigneur.
9 Etienne de Bourbon, Tractatus de diversis materiis predicabilius, éd. F. Lecoy, 1877, repris dans Anecdotes
historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d’Etienne de Bourbon.., par A. Lecoy de la Marche,
Paris, 1877, § 365, p. 321-322. Texte en annexe. 10
Gervais de Tilbury, Otia imperalia (III, n°58), éd. G.W. Leibniz, in Scriptores rerum Brunsvicensium, I ,
Hanovre, 1707, p. 987 et sq. ; trad. française par A. Duchesne, Le Livre des Merveilles, Les Belles Lettres, 1992.
Texte latin reproduit en annexe. 11
Historia ecclesiastica, VIII, 17, éd. M. Chibnall, Oxford, 1973.
4
Une autre analogie par rapport à une autre figure royale est attestée, véhiculée cette
fois-ci par la préposition pro : Hélinand de Froidmont († 1229/30)12
évoque lui aussi
l’apparition d’un revenant qu’il rattache à notre famille. Mais il explique que Hellequin veut
dire non plus Arthur mais Charles Quint : Corrupte autem dictus est a vulgo Hellequinus, pro
Karlequinus. Il s’agit sans doute du Prince Charles de Lorraine, qui est le dernier Carolingien
connu : il a hésité un instant de faire valoir ses droits sur le trône de France, ce dont Hugues
Capet profita pour prendre le pouvoir. Représentant légitime des Carolingiens, victime d’un
changement de souveraineté, des légendes courent au sujet de son futur retour « avec son
armée (…). Peut-être ses partisans espèrent-ils quelque temps son retour, de la même façon
que les Bretons attendaient Arthur13
» : on disait qu’il était enfermé avec ses soldats dans le
mont Odenberg, en Basse-Saxe. Et pour souligner la cohérence du réseau analogique, on peut
noter qu’en Hesse, les mères pour faire peur à leurs enfants désobéissants leur disent : Du, der
Quinte kommt14
! tout comme on brandit la menace du roi Hérode dans l’exemple cité tout à
l’heure.
Une autre imbrication syncrétique apparaît ici : Jacob Grimm note que le mont
Odenberg se trouve à proximité du « Wuotansberg » ; il établit ainsi une parenté entre Wodan
et Charles Quint, même s’il souligne le caractère tardif de l’assimilation du motif de la chasse
sauvage à ce dernier. On raconte en effet que Charles Quint aurait dégagé une source avec son
cheval dans les environs de l’Odenberg pour son armée altérée. Vint ensuite la grande bataille
à la suite de laquelle il fut enfermé avec toute son armée dans la montagne. Mais tous les sept
ou cent ans, il en sort ; on peut observer alors ses guerriers s’adonner à leurs exercices
militaires15
. Or, d’autres interprétations feront non plus seulement de Charles Quint mais de
Hellequin un avatar d’Odin ou Wodan : le réseau de signification reste cohérent. Jacques Le
Goff de son côté pense que Charles Quint renvoie à Charlemagne. Or, Charlemagne, de son
côté, d’après de nombreuses traditions germaniques16
, ne dort-il pas, lui aussi, dans une
montagne ? Lui aussi se réveillera un jour, lui aussi, il reviendra peut-être. Mais revenons-en à
Hellequin- Charles-Quint. Un autre exemple assimile les deux figures :
De la mesnie Helquin je te di communelment ce sont deables qui vont en guise de gent qui vont à
cheval trotant ; et ce veult dire Sautiez, quant il dit : ab incursu… C’est une manière de trot. Mes donc
vint ce mot Helquin ? tu dois savoir, mon enfant, que le quint Charles qui fu en France, si emprint une
grant bataille et mourut. Après sa mort l’en vit pluseurs au champ où la bataille avoit esté auxi comme
une grant assemblée de gens trotans à Charles ; et disoit on que c’estoit le quint Charles qui estoit mort
et qu’il revenoit au champ où il avoit esté mort, lui et sa gent, et pour celui Charlequin, c’est à dire le
quint Charles, l’en dit Helquin. Si que pour celle apparence dit on encore, quant l’en voit, ou on ot
auxi comme une assemblée de gens trotans à cheval par nuit : Ce sont la mesnie Hellequin, aussi
comme qui deist : veci la gent au Charle quint17
.
12
Hélinand de Froidmont, De cognitione sui, PL 212, col. 731-733. Texte latin en annexe. 13
A. Lombard-Jourdan, Aux origines de Carnaval, op. cit., p. 265. 14
J. Grimm, Deutsche Mythologie, 3e édition, t. II, p. 890.
15 Deutsche Mythologie, 2, p. 783 et sq. Cf. B. Kellner, Grimms Mythen, Studien zum Mythosbegriff und seiner
Anwendung in Jacob Grimms Deutscher Mythologie, Frankfurt, Peter Lang, 1994, p. 118. 16
Cf. D. Boutet, Charlemagne et Arthur ou le roi imaginaire, Paris, Champion, 1992, p. 295. 17
Le Roux de Lincy, Le Livre des Légendes, Paris, 1836, p. 241-242. Reproduit par K. Meisen, op. cit., p. 80.
Nous trouvons le même texte dans le Second Lucidaire (1312) : voir D. Ruhe, Gelehrtes Wissen, Aberglauben
und pastorale Praxis im französischen Mittelalter. Der Second Lucidaire und seine Rezeption (14.-17. Jh.),
Wiesbaden, 1993, p. 115, cité par C. Lecouteux, Chasses fantastiques et cohortes de la nuit au Moyen Age, op.
cit., p. 158.
5
Dans Richard sans Peur18
, nous trouvons cette même assimilation entre les deux noms; ce
texte particulièrement intéressant met en scène un cérémonial d’hommage royal, soulignant
donc cette qualité essentielle de notre figure :
Et incontinant comme à heure d’entre chien et leu, à l’avesprant, ilz vont ouyr une si très grant noise et
si horrible que merveilles, et veirent comme deux hommes prindrent ung drap de plusieurs couleurs, se
leur sembloit, que ilz estendirent sur la terre et ordonnèrent par siéges comme s’ilz vouloient ordonner
siége royal. Et puis après veirent venir ung roy acompaigné de plusieurs manières de gens, qui
merveilleusement grant noise et espovantable faisoient. Celuy roy se seoit en siége royal, et là le
saluoient et servoient ses gens comme roy.
Hellequin – Charles Quint - Arthur :une seule et même figure royale, un roi qui dort quelque
part et qui revient, qui apparaît périodiquement, dont le destin est interprété de manière
diverse mais qui donne un singulier éclairage à la fonction royale.
Il faut donc se demander si on a affaire à
Retour ou substitution ?
L’enjeu de bien de contes de fées, c’est pour le roi de trouver un successeur pour
assurer la pérennité de son trône ; c’est de trouver un gendre digne ; c’est, enfin, pour le héros
d’épouser la fille du roi.
Or, tout le monde le sait, le roi Arthur a eu beaucoup de descendants. En particulier,
dit-on, il est l’ancêtre d’une famille très célèbre, les Plantagenêts qui revendiquent cette
filiation mythique ne serait-ce que pour ne pas être en reste par rapport aux Français et leur
légendaire Charlemagne, qui dort lui aussi dans une montagne, on vient de le voir, dont on
attend également le retour. En même temps, par un fait exprès de haute cohérence, la famille
Plantagenêt revendique en même temps – et ce n’est pas contradictoire ! – un autre ancêtre : le
diable en personne : « Nous, qui provenons du diable, reviendrons au diable », dit Richard
Cœur de Lion19
. Or, Hellequin est volontiers assimilé à une figure diabolique.
.
Aussi bien Giraud de Barri que Gautier Map suggèrent dans leur peinture de la Cour
d’Henri II Plantagenêt des similitudes avec la Mesnie Hellequin dont ils rapportent d’ailleurs
tous deux des éléments de légende. Gautier va jusqu’à en faire un purgatoire ambulant, un
locus penalis très proche des peintures de l’enfer où défilent en cortège les vices et des
démons, une danse terrifiante. Cette assimilation des « curiales » des Plantagenêts se trouve
également chez Pierre Blois qui dit dans son Episola XIV ad sacellanos aulicos regis
Anglorum de 1175 : « nunc autem sunt martyres saeculi, mundi professores, discipuli curiae,
milites Herlewini20
. Saint Bernard de Clairvaux lui-même aurait dit que les Plantagenêts
venaient tous du diable, et qu’ils retourneraient un jour en enfer21
! Mais surtout, on dit que la
18
Chronique de Normandie : une « avanture » en forêt de Moulineaux (XVe). K. Meisen, op.cit., p. 85-94,
d’après une impression de 1487 parue à Lyon, reprise par F. Michel, Chronique des Ducs de Normandie, Paris,
1836, p. 336-341 et par L.J.N. Monmerqué et F. Michel, Théâtre français au moyen âge, Paris, 1839, p. 73-76. 19
M. Aurell, op. cit., p. 7. 20
PL 207, col. 44. 21
E.Türk, op. cit., p. XIV.
6
troupe volante n’a plus été vue très précisément depuis l’avènement d’Henri II, comme si une
substitution, un retour avait eu lieu :
La troupe et les phalanges divagantes de la nuit, que l’on disait d’Herlethingi, assez fameuses en
Angleterre sont apparues jusqu’à l’époque du roi Henri II, notre maître ; dans cette armée de l’errance
infinie, de la ronde insensée, de l’étourdissant silence (attoniti silencii), bien des hommes apparurent
vivants alors qu’on les savait décédés. Pour la dernière fois, cette mesnie (familia) d’Herlethingi a été
vue dans la marche des Galles et d’Hereford la première année du règne d’Henri II, vers midi. Elle
était semblable à nous lorsque nous errons avec des chariots et des bêtes de somme, avec des
corbeilles et des paniers, des oiseaux et des chiens, et un grand concours d’hommes et de femmes. Les
premiers qui les virent ameutèrent contre eux tout le voisinage avec des trompettes et des cris, et
comme c’est l’usage chez ce peuple très vigilant, ils se munirent aussitôt de toutes sortes d’armes ; une
troupe nombreuse arriva, et n’ayant pu par la parole leur extorquer le moindre mot, ils se préparaient à
leur répondre avec des javelots. Mais s’élevant dans les airs, les autres disparurent d’un seul coup.
Depuis ce jour, on n’a jamais revu ces guerriers, comme s’ils nous avaient communiqué leur errance,
nous qui sommes fous, qui usons nos vêtements, dévastons les royaumes, rompons nos corps et ceux
de nos montures, ne cessons de chercher un remède à nos âmes malades (…).Gautier Map (v.1182-
1193)22
.
On trouve la même logique de substitution en conclusion de l’histoire de Herla que nous
allons retracer dans un instant, et qui permet d’assimiler Herla à Hellequin :
Un récit fabuleux affirme que ce roi Herla poursuit toujours ses folles rondes en compagnie de son
armée, dans une errance infinie, sans repos ni relâche. Beaucoup de gens, croit-on, ont vu
fréquemment cette armée (multi frequenter illum, ut autumant, exercitum viderunt). Mais on dit
qu’elle cessa finalement, la première année de notre roi Henri, de visiter périodiquement notre
royaume comme elle le faisait auparavant. De nombreux Gallois la virent alors s’immerger au bord de
la Wye, le fleuve d’Hereford. Cette ronde fantastique (fantasticus ille circuitus) s’est apaisée depuis
cette heure, comme si elle nous avait communiqué son errance pour prix de son repos23
.
Si nous avons ici la suggestion d’une substitution de l’un à l’autre (le « jeune » remplaçant
« l’ancien »), d’autres textes font état du retour du roi sans hésitation possible :
Dans Le Batard de Bouillon24
, Hugues de Tabarie découvre en Féerie un cor d’ivoire ; il
arrive à souffler dedans et à en sortir un son, ce qui non seulement révèle au monde qu’il est
le chevalier le plus courageux qui existe (Nuls hons du firmament Ne me porroit sonner pour
or ne pour argent, Se che n’est flour du monde, passant de hardement Tout le monde a .j. jour,
v. 3437-3440) ; la sonnerie fait en outre apparaître le roi couronné, comme dans une véritable
épiphanie d’outre-tombe:
A tant es vous Artus, le noble conquerant,
Richement couronnés de couronne luisant ;
.II. fees gratieuses l’aloient adestrant ;
L’une fu sa soer Morgue, qui a prisier fist tant (v. 3548-3552).
22
De nugis curialium, I. XIII. Courtiers’s Trifles, éd. et trad. en anglais M.R. James, 1914, revue par C.N.L.
Brooke et R.A.B. Mynors, Oxford, 1983 ; Contes de courtisans, Traduction du De nugis curialium de Gautier
Map par M. Perez, Lille, Centre d’études médiévales de l’Université de Lille, 1987 ; A.K. Bate, Contes pour les
gens de cour, Turnhout, Brepols, 1993. 23
De nugis curialium, I.XI. Traduction de J.-C. Schmitt, Le corps, les rites, les rêves, le temps, op. cit., 2001, p.
362-365. 24
Le Batard de Bouillon, Chanson de geste, éd. R.F. Cook, Genève, Droz, 1972.
7
Le Roi avec toute une escorte de fées invite le chevalier et ses compagnons à une promenade
à travers un verger entouré d’un mur en or et en argent, promenade qui durera cinq années !
Autre exemple, c’est un étonnant poème latin, le Draco Normannicus, écrit entre 1167 et
1170 par Etienne de Rouen pour Henri II Plantagenêt qui développe, à la suite de Geoffroy de
Montmouth et de Wace, cette histoire d’Arthur enlevé soit dans l’Insula Avallonis, ou
Fortunata, ou Pommorum, où, soigné par Morgane, il attend son retour :
Saucius Arturus petit herbas inde sororis,
Avallonis eas insula sacra tenet.
Suscipit hic fratrem Morganis nympha perennis,
Curat, alit, refovet, perpetuumque facit25
.
Arthur a donc été soigné par les herbes de sa sœur Morgane dans l’Île d’Avalon, herbes qui
non seulement l’ont guéri, mais qui l’ont rendu immortel. Or, Etienne de Rouen, à cause de la
menace d’invasion que fait peser Henri II sur la Bretagne, imagine qu’un personnage appelé
Roland de Bretagne – nom rempli de sous-entendus – envoie une lettre au roi Arthur défunt
depuis si longtemps pour l’appeler à l’aide. Arthur frémit de colère, répond à Roland pour le
rassurer, puis écrit à Henri II lui-même et lui rappelle successivement ses propres victoires sur
les Romains et sur Mordred, puis sa blessure mortelle de la bataille de Camlann et sa guérison
par les herbes merveilleuses de Morgain, (…) puis enfin, le fait que, devenu le puissant roi
des Antipodes, il est prêt à rentrer aussitôt en Bretagne si Henri II ne laisse pas son peuple en
paix26
.
Retour au substitution ? On a affaire à un imaginaire fondé sur la représentation cyclique du
temps. Essayons dans une seconde partie d’en sonder la signification.
II. Si le grain ne meurt : du cycle de la fécondité
Dans une traduction en langue vernaculaire de la Cité de Dieu de Saint Augustin,
Raoul de Presle (1316-1382) associe la Mesnie Hellequin à Dame Abonde, divinité populaire
qui entre autres renvoie, comme son nom l’indique, à la fertilité.
La mesgnée de Hellequin, de dame Habonde & des esperis qu’ils appellent Fées, qui apperent es
estables & es arbres (XV, 23)27
.
On trouve d’autres intersections des réseaux respectifs de ces deux figures dans la littérature
vernaculaire, ce qui peut souligner leur parenté.
25
Cité par M. Delbouille, « Le Draco normannicus, source d’Erec et Enide, in Mélanges de Langue et de
Littérature médiévales offerts à Pierre Le Gentil, Paris, SEDES, 1973, p. 194. Nous nous appuyons sur cette
étude très importante. 26
Ibid., p. 194. 27
Du Cange, article « Hellequinus », Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, Glossarium novum
ad scriptores medii aevi, t. 2, Paris, 1766, col. 733. Précisons que cette traduction de Raoul de Presle nous est
parvenue par de nombreux manuscrits, dont certains (comme celui de Mâcon) superbement enluminés. Citons le
BNF fr. 22 dont une partie a été éditée par A. Le Roux de Lincy et L.-M. Tisserand dans Paris et ses historiens
aux XIVe et XV
e siècles, Paris, 1967 ; le ms Mâcon B.m. 0001, f. 002, 1 ; des éditions incunables comme celle
d’Abbeville, 1486, BNF, Réserve C 554.
8
Une récurrence éternelle
Or, la notion de souveraineté est profondément liée à celle de la fécondité et de
l’éternel retour du cycle saisonnier. C’est qu’on désigne aussi parfois par le nom de
« Königsheil », c’est-à-dire « le pouvoir miraculeux du roi de donner de riches moissons, des
richesses, la victoire et le butin de la guerre28
. » La thématique de la fertilité, profondément
ancrée dans la référence hellequinienne, est véhiculée au niveau symbolique et narratif par la
corrélation originale nouant les noces, le banquet et la mort, les funérailles. Nous touchons ici
au cœur du résidu mythique à travers cette « logique conflictuelle » ou « prélogique29
» ou
encore coexistence des contraires dans ces couples antinomiques définissant la tension
dialectique inhérente au mythe. Les merveilleux Evangiles des Quenouilles s’en font l’écho :
Quant une personne songe neupces, sachiez pour vray que ce signifie la mort d’aucun son
amy30
.
Revenons à Gautier Map. Il relate l’histoire d’un roi nommé Herla, nom constituant une autre
variante de Hellequin. C’est d’abord une histoire de noces, noces accompagnées comme il se
doit d’un somptueux banquet préparé et servi par des créatures surnaturelles qui puisent ces
richesses dans un monde souterrain regorgeant de richesses31
; c’est l’histoire d’un « très
ancien roi des Bretons » qui sera privé de sa royauté, ou plus exactement ravi à sa terre par un
autre roi, un pygmée qui se dit son proche parent et qui l’entraîne pendant trois jours, semble-
t-il, dans son royaume souterrain, sous prétexte de fêter son mariage. Seulement, lorsque
Herla remonte à la surface de la terre, il doit constater que deux siècles ont passé au lieu de
trois jours, qu’il n’entend plus la langue d’un royaume qui n’est plus le sien (les Saxons ayant
chassé les Bretons), et qu’il est condamné à une existence errante avec toute sa suite sans
pouvoir mettre pied à terre à cause d’un cadeau qui véhicule un interdit : un petit chien
« portatif » qui refuse obstinément de sauter à terre, ce qui aurait rompu le charme. En fait, ce
petit chien doit « protéger Herla et ses homme de la dissolution 32
», il les maintenir dans cette
situation de morts-vivants ou de revenants de l’autre monde.
A l’exemple de cette histoire , de nombreuses trames évoquant la Mesnie Hellequin y
intègrent la thématique des noces dans son lien intime et paradoxal avec la mort. « La
référence à la fertilité est implicite la plupart du temps, comme si son rapport avec les
cohortes nocturnes était une évidence33
. » Ce n’est pas par hasard que tant de traditions
associent le banquet de noces au festin funèbre34
. Ce n’est pas par hasard que les banquets
rituels, encore de nos jours, ont lieu dans les nuits les plus obscures de l’année, gage d’une
résurrection, d’un retour de fertilité promis35
. Or, la thématique du mariage est connectée à
28
K.F. Werner, « Lien de parenté et noms de personne. Un problème historique et méthodologique », in G. Duby
et J. Le Goff (dir.), Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Ecole française de Rome, 1977, p. 16. 29
Cf. A. Siganos, « Définitions du mythe », in D. Chauvin, A. Siganos et Ph. Walter, op. cit., p. 86. 30
Les Evangiles des Quenouilles, samedy, .xvij.e chappitre, p. 115.
31 « L’autre monde est plein de richesses, c’est une véritable pays de cocagne ». C. Lecouteux, Chasses
fantastiques et cohortes de la nuit au Moyen Age, op. cit., p. 83. 32
C. Lecouteux, « Chasse sauvage / Armée furieuse. Quelques réflexions », in Ph. Walter (dir.), Le mythe de la
Chasse sauvage dans l’Europe médiévale, Champion, 1997, p. 27. 33
C. Lecouteux, ibid., p. 192. 34
Notons en outre que « le repas en commun (…) symbolise à la fois l’union sociale et magico-religieuse des
participants, et (…) annonce ou constitue la fin de la cérémonie. A. Van Gennep, Le folklore français, Paris,
Robert Laffont, « Bouquins », 1999, t. 2, p. 1427. Voir aussi p. 1895. 35
A propos du banquet rituel et mythique, voir Ph. Walter, La Mémoire du Temps, op. cit., p. 458-459.
9
celle du charivari, lui-même apparenté au carnaval36
: en effet, le charivari est organisé à
l’occasion du remariage d’une veuve et aurait pour fonction d’empêcher le mari défunt,
susceptible d’être jaloux, de se manifester, de devenir un revenant vindicatif.
Mariage et fertilité relèvent ainsi d’une problématique commune. Ce n’est pas par
hasard que dans beaucoup de nos traditions, notre roi dort dans une montagne : « Dans la
montagne qui s’ouvre sur toutes les richesses d’une noce, nous reconnaissons un des sièges de
l’Autre Monde, et en particulier le séjour de Pluton, régnant sur les trésors souterrains et la
foule des morts37
. » D’ailleurs, les clochettes, qui peuvent être des attributs paradoxaux – et
carnavalesques - de Hellequin peuvent se rencontrer déjà dans l’Antiquité à l’occasion d’une
cérémonie cultuelle liée à la fertilité :
Lors des cérémonies en l’honneur de Cybèle, figuraient toujours les tympana ou tambourins garnis de
petites sonnettes ou de grelots. De telles fêtes dédiées à la Terre Mère étaient encore célébrées en
Gaule aux IVe-VI
e siècles. Il se produisait sans doute une confusion entre tympana et campana
38.
La récurrence éternelle de certains événements marquants se rattache à cette
problématique cyclique et acquièrent par là-même un sens. Les blessures d’Arthur qui vit
retiré dans l’Etna se rouvrent tous les ans, repoussant par conséquent son retour sur terre dans
un avenir éternellement mythique mais sans pour autant le mettre en question. Est impliqué ici
la problématique de la vie, de la mort – et en particulier du passage de vie à trépas -, ainsi que
celle de la résurrection. Ainsi, le retour des revenants de la Mesnie Hellequin lors des Douze
Jours notamment établit un lien ambigu avec les vivants : soit les revenants prodiguent des
richesses à ceux qu’ils visitent, leur apportent donc la fertilité (n’est-ce pas là le sens de la
générosité dont fait preuve le Pygmée à l’égard de Herla), soit ils les cherchent pour les
entraîner avec eux, c’est-à-dire ils incarnent la menace de la mort. La hotte en particulier peut
servir de support à cet imaginaire dans des traditions encore vivantes aujourd’hui.
La figure qui se dégage de l’aspect funéraire de notre problématique est celle du roi
ravisseur : voilà la menace qu’incarne Hellequin, voilà la menace que l’on brandit en
évoquant le roi Hérode. On pourrait d’ailleurs opposer à cette figure le motif inverse, tout
aussi fécond et répandu, du rapt de la reine : Proserpine-Perséphone ou enocre la Reine
Guenièvre du Chevalier de la Charrette peuvent être évoquées comme exemples. Comme par
exemple dans le lai Sir Orfeo39
, traduction d’un lai anglo-normand aujourd’hui perdu (qui
aurait été écrit entre 1160 et 1189 et auquel font allusion le Lai de l’Espine, Floire et
Blancheflor et le Lancelot en prose). Le sujet de Sire Orfeo, s’il se réclame explicitement de
l’antique Orphée et Eurydice, présente un syncrétisme de traditions remarquable : Orfée est
Roi d’Angleterre ; son père descend de Pluton et sa mère de Junon. :
Leur roi arriva aussitôt, très vite,
Avec cent chevaliers, ou plus,
36
Voir en particulier J.D. Lajoux, Le calendrier et les fêtes calendaires dans l’Europe contemporaine, Thèse de
Doctorat, Paris, Sorbonne-René Descartes, p. 707-752. 37
M.-L. Chênerie, « Un recueil arthurien de contes populaires au XIIIe siècle ? », art. cit.,, p. 44.
38 A. Lombard-Jourdan, op. cit., p. 226.
39 Edité dans Marie-Thérèse Brouland, op. cit. ; voir en particulier p. 372. Le manuscrit Auchinleck est de 1340.
On assiste en effet à l’émergence de textes anglais après que Jean sans Terre eut perdu la Normandie et
qu’obligation eut été faite à tous les nobles d’opter pour l’une ou l’autre nationalité. Le français outre-Manche
subit alors un rapide déclin qui se précise surtout à partir de 1295 où les textes officiels commencent à paraître à
la fois en lingua Anglicana et Gallicana. Les descendants des anciens Normands ne comprennent plus le
français, et pis, le français devient « un objet de risée ».
10
Et cent demoiselles aussi,
Tous sur des chevaux blancs comme neige
Et blancs comme lait étaient leurs vêtements.
Jamais encore je n’avais vu
Si belles créatures jusqu’ici.
Leur roi avait une couronne sur la tête (…).
De force il m’arracha,
Et m’obligea à chevaucher, avec lui,
Sur un palefroi, à ses côtés.
Il m’emmena dans son palais (…) (v. 142-157)40
.
Cette figure de ravisseur royal (appelé king of fairy) est présentée en train de chasser, et on
précise qu’il ne prend jamais aucune bête : on comprend que ses proies sont d’une nature tout
à fait particulière41.
Le sommeil du roi : l’Absconditio
Il s’agit sans doute d’une réminiscence mythique autour de la figure du « premier roi »
liée au thème de l’ « Absconditio » peut être évoquée ici: la carrière de ce roi « est
mystérieusement prolongée par une retraite mystique qui l’installe provisoirement (…) dans
un au-delà ou un espace marginal, dont il ressortira un jour pour récupérer son trône ou
exterminer les puissances du mal42
». Comme le montre la légende d’Herla et celle d’Arthur,
son éviction temporaire peut être le résultat d’un changement de régime ou de souveraineté
causé par une invasion. Mais le roi attend le moment de sa revanche - d’où ses apparitions
cycliques, cette « mort » qui n’est donc qu’apparente – pour restaurer sa royauté, sa
souveraineté et les valeurs qui s’y rattachent. - Dans le monde des morts, le roi est devenu
« souverain de l’au-delà, c’est-à-dire grand régulateur de la circulation des âmes, ordonnateur
des rapports, échanges et réciprocités entre les morts et les vivants43
» ! Voilà pourquoi le roi
Hérode, pourquoi Arthur, Charles Quint et Hellequin reviennent de nuit déjà à présent ! Ce
motif mythique est très répandu. Les personnages possédant une envergure historique
importante ne peuvent pas mourir44
. Voici en effet ce qui arrive lorsque meurt le roi :
40
Tho com her king, also bliue, / With an hundred knightes & mo, / & damisels an hundred al-so, / Al on snowe-
white stedes; / As white as milke were her wedes. / Y no seighe neuer ghete before / So fair creatours y-core./
The king hadde a croun on hed (…). / Wold ich nold ich, he me nam, / & made me with him ride / Opon a palfray
bi his side; / & brought me to his palays. 41
He might se him bisides / (Oft in hot vnder-tides) / The king o fairy with his rout / Com to hunt him al about /
With dim cri & bloweing, / & houndes also with him berking; / Ac no best thai no nome, / No neuer he nist
whider thai bi-come. / & other while he might him se / As a gret ost be him te / Whele atourned, ten hundred
knightes (v. 281-291). 42
F. Delpech, « Le Chevalier-Fantôme et le Maure reconnaissant, remarques sur la légende de Muño Sancho de
Finojosa », in Ph. Walter (dir.), Le mythe de la Chasse sauvage dans l’Europe médiévale, Champion, 1997, p.
73-123, p. 115. 43
F. Delpech, art. cit., p. 120. 44
Cf. D. Boutet, op. cit., p. 295. J. Mourreau, « La Chasse sauvage, mythe exemplaire », art. cit., p. 42. Brüder
Grimm, Deutsche Sagen, München, Winkler Verlag, 1981, d’après la troisième édition de 1891 (première édition
1816 et 1818), notamment n° 23 : „Friederich Rotbart auf dem Kyffhäuser“, et n° 26 et 28 qui évoquent le
Gudensberg ou le Wunderberg où séjourne Charlemagne et toute son armée. La légende n° 28 évoque en outre
la possible confusion entre Kaiser Karl V et Friederich. C. Seignolle, Contes, Récits et Légendes des pays de
France, Presses de la Renaissance, 2004, « Alsace », t. II, 740.
11
Des rumeurs se mettent alors à circuler. Le roi (ou le héros) est « parti pour un pays lointain » (parfois
pour la Croisade), il est « retenu prisonnier » (Richard Cœur de Lion), il sommeille en quelque endroit
éloigné. Ceux qui lui ont succédé profitent de son absence (….). Mais un jour il reviendra dans toute
sa gloire et sa fureur, rétablir l’ordre et la loi, châtier les traîtres, et récompenser les siens. C’est alors
qu’il prendra, bien souvent, les traits du Wilde Jäger45
.
D’ailleurs, plus récemment, cette constante s’est vérifiée pour Napoléon46
dont Walter
Scott, Théophile Gautier ou encore Victor Hugo se sont fait l’écho47
, et même pour Hitler48
.
En Alsace, rapporte Claude Seignolle, on raconte que l’empereur Frédéric Barberousse dort
près de Buchenfeld, au Bibelstein. Et surtout, « c’est Dietrich qui dort entouré de ses preux et
la main toujours à la garde de son épée, attendant sans doute pour se lever que le Turc vienne
abreuver ses chevaux sur les bords du Rhin. De cent ans en cent ans, il se réveille, fait le tour
du rocher pour dégager sa longue barbe, regarde aux quatre points cardinaux, se recouche et
s’endort à nouveau49
. »
Le Carnaval
Or, il y a une époque toute particulière dans l’année où le ciel s’ouvre pour ainsi dire,
où les échanges entre nos deux mondes s’accélèrent, où les morts re-fécondent pour ainis dire
notre univers, enfin où l’on fête ce renouveau cyclique du temps : c’est Carnaval.
En janvier-février, les frontières entre le monde des vivants et celui des morts sont ouvertes, et plus
spécialement, selon une croyance commentée par Macrobe, l’accès des hommes aux cieux devient
possible. Par ce passage appelé la porte des hommes, les âmes circulent en suivant la Voie lactée ;
elles peuvent alors s’introduire dans l’au-delà50
.
Carnaval marque le changement de saison, marque l’initiation d’une rotation
supplémentaire de la roue du temps, marque le passage, celui de la mort à la vie, ce
qu’exprime la loi du renversement qui le marque. Carnaval, c’est un rite de fécondité que l’on
célèbre à l’occasion du passage à une nouvelle année, un rituel de mariage aussi51
: Carnaval
est apparenté à Charivari, qui est organisé soit pour fustiger des veuves ou veufs à l’occasion
de leur remariage (selon l’idée que la viduité n’empêchant pas la continuation du premier
mariage, il y a bigamie du nouveau marié, ce qui provoque le courroux du mort), soit pour se
moquer des (futurs ?) cocus affublés pour l’occasion de bois de cerf52
. Carnaval est toujours
lié à une gigantesque ripaille, banquet au cours duquel peuvent naître de grands héros comme
Gargantua. Exaltation enfin de délices infernaux à la manière des projections provocatrices
d’Aucassin53
, inversion suprême comme dans le Songe d’enfer de Raoul de Houdenc54
qui
offre ce spectacle d’un enfer joyeux où l’on passe le plus clair de son temps à banqueter ; les
mets cependant n’y sont pas communs : on mange de « l’usurier lardé », de la « langue frite
45
J. J. Mourreau, art. cit., p. 41. 46
J. Tulard, Le mythe de Napoléon, Paris, Armand Colin, 1971, p. 59. C. Seignolle, Contes, Récits et Légendes
des pays de France, Presses de la Renaissance, 2004, « Alsace », t. II, p. 786. 47
Vie de Napoléon ; Partie Carrée ; Les Burgraves. J. J. Mourreau, art. cit., p. 42. 48
J. Tulard, op.cit., p. 59. 49
C. Seignolle, op. cit., « Alsace », p. 741. 50
Ph. Walter, « Antoine, le centaure et le capricorne du 17 janvier », art. cit., p. 131. 51
J.D. Lajoux, Le calendrier et les fêtes calendaires dans l’Europe contemporaine, Thèse de Doctorat, Paris,
Sorbonne-René Descartes, p. 707-752. 52
Cf. les considérations d’ A. Lombard-Jourdan, op. cit., p. 72-80. 53
Aucassin et Nicolette, VI, li 24 et sq., p. 6. 54
R. de Houdenc, Le Songe d’enfer, suivi de la Voie de paradis, poèmes du XIIIe siècle, éd. M. Timmel Mihm,
Tübingen, Niemeyer, 1984.
12
de playdeur », du « rôti d’hérétiques en sauce » dans une ambiance d’« anthropophagie
délirante », d’« inversion carnavalesque55
».
Or, si la configuration de la Mesnie Hellequin semble, pour qui la considère de
manière un peu rapide et superficielle, renvoyer à un imaginaire surtout funèbre et effrayant,
on peut déceler un aspect carnavalesque déjà dans le premier témoignage écrit de la Mesnie
Hellequin, celui d’Orderic Vital, qui semble pourtant a priori étranger à cette inspiration
festive : le défilé des différentes catégories de revenants dûment « costumés » selon leur
appartenance sociale représenterait un « carnaval funèbre », un « carnaval macabre56
» . En
particulier à partir des attestations vernaculaires, une figure apparemment opposée à celle de
notre roi inquiétant émerge lentement, une figure affublée de clochettes carnavalesques
comme dans Le Tournoiement Antécrist d’Huon de Méry (1240)57
, où Hellequin est assimilé à
la futile Cointise : les clochettes sont explicitement associées au désir de plaire : Et por ce que
plus cointe fust, Ot sonnestes et campenelles .. : pour être plus jolie encore, elle avait attaché
des sonnettes et des clochettes à ses armes. Adam de la Halle dans Le Jeu de la Feuillée
(1276)58
met en scène une créature désacralisée, en l’occurrence un roi Hellequin amoureux
de la fée Morgane (v. 607-610) ! Remarquez que nous restons dans l’univers de référence
arthurien ! Dans un appendice du Roman de Fauvel (1310/1314)59
, Hellequin semble surgir au
milieu d’un charivari. Remarquons que les personnages peints par Etienne de Bourbon, à peu
près à la même époque, qui se complimentent réciproquement au sujet de l’élégance de leur
coiffure peuvent évoquer ce même thème de la coquetterie dans une association à la figure de
Hellequin. Par le biais de la coquetterie – impliquant un « maquillage », donc un
travestissement, donc une mascarade – le pas vers l’attribution de qualités carnavalesques ou
dérisoires peut donc être franchi. Mais dans quelle mesure Hellequin funèbre et Hellequin
tintinnabulant s’excluraient-ils mutuellement ?
III. Coïncidentia oppositorum : sceptres et marottes
On commence peut-être à entrevoir la fascinante cohérence de notre réseau de
signification, et pourquoi Hellequin dès nos plus anciens textes est à la fois effrayant – et
affublé de clochette. C’est que mort et fête du printemps se tiennent. Si le grain ne meurt, il ne
peut fructifier, nous apprennent l’Evangile de saint Jean et la nature. Examinons donc cette
coexistence des – apparentes – contraires à travers quelques attributs royaux :
La couronne et les cornes
La couronne est naturellement le premier symbole de la royauté, si bien qu’elle peut la
symboliser sans même faire référence à la personne qui l’incarne (J. Favier évoque par
55
J. Baschet, op. cit., p. 570. 56
P. Bouet, « La ‘Mesnie Hellequin’ dans l’Historia Ecclesiastica d’Orderic Vital », in Mélanges François
Kerlouégan, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 515, Paris, Les Belles Lettres, 1994, p. 65 et 66. 57
Huon de Méry, Le Tournoi de l’Antéchrist, éd. G.Wimmer 1888, reprise par S. Orgeur, Paradigme, 1994. 58
Adam de la Halle, Œuvres Complètes, éd. P.Y. Badel, Le Livre de Poche, coll. Lettres Gothiques, 1995. 59
Fauvel est constitué de trois œuvres : les deux premiers livres sont désignés comme « version A » ; une
seconde version, E, qui est plus exactement un troisième livre, rédigée par Chaillou de Pestain, se trouve
intercalée. C’est cette version qui développe le motif du charivari; elle comporte un volet iconographique
important. Editions : A. Langfors, Le Roman de Fauvel de Gervais du Bus, Paris, 1914 -1919 (SAFT 63) ; le
texte central qui nous intéresse se trouve également dans M. Lecco, Il motivo della Mesnie Hellequin nella
letteratura medievale, op. cit., p. 133-146 (Appendice II).
13
exemple les seaux de régence de la minorité et des Croisades de Louis IX, ou la monnaie de
Charles VI dite « écu de couronne »). Elle est réellement portée le jour du sacre, ce qui
souligne sa portée symbolique, et à l’occasion de cérémonies ou de banquets. L’iconographie
médiévale, en particulière la statuaire des cathédrales dote les rois de l’Ancien Testament de
couronnes à côté des rois médiévaux. Mais on trouve la couronne également très tôt
également associée aux personnifications de la mort. Le Triomphe de la Mort de Clusone
(XVe siècle
60) représente une Mort portant couronne ; l’Erlkönig de Goethe sera doté de Kron
und Schweif. Mais le roi ne porte pas nécessairement une couronne sur son chef. Celui-ci peut
en effet recevoir un autre ornement. On a vu que Arthur peut apparaître sinon lui-même
affublé de cornes du moins chevauchant une bête à cornes qui font pendant à sa couronne. La
couronne est en effet interchangeable avec les cornes. Celles-ci sont en effet à la fois
emblème de puissance et marque diabolique. En effet, dans l’Antiquité, les cornes étaient
d’abord un attribut de puissance : « Tu ramènes l’espoir dans les âmes tourmentées, tu donnes
au pauvre des forces et des cornes », dit un célèbre vers d’Horace61
. Le commentateur ajoute :
« Les cornes sont l’emblème de la force et mises, à ce titre, au font des statues de fleuves ou
même attribuées à Dionysos. Le symbole était sans doute d’origine orientale. »
On connaît le fameux Moïse cornu de Michel-Ange au tombeau de Jules II, à Saint-
Pierre in Vincoli à Rome, représentation qui reprend la tradition juive dotant justement Moïse
de cornes : Pierre le Mangeur a diffusé cette croyance que Moïse, au bout des 40 jours passés
sans boire ni manger auprès de Dieu qui lui dictait les tables de la Loi, apparut au peuple avec
des cornes lorsqu’il descendit de la montagne62
; il s’agit peut-être à l’origine d’une
métaphore analogique aux rayons du soleil qui tel un halo ou une auréole, entourent le visage
du transfiguré venant de passer tant de temps en présence du Très-Haut. Le Psaume 111
(112), 9, dans la version de la Vulgate dit de l’homme craignant Dieu que sa justice subsiste à
jamais et que cornu ejus exaltabitur in gloria, ce qui est en général traduit, de manière un peu
édulcorée, par « sa tête s’élève avec gloire ». De même, dans le premier Livre de Samuel (ou
Rois, I, 2, 1), Anne exalte le Seigneur en disant : Exultavit cor meum in Domino, et exaltatum
est cornu meum in Deo meo, ce qui est en général traduit par « ma force a été relevée par
l’Eternel ». Mais en même temps, les cornes sont l’attribut d’animaux comme le taureau, le
bouc ou le bélier, réputés pour leur férocité brutale et qui ont fourni très tôt des analogies
parlantes avec toutes sortes de caractéristiques négatives du diable qui en porte par
conséquent très volontiers, mais qui cependant à son tour peut être représenté avec une
couronne63
! Cette identité fonctionnelle de la couronne et des cornes est illustrée par exemple
par le roi Belnain dans le Conte du Papegau : lorsqu’il apparaît sous une apparence animale,
il arbore bien des cornes toutes blanches, ornées d’or, rappelant ainsi la couronne que le roi
possède du moins symboliquement sous son autre apparence : Si ont la trouvé une moult belle
beste qui estoit bien aussi grande comme ung toriaux (…) et avoit deux cornes en la teste plus
blanches que neges a barres de fin or, et sa pelleure estoit plus vermeille que nulle graine64
.
On trouve la même symbolique dans Wigalois, où le roi Lar est transformé en un animal
60
A. Corvisier, Les danses macabres, Paris, PUF, 1998, p. 55. 61
Tu spem reducis mentibus anxiis / uirisque et addis cornua pauperi, Ode 21, lib. III, éd. F. Villeneuve, Paris,
Les Belles Lettres, 1944. Le commentateur ajoute : « les cornes sont l’emblème de la force et mises, à ce titre, au
font des statues de fleuves ou même attribuées à Dionysos. Le symbole était sans doute d’origine orientale. » 62
Cumque descendisset de monte cum tabulis, apparuit facies ejus cornuta, et ipse ignorabat, id est radii miri
splendoris ferebantur de facie ejus, qui reverberabant oculos intuentium, quos gloriam vultus Moysi appeliat
Paulus apostolus. Petrus Comestor, PL 198, col. 1192, “De secundis tabulis, et gloria vultus Moysi”. 63
Cf. Bibl. Hist. Mss. BN n° 6829, f°18, cité par A. Maury, Croyances et légendes du Moyen Age, , op. cit., p.
285, n° 2. 64
Le Conte du Papegau, p. 196, li. 20-23.
14
merveilleux et magnifique qui « porte sur sa tête une couronne dorée élégamment rehaussée
de deux cornes noires saillantes65
».
Mentionnons finalement les fameuses oreilles de cheval du roi Marc66
, oreilles qui
dans notre problématique peuvent être interprétées comme une variante des cornes. Dans le
Tristan de Béroul, l’affreux nain Froncin connaît ce secret du roi et le trahit en le confiant à
une aubépine :
Li nains fu cort, la teste ot grose,
Delivrement ont fait la fosse,
Jusq’as espaules l’i ont mis.
« Or escoutez, seignor marchis !
Espine, a vos, non a vasal :
Marc a orelles de cheval. »
Bien ont oï le nain parler (v. 1329-1335)67
.
Les barons ayant été conviés à assister à cette confidence, s’empressent d’informer le roi
qu’ils connaissent désormais son secret. Le roi rit, ne dément pas mais coupe la tête au nain.
Dans une version irlandaise de cette légende, le roi Echoid, affublé des mêmes
« gracieusetés », possède un barbier attitré en la personne d’un jeune homme de confiance,
avec lequel il se retire dans une région déserte chaque fois que son chef doit être tondu,
naturellement dans le but de cacher au monde son secret. Un échange de questions-réponses a
alors rituellement lieu entre le roi et son barbier (dont la fonction, soulignons-le, possède une
symbolique mortelle) : « Ma tête est-elle belle et majestueuse après avoir été rasée de frais ? »
demande le roi. « Elle est vraiment bien », répond le jeune homme68
. Il s’agit sans doute
d’une réinvestiture royale rituelle liée à une mort /résurrection (la tête a été rasée, coupée, puis
« remise en place ») dont la question pourrait rendre compte. La réponse dans ce cas
affirmerait que le roi est bien vivant et qu’il pourra donc réintégrer avec son barbier la société
dont il s’était écarté le temps du « rite ». Ainsi donc, signe ambigu s’il en est, couronne,
cornes ou oreilles sont emblématiques de l’ambivalence de la figure royale qu’est Hellequin,
et tous ses avatars.
Sceptres et marottes
Autre attribut royal : le sceptre. Souvenons-nous : le géant qui a arrêté le prêtre
Walchelin certaine nuit de Nouvel An portait un gourdin. Le bâton est un attribut identitaire
fondamental des principaux avatars de Hellequin, et tout particulièrement de l’homme
sauvage plein d’ambivalence dans notre univers. Or, le bâton, dans l’univers de référence
royal, devient sceptre. Plus précisément, au moins depuis l’époque carolingienne, le roi de
France en possède deux : un long bâton qui constitue l’insigne de commandement et qu’il
tient dans la main droite, et un plus petit bâton pourvu à son extrémité d’une main d’ivoire
appelé « main de justice » qu’il tient dans sa main gauche (cf. Favier, Dictionnaire de la
65
Daz tier ûf sînem houbet treit / eine guldîne krône; / diu ist bewahsen schône / mit zwein swarzen hornen.
Claude Lecouteux remarque à ce propos que les cornes ne sont pas seulement une marque de puissance, mais
aussi de « majesté et de sacralité, puisque leur forme est circulaire et qu’elles renferment une couronne royale
qui est le seul signe de reconnaissance du roi Lar transformé en cet animal qui, dans sa symbolique, se rapproche
du cerf. » V. 3859-3862 et note n° 80, p. 169. 66
G. Milin, Le Roi Marc aux oreilles de cheval, Genève, Droz, 1991. 67
Béroul, Le Roman de Tristan, Poème du XIIe siècle, éd. E. Muret, Paris, Champion, 1982.
68 G. Milin, op. cit., p. 49.
15
France médiévale). Ce petit sceptre est d’ailleurs porté également par l’empereur et les autres
rois, ainsi que par la reine. Mais ce n’est pas l’ornement du sceptre, appelé d’ailleurs à être de
plus en plus soigné, qui importe : c’est bien le bâton qui signifie le pouvoir du roi, un peu
comme la baguette magique renvoie à celle du prestidigitateur.
Or, ce bâton royal, ce sceptre possède lui aussi son contraire, aux antipodes de la
gravité : c’est la marotte. La marotte est un bâton surmonté d’une tête grotesque couverte d’un
capuchon et pourvue de clochettes ; il y a donc fusion des trois attributs évoqués en un seul
objet. La marotte est l’emblème ou l’« accessoire inséparable du fou69
», c’est le « sceptre »
du fou (Narrenzepter), l’emblème de son pouvoir, double ridicule de lui-même tout autant que
du roi.
Attachez moy une sonnette
Sur le front d’ung moyne crotté,
Une oreille à chasque costé
Du capuchon de sa caboche :
Voyla ung sot de la Bazoche
Aussi bien painct qu’il est possible (…)70
.
Au même moment, toujours vers la fin du Moyen Age apparaît un « tintinnabulant
personnage » dans la configuration carnavalesque mais aussi hellequinienne : « Son visage
s’enserre dans un capuchon à oreilles d’âne orné de grelots et il porte une marotte à la main.
Apparue furtivement vers 1350 en marge d’un psautier de Wurzbourg, son image, servie par
l’invention de Gutenberg, va déferler en se multipliant dans tout l’Occident71
. »
Pour mon souhait, qui nuyt et jour m’assotte,
Je souhaitte des choses non pareilles :
Premièrement une belle marotte
Et chapperon garni de grans oreilles,
Des sonnettes faisant bruit à merveilles.
Les Souhaiz du Monde (XVe siècle
72).
Ainsi donc, plutôt qu’une grimace satirique du pouvoir, la marotte pourrait en représenter une
autre, une nouvelle face, le reflet de miroir, distorsion qui pourrait être l’image du
renouvellement de la souveraineté, de la nécessité de ce renouvellement, et la projection de sa
jeunesse reconquise, du moins est-ce là une analyse possible dans cette configuration.
On pourrait développer d’autres exemples encore d’attributs ambivalents. La barbe par
exemple, qui est à la fois un symbole de royauté – pensez à la barbe fleurie de Charlemagne
qui al piz lui ventelet et par laquelle il jure, alors qu’il semble que dans la réalité, pendant la
plus grande partie du Moyen Age on ne portait pas de barbe - et l’attribut spécifique de
l’homme sauvage, un proche parent de Hellequin, et dont on a pu dire qu’il relève « d’une
symbolique de la royauté alternative73
», idée que nous ne pouvons développer ici. On
69
C. Gaignebet, J. D. Lajoux, Art profane et religion populaire, op. cit., p. 183. 70
Marot, La seconde Epistre du Coq en l’Asne envoyée audict Jamet, in L’Enfer, Les Coq-à-l’Âne, les Elégies,
éd. C.A. Mayer, Paris, Champion, 1977, p. 37, v. 80-85. 71
M. Lever, op. cit., p. 37. 72
Cité par M. Lever, ibid., p. 37. 73
Ph. Walter (dir.), Le Devin maudit, op. cit., p. 32.
16
pourrait évoquer le manteau74
, autre attribut royal qui est en même temps la tenue de
camouflage si j’ose dire des figures hellequiniennes.
Conclusion
Ce réseau de cohérence établi autour de la problématique du retour du roi et de sa
logique cyclique, saisonnière nous renvoie à la fonction fondamentalement sacrée de la
royauté comme présidant aux flux de la vie, à la mort et à la résurrection. Cette cohérence est
tantôt exprimée en termes dramatiques, mais parfois aussi avec l’insolence des défilés
carnavalesques et du Charivari.
Notre figure renvoie ainsi au mythe du Graal qui peut constituer un reflet de notre
configuration. Le mystère du Graal est un mystère « de bouche », un mystère de nourriture.
Souvent, le saint vaissel est une véritable corne d’abondance qui sert à chaque convive ce
qu’il désire sans qu’il y ait à formaliser son souhait75
. Le Graal ne génère-t-il pas l’hostie
sacrée qui maintient en vie le père du Roi Pêcheur, une vie à vrai dire d’au-delà déjà ? Encore
un roi qui attend dans sa cachette son heure, figure qui se distingue d’ailleurs mal de celle du
Roi Pêcheur lui-même, blessé parmi les quisses ambesdeus76
, blessure emblématique
nécessitant une régénération en vue de rétablir la fertilité manquante. Ceci n’exclut pas
naturellement le lien avec la souveraineté qui était pour un Jean Marx la quintessence de la
question qu’aurait dû poser Perceval pour mettre fin à la malédiction de la terre gaste et des
grandes injustices ayant forcés à l’exil les justes :
Des paroles doivent être dites et des questions doivent être posées, qui appelleront infailliblement des
réponses. Ces réponses donneront au héros du Graal le moyen de maîtriser les causes de la Geis ou de
l’interdit placé sur le pays à délivrer. (…)
Mais le fait important était que celui qui pose la question et qui obtient [la] réponse au sujet de la base
même de la royauté et de la Souveraineté, se trouve qualifié par là même comme successeur du Roi.
(…) La royauté est libérée par la question ; elle est en même temps dévolue77
.
La littérature met en scène ces senefiances. Dans le tardif Perceforest78
en particulier,
nous avons un très bel exemple de la conjointure – pour parler comme Chrétien – du notre
problématique de la souveraineté, et de la configuration mythique de la Mesnie Hellequin : le
roman met en scène le retour, il dit la revenue, du roi après 16 ans d’absence du pouvoir, à
cause d’un accident de chasse. Son retour se fait de manière triomphale. A la manière d’une
véritable entrée royale, un immense cortège le précède, l’annonce. Et, point culminant avant
son apparition, un tournoi a lieu dans l’air, comme un spectacle offert au roi ! Et puis il
apparaît, couronné, le sceptre à la main, et l’ordre se trouve rétabli, définitivement.
La fonction royale renvoie donc, d’après ces considérations, fondamentalement à la
perception du temps, à une tentative de sa maîtrise. Des images différentes, très suggestives,
traduisent cette problématique, sous-tendues par celle du passage immuable des saisons qui
74
Vêtement des dieux, il est également porté par les représentants de l’autorité dans la Bible. Lorsque Elie (1
Rois, 19,19) le transmet à son disciple Elisée, il lui lègue également son pouvoir. A la fois symbole de pouvoir et
de protection, il peut également marquer l’appartenance à un corps, ordre ou confrérie. G. Duchet-Suchaux, M.
Pastoureau, La Bible et les Saints, guide iconographique, Paris, Flammarion, 1994, art. « manteau ». 75
Par exemple La Queste del Saint Graal, p. 15, li 7 et sq., en part. li 27. Troisième Continuation, v. 41938 et sq. 76
Le roman de Perceval ou le Conte du Graal, v. 3513. 77
J. Marx, La légende arthurienne et le Graal, op. cit., p. 277 et 271. 78
Perceforest, II, 2, § 438 sq.
17
renouvellent le temps : celle du roi qui dort dans une montagne ou une île ; l’idée de son
retour cyclique qui y est attachée ; et enfin, l’écoulement miraculeux du temps. La royauté
symboliserait ainsi cette force de la régénération de chaque nouveau printemps, qui chaque
nouveau printemps vainc le froid de la mort. Elle symboliserait en même temps ce désir d’une
éternité immuable où tout se stabiliserait, où le –bon – roi veillerait de manière perpétuelle à
la marche harmonieuse de l’univers. La vraie royauté, ce serait ainsi celle qui parviendrait à
dominer le temps, c’est-à-dire à vaincre la mort. Défi ultime qui se pose à Arthur, et que nous
rend intelligible la nature paradoxale et fascinante de son double mythique, Hellequin.


















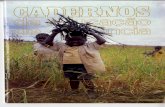






![2]m](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63213e05e9691360fe02237c/2ou-166782-m.jpg)