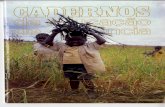L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves
Transcript of L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves
Dalhousie University is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Dalhousie French Studies.
http://www.jstor.org
L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves Author(s): Anne-Marie Picard Source: Dalhousie French Studies, Vol. 17, DE DURAS ET ROBBE-GRILLET À CIXOUS ET DEGUY (
Fall-Winter 1989), pp. 17-26Published by: Dalhousie UniversityStable URL: http://www.jstor.org/stable/40836526Accessed: 18-08-2015 23:50 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
17
L'Indiade ou Vinde de leurs rêves Anne-Marie Picard
Cette fresque de cinq heures, longue comme la tapisserie de Bayeux, me poursuit de son indianité depuis mon printemps parisien 88. La fixer à mon mur une fois pour toutes et qu'il en soit fait des rêves exotiques d'Hélène Cixous.1
L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves2 est une entreprise culottée. D'abord parce qu'on dirait que tout spectacle s'adressant aux intellectuels implique une zone de souffrance quelque part: à la Cartoucherie de Vincennes, la prise du plaisir du texte est âprement punie par la dureté monacale des sièges. Ascétisme oblige. Cilottée, parce qu'elle est oeuvre de totalisation s'il en est une. L'englobante affection d'Hélène Cixous et d'Ariane Mnouchkine3 pour le sublime du tout-embrasser étouffe parfois le désir. Comblé-es de riz au cari, d'Histoire, d'émotions, de musique à tout rompre, des folles bousculades de la multitude, nous sortons de là, abasourdi-es, épaté-es devant l'impertinence, nous dirons, du projet. Mettre sur scène l'Inde est déjà gigantesque, mais l'humanité tout entière tient de la Genèse. Il y est en effet question de retrouver l'étincelle première de la constitution de l'être, l'Inde devenant alors ce pays parabolique du Pilgrim's Progress de Bunyan.
Contentons-nous, au lieu de refaire le monde intentionnel de Cixous - ce qui tiendrait ici du miracle - de traverser quelques nuées célestes; les passages4 focalisés comme autant de bulles textuelles à faire exploser.
Trois directions, décelées dans l'inten tionnalité de L'Indiade, vont poindre dans ce collage triangulaire:
1. Un mouvement de l'ordre de Yhistoriographique. Située entre les élections de 1937 et l'assassinat de Gandhi en 1948, la pièce d'Hélène Cixous fait revivre le drame de la Partition et de l'Indépendance. Nous verrons que tente surtout de se parler un être- avant l'action du sujet historique, l'événementiel étant déjà répertorié dans les livres. Imprimée dans nos têtes d'Occidentaux, l'histoire de l'Inde et de sa liberté constitue chez les spectateurs un savoir plus ou moins flou, une doxa. Ce qu'en-dira-t-on sur l'Inde permet le suspens, donnant une directionnalité du moins chronologique.
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
18
2. Un mouvement que nous appellerons ontographique. Uêtre- indien (en l'occurence) se constitue sous nos yeux dans une réponse à la question: "Où suis-je? Que suis-je?" Uontos est alors un être- dans, une cartographie.
3. Enfin un mouvement théologique impliqué par les deux autres et les traversant. Tension qui est recherche de l'humain comme catégorie et qui participe donc du Divin. C'est un être-comme qui se constitue.
Ainsi le sujet de L'Indiade se parle dans et par les lieux de l'autre.
1. D'abord celui an je de l'historiographe. Les personnages sont alors des êtres en proie à leur historicité obligée, se débattant avec leur iconicità même. Ils sont des êtres toujours-déjà enfermés dans la douleur future, écrite ailleurs.
2. Le je-indien est impensable sans la nomination de soi effectuée par l'autre: Hindou, Musulman, Punjabi, Bengali... Le nom de lf Autre me nomme. La territorialisation me constitue dans une négativité sanglante: où est l'autre, je ne suis pas.
3. La rédemption serait dans la rencontre vraie, c'est-à-dire dans la pensée de l'autre comme "humain". Le Tiers Divin (figure maternelle) rassemble les contraires. Le transport ailleurs (meta- phorein) permettrait la non- violence et la paix.
Commençons par une visualisation de l'espace resplendissant que vont parcourir les personnages: dans la Cartoucherie, la scène est immense en marbre blanc. Les murs sont blancs, nus sans tenture. Le plafond, couvert d'une toile parsemée d'étoiles dorées, diffuse une lumière fluorescente qui donne l'effet de la lumière du jour. Les dizaines d'Intouchables qui ont disposé les tapis et dessus de gros futons blancs, sont sortis à reculons et à regret. Nehru, Azad, Sarojini, la seule femme, et Patel sont assis sur ces futons, adossés à de gros traversins.
La première tirade5, incipit de la pièce, s'ouvre sur un nom propre, celui d'un absent. L'annonce de son arrivée (1) enclenche un niveau que Ton peut appeler premier, celui de l'action, ici future apparition d'un personnage. La deuxième phrase (2) joue un tout autre jeu. Deux autres instances absentées, parlées à la troisième personne ouvrent un débat pour le spectateur: le chef de la ligue musulmane, comme singularité, s'oppose à la pluralité des leaders du Congrès. Cette différence peut permettre l'inférence: " Jinnah est le chef de la ligue". Mais eux, qui sont-ils? Qui sont les personnages présents en costume d'apparat, signifiés donc comme importants? Cette absence plurielle énoncée, l'utilisation du futur (Ce sera un grand jour. ..l'Inde. ..verra réunis...) et la personnification lyrique
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
19
des lieux {Vinde. ..verra ti Bombay la magnifique) appartiennent au discours historiographique. La rencontre à venir, marquée par un passif {réunis. ..les leaders. ..et le chef...), parle un temps déjà constitué comme événement, le processus de connaissance déjà accompli car déjà narrativisé. Une conscience historique fait du futur des actants un passé pour elle-même par cette boucle rétroactive de la prophétie.
Si Nehru est au moins reconnu sur scène, Azad, lui, ayant le costume musulman, est difficile à situer. Un premier nous (3. a) apparaît dans la relation de possession à grand destin et en opposition à les Anglais. Puisque l'Inde a été précédemment associée à grand jour, il nous est possible par cette contiguïté sémantique, d'ébaucher un nous-indien seulement. Le sujet Azad (qui est effectivement leader du Congrès) n'est pas mis en scène. La présence matérielle du corps et de la voix ne s'énonce pas dans le discours. Si ce nous-indien s'ébauche par la référence au déjà-écrit de l'Histoire, ce pronom à la troisième personne des leaders continue de circuler sans objet pour se poser. Elle reste comme titre, fonction politique et rôle historique. Ainsi Jinnah, le chef de la ligue, les leaders du Congrès et nous-l'Inde (en opposition aux Anglais) ont pris leur position. Discours de la simplicité idéologique d'une certaine historiographie qui rend cohérent a priori ces instances multiples et ambivalentes, l'histoire déjà racontée recommence. Assez d'éléments sont en place pour "désangoisser" le spectateur. Azad n'a pas à parler en son nom, il va présenter Nehru et donc mettre en marche le déjà-connu.
L'adresse directe (3.b) va situer le groupe autour de son chef Nehru, et constitue une mise en situation politique et temporelle. L'infinie indétermination de ce qui précède est soudain située dans un avant de l'événement (la rencontre). Ainsi la parole de cet homme, parole à venir, pourrait faire changer l'Histoire. L'injonction est la suivante: "Nehru! Faites l'Histoire!1' Ce qui est demandé est d'accomplir la prouesse de Mary Poppins qui saute effectivement dans le dessin à la craie sur le trottoir! Le mouvement rétroactif premier de la prophétie se transforme en ré-écriture du livre. Le donc nous fait présupposer à lui seul le pouvoir de Nehru, la grandeur de Nehru, similaire à celle du jour et celle du destin indien. Ce qui est posé n'est que cette représentativité essentielle au théâtre, représentativité qui va être la possibilité de la mise en marche: 1. de l'action (l'homme Nehru dans le contexte en question a ce pouvoir); 2. du contrat d'authenticité. Nehru, en Toccurence, est déjà constitué comme héros et va faire croire en la vérité du
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
20
discours historiographique qui s'est élaboré (2). Il va pouvoir jouer sur les deux plans de l'historique et de l'héroïque.
Jinnah, les leaders, l'Inde, les Anglais et Nehru sont en place. Le discours de la vérité historiographique est le leurre nécessaire pour que se signe un autre contrat, celui de coopération entre spectateurs et personnages. Il nous est dit: "Voilà c'est simple, ce que vous savez déjà sur l'Inde est vrai". Cet appel démagogique permet la croyance, fondatrice de la dénégation qui travaille dans les arts de la représentation: croyance doxologique qui est production idéologiquement marquée et qui va fonctionner dans Ulndiade comme effet de réel. Ainsi le sujet-Nehru est addressé en tant que figure historique accréditée par Azad, incarnation de l'Histoire et de sa doxa. Nehru est en ce sens déjà déterminé par son futur; le personnage, dans cette synchronie atemporelle, ne passe la rampe que comme masque du Grand Nehru. Il n'accède pas à une existence même fictive, qui serait perçue comme en devenir, en question. Azad non plus: lui, parle comme choeur, commentateur de l'invisible évidence.
Quelque chose parle les personnages, comme si une parole avait été divisée en plusieurs corps, la lecture d'un même texte dite par plusieurs voix. Les êtres restent plongés dans l'immanence et ne se séparent pas existentiellement les uns des autres. Ils sont enfermés dans l'impuissance, prisonniers d'une omniscience. L'Inde de leurs rêves. Qui parle? Qui sont-i/s?
L'action métaphorisée (4) reste effet stylistique. Le monde possible sur lequel les personnages agissent, ne se constituera pas, restera parabolique: la nudité de la scène aidant à empêcher toute élaboration imaginaire d'un univers transformable. La carte murale du hall d'entrée (l'Inde et le Pakistan actuels) constitue le lelos de cette réalité qui, dans la pièce, s'élabore semblable à elle-même: Ulndiade trace une cartographie des mouvements historiques comme prétexte à la mise en scène de la subjectivité, mouvance de l'Un vis-à-vis de l'Autre.
L'Autre est tout de suite posé. Son nom commence et termine la première tirade. En tant qu'absent, c'est-à-dire objet de désir et de répulsion (les absents ont toujours tort), il s'inscrit comme le non- nous, le nous étant qui se parle comme l'Inde. Jusqu'au bout, le spectateur aura du mal à inclure Jinnah dans ce sujet national qui cherche à se constituer. Il est après tout l'ouvrier de la Partition et nommé implicitement comme tel dès le début. Il est le mécréant, celui qui croit mal, qui n'a foi ni en dieu, ni en l'union nationale, ni en Gandhi, ni en la mère-pays natal, il est donc le mauvais fils. Habillé à l'européenne, il sera vu par nous, spectateurs, comme
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
21
l'autre de l'autre-indien, et l'origine de la douleur de l'Inde (les Anglais, eux, sont beaux comme des princes, même poète shakespearien6): l'ennemi pour Cixous, c'est celui qui divise, qui n'aime pas donc.
Le désir de la rencontre (retrouvailles) des contraires, thème principal de la morale cixolienne, se met en place dès l'incipit. Jinnah et Nehru, les deux frères ennemis, ne se rencontreront pas. Le Pakistan adviendra.
Cixous entreprend d'écrire une Iliade moderne pour le théâtre au moment où le récit dans le roman institué reprend du "poil de la bête". Elle s'y embarque avec toute l'innocence émerveillée nécessaire. A trop feuilleter les livres d'histoires, les livres sur les autres, elle tente d'accomplir un travail d'archéologue, de conservatrice de musée aux idées, aux peuples.7 Récit d'un temps d'une mise au monde qui est auto-nomie, où se donner un nom unique est l'enjeu: Hindoustan, Pakistan, Punjab, Bengale... Les mots ont chacun leur visage, leurs rêves d'Indes au pluriel. Ainsi les noms propres, documentés dans les programmes distribués, historiographes, photographiés, biographies arrivent une fois incarnés, déjà chargés de sens. Ils pourraient aussi bien rester muets, ne pas produire de paroles et se re-produire sur scène dans la pantomime (d'ailleurs très utilisée par Ariane Mnouchkine qui supprime les dialogues de certaines scènes trop bavardes dans le projet initial). Llndiade est constituée par une série de tableaux à la chronologie floue où se mêlent l'historiographie et la "harangue" théologique passant souvent par le lyrique pour en invoquer à l'essence de l'humain.
Marqué de cette nostalgie, du plus-jamais-pourtant-peut-être d'un temps qui serait situé avant la connaissance, le passé continu de notre deuxième passage est signe du paradis perdu où croire, c'est ne-pas-savoir, c'est-à-dire être (indien)- je crois que je suis, donc je suis. Le je qui énonce ici est celui d'une ontologie nationale, celle de l'être-indien. S'insère dans ce continuum le je du personnage, Iqbal, le poète: par mes chansons (1) et mes livres (2), le sujet s'énonce dans un rapport de possession à des objets symboliques mais historiques; en ce sens, documents, parce qu'ils ont une existence matérielle. Il nous est dit: "Iqbal a existé historiquement. Son poème ici-maintenant pourrait avoir été le sien. Un poète parle comme ça...". Mentionner dans cette tirade lyrique l'existence prouvable de restes textuels encore tangibles, ancre le sujet parlant dans le discours historique sus-mentionné et idéologiquement laisse parler une autre poète, enfermant le je du héros dans l'immanence. Mes chansons, encore production du sujet indien, deviennent mes livres,
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
22
simple support matériel, ersatz du sujet musulman à venir, encore simplement étranger, non-indien. Mon frère le Hindou (2) va, par rétroaction, qualifier le je jusque là prononcé. Mon frère, dans la relation familiale à ma mère/mon pays natal, constitue ainsi le sujet dans ce rapport-là: "Où est ma mère? Mon frère est hindou, il est accepté comme fils par ma mère, qui suis-je?"
Faute de trouver une mère qui le reconnaisse, l'enfant oublié va chercher une autre légitimation (jadis. ..nos cavaliers [4]): le je cherche à se figurer en relation, en filiation par rapport à un sujet musulman historique, constitué par l'héroïsme, déjà chanté par d'autres poètes. Recherche d'une identification perdue (reprise de l'imparfait de la nostalgie) avec d'autres productions symboliques. Le héros lyrique de Llndiade, par cet effet intertextuel, se constitue comme objet discursif. L'effet de réel, inscrit dans la mention rapide de "produits" de l'existant Iqbal, est évacué pour abstraire la voix parlante, la désincarner et donc la désancrer de la scène temporellement et spatialement située. L'essentialité du sujet ne peut que se "prononcer". Il n'y a pas d'énonciation car pas de rapport à l'énoncé autre que dans lã prosopopèe: je est parlé par un autre, une quatrième instance: la première étant la mère, le pays; la deuxième, le frère; la troisième, le musulman, enfin nommé. Le sujet est ainsi une instance toujours absente, parlé comme type, "le musulman", constitué dans la division et sa violence, celle de la séparation d'avec la mère et le frère.
Le personnage Iqbal finira sa tirade sur ces mots: Je vous ai dit ma désillusion. Elle est désormais ma pente, mon chemin. I La division est. Division, tout est division. Ce qui avait été un moment d'absence au "réel" de la diégèse, absence à l'événement, se dissipe dans l'adresse aux autres, en face. Ma désillusion serait donc une reprise sémantique, une titularisation de l'envolée lyrique qui vient de se terminer. Le sujet parlant apparaît enfin comme présence de chair et d'os, transcendante et en devenir. Le sujet est celui du poète connu mais ici-maintenant dans la décision, dans l'acte (il quittera l'Inde et la scène pour ne plus y revenir). Ces deux dernières lignes du poète Iqbal, à la première scène du premier acte (donc au tout début), vont permettre à Cixous de positionner une ontologie de l'un contre l'autre, face à l'amour transcendantal de Gandhi. Iqbal passant du "j'étais indien" au "je suis étranger" a tracé le chemin de l'ontologie musulmane indienne comme surgie d'un passé harmonieux, continu; un état prénatal et natal où il était reconnu par sa mère l'Inde. Etat d'être dans l'indifférence qui aboutira, par la prise de conscience de sa propre altérité, à la question: "Où suis-je?" et "Que suis-je?" Le positionnement (national comme
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
23
métaphoriquement familial) constitue le nom donc l'envisagement possibe de soi. Du précaire "plus indien" à l'anonyme "étranger", il se constitue "musulman", d'abord par la visée de l'autre comme "hindou" (le nommant, il se nomme); et en se plaçant dans la patrilinéarité, celle de la mémoire des ancêtres constitués comme "pères" par la nomination effectuée dans et par le discours des poètes et des historiens - la paternité devant se parler telle sans cesse, étant seulement matérialisable comme métaphore produite par les discours de la loi et de l'histoire "patriarcales" (comme leurs noms l'indiquent).
Cette tirade fonctionne comme un acte de parole du je-musulman qui vient de se constituer in vitro. Iqbal rejoue la division comme constitutive; elle signifie la sortie du marasme indéterminé grâce au Big Bang de l'advenue de et à la différence. Ce chantre du ou bien ou bien - avec Jinnah comme coreligionnaire, mais lui agira sur l'inscription de cette différence-là sur la carte du monde - sera idéologiquement positionné face à la philosophie gandhienne constitué autour du signifié transcendantal de la maternité.8
La complexité de ce qui est en jeu dans L'Indiade commence sans doute à se faire sentir: l'intention est historiographique seulement si l'Histoire sert de trame de vérité pour que puisse s'y tisser l'éphémère du mouvement de constitution ontologique national des peuples. La pièce saisit ce moment de l'advenue à la différence dans toute sa violence et son potentiel d'humanité, c'est-à-dire de bonté et de beauté fondamentales pour notre Cixous du Siècle des Lumières. L'épopée, a-t-elle une autre fonction?
La totalisation que rêve d'accomplir L'Indiade ne peut même se penser sans une formidable croyance en l'humain et cette nuée rosissante à forte tendance panthéiste agace parfois notre cynisme post-soixante-huitard et postmoderne. Il est vrai qu'après la déconstruction, il faut reconstruire. Mais la question qui pourrait me construire, moi-sujet féminin (en l'occurence), est celle de l'adresse: où suis-je inscrite dans L'Indiadel Comment cet allant-devenant- sexué du sujet, construit dans et par les productions symboliques, laisse-t-il la possibilité de m'insérer spectatrice? Nous ne pourrons que bégayer une bribe de réponse (ceci constituant un travail de longue haleine).
La présence, parmi les Grands de l'histoire de l'Inde, de la poète Sarojini Naïdu, permet de se penser comme cible d'une adresse, donc de faire jouer l'identification.
Dans cette tirade de l'acte IV, Sarojini s'adresse à un être aimé (1). Cet amour-là parlé par un vocatif affectif ouvre un nouveau registre, celui du personnel et de l'humain, enfin! Son moi-je
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
24
égocentrique à souhait impose avec vieille ci fatiguée un ordre. Ou plutôt c'est une catastrophe qui s'opère: de l'ordre de l'icônicité historique surgit le désordre du corporel, du vivant là-maintenant. Toi-aimé de moi, vieille, fatiguée ancrent le sujet appréhendé comme toujours-déjà incarné dans un corps et en relation avec un autre regardé et regardant; Sarojini est signifiée en tant que avec l'autre et comme l'autre, c'est-à-dire mortelle. Parce qu'elle n'a pas la "carrure" du héros historique dont l'identité est formalisable et connaissable, elle peut représenter le processus dynamique de la subjectivité: le j'ai vécu (4) semble être celui de son être-historique, déterminé dans Tordre de Y epos, ordre de cette chanson qui ne cesse de la chanter, tandis que le j 'ai survécu (dans son corps et sa fatigue) appartient à l'ordre de la physis, rebelle à cet epos qui l'oblige, que Sarojini cherche à abandonner en remaniant les paradigmes de l'Histoire. En effet, à l'annonce de la fin des massacres qui ont suivi la Partition, elle dira ses mots: ...Delhi délivrée! Enfin boire, manger, dormir! Etre pour quelques temps une femme ordinaire! Voilà mon rêve (5:4, 205). Et nous avons un élan du coeur pour elle à ce moment-là. Dans notre passage de l'acte IV, elle essaie justement, dans son adresse à l'homme-Nehru, d'être cette femme ordinaire, ordinaire de par sa singularité. En tant que femme- indienne, elle se soustrait de sa position historique et épique, se place par sa fatigue et son impatience, c'est-à-dire son impertinence, en deçà de son appartenance à la communauté du nous-hommes historiques (2).
Nous posons ainsi, sans pouvoir aller plus loin ici, le personnage de Sarojini comme le seul qui fasse de l'ombre à l'icône. En la constituant ainsi, dans la diachronie et dans le lien d'abord à l'autre comme humain, puis à sa propre multiplicité, Cixous fait miroiter les facettes d'une possibilité d'Histoire de la subjectivité, celle d'un théâtre qui, à partir de l'inscription critique du sujet historiographe comme sexué, procéderait à une relecture du concept d'événement. La question du sujet et/ou de la sexuation, en tant qu'effet de discours et d'adresse, pourrait alors bien se poser, en catimini, comme le point d'orgue de notre fugue.
University of Toronto
NOTES
1. Sur Cixous: Verena Andermatt Conley, Hélène Cixous: Writing the Feminine (Lincoln: University of Nebraska Press, 1984); comporte une bibliographie sommaire des études critiques consacrées à l'auteure.
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
25 2. Hélène Cixous, L'Indiade ou Vinde de leurs rêves et quelques écrits sur le
théâtre (Ed. Théâtre du Soleil, 1987). Jouée à la Cartoucherie de Vincennes, septembre 1987-juin 1988 (référence subséquente: L'Indiade).
3. Sur le Théâtre du Soleil, voir: "Différent: le Théâtre du Soleil", Travail théâtral (Paris: Ed. La Cité, février 1976); "Le théâtre d'intervention depuis 1968", Théâtre recherche 2 (Lausanne: Ed. L'Age d'Homme, 1983); "Théâtre du Soleil", Fruits 2/3 (Paris: Presses Universitaires de Vincennes, juin 1984). Sur L'Indiade: Hélène Cixous et Martine Frank, "Le Théâtre du Soleil: L'Inãade' Double Page 49 (1987); Anne-Marie Picard, "L'Indiade or Ariane's and Hélène's Conjugate Dreams", Modem Drama (Spring 1989).
4. Voir en annexe les trois passages en question. 5. Voir annexe. Les numéros entre parenthèses correspondent au découpage
effectué dans ces tirades. 6. Mountbatten jouera cette ambivalence: joue par un acteur indien en costume
de vice-roi médaillé, il se laissera emporter par une mélancolie digne d'Hamlet (4:1, 147-48): "O India, grosse de tempêtes et de merveilles, / Tu attends le coup en tremblant / Comme une bête qui sait et ne sait pas son sort. / Permets-moi de passer ma dernière nuit d'innocence avec toi. / Demain je serai impitoyable. / C'est par de telles nuits que dans les pièces de Shakespeare s'embrasaient les amours condamnées...".
7. Voir ce qu'elle en dit elle-même: "Entretien avec Hélène Cixous par Pascal Hassoun, Chantai Maillet, Claude Rabant", dans "L'autre sexe", Patio 10 (1988): 61-76, particulièrement 65.
8. La mère devenant le lieu pré-Oedipien de l'union et de l'indifférenciation sexuelle et sociale, lieu de l'amour (la loi du père, celle de la castration n'étant pas encore advenue); lieu du féminin et de la chora kristevienne, il est rêve de l'harmonie perdue, celle des illusions des théoriciens panthéistes médiévaux dénoncées par Lacan ("L'agressivité en psychanalyse", Ecrits [Seuil, 1966]: 119) et reconceptualisées comme possible pensée d'un sujet féminin par la théorie psychanalytique féministe (voir le travail original de Kaja Silverman, The Acoustic Mirror: The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema [Indiana University Press, 1988]; voir aussi mon article mentionné ci-dessus [note 3] quant à l'éthique panthéiste de Mnouchkine et de Cixous).
ANNEXE
I. Azad (1.1:21) 1 . Jinnah arrive tout à l'heure. 2. Ce sera un grand jour pour l'Inde qui verra réunis pour la première fois
sous le ciel de Bombay la magnifique, les leaders du Congrès et le chef de la ligue musulmane.
3 .a. Pour notre grand destin et contre les Anglais, b. faites-en donc un jour plus grand encore,
4. enracinez l'arbre de l'union hindoue-musulmane plus profondément, 5. Jawahar, 6. offrez courtoise réparation à Jinnah.
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
26
IL Iqbal (1.1:32) 1 . Je croyais que j'étais Indien quand je ne savais pas encore,...
Tétais heureux, les enfants chantaient mes chansons Quand je croyais encore que ce pays était ma mère.
2. Où donc est mon pays natal? On me dit que c'est ici. Je crois voir ma mère glisser doucement vers moi. Je cours... Ma mère n'est pas ma mère. Ma maison n'est pas ma maison. J'entre comme un invité dans ma propre maison, J'y suis mal reçu, gourmande, mes livres sont jetés à terre. J'entre, je suis étranger.
3 . Et cependant mon frère le Hindou est fêté. Tout ce qui est amer, pour moi, Pour lui, tout ce qui est doux. Où donc est mon pays natal?...
4. Je circule dans l'immense Delhi. Jadis nos cavaliers soulevaient la poussière de leurs sabots martiaux. Comme nous étions grands, comme nous sommes voûtés.
5. Les larmes aux yeux, le musulman ramasse dans la poussière le Koran piétiné. Au pays indien, pense-t-il, qu'est-ce que le peuple musulman? La trace d'une gloire, le fantôme d'un maître...
6. Je vous ai dit ma désillusion. Elle est désormais ma pente, mon chemin. La division est. Tout est division.
ffl. Sarojini (4.1:152) 1. Panditji, mon bien-aimé, moi, je suis vieille, je suis fatiguée, mon
espoir ne va pas plus loin que cette année. 2. J'ai peur qu'à vouloir à tout prix l'impossible, nous perdions la fragile
chance de l'Indépendance. 3. Après tout, si ce mois-ci nous croyons apercevoir la fin de l'Empire,
c'est parce que Londres, pour le moment est travailliste. Mais si nous tardons et retardons?
4. Ah! Panditji, d'abord l'Indépendance. Voilà pourquoi j'ai vécu et survécu.
5. Demain, grand roi tremblant, n'oublie pas la vieille Sarojini. 6. Moi cette nuit je te bénis. Que Dieu te donne la force de supporter nos
angoisses, nos contradictions et tes propres décisions. Et quoi qu'il m'arrive par toi demain, je l'accepterai de bonne grâce.
7. Chut! Ne répondez pas. Je m'en vais. Bonne nuit, pauvres Indiens tout scintillants de sueur et de larmes. (Sarojini sort)
This content downloaded from 193.49.37.77 on Tue, 18 Aug 2015 23:50:39 UTCAll use subject to JSTOR Terms and Conditions