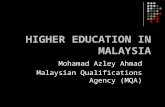Courbe de Beveridge et demande de qualifications
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Courbe de Beveridge et demande de qualifications
Henri Sneessens
Courbe de Beveridge et demande de qualificationsIn: Économie & prévision. Numéro 113-114, 1994-2-3. Études du marché du travail. pp. 127-137.
Citer ce document / Cite this document :
Sneessens Henri. Courbe de Beveridge et demande de qualifications. In: Économie & prévision. Numéro 113-114, 1994-2-3.Études du marché du travail. pp. 127-137.
doi : 10.3406/ecop.1994.5671
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecop_0249-4744_1994_num_113_2_5671
RésuméCourbe de Beveridge et demande de qualifications,par Henri Sneessens.
Cet article analyse les causes possibles de la détérioration de la relation observée entre emploisvacants et chômage, indiquée par la courbe de Beveridge. L'analyse est basée sur un modèle macro-économique distinguant deux niveaux de qualification, dans lequel les entreprises peuvent êtrecontraintes soit par un manque de débouchés, soit par un manque de capacités de production, soitencore par un manque de main-d'œuvre qualifiée. Les résultats des estimations suggèrent un faibleaccroissement des frictions et un accroissement appréciable des problèmes structurels entre 1962 et1989.
ResumenCurva de Beveridge y demanda de cualificaciones,por Henri Sneessens.
En este artículo se analiza las causas posibles de la deterioración de la relación observada entreempleos vacantes y paro, indicada por la curva de Beveridge. El análisis esta basado en un modelomacroeconómico que distingue dos nivelés de cualificación, en el cual las empresas pueden estarobligadas ya sea por falta de mercado o bien por falta de capacidades de producciôn, o bien inclusopor falta de mano de obra cualificada. Los resultados de las estimaciones sugieren un incrementoreducido de las fricciones y un incremento apreciable de los problemas estructurales entre 1962 y1989.
ZusammenfassungBeveridge-Kurve und Qualifikationsnachfrage,von Henri Sneessens.
In diesem Artikel werden die möglichen Ursachen für die Verschlechterung der zwischen freienArbeitsplätzen und Arbeitslosigkeit beobachteten Beziehung analysiert, die durch die Beveridge-Kurvedargestellt wird. Die Studie basiert auf einem gesamtwirtschaftlichen Modell, bei dem zwischen zweiQualifikationsniveaus unterschieden wird und in dem sich die Unternehmen entweder wegen einesMangels an Absatzmärkten, eines Mangels an Produktionskapazitäten oder aber auch eines Mangelsan qualifizierten Arbeitskräften zwangsweise befinden können. Die Schätzungsergebnisse lassen eingeringes Ansteigen der Friktionen und eine erhebliche Zunahme der strukturellen Problème zwischen1962 und 1989 vermuten.
AbstractThe Beveridge Curve and the Demand for Qualifications,by Henri Sneessens.
This article analyzes the possible reasons for the observed deterioration in the relationship between jobvacancies and unemployment, as shown by the Beveridge Curve. The analysis is based on amacroeconomic model, which distinguishes two levels of qualifications and in which firms may berestricted either by a lack of markets, a lack of production capacity or a lack of skilled manpower. Theresults of the estimates suggest low frictional growth and an appreciable rise in structural problemsbetween 1962 and 1989.
Courbe
de Beveridge
et demande
de qualifications
Henri Sneessens(*)
Les statistiques officielles du nombre de chômeurs et du nombre d'emplois vacants suggèrent d'importants changements dans la relation unissant ces deux variables, connue sous le nom de courbe de Beveridge. Le graphique 1 reproduit l'évolution observée en France. La plupart des autres pays sont caractérisés par une évolution semblable (voir OCDE, 1988, p. 37 et suivantes). Comment interpréter ces observations ? Ce glissement de la courbe de Beveridge reflète-t-il un simple biais statistique dû à la façon dont ont été collectées ces données, en particulier celles des emplois vacants ? Ou bien traduit-il un phénomène réel plus profond, lié à des chocs structurels et au fonctionnement même du marché du travail ? Dans quelle mesure la persistance du chômage en Europe est-elle imputable à cette évolution ? Il n'y a pas à ce jour de réponse unanime à ces questions.
Graphique 1 : relation observée en France de 1962 à 1989 entre offres et demandes d'emploi insatisfaites
(en pourcentage de la population active totale)
Offres insatisfaites 1,2%
2,0% 4,0% 6,0% 8,i Demandes insatisfaites
10,0% 12,0%
Source : Le mouvement économique en France 1949-1979 et Annuaire statistique de l'Insee.
(*) 1res, département des sciences économiques de l'université catholique de Louvain, et faculté libre de sciences économiques de l'université catholique de Lille.
Je remercie B. Maillard pour son aide précieuse dans la collecte et la préparation des données. Cette recherche fait partie d'un projet SPES sur la formation des prix et salaires et sur la persistance du chômage (contrat SPES-0024 DK) ; elle a bénéficié également d'un soutien financier du Commissariat général du Plan, Paris, et du programme "Pôle d'attraction interuniversitaire" du gouvernement belge.
Économie et Prévision n° 112-113 1994/2-3
En dehors des problèmes de mesure statistique, plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour expliquer des déplacements, réels ou apparents, de la courbe de Beveridge. Des chocs purement conjoncturels peuvent affecter différemment l'évolution du nombre de chômeurs et d'emplois vacants et provoquer ainsi des déplacements apparents de la courbe de Beveridge. La méthodologie développée par Blanchard et Diamond (voir par exemple Blanchard et Diamond, 1989) a inspiré nombre de travaux empiriques destinés à évaluer l'importance relative de chocs conjoncturels et de chocs de réallocation. Pour la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, Jacques et Langot (1992) concluent que les déplacements de la courbe de Beveridge ne peuvent être totalement expliqués ni par une dynamique conjoncturelle ni par des chocs de réallocation aléatoires, mais résulteraient pour l'essentiel d'une tendance déterministe dont la signification économique reste à préciser. Un tel déplacement pourrait être la conséquence soit d'une réduction continue de la mobilité (réduction de l'intensité ou de l'efficacité des recherches d'emploi et de travailleurs, due au mode de fonctionnement du
127
Graphique 2 : pourcentage d'entreprises confrontées à des difficultés de recrutement en cadres, ouvriers
qualifiés et ouvriers spécialisés, ensemble de l'industrie, France, 1976-1992
— — Cadres Ouvriers qualifiés Ouvriers spécialisés • - - Difficultés totales
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
Graphique 3 : pourcentage d'entreprises dont la production est limitée par un manque d'équipement ou un manque de personnel
(ensemble de l'industrie, France, 1976-11 à 1992-IV)
Goulot d'équipement Goulot de personnel
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
Graphique 4 : taux de chômage en France de 1962 à 1989
1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
système d'assurance- chômage, du marché immobilier, à l'effet de découragement engendré par la persistance du chômage elle-même...), soit véritablement d'une montée régulière et systématique des problèmes "structurels", ou les deux à la fois, d'où résulteraient des disparités et des cloisonnements accrus entre divers segments du marché du travail (régions, qualifications, âge...).
Jackman, Layard et Savouri (1990) proposent d'utiliser comme indice d'inadéquation structurelle (mismatch) la variance des taux de chômage relatifs des diverses régions ou groupes de travailleurs. Cet indice est justifié théoriquement à partir d'un modèle de type NAIRU mais avec un marché du travail segmenté et des salaires négociés sur chaque segment séparément. Quels que soient la segmentation (régions, professions...) ou le pays considéré, la variance des taux de chômage relatifs apparaît systématiquement à la baisse après 1973, d'où il faudrait conclure que les problèmes structurels auraient en fait perdu de leur importance. Ce résultat contre-intuitif et systématique laisse planer quelques doutes sur la signification véritable de cet indice. Entorf (1993) fait observer que lorsque les taux de chômage augmentent tendanciellement, cette mesure converge nécessairement vers zéro ; elle ne pourrait donc être valide que lorsque les taux de chômage sont stationnaires.
Les modèles avec contraintes quantitatives permettent une modélisation alternative intéressante des phénomènes liés à la courbe de Beveridge. De ce point de vue, l'intérêt des modèles avec contraintes quantitatives est double. D'une part ils conduisent naturellement à une fonction d'emploi agrégé que l'on peut réinterpréter aisément en termes de courbe de Beveridge, du moins lorsque la fonction d'emploi est obtenue par l'agrégation explicite de micromarchés différents (Lambert, 1988) de façon à permettre la coexistence d'entreprises avec contraintes de main-d'œuvre (emplois vacants) et d'entreprises avec contraintes de débouchés ou de capacité (chômage). D'autre part, ils peuvent être élargis et réinterprétés de façon à intégrer les développements récents sur la formation des prix et salaires et l'analyse des conséquences macro-économiques de la concurrence imparfaite sur le marché des biens et du travail (Sneessens, 1987). On aboutit ainsi à des modèles dans lesquels on peut étudier à la fois la détermination du taux de chômage d'équilibre et les déplacements de la courbe de Beveridge, et l'interaction entre les deux (Sneessens, 1992). Les estimations économétriques réalisées à partir de ces modèles (voir Drèze et alii, 1990) suggèrent des déplacements statistiquement significatifs, encore que modérés, de la courbe de Beveridge dans la plupart des pays industrialisés, même après prise en compte de la dynamique conjoncturelle de court terme (Franz et Smolny, 1993). Ces déplacements étant cependant la plupart du temps mesurés par une simple tendance linéaire déterministe ou par solde, la question des facteurs responsables de ces inadéquations structurelles croissantes reste
128
ouverte. Bean et Gavosto (1990) mettent l'accent sur la désemployabilité des chômeurs de longue durée ; Bentolila et Dolado (1990) montrent que l'indice d'inadéquation structurelle obtenu par solde pour l'Espagne est corrélé avec des variables structurelles telles que les proportions de chômeurs de longue durée, dispersion des taux de chômage régionaux, flux migratoires, indice de turbulence...
Les modèles à contraintes quantitatives utilisés jusqu'à présent restent très agrégés, trop probablement pour appréhender correctement les effets d'éventuels changements structurels sur le marché du travail. L'objectif de cet article est de généraliser les modèles existants de façon à permettre une distinction entre travail qualifié et travail non qualifié. Cette généralisation permettra d'évaluer dans quelle mesure les glissements de la courbe de Beveridge pourraient être le résultat d'une inadéquation croissante entre qualifications demandées et qualifications offertes. Le problème des qualifications est probablement l'un des plus fondamentaux. Les disparités entre régions, secteurs et sexes reflètent certainement en partie des problèmes de qualification. La mobilité entre diverses catégories de qualifications est probablement bien plus limitée, et en tout cas moins contrôlable que la mobilité entre régions ou entre secteurs. La distinction entre qualifies et non-qualifiés sous-tend également deux des questions les plus souvent évoquées, celle d'une part d'une éventuelle pénurie de main-d'œuvre qualifiée, qui pourrait freiner la croissance et générer des pressions inflationnistes bien avant le retour au plein-emploi, celle d'autre part des possibles effets pervers de la législation sur le salaire minimum, qui entretiendrait un déséquilibre entre qualifications offertes et qualifications demandées. Nombre de travaux aux États-Unis (voir par exemple Bound et Johnson, 1992, Levy et Murnane, 1992) suggèrent en effet qu'un choc technologique non neutre pourrait avoir modifié profondément la demande de main-d'œuvre non qualifiée et contribué à la diminution brutale du salaire relatif de cette catégorie de travailleurs. En Europe, compte tenu de la rigidité des salaires relatifs, un tel choc technologique aurait pour conséquence une inadéquation structurelle durable.
Dans cette perspective, il est utile de comparer le glissement observé de la courbe de Beveridge (cf. graphique 1) aux résultats d'enquêtes effectuées par l'Insee auprès des entreprises. Les graphiques 2 et 3 montrent que la reprise de la fin des années 1980 a été accompagnée d'une augmentation sensible de la proportion d'entreprises ayant des difficultés de recrutement ou dont la production était freinée par un manque de main-d'œuvre qualifiée(1), alors même que le taux de chômage global restait très élevé. On remarquera que la proportion d'entreprises confrontées à des difficultés de recrutement de cadres fluctue autour d'une tendance croissante alors qu'on n'observe aucune dérive tendancielle pour les ouvriers qualifiés ou spécialisés.
Reste à savoir comment définir concrètement le concept de qualifié et de non-qualifié. L'éducation n'est qu'un critère parmi d'autres, comme par exemple le savoir-faire acquis par l'expérience professionnelle ou les qualités de caractère. L'approche par catégories socioprofessionnelles semble la seule possible du point de vue empirique. Les enquêtes sur l'emploi effectuées par l'Insee distinguent sept catégories d'actifs, fondées sur la nature du dernier emploi occupé. L'objectif est de regrouper ces catégories en deux groupes aussi homogènes que possible et correspondant chacun à un niveau de qualification différent. L'analyse des caractéristiques de ces catégories socioprofessionnelles (voir Maillard et Sneessens, 1994) suggère le regroupement suivant. - Qualifiés : cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires (y inclus techniciens et contremaîtres), soit les catégories 3 et 4 ; -Non-qualifiés{2) : agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et chefs d'entreprise, employés, ouvriers et chômeurs n'ayant jamais travaillé - dont la majorité recherchent un emploi non qualifié - soit les catégories 1, 2, 5, 6 et 81.
Le graphique 4 décrit l'évolution des taux de chômage correspondants^. Les taux de chômage sont croissants pour les deux groupes ; bien que le rapport des taux de chômage demeure assez stable (autour de 6), l'écart entre les deux taux augmente fortement, passant de 1,9 point en 1962 à 11,6 points en 1989.
Le modèle théorique utilisé pour permettre une interprétation de ces données est développé dans la première partie. La deuxième partie est consacrée aux résultats empiriques. Un résumé des conclusions est enfin présenté.
Le modèle théorique
La modélisation proposée est une extension des modèles macro-économiques avec contraintes quantitatives et agrégation explicite sur des micromarchés. On suppose un grand nombre n d'entreprises ; à chaque entreprise correspond un micromarché. Il y a trois facteurs de production : capital, main-d'œuvre qualifiée et main-d'œuvre non qualifiée. La technologie de production est prédéterminée et reflète les coûts relatifs (anticipés) des intrants au moment de son installation ; elle est supposée identique dans toutes les entreprises. Nous considérerons d'abord la détermination de l'emploi au niveau de l'entreprise individuelle. Nous déduirons ensuite les conséquences de cette analyse pour l'emploi qualifié agrégé, et la relation entre emplois vacants et chômage sur ce marché. Nous examinerons enfin la détermination de l'emploi agrégé total et la relation globale (qualifiés + non-qualifiés) entre emplois vacants et chômage.
129
Soulignons d'emblée que notre objectif reste, à ce stade, relativement limité : introduire la distinction entre main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée dans un modèle avec contraintes quantitatives, l'utiliser pour construire une courbe de Beveridge et l'indicateur d'inadéquation structurelle qui lui est associé, utiliser les statistiques disponibles pour effectuer un premier test de l'aptitude de cette modélisation à décrire les faits observés. L'analyse des choix technologiques et des décisions de prix et de salaires qui pourraient avoir causé les évolutions observées est clairement hors du champ couvert par cet article et laissée à plus tard. Ajoutons cependant que le contexte le plus naturel dans lequel interpréter l'analyse développée ci-après serait un modèle avec concurrence imparfaite sur les marchés des biens et du travail, et taux de chômage d'équilibre de type NAIRU (voir par exemple Sneessens, 1987).
L'entreprise individuelle
La technologie de production est de type Léontief, c'est-à-dire que les facteurs de production sont strictement complémentaires à court terme (ce qui n'empêche pas les facteurs de production d'être substituables à plus long terme). Elle est entièrement caractérisée par les coefficients techniques suivants :
Lq (1) a n = —rr : le nombre d'unités de main-d'œuvre h y qualifiée requis pour produire une unité de biens ;
Ln (2) an =~rr : *e nombre d'unités de main-d'œuvre non qualifiée requis pour produire une unité de biens ;
(3) c = -y : le nombre d'unités de capital requis pour produire une unité de biens. Il en découle le coefficient d'emploi moyen :
(4)
qui est le nombre d'unités de main-d'œuvre (qualifiée + non qualifiée) requis pour produire une unité de biens.
(4) : Les contraintes d'offre pour l'entreprise i sont
- l'offre de main-d'œuvre qualifiée sur le micromarché i est limitée à LFqi , de sorte que l'on aura toujours
- le stock de capital disponible Kt est prédéterminé et fixe la capacité de production de l'entreprise ;
(7)
capacité de production à laquelle correspond un niveau d'emploi qualifié maximal LCqi ; il en découle pour l'emploi qualifié la contrainte supplémentaire :
où
LC = a YC = -1 K
On suppose donc que la demande en main-d'œuvre non qualifiée n'est jamais rationnée, alors que la demande en main-d'œuvre qualifiée peut l'être. Cette hypothèse, nécessaire pour limiter la complexité du modèle empirique, semble assez réaliste. Comme il est indiqué ci-dessus, le nombre de non-qualifiés sans emploi est aujourd'hui très élevé, bien plus élevé que celui de qualifiés dans la même situation. Certes, il fut une époque (il y a vingt ans et plus) où le nombre de non-qualifiés sans emploi était faible ; le manque de main-d'œuvre non qualifiée était alors rapidement compensé par l'immigration. On suppose également que les tensions sur le marché de la main-d'œuvre qualifiée n'attirent pas sur ce marché des travailleurs initialement positionnés sur le marché de la main-d'œuvre non qualifiée, une hypothèse qui paraît assez réaliste vu la faible mobilité à court terme entre ces deux marchés (flux annuel d'environ 2 %).
Compte tenu d'une contrainte de débouchés YD . , l'emploi qualifié dans l'entreprise / sera déterminé par le minimum de l'emploi "keynésien" ( LDq = a YD. ), de l'emploi de pleine capacité et de l'offre qualifiée :
(9) = Min{LDqi,LCqi,LFqi).
Puisque les facteurs de production sont strictement complémentaires et l'offre de main-d'œuvre non qualifiée pléthorique, l'emploi non qualifié est proportionnel à l'emploi qualifié :
où Lqi représente l'emploi qualifié dans l'entreprise i ;
- l'offre de main-d'œuvre non qualifiée n'est jamais contraignante, et donc perçue comme illimitée ;
(6)
(10) Lni = an¥l = -fLqi,
de même que l'emploi total :
(11) L. = La + Ln = fl+ — V q
130
L'emploi qualifié L'emploi qualifié agrégé est simplement la somme des emplois sur chacun des micromarchés :
(12)
< Min V l l l )
Représentons la distribution des LDq , LCqi et LF sur les divers micromarchés de la manière suivante :
(13)
(14)
LDt
LC,
(15) LFa = LF, W
où les variables non indicées par i représentent des quantités agrégées et les ui,vi,wi correspondent aux écarts à la moyenne. Sous l'hypothèse que ces écarts sont distribués selon une loi log-normale (avec quelques restrictions ; voir Sneessens, 1983, et Lambert, 1988), l'emploi qualifié total, c'est-à-dire la somme des minima par micromarché, peut s'écrire comme une fonction de type CES des agrégats LDq>LCq ctLFq
(16)
CES d'emploi contient implicitement une relation entre emplois vacants et chômage, que suggéraient déjà les commentaires précédents. On obtient cette relation de la façon suivante. Si l'offre de main-d'œuvre qualifiée était infiniment abondante (LFq -> «>), aucune entreprise n'en manquerait. Il n'y aurait plus d'emplois qualifiés vacants, et l'emploi qualifié serait égal à une valeur maximale LE , correspondant à la demande effective de travail qualifié. Cette demande effective est calculée en prenant la limite de la relation ŒS-emploi pour LF tendant vers l'infini :
(17) LEa = lim LD-qP + LC-p+LF'qp
LC P .
Par substitution de LE dans la CES de départ, on peut réécrire l'emploi qualifié observé Lq comme fonction de la demande effective LE q et de l'offre LF q
(18)
P .
En divisant à gauche et à droite par le niveau d'emploi et en réarrangeant les termes, on obtient la relation :
(19) 1 = LE, LF.
<Min(LDq,LCq,LFq).
La valeur du paramètre p ( 0 < p < °° ), est liée aux variances et aux covariances des écarts unvnetw. ; elle est d'autant plus élevée que les variances sont faibles et les corrélations élevées. L'inverse de p est donc à interpréter comme une mesure des déséquilibres entre offres et demandes locales de main-d'œuvre qualifiée imputables à des frictions, c'est-à-dire à une mauvaise répartition des L ty, L Ç et L F (mismatch) plutôt qu'à un déséquilibre macro-économique. Plus la valeur du paramètre p est faible, plus l'emploi qualifié sera faible, à valeurs données des agrégats LDq, LCq et LF q. L'emploi qualifié n'est égal au minimum des agrégats qu'en l'absence de frictions, lorsque p tend vers l'infini.
On peut à partir de cette fonction d'emploi calculer les proportions d'entreprises contraintes par les débouchés, la capacité de production ou l'offre de main-d'œuvre qualifiée (voir par exemple Lambert, 1988 , ou Sneessens, 1992). Cette fonction
= (l-VRa)
où VRq et URq sont respectivement le taux d'emplois vacants et le taux de chômage pour les qualifiés. Cette relation entre taux d'emplois vacants et taux de chômage est la traditionnelle courbe U V , limitée ici au marché de la main-d'œuvre qualifiée. Si l' on mesure l'importance des frictions (mismatch) sur ce marché par la valeur que prendrait le taux de chômage si ce dernier et le taux d'emplois vacants étaient égaux, on voit que cette valeur est fonction négative du paramètre p :
(20) taux de chômage frictionnel chez les qualifiés
= 1-2 P.
Un accroissement des frictions, une réduction du paramètre p , se traduit par une déformation de la courbe UV, équivalente à un déplacement vers la droite.
131
L'emploi total et la courbe de Beveridge
Au niveau agrégé, l'on retrouve entre emploi qualifié et emploi non qualifié, entre emploi qualifié et emploi total, les mêmes relations que celles obtenues pour l'entreprise individuelle. C'est à nouveau la conséquence des hypothèses de stricte complémentarité des facteurs de production (à un moment donné du temps bien sûr) et d'absence de contrainte en main-d'uvre non qualifiée. On écrira donc :
(2D Ln = ^Lq,
(22) L = Lq + Ln = L - L 4 ~ a *' uq
Si l'on remplace dans cette expression Lq par la fonction CES obtenue auparavant, compte tenu des définitions de LD q ( = a q YD ) et LCq ( = a q YC ) indiquées plus haut, l'on obtient facilement :
(23) L = {LD p + LC p + [\lLF]~p\
cette courbe dépend des deux paramètres p et jx . Une réduction de la valeur de l'un de ces paramètres correspond à un déplacement de la courbe de Beveridge vers la droite. L'inverse du premier ( 1 / p ) mesure l'importance des frictions sur le marché des qualifiés, l'inverse du second ( 1 / \i ) mesure l'importance du problème structurel, l'inadéquation entre structure de la demande et structure de l'offre en termes de qualifications. Lorsque le taux de chômage est égal au taux d'emplois vacants, sa valeur, que nous appellerons taux de chômage structurel, devient :
(26) taux de chômage structurel
= 1- 1 + H
p\
qui est une fonction croissante de l'inverse de jx et de p (pour jx > 1 ).
où : LD = ^- LDq est l'emploi total (qualifié + non Résultats empiriques
qualifié) keynésien, défini par LD = a YD ; a LC = LC. . est l'emploi total (qualifié + non
qualifié) de pleine capacité défini par LC = a YC .
Le paramètre jx est, quant à lui, défini par
LF. a W » =
~q LF q LFq/LF 2 > 0 Lq/L
Le numérateur est l'offre qualifiée en pourcentage de l'offre totale, le dénominateur est l'emploi qualifié en pourcentage de l'emploi total. Le paramètre |X mesure donc le décalage éventuel entre structure de l'offre et structure de la demande de travail.
L'équation CES d'emploi agrégé (23) est très proche de celle obtenue dans les modèles sans distinction de qualifications ; elle n'en diffère que par le paramètre jx , lorsque celui-ci est différent de 1. Pour mieux comprendre la signification de ce paramètre, examinons la relation entre chômage et emplois vacants implicite dans l'équation (23). Par la même procédure qu'en (17) et (19), on obtient la courbe UV :
(25) 1 = ( 1 - VR ) + - (l-UR) V J
où VR et UR représentent cette fois les taux d'emplois vacants et de chômage agrégés. Il s'agit donc bien de la courbe de Beveridge. La position de
Spécification du modèle empirique
Le modèle empirique comprend deux équations, emploi (L) et importations (M), spécifiées comme suit:
_ _ J_ L = {LD Pf+ LC P'+[|xLF] P'} P, iu1(
M = MD. YD aL x u2,
où u j et u2 sont deux termes d'erreur.
On a: = p0 + Pi' ; Pt
LD = exp { cp [ y o + ln ( a YD ) 1 + ( 1 - 9 ) m L - 1 } ; YD = FD - MD ;
MD = m0tFDmi ;
niQt = exp mnn + mm t + mnr, t 0 0 "r m01
M
02
+ A(R)\ m03ln + m04ln
LC = exp^ cp Yo + ln c + ( l-cp)lnL_1
132
FD représente la demande finale totale. Les importations observées M reflètent deux évolutions. L'une, qui peut être qualifiée de structurelle, est représentée par MD et inclut les effets de l'ouverture au commerce extérieur (mesurée par une tendance quadratique) et des prix relatifs (prix des importations totales PM et des importations d'énergie PE rapportés au prix de la valeur ajoutée PY). L'autre, purement conjoncturelle, représente l'effet de tensions (rapport entre demande pour la production domestique YD et le niveau de production a .L). Nous avons à dessein repris les mêmes spécifications que Lambert et alii (1984) ; la seule différence, outre la présence du paramètre ji et la distinction entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, est l'ajout du prix réel de l'énergie dans l'équation d'importations. Cette formulation appelle les commentaires suivants.
- Les frictions sur le marché de la main-d'œuvre qualifiée (mesurées par le paramètre 1 / p ) sont représentées par une fonction linéaire du temps afin de laisser ouverte la possibilité d'un accroissement tendanciel du taux de chômage frictionnel sur ce marché.
- La productivité du travail et du capital, et donc les coefficients techniques a et c , sont à moyen-long terme fonction du prix relatif travail/capital, du coût relatif qualifié/non-qualifié, et probablement aussi du coût réel de l'énergie. Notre objectif n'est pas ici d'étudier les facteurs responsables des changements technologiques observés, en particulier la substitution entre qualifiés et non-qualifiés. Nous prendrons les coefficients techniques comme donnés. Les productivités apparentes sont corrigées des effets purement conjoncturels à l'aide des mesures de degré d'utilisation des facteurs publiées par l'Insee. On tient compte d'éventuels effets d'échelle liés à cette correction par l'introduction des paramètres y0 et y0'. La demande "keynésienne" est obtenue en multipliant la demande de biens par l'inverse de la productivité du travail (a), et l'emploi de pleine capacité en multipliant le stock de capital par le rapport travail-capital (a/c ).
- L'effet de coûts d'ajustements sur la demande de travail est pris en compte par l'utilisation d'un modèle d'ajustement partiel (0 < (p < 1 )(5).
- La formulation retenue suppose que la demande finale n'est jamais rationnée, le déficit de production domestique étant toujours compensé par les importations et le degré d'utilisation des facteurs, y compris la main-d'œuvre. La demande de biens domestiques n'est pas observée, ce qui nous oblige à estimer conjointement fonction d'emploi et fonction d'importation.
- L'introduction du prix réel de l'énergie dans la fonction d'importations permet un effet différent pour les changements de prix relatifs dus au prix de
l'énergie. L'effet d'un changement de prix relatifs est étalé dans le temps, avec une dynamique :
A(R) = S0
et Ôq + S^ = 1 ,
où R est l'opérateur de retard.
- LF est la population active observée (emploi + chômage), lissée par régression sur la population en âge de travailler afin d'éliminer les fluctuations conjoncturelles (endogènes) des taux de participation et éviter les biais de simultanéité.
Population active totale et population active corrigée
Le paramètre structurel jli est évalué à partir des chiffres observés d'emploi et de population active (équation (24)). La proportion de qualifiés augmente fortement au fil du temps, mais après 1973, plus vite pour l'emploi que pour la population active. Il en résulte (voir graphique 5) que la valeur du paramètre d'inadéquation structurelle 1/ji , d'abord relativement stable jusqu'en 1973, augmente ensuite très fortement jusqu'en 1983-1984, puis se stabilise à nouveau. Le décalage entre structure de l'offre et structure de l'emploi n'est que de 0,5-1 % en début de période, monte à 7 % en fin de période(6). Afin d'éliminer l'effet sur \i des variations conjoncturelles des taux de participation et de rétention de la main-d'œuvre, de même que les biais de simultanéité qui peuvent en découler, nous utiliserons comme valeur de 1/u, celle obtenue par lissage de la série initiale (tendance linéaire par morceaux, en traits discontinus sur le graphique). Les séries de population active totale (et lissée, LF ) et population active corrigée (l/|iLF) sont reproduites sur le graphique 6. Pour donner une meilleure idée de l'importance de cette correction, nous avons également représenté sur le graphique la population active diminuée du nombre de chômeurs de longue durée (supérieure ou égale à 2 ans). On voit que les deux corrections sont fort semblables, ce qui illustre le lien entre inadéquation structurelle et chômage de longue durée.
À titre de comparaison, le graphique 7 reproduit les valeurs obtenues à partir de l'indicateur d'inadéquation structurelle proposé par Jackman, Layard et Savouri (1990), soit : 1 + 0,5 x la variance des taux de chômage relatifs. Comme le précédent, cet indice fait apparaître un net accroissement des problèmes structurels de qualification au cours des vingt dernières années. Les deux indices culminent en fin de période à des valeurs semblables (environ 7 %). On remarque deux différences cependant. Avec l'indice de Jackman, Layard et Savouri, la rupture apparaît plus tardivement (1978 au lieu de 1974), et l'intensité des problèmes d'inadéquation structurelle est déjà relativement forte, bien que stable durant la première sous-période (3 % contre 1 %f\
133
Graphique 5 : indice d'inadéquation structurelle 1/u,, , rapport des proportions de qualifiés dans l'emploi
et dans la population active, 1962-1989
Tableau 1 : paramètres estimés (écarts types asymptotiques entre parenthèses)
1,02-
1,004-+ 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
Graphique 6 : population active totale (lissée) LF, population active corrigée (X LF et population active
hors chômeurs de longue durée, 1962-1989
Population active en millions 25-
Totale (LF)
1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
Graphique 7 : comparaison avec l'indice d'inadéquation structurelle de Jackman, Layard et Savouri (1990), basé sur la variance des taux
de chômage relatifs
1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
Les paramètres estimés
Les paramètres estimés par maximum de vraisemblance sont reproduits dans le tableau 1. Deux estimations sont présentées, l'une libre, l'autre contrainte ; les contraintes, toutes acceptées, font baisser le logarithme de la vraisemblance de 190,95 à 187,56. On notera les particularités suivantes.
Yo
Yo
<P
Po
Pi
SEE DW
Emploi Estimation
libre -0,0191 (0,0065) -0,0078 (0,0441) 0,3292 (0,0884) 0,0058 (0,0040) 29.10"5
(20.10"5)
0,0028 1,8286
Estimation contrainte -0,0147 (0,0067) 0,0000 0,3194 (0,0483) 0,0059 (0,0028) 36.10"5
(9. 10~5)
0,0030 1,7825
Importations
mi
m2
«00
m01
m02
™03
m04
«0
°2 SEE DW
Estimation libre
0,9974 (0,0056) 1,4336
(0,1752) -3,1433 (0,0381) 0,0745
(0,0023) -0,0009
(5.10-5) -0,1424 (0,1169) 0,0701
(0,0555) 1,0174
(0,9733) -3,2548 (3,4117) 0,0137 1,6736
Estimation contrainte
1,0000 1,5877
(0,1811) -3,1244 (0,0341) 0,0745 (0,0024) -0,0011
(4.10"5) -0,5776 (0,1129) 0,2273
(0,0437) 0,0000
0,0000 0,0144 1,6203
- L'effet des tensions (m 2 ) sur les importations est très significatif. Il implique une forte hausse conjoncturelle des importations de 1985 à 1989. En 1985, les tensions sont quasi inexistantes ; avec la reprise économique, les tensions réapparaissent progressivement et produisent un accroissement des importations égal à 7 % de leur niveau normal en 1987, 12 % en 1988, 18 % en 1989. L'élasticité des importations à la demande finale (m l ) n'est pas significativement différente de l'unité, et bien inférieure aux valeurs obtenues par moindres carrés en remplaçant la variable de tension par le degré d'utilisation des capacités, ce qui confirme qu'une représentation inadéquate des effets de tension est susceptible de biaiser fortement les paramètres de la fonction d'importation (Maillard et Sneessens, 1993). L'élasticité aux prix relatifs (m 0 3 ) est estimée à - 0,58, et significativement différente de zéro. Elle est fortement réduite pour les variations liées au prix de l'énergie (m 0 4 > 0)(8).
- Le graphique 8 permet de visualiser le rôle relatif des différentes variables dans la croissance des importations en pourcentage de la demande finale. L'année de référence est 1983. L'effet de l'ouverture progressive au commerce mondial (trend et trend au carré) est représenté en pointillés, l'effet combiné de la tendance et des prix relatifs en traits continus fins, l'effet total tendance-prix relatifs-tensions en traits continus gras. On voit que l'effet des prix relatifs est défavorable jusqu'en 1983, l'effet des tensions particulièrement important dans les années 1970 et à la fin des années 1980.
134
Graphique 8 : facteurs explicatifs de l'évolution de la part des importations dans la demande
finale totale (1983:1)
1,2
1,0 ■■
0,8-
0,6 ■ .
Tendance + prix relatifs, + tensions .
Tendance
1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
Graphique 9 : taux d'emplois vacants et taux de chômage estimés sur le marché de la main-d'œuvre
qualifiée, 1962-1989
VRq
1,0%
0,5% -
1974^
1962/
I 1
VR =
Y
UR
\
1963 — i 1 —
"^^1980
1 1
1989
—I 1 ■^^1987 — \-URq-
0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%
- La valeur de p l (le coefficient du trend de 1 / p t ) est positive et significativement différente de zéro (mais deux fois plus faible que celle obtenue par Lambert et alii, 1984, dans la version de ce modèle sans distinction de qualifications). Il en résulte une hausse modérée du taux de chômage frictionnel sur le marché de la main-d'œuvre qualifiée tel qu'il est défini en (20), qui passe de 0,66 % en 1962 à 1,32 % en 1989. Sur la même période, le taux de chômage observé chez les qualifiés passe d' environ 0,7 % à 4,0 %. Le graphique 9 reproduit ces évolutions. Il montre clairement qu'après 1974, l'on a toujours observé un taux de chômage nettement supérieur au taux d'emplois vacants ; cet écart est allé croissant jusqu'en 1985. Les tensions ont été maximales en 1962 et 1974. On peut, à partir de la fonction d'emploi, calculer la proportion d'entreprises contraintes par un manque de main-d'œuvre qualifiée. Cette proportion est égale à 48 % en 1962, 58 % en 1974, 13 % seulement en 1989.
- Ces valeurs de p,, combinées à celles de \it, impliquent une hausse substantielle du chômage structurel (équation (26)), qui passe de 1,05 % en 1962 à 6,01 % en 1989 (au cours de la même période, le taux
de chômage observé est passé de 1,42 à 9,51 %). Cette évolution signifie également d'importants déplacements vers la droite de la courbe de Beveridge agrégée, illustrés par le graphique 10. Ce graphique reproduit les courbes de Beveridge estimées pour les années 1974 et 1988, ainsi que toutes les combinaisons effectives de taux d'emplois vacants et de taux de chômage, année par année de 1962 à 1989. Toutes ces valeurs ont été calculées à partir de l'équation d'emploi agrégé. On retrouve dans l'ensemble les mêmes évolutions que celles qui sont décrites sur le graphique 1 (avec quelques différences pour les années 1960, qui pourraient s'expliquer par l'évolution de la représentativité des statistiques officielles d'emplois vacants).
Graphique 10 : déplacements de la courbe de Beveridge agrégée de 1962 à 1989, tels qu'ils sont
estimés à partir de l'équation d'emploi
\ Courbe 1988 \
0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 8,0% 10,0% 12,0% UR
- La proportion d'entreprises contraintes par les débouchés (calculée à partir des résultats d'estimation du tableau 1) a toujours été dominante (et supérieure à 40 %) sauf en quelques occasions : 1962 et 1971-1975 (de 40 à 60 % des entreprises sont alors contraintes par un manque de main-d'œuvre qualifiée), et 1988-1989 (50 à 60 % des entreprises sont contraintes par la capacité de production). Ces proportions sont reproduites sur le graphique 11. Le graphique 12 reproduit les séries de population active corrigée des effets structurels (jx . LF), emploi de pleine capacité (LC ) et emploi effectif estimé (L ). Graphique 11 : proportions d'entreprises contraintes
par un manque de débouchés, de capacités de production ou de main-d'œuvre, 1962-1989
... main-d'œuvre~ ~~ ■ 0 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
135
Graphique 12 : population active corrigée [l LF , emploi de pleine capacité LC et emploi effectif L ,
1962-1989
20000
19000 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990
- La spécification du modèle utilisé peut être généralisée de façon à englober le modèle sans distinction de qualifications comme cas particulier. Il suffît pour cela de réécrire l'effet de la population active dans l'équation d'emploi sous la forme :
où T|o est un paramètre à estimer. Le modèle sans (respectivement avec) distinction de qualifications est obtenu pour r|0 = 0 (respectivement r|0= 1 ). L'estimation donne r|0 = 1,15 , avec un écart type de 0,58 ; r| 0 est donc signifîcativement différent de zéro, bien que très imprécis. En d'autres termes, la distinction entre qualifiés et non-qualifiés (l'introduction de la variable structurelle \it ) n'est pas rejetée par les données et améliore (légèrement) la qualité du modèle. Il faut souligner que ce résultat est basé sur une estimation économétrique qui n 'utilise pas l'information disponible dans les statistiques officielles d'emplois vacants. L'aptitude du modèle à reproduire les déplacements observés de la courbe de Beveridge n'est pas donc pas prise en compte dans le calcul de la vraisemblance.
Conclusions
L'objectif de ce travail était d'étudier dans quelle mesure la détérioration observée de la relation entre emplois vacants et chômage (le déplacement de la courbe de Beveridge) pouvait résulter d'un réel problème d'ajustement entre offre et demande, soit de nature purement frictionnelle, soit de nature structurelle (inadéquation entre structure de l'offre et structure de la demande de travail en termes de qualifications), plutôt que d'un simple artefact statistique. Pour effectuer cette analyse, nous nous sommes basé sur un modèle macro-économique distinguant deux niveaux de qualification. Nous avons supposé que les entreprises pouvaient être contraintes
soit par un manque de débouchés, soit par un manque de capacités de production, soit encore par un manque de main-d'œuvre qualifiée, mais qu'elles n'étaient jamais contraintes par un manque de main-d'œuvre non qualifiée. Cette formulation permet d'obtenir une équation d'emploi agrégé qui contient implicitement une courbe de Beveridge, dont la position dépend des frictions sur le marché de la main-d'œuvre qualifiée et de l'inadéquation entre structure de l'offre et structure de la demande de travail en termes de qualifications.
Les résultats d'estimation de ce modèle économétrique avec contraintes quantitatives suggèrent un accroissement appréciable des problèmes structurels. Le taux de chômage structurel serait ainsi passé de 1,12 % en 1962 à 6,41 % en 1989. Durant la même période, le taux de chômage observé est passé de 1,42 % à 9,51 %. L'essentiel de ces hausses se fait en 10 ans, de 1974 à 1984. En termes de courbe de Beveridge, ces deux évolutions impliquent à la fois un important déplacement vers la droite de la courbe de Beveridge et un glissement vers le bas le long de cette courbe. Cette dégradation de la relation entre taux de chômage et taux d'emplois vacants résulte en partie de frictions accrues sur le marché de la main-d'œuvre qualifiées, mais surtout d'une inadéquation croissante entre structure de l'offre et structure de la demande de travail en termes de qualifications.
Ce résultat conduit naturellement à s'interroger d'une part sur les facteurs responsables de la hausse du taux de chômage structurel, d'autre part sur le lien entre taux de chômage structurel et taux de chômage observé. La première question concerne en particulier l'effet du progrès technique et des changements de coûts relatifs des facteurs (dont le salaire relatif qualifié vs non-qualifié), sur les coefficients techniques et la structure de la demande et de l'offre de travail. C'est dans ce contexte également que se pose la question de l'efficacité des politiques d'intervention active (formation, TUC.) sur le marché du travail, celle des conséquences de la mobilité des travailleurs entre catégories, en particulier des qualifiés vers les non-qualifiés (ladder effect). La seconde question porte sur les causes de la croissance observée du chômage. Cette croissance est-elle imputable, directement ou indirectement, à la hausse du taux de chômage structurel, c'est-à-dire à l'inadéquation croissante entre structure de l'offre et structure de la demande de travail en termes de qualifications ? À cet égard, il convient de rappeler qu'en France, la proportion d'entreprises contraintes par un manque de main-dœuvre qualifiée lors de la reprise de la fin des années 1980 est restée relativement faible. Les estimations économétriques présentées dans la quatrième partie corroborent les résultats d'enquête de FInsee. La persistance du chômage n'est donc pas imputable à un effet direct de rationnement de la demande de main-d'œuvre qualifiée, ce qui n'exclut bien sûr pas un effet indirect via la boucle prix-salaires et le taux de chômage d'équilibre compatible avec la stabilité (du taux de croissance) des prix (NAIRU). Ces questions restent à étudier.
136
Notes Bibliographie
(1) Le graphique 3 montre également que la contrainte la plus forte était celle des capacités de production. (2) Idéalement, l'on aimerait traiter séparément les catégories 1 et 2 (essentiellement des indépendants) et distinguer parmi les ouvriers les qualifiés des non qualifiés. Nous nous limiterons néanmoins à deux groupes, d'une part afin de préserver la maniabilité du modèle empirique, ensuite parce que la distinction entre ouvriers qualifiés change substantiellement de contenu dans la nouvelle nomenclature utilisée après 1982. (3) Les séries d'emploi et de population active sont calculées en appliquant aux séries macro-économiques habituelles les pourcentages de qualifiés et de non-qualifiés, tels qu'ils sont définis ci-dessus, obtenus à partir des enquêtes sur l'emploi. (4) Pour le moment, nous considérons ces bases comme données. Tout cela n'exclut pas bien sûr de futurs développements de ce modèle de base pour endogénéiser ces contraintes et les rendre manipulables par l'entreprise, via des changements du prix de vente (pour la contrainte débouchés introduite un peu plus loin), des salaires offerts (pour la contrainte en main-d'œuvre qualifiée) ou des investissements (pour la contrainte de capacité). Ces ajouts ne seront pas de nature à modifier cette première formalisation, ils ne feront que la compléter. (5) Une approche rigoureuse nécessiterait de prendre en compte les coûts d'ajustement de l'emploi, de même que celui des techniques de production, et la dimension intertemporelle des décisions. En présence de contraintes quantitatives, une telle modélisation pose des difficultés particulières et reste à développer. Notre intérêt primordial étant l'analyse des évolutions de long terme, la prise en compte des phénomènes de court terme par une dynamique, même arbitraire, de type correction des erreurs, devrait suffire et permettre une interprétation correcte du long terme ; cette approche semble en tout cas préférable, vu les fortes non-linéarités du modèle, à une formulation économétrique purement statique. (6) On pourrait objecter que les évolutions décrites sur les graphiques 5 et 6 résultent uniquement de la réduction du nombre d'agriculteurs, inclus dans les non-qualifiés. Il n'en est rien. Lorsque l'on élimine du calcul les agriculteurs et les commerçants de sorte que le groupe des non-qualifiés ne contienne plus que les employés et les ouvriers, les évolutions demeurent fort semblables et l'inadéquation structurelle est plus marquée encore. Le décalage entre structure de l'offre et de l'emploi passe de 1 % en début de période à 9 % en fin de période. (7) Soulignons que l'indicateur de Jackman, Layard et Savouri n'est pas obtenu de la même façon. Il n'est pas dérivé d'une courbe de Beveridge, mais d'une analyse de type NAIRU avec désagrégation des équations de salaires. Ajoutons que lorsqu'elles sont calculées directement à partir des taux de chômage de chaque PCS y inclus les chômeurs n 'ayant jamais occupé d'emploi (plutôt qu'à partir du regroupement qualifiés/non-qualifiés), les valeurs de cet indicateur changent totalement et suggèrent une baisse des problèmes structurels. (8) La part des produits énergétiques dans les importations totales à prix constants (1980) a fluctué entre 10 et 20 %. Compte tenu de l'imprécision des élasticités estimées, l'on peut conclure qu'une hausse du prix des importations liée à une hausse du prix de l'énergie n'a guère d'effet sur les volumes importés.
Bean C, Gavosto A. (1990). "Outsiders, Capacity Shortages and Unemployment in the United-Kingdom", in Drèze et alii eds, Europe's Unemployment Problem, MIT Press. Bentolila S., Dolado J.J. (1990). "Mismatch and Internal Migration in Spain", in F. Padoa-Schioppa éd., Mismatch and Labour Mobility, Cambridge University Press. Blanchard O.J., Diamond P. (1989). "The Beveridge Curve", Brookings Papers on Economic Activity, n°l, pp. 1-76. Bound J., Johnson, G. (1992). "Changes in the Structure of Wages in the 1980's: An Evaluation of Alternative Explanations", The American Economic Review, vol. 82, n°3, pp. 371-392. Choffel Ph., Kramarz F. (1988). "Évolution des structures professionnelles dans l'industrie depuis 1969", Économie et Statistique, n°213, pp. 5-26. Drèze J.H., Bean Ch., Lambert J.P., Mehta F., Sneessens H.R. (1990). Europe 's Unemployment Problem, MIT Press. Entorf H. (1993). "Do Aggregate Measures of Mismatch Measure Mismatch ? A Time-Series Analysis of Existing Concepts", mimeo, département de la Recherche, Insee, Paris. Franz W., Smolny W. (1993). "The Measurement and Interpretation of Vacancy Data and the Dynamics of the Beveridge Curve: The German Case", paper presented at the international workshop on "Measurement and Analysis of Vacancies: An International Comparison", January 1993, University of Limburg, Maastricht. Jacques J.-F., Langot F. (1992). "La courbe de Beveridge : Une comparaison internationale", Cahiers de Recherche Économie, Mathématiques et Applications, n°92.08, université de Paris-I - Panthéon-Sorbonne, Paris. Jackman R., Layard R., Savouri S. (1990). "Labour-Market Mismatch: A Framework or Thought", in F. Padoa-Schioppa éd., Mismatch and Labour Mobility, Cambridge University Press. Lambert J.-P. (1988). Disequilibrium Macroeconomic Models, Cambridge University Press, Cambridge. Lambert J.-P., Lubrano M., Sneessens H.R. (1984). "Emploi et chômage en France de 1955 à 1982 : un modèle macro-économique annuel avec rationnements", Annales de l' Insee, n°55/56, pp. 39-76. Levy Fr., Murnane RJ. (1992). "U.S. Earnings Levels and Earnings Inequality: A Review of Recent Trends and Proposed Explanations", The Journal of Economic Literature, vol. 30, pp. 1333-1381. Maillard B., Sneessens H.R. (1993). "On the Modelling of Quantity Constraints: An Empirical Point of View", Annales d'Économie et de Statistique, n°32, pp. 43-64. Maillard B., Sneessens H.R. (1994). "Caractéristiques de l'emploi et du chômage par PCS : France, 1962-1989", Économie et Prévision, ce numéro. OCDE (1988). Perspectives économiques de l'OCDE, décembre. Sneessens H.R. (1983). "Aggregation in Quantity Rationing Models", Unpublished Manuscript, département des sciences économiques, université catholique de Louvain. Sneessens H.R. (1987). "Investment and the Inflation-Unemployment Trade-off in a Quantity Rationing Model with Monopolistic Competition", European Economic Review, vol. 31, pp. 781-808. Sneessens H.R. (1992). "Contraintes de débouchés, capacités de production et chômage dans un modèle macro-économique avec concurrence imparfaite", L'Actualité économique, vol. 68, pp. 140-174.
137