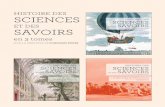Connaissance semiotique et Mathematisation – semiogenese et explicitation
Communiquer oralement : compétence transversale et savoirs sous-jacents. Ce que disent et ne...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Communiquer oralement : compétence transversale et savoirs sous-jacents. Ce que disent et ne...
1
Communiquer oralement : compétence transversale et savoirs sous-jacentsCe que disent et ne disent pas les programmes à propos de l’oral dialogique
Monique Lebrun, UQAMséminaires de l’ORE (Observatoire des réformes en éducation), 29 février 2008
2
Introduction Les programmes d’enseignement québécois de la dernière cuvée font état d’une compétence transversale de l’ordre de la communication qui donne une place aux divers « langages » (oral, écrit, musical, médiatique, etc) dont, au premier chef, la langue d’enseignement.
Nous nous intéressons à cette prise de position officielle, et plus particulièrement à la communication orale et à sa traduction immédiate dans les objectifs et contenus des programmes de français langue première, de ceux touchant l’univers social (histoire, géographie, éducation à la citoyenneté), et enfin, de ceux d’éducation morale et religieuse.
3
Introduction (suite) Nous nous proposons d’analyser ces programmes afin de débusquer ce qu’ils disent et ce qu’ils taisent sur les habiletés en communication orale qu’ils peuvent ou devraient susciter.
Nous focaliserons notre attention sur l’oral dialogique présent dans des pratiques telles que le débat argumenté, en raison du parti-pris ministériel pour une épistémologie de construction des savoirs.
Et ceci, dans l’optique de favoriser la discussion sur ces « compétences transversales » constituant une nouveauté des programmes d’enseignement de notre millénaire.
4
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles 1.1-position sur l’épistémologie des savoirs
Le MÉLSQ a choisi le constructivisme comme paradigme épistémologique pour ses divers programmes d’enseignement.
« Le constructivisme est une posture épistémologique qui postule que la connaissance se développe dans et par l’action en situation ... Connaître est ... un processus, une connaissance en action qui s’ajuste perpétuellement aux objets sur lesquels elle porte » (Masciotra, 2006)
5
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles 1.1-position sur l’épistémologie des savoirs
(suite)
Par plusieurs de leurs aspects, les programmes officiels peuvent même être dits socioconstructivistes, puisqu’ils insistent sur l’importance du contexte social, et surtout, sur les interactions sociales.
« Dans la perspective socioconstructiviste, une personne construit des connaissances dans des situations et des contextes sociaux qui influent sur ses constructions personnelles. Ces dernières participent de la nature sociale des situations et des contextes. (Masciotra, 2006)
6
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles 1.1-position sur l’épistémologie des savoirs (fin)
Par ailleurs, comme le fait remarquer Jonnaert(2001)« L’articulation d’une logique de compétences à une visée constructiviste n’est pas évidente », ce qui rend un peu difficile l’analyse des programmes en cause.
7
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles 1.2-position sur le français comme compétence
transversale
Les programmes québécois actuels du primaire et du secondaire sont basés sur des compétences tant générales que spécifiques. Nous ne discuterons pas ici de la problématique entourant le concept de compétence comme l’entend le MELSQ
8
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles 1.2-position sur le français comme compétence transversale (suite)
Les compétences « transversales » à toutes les disciplines qu’identifient les programmes sont au nombre de neuf. L’oral auquel nous nous intéressons nous semble illustrer certaines de ces compétences transversales :
a)deux compétences d’ordre intellectuel : exploiter l’information; exercer son jugement critique;
b)une compétence d’ordre personnel et social : coopérer;
c)une compétence de l‘ordre de la communication : communiquer de façon appropriée.
9
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles
1.2-position sur le français comme compétence transversale (suite) La position ministérielle actuelle est de faire de la langue un outil d’apprentissage dans toutes les disciplines, et c’est en ceci qu’on peut dire que le français est « transversal » dans les programmes.
« C’est par l’utilisation de la langue dans des contextes variés
... que l’élève est amené à communiquer de façon appropriée avec plus de clarté, de confiance et d’efficacité. La langue d’enseignement constitue un véhicule privilégié de médiation des apprentissages dans l’ensemble des disciplines.
10
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles
1.2-position sur le français comme compétence transversale (suite) Ouvrant ainsi la porte au savoir et à sa construction, la pratique langagière fait appel aux compétences transversales de tous les ordres. Elle s’avère particulièrement indissociable de la mise en oeuvre de la pensée créatrice, de l’exercice du jugement critique et, à l’évidence, de la communication. » (PFÉQ,2001,p. 59)
L’ oral participe à la construction des univers discursifs des diverses disciplines à partir de la parole de l’enseignant et des échanges verbaux entre élèves. C’est l’ « l’oral pour apprendre », où une notion s’élabore par tâtonnements successifs au fil des échanges
11
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE1-Les prises de position ministérielles
1.2-position sur le français comme compétence transversale (suite)
Utiliser l’oral pour apprendre suppose que l’enseignant devienne un spécialiste des
conduites discursives (Grandaty; Nonnon, 2001) , qu’il surveille l’engagement des élèves dans
une situation d’interlocution, qu’il gère la construction des rapports entre
interlocuteurs, la construction et la transformation des objets
du discours tout au long de l’interaction (ex. : formulation de définitions, de comparaisons, explications, formulation de problèmes ou d’hypothèses).
12
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique
Nous nous intéresserons ici à l’oral de l’élève et accessoirement à celui de l’enseignant.
Il s’agit d’un oral -où s’articulent le langagier , le cognitif et le social, selon une épistémologie qui emprunte à Vygotsky et à Bakhtine,
-où l’interaction langagière est en partie constitutive de l’apprentissage : ce que l’élève apprend dans une situation donnée est le résultat de la co-construction de savoirs par l’interlocution.
13
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique
Ce qui nous intéresse ici, c’est la langue comme outil
Donc, moins ses caractéristiques linguistiques (lexicales, syntaxiques phonétiques) de l’oral, que sa dimension communicationnelle et interactionnelle.
14
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.1-Oral monogéré et polygéré ; dialogal et
dialogique
L’oral monogéré est celui où le discours est pris en charge et généré par un seul émetteur.
Il se construit en référence aux conduites discursives: raconter, décrire, expliquer, argumenter.
C’est l’oral monologal (l’oral à un locuteur, l’exposé, par exemple). ( Kerbrat-Orecchioni, 1990)
15
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.1-Oral monogéré et polygéré ; dialogal et dialogique
L’oral monogéré est souvent empreint de préoccupations dialogiques, au sens de Bakhtine (1979), c’est-à-dire de préoccupations pour l’auditeur, dont on tient compte implicitement du point de vue, même si, dans des formes orales telles que l’exposé, il n’y a pas à proprement parler, d’interaction verbale.
16
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.1-Oral monogéré et polygéré ; dialogal et dialogique
L’oral polygéré est celui où le discours se construit à plusieurs
La position des participants n’est pas fixée à l’avance et évolue au cours de l’interaction. C’est l’oral dialogal de la discussion et du débat : il suppose l’interaction orale.
Encore plus que l’oral monogéré, l’oral polygéré peut être dialogique, au sens où la prise en compte de l’autre est explicite, particulièrement dans des formules telles que le débat et la discussion.
17
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.1-Oral monogéré et polygéré ; dialogal et dialogiqueCe qu’est le dialogisme de Bakhtine (1979; 1981) -Nous n’existons qu’en relation avec autrui et en
interaction avec des contextes sociaux et culturels différents.
-Le sens n’existe pas dans le texte seulement : il est construit par le lecteur, ou les lecteurs interprétant un texte en collaboration.
-La « polyphonie énonciative » est l’ interaction dialogique de lecteurs, chacun apportant son bagage socioculturel, ses valeurs, ses points de vue particuliers.
- La créativité verbale est perceptible dans les échanges oraux : les interlocuteurs s’ajustent et réinventent le langage, parfois de manière hasardeuse.
18
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous
intéresse 2.2.1Un oral dans la perspective socioconstructiviste par ses aspects sociaux
Ce type d’oral est tout à fait dans la logique de programmes qui se veulent construits dans une perspective socioconstructiviste.
En ceci, ils sont les héritiers direct des théories de Vygostky (1985), qui a été le premier à développer le caractère social de l'apprentissage.
19
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.1 Un oral dans la perspective socioconstructiviste
par ses aspects sociaux /VYGOTSKY Selon lui, les fonctions psychiques supérieures de l’être
humain (ex. : la formation de concepts, la mémoire logique, etc) trouvent leur origine dans les relations entre les êtres humains.
En se socialisant, l’apprenant travaille également à son individuation progressive car les instruments psychologiques qui lui sont transmis lui permettent un contrôle de plus en plus personnel de ses activités.
Pour lui, grâce aux échanges et négociations de sens, l’interpersonnel devient intrapersonnel grâce à l’intériorisation progressive que fait le sujet.
Ce que l’on construit simultanément, dans les échanges, c’est à la fois des connaissances sur un référent et un contexte interlocutoire commun qui permet de créer une communauté discursive.
20
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.2 Un oral où le travail énonciatif sur les genres
discursifs est « socialisé » Que l’oral soit monogéré ou polygéré, le locuteur explore les ressources du langage pour se construire des représentations, s’affirmer, et , dans le cas de l’oral polygéré, affiner et complexifier grâce aux échanges les représentations qu’il a sur un sujet donné.
Le travail énonciatif (soit celui sur le discours en contexte) comporte des dimensions discursives et sémiotiques.
21
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.2 Un oral où le travail énonciatif sur les genres
discursifs est « socialisé » Selon Bakhtine, entrer dans un savoir, ce n’est pas
seulement s’approprier des concepts, des manières de faire ou de penser, mais c’est aussi s’approprier les genres de discours qui les sous-tendent et qui permettent l’entrée dans une communauté discursive où on les utilise.
Pour lui, les genres de discours que l’on pratique à l’école sont des « genres seconds », plus élaborés et plus fondés culturellement que les « genres premiers » que l’on pratique dans l’urgence de la vie quotidienne. Le sujet garde une certaine distance par rapport à son objet et par rapport à son activité locutoire : l’énonciation dépend de conventions fortes à propos des formes langagières permises.
22
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.2 Un oral où le travail énonciatif sur les genres
discursifs est « socialisé » À travers un genre discursif donné (par exemple : définir,
raconter, argumenter), on retrouve des séquences que l’institution scolaire tend à codifier (Dolz et Schneuwly,1998), ce qui joue sur la mise en mots, d’où les tâtonnements et les reformulations.
Les reformulations sont la trace d’un travail métacognitif. On peut avoir les reprises littérales, les paraphrases, les expansions, les suppressions, les commutations.
Ceci va de pair avec les maximes de coopération de Grice (1975) : selon la perspective interdiscursive et interactionnelle, le locuteur se préoccupe d’être clair pour les autres (accord, par exemple, sur la valeur référentielle d’un énoncé), alors que selon la perspective intradiscursive, il s’efforce de produire un discours cohérent en soi.
23
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.2 Un oral où le travail énonciatif sur les genres
discursifs est « socialisé »
Quant à la dimension sémiotique, elle concerne la construction des objets du discours par le langage.
Par exemple, si l’on décrit un objet, on ancre le référent commun à tous dans un « nom » qui réfère tous les interlocuteurs au thème en cause. Il y a donc accord entre interlocuteurs sur la valeur référentielle d’un énoncé.
24
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.3 Un oral où l’enseignant est un médiateur qui
pratique l’étayage
Vygotsky (1985) a mis de l’avant la notion de zone proximale de développement, qui découle de l’ancrage social du développement : l’apprenant doit être aidé pour acquérir de nouveaux instruments psychologiques et se développer.
Sous la direction de l'adulte ou en relation avec des pairs, il se développe par imitation, en assimilant et en maîtrisant des concepts de plus en plus complexes.
25
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE RÉFÉRENCE DE NOTRE ANALYSE2-Notre objet d’analyse: l’oral dialogique2.2Pourquoi l’oral polygéré et dialogique nous intéresse2.2.3 Un oral où l’enseignant est un médiateur qui pratique
l’étayage L’imitation est reliée à l’étayage, concept développé par
Bruner (1983). Dans l’étayage, on montre à l’élève comment donner une réponse, comment en recevoir une et comment interagir avec le groupe. Il faut que l’enseignant prenne le temps de le faire (apprentissage par observation et imitation et enseignement par modélisation) .
Selon le contrat didactique, c’est à l’enseignant que revient la gestion de l’interaction en classe, et donc de l’interaction orale. Le cadre participatif (Goffman, 1987) est particulier en raison du nombre des élèves, de leur situation d’apprenants et du rôle de responsable des prescriptions ministérielles qu’a l’enseignant.
26
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT
Nous nous centrerons ici sur l’oral polygéré , dans une perspective de co-construction des savoirs, soit sur le débat-discussion, qui suppose des compétences argumentatives
1-L’argumentation au plan théorique
L’argumentation est différente de l’explication.Dans l’argumentation, il y a élaboration de nouveaux savoirs par négociation de significations à travers un discours qui tend à s’affiner
L’argumentation est « une activité qui vise à intervenir sur les idées, les opinions, les attitudes, les sentiments ou les comportements de quelqu’un ou d’un groupe de personnes. » (Grize, 1996)
27
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT1-L’argumentation au plan théorique (suite)
L’argument peut se définir comme « tout segment qui appuie un autre segment, que ce soit par une relation de causalité, de finalité, d’exemplification, de restriction, etc » (Golder, 1996).
Dans l’argumentation, on parle de «statut discursif » des interlocuteurs : certains d’entre eux, surtout l’enseignant (car il connaît le savoir visé), définissent le mode des échanges et assurent la progression thématique.
Grize (1996) rappelle que la construction de l’objet argumentatif suppose la mise en œuvre, dans le discours de procédures de filtrage de certains aspects et de saillance (ou mise en valeur) d’autres aspects.
28
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT1-L’argumentation au plan théorique (suite)
Il existe trois types d’arguments selon la source (Allieu-Mary, 2004)
-les arguments pragmatiques : ce sont les informations prélevées dans un texte;
-les arguments pseudo-pragmatiques : ce sont des extrapolations à partir d’un texte, par exemple, des hypothèses quant aux sentiments d’un personnage de roman
-les arguments intellectuels : ils sont fondés sur des modes de raisonnement reconnus comme valides. Ainsi, on retrouve
-les raisonnements par disjonction (ou dissociation de deux cas), -les raisonnements par analogie (ou inférences, ou déductions) -et les raisonnements par tiers exclus, par lesquels soit on concilie deux positions contraires, soit on opte pour l’une de préférence à l’autre.
29
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT1-L’argumentation scolaire Dans le cadre de la salle de classe, ce qui est en jeu dans le discours argumentatif, outre le rapport au pouvoir (à travers une coopération basée sur le respect), c’est surtout le rapport au savoir et à l’ancrage de celui-ci dans la réalité et dans la vérité.
Deux moments dans l’argumentation à l’école (Weisser et al, 2003) :
1e- les élèves argumentent autour des représentations initiales qu’ils se font à propos d’un phénomène.
2e- après avoir formulé des hypothèses et prélevé des informations, ils poursuivent leur discussion de façon plus structurée et fondée en vue de produire un savoir.
30
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT1-L’argumentation scolaire Les arguments avancés peuvent être d’inégale valeur (arguments
d’autorité, argumentation circulaire, appel à l’expérience, évidence partagée, savoir livresque, etc), mal justifiés, non étayés : c’est à l’enseignant de rectifier le tir par l’étayage.
La participation à un débat suppose l’écoute active. En relation interactionnelle, l’écoute suppose qu’il y ait interprétation des paroles de l’autre, donc construction de sens.-
Il y a nécessairement des déplacements thématiques et discursifs dans les échanges, ce qui rend nécessaire la vigilance des interlocuteurs.
C’est dans une écoute active que s’élaborent les significations communes, puisque c’est grâce à elle que surgissent les demandes de clarification, d’ajustement. C’est par là aussi que l’on peut dire que l’oral du débat est un oral réflexif ( Chabanne et Bucheton, 2001) qui n’est ni un oral spontané ni un texte oralisé, mais bien un oral intermédiaire portant des traces d’échanges, et donc d’apprentissages.
31
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT1-L’argumentation scolaire La confrontation permet de décontextualiser les points de vue et les opinions de l’ancrage affectif où ils se sont construits.
Le rapport au langage est aussi transformé: il sert à mettre en mots l’évolution d’une pensée de façon optimale et , pour ce faire, apprendre à généraliser, à abstraire, à déduire, à maîtriser diverses ressources linguistiques, dont le lexique d’une discipline donnée.
32
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT
1-L’argumentation scolaire /Le rôle de l’enseignant1e- combiner différentes dimensions dans le choix d’un thème à débattre :
-dimensions psychologiques (affects, motivations, intérêts), -cognitives (complexité des thèmes, connaissances des élèves sur le sujet), -sociales (résonance sociale du thème, ses enjeux polémiques et éthiques) -didactiques (viser l’apprentissage en tenant compte du niveau des élèves). (Dolz et Schneuwly (1998)
2e-rappeler les consignes, arbitrer le plus souvent les tours de parole, juger de la pertinence des prises de parole, poser les questions appropriées, amener à reformuler, à pousser plus loin la réflexion, à faire des bilans.
3e-montrer comment justifier une position, réfuter les thèses adverses, concéder à l’interlocuteur certains arguments, utiliser les connecteurs, maîtriser le métalangage de l’argumentation, dont les modalisations du discours. le soutien de l’écoute.
4e- veiller aux conditions favorables à une bonne écoute5e-concernant sa discipline, éclairer les élèves sur les arguments
valides ou non, confronter les élèves à des objectifs complexes et veiller à l’appropriation d’un lexique spécifique pour désigner les objets de discours.
33
2e PARTIE : LE GENRE ORAL FORMEL LE PLUS IMPORTANT DANS UNE PERSPECTIVE « TRANSVERSALE » , LE DEBAT
1-L’argumentation scolaire /Le rôle de l’enseignant Les fondements de l’argumentation ne sont pas toujours les mêmes d’une discipline à l’autre : ainsi, en histoire, contrairement aux disciplines scientifiques, aucune vérification expérimentale n’est possible.
Normalement, l’enseignant doit suspendre son propre point de vue pour aider ses élèves à faire surgir les leurs. Il doit posséder un certain niveau de tolérance pour les flottements discursifs et argumentatifs; il doit également être ouvert à l’expression des émotions. Ce qui lui importe est la construction sociale des savoirs, et, ce faisant, la construction de l’identité personnelle de ses élèves.
34
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
1-Positions générales des programmes Dans les disciplines choisies, l’élève est à même de pratiquer
de façon maximale la compétence transversale «exercer son jugement critique », ce qui est l’un des buts du PFÉQ
« À la fin du primaire, l’élève a appris à différencier son opinion de celles des autres et à l’exprimer de manière relativement articulée. Il accepte d’en débattre et de remettre en question son propre jugement ... il parvient à distinguer les arguments affectifs des arguments rationnels. Cela lui permet de saisir certains enjeux logiques, éthiques ou esthétiques d’une situation ou d’une question et de reconnaître, ne fût-ce que sommairement, les valeurs, les principes, les droits ou les devoirs sur lesquels il fonde son jugement. «
« Au secondaire, l’élève apprend à s’interroger sur ses opinions ou ses prises de position. ... Il se préoccupe davantage de la justesse de ses arguments et de la nécessité de les remettre en question au besoin. Il aborde des situations plus complexes où se mêlent des enjeux de tout ordre ... en tenant compte du contexte et du point de vue des divers acteurs. » (MELSQ, PFÉQ, p. 41)
35
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES2-Le débat-discussion en sciences humaines2.1 Généralités
En sciences humaines, l’argumentation a une couleur particulière car on se soucie de la « preuve », mais dans un cadre pluri-paradigmatique, contrairement à ce qui se passe en sciences (Biseault et al., 2004)
La posture de l’élève doit être celle d’un « chercheur » qui utilise les pratiques sociales de référence comme un cadre d’analyse ; l’enseignant est derrière lui pour valider ce cadre.
36
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.1 Généralités Le débat scolaire n’a pas le même sens que le débat démocratique :
les modes de validation des arguments ne sont pas comparables. Ex : en histoire, les faits apportés pour argumenter n’ont pas l’actualité de ceux qui sont requis dans les débats scientifiques.
Le fait d’introduire le débat-discussion dans la classe de sciences humaines, c’est en quelque sorte rompre avec la « boucle didactique » usuelle (Audigier et al. , 1996) ,qui se présente ainsi:-annonce du contenu à voir par l’enseignant -présentation de ce contenu sous forme d’exposé mêlé de questions-réponses et souvent appuyé par un document-clôture-synthèse de la « boucle » et début d’une nouvelle boucle.
Audigier et al. ont souligné la prépondérance du discours factuel et déclaratif des sciences humaines à l’école.
Ce genre de pratiques entraîne une évaluation-miroir de l’exposé de l’enseignant.
37
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.1 Généralités La question fondamentale touchant le débat en sciences humaines est la suivante : comment l’argumentation ayant cours dans le débat permet-il de saisir le monde d’une certaine manière ?
À part le débat, on peut utiliser le « jeu de rôles » comme susceptible de faire surgir les habiletés des élèves à exprimer leur point de vue et à argumenter : par exemple, un débat sur le sujet « l’Afrique s’en sortira-t-elle, économiquement ? », des jeux de rôles autour des fauteurs de guerre concernant la 2e guerre mondiale, etc.
Pour convaincre leurs adversaires, les élèves doivent étayer leurs arguments de connaissances spécifiques à la discipline.
38
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.1 Généralités Quant à l’enseignant, il se penchera de façon plus spécifique sur :(1) la recevabilité des arguments dans son champ disciplinaire ; (2) les éléments discursifs employés pour convaincre (ex : le recours à un vocabulaire spécifique, à des généralités ou à des exemples ; le sens de l’observation démontré ; la facilité à catégoriser ; la clarté de la description ;la pertinence des preuves ; la reformulation pertinente des sources ; la prise en charge de l’énoncé grâce aux modalisateurs) ; (3) le processus de co-construction des connaissances, et, par là, le processus de construction personnelle de l’élève.
39
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois L’histoire et l’éducation à la citoyenneté (HÉC) de même que la géographie, font partie du domaine de l’ « univers social » .
Selon le programme touchant l’univers social au primaire, l’élève « développe son jugement critique par la consultation de points de vue divergents avant d’arrêter le sien sur le sens du changement, de le justifier et de le confronter avec celui d’autres élèves, en le défendant et en le nuançant au besoin » (p. 11).
40
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois Au secondaire, les programmes HÉC visent trois compétences . Les deux dernières nous semblent constituer des portes d’entrée pour l’oral argumentatif : *interpréter les réalités sociales à l’aide de la méthode historique; *construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire. La position du programme est non équivoque sur le sujet : « ... l’interprétation des réalités sociales nourrit la structuration de son identité parce qu’elle l’oblige à confronter perceptions et valeurs. Enfin, coopération, interaction et échange d’opinions s’ajoutent aux ressources de l’élève qui développe ses compétences en histoire et éducation à la citoyenneté. » (PFÉQ, 2004,1er c., p. 341).
41
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois L’enseignant est vu comme médiateur entre les élèves et le
savoir : «Il se préoccupe du développement des stratégies cognitives et
métacognitives de l’élève. Il fait en sorte qu’il s’engage dans un processus de construction de sens en favorisant la discussion, l’échange et la confrontation des points de vue et en suscitant l’expression des sentiments et des émotions. (PFÉQ, 2004, 1er c., p. 342).
En ce qui regarde la compétence « construire sa conscience citoyenne à l’aide de l’histoire », le programme souligne que l’élève
... doit se préparer à jouer un rôle de citoyen responsable, capable de s’engager dans les débats sur les enjeux sociaux. Les microsociétés que constituent la classe et l’école présentent déjà de bonnes occasions d’échanges et d’interventions sur leur organisation, sur leur fonctionnement ou encore sur les multiples questions de nature citoyenne qui surgissent fréquemment (id., p. 348).
42
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois Le programme du 2e cycle du secondaire invite même l’enseignant à offrir à l’élève des situations de délibération sociale sur des enjeux actuels. On demande de faire progresser l’élève dans son argumentation, par rapport au premier cycle.
On y énumère cinq composantes à considérer dans l’exercice de la citoyenneté: l’identité sociale, la participation à la vie collective, la délibération, les institutions publiques et la vie démocratique.
Le débat est spécifiquement mentionné comme un outil à utiliser à ce niveau pour éclairer les enjeux de société.
43
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois Bouchard (2007), rapprochant le programme HÉC de celui de ÉCR propose d’inclure au programme HÉC « une approche habilitant au questionnement à propos de la norme, à la recherche commune de l’argument meilleur pour répondre à un problème d’ordre moral. »
On peut effectivement penser que les échanges oraux tels que le débat jouent un rôle majeur dans la formation de l'individu à la vie sociale et à la tolérance. L'éducation à la parole « publique » peut contribuer à construire le contrepoids nécessaire à la violence, à la défaite de toute éthique, et ainsi aider à la restauration de valeurs partagées.
44
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois Le PFÉQ du secondaire de géographie précise que l’élève
est amené à résoudre des situations-problèmes d’ordre territorial et que , pour ce faire, il doit analyser efficacement certaines pistes de solution.«L’élève est également appelé à exercer son jugement critique, notamment lorsqu’il examine les conséquences des actions humaines sur un territoire. Il en va de même lorsqu’il évalue des solutions à des problèmes d’ordre planétaire, se positionne au regard de leur efficacité et justifie sa position. ... Pour développer ses compétences, l’élève est appelé à coopérer, car il est souvent placé devant des tâches complexes dont l’exécution suppose un travail de collaboration. Il est alors amené à interagir en manifestant une ouverture d’esprit et à accueillir les justifications des autres dans le respect des divergences de vue et d’opinion. (PFÉQ, 2001, p. 304 et 305)
45
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
2-Le débat-discussion en sciences humaines2.2 Les programmes québécois Bilan provisoire des programmes de sciences humaines relativement à l’oral argumenté
-Les objets d’apprentissage sont très circonscrits en histoire et en géographie.
-Ils le sont moins en éducation à la citoyenneté. (ex. : conception de la Nation; rôle de l’État, droits des autochtones; préservation du patrimoine culturel).
-On peut donc penser qu’il y aurait, dans ces disciplines au moins deux types de débats argumentés, -l’un se basant sur l’analyse de documents « factuels » et recherchant, de ce fait, la « valeur de vérité » d’un jugement » -l’autre plus spéculatif et fondé sur des interprétations plus « personnelles » des faits.
46
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.1 Les programmes de morale
Les programmes de morale du primaire et du secondaire actuellement en cours se situent dans le domaine du « développement de la personne », où se retrouvent par définition des notions telles que l’engagement, la solidarité, de même que le respect de soi et d’autrui.
Le programme de morale du primaire demande d’inciter l’élève à prendre position de façon éclairée sur des situations comportant un enjeu moral, ce qui suppose que l’élève considère différents points de vue, diverses options possibles, et leurs effets sur lui et les autres. Une autre exigence de ce programme en termes de compétences est la pratique du dialogue moral.
47
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.1 Les programmes de morale « Le dialogue moral peut se pratiquer lors d’une recherche
commune sur le sens de mots tels que besoin, famille, préjugé, droit, responsabilité ou norme. Il se pratique aussi lors de l’analyse de situations comportant un enjeu moral ou encore lors de la préparation, de la réalisation et de l’évaluation d’une activité ou d’un projet qui permet d’actualiser des valeurs. » (PFÉQ, 2001,p. 286)
Par le dialogue moral, l’élève apprend à se décentrer de
son point de vue personnel et à respecter le point de vue de l’autre. Le programme suggère d’initier l’élève à la procédure du dialogue et de lui montrer quels sont les obstacles d’une véritable communication. On peut se demander en quoi le dialogue moral, surtout au primaire, peut susciter le débat-discussion, le programme n’évoque pas les situations concrètes de dialogue.
48
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.1 Les programmes de morale Le programme de morale du secondaire demande entre autres à
l’élève de se positionner de façon réfléchie au regard d’enjeux d’ordre éthique (ex. : clonage, manipulation génétique, réchauffement de la planète).
On y met davantage qu’au primaire l’accent sur la délibération, le dialogue et l’exercice de la pensée critique.
L’enseignant doit inciter l’élève à considérer plusieurs points de vue et l’aider à prendre position et à justifier son choix.
On ne spécifie pas, au 1er cycle du secondaire, que cela se fait à travers le débat. Cependant, au second cycle du secondaire, les problématiques soulevées par les récits suggèrent une réflexion et une analyse au moyen du dialogue moral, qui ... peut aussi se faire, à l’occasion, en dyades ou en petits groupes, suivi d’un retour en grand groupe. » (PFÉQ, 2004, p. 499)
La dynamique de ce dialogue moral en est une de coopération, et non de compétition. On n’est pas très loin du débat malgré tout.
49
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.2 Les programmes de ÉCR
Ce programme insiste sur la pratique du dialogue dans la perspective du vivre-ensemble et donc, expressément, sur le partage de valeurs communes, l’appréciation de différentes visons du monde et la prise de position personnelle et réfléchie au regard d’enjeux moraux ou éthiques.
Le but est d’être capable de porter des jugements sur les valeurs et les normes qui orientent l’agir humain au sein d’une société pluraliste et démocratique.
50
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.2 Les programmes de ÉCR Au primaire, le programme spécifie que la pratique du dialogue
comporte deux dimensions interactives :* la délibération intérieure *l’échange d’idées avec les autres afin de se construire un point de vue, en organisant sa pensée.
On suggère à l’enseignant du 1er cycle du primaire (p. 43 du PFÉQ, 2001) de faire « pratiquer le dialogue à l’intérieur de la conversation, de la discussion, de la narration et de la délibération ».
Au 2e cycle du primaire, les élèves se familiarisent avec l’entrevue et, au 3e cycle, « avec un autre forme de dialogue, le débat » (ibid.), en apprenant , entre autres, à vaincre les préjugés, les stéréotypes et les arguments d’autorité.
51
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES3-Le débat-discussion en morale et en éthique et culture religieuse (ÉCR)
3.2 Les programmes de ÉCR Le programme du secondaire est du même ordre que celui du primaire, avec son insistance sur les diverses formes de dialogue, dans des contextes qui se complexifient.
L’éducation éthique va plus loin que l’étude des faits pour en vérifier la vérité : le jugement moral, parce qu’il est basé sur la délibération, vise l’interprétation
52
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES3-Le débat-discussion das les programmes de français
Les programmes de français sont généralement divisés selon les volets langue écrite et langue orale. Cette dernière a toujours occupée une position secondaire, l’écrit étant réputé difficile et nécessitant un apprentissage structuré.
Cependant, depuis une dizaine d’année, en raison de travaux tels que ceux de Dolz et Schneuwly (1998), Garcia-Debanc et Plane (2004), de même que Lafontaine (2001) et bien d’autres, on insiste de plus en plus sur la nécessité de structurer l’enseignement de l’oral en genres formels à l’école.
Qui plus est, on souligne de plus en plus que l’oral peut non seulement être un OBJET systématique d’enseignement, mais également un OUTIL transversal permettant de réaliser divers apprentissages.
53
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES3-Le débat-discussion das les programmes de français Les recherches des didacticiens du français se sont surtout
centrées sur l’oral comme objet d’enseignement, l’oral comme vecteur d’apprentissage restant le grand oublié.
Kerbrat-Orecchioni (1990) a fait ressortir dans ses écrits la nature interactionnelle de l'oral Concernant une typologie possible des interactions, elle inventorie diverses caractéristiques:le cadre spatio-temporel ; le nombre et la nature des participants ; le but de l'interaction (finalisée, phatique, avec enjeu... ) ; le degré de formalité (intime, familier, guindé... ) ; l' axe consensuel/conflictuel ; la durée ; le contenu (nature de la macro-structure : argumentative, narrative ou descriptive).
Pour elle, certaines caractéristiques sont communes à toutes les interactions verbales et d’autres sont spécifiques à des interactions qui ont leurs contraintes structurales et rituelles propres.
54
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES
3-Le débat-discussion das les programmes de français Analysons la place du débat-discussion dans les différents
volets de l’enseignement du français. Le débat formel comme « genre second » (Bakhtine 1979 ; 1981)
est matière au programme de français, selon des modalités variées, qui vont de la simple discussion du début du secondaire au débat argumentatif de la fin du secondaire.
En plus d’enseigner le débat-discussion pour lui-même, l’enseignant de français s’en sert comme outil (à l’égal de ce que peuvent faire d’autres disciplines), entre autres dans les activités de lecture.
En effet, les programmes officiels encouragent depuis au moins une dizaine d’années les cercles de lecture comme formule pédagogique susceptible d’aider les élèves à améliorer leur compréhension des œuvres longues (entendons ici des œuvres littéraires) et ceci, tant au primaire qu’au secondaire.
55
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES3-Le débat-discussion das les programmes de français Au secondaire, le programme propose également des
interactions orales collectives au cours desquelles l’élève apprend à structurer ses idées, à respecter les tours de parole et à faire progresser l’échange.
Le programme du 1er cycle du secondaire spécifie même les formules : « discussion en sous-groupe, échange en grand groupe ; tables rondes ; cercles de lecture ; entretien critique ; jeu de rôles ; jeu de confrontation » (PFÉQ, secondaire 1e cycle, p. 123), ces formules apparaissant pour illustrer la « famille de situation » « défendre une idée en interagissant oralement » .
Le programme du 2e cycle du secondaire précise aussi qu’il faut habituer les élèves à la confrontation dans la défense de leurs idées et suggère deux grands types d’intentions, soit -débattre pour justifier une façon de penser ou d’agir
-et débattre pour agir sur les croyances, les valeurs et les attitudes de quelqu’un
56
3e PARTIE : LE DÉBAT ET L’ARGUMENTATION DANS LES DIVERSES DISCIPLINES3-Le débat-discussion das les programmes de français
En ce qui regarde les paramètres d’évaluation habituels relatifs à la consistance et à la cohérence du contenu de ces échanges oraux, le programme prévoit de les juger sur la qualité linguistique (choix adéquat des ressources verbales, respect de la langue standard) et oublie les aspects argumentatifs.
On le voit, les programmes de français se cantonnent dans des généralités concernant l’oral polygéré en classe de français au secondaire.
On aurait aimé des suggestions plus concrètes et des positions plus affirmées, entre autres sur la place des discussions orales relatives au travail d’écriture en sous-groupe, ou encore, une description explicite des avantages de la formule des cercles de lecture au plan heuristique, eu égard aux prises de position socioconstructivistes des auteurs du PFÉQ.
57
BILAN ET PROSPECTIVES 1-Bilan sur l’oral dialogique polygéré dans les programmes
Si l’oral dialogique polygéré nous semble apte à développer les capacités argumentatives des élèves et, par là, à les faire progresser dans leurs apprentissages, nous avons vu qu’il est bien timidement présenté dans les programmes analysés.
Certes, ceux-ci prennent position pour le français comme compétence transversale, mais, dans le concret des choses, soit dans les objectifs spécifiques, on en retrouve peu de manifestations.
Par ailleurs, ces programmes ne soulignent pas à quel point l’oral argumentatif considéré de façon transversale aux programmes permet une coopération entre pairs et l’exercice du jugement critique .
58
BILAN ET PROSPECTIVES 1-Bilan sur l’oral dialogique polygéré dans les
programmes Ainsi dans les programmes de sciences humaines, certains objectifs sont susceptibles d’être interprétés comme donnant lieu à des débats.
Cependant les programmes n’en font pas directement la suggestion, se contentant de suggérer des interactions et échanges d’opinion, entre autres par le travail en équipe, sauf à propos de l’éducation à la citoyenneté au secondaire, où ils suggèrent de tenir des « débats sur les enjeux sociaux »
Cela nous semble trop restreint à un seul volet du programme,trop tardif et trop vague, le programme ne spécifiant pas le type d’argumentation recherché.
59
BILAN ET PROSPECTIVES 1-Bilan sur l’oral dialogique polygéré dans les programmes Les programmes de morale et d’éthique insistent particulièrement sur la notion d’engagement, et donc, de délibération préalable, ce qui suppose l’examen des divers points de vue d’autrui; c’est ce qu’ils identifient comme étant le dialogue moral.
Ce concept à une extension plus grande qu’il y apparaît à première vue, le « partage collectif » pouvant se faire sous diverses formes, dont le débat, qui fait l’objet de quelques explications dans le programme d’ÉCR.
Cependant, encore là, les spécificités de l’oral argumentatif ne sont pas disséquées : ainsi, on ne démontre pas la place du descriptif et de l’évaluatif dans un argumentaire.
60
BILAN ET PROSPECTIVES 1-Bilan sur l’oral dialogique polygéré dans les programmes Les programmes de français étudient formellement le débat
comme genre oral. L’oral argumenté comme vecteur d’apprentissage apparaît
également à propos des cercles de lecture, visant l’interprétation des œuvres, mais il s’agit d’une simple mention, non assortie de recommandations sur de possibles façons de faire et des avantages à en retirer.
Rien n’est mentionné sur la contribution possible d’un débat argumenté lors d’une production écrite.
On peut en conclure que les prises de positions socioconstructivistes du MELSQ ne se traduisent qu’en termes généraux dans les programmes.
Ceux-ci sont pour le développement des capacités cognitives et métacognitives des élèves, pour la création de communautés d’élèves discutant sur les contenus scolaires, mais ils explicitent bien peu leurs propositions en termes fonctionnels, particulièrement en ce qui regarde l’oral dialogique.
61
BILAN ET PROSPECTIVES 2-Travailler l’oral dialogique: une mission difficile
Apprendre aux élèves à améliorer leurs compétences langagières à l’oral n’est pas une tâche aisée pour la plupart des enseignants.
-Chez les enseignants de français, on peut évoquer la difficulté à distinguer l’oral pour apprendre de celui qui est étudié en tant qu’objet d’enseignement. Ils se sentent démunis lorsqu’ils doivent élaborer une progression.
-Chez les autres enseignants, la discussion orale est au mieux un outil extrêmement secondaire , à utiliser avec circonspection, car ils n’ont pas une formation suffisante pour le faire.
62
BILAN ET PROSPECTIVES2-Travailler l’oral dialogique: une mission difficile La question du sens de l’activité est également
problématique . Il n’apparaît pas facile aux enseignants de proposer des
situations d’interaction orale qui provoquent un intérêt pour les élèves tout en étant riches en apprentissages.
De plus, les situations mises en place ne donnent pas toujours les résultats escomptés, c’est-à-dire que tous les élèves ne prennent pas forcément la parole.
La gestion du temps est un autre problème. Même si la classe est divisée en plusieurs groupes, un élève
seulement peut parler, pendant que les autres l’écoutent. Les échanges oraux demandent du temps. De plus, le temps que
prennent les élèves à chercher leurs mots, à exprimer leur pensée par tâtonnement peut déstabiliser le maître.
Ils peuvent se demander quand intervenir, quand décider qu’un élève a suffisamment monopolisé l’attention. ( tolérance à ces ambiguïtés de fonctionnement , gestion souple, à l’affût des dérapages).
63
BILAN ET PROSPECTIVES3-Des avantages à considérer l’oral dialogique comme une
formule prometteuse Comme le dit Plane (2000) : l’oral donne plus de place à la parole de l’élève : sa prise en compte dans les apprentissages fait changer la perspective d’enseignement. L’enseignant est moins centré sur son cours, sur le contenu qu’il veut faire passer, mais plus attentif à ce que comprend l’élève
Favoriser la participation orale en classe, signifie ultimement privilégier la personne dans sa singularité, la responsabiliser, valoriser la coopération et le dialogue, défendre la tolérance et le respect.Il faut cependant respecter certaines balises.
64
BILAN ET PROSPECTIVES3-Des avantages à considérer l’oral dialogique comme une formule
prometteuse Les conduites argumentatives ne doivent pas virer à la confrontation : ce que l’on vise, c’est une co-élaboration de positions dont les critères de qualité dépendent grandement du champ disciplinaire en question.
Par ailleurs, la discussion-débat permet une observation réfléchie de la langue en s’appuyant sur des situations concrètes où son usage personnalisé devient nécessaire pour argumenter. Pour les élèves dont le rapport à l’écrit est difficile, le débat ouvre des voies d’expression nouvelles qui, par ricochet, peuvent entraîner de meilleures représentations de l’écrit, puisque l’oral, comme l’écrit, permet de développer la conscience métalinguistique.
65
BILAN ET PROSPECTIVES
4- Prospective Il est à souhaiter que l’on entreprenne dans nos milieux une recherche transdisciplinaire de terrain sur les diverses situations didactiques où l’oral argumentatif est utilisé
-afin de cerner les apports exacts de cet outil à l’apprentissage des élèves
- afin de décrire les types de raisonnements, tant généraux que spécifiques à une discipline, l’élève utilise,
-et suggérer diverses approches d’oral polygéré transdisciplinaires dont l’enseignant de français serait le pivot central, tout en travaillant en collaboration avec ses collègues.
66
BILAN ET PROSPECTIVES4- Prospective Les points à toucher dans cette recherche :
*le poids des savoirs disciplinaires, *les modalités de l’apprentissage en collectivité, *les ressources linguistiques spécifiques à mobiliser *l’évolution de tous ces aspects au cours d’une année scolaire.
Une telle recherche permettrait de documenter le rôle de l’enseignant dans diverses situations de débat et de le systématiser selon les situations, ce qui inciterait à préciser, dans les programmes, et dans le matériel didactique, le rôle de l’oral transversal dialogique.
Nous en revenons ainsi aux présupposés épistémologiques à la base même de notre système éducatif.