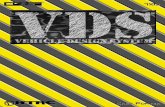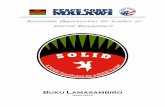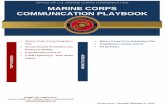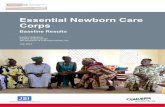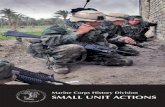Communication, déchéance du corps chez loakira
-
Upload
fldm-usmba -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Communication, déchéance du corps chez loakira
La Trilogie de Mohamed LOAKIRA est une œuvre
majeure dans l’univers littéraire marocain. Sa trace
est marquante du fait de son originalité créative.
Une œuvre qui, pour le moins qu’on puisse dire, est
habitée et régie par la trans-culturalité et la multi-
appartenance de son créateur. Marocain de nationalité,
amazigh d’origine, français de langue d’écriture,
marxiste d’idéologie et musulman de mémoire.
Ce travail est le fruit d’une réflexion qui a été
commencée en deuxième année de master « Lettres et
expressions artistiques », lorsque nous avions choisi
de travailler sur Mohamed Loakira en projet de fin
d’étude, et avant dans le séminaire de M. A. Kamal.
Peut-être que c’est un peu tôt de parler de
fructification, ce n’est qu’une floraison printanière,
suite d’une irrigation hivernale et en attente
d’ensoleillement estival.
Il porte comme titre « La déchéance du corps dans
la trilogie de Mohamed Loakira », cet écrivain qui
nous a sublimés par une écriture ultramoderne. Cette
thématique de la déchéance du corps a été déjà
appréhendée dans notre mémoire, sous la direction
fructueuse de M. Khalid Hadji, dans ce que nous avions
eu le soin d’appeler « L’écriture de la perte », cette
perte qui a été décrite dans l’écriture dans une
première partie, pour l’être approchée dans le corps,
dans une partie seconde et finale.
Nous allons esquisser par une définition des
termes formant l’intitulé de ce travail, pour arriver
à bien lire cela dans l’œuvre de Mohamed Loakira.
1- Précision méthodologique :
La déchéance en langue française se prête à
plusieurs significations, c’est l’action de déchoir,
état de ce qui est déchu ; tomber dans un état
inférieur à celui où on était, s’abaisser. Comme terme
de droit, il prend le sens de « perte légale d’un
droit pour n’avoir pas rempli des obligations ». En
théologie, il signifie « perte de l’état de grâce
originelle ». Mais toutes ces significations tournent
autour de la perte d’une qualité ou d’une quantité.
En théories de pensée, ou plus exactement en
philosophie, la déchéance est apparue avec Heidegger
comme étant un état de l’être-dans-le-monde. Cet état
de l’être-là déchu est celle de l’étant dispersé dans
le monde, accaparé par les autres et déterminé sans
cesse par rapport à eux. Il est soumis à l’emprise
d’autrui et dépossédé de son être soi-même. Il est
sous « la dictature du on » selon l’expression de
Heidegger. C’est une sorte d’aliénation, selon
Sartre ; autrui, ce « moi qui n’est pas moi » est
aliénant. Ainsi peut-on dire, somme toute, que la
déchéance est la perte de son être (Heidegger) ou de
sa liberté (Sartre) dans autrui.
Celui qui a donné une grande importance au corps
est M. Merleau-Ponty, le corps pour lui n’est pas une
simple réalité matérielle, mais c’est un ensemble de
significations vécues, un foyer de sens, il est
« sensible au double sens de ce qu’on sent et de ce
qui sent »1
Le corps est le point de départ de toute relation
à l'être, il n'est pas du tout passif, mais l'œuvre de
la perception. C’est en quelque sorte un processus de
subjectivation du sujet vis-à-vis du monde. Il est
évident que dans la phénoménologie, l’importance du
corps se rapporte nécessairement à l’expérience du
corps. Parce que le corps est le seul instrument de
connaissance du réel qu’il saisit directement. Dans la
1Merleau-Ponty, (Maurice), Le visible et l’invisible, Gallimard, Tel, p : 313
Phénoménologie de la perception2, Merleau-Ponty donne à voir
l’enracinement de l’homme dans le monde par son corps.
Il s’agit d’expliciter la structure de la perception
qui est un mode d’accès privilégié aux choses. Il
affirme : «Je considère mon corps, qui est mon point
de vue sur le monde, comme l’un des objets de ce
monde»3. Le corps se trouve au centre de cette
phénoménologie de la perception qui décrit le monde.
Ainsi Merleau-Ponty révèle l’état de l’être
phénoménologique qui correspond à l’expérience du
corps :
« Mon corps est à la fois voyant et visible. Luiqui regarde toutes choses, il peut aussi seregarder, et reconnaître dans ce qu’il voit alorsl’"autre côté" de sa puissance voyante. Il se voitvoyant, il se touche touchant, il est visible etsensible pour soi-même. [… C’est] un soi parconfusion, narcissisme, inhérente de celui qui voità ce qu’il voit, de celui qui touche à ce qu’iltouche, du sentant au senti – un soi donc qui estpris entre des choses, qui a une face et un dos, unpassé et un avenir… »4.
Le corps est voyant et visible, touchant et
touché ainsi que sentant et sensible simultanément.
Merleau-Ponty relève l’état coextensif de ces deux
modalités de l’être phénoménologique qui correspondent2 Merleau-Ponty, (Maurice), Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945.3 Ibid, p: 85.4 L'œil et l'esprit, op. cit., p: 18-19.
à l’évidence de l’expérience du corps. Il n’y a donc
plus de distinction absolue entre sujet et objet dans
son corps phénoménal. Il va de soi que, pour le
phénoménologue, le monde ne peut pas être distingué du
corps:
« visible et mobile, mon corps est au nombre deschoses, il est l’une d’elles, il est pris dans letissu du monde et sa cohésion est celle d’une chose»5.
Dans ce cas, la déchéance du corps serait
comprise comme une perte de son état coextensif. Dans
le sens où on peut dire que le corps est déchu et
perdu quand il perd un pôle de sa double
fonctionnalité et plus précisément celui de l’objet6.
Si le corps n’arrive pas à se sentir comme objet,
alors on est en droit de dire qu’il est en état de
dispersion dans le monde et s’il n’arrive pas à sentir
les objets qui l’entourent, on est dans ce qu’on
appelle « l’objet perdu ». Donc, la déchéance du corps
est quasiment liée à une perte de son état objectif.
Comme nous avons eu le soin d’expliquer ci-dessus la
dispersion dans le monde en terme d’être sous « la
dictature du on » heideggerienne ou l’aliénation5 Ibid, p: 19.6 L’objet ici signifie le fait de se considérer comme objet ou de considérerun objet autre que soi.
sartrienne, nous allons essayer d’expliciter, tant que
possible, la notion de l’objet perdu.
Nous débuterons la clarification de l'objet perdu
par ce que nomme Jacques Lacan "l'objet (petite) a".
Selon Lacan, "l'objet a" est un objet cause du désir.
Ainsi cet objet de désir pour Lacan est perdu et tous
les objets qui se proposent au sujet désirant ne sont
que des substitutions de l'initial objet perdu. On
pourrait dire que la théorie lacanienne des objets a
reprend, en la systématisant, la théorie freudienne
des objets partiels, ces objets dont le sujet a du se
séparer, le sein dans le sevrage, les selles dans
l'apprentissage de la propreté.
Pour Pasqual Quignard7 l'origine de l'objet perdu
«est d'abord un phénomène subjectif qui prend son
origine dans la carence, l'absence, la privation,
l'invisibilité»8. L'objet perdu vient d'un manque, de
la sensation même qu'il devrait y avoir quelque chose
là où il n'y a rien.
Après cette mise en train méthodologique,
essayons à l'instant de trouver les traces de cette
déchéance du corps au "corps" même du texte loakiréen.7 Quignard, (Pascal), Sordidissimes, Edition Grasset, 2005.8 Ibid, p: 226.
2- La dispersion des personnages
dans le monde de fiction :
La déchéance des personnages comme étant des
êtres dispersés dans cet horizon signifiant qui est
l’univers fictionnel, dans ce monde possible, est
régie par leur acceptation de la doxa, par leur
intégration des règles sociales, par l’incarnation de
ce qu’on dit, de ce qu’on juge bon ou mauvais. C’est
une manière de s’oublier dans ce qui est commun, que
cela soit les traditions ou les relations sociales,
etc.
Le personnage le plus représentatif de cette
catégorie est sans aucun doute celui de Lalla Chama,
tout la portait à être aliénée, son éducation
traditionnelle qui lui a donnée cette image inférieure
de la femme soumise, de celle attirante, objet de
plaisir. Ainsi peut-on lire au début de L’Esplanade :
« Toute jeune, Lalla Chama était au fait des normesstrictes de cette foire à chair. Elle veillaittoujours à être présentable, douce, obéissante afind’attirer l’attention des nicheuses, d’être l’objetde tous les désirs, d’étaler intelligemment sabeauté, son charme, ses bonnes manières et derendre, de ce fait, les filles de son âgeinvendable »9
9 E. C. S, p : 11.
De telle sorte, le narrateur-conteur dessine
l’archétype de la femme traditionnelle marocaine, tous
les clichés et les idées reçues sont présents. Lalla
Chama ne vit nullement pour elle-même, elle a perdu
son authenticité, ou plus exactement, elle n’a pas
d’authenticité, elle prend l’image de ce que l’on veut
d’elle. Son éducation était machinale comme on
fabrique une marchandise pour une clientèle
particulière :
« Ah ! L’air hautain, racé qu’elle prenaitlorsqu’elle accompagnait sa mère aux mariages, auxaprès-midi festifs entre femmes, réunion propicepour exposer et vendre la marchandise lustrée etbien empaquetée. »10
Ce lexique commercial, qui caractérise le corps
féminin, est le summum de la déchéance de l’être
féminin dans la société patriarcale et machiste.
Pire encore est le passage suivant :
« Les fouineuses ne négligeaient aucune partie ducorps : de l’haleine, de la transpiration à ladenture, la chevelure, aux poils des jambes ; duteint des joues, des ongles, du blanc d’œil à lataille, à la forme des hanches. »11
Plus que la marchandisation du corps, on assiste
ici à une forme d’esclavage, d’animalisation du corps
10 Ibid, p : 10.11 Ibid, p : 11.
féminin. Car une femme est considérée, dans cette
société traditionnelle, comme une machine de
reproduction et de plaisir, elle doit être bien huilée
et bien belle afin qu’elle puisse jouer son rôle
agréablement.
La vie du foyer, cette vie à deux, ce corps à
corps entre l’être masculin et celui féminin n’échappe
pas à la décrépitude, quant à lui. La femme dépossédée
par sa beauté éphémère et sa convoitise, l’homme par
sa force physique et financière et sa concupiscence.
C’est l’image de la vie conjugale que le texte
loakiréen présente pour déconstruire :
« Lalla Chama magnifie encore les soirs d’hiverlorsque Ba Jelloul, jeune marié passionné, revenaitchargé de présents, de fraicheur, de désirs ardentset de liasses de billets qu’il répandait à sespieds en lui chuchotant à l’oreille, la maincaressant ses seins […] - Tu mérites mieux que cela, toi joliesse de ma
vie ! »12
Sitôt la beauté s’affaiblie que l’intérêt cherche
un autre chemin, un autre corps qui pourrait aiguiser
le plaisir.
« Monsieur est servi. Un plat bourré d’épicesaphrodisiaques, préparé avec finesse, sur desbraises étouffées touts une existence.
12 Ibid, p :12
Monsieur fait le difficile, pousse le plat du boutdes doigts.Madame arrondit les angles.Entre deux paroles en instance, Madame insinue àMonsieur qu’elle est pure et passionnément prêtes’il daignait la prendre cette nuit, autant de foiset comme bon lui semble. Monsieur feint la fatigue et l’incapacité de seremembrer, radote la peine du jour, le manqued’aide, les difficultés de labourer la terre. Sans attendre de réponse, Ba Jelloul tourne le dosà la pénombre. Il s’allonge de tout son long sur lalarge banquette en cèdre massif et tire lacouverture à hauteur du menton.Le porc ronfle déjà. »13
Terrible condition humaine que celle de Lalla
Chama, victime d’une société qui classe la femme dans
la catégorie la plus basse de l’échelle sociale.
Ce qu’on doit signaler, en l’occurrence, est
l’usage excessif de la polyphonie dans la narration.
Ce qui joue un rôle important dans le fait de
l’installation de la doxa et des idées reçues et leur
intégration par le personnage en question, à savoir
Lalla Chama :
« Lalla Chama regrette l’enfant adorée qu’elle fut.Enfant baignant dans le musc blanc, la soie, lespromesses de l’infinitude du bonheur, de laquiétude et de l’aisance dans un foyer douillet.La nostalgie de se sentir entourée d’égards etd’amour l’évide en silence. Si vite volatilisé letemps où elle fut la coqueluche de tout le quartier[...]
13 Ibid, p :16
Regrette-elle aujourd’hui de ne plus être invitéecomme avant aux mariages et aux après-midi festifsentre femmes ? »14
Dans cet extrait, les paroles du narrateur
s’entremêlent avec celles du personnage de Lalla
Chama. On pourrait dire que c’est un discours rapporté
à l’indirect libre. Ce type de discours rapporté a de
spécial cette possibilité de voler les mots aux
personnages pour les mettre dans une hybridité
discursive d’une grande saveur littéraire. De plus,
cette hybridité dans le discours donne aux paroles un
caractère général cristallisant tous les clichés et
les idées reçues de la société où naissent et se
développent les personnages.
3- Le morcèlement des corps
érotisés:
Les personnages des récits de Loakira s'identifient
à une partie de leurs corps. Dans cette
fragmentation du corps, l'identité des personnages
est donc tronquée. Toujours est-il que les
personnages passent par une identification
14 Ibid, p :10
partielle, organe par organe, jusqu'à ce que le
lecteur arrive à reconstituer le portrait de
chacun, sinon dans la plupart des cas, il est voué
à l'impossible reconstitution. Ce morcèlement ôte à
l'individu son intégralité qui forme son entité
pour le rendre un simple attribut. Ainsi le corps
semble être désuni et fragmenté.
«Il [Mamoun] prend sa bien-aimée en bandoulière, lacajole enduit son front, son cou de salive, laisseses mains paître sur les tétons, la colonnevertébrale, entre les cuisses et la fente. Il sesent traversé par un frisson inaccoutumé, secouerpar les palpitations de (son) membre [...]Débordant de joie, Mamoun continue à raconter àZoubida des histoires à dormir debout.Elle reste suspendue à ses lèvres barbouilléesd'écume apaisante.»15
Dans ce passage, les deux corps de Mamoun et de
Zoubida, sa bien-aimée, se décomposent, se
fragmentent, s'échangent et s'entrelacent même. Ainsi
la désagrégation laisse imaginer l'union des deux
corps en un seul.
Du coup, le désir charnel peut être qualifié, le
cas échéant, comme un désir de posséder le corps
propre du bien-aimé. En effet s'effectue
l'entrecroisement à l'unisson des deux corps, à tel
15 L'Esplanade des Saints, op. cit., p:114
point que l'un se perd dans l'autre mutuellement.
Cependant, cette re-union finale ne passe que par une
dés-union initiale, de telle sorte que chaque membre
retrouve son antidote, telle une aimantation qui les
gagne et les fait tendre l’un vers l’autre tout en
restant rémanente même après leur séparation.
«Une sensation étrange le gagne.Mains moites, tremblantes, comme voulant sedétacher de son corps. Crampes. Fourmillements dansles pieds. Cheveux dressés, comme suspendus par despinces à linges. Une envie folle de bouger s'emparede tout son être.»16
Il s'agit de presque la même chose concernant la
relation mère-fils. Lorsque Mamoun sent un attachement
vertigineux envers sa mère, il est à constater un
morcèlement du corps maternel au point que cela
envisage une envie phagocytaire, dans une volonté de
se retourner là où il est sorti pour la première fois,
l'enceinte matricielle.
« Il [Mamoun] rit, écoute son corps, crie d'extase,lorsqu'elle [la mère] s'éclate, pérennise sesabsences […] Il se surpasse, inventant desprétextes et des combines pour s'éterniser en elle,habiter chaque parcelle de son territoire, quitte àsquatter, à son corps défendant, les battements deson corps et être le rythme […] Les deux seconfondent en un souffle enlié.»17
16 Ibid, p:114.17 Ibid, p:42.
Ce qu'il est à remarquer le plus dans ce passage
est sans aucun doute l'utilisation excessive des
adjectifs possessifs au point d'en perdre l'origine
nominale qu'ils remplacent, celui de la mère ou celui
du fils. Cela justifie clairement ce que nous voulons
faire entendre par la re-union des deux corps aimantés
par un fort attachement.
Cette relation dépasse des fois son caractère
maternel pour atteindre un degré incestueux:
«Mamoun languit de serrer fortement sa mère contrelui […] Il se crée les occasions pour humer sonodeur et cacher sa tête entre ses seins qu'ilaimerait tant sucer, tenir dans ses mains, enmordre les tétons. Il se laisse bercer par le songed'avoir embouché sa partie intime et claironne hautet fort sa béatitude en s'entendant avouer:Suis-je vraiment sorti d'ici? Alors je veux yretourner.J'affiche le désir ardent d'y rester, non sept oumême neuf mois, mais une éternité. Et vivement larésurrection chaque soir!Là, il ne comptera ni le temps révolu, ni celui àégrené sans pouvoir le canaliser, ni celui restant,encore embourbé dans l'improbabilité de sarencontre, pourtant bien inscrit sur le front.»
Ce désir incestueux est lui-même celui de
regagner ce royaume originel, ce lieu obscur et perdu
pour toujours, ce lieu où l'enfant avait constitué une
partie de sa mère, presque un membre parmi les autres
membres. Là où la notion du temps n'est guère celle du
monde visible. Là où l'éternité rejoint l'instant.
De ce fait se justifie le recours du narrateur,
dans L'Inavouable, à l'image du fœtus qu'a incarné
Mamoun après avoir vécu une perdition totale:
« il s’éloigne du palpable, se laisse embarquerdans les fantasmes qu’il prend pour des réalités…ilse surprend ramassé sous la couverture en laineécrue en position du fœtus »
A noter que même dans nos traditions marocaines,
il est très usité de mettre les nouveau-nés, par un
accouchement précoce, à l'intérieur de la laine écrue
comme substitution à l'utérus maternel.
De telle manière, nous pouvons dire maintenant
que la perte du corps en celui de la mère n'est autre
qu'une recherche de l'endroit initial, l'objet perdu,
ainsi la sacralité du corps maternel n'est qu'une
substitution du premier. Mais encore, nous pouvons
ajouter que le glissement de Mamoun dans le corps de
sa bien-aimée lui révèle sa perte capitale, ainsi, le
désir sexuel peut-être qu'il surgit du désir né de
cette recherche acharnée, néanmoins jamais satisfaite.
4- La perte du corps par le sexe:
La perte du corps dans le récit de Loakira se
présente encore comme perte de contrôle, de la
maîtrise du corps, de ses organes vitaux, parfois
celui de la continence qui est une des manifestations
de cette décrépitude ; vécue aussi comme une perte de
l'indépendance du corps et de sa dignité. C'est une
sorte de corps soumis à la volonté sexuelle de son
possesseur, qu'il soit le même individu ou un autre.
Pour clarifier ce point nous allons essayer de
mettre en exergue trois cas saillants:
D'abord, l'homme, pris par un fort désir sexuel,
perd le contrôle de l'élan de son corps, de ses
membres génitaux, tel son pénis. L'exemple de Ba
Jelloul est très illustratif pour ce point:
«Ba Jelloul, en transe, fort préoccupé par lesdélices terrestres, s'en remplit les yeux enégrenant les parties saillantes des corps qu'ildevine rencontrer sur son passage […] Coq débile, lâché dans une basse-cour, il sedésaltère et se délecte.Il se lacère, s'éparpille, marche à trois pattes[…] Maintenant il butine à sa guise, fornique avecles yeux, laisse son membre s'allonger. Il faitdurer le plaisir et se prévaut ses conquêtesimaginaires.»18
18 Ibid, p:85-86-87.
Le personnage de Ba Jelloul présente quasiment,
dans l'œuvre, l'archétype de celui possédé par les
désirs charnels à en perdre la conscience. Il est à
constater également, que la perte passe aussi par la
jouissance comme insatisfaction des désirs sexuels et
leur maintien dans une phase attentive et
fantasmatique:
«Il s'imbibe d'eau-de-vie, se gave de platsrelevés, mijotés fume du kif kif, danse, chante,fornique et fornique à perdre la notion du temps.Le jour savoure l'arrivée de la nuit et la nuit serefait une virginité, domine et se prolonge. Lesfilles choisies passent sous son corps,disparaissent. D'autres reviennent fraîches etdélassées. A lui de refaire l'effort, hululer,hennir, hurler ou chanter à la lune.Mais à force de s'étourdir sur des blocs de chairinsensible, de patauger et de se relever ivre deleurres, à force de farfouiller sans déceler detrésors, la lassitude ramène Ba Jelloul à laraison.Il finit par avoir l'impression d'agoniser sur deslèvres usées par trop de frottements et demorsures, accentuées par un rouge-baiser fade etdélébile, sur des sacs de viande épaissis etflasques.»19
L'appétence sexuelle, au lieu de calmer la soif
de Ba Jelloul, le rend insensible aux attirances de
ces maitresses, le corps féminin se neutralise à ses
yeux et l'acte devient "fade" et "délébile". Ainsi
19 Ibid, p:149.
l'excès du désir produit l'impossible plaisir. Après
la jouissance, le désir quitte le corps et les traces
qu'il a laissées deviennent, à leur tour, vides de
sens et abjectes, aux yeux mêmes de la personne chez
qui elles avaient pu, quelques instants plus tôt,
susciter violemment ce désir.
En suite il s'agit du cas de la femme dont
l'existence se limite à satisfaire le plaisir sexuel
de son mari, ainsi est-elle vue comme une masse de
chair érotisée:
«Elle est la masse de chair qui est tenue d'êtrebelle, fraîche, chaleureuse, aguichante pour égayerle retour de son mari, lever les jambes quand ill'ordonnera et s'évertuer à satisfaire ses désirs àsens unique, à supporter ses fantasmes et sessecrets d'alcôves.Lalla Chama ne vit que pour les autres»20.
Enfin, le cas de l'enfant pris par "la toile
d'araignée" d'un homosexuel positif. Ainsi soumis à
ses attraits sexuels, il perd tout contrôle de son
corps et devient son acolyte. De telle sorte, son
existence se limite à la production de la jouissance
de son maître:
«Il (l'enfant enlevé par des kidnappeurshomosexuels) deviendra objet ne valant la savate
20 Ibid, p:43.
d'un vagabond. Sera méprisé, n'existant que selonle bon vouloir de ses ravisseurs. Vivra dansl'obscurité des grottes. Ne touchera plus le soleildes yeux, ni constatera le changement des saisons.Fera le ménage. Allumera les bougies […] Servira àmanger. Débarrassera la table […], attendantdocilement que ses maîtres daignent le prendre sanségard, l'un après l'autre […] Cet enfant est mort,Ô! Clarté de mon existence […]Il vivra une vie d'enfer, de l'enfance à la mort,maltraité, humilié, rudoyé, vendu et acheté à baspris. Sa parole, baliverne sur baliverne,n'intéressera même l'oreille d'un sourd. Saposition sociale sera dégradante pour ne pas direinexistante.»21
5- La perte de la perte:
Dans A corps perdu et L'Inavouable, Mamoun endure deux
circonstances causant d'ultimes souffrances. Il est
question de la perte de ses proches, de sa propre
famille. C'est plus précisément la mort de sa mère et
la disparition de ses enfants, les diablotins. Une
telle séparation que nous pouvons assimiler à même la
mort encore.
Suivons la même lignée de pensée qu'on a
développée plus haut, le corps de la mère, mais aussi
celui du fils et de la fille, n'est qu'un objet de
substitution qui remplace l'objet perdu initialement,
21 Ibid, p: 105-106.
à savoir la matrice maternelle. Toujours selon un
point de vue psychanalytique.
Cependant, lorsque cet objet de substitution se
perd à son tour, nous sommes en mesure de parler d'une
perte de la perte.
Cette perte seconde s'avère être d'une nature
destructrice, dans la mesure où l'individu se
déstabilise et manque tout contrôle de son corps et de
son être en entier. Ainsi Quingard explique-t-il que
«celui qui a subi la perte rejoint le perdu au sein de
son gémissement, il quitte son corps et se décompose
dans l'atmosphère du monde.»22
N'est-il pas le même sort de Mamoun après la mort
de Lalla Chama? Ne s'élance-t-il pas, introduit par
un discours direct ?
«Aucun des disparus ne comblera le vide ressenti enmoi. Il va grandissant. La vraie séparation conduitl'endeuillé par voies et par chemins, dépouillé deces petites choses qui donnent un sens auquotidien. Relève-toi, Mère. Je suis de retour […]Aucun des disparus, fut-il cher ou proche, ne vautla quelconque poussière qui frôle tes cheveux, tespieds.Une étrange sensation l'enrobe.Elle l'anime d'une force inexplicable, d'uneimpatience telle qu'il pousse loin, très loin le
22 Quignard, (Pascal), Sordidissimes, op. cit. p: 21.
pas et le pas, s'imagine voltigeant entre ciel etterre […]»23
Nous sommes alors, en plus de l'errance due au
chagrin de la séparation, en face d'une certaine
sacralisation de l'image maternelle. Perdant son
corps, son image s'angélise, se divinise jusqu'à
acquérir une puissance surnaturelle, "une force
inexplicable". Elle devient un objet sacré. Cette
sacralisation se manifeste dans le texte par la
majuscule de la première lettre "Mère".
De plus, la perte de la mère fait penser à la
naissance qui est la perte du premier royaume de
Mamoun:
« (la mort) d'un être cher creuse le néant autourde soi, amplifie le cri de naissance et rendprésent les futilités enfouies dansl'inattention.»24
Suivant cette idée, la mort est semblable au feu,
comme l'a bien démontré Gaston Bachelard, dans son
ouvrage majeur, La psychanalyse du feu. Elle est
destruction et renaissance:
«le feu suggère le désir de changer, de brusquerle temps, de porter toute la vie à son terme, à son
23 A corps perdu, op. cit., p: 9.24 Ibid, p: 10.
au-delà […] L'être fasciné entend l'appel dubûcher. Pour lui, la destruction est plus qu'unchangement, c'est un renouvellement.»25
La même chose regagne Mamoun, après avoir été la
victime d'une perte de mémoire touchant des scènes de
son enfance où Lalla Chama lui racontait des contes
fantastiques. Il affirme avec un ton fort:
« Debout le mort, se dit-il.Debout et marche parmi les morts.Re-nais autrement du dedans.»26
En outre, il est utile d'ajouter que Mamoun a
vécu également la perte initiale à deux reprise, la
première lors de sa naissance et la seconde à
l'instant de quitter la maison paternelle, étouffé par
le cynisme d'un père sans pitié.
«Lalla Chama avait poussé, voire jeté Mamoun dansle noir:- Bon vent, poussin. Cours, cours. Déploie tes
ailes, ne regarde pas en arrière […] Quitte cettemaison, cette impasse […] Dénie le lieu de tanaissance […] Change de chair, de nom, dedestinée […] Donne toi une nouvelle vie, re-naisailleurs. N'importe où. N'importe comment.
La rage avec laquelle cette expulsion a été décidéeet exécutée n'avait d'égale que la douleurjouissive de l'enfantement.»27
25 Op.. cit, p:39. 26 A corps perdu, op. cit., p: 12.27 Ibid, p:19-20.
Il faut dire que ce thème de la re-naissance est
fort présent chez Loakira. La mort est re-naissance,
la séparation est re-naissance. Qu'en est-il alors de
son recueil de poème N'être? Cette négation de l'être,
cette perte de l'être n'est-elle pas une re-naissance?
D'autant plus que même phonétiquement les deux
expressions se rapprochent (n'être et naître).
Ainsi peut-on relier cela à la notion de "la
métaphore vive" chez Paul Ricœur, dans la mesure où la
métaphore assigne un "penser plus" au sens initial. Le
"est" de la copule signifie "être" et "n'être pas" qui
désigne ce que l'imagination laisse en suspens, en
"épochè"28, comme présence parmi d'autre de l'être.
Suivons le même chemin, nous avons le droit de dire
que la re-naissance chez loakira est une naissance
dans l'imagination différente de la première.
Pour en conclure, il faut dire que la perte dans
le corps est perçue dans l'écriture loakiréenne comme
une sorte de déchéance de ce dernier. C'est la
dégénérescence, l’abaissement et la détérioration de
l'être de Mamoun suite aux aléas qu'il a subis;
commençant par une relation troublée avec un père et
un frère à la limite de l'humanité, passant par la28 Cf. Ricœur, (Paul), La métaphore vive, Edition Seuils, 1975.
mort difficilement digérée de sa mère, et finissant
par la séparation forcée avec ses diablotins. Tout
cela a influé négativement l'épanouissement de son
corps.
Ainsi cette dégradation du corps qui accompagne
une crise de l'être justifie le recours aux
sordidissimes29 et au registre bestial:
« Tu es sale, dégoutant, cochon dans une porcherieambulatoire. Tu pues des pieds et des aisselles.As-tu oublié que tu as chié dans ton froc, que tun’as pas arrêté de péter depuis avant-hier ? »30
A tel point d'atteindre une attitude masochiste,
réclamant la répugnance de son propre corps:
« Qui donnerait plus ?...le corps appartient àcelui qui le porte. »31
Ou encore:
« Il dépècera sa peau avec ses propres griffes, enboira le sang chaud et se donnera en offrande auxloups affamés ».Que risque-t-il après une telle déchéance ?»32
29 Néologisme de Pascal Quignard que nous aurons le soin de traiter juste après.30 A corps perdu, p: 34.31 Ibid, p: 43.32 L'Inavouable, p:101.