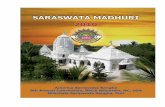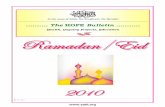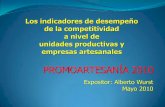Bellefontaine 2010 Domesticat arganier
Transcript of Bellefontaine 2010 Domesticat arganier
De la domesticationa l’amelioration varietale de l’arganier(Argania spinosa L. Skeels) ?
Ronald Bellefontaine
CiradUPR Génétique forestièreTA 10/DCampus international de Baillarguet34398 Montpellier cedex 5France<[email protected]>
Tirés à part : R. Bellefontaine
RésuméDurant les toutes dernières années, les connaissances sur les divers modes de régé-nération de l’arganier ont favorablement évolué, ce qui laisse enfin présager deréelles possibilités pour rajeunir l’arganeraie vieillissante au Maroc. La reproductionsexuée, mais surtout la multiplication végétative, connaissent des avancées décisivesdepuis peu. Cette dernière voie permet de cloner des « arbres plus », âgés de plu-sieurs centaines d’années, sélectionnés par les populations rurales. La multiplicationasexuée ouvre également la voie à la mise en place de meilleures stratégies deconservation et de gestion de la très grande diversité génétique de l’arganier.Les plantations au Maroc, ainsi que dans des pays à climats voisins, notammentl’Algérie où l’arganier est présent naturellement à l’état résiduel et l’Espagne où ilest subspontané, ou d’autres pays à climat méditerranéen côtier où il ne gèle pas,pourront prendre dorénavant plus d’ampleur. L’arganeraie étant un écosystèmecultivé multiproductif, les principaux critères de sélection suggérés ici devront pren-dre en compte les deux produits principaux de l’arganeraie : l’huile et le chevreau.Les divers progrès récents, présentés dans cet article, permettent d’envisager ladomestication de l’arganier et à très brève échéance la création de vergers clonaux.Les plantations, privées ou domaniales, à l’aide de boutures dotées d’un enracine-ment adventif dense laissent entrevoir des mises en défens plus courtes contre lestroupeaux de chèvres et donc une meilleure acceptation par les populations ruralesdes plantations futures.
Mots cles : Argania spinosa, domestication, foresterie, multiplication végétative,régénération sexuée.
AbstractFrom domestication to varietal improvement of the argan tree (Argania spinosa L. Skeels)?
Over the past few years knowledge has increased about the various modes of rege-neration of the argan tree, signalling real possibilities of rejuvenating aging Moroc-can argan forests. Sexual reproduction and, especially, vegetative multiplicationhave recently advanced substantially. The latter approach makes it possible toclone the “plus trees” often hundreds of years old and selected by the rural popula-tions. Asexual multiplication also opens the door to implementing better conserva-tion and management strategies for the widescale genetic diversity of argan trees.Plantations in Morocco as well as in countries of similar climate could be increased.Clearly concerned are countries like Algeria, where the argan tree grows naturally,Spain, where it is sub-spontaneous, and other countries with mediterranean coastalclimates remaining above freezing. As the argan tree is a multi-productive cultivatedecosystem, the main selection criteria suggested herein take the two main argan pro-ducts into account: oil and goat herding. The recent progress presented in this articlemakes it possible to foresee domestication of the argan tree and the creation ofcloned orchards in the near future. Private or domanial plantations, aided by
doi:10.1684/sec.2010.0226
Article de recherche
Sécheresse 2010 ; 21 (1) : 42-53
42 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
cuttings producing dense adventitious rooting, announce the possibility of rest-rotationgrazing against herds of goats and thus better acceptance of future plantations byrural populations.
Key words: Argania spinosa, domestication, forestry, vegetative multiplication,sexual regeneration.
A rgania spinosa est un arbre detaille moyenne à usages multiples,généralement d’une dizaine de
mètres de haut. Les atouts uniques decette espèce ont été décrits par diversauteurs de monographie [1-6]. Les mêmeset d’autres [7, 8] signalent que l’argane-raie de plaine, la plus accessible et laplus convoitée par les agriculteurs, est entrès forte régression. En revanche, ladégradation de l’arganeraie de montagnese fait à un rythme moins important, vul’attachement des populations rurales àcet écosystème, la prise de conscience col-lective et le maillage assez dense desOrganisations non gouvernementales(ONG) et des coopératives [3, 6] dansl’aire de l’arganier de montagne. Maisson vieillissement inquiète. La structure decette arganeraie montre une dynamiquegénérale de régression caractérisée pardes peuplements vieillissants et localementde fortes mortalités. On note partout undéficit chronique flagrant de petits diamè-tres dénotant une absence de régénéra-tion. La dégradation des arganeraies, endehors de celles qui sont surpâturées carutilisées comme collectifs de village, se tra-duit par la disparition de tout le sous-étageet le vieillissement accéléré du peuplement,où l’on ne remarque plus de semis naturelsrécents [2, 4, 8]. Pour l’arganeraie demontagne, l’objectif premier de l’aména-gement forestier est la protection – souventaléatoire, sauf si les populations sont forte-ment impliquées – et la réhabilitation decertaines arganeraies menacées.Le choix d’un développement durable fondésur la valorisation équilibrée de toutes lesressources naturelles végétales et animalesy est incontournable [2-4]. Force est de cons-tater que le troupeau de caprins (et d’ovins)est un des éléments essentiels de cet écosys-tème. « L’originalité de ce système agro-sylvo-pastoral est fondée sur une espèceendémique, l’arganier, exploité par des ani-maux acrobates parfaitement adaptés, leschèvres, géré par des paysans confrontés àun milieu difficile mettant en œuvre uneorganisation sociale subtile et des pratiquesrodées par le temps […] au nomde sa valeurpatrimoniale. » [5]. Il reste à obtenir uneréelle participation des éleveurs de chèvreset de moutons, voire même des éleveurstranshumants de camélidés, afin que lesplantations récentes et les jeunes semis natu-rels, quand ils existent, ainsi que les sous-bois, ne soient pas broutés.
La croissance de l’arganier est très lente.L’accroissement annuel moyen (aam) enhauteur durant les vingt premières annéesvarie entre 0,2 et 0,3 m par an en terrainordinaire dans des parcelles encloses etbien surveillées où les arganiers avaientété coupés rez-terre [1]. Il peut atteindrevers 10 ans s’il est monocaule, 2 à 3 m,voire 3,5m à 7 ans dans des emplacementsplus favorables [1]. Sans aucun traitementsylvicole, à l’Institut agronomique et vétéri-naire (IAV) d’Agadir, 20 arbres issus degraines « tout-venant1 » plantés dans unsol agricole alluvial à un espacement de3 x 4 m et arrosés tous les quinze jours pen-dant les six premiers mois atteignent à 6 ansune hauteur totale moyenne de 1,75 m(aam = 0,29 m/an) [9]. Dans la régiond’Essaouira (plateau des Haha), l’aam enhauteur durant les 20 premières annéesest de 0,38 m [2]. Dans ce type de stationplus fertile, la mise en défens contre les trou-peaux se limiterait alors à six ou sept ans.Or, depuis quelques années, les techniquesd’obtention de plants en pépinière s’amé-liorent et la multiplication végétative desarganiers par bouturage herbacé, greffageet marcottage aérien notamment, a fait desprogrès très importants. Le système raci-
naire des plants obtenus par bouturage her-bacé (figure 1) est bien plus développé aumême âge que celui d’un semis (figure 2),ce qui devrait avoir un impact sur la survieet la croissance juvénile.Par ailleurs, depuis six ans, les plantationsd’arganiers se multiplient dans les Direc-tions régionales des Eaux et Forêts duSud-Ouest du Maroc. À la fin de l’hiver2007-2008, 4 980 hectares ont été plan-tés, dont 95 % depuis fin 2002 [10] avec,dans certains cas, des taux de réussitesupérieurs à 75 % après quatre années(Tiznit, région de Tifadine) et sur de gran-des superficies [11]. Les troupeaux despopulations riveraines, impliquées dèsl’origine, respectent jusqu’à présent cesplantations. Les forestiers comptent unedizaine d’années pour mettre un jeuneplant « tout-venant » hors de portée deschèvres. Mais avec les clones performants,une sylviculture intensive et l’apport de lamycorhization [12, 13], on pourra trèsvraisemblablement raccourcir ces délais,concilier les souhaits des agriculteurs-éleveurs, et domestiquer l’arganier.
Domestication
L’arganeraie ne peut plus être considéréeen termes de génétique comme une « forêtsauvage », mais l’arganier y est loin d’être
Figure 1. Enracinement d’une bouture herbacée, élevée en portoir alvéolé de 20 cm de profon-deur favorisant l’autocernage et la ramification des racines.
1 « tout-venant » : plants ou graines non sélec-tionnés, issus de fécondations naturelles noncontrôlées.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 43
une plante cultivée. Il est cependant trèsprobable qu’au fil des siècles, les généra-tions d’agriculteurs-éleveurs vivant dansl’arganeraie ont exercé une certaineforme de sélection. Ainsi, la facilité deconcassage des coques, la précocité àfournir des fruits tout au début de la saison,le diamètre des fruits, le caractère remon-tant avec deux cycles de fructifications parannée, la qualité fourragère des fruits (cer-tains ont la particularité de présenter desfruits dont la chair peut se détacher aisé-ment, une fois séchée, en un ou deuxmorceaux et de pouvoir être conservéeconstituant ainsi des réserves alimentairespour le bétail en cas de disette) (figure 3)ou encore la spinescence2 des arganiers– certains sont inermes (sans épine) – sontdes caractères remarqués par les femmesqui récoltent traditionnellement les fruits.S’agissant de plantes pérennes, ces arga-niers remarquables n’ont pas été stabilisésau fil du temps, mais il est probable quecertains semis artificiels et volontaires pro-venant de ces « arbres plus » aient eu lieudans les champs ou à proximité des mai-sons. Cette sélection peut être considérée
comme l’amorce d’une domestication.Aujourd’hui, les progrès accomplis dansle domaine de la multiplication végétative,tels que nous les présentons ci-après, per-mettent de prévoir l’avenir de l’arganeraieavec un certain optimisme.Prolongement de la domestication, l’amélio-ration des plantes (dont celle des arganiers)alliant connaissances en génétique et enphysiologie, permettra d’appliquer des cri-bles plus efficaces en vue de créer desvariétés mieux adaptées aux besoins despopulations.
Reproduction sexuee
Biologie reproductive
L’arganier est une espèce monoïque : lesfleurs mâles et femelles sont portées parle même arbre. Les fleurs sontprotogynes3, le style émergeant de l’ovaireavant que les anthères ne s’épanouissentpour libérer le pollen [14]. Pour d’autreschercheurs, l’émission des grains de pollena lieu bien avant l’épanouissement desstructures femelles (protandrie), ce quirend l’autopollinisation presque impossible[6]. Son mode de reproduction est essen-tiellement allogame [7, 15, 16].La pollinisation est anémophile à 80 % etentomophile à 20 % [2]. La pollinisationanémophile a lieu sur des distances trèscourtes [14]. La pollinisation croisée etlibre (7-9 %) donne des résultats supérieurspar rapport à l’autofécondation (0,5 %)[14]. « L’autopollinisation et l’allopollinisa-tion contrôlées ont été réalisées pendanttrois années consécutives chez plusieurs
génotypes. Dans tous les croisements, lenombre moyen de fruits obtenus parautopollinisation est cinq fois moins impor-tant que le nombre de fruits issusd’allopollinisation. Le taux de réussite depollinisation ne dépasse pas 10 % enmoyenne dans les meilleurs des cas chezles fleurs autopollinisées alors qu’il atteint78 % en moyenne chez les fleursallopollinisées. L’autoincompatibilité semblepartielle chez certains génotypes etcomplète chez d’autres » [16].Les fleurs jaunes, seules ou groupées englomérules, sont minuscules (2 à 4 mm) etapparaissent en général en février en posi-tion axillaire sur les rameaux (de l’annéeou des années précédentes) [2]. Ces fleursévoluent en six phases phénologiques[17]. Le pollen est libéré dès le stade 1« bouton floral » (protandrie) et la récepti-vité stigmatique est optimale au stade 3« fleur épanouie » [16]. Le stade 2 « bou-ton floral avec style apparent » évolue enfleur épanouie en un à trois jours et ladurée de vie d’une fleur une fois épanouieoscille entre trois et cinq jours selon legénotype [16].La floraison est maximale de mars à fin mai[2], mais des fleurs peuvent apparaître àn’importe quelle saison (floraison dite« remontante ») avec une pointe en hiver(près de la côte) et au printemps [6].Cette dernière saison est la période laplus favorable [1, 2, 6]. Des observationsdurant trois années successives (1994-1997) dans trois localités (Argana aunord-est d’Agadir, Ait Melloul à l’est, AitBaha au sud-est, distantes d’environ80 km à vol d’oiseau) ont permis deconclure que « quelle que soit l’année, ily a toujours des arbres en fleurs dans cha-cune des trois localités » [16]. En fonctionde leur environnement et de leur génotype,on peut trouver des arganiers précoces,qui peuvent dans certains cas fleurir enoctobre-décembre, et des tardifs, qui fleu-rissent en avril-juin [16].
Figure 2. Enracinement typique, avec unepivo-tante et très peu de radicelles, de deux semisélevés de manière traditionnelle en sachet depolyéthylène de 20 cm de profondeur.Cliché : R. Bellefontaine.
Figure 3. La chair desséchée des fruits de ce clone qui ne s’effrite pas en dizaines de petites par-ticules (fruits situés à gauche) est récoltée pour constituer une réserve alimentaire.
2 Présence et disposition des épines à la surfacegénéralement des branches ou troncs des végé-taux.
3 Protogynie : se dit d’une fleur bisexuée dont legynécée (et donc le stigmate) arrive à maturitéavant que les anthères (partie terminale de l’éta-mine qui produit le pollen) ne s’ouvrent, ce quiempêche l’autogamie (auto-fécondation).
44 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
Pour réaliser des croisements contrôlés,l’émasculation devient obligatoire dès lestade « bouton floral », pour éviter lacontamination par l’autopollinisation.La pollinisation contrôlée de la fleurd’arganier n’est possible que treize joursaprès son émasculation [16].L’arganier peut commencer à fructifier dèsl’âge de 5 ans [1, 2], voire même bienavant. Une quantité très importante de jeu-nes fruits imparfaitement formés tombentavant leur maturité : 11 % des fleurs vontdonner finalement des fruits [18]. Troisphases de chutes de fruits non complète-ment formés ont été remarquées :– 57 % juste après la nouaison (diamètredu fruit < 3,5 mm) ;– une phase de 5 mois – entre la nouaisonet la maturité – pendant laquelle letaux de chute passe de 10 à 1 %(5,2 < d < 16 mm) ;– 2 à 4 % par mois quand le fruit ne grossitplus (d = 17 mm en moyenne) [18].Divers facteurs peuvent en être responsa-bles après la nouaison et avant maturitécomplète : vents desséchants comme lechergui, action mécanique des pluies,parasites, reprise vigoureuse de lacroissance des rameaux, etc. Les fruitssont mûrs en général entre juin etaoût en fonction des conditions environne-mentales.
Semis naturels
Le potentiel de régénération existe, mais lacontribution effective au rajeunissement del’arganeraie reste excessivement ténue.Dès les années 1990, le constat étaitdéjà assez pessimiste : « L’arganier ne serégénère ni naturellement par semis(exceptés quelques cas très rares), ni defaçon artificielle en plantations [2] ».« Dans la quasi-totalité de l’arganeraie,la régénération par semis naturel sousl’arbre ne s’observe plus » [4].Aujourd’hui, en forêt, on ne constate plusguère de semis naturels, sauf exceptionnel-lement en bordure d’oueds ou dans desendroits très protégés : des semis naturelsont pu s’implanter notamment dans lestapis denses d’euphorbes, et sous lesrares jujubiers, tizras, genêts épineux quisubsistent en sous-bois, dans certains mursen pierres sèches (sans doute apportés pardes écureuils).
Semis « tout-venant » en pepiniereet plantations recentes
La production de plants en pépinière a étéétudiée depuis de nombreuses années.Les pépiniéristes marocains ont dorénavantla possibilité de produire dans de bonnesconditions des arganiers « tout-venant »
[7, 19-22] dont les graines ont été achetéessur les marchés, sans connaître l’origineexacte.En pépinière « traditionnelle » (où l’on uti-lise encore des sachets en polyéthylèneavec fond de 15-25 cm de profondeur et7 à 9 cm de diamètre), on remarque peuaprès l’apparition des cotylédons que laracine pivotante a une croissance trèsrapide et mesure en quelques jours 5 à8 cm sans guère développer un cheveluou des racines latérales (figure 2). Le fonddu sachet est atteint par l’extrémité de lapivotante en quelques semaines. Après38 jours, le système racinaire peut mesurervingt fois la longueur de la partie aérienne[8]. Les racines forment alors un chignonou une crosse et les plants sont condamnésà l’échéance de quelques années. Avec cetype de conteneur obsolète, la principaledifficulté pour les pépiniéristes du Hautcommissariat des eaux et forêts et de lalutte contre la désertification (HCEFLCD)est de programmer leurs semis de façonà obtenir des plants ayant une taille suffi-sante de façon coordonnée avec l’arrivéeplus ou moins tardive des pluies et l’avan-cement des chantiers de plantation. C’estune mission quasiment impossible. Or denos jours, l’utilisation de conteneurs horssol, plus adaptés, comme les portoirs rigi-des à alvéoles profondes, permet l’auto-cernage des racines. Ce portoir favorisela formation de racines ramifiées tout aulong de la pivotante (figure 1). Il suffitalors, sur le terrain, d’employer au momentde la plantation des plaques de dépotage
qui rendent le démoulage aisé et n’abî-ment pas les racines. Ce type d’enracine-ment améliorera très vraisemblablementles taux de reprise sur le terrain. Ces por-toirs posés hors sol sur une armature rigidegrillagée sont utilisés au Centre régionalde recherches forestières (de Marrakech,CRRF).Il faudrait dorénavant proscrire les sachetsen polyéthylène de 15-25 cm de profon-deur, ainsi que les plaques alvéolées defaible profondeur (4 à 5 cm) utiliséespour la germination à l’IAV d’Agadir(figure 4) [6]. Cette méthode nécessiteensuite un habillage des racines qui sortentde la mini-motte et dix jours plus tard unrepiquage dans des sachets de 20 cm deprofondeur, ce qui induira la formation dechignons. À l’échéance de 1 à 10 ans, leschances de croissance, voire de survie,d’un plant présentant un chignon sont infi-mes. Cet habillage manuel à l’aide deciseaux aurait cependant l’avantage de sti-muler un important chevelu racinaire prèsdu collet [23].Les plantations réalisées au Maroc depuisfin 2002 dans la région de Tifadine (Tiznit)se basent sur une demande, puis une impli-cation exemplaire, des populations river-aines, car nous n’avons constaté en 2008aucun abroutissement par des caprins àTifadine. Un inventaire du taux de réussitedes quatre premières campagnes de plan-tation y a été effectué en mars 2008 [11].L’espacement varie de 7 x 7 m à 10 x10 m. Il n’y a pas eu de regarnissage desplants morts. Le taux de réussite le plus
Figure 4. Après quelques jours, les racines commencent à tourner au fond de l’alvéole très peuprofonde et forment un chignon qui condamne le plant.Cliché : R. Bellefontaine.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 45
élevé est observé pour la deuxième cam-pagne de reboisement où le nombre deplants vivants atteint après 51 mois plusde 81 %. Les troisième et première campa-gnes ont un pourcentage de réussite d’envi-ron 77 et 74,5 % (respectivement après39 et 63 mois). Le taux de réussite le plusbas est enregistré après 27 mois au niveaude la dernière campagne (2005-2006)pour laquelle le nombre d’emplacementsvides est anormalement élevé (346 sur615 inventoriés, soit un pourcentage de56 %) (tableau 1). Si ces emplacementsn’ont réellement pas été plantés, par exem-ple faute de plants disponibles, alors le tauxgénéral de mortalité pour ces quatreannées s’avère faible – de l’ordre de 5 à7,3 % [11].
Multiplication vegetative
Rejets de souche
Après abattage d’un arganier, des bour-geons situés à la base de la souche sedéveloppent en « rejets de souche ».Ces derniers constituent aujourd’hui detoute évidence et sur toute son aire la prin-cipale voie de régénération de l’arganier.Après une exploitation, on peut ainsidénombrer de 20 à 50 rejets par souche[24], voire plus. Les arganiers surviventaux pires mutilations, mais l’abroutisse-ment répété par les caprins viendrait peuà peu à bout de cette résistance [2]. Cettefaculté de « rejetonnage4 », se maintien-drait au-delà de 200 à 250 ans [1, 2].Dans les années 1960, l’âge d’exploitabi-lité était fixé à 140 ans, ce qui correspon-drait plus ou moins à un diamètre atteignanten moyenne 30 à 35 cm [1], âge auquel laproduction fruitière commence à décroîtresérieusement. La coupe à blanc était suivied’une mise en défens de 10 ans minimum,voire plus (15 ans [4]). Cette mise en défensest en général très mal acceptée par leséleveurs. Il y a 50 ans, les coupes d’amélio-
ration prévues comprenaient d’abord lesdépressages5 des rejets et ultérieurementles éclaircies. Les dépressages devaientêtre pratiqués assez tardivement vers15-20 ans. Quant aux éclaircies, ellesn’étaient pas ou peu pratiquées. Dès lors,les rejets se disposaient en « gobelets »(figure 5) autour d’une même souche [1].On aboutissait ainsi à une futaie surbais-sée, favorisant par là même l’accès àl’abroutissement aérien pour les chèvresen saison sèche, complément indispensablede la vaine pâture. Aujourd’hui, ce dépres-sage indispensable est rarement exécuté,car les superficies sont immenses et lesdébouchés pour les perches sont rares.Cette carence de sylviculture réduit la fructi-fication par manque de lumière et parabroutissement des fleurs ou des jeunesfruits. Dans certaines régions, on peutcependant trouver des arganeraies n’ayantque quatre à cinq brins par souche, ce qui
peut laisser soupçonner des pratiques pri-vées mais interdites (donc peu connues).Aucune recherche n’a été menée à ce jourpour déterminer si un nouveau système raci-naire se développe autour de chaque rejetdépressé, comme c’est le cas pour le châtai-gnier en France [25]. Et ainsi, nul ne peutaffirmer que le rejetonnage constitue unevoie de régénération indéfinie et sansrisque ; en effet, si les rejets ne produisentpas de nouvelles racines autonomes, onpeut craindre qu’après plusieurs rotations lasouche s’épuise définitivement et meure [26].
Drageonnage et rejetsau pied de certains arganiers ages
Tous les chercheurs travaillant dans l’arga-neraie ont observé qu’au pied de certainsarganiers diverses pousses sont parfoisémises par les arbres même s’ils semblentn’avoir jamais été coupés (figure 6). Cetteprofusion de pousses très épineuses rendtoute observation difficile et aucune étuden’a été menée pour déterminer leurorigine. Il pourrait s’agir de drageons[26, 27], ainsi que le suggèrent deuxauteurs [2, 6], sans cependant apporter
Figure 5. Il n’y a pas eu de dépressage et on dénombre une quarantaine de vieux rejets de souche.Cliché : R. Bellefontaine.
Tableau 1. Taux de reussite de quatre campagnes de plantation a Tifadine [11].
Annee (hiver)de plantation
Superficieplantee(ha)
Tauxd’echantillonnage
(%)
Nombre de trousou de plants mesures
Nombre (N) et pourcentage (P en %) de plants ou d’emplacements (trous de plantation)vides de plants
N en vie P en vie N morts P morts N vides P vides
2002-2003 40 5 318 237 74,5 16 5,0 65 20,4
2003-2004 30 5 391 317 81,1 21 5,4 53 13,5
2004-2005 50 5 757 582 76,9 50 6,6 125 16,5
2005-2006 100 3 615 224 36,4 45 7,3 346 56,3
Total 220 - 2 081 1 360 - 132 - 589 -
4 Rejetonnage : néologisme correspondant auterme anglais « resprouting » [26].
5 Le dépressage est une opération qui consisteà couper la plupart des rejets de souche, notam-ment ceux qui sont malingres ou mal conformés,en vue d’améliorer la croissance individuelledes quelques rejets qui sont conservés.
46 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
de preuves : « La régénération par rejets desouches après la coupe, et encore moinscelle qui s’opère par le drageonnage ou lemarcottage, ne peuvent en aucun cas assu-rer la pérennité à long terme de l’écosys-tème à arganier [2] » ; « à la base dutronc, on observe très souvent une régénéra-tion abondante de drageons [6] ». Sur leterrain, à part quelques cas, les drageonsqui apparaissent sur les racines à quelquesmètres du tronc sont assez rares (figure 7).Ces drageons ne semblent pas former desracines adventives et ne s’affranchissentpas. Ils n’acquièrent jamais leur autonomie.Les espèces qui produisent des drageons oudes marcottes affranchis sont très largementminoritaires parmi plus de 875 espècesrecensées [26], puisqu’elles représententmoins de 1 %. L’affranchissement se produitnaturellement par autodégénérescence dela racine mère. « Si les drageons ont leurpropre système racinaire et sont complète-ment indépendants trophiquement (pourl’eau, les sucres et éléments minéraux), ilsdeviennent des individus séparés et autono-mes. Dans ce cas, on peut alors effective-ment parler de multiplication végétative.Rappelons que cette dernière permet,d’une part une duplication asexuée en évi-tant les recombinaisons génétiques et,d’autre part, un affranchissement par rap-port à la plante-mère » [26]. Les drageonsde l’arganier ne doivent pas être confondusavec les marcottes terrestres, car avec devieux arbres, il n’est pas aisé de reconnaître(sans analyse anatomique) une tige (ou une
branche) ensevelie d’une racine partielle-ment mise à nu. Le drageonnage ne peutêtre exploité comme voie de régénérationde l’arganeraie.
Marcottage terrestre
Dans l’arganeraie, cette forme de propaga-tion végétative se révèle plus fréquente quele drageonnage, notamment en bordured’oued, en plaine et dans les sites très ven-teux. Dans ce dernier cas, les arganiers sontcouchéspar les ventsmarins et leurs branchesinférieures s’enracinent et forment alors desmarcottes terrestres. Au bord d’oueds et enzone alluviale, les cépées non dépresséesprésentent des rejets de souche dominantset d’autres dominés ; ces derniers ont souventun développement plagiotrope et peuventêtre recouvertspardessédiments.Desracinesadventives souvent peu nombreuses appa-raissent alors sur ces branches (figure 8).Il semble impossible de tirer profit de cesmar-cottes naturelles pour régénérer l’arganeraie.
Marcottage aerien
La technique la plus courante consiste àentailler l’écorce de branches fines de 1 à2 cm de diamètre, puis à badigeonner lecambium mis à nu avec une hormone (AIB0,4 %). Le type d’entaille ou de blessurevarie selon les espèces, de l’incision légèreà l’annélation complète : certains auteurspréconisent une annélation complète corti-cale sur 1 à 4 cm de long et très peu pro-
fonde [28-30], d’autres une incision légèresur 3 cm tout en laissant l’écorce en place[31], d’autres encore une double incisionsur le haut et le bas du rameau [30, 31].Après le badigeonnage et sans attendre,l’étape suivante consiste à poser un man-chon de substrat entouré d’un plastiquenoir suffisamment épais pour résister auxUV et aux vents, le plastique devant eneffet résister au vent pendant 3 semainespour certaines espèces, mais pendant 4 à5 mois pour d’autres. L’ensemble est liga-turé hermétiquement aux deux extrémités.Parfois, dans les zones semi-arides, desfourmis attirées par l’eau contenue dans lesubstrat occasionnent des dégâts dont il fautse protéger en entourant les deux extrémitésdu manchon de glu (ou de graisse). À l’aided’une seringue, on apportera 10 mm d’eautoutes les deux à quatre semaines en rebou-chant le trou fait par l’aiguille. Le nombre etla qualité des racines adventives néofor-mées dans le manchon sont déterminantespour la survie future de l’arbre. Si elles sontrares et chétives, la marcotte risque de nepas survivre à la période de sevrage.Les avantages des marcottes aériennessont connus : copie fidèle du génotype,précocité de production de fruits, faiblecoût et technicité que les populations rura-les peuvent maîtriser rapidement, etc. Enrevanche, la réhydratation du substrat àl’aide d’une seringue est coûteuse. L’incon-vénient majeur souvent cité est le risque dechablis : après quelques années, si l’enra-cinement adventif est peu dense et ne cor-respond pas aux critères de stabilité del’espèce, l’arbre marcotté est parfois ren-versé par des vents violents.Des essais menés à Agadir à l’IAV [30] ennovembre 1996, poursuivis en juin 1997,ont comparé sur quatre arganiers troistypes de blessure d’un à deux centimètresde longueur :– annélation complète ;– deux incisions, l’une sur la face supé-rieure du rameau et l’autre sur la faceinférieure ;– trois incisions en laissant chaque fois unlambeau d’écorce intact entre les incisions.Ces trois traitements ont été répétés troisfois sur chaque arbre. Pour l’essai denovembre, seuls deux rameaux à doubleincision ont produit chacun une racineunique. Pour le deuxième essai, les dessè-chements des rameaux à annélation com-plète ont été encore plus rapides. Les deuxautres traitements n’ont pas donné de résul-tats positifs ; les auteurs [30, 31] souli-gnent que la saison sèche et chaude n’estpas indiquée pour de tels essais.Des expériences plus récentes, encadréespar l’IAV-Agadir et le Centre de coopéra-tion internationale en recherche agrono-mique pour le développement (Cirad), ontété entreprises en 2007 et 2008. Les tests
Figure 6. Certains arganiers relativement âgés produisent de nombreuses pousses basales (quipourraient être des drageons).Cliché : R. Bellefontaine.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 47
et résultats positifs obtenus en 2007 [32]ont été prolongés durant le printemps etl’été 2008. Ces nouveaux essais [11] ontété effectués sur huit génotypes différents etsur des rameaux ou sur des gourmands àla base du tronc comparant treize traite-ments : en irrigué ou non, avec ou sanshormone, comparaison de trois substrats(tourbe, mélange de tourbe et de fibre decoco, sphaigne du Chili). Faute de moyensfinanciers, ces essais ont été réaliséssans dispositif statistique strict. Au total,170 marcottes avec incision simple ontété mises en place durant les mois demars et de mai 2008. Sans pouvoir tirerdes conclusions définitives du fait du dispo-sitif, des observations intéressantes permet-tent de mettre en exergue que trois à qua-tre mois après le marcottage, des racinesadventives vigoureuses et ramifiées appa-raissent principalement dans le substrat àbase de sphaigne du Chili et sur rameaujeune (figure 9). D’après de récents essaisau Burkina Faso [33, 34], la sphaigne duChili saturée en eau est le substrat le plusapproprié pour marcotter les rameaux desdiverses espèces. Il semble également sedégager de ces essais sur arganiers [11]que certains génotypes (arbre n° 3) se mar-cottent assez aisément, alors que d’autresparaissent récalcitrants. Parmi les dixrameaux marcottés de l’arbre n° 3, sixont produit de nombreuses racines et ontété transplantés dans des récipients de10 litres dans un substrat plus riche. L’irri-gation durant les mois secs a favorisésemble-t-il l’induction de racines adventi-ves. Au final, en juillet 2008, huit marcot-tes (4,7 %) ont pu être transplantées [11].
Bouturage
Les techniques ont bien évolué depuis lespremiers essais réalisés en 1976 à lastation de recherches forestières de Rabat[35]. En 1994, une technique innovantepour l’arganier [13] a été mise au pointet reprise en 1998 [15] : de jeunesrameaux (diamètre non précisé) sont préle-vés sur des arbres sélectionnés, puis trans-portés au laboratoire dans une glacièretapissée d’un linge humide, puis découpésen tronçons de 8 à 10 cm de long. Les feuil-les de la base sont éliminées. Lavées àl’eau du robinet, les boutures sont ensuiteplongées pendant 10 minutes dans unesolution d’eau distillée stérile à 10 %d’eau de Javel et à 5 mL d’agent mouillant(Pax) par litre, puis rincées avec de l’eaudistillée stérile. Les boutures sont ensuitetraitées pendant cinq minutes par unesolution d’AIB à 5 000 ppm préalablementstérilisée. Enfin, elles sont placées dansdes pots de culture remplis de 50 g devermiculite, qui ont été préalablement arro-sés jusqu’à saturation avec la solution de
Figure 7. Surplombant une route, cet arganier montre des racines déchaussées par l’érosion. Surl’une d’entre elles (cercle rouge), on remarque un drageon qui n’est pas autonome (agrandi dansle coin droit).Cliché : R. Bellefontaine.
Figure 8. Au bord de l’océan, les branches d’arganiers couchés par les vents s’enracinent. Onvoit, sous la branche (à la pointe du stylo), la section d’une racine cassée.Cliché : R. Bellefontaine.
48 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
Long-Ashton et autoclavés pendant 1 heureà 120 °C. Sur les trois têtes de clones tes-tées à Argana et pour trois périodes debouturage (décembre 1994, mai 1995,mars 1996), au final 44 boutures sur260 se sont enracinées en deux à troismois [15]. La plupart des boutures qui nese sont pas enracinées étaient contami-nées. Le maximum de boutures obtenuesl’a été en mars 1996 avec la tête declone G2f avec 15 boutures enracinéessur 50 (30 %) en deux mois [15]. Pourde nombreux plants enracinés, une crois-sance plagiotrope avec une dominanceapicale insuffisante a été constatée.Cependant, une croissance orthotrope aété observée pour quelques bouturestransplantées dans de grands pots enmai 1996 et leur hauteur moyenneétait respectivement après 14 mois et21,5 mois de 1,3 et 1,75 m [13, 15].Les différences de pourcentage d’enracine-ment dépendent avant tout du clonemultiplié et du substrat [13, 15]. Le tauxd’enracinement le plus élevé l’a été avecun substrat à base de « terragreen » (subs-trat inerte à base d’argile calcinée désin-fectée), qui est supérieur à la vermiculite etau substrat siliceux.D’autres essais de bouturage menés àl’IAV à Agadir en juillet-août 1996, enmars-avril 1997 et de janvier àavril 1998 ont testé divers paramètres surrespectivement 72, 72 et 81 (soit 225)boutures [31]. Une dizaine d’entre elles(prélevées sur des rejets de souche) ontémis en moyenne deux à quatre radicelles.Malheureusement, les résultats de cesessais, réalisés avec un petit nombre deboutures pour chaque traitement, ne per-mettent aucune conclusion fiable.
Entre fin décembre 1997 et débutmai 1998, des boutures de tête de 5 cmde longueur ont été prélevées sur du maté-riel jeune (rejets d’arganiers) et placées àl’IAV d’Agadir en serre dans un substratunique (un volume de tourbe noire pourun volume de sable grossier) sous unehumidité relative de l’air supérieure à60 % et une température voisine de30 °C [36]. Les boutures proviennent detrois rejets différents. Ni le nombred’arbres (sans doute un seul ?), ni celuide boutures testées par rejet ne sont men-tionnés. Il ressort de ces essais qu’un trem-page pendant cinq secondes dans de l’AIBà 500 ou 1 000 ppm améliorerait la néo-formation de radicelles. Sept mois après lebouturage, l’auteur observe un tauxd’enracinement de 57, 85 et 91 % respec-tivement pour les rejets 1 à 3. Il note éga-lement de six à dix radicelles de 15 à18 centimètres de long par bouture. L’enra-cinement ne débute qu’à partir du 45e jourchez le rejet le plus apte à la rhizogenèse.Le bouturage effectué au mois de mai per-met d’obtenir un taux d’enracinementassez élevé. Ne connaissant pas exacte-ment le nombre de boutures par traitement,ni a fortiori le nombre total de bouturesréalisées, ces informations [36] ne peuventêtre érigées au titre d’itinéraire techniqueformel à suivre.En juillet puis en septembre 2001, deuxessais de boutures semi-lignifiées traitéesavec l’AIB (1 000 ppm pendant 5 secondes)provenant de 30 et 20 génotypes respecti-vement ont été mis en place sous une mini-serre avec des brumisations quotidiennes àl’université d’Agadir. Pour chaque géno-type, 28 boutures (ramets) sont récoltées.Au total, la reprise de 1 400 boutures aété testée. Après une phase d’acclimata-
tion, les deux essais ont permis d’obtenir12 et 18 boutures (respectivement aprèstrois mois, soit en septembre, et après cinqmois, en janvier 2002) Dans ces conditionsnotamment de brumisation, l’auteur déduitque le bouturage automnal est meilleur, cartous les génotypes ont émis des cals et 45 %des racines [21].Entre 2007 et 2009 dans le cadre d’unprojet CRRF-Cirad [37], il a été observésur près de 1 800 boutures herbacées(figure 10) que le bouturage de ramets pré-levés sur de jeunes plants (ou mieux sur dejeunes semis) est assez aisé si on disposed’un système de brumisation adapté etd’une technique adéquate.Dès qu’il s’agit de matériel végétal âgé, lesréussites deviennent beaucoup plus rares[4, 37]. Or les « arbres plus », sélectionnéspar les populations sur la base de diverscritères, ont fréquemment un diamètrevariant de 30 à 80 cm. La dendrochrono-logie ne permet pas de mesurer leur âge :« On peut donner à un arbre adulte de30 cm de diamètre… un âge approximatifde 130 à 150 ans » [1]. Pour les essaisCRRF-Cirad sur arbres âgés, 1 400 rametsont été prélevés sur 14 génotypes diffé-rents des régions d’Agadir et d’Essaouira,puis ont été bouturés ou greffés. Fin 2009,dans la pépinière du CRRF, la mobilisationde 10 têtes de clones très âgés sur les 14retenues au début du projet a été obtenue[37], ce qui prouve qu’avec un itinérairetechnique adapté, la mobilisation des meil-leurs génotypes pour l’un des critères citésau chapitre suivant est dorénavant pos-sible. Les essais continueront en 2010 ;une publication est en cours. Conformé-ment à ce qui est dit dans la littératureinternationale, il semble que, pour lesarganiers très âgés, les prélèvements dematériel végétal jeune prélevé près de lasouche (ramets en bon état physiologique)sur des drageons, sur des gourmands oudes rejets émanant de la base du tronc(figure 6) sont à conseiller.
Greffage
De juillet 1996 à mars 1998, des essaisde greffage portant sur huit à seize porte-greffes lors de chaque essai ont été réalisésà l’IAV d’Agadir [30, 31] suivant diversesméthodes : par fente apicale, par appro-che, par écusson. Au total, 136 greffesont été effectuées en juillet et novem-bre 1996, en février, juin, novem-bre 1997 et en mars 1998. Les 24 greffesen écusson tentées en novembre 1996 enplein air sur un arbre âgé et parallèlementen serre avec des jeunes porte-greffes ensachets n’ont donné aucun résultat positif.Les auteurs en déduisent que le greffagepar approche et le greffage par fente api-cale sont les deux méthodes les mieux
Figure 9. Racines obtenues un mois après le sevrage d’une marcotte aérienne d’arganier poséeen mars et sevrée fin juin 2008.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 49
adaptées à l’arganier : leurs meilleurspourcentages de réussite sont obtenus ennovembre 1997 et mars 1998 par gref-fage « sous vitre » [31], à humidité satu-rante et avec chauffage de fond. Les coupeshistologiques montrent qu’une semaineaprès la greffe, l’union des vaisseaux vas-culaires est réalisée, mais après cinq mois,il peut subsister parfois des zones de non-contact. Le greffage en fente apicale néces-site une humidité saturante, supérieure à85 % et une température moyenne com-prise entre 20 et 25 °C [31]. La phased’acclimatation reste la phase cruciale ;elle ne peut avoir lieu que pendant despériodes où la température diurne estencore fraîche. Vu le nombre réduitd’essais, effectués de surcroît lors de sai-sons différentes, il est difficile d’extrairede ces essais des informations précisesquant à la technique et à la saison optimalede greffage.Des recherches sur le greffage ont été entre-prises de 2007 à 2009, et continueront en2010, au CRRF avec le concours du Cirad.Plus de 1 200 greffes, principalement enfente terminale, ont été tentées à diversessaisons le plus souvent en ambiance confi-née. Les résultats sont en cours d’analyse etun article sera publié prochainement.Les figures 11 et 12 montrent que la mobili-sation ex situ de vieux génotypes âgés de200 à 400 ans est possible par greffageen fente terminale et en écusson sur desporte-greffesâgésdequelquesmois.Cesder-
niers doivent être, au moment du greffage,en plus forte activité physiologique que lesgreffons. Les conditions climatiques àMarra-kech sont plus continentales que celles de lazone côtière naturelle de l’arganier, indui-sant un décalage d’activité physiologiqueentre les greffons et les porte-greffes.Ces der-niers peuvent souffrir du froid en hiver et êtredès lors en repos végétatif, ce qui condamnele greffage à cette saison à Marrakech.Des différences de maturité des tissus misen contact, ainsi que des conditions de trans-port des greffons de leurs sites naturels(régions d’Agadir et d’Essaouira), peuventégalement expliquer les faibles taux actuelsde réussite après sevrage. Les conditions degreffage (notamment pour éviter tout stresshydrique post-greffage des greffons), desevrage et d’endurcissement sont encore àaffiner. Legreffage en écusson semble cepen-dant être laméthode à préconiser, car elle estplus simple, mais la difficulté majeure est dedéterminer la périodeoptimale,mais fugace,de l’année pendant laquelle l’écorce desporte-greffes se détache sans difficulté, afinque l’union tissulaire entre greffon et porte-greffe se réalise au plus vite.
Micropropagation
Lamicropropagation sur l’arganier a débutéen 1987 [6] avec des milieux de culture etrégulateurs de croissance disponibles àl’époque : plusieurs essais ont produit descals. En1994, les étudesdemicrobouturage
d’une autre équipe [13] avaient permisd’obtenir 4 explants sur 28. De 1994 à2004, plusieurs essais ont à nouveau eulieu à l’IAV d’Agadir avec un protocole quiest décrit dans le livre leplus récent sur l’arga-nier [6]. Selon Kenny, la formation de raci-nes est la phase la plus délicate. Les diversesexigences nutritionnelles et environnementa-les à différentes époques de l’année ne sem-blent pas encore parfaitement au point, cequi se traduit par la production « de beau-coup de cals. De plus, l’induction de racinesne commence qu’à partir de la cinquièmesubculture et ce n’est que vers la dixièmeque le taux d’enracinement atteint les70 % » [6]. Kenny affirme qu’il subsisteencore de nombreux problèmes à régler :nécrose apicale, cal, absence de racinessecondaires, contamination, blocage del’allongement racinaire, acclimatation desvitro-plants.À l’Institut national de la recherche agrono-mique (Inra) de Dijon, les essais ont portésur du matériel végétal non lignifié prove-nant de pieds mères âgés d’1 à 3 ans,élevés en serre à Dijon. Ces pieds mèresproviennent de 28 ortets sélectionnés auMaroc. Le protocole de production demicroboutures [4, 7] préconise le milieude Murashige et Skoog (ou milieu MS)qui induit un bon développement de pous-ses de plus de 5 cm chez certains clones[7]. D’autres clones montrent des taux demultiplication faibles et ont des apex nécro-sés sur divers milieux testés. Quand les
Figure 10. Quatorze semaines après sa mise en terre, photo de l’enracinement d’une boutureherbacée d’arganier « tout-venant » au Centre régional de recherches forestières (CRRF)de Marrakech.Cliché : R. Bellefontaine.
Figure 11. Greffe en écusson, réalisée le 29mai2008et photographiée huitmois plus tard(tête de clone n° 9).Cliché : R. Bellefontaine.
50 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
microboutures s’enracinent dans des tubescontenant du « terragreen » à la place del’agar, le niveau d’enracinement est biensupérieur, prouvant par là que l’arganierest plus sensible aux propriétés du substratqu’à sa composition chimique [7]. Il restelà encore de sérieux problèmes techniquesà régler.
Criteres de selection des arganiers
D’un point de vue économique, les produitsprincipaux de l’arganeraie sont l’huile ali-mentaire et les troupeaux de chevreaux (etdonc la production de fourrage aérien oude tourteau). Ils conditionnent la stratégiede développement durable de l’argane-raie. Le prix du litre d’huile a augmentétrès rapidement au cours des cinq à septdernières années et l’amélioration variétaledoit en tenir compte de manière prioritaire.L’objectif principal actuel est la productiond’huile de qualité. Mais cette filière seulen’est pas viable à long terme. Parallèle-ment, la filière « fourrage », mais aussi lesfilières médicinales, cosmétiques et chimi-ques ne doivent pas être négligées. Unsuivi quotidien d’un troupeau de chèvresa démontré que la contribution fourragèretotale des arganiers (feuilles, fleurs, pulpede fruits) varie de 47 à 84 % selon les sai-sons [38]. Ce « pâturage suspendu » four-nirait chaque année 320 millions d’unitésfourragères [8].
Dans ces régions arides et semi-arides, unautre aspect primordial est la production declones résistants et à croissance juvénilerapide afin d’écourter au maximum lesmises en défens des périmètres récemmentplantés. L’idéal serait de sélectionner, avecle concours des populations et des scientifi-ques, des génotypes représentant correcte-ment la variabilité génétique et répondantaux principaux critères énumérés ci-dessous :– résistances diverses (sécheresses, mala-dies, etc.) et adaptabilité suffisante desgénotypes sélectionnés comme têtes declones (donc in fine des clones produits) ;– système racinaire puissant assurant unevigueur végétative et une croissance juvé-nile rapide des clones ;– qualité de l’huile en fonction des géno-types (ou des provenances) ;– caractère inerme de certains arganierspermettant une récolte sur pied au momentoptimal afin d’obtenir une huile de qualité(et non pas sous l’arbre quand les fruitssont trop mûrs) ;– finesse des coques de la noix : certainsgénotypes produisent des coques qui secassent plus facilement lors du concassagemanuel [15] ;– bons rendements en huile de qualité ;– importante productivité annuelle en fruitspendant une période de vie assez longue ;– entrée en fructification après trois ans aulieu des10-15années connues actuellement ;– précocité dans la saison de fruits mûrs(huile de primeure au prix de vente plusélevé) ;
– production « remontante » de fruits assu-rant deux récoltes par an.Les caractéristiques suivantes devraientégalement être prises en compte pour lesautres filières énoncées ci-dessus :– caractéristiques favorables du fourragefoliaire pour les caprins et dromadaires ;– composition chimique de la pulpe (aci-des gras, tocophérols, etc.) et des feuillesdes rejets de souche (gamme de cosméti-ques, etc.) ;– caractéristiques favorables du tourteaupour le bétail ou la volaille.
Conclusion
Les espèces ligneuses sont, sauf exception,des espèces peu ou non domestiquées.Seule une infime minorité d’entre elles secaractérisent par une création variétale fon-dée sur l’amélioration de populations parcycles de récurrence favorisant la recombi-naison. L’évaluation des aptitudes à la com-binaison et l’identification de critères phé-notypiques ou moléculaires de sélectionprécoce ne sont en cours d’étude actuelle-ment que pour de rares ligneux, dont l’arga-nier ne fait pas partie. Pour ce dernier, iln’existe aujourd’hui en recherche forestièrequ’un effort6 pour la sylviculture et le clo-nage d’« individus plus » par multiplicationvégétative.La nécessité de développer des conserva-toires et vergers ex situ et de maintenir desactions in situ pour conserver et gérer ladiversité actuelle - en voie de réductionrapide - est érigée en priorité nationale sil’on s’en réfère au Plan Maroc Vert datantde 2008, d’autant plus que l’arganeraiea été déclarée Patrimoine mondial del’Unesco en 1999. L’arganeraie de plainea été souvent coupée et remplacée par descultures d’agrumes et de légumes sousserre. Depuis peu, les pompages excessifsdans la nappe phréatique condamnent lesplantations d’agrumes [8] qui depuis quel-ques années sont déracinées [10] dansle Souss. Dans cette plaine, l’arganierpourrait avoir un second avenir s’il estcultivé en mélange avec des plantes médi-cinales, aromatiques ou plantes à latex(Parthenium argentatum, le guayule) ensous-étage.Pour faire face aux nouvelles contraintesenvironnementales des décennies à venir,dans l’arganeraie notamment, les ressour-ces génétiques sont la source essentielle derichesses à protéger, puis à exploiter parla sélection, pour permettre d’améliorer lesaptitudes des « arganiers plus » préservéspar les populations rurales. Aucune variété
Figure 12. Mobilisation ex situ, par greffe en fente terminale, de la tête de clone n° 4, qui serautilisée comme pied mère.Cliché : R. Bellefontaine.
6 Si l’on ne prend pas en considération lesautres études chimiques, médicales, socio-économiques.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 51
n’a été domestiquée à ce jour. Compren-dre l’origine de ces « formes » adoptées etvraisemblablement préservées, mettre enplace des bases de données sur leur poly-morphisme, et approcher finement lacaractérisation par les méthodes récentesde phénotypage, sera la prochaine étapepour améliorer l’arganeraie. Concevoir àquel taux et par quel mécanisme se génèrela diversité génétique dans les populationsactuelles « naturelles », mais influencéespar l’homme, appréhender la manièredont la sélection sur les phénotypes vamodifier la structure et l’évolution de lavariabilité génétique, voilà quelques-unsdes problèmes que devront résoudre lesgénéticiens marocains.Beaucoup d’informations manquentencore à ce jour, notamment pour la pro-duction de boutures de nombreux géno-types à mobiliser dans les futurs vergers àgraines (et éventuellement à commerciali-ser dans le cadre de plantations privées) :rajeunissement physiologique optimal enpartant d’arganiers âgés de 200 à400 ans – voire plus, rapidité de la crois-sance juvénile aérienne et racinaire, résis-tance aux chablis, gestion satisfaisante despieds mères, etc. Les techniques de multi-plication préconisées dans cet article per-mettront par ailleurs de sauvegarder desindividus précieux, rares et isolés.La production de graines de qualité supé-rieure reste une démarche parallèle priori-taire à mener, par exemple en créant unverger à graines - isolé de toute pollutionpollinique - destiné à la production deplants pour les services forestiers et d’éven-tuels privés. On a vu plus haut que leHCEFLCD a augmenté la cadence annuellede plantation d’arganiers au cours des sixdernières années et que les techniques deplantation doivent encore être légèrementaméliorées. Mais les résultats de Tifadinemontrent à l’évidence que les soins appor-tés au moment de la plantation et les arro-sages durant la première année sont vitauxpour assurer la reprise et un bon dévelop-pement des arganiers. Il sera indispen-sable d’améliorer à la fois la sylviculture(fertilisation, associations symbiotiques,élagage juvénile éventuel en vue d’aug-menter la production quantitative de fruits,etc.) et la vitesse de croissance juvénile desplants afin de ne pas décevoir les popula-tions par des mises en défens trop longuesempêchant le parcours par les troupeaux.La durée de ces mises en défens seraréduite dès que les utilisateurs planterontdes plants ou des clones à croissance juvé-nile rapide produits par des techniquesmodernes de portoirs alvéolés hors solavec autocernage automatique des raci-nes, car ces plants disposeront alors d’un
enracinement puissant et dense qui devraitleur permettre d’explorer rapidement leshorizons inférieurs.■
Références
1. Boudy P. Monographies et traitements desessences forestieres, fascicule 1. Economie fores-tiere nord-africaine, Tome 2. Paris : Larose,1950.
2. M’hirit O, Benzyane M, Benchekroun F,El Yousfi SM, Bendaanoun M. L’arganier. Uneespece fruitiere-forestiere a usages multiples.Sprimont (Belgique) : Mardaga, 1998.
3. Alifriqui M. L’ecosysteme de l’arganier. Paris :Pnud (Programme des Nations unies pour leDeveloppement), 2004.
4. Nouaim R. L’arganier au Maroc : entre mytheset realites. Paris : L’Harmattan, 2005.
5. El Aıch A, Bourbouze A, Morand-Fehr P. Lachevre dans l’arganeraie. Rabat : Institut Agrono-mique et Veterinaire; Actes Editions, 2005.
6. Kenny L.Atlas de l’arganier et de l’arganeraie.Agadir : Institut Agronomique et Veterinaire,2007.
7. Nouaim R, Mangin G, Breuil MC, Chaussod R.The argan tree (Argania spinosa) in Morocco:Propagation by seeds, cuttings and in-vitro tech-niques. Agrofor Syst 2002 ; 54 : 71-81.
8. Tarrier MR, Benzyane M. L’arganeraie maro-caine se meurt : problematique et bio-indication.Secheresse 2003 ; 1E : 60-2.
9. Benismail MC, Mokhtari M. La domesticationde l’arganier : vers une exploitation rationnelleet durable de l’espece Argania spinosa L. Skeels.Ann Rech For Maroc 2007 ; 38 : 197-206.
10. Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa. Etude de revision du Plan Directeurd’amenagement Integre des Ressources en Eau(PDAIRE) des bassins du Souss – Massa. MissionI : Collecte des donnees, diagnostic et evaluationdes ressources en eau et etat de leur utilisation.Volume 7 : Etat de l’environnement et demandeen eau environnementale. Rapport definitif. Aga-dir : Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa, 2008.
11. Bouiche L. Etude des modes de regeneration afaible cout de l’arganier (Argania spinosa) auMaroc.Master II « Bioress en Reg Trop etMediter,universite de Paris XII, 2008.
12. Echairi A,NouaimR,ChaussodR. Interet de lamycorhization controlee pour la production deplants d’arganier (Argania spinosa) en conditionsde pepiniere. Secheresse 2008 ; 19 : 277-81.doi : 10.1684/sec.2008.0147.
13. Nouaim R. Ecologie microbienne des solsd’arganeraie (S.O. marocain) : activites micro-biologiques des sols et role des endomycorhizesdans la croissance et la nutrition de l’arganier(Argania spinosa (L.) Skeels). These d’Etat, Uni-versite Ibn Zohr, Agadir, 1994.
14. Nerd A, Irijimovich V, Mizrahi Y. Phenology,breeding system and fruit development of argan(Argania spinosa, Sapotaceae) cultivated inIsrael. Econ Botany 1998 ; 52 : 161-7.
15. Kaaya M. Contribution a la domestication del’arganier : selection et multiplication. These,faculte des sciences, universite Ibn Zohr, Agadir,1998.
16. Benlahbil S. Pollinisation naturelle et artifi-cielle de l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels).These, faculte des sciences, universite Ibn Zohr,Agadir, 2003.
17. Bani-Aameur F. Phenological phases ofArga-nia spinosa (L. Skeels) flower. ForGenetics2000 ;7 : 329-34.
18. Benismail MC, Benzaki ME. Aptitude fructifereet de ramification du jeune rameau chez l’arganier(Argania spinosa L. Skeels). Colloque internationalsur les ressources vegetales : « L’arganier et lesplantes des zones arides et semi-arides », Agadir,23-25 avril 1998.
19. Bouzoubaa Z, El Mousadik A. Effet de la tem-perature, du deficit hydrique et de la salinite sur lagermination de l’Arganier - Argania spinosa (L.)Skeels. Acta Bot Gal 2003 ; 150 : 321-30.
20. Tazi MR, Berrichi A, Haloui B. Effet du polye-thylene glycol sur la germination et la croissancein vitro de l’arganier (Argania spinosa L. Skeels)des Beni-Snassen (Maroc oriental). Secheresse2003 ; 14 : 23-7.
21. Alouani M. Regeneration de l’arganier(Argania spinosa (L.) Skeels) : protocole de pro-duction de plants de semis et par bouturage etreussite de la transplantation. These, faculte dessciences, universite Ibn Zohr, Agadir, 2003.
22. Alouani M, Bani-Aameur F. Argan (Arganiaspinosa (L.) Skeels) seed germination under nur-sery conditions: effect of cold storage, gibberellicacid and mother-tree genotype. Ann For Sci2004 ; 61 : 191-4.
23. Benismail MC, Benzaki ME. Conditions deproduction rapide de plants par semis chezl’arganier (Argania spinosa L. Skeels). Colloqueinternational sur les ressources vegetales :« L’arganier et les plantes des zones arides etsemi-arides », Agadir, 23-25 avril 1998.
24. Belghazi B, Ezzahiri M, El Kharouider A,Belghazi T. Bilan des nouveaux recepages de l’ar-ganeraie d’Ida ou Throuma (Tamanar) : vitessede croissance des rejets et vigueur des souchesen relation avec le milieu. Ann Rech For Maroc2007 ; 38 : 106-23.
25. Bourgeois C, Sevrin E, Lemaire J. Le chatai-gnier : un arbre, un bois. Paris : Institut pour leDeveloppement Forestier, 2004.
26. Bellefontaine R. Pour de nombreux ligneux, lareproduction sexuee n’est pas la seule voie : ana-lyse de 875 cas – Texte introductif, tableau etbibliographie. Secheresse 2005, 3E www.seche-resse.info/article.php3?id_article=2344
27. Bellefontaine R, SabirM,KokouK, et al.Argu-mentaire pour l’etude et l’utilisation des marcotteset drageons dans les pays a faible couvert ligneux.Secheresse 2005, 3E, www.secheresse.info/article.php3?id_article=2343
28. Meunier Q, Bellefontaine R, Boffa JM,Bitahwa N. Low-cost vegetative propagation oftrees and shrubs. Technical Handbook for Ugan-dan rural communities. Kampala (Ouganda);Montpellier (France) : Ed. Angel Agencies;Cirad editions, 2006.
52 Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010
29. Meunier Q, Bellefontaine R, Monteuuis O. Lamultiplication vegetative d’arbres et arbustesmedicinaux aubenefice des communautes ruralesd’Ouganda. Bois For Trop 2008 ; 296 : 71-82.
30. Mokhtari M, Zakri B. Limites phytotechniqueset physiologiques au bouturage, marcottage etgreffage de l’arganier (Argania spinosa L.Skeels). Colloque international sur les ressourcesvegetales : « L’arganier et les plantes des zonesarides et semi-arides », Agadir, 23-25 avril1998.
31. Mokhtari M. Le greffage de l’Arganier. Unchallenge pour la multiplication clonale. BullMens d’Info et Liaison du PNTTA (ProgrammeNational de Transfert de Technologie en Agricul-ture, Rabat), 2002 ; 95 : 3-4.
32. Saibi L.Multiplication vegetative de l’arganier(Argania spinosa (L. Skeels). Master II « Bioressen Reg Trop et Mediter », universite Paris XII,2007.
33. Ricez T. Modes de regeneration a faible coutde Prosopis africana etDetariummicrocarpum enforet classee de Dinderesso. Master II « Bioress enReg Trop et Mediter », universite Paris XII, 2008.
34. Zouggari A. Regeneration et domesticationd’especes ligneuses utilisees dans l’artisanatd’art dans l’Ouest et le S-Odu Burkina Faso.Mas-ter II « Bioress en Reg Trop et Mediter », universiteParis XII, 2008.
35. Platteborze A. Premier essai de bouturagede l’arganier a partir d’arbres adultes. Rabat :Station de Recherches Forestieres, 1976.
36. HarrouniMC.Multiplication de l’arganier parbouturage. Bull Mens d’Info et Liaison du PNTTA(Programme National de Transfert de Technolo-gie en Agriculture, Rabat) 2002 ; 95 : 2-4.
37. Bellefontaine R, Monteuuis O, Ferradous A,Alifriqui M. Bilan apres 26 mois du Projet Produc-tion de plants clones d’arganier. Montpellier :Cirad-Bios, 2009.
38. El Aich A, Bourbouze A, Morand-Fehr P. Lafiliere chevreau de l’arganeraie, un produittypique et durable. Ann Rech For Maroc 2007 ;38 : 124-37.
Sécheresse vol. 21, n° 1, janvier-février-mars 2010 53