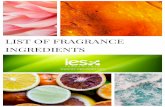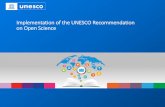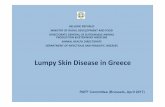Bâtisseurs d'Empires. Présentation
Transcript of Bâtisseurs d'Empires. Présentation
Extraits de :
Alessandro Stanziani, Bâtisseurs d’Empires. Russie, Inde et Chine à la croisée des mondes.
Paris, Liber, 2012
Dans les steppes d’Asie centrale autant qu’en Inde, le ravitaillement des chevaux et des hommes est tout aussi important que la qualité des sabres. La bataille d’Ulan Butong oppose 10 000 Dzoungars (30 000 suivant d’autres sources) à deux armées mandchoues (soit 5 000 hommes) ; le siège de Gingee par les Moghols implique environ 40 000 soldats, des dizaines de milliers de chevaux et de dromadaires, et des centaines d’éléphants. Ces affrontements ont lieu à des centaines, parfois des milliers de kilomètres des villes et des pâturages. D’où venaient les approvisionnements nécessaires ? Les steppes ne sont-elles pas synonymes de territoires désertiques et de populations nomades ? Et où l’Inde, que nous décrivons toujours surpeuplée et sous-alimentée, trouvait-elle, en 1690, ces immenses ressources ?
Le point de départ et le fil directeur de cet ouvrage est donc tout simple : de quelle manière Russes, Chinois et Moghols ont-ils, chacun à leur manière, réglé le problème de l’approvisionnement des armées dans les steppes et lors des sièges dans des régions périphériques ? Il s’agit d’un fil apparemment ténu qui ouvre en réalité très vite sur des questions beaucoup plus larges : la production et l’acheminement des denrées, le stockage et le transport des produits, la colonisation de territoires vastes et éloignés.
Les hommes et les chevaux doivent se nourrir. À cette fin, les steppes russes et mongoles, les « terres noires » du centre de la Russie, ainsi que les régions agricoles de la Chine et les plaines du Gange sont mises à contribution. Cependant, les manières d’obtenir des chevaux et du fourrage dans la steppe, du riz et du blé dans les régions fertiles d’Inde et de Chine ne répondent ni aux mêmes contraintes ni aux mêmes logiques qu’en Europe. Les pluies, la mousson, la sécheresse conditionnent les vies des paysans et des seigneurs, des citadins, mais aussi le recrutement et l’approvisionnement des armées. À son tour, la disponibilité en chevaux renvoie à un élément crucial de l’histoire mondiale : la présence d’élevage, d’une part, les connaissances techniques, d’autre part. Les chevaux sont l’arme la plus redoutable dans les steppes ; leur élevage à large échelle requiert des pâturages incompatibles avec l’agriculture intensive, de vastes espaces et une organisation sociale qui assigne aux cavaliers et aux éleveurs un rôle dominant par rapport aux agriculteurs sédentaires. Ces conditions ne sont pas toujours réunies. Le cas échéant, le commerce des chevaux peut suppléer au manque d’élevage sur place. Encore faut-il avoir quelque chose à offrir aux éleveurs et vaincre la concurrence d’autres acheteurs potentiels. Dans l’édification des empires eurasiatiques, la lutte pour les chevaux est impitoyable. Chinois, Russes et Moghols auront dès lors à se confronter entre eux mais aussi avec les peuples des steppes, les éleveurs mongols. Qui parmi les Chinois, les Russes et les Moghols aura le mieux réussi dans ces opérations et pour quelles raisons ?
Finalement, l’organisation militaire exige une discipline, une administration fiscale et un système de recrutement. Ce dernier peut avoir comme cible des mercenaires, des élites guerrières, des cavaliers nobles, des soldats paysans. En Inde, des guerriers ascètes combattent à côté de paysans affamés et des
cavaliers rajput ; dans les steppes d’Asie centrale, les Cosaques déferlent à côté des Nogays1 (une confédération de tribus turques et mongoles), véritables nomades, et de paysans russes cachés derrière les fortifications en bois ; en Chine enfin, ou plutôt dans sa partie nord-occidentale, des paysans han, des criminels ordinaires et des guerriers mandchous organisés en bannières sont confrontés aux hordes dzoungars. Tous doivent être rémunérés alors même que leur emploi détourne des ressources monétaires, alimentaires et des bras qui pourraient être consacrés à d’autres occupations. Tout l’équilibre social est concerné. Les formes du recrutement et de la gestion des soldats, leurs équipements et approvisionnements s’ancrent dans le tissu social, dans les formes des institutions politiques et, bien entendu, dépendent de l’accès aux ressources disponibles. Les relations entre paysans, seigneurs, soldats et administration constituent ainsi une architecture complexe et réglée.
Voici que le petit fil directeur initial conduit à interroger l’origine et le fonctionnement de trois empires parmi les plus puissants de l’histoire de l’humanité : la construction impériale, son fondement social et économique et ses dynamiques sont à la base de l’organisation militaire. En même temps, il ne suffit pas d’identifier des questions et des variables pertinentes, encore faut-il voir quand elles le sont et pour quelles raisons. Les siècles compris entre le XVIe et le XVIIIe sont ceux de l’expansion maximale des trois empires qui, au contraire, montrent par la suite des signes de faiblesse, d’abord en Inde, vers la fin du XVIIIe siècle, puis, au siècle suivant et, dans une moindre mesure, en Chine. La Russie, elle, tirera son épingle du jeu jusqu’à la Première Guerre mondiale. Ces dynamiques méritent une explication : pourquoi des stratégies gagnantes au XVIe, au XVIIe et, en partie, au XVIIIe siècle se révèlent-elles inadaptées par la suite ? Pour quelles raisons les Russes ont-ils tenu plus longtemps que les Indiens et les Chinois face à l’émergence des pouvoirs occidentaux ?
Mon point de vue provient de mes travaux sur l’histoire russe ; je suis habitué à me poser des problèmes en termes d’autocratie et de servage ; cependant, en 1689, à Nertchinsk, si loin de Moscou et de Saint-Pétersbourg, comment ces éléments auraient-ils pu jouer un rôle face aux Chinois ? Pierre n’est même pas tsar de Russie ; des paysans venus de loin, du cœur de la Russie, mal armés, accompagnent la délégation russe. L’occupation des steppes n’est pas simple à mettre en pratique. Ce n’est pas dans le pouvoir du nombre (la population chinoise ou indienne), ni dans l’étendue du territoire (cette dernière étant plutôt le résultat que la cause) et encore moins dans leur caractère « despotique » qu’il faut chercher la force des Empires russe, chinois et moghol, leurs différentes évolutions ainsi que le résultat de leur confrontation avec l’Occident. Ainsi, certains éléments sont communs aux trois empires : leur capacité à intégrer des ethnies et des religions différentes, leur aptitude à mobiliser des ressources agricoles et militaires, l’importance du commerce, des organisations bureaucratiques complexes. Les différences sont tout aussi remarquables : les Chinois développent davantage le marché afin d’approvisionner l’armée ; les Russes ont recours aux soldats-colons et procèdent à une centralisation importante de leur administration, tandis que les Moghols misent sur la décentralisation de la fiscalité et de l’armée. Ici, j’entends déjà le reproche : Russie, Inde, Chine, mais qu’en est-il de l’Occident ?
Les chercheurs sont constamment enjoints de mesurer tout espace, entité sociale ou organisation non occidentale à l’aune de l’Occident. Rarement de manière explicite, le plus souvent de manière implicite, un spécialiste de la Russie est obligé d’adopter un tel positionnement. Indianistes et
1 Les Nogays, Nogaïs ou Noghai sont un peuple de langue turque, essentiellement installé dans l’actuelle république du Daghestan, dans le Caucase ; ils sont souvent appelés les « Mongols caucasiens » ; leur langue est le nogaï ou nogays. Les Nogaïs sont les descendants des Kiptchaks qui se mélangèrent aux Mongols qui avaient conquis leur territoire. Ils [que désigne ce « ils » : les Kiptchaks ?] formaient la horde de Nogaï. Ils tirent leur nom du prince Nogaï, arrière-petit-fils de Gengis Khan, qui fut une personnalité importante parmi les Mongols de Russie à la fin du XIII
e siècle. La plupart des Nogays sont des musulmans sunnites.
sinologues font de même. Sans comparaison, il n’y a guère de spécificité ; j’entends bien. Mais pourquoi toujours avec l’Occident comme point de référence ?
En revanche, voici que la bataille d’Ulan Batong, les hauts faits d’Aurangzeb, les armées chinoises, russes et mogholes et leurs approvisionnements tirent dans une tout autre direction : je pars de la Russie et la compare à l’Inde et à la Chine. L’Occident omniprésent, sans disparaître pour autant, demeure à l’arrière-plan. Du coup, c’est un monde nouveau qui s’ouvre : la construction d’entités territoriales ; la relation entre guerre, économie et dynamiques sociales ; la signification même de la frontière. Vues d’Asie et suivant des comparaisons entre steppes d’Asie centrale, Moscovie, Chine et Empire moghol, ces questions n’aboutiront pas aux mêmes réponses qu’en suivant les axes habituels Delhi-Londres, Yangtzee-Lancashire ou Paris-Moscou. La comparaison-confrontation avec l’Occident ne devient pertinente qu’à partir d’une époque relativement tardive, à savoir la fin du XVIIIe siècle, et rien ne justifie de la plaquer sur des époques antérieures, comme si l’histoire était déjà écrite et que la suprématie de l’Occident était inévitable.
Pouvoir territorial et constructions étatiques
Vers la fin du XVIIe siècle, les voyageurs français, italiens ou anglais qui s’aventuraient en Inde et en Chine s’étonnaient de l’étendue du territoire, des mœurs exotiques et, pour ce qui est de l’Inde moghole, de ses immenses richesses2. Ils soulignaient déjà la force économique et militaire des Russes, certes primitifs et proches des Tatars, mais de plus en plus puissants3. En effet, en 1689, l’Inde, la Chine et la Russie produisent 70 % du PIB mondial4 ; malgré des incertitudes importantes dans les sources, la population chinoise est estimée à entre 100 et 130 millions d’habitants, celle de l’Inde à 180 millions, tandis que l’Europe entière effleure à peine les 100 millions. Ces chiffres racontent une histoire : celle de l’émerveillement occidental. Ils en cachent une autre : celle de la formation et du fonctionnement de ces empires. L’histoire et la sociologie comparées des constructions étatiques nous ont souvent appris à penser en termes d’États-nations. Ainsi, même si un auteur tel que Charles Tilly déclare d’emblée qu’il faut éviter de projeter vers le passé les constructions récentes, il en reste lui aussi prisonnier5. C’est là une conséquence de l’attitude qui consiste à étudier le passé afin de repérer les origines du présent. Le « mythe des origines », critiqué par Marc Bloch6, devient ainsi le socle dur d’une construction téléologique de l’histoire. Tilly classe les États en trois groupes : les empires fondés sur les tributs (tribute-making empires) ; les cités-États, italiennes principalement ; les États-nations. À ces trois catégories correspondent des gradations différentes du capital et de la coercition. Ainsi, les cités-États se distinguent par un capital maximal et un pouvoir coercitif minimal ; à l’opposé, toujours suivant Tilly, dans les empires asiatiques comme la Russie et la Chine, le manque de capitaux aurait été compensé par un maximum de coercition. Finalement, seuls les États-nations européens auraient fourni le bon mix de capital et coercition. Ce mélange aurait finalement permis la naissance des États modernes, de leurs armées, mais aussi la révolution industrielle et l’urbanisation.
2 Pour ne citer que quelques références dans une bibliographie massive : Un libertin dans l’Inde moghole. Les voyages de François Barnier (1656-1669), Paris, Chandeigne, 2008 ; Antoine-François Prevost, Histoire générale des voyages, ou Nouvelle Collection de toutes les relations de voyage par mer et par terre qui ont été publiées jusqu’à présent dans les différentes langues, 15 tomes, Paris, 1746-1759. On se référera aussi à l’importante synthèse de Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, Albin Michel, 1971. 3 Voir l’anthologie de textes choisis de Claude de Grève, Le Voyage en Russie, Paris, Laffont, 1990. 4 Angus Maddison, Contours of the World Economy, 1-2030 ad, Oxford, Oxford University Press, 2007. 5 Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States. AD 990-1992, Cambridge-Oxford, Blackwell, 1990. 6 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1993 [1949].
Ce raisonnement soulève deux ordres de problèmes : il part des résultats et prend les antécédents chronologiques pour des « causes », alors que rien ne nous assure que la croissance de l’Angleterre, par exemple, ait effectivement été liée à l’adoption de la Déclaration des droits (Bill of Rights) de 1689 ou que Venise ait succombé du fait de son incapacité à donner vie à un État comme la France. Le capitalisme s’est souvent développé sans guère accorder de droits civils ; bien au contraire, l’histoire est remplie d’exemples prouvant le contraire. La Chine d’aujourd’hui, le nazisme au XXe siècle constituent de parfaits exemples de capitalismes sans droits réels pour les populations. Au fond, même le développement du capitalisme en Europe au XIXe siècle s’appuyait sur une limitation étroite des droits civils et politiques réservés à une minorité de propriétaires. Le lien entre démocratie et capitalisme est sans doute politiquement correct ; il n’est pas nécessairement vrai. Il est donc important de chercher le capitalisme aussi en dehors des pays libéraux et démocratiques actuels.
Inversement, les États asiatiques à l’époque moderne n’étaient guère aussi despotiques et avaient davantage de capital que Tilly et d’autres le soutiennent. Il est vrai, comme ces auteurs l’ont souligné, que les pouvoirs mongols et turcs d’Asie centrale ont laissé leur empreinte sur les grands États asiatiques, tels que la Chine et la Russie. Il est même possible d’aller plus loin et de considérer que l’Inde moghole aussi a beaucoup hérité des pouvoirs d’Asie centrale. Seulement, ces derniers étaient bien moins nomades et pilleurs qu’on l’affirme d’habitude. Ils disposaient d’une organisation territoriale bien établie, d’une fiscalité et d’un système de conscription qu’ils ont légués à leurs successeurs eurasiatiques. L’empire de Chinggis Khan (transcription du mongol de Gengis Khan) a été un des plus grands, sinon le plus étendu de l’histoire ; et nous savons désormais que les Mongols étaient tout sauf de simples pilleurs nomades. Bref, il ne faut pas imaginer que ces pays ne tenaient que par beaucoup de coercition et étaient dépourvus de capital7.
L’opposition entre sédentaires et nomades a été longtemps avancée au sein des sociétés sédentaires : Momigliano avait déjà souligné l’importance de cette opposition dans l’Antiquité grecque et romaine8. Qualifier de « barbares » les populations limitrophes, ou de « pirates », de « nomades » et de « brigands » ceux qui se mettent à la marge des institutions territoriales est caractéristique des historiographies nationales9. Pour quelles raisons devrions-nous nous fier aux représentations des peuples sédentaires et aux historiographies nationales ? En croisant ces historiographies entre elles, nous nous apercevons que, souvent, nomades et pirates étaient parfaitement intégrés au sein des pouvoirs territoriaux et que seule la rupture des équilibres en place portait ces derniers à les qualifier de barbares et de pilleurs10. Il faudra dès lors justifier la naissance des États nomades et identifier par la suite leur filiation au sein des grands empires eurasiatiques. Quel est le lien historique entre ces formations ?
7 Nicola Di Cosmo, Ancient China and Its Ennemies. The Rise of Nomadic Power in East Asian History, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 8 Arnaldo Momigliano, Problèmes d’historiographie ancienne et moderne, Paris, Gallimard, 1983. 9 David Morgan, The Mongols, 2e éd., Malden, Blackwell, 2007 ; Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949 ; J. L. Anderson, “Piracy and world history: an economic perspective on maritime predation”, Journal of World History, 6, 1995, p. 175-199. 10 Pour une réévaluation récente du rôle des nomades, voir Scott Levi, India and Central Asia. Commerce and Culture, Oxford-Delhi, Oxford University Press, 2007. Sur les pirates, voir Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns. State-building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe, Princeton, Princeton University Press, 1994.
Pouvoirs et entités politiques en Eurasie, vers 1200.
http ://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier :Premongol.png
(déplacer la carte ds le cahier et l’annoncer ds le texte)
Nicola Di Cosmo a essayé de dépasser Tilly en offrant une théorie des constructions étatiques en Asie centrale. Il a critiqué l’opposition entre nomades et sédentaires et mis l’accent sur la « crise » afin d’expliquer la naissance des puissances territoriales dans cette partie du monde. Initialement, les entités politiques d’Asie centrale expriment une organisation par clans qui correspond à un usage extensif du territoire. Par la suite, l’épuisement des ressources aurait provoqué une crise économique et de légitimité des chefs de clan que seul un renforcement territorial, avec la mise en place d’une fiscalité et d’une armée régulière, aurait permis de vaincre. Cette théorie permet de dépasser l’opposition entre nomades et sédentaires ; Di Cosmo a eu le mérite d’introduire les pouvoirs d’Asie centrale sur la scène historique mondiale11. En même temps, son approche finit par légitimer toute construction historique en imaginant une « crise » à son origine. S’il y a eu changement, c’est qu’il y avait crise. Il s’agit là moins d’une véritable explication que d’un raisonnement circulaire. Vingt ans
11 Nicola Di Cosmo, “State formation and periodization in Inner Asian History”, Journal of World History, 10, 1, 1999, p. 1-40.
auparavant, Reinhart Koselleck critiquait l’usage de la notion de crise : crise pour qui et évoquée par qui12 ?
Combien de profits s’accumulent et de pouvoirs se mettent en place pendant les périodes dites de « crise » ? La pertinence de cet argument dépasse toute époque et toute configuration historique : elle est sans doute valable de nos jours, lorsque les médias et les politiciens parlent de « crise » afin de mieux faire passer certains changements ; elle est encore plus valable en histoire. Avant Di Cosmo, des historiens célèbres – Steensgaard, Hobsbawm et beaucoup d’autres – n’ont cessé de parler d’une « crise » au XVIIe siècle qui aurait permis le passage du monde médiéval tardif au monde capitaliste13. Braudel s’était employé à critiquer cette fracture présumée, visant selon lui moins à rendre compte des dynamiques historiques qu’à confirmer les étapes du capitalisme vues par les marxistes, mais aussi par la vulgate libérale. La crise comme facteur du changement ? C’était oublier la longue durée, la persistance des structures, les mouvements longs de l’économie et surtout des institutions14. Et, comme l’avait sagement demandé un politiste, Barrington Moore, dès les années 1960 : pour quelles raisons sommes-nous portés à croire que le changement provoquerait des crises alors que les continuités iraient d’elles-mêmes ? Et que dire des luttes menées pour perpétuer une manière d’être, une croyance, une institution en vie15 ?
Barrington Moore pensait que, dans l’histoire récente de l’humanité, beaucoup plus de sang a été versé pour préserver que pour innover. Il avait probablement raison. Il faudra donc essayer d’intégrer les moments de rupture dans les trajectoires historiques longues en évitant d’imposer toute nécessité. Il est toujours possible, après coup, de justifier par telle ou telle nécessité un phénomène historique. Cette approche empêche de voir les issues possibles à un moment donné et les bifurcations historiques. Ainsi, la formation de l’Empire russe aux dépens de la Lituanie, des Cosaques et des khanats d’Asie centrale ne saurait se résumer au fait que ces formations étaient en « crise » et que dès lors elles auraient eu besoin de se transmuer en autre chose. Cette issue ne peut s’expliquer par la supériorité prétendue des États nationaux sur les pouvoirs nomades, dans la mesure où ces deux types idéaux étaient absents dans les steppes à l’époque étudiée. Du coup, si ce n’est ni la crise ni la tension entre coercition et capital, comment expliquer l’évolution des formations territoriales en Eurasie ?
Afin de répondre, il faudra éviter de penser ces entités exclusivement à partir de nos propres catégories européennes. Bin Wong a poussé très loin dans la comparaison entre les modalités de la construction étatique en Chine et en Europe. Il considère à juste titre que la plupart des comparaisons sont faites à partir d’un questionnement européen ; ainsi, le rôle des villes comme moteur de la « modernisation » a été souvent évoqué comme spécificité occidentale, les villes chinoises (et d’ailleurs) étant plutôt associées à des entités administratives. Selon Wong, l’analyse historique ne permet guère de confirmer cette opposition, du fait de la présence très précoce d’instances administratives dans les villes européennes et, inversement, d’activités commerciales dans les villes chinoises. Ces dernières auraient dès lors contribué grandement à la construction étatique en Chine16. En employant la terminologie de Tilly, mais pas ses conclusions, il montre ainsi que les villes chinoises, à l’instar de leurs homologues européennes, auraient mobilisé capital et coercition. Si différence il y a entre l’Europe et la Chine, il
12 Reinhart Koselleck, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Paris, EHESS, 1990. 13 Eric Hobsbawm, “The general crisis of the European economy in the 17th century”, Past and Present, 6 (1), 1954, p. 33-53 ; Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East India Companies and the Decline of the Caravan Trade, Chicago, University of Chicago Press, 1975. 14 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Paris, Armand Colin, 3 vol., 1977-1979. 15 Barrington Moore Jr, Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie, Paris, Maspero, 1969. 16 Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of the European Experience, Ithaca, Cornell University Press, 1997.
faut la chercher moins dans ces éléments que dans les objectifs et les valeurs des politiques économiques. Autant, selon Wong, les souverains et municipalités en Europe auraient soutenu les ambitions de gain des marchands, jusqu’au cas extrême du mercantilisme, forme de soumission des intérêts étatiques aux objectifs commerciaux, autant en Chine, le profit aurait constamment été soumis à des pressions d’ordre moral, voire à un véritable pillage de la part de l’État. Suivant cette perspective, éthique et corruption sont complémentaires plutôt qu’en opposition. Les autorités chinoises auraient dès lors essayé de contrôler le marché afin de parvenir à un « juste prix » permettant de concilier les intérêts des marchands avec l’ordre social et éthique de l’empire. De même, l’ambition d’un « juste prix » et d’un ordre social du marché irait de pair avec l’extraction par l’État d’une partie du surplus. Finalement, selon Wong, en Chine la culture des Han se serait imposée à l’ensemble de la population, y compris d’origine mongole, tandis qu’en Europe des influences différentes – arabes d’une part, judéo-chrétiennes de l’autre – auraient produit des divisions culturelles importantes. Cette confrontation aurait été source d’affrontements politiques et militaires et, à partir de là, d’innovations technologiques17.
Wong a eu le mérite de sortir les réflexions occidentales sur la Chine d’un questionnement européo-centré et de lancer le débat sur des modalités différentes de la croissance économique et de la construction étatique. En même temps, son approche révèle une vision particulière de l’histoire de Chine. L’empreinte des Han, que Wong (et maints autres sinologues18) met en avant, exprime l’attitude somme toute conventionnelle de certaines élites intellectuelles et politiques chinoises visant à minimiser le poids de la culture mongole19. Cette attitude découle de la constitution elle-même des sources et des archives chinoises, en grande partie d’origine han. Ces interrelations étroites entre construction de la mémoire et pratiques du pouvoir sont particulièrement évidentes sur une échelle comparée. L’attention privilégiée accordée à la dimension han se reflète dans la manière dont Wong évalue les tensions entre culture européenne et culture arabe. Ces tensions sont à nuancer ; comme l’avait bien montré Braudel, l’interaction entre ces deux cultures autour de la Méditerranée conduisit davantage à une forme d’intégration qu’à la confrontation évoquée par Wong. Bref, au lieu d’avoir une culture unifiée en Chine et des oppositions fortes en Europe, nous trouvons des formes de superposition de cultures différentes au sein de ces deux économies-monde. Gardons dès lors cette interrogation pour notre enquête : comment identifier une culture homogène ? L’Europe en exprime-t-elle une ? Si l’Europe inclut la Méditerranée, alors l’Islam en fait partie intégrante. La manière dont le problème des liens et des tensions entre constructions territoriales-administratives, d’une part, et cultures d’autre part a été résolu en Chine, en Inde et en Russie nous livrera un éventail de solutions historiques permettant d’alimenter des réflexions moins hâtives sur ce sujet.
Le deuxième aspect évoqué par Wong, à savoir le lien entre alimentation et éthique, prête aussi à discussion dans la mesure où la régulation des marchés et des réserves granaires à partir d’un ordre éthique n’était nullement une spécificité chinoise, mais au contraire était largement dominant en Europe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, voire après20. La tension entre affaires et éthique, capitalisme et religion n’est pas une spécificité du confucianisme, ni par ailleurs du capitalisme. Depuis Max Weber, cette relation est constamment invoquée et jamais prouvée : les protestants à l’origine du capitalisme ? Pourquoi pas, sauf que plusieurs pays protestants n’ont pas brillé par leur niveau de développement et
17 Ibid. 18 Pour un aperçu, voir The Cambridge History of China, en particulier les volumes 8 et 9. 19 Voir la critique de Nicola Di Cosmo, “State formation…”, art. cit. Voir aussi Maurice Aymard, « De la Méditerranée à l’Asie. Une comparaison nécessaire », Annales HSS, 1, 2001, p. 43-50. 20 Jean-Yves Grenier, L’Économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996 ; Monica Martinat, Le Juste Marché. Le système annonaire romain aux XVI
e et XVIIe siècle, Rome,
École française de Rome, 2005.
que les pays catholiques, sans doute en difficulté au XIXe siècle par rapport à ceux de l’Europe septentrionale, ont bien remonté la pente ensuite. Cette conclusion est même renforcée si nous suivons Braudel et parlons de « capitalismes » à partir du XIIe siècle.
De même, en Chine, le confucianisme (par ailleurs difficile à définir comme un ensemble cohérent et uniforme de pratiques et de croyances) a été longtemps identifié comme la source du « retard » pour être de nos jours invoqué comme origine de la croissance chinoise21. Il est temps d’arrêter d’imposer ce type de relations mécaniques et simplificatrices entre religion et capitalisme, éthique et marchés. Nous n’allons pas discuter de ce lien en tant que tel ; au cours de notre analyse historique, nous allons rencontrer ces éléments suivant une perspective inhabituelle mais qui permet de comprendre le lien entre groupes religieux et mobilisation militaire. En Europe, nous sommes habitués, par notre propre histoire faite de guerres saintes, de réformes et de contre-réformes, à envisager ce lien comme une tension. Les difficultés de nos jours liées aux formes d’intégrismes poussent dans cette même direction. Nous serons alors surpris de trouver en Russie, en Inde et en Chine, à l’époque moderne, des constructions impériales où la coexistence de religions et d’ethnies était la règle. Les guerres et campagnes militaires entre Moghols et royaumes hindous ne trouvaient pas dans l’argument religieux leur justification principale ; il en allait de même dans les campagnes des Russes contre les khanats mongols ou dans celles des Mandchous contre les Dzoungars22. Dans tous ces cas, des considérations géopolitiques plus générales l’emportaient sur les aspects plus strictement religieux. Néanmoins, même si de manière moins mécanique que dans les théories citées, cet aspect constitue un élément crucial dans les dynamiques sociales et économiques et dans l’organisation politico-territoriale. Sur la très longue durée, la relation entre bouddhisme, confucianisme et, plus tardivement, islamisme a été centrale dans l’histoire de Chine23, tout comme celle entre hindouisme et islamisme a accompagné la construction de l’Empire moghol24. Quant à la Russie, nous allons le voir, le facteur religieux, quoique étroitement lié à la consolidation du pouvoir central, n’intervient que tardivement dans la construction impériale.
Voici donc qu’après les États-nations de Tilly et les pouvoirs mongols de Di Cosmo, un nouvel acteur politique s’impose dans les travaux actuels des politistes, historiens et économistes : l’empire. Ce dernier n’apparaît plus comme une construction préindustrielle et ancienne, mais comme l’institution par excellence de l’histoire très longue de l’humanité. Les dynamiques impériales et les tensions entre empires deviennent ainsi le moteur de l’histoire, depuis les empires anciens, en passant par Rome, Byzance, la Chine, la Perse, les empires coloniaux, les Russes, jusqu’à l’Empire américain25. Cette nouvelle vague a le mérite de dépasser le cadre de l’État-nation et de rendre compte des interactions complexes et non euro-centriques du monde. Est-ce l’empire qui permettrait de suppléer à ce manque ?
21 Pour une explication du retard chinois du fait du confucianisme, voir David Landes, Richesse et pauvreté des nations, Paris, Albin Michel, 2000 ; Joel Mokyr, The Lever of Riches, Technological Creativity and Ecnomic Progress, New York, Oxford University Press, 1990. Pour l’attitude opposée, voir entre autres Heng-fu Zou, “‘The spirit of capitalism’ and long-run growth”, European Journal of Political Economy, 10(2), 1994, p. 279-293. 22 Donald Ostrowski, Muscovy and the Mongols: Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier, 1304-1589, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 23 Pamela Kyle Crossley, The Manchus, Oxford, Basil Blackwell, 1997. 24 Muzzafar Alam, The Languages of Political Islam: India 1200-1800, Chicago, Chicago University Press, 2004. 25 La meilleure expression de cette tendance se trouve sans doute dans l’ouvrage de Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires in World History: Power and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 2010.
La réponse sera positive à la condition que la notion d’empire soit utilisée comme une heuristique pour questionner les diversités historiques et non pas comme une notion fourre-tout qui, dès lors, serait moins source de compréhension que de confusion. Il s’agit d’appréhender les caractéristiques de l’Empire chinois, de l’Empire russe et de l’Empire moghol en ayant soin de les distinguer suivant l’époque étudiée. La notion d’empire, historiquement située, conduit à interroger des entités territoriales fluides et mobiles, dans lesquelles des groupes ethniques, religieux et sociaux différents (de la famille et au clan à l’administration publique, des paysans aux soldats) interagissent, se hiérarchisent, suivant des modalités d’intégration et/ou d’assimilation différentes. Par exemple, la diffusion de l’Islam en Afrique-Eurasie a constitué un facteur puissant d’unification entre ces différentes parties du monde ; en même temps, cette mouvance a pris des contours différents dans des régions différentes, encouragée par le rôle de la shar’ia (charia). Les modalités d’expression du pouvoir islamique n’ont pas été les mêmes en Asie centrale, dans l’Empire ottoman et dans l’Inde moghole, en Indonésie et en Afrique orientale. À partir de là, les relations des musulmans avec les hindous, les Mandchous et les Russes orthodoxes ont peu en commun avec ce que l’on pourrait déduire des tensions récentes en Inde ou des formes d’exclusion mises en place par la Russie tsariste seulement depuis la fin du XIXe siècle, sans oublier les épurations ethniques staliniennes et les positions maoïstes vis-à-vis des Tibétains. Ces tensions appartiennent au XXe siècle, elles étaient bien plus faibles à l’époque moderne26.
La complexité et la capacité d’intégration des différentes religions et groupes ethniques sont communes à la Chine, à l’Inde moghole et à la Russie à l’époque moderne. L’ethnicité est un projet politique et la religion, avec l’armée, en constitue le marqueur. Cependant, les élites guerrières ne sont pas intégrées de la même manière dans chacun de ces empires : le rôle politique, militaire et social des Cosaques n’est pas le même que celui des Rajput ou des Marathes en Inde, à son tour différent de celui des Mandchous au sein de l’empire des Qing. La question est de savoir de quelle manière ces modalités d’insertion ont interagi avec les constructions impériales et la dynamique d’ensemble. Ma réponse sera que, à court et à moyen terme, l’attitude moghole consistant à laisser une relative autonomie aux groupes armées des sous-États fonctionnait autant, sinon mieux que celle des Russes et des Chinois, davantage prompts à la centralisation. Cependant, à plus long terme, cette stratégie moghole a été une des sources de leur déclin, tandis que les solutions chinoise et surtout russe ont mieux tenu face à la standardisation de l’armée et à l’expansion occidentale.
Militaires, mercenaires et paysans
J’en arrive au socle dur de ma démonstration, à savoir la relation entre soldats et pouvoirs territoriaux. Le succès de l’Occident face au reste du monde est souvent expliqué par la révolution militaire qu’a représentée le passage de la chevalerie médiévale à la cavalerie d’attaque, à l’infanterie lourde et à l’artillerie. Cette évolution est rapportée à la centralisation administrative, à la mise en place d’une fiscalité efficace et, bien entendu, d’un système de conscription et d’une économie capitaliste. À cette évolution s’ajoute celle des armes à feu, des techniques de combat, de la logistique, de l’organisation même de l’armée, censée être rationalisée27.
En réalité, les points essentiels de cette démonstration méritent d’être nuancés : il ne suffit pas de parler d’armes à feu, encore faut-il distinguer les mousquets des fusils, les armes à répétition des
26 Muzzafar Alam, The Languages of Political Islam, op. cit. 27 Geoffrey Parker, The Military Revolution and the Rise of the West, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
autres, les mortiers des canons, etc. Avec ces précisions, la modernisation des armées européennes se présente comme une évolution longue et complexe, qui n’a rien d’une révolution. La transformation des techniques d’approvisionnement et de la logistique a également été lente et les principales armées européennes sont confrontées à des problèmes importants d’approvisionnement au moins jusqu’à la Première Guerre mondiale28.
Autant la « révolution » militaire de l’Occident est à relativiser, autant, inversement, les empires eurasiatiques ont été beaucoup moins réticents à l’innovation qu’on l’affirme d’habitude ; la cavalerie et son rôle évoluent, tout comme les armes et l’infanterie. Les armes à feu se répandent dans les steppes et dans la péninsule indienne. Moins qu’en Europe, certes ; mais pour quelles raisons ?
Ces dynamiques s’expliquent par les conditions du terrain de combat. Dans les steppes, les chevaux gardent longtemps leur importance, et les techniques mongoles se transmettent efficacement aux Chinois, aux Russes et aux Indiens. Les armes et les techniques de combat européennes ont du mal à s’imposer dans les steppes, mais aussi dans les montagnes indiennes du Cachemire et, bien entendu, au Bengale. Il ne faut pas arriver jusqu’au Viêt Nam ou jusqu’en Afghanistan pour conclure que la guerre à l’occidentale n’est pas aussi dans d’autres parties du monde. Si, en Europe, la conscription moderne s’impose seulement avec les guerres napoléoniennes, c’est la Russie, pays considéré comme arriéré, qui est la première à mettre en place une conscription raisonnée et généralisée29. Contrairement aux idées reçues, la force de la Russie à l’époque moderne ne se situe pas dans le servage qui aurait permis une conscription facile, peu coûteuse et en même temps fondée sur le pouvoir des propriétaires fonciers ; confiné au cœur de la Russie (et encore !)30, le servage sert en réalité moins de source de recrutement que de contrepoids aux ambitions des propriétaires fonciers. Nous allons voir que ces derniers n’étaient pas partisans de l’expansion territoriale, qu’ils voyaient comme une menace pour leur pouvoir. À juste titre, car l’expansion russe s’appuie sur une fluidité sociale importante ; dans les steppes, nobles, soldats, officiers ou employés de l’État ne se distinguent jamais de manière rigide et irréversible. L’expansion russe est celle des soldats-colons, reliés à l’État et assurant une relative autonomie de ce dernier vis-à-vis des propriétaires fonciers du centre de la Russie. La force de cette dernière se trouve donc ailleurs que dans le servage et dans l’absolutisme ; elle réside dans un empire relativement flexible dans ses institutions et hiérarchies sociales et où le véritable barycentre se situe dans la périphérie, dans les steppes, plutôt qu’à Moscou et encore moins à Saint-Pétersbourg. Le pouvoir des tsars et des élites moscovites est important ; cependant, il se négocie constamment avec les autres échelons de la société, surtout dans les territoires fraîchement conquis. En retour, ces derniers ne cessent d’influencer les politiques et les équilibres au « centre ». En particulier, plus que le servage, deux facteurs soutiennent l’expansion russe : la conscription moderne et le soldat-colon dans les steppes, capable de cultiver la terre comme de manier les armes.
La Chine aussi soutient son expansion dans les steppes par des soldats-colons. Surtout dans le nord, où cette figure permet en même temps de contrer les pouvoirs mongols en place et de les intégrer progressivement au sein des réseaux commerciaux chinois. Encore plus qu’en Russie, la différence entre les régions chinoises passe par celle entre des groupes ethniques, les Mandchous au nord, les
28 Jeremy Black, European Warfare, 1660-1815, New Haven, Yale University Press, 1994. 29 John Keep, Soldiers of the Tsar: Army and Society in Russia, 1462-1874, Oxford, Clarendon Press, 1985. 30 Sur ces aspects, voir Carol Belkin Stevens, Soldiers on the Steppe: Army Reform and Social Change in Early Modern Russia, Dekalb, Northern Illinois University Press, 1995. Voir aussi Alessandro Stanziani, “Serfs, slaves, or wage earners? The legal statute of labour in Russia from a comparative perspective, from the 16th to the 19th century”, Journal of Global History, 3(2), 2008, p. 183-202 ; Alessandro Stanziani, “The legal statute of labour in the seventeenth to the nineteenth century: Russia in a comparative European perspective”, International Review of Social History, 54, 2009, p. 359-389.
Han aux sud, les guerriers au nord, les marchands au sud. Cette opposition est néanmoins à nuancer, car le commerce et l’armée unissent ces différentes parties31. La force de la Russie a été d’avoir soudé les paysans-soldats à l’État aux frais des propriétaires nobles ; celle de la Chine (à certaines époques) a plutôt été de les rapprocher et, dans certains limites, de rapprocher marchands, paysans et soldats. Le soldat-colon est en revanche absent en Inde, pour des raisons qui tiennent moins au peuplement (comme on pourrait l’imaginer à partir de l’idée d’une Inde surpeuplée) qu’aux modalités de recrutement des Moghols. Ces derniers ont recours à l’intermédiation des clans guerriers et des mansabdars pour la cavalerie, tandis que les zamindars (les propriétaires fonciers et collecteurs d’impôts) recrutent les paysans-soldats de l’infanterie32. Dans l’Inde moghole, l’État n’acquiert jamais le monopole de la violence. La décentralisation des pouvoirs, le recours à des intermédiaires militaires accompagnent la force des rajas et des zamindars, des seigneurs de la guerre et des propriétaires fonciers. Cette multiplicité des pouvoirs facilite la coexistence entre les musulmans et les hindous, entre les paysans, les propriétaires et les marchands, et entre les princes et leurs États. La coordination militaire liée aux armées à feu balaie cette solution. Cependant, il s’agit là d’une issue tardive, propre au XIXe siècle.
À ces diversités en matière de recrutement correspondent celles dans la logistique. Les Russes deviennent forts sans miser sur les voies terrestres – et pour cause ! Leurs routes boueuses et gelées ne sont guère praticables et, à l’époque moderne, des investissements dans ce domaine seraient hors de prix, voire techniquement hors de portée. Le faible développement des routes en Russie n’est pas forcément synonyme de retard ou d’incapacité à investir dans des infrastructures marchandes33. Au contraire, il répond parfaitement aux conditions climatiques locales. De ce fait, les Russes préfèrent multiplier les lieux de production et les rapprocher des terrains d’expansion et d’occupation. Les réserves granaires visent cet objectif et vont de pair avec les soldats-colons. Les Chinois, eux, mettent aussi en place un système de réserves ; cependant, ils jouent plus que les Russes la carte de l’intersection entre réserves civiles et réserves militaires et, à partir de là, ils investissent dans les routes et les canaux. Les Moghols, enfin, misent surtout sur la construction des axes routiers. Cependant, ayant délégué le recrutement des armées et l’approvisionnement aux zamindars, ils se retrouvent avec des routes ouvertes à toute utilisation, non seulement par leur propre armée, mais aussi par celles de leurs opposants, intérieurs comme extérieurs.
Finalement, les modalités de financement de ces projets impériaux et des armées en particulier sont cruciales. L’Inde moghole décentralise en bonne partie ces financements, tandis que, à l’opposé, la Russie fait de la centralisation fiscale une de ses mesures-phare. La Chine mandchoue des Qing cherche quant à elle, à conjuguer centralisation et autonomie locale avec des résultats différents suivant la conjoncture politique, sociale et monétaire.
En résumé, les succès à court, à moyen et à long terme des empires eurasiatiques sont liés à la manière dont ils ont su combiner formes de recrutement, armée et ordre social, approvisionnements militaires et organisation économique d’ensemble34. Par rapport à l’Occident, ces solutions se sont révélées être
31 Nicola Di Cosmo (ed.), Military Culture in Imperial China, Harvard, Harvard University Press, 2009 ; Joanna Waley-Cohen, The Culture of War in China: Empire and the Military under the Qing Dynasty, Londres, Tauris, 2006 . 32 Jos Gommans, Mughal Warfare, Londres, Routledge, 2002 ; Muzaffar Alam, Sanjay Subrahmanyam (ed.), The Mughal State, 1526-1750, New Delhi, Oxford University Press, 1998. 33 Parmi ceux qui ont soutenu cet argument : Jerome Blum, Lord and Peasants in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century, New York, Atheneum, 1964. 34 Pour une comparaison entre l’Inde moghole, l’Empire safavide et l’Empire ottoman, voir Stephen Dale, The Muslim Empires of the Ottoman, Safavids, and Mughal, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
moins « primitives » et simplistes qu’on l’affirme d’habitude. La Chine n’a cessé de progresser jusque vers la fin du XVIIIe siècle à un rythme comparable à celui de l’Europe35. Les Occidentaux n’ont dominé que dans le courant du XIXe siècle, et encore ce succès aura été limité aux régions côtières et il n’aurait duré qu’une centaine d’années sur une histoire millénaire. L’Inde aussi est loin d’être si décadente que l’ont affirmé les historiographies occidentales et les anti-impérialistes. Son déclin est limité jusqu’au XVIIIe siècle et l’Angleterre (ou plutôt l’East Indian Company), malgré sa puissance, est confrontée à des guerres importantes en Inde jusque vers le milieu du XIXe siècle36. La Russie enfin, le pouvoir le plus improbable d’Eurasie, si petite à l’origine (duché de Kiev, puis Moscou), avec une très faible population, sans ressources facilement exploitables ni traditions millénaires comme celles que revendiquent ses voisins, arrive à s’agrandir autant sinon mieux qu’eux : elle occupe d’abord les steppes au sud et à l’est aux dépens des pouvoirs mongols, puis la Pologne, la Sibérie et l’Ukraine. Avec des hauts et des bas, elle maintient sa puissance pendant des siècles, en dépit des annonces répétées de sa chute imminente de la part des Européens. À l’époque de Pierre le Grand, après la guerre de Crimée (1853-1856), la révolution bolchevique de 1917, le putsch de 1989 ou la crise financière de 1997, l’Occident croit toujours voir les symptômes d’une explosion prochaine de la Russie qui ne se produit jamais37.
Barrington Moore aimait expliquer les origines de la dictature et de la démocratie à partir des relations entre État, propriétaires fonciers et paysans à l’époque moderne38. C’était un questionnement intéressant mais dont la limite principale se situe dans le contexte politico-intellectuel dont il est issu, la guerre froide. Le despotisme asiatique de Wittfogel baignait dans ce même contexte39. La guerre froide est finie. Nous pouvons désormais étudier les constructions impériales eurasiatiques moins pour opposer le despotisme à la démocratie, l’Occident à l’Asie, que pour comprendre de quelle manière, à l’époque moderne comme de nos jours, ces pays ont su mélanger économie, construction territoriale et métissage social. Il n’est plus question de trouver un nouvel « ennemi » de la civilisation occidentale et de craindre le « péril jaune » (phobies déjà en vogue vers la fin du XIXe siècle, avec la vague d’émigrations massives, puis entre les deux guerres mondiales). Il est en revanche nécessaire de prendre acte du multipolarisme mondial et des croisements constants entre populations, ethnies et mondes économiques. Ces relations s’expriment à la fois sur le plan de l’activité militaire, en lien avec la croissance économique, et sur le plan du métissage social, en lien avec la construction de la frontière. C’est vers ces éléments que nous nous tournons à présent.
Guerre et dynamiques économiques
Avec les explications géopolitiques et sociales, ce sont celles qui mettent l’accent sur l’économie qui ont le plus marqué les comparaisons entre l’Occident et les empires eurasiatiques. En histoire économique, la question récurrente depuis des décennies et encore de nos jours consiste à se demander comment l’Occident a pu si bien réussir face à la Chine ou à l’Inde millénaires. Or cette question est biaisée : elle part d’une auto-complaisance qui conduit inévitablement à des fausses explications et, en réalité, à des raisonnements circulaires. Nous savons déjà à quoi nous nous attendons et nous
Voir aussi Rohan D’souza, “Crisis before the fall: some speculations on the decline of the Ottomans, Safavids and Mughals”, Social Scientist, 30, sept.-oct. 2002, p. 3-30. Je remercie Claude Markovits pour m’avoir signalé ce travail. 35 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence. China, Europe, and the Making of the Modern World Economy, Princeton, Princeton University Press, 2000. 36 Tirthankar Roy, The Economic History of India, 1857-1947, Delhi, Oxford University Press, 2000. 37 Dominic Lieven, Empire, The Russian Empire and its Rivals from the Sixteenth Century to the Present, Londres, Pimlico, 2003. 38 Barrington Moore Jr, Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie, op. cit. 39 Karl Wittfogel, Le Despotisme oriental, Paris, Minuit, 1957.
cherchons tout simplement des arguments justifiant le succès de l’Occident. Cet émerveillement unit les partisans et les détracteurs du modèle occidental ; au fond, les anticapitalistes se contentent de renverser le jugement de leurs opposants, tout en en gardant les principaux présupposés, à savoir le succès fulgurant de l’Occident capitaliste.
Ces attitudes ne sont pas nouvelles, mais elles ne sont pas les seules possibles. En réalité, dès le XVIIIe siècle pour la Russie, et plus tard, courant XIXe pour la Chine et l’Inde, de nombreux voyageurs européens opposent la civilisation et l’économie de leur pays au retard et à la barbarie des Asiatiques. Le temps n’est plus à l’émerveillement, comme à l’époque de Marco Polo et jusqu’au XVIIe siècle, mais à la confrontation, aux différences et, dès lors, à la mise en évidence du progrès européen. Bien entendu, des exceptions et pas des moindres sont présentes ; de nombreux philosophes – Voltaire et Diderot parmi d’autres – opposent la décadence occidentale aux possibilités réformatrices de pays « vierges » ou « nouveaux », tels que l’Afrique ou même la Russie40. Cependant, cette attitude n’a pas cessé d’évoluer au fil du temps, en fonction notamment de la réception des Lumières en France, en Russie ou dans d’autres pays « nouveaux ». L’appréciation de l’une ou de l’autre va de pair avec la réception des Lumières par ses élites.
Vers la fin du XVIIIe siècle, quelque chose se casse dans ces attitudes oscillantes : les institutions économiques de l’Occident, la propriété privée, la fiscalité centralisée, le marché, le travail salarié sont désormais perçus comme les fondements du progrès et de la civilisation. Tout ce qui s’en écarte – les propriétés communes, les limites imposées au marché, l’absence de fiscalité centralisée – est au contraire vu comme un signe et une cause du « retard »41. Les Lumières ont projeté un idéal ; les idéologies du XIXe siècle l’ont ratifié. Positivistes, libéraux et socialistes, puis marxistes, distants à maints égards, se rejoignent par l’accent mis sur les différences économiques entre l’Occident et le reste du monde42. Ces orientations n’ont pu que se renforcer pendant le XXe siècle des extrêmes, de la guerre froide et de la décolonisation. L’histoire économique s’est le plus souvent limitée à affirmer des hypothèses comme si elles étaient des évidences. Des tautologies ont tenu lieu d’explication. Ainsi, au sujet de la Chine, le questionnement a toujours été de savoir pourquoi ce pays, si en avance sur l’Europe par sa technique, sa culture, son expansion, n’a pas dominé le monde dès l’époque moderne, et pourquoi la révolution industrielle a eu lieu en Angleterre.
Depuis la fin du XIXe siècle, avec Weber, et jusqu’à nos jours, cette question fondamentalement biaisée a mobilisé des légions d’historiens et d’économistes. Il n’est pas question ici de résumer ces débats mais seulement de les discuter du point de vue qui nous intéresse ici, à savoir la relation entre innovation technique et militaire et croissance capitaliste. Ainsi, David Landes, célèbre pour son Prométhée libéré, sorte de célébration des progrès techniques en Angleterre, explique le paradoxe chinois par le fait que l’Europe avait pu bénéficier d’une culture bien plus ouverte que celle de la Chine. Les traditions judéo-chrétiennes se lieraient à la démocratie et cette dernière à la liberté d’initiative et d’entreprise. Suivant Landes, la Chine des mandarins et des despotes ainsi que l’hostilité du confucianisme envers le capitalisme ne pouvaient guère faire le poids face à la liberté chrétienne et
40 Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, op. cit. 41 Alessandro Stanziani, “Free labor-forced labor: an uncertain boundary? The circulation of economic ideas between Russia and Europe from the 18th to the mid-19th century”, Kritika. Explorations in Russian and Eurasian History, 9 (1), 2008, p.1-27. 42 Voir la synthèse de Frederick Cooper, Colonialism in Question, Berkeley, University of California Press, 2005.
capitaliste43. Au-delà d’une attitude à la limite du racisme, le problème est que, comme nous l’avons déjà dit, cette relation négative entre confucianisme et capitalisme n’a jamais été démontrée44.
Bien que de manière moins caricaturale que chez Landes, le lien entre marché, propriété privée et innovation comme fondement des différences entre l’Occident et la Chine se retrouve chez la plupart des historiens-économistes. Ainsi, Joel Mokyr, célèbre pour ses histoires des techniques et de l’innovation, considère qu’en Chine, on n’innove pas, on invente, c’est-à-dire que les idées nouvelles ne trouvent pas d’applications pratiques, susceptibles de se répandre dans l’activité économique. Il explique ces limites par les caractères de la science chinoise traditionnelle (contemplative plutôt qu’opérationnelle), par l’État prédateur et par la protection insuffisante de la propriété privée, en matière de brevets notamment45. En réalité, la science chinoise à laquelle se réfèrent Mokyr et plusieurs de ses collègues n’est pas tellement celle qui se développait en Chine mais plutôt celle que ces auteurs imaginent en citant, souvent de manière inappropriée, le pionnier, en Occident, des études sur la science chinoise, Joseph Needham. Son œuvre monumentale constitue la référence dans ce domaine46. Au cours de plusieurs décennies, Needham a livré une masse de renseignements sur la science chinoise. Il contestait le lieu commun occidental suivant lequel les Chinois auraient été incapables de réflexions théoriques menant à la recherche fondamentale. Il expliquait qu’en réalité la philosophie chinoise donnait vie à des réflexions théoriques autres que celles auxquelles nous sommes habitués en Occident, surtout depuis le XVIe siècle. Cependant, la manière dont Needham identifiait la spécificité de la science chinoise était influencée par sa conception de la science occidentale : il voyait un lien direct, en Occident, entre science et technologie, en partie lié au rôle majeur des marchands et des premiers entrepreneurs. Du coup, l’absence présumée de ces derniers en Chine (ou, du moins, leur soumission au pouvoir étatique) aurait lourdement pesé sur l’évolution de la science47. Ces dernières années, ces manières de comparer la science dite « occidentale » à celle d’autres parties du monde a été progressivement remise en question ; de nombreux auteurs ont ainsi mis en évidence les phénomènes d’emprunts réciproques sur la très longue durée entre la Chine et l’Europe, l’Inde et l’Europe, etc.48 ; de nouvelles données issues des archives et du travail archéologiques confirment ces interprétations nouvelles49.
Cependant, ces phénomènes de circulation et d’intégration entre mondes différents ont du mal à traverser les domaines misant sur des comparaisons entre des types idéaux de la science et du capitalisme occidentaux. Ces idéaux-types ne cessent de conditionner nos réflexions sur le lien entre science et capitalisme ; contrairement à ce que certains responsables politiques européens expriment de nos jours et à ce que plusieurs historiens, surtout anglais, ont affirmé dans le passé, le technicisme prétendu de l’Occident ne s’est jamais passé de la recherche fondamentale. Bien au contraire, cette
43 David Landes, Richesse et pauvreté des nations, op. cit. 44 L’erreur à la base de ces affirmations est patente : on prend la coexistence de deux phénomènes comme la preuve de l’influence de l’un sur l’autre. C’est comme si on liait, par exemple, les succès dans la coupe du monde de football à la présence, dans les pays gagnants, du code civil à la française plutôt qu’au droit anglo-saxon. Cette liaison est confirmée presque à cent pour cent tout en étant évidemment fausse. 45 Joel Mokyr, The Lever of Riches, op. cit. 46 Joseph Needham, Science and Civilization in China, Cambridge, Cambridge University Press, 1954-2008, 27 vol. 47 Joseph Needham, op. cit., vol. 3, 1959, p. 166-168 ; aussi J. Needham, Clerks and Craftsmen in China and the West, Cambridge, Cambridge University Press, 1970, p.82. 48 Dagmar Schäfer, Des Kaisers seidene Kleider. Staatliche Seidenmanufakturen in der Ming-Zeit (1368-1644), Heidelberg, Forum, 1998 ; Kapil Raj, Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2008. 49 Voir par exemple la base de données mise au point au Max Planck Institute par Dagmar Schäfer, Martina Siebert et Cathellen Paethe, sous le titre de Monumentalized or Marginalized, Writings about Technology in Chine History, a Database.
dernière et, de manière générale, le savoir pour le savoir, sans objectifs lucratifs immédiats, a longtemps animé la science et la culture occidentales. Par exemple, sans les moines copistes, sans la transmission du savoir ancien en mathématiques, la notion de limite n’aurait pas vu le jour et, sans elle, l’ingénierie moderne ne serait pas née. Sans la linguistique arabe et chinoise, les Occidentaux n’auraient jamais appris les secrets de la fabrication de la poudre à canon ni les secrets de la navigation50.
Inversement, les idées communes sur la contemplation prétendue des Chinois, leur isolement du reste de la société, l’opposition des mandarins despotiques à tout progrès viennent d’être ébranlées par les études montrant le dynamisme du savoir et ses applications en Chine à l’époque moderne51. De manière plus directe et plus simple encore, l’essor récent de la Chine est en train de mettre un terme à ces fausses évidences reliant tradition confucianiste et absence d’innovation scientifique. Une fois de plus, lorsqu’il observe l’Orient, l’Occident projette ses propres fantasmes : en l’occurrence, soit l’idéal d’une science appliquée, sans place pour la recherche fondamentale (c’est le cas de nos jours), soit celui d’une science « pure », détachée de tout enjeu politique et économique (image mythique de la science au XIXe siècle)52. Les voyageurs au XIXe siècle expliquaient ainsi les difficultés des Chinois, mais aussi des Mongols, des Indiens et des Russes, bref, des peuples non occidentaux, par le fait qu’ils étaient excessivement intéressés par les aspects pratiques et, de ce fait, ils délaissaient la science pure53. De nos jours, d’autres savants éminents affirment le contraire avec la même certitude.
À partir de ces faux jugements sur la science, les difficultés de la Chine sont expliquées par l’absence d’une véritable révolution militaire de style occidental. Comme les Chinois ou les Indiens sont réputés être dépourvus de sens pratique, ils n’auraient pas exploité leurs connaissances en explosifs à des fins militaires. Ainsi, la poudre à canon n’aurait guère été utilisée car les Chinois en voyaient peu l’utilité en dehors des feux d’artifice ; ou, encore, les mandarins et les élites corrompues se seraient opposés à toute rationalisation de l’armée et à toute innovation dans le domaine militaire54. Comme nous allons le voir, ces affirmations se heurtent à un double constat : premièrement, les armes à feu et l’artillerie lourde en particulier n’étaient pas forcément utiles dans les steppes et, lorsqu’elles étaient nécessaires, les Chinois en ont largement fait usage. Deuxièmement : la corruption en elle-même n’explique pas grand-chose ; à la limite, surtout dans le domaine militaire, elle a souvent été un formidable soutien aux investissements. En revanche, la question pertinente est celle de savoir pour quelles raisons, dans l’Inde moghole, dans la Chine des Ming ou des Mandchous ou encore en Russie au XVIIe siècle, tel ou tel groupe se serait opposé aux innovations militaires. Ces dernières ne relèvent pas que de leur efficacité (à son tour dépendante du terrain, comme nous venons de le dire), mais elles se lient au tissu social sous-jacent et aux pratiques économiques. Dans les mondes ruraux qui caractérisent l’époque étudiée, le recrutement influence les activités agricoles et les relations entre seigneurs et paysans. Le passage de la cavalerie à l’infanterie, des archers aux fantassins, exige une reconfiguration de ces relations. Ces changements ne sont pas toujours bien vus, ni par les paysans, ni par leurs seigneurs. De même, les cavaliers mythiques de Chine, d’Ouzbékistan, ou encore les Rajput et les sikhs, savent parfaitement que toute introduction des armes à feu signifie un rééquilibrage des hiérarchies militaires, sociales et politiques – d’où leur opposition aux innovations. Cependant, ces résistances n’ont pas
50 Nicolas Bourbaki, Éléments d’histoire des mathématiques, Berlin, Springer, 2007 [1984]. 51 Bin Wong, China Transformed, op. cit. 52 Helaine Selin (ed.), Encyclopaedia of the History of Science, Technology and Medicine in non-Western Cultures, Dordrecht, Klewer, 1997. 53 Ainsi, Armin Vambery, Voyage d’un faux derviche en Asie Centrale, 1862-1864, Paris, Phébus, 1994 : « un oriental pur sang… n’accepterait jamais comme valable un mobile simplement scientifique… les Orientaux ne comprennent pas l’inquiète curiosité des savants et ne croient pas volontiers qu’elle puisse exister » (p. 27). 54 Voir les pages suivantes et le chapitre 2 pour les références.
donné les mêmes résultats en Chine, en Inde et en Russie. L’analyse de ces évolutions différenciées va être au cœur du présent ouvrage.
Cependant, ce genre d’analyse est absent en histoire économique où, ces dernières années, un argument à première vue surprenant s’est affirmé : la Chine aurait été peu performante dans le domaine militaire et, à partir de là, dans l’innovation capitaliste et industrielle, du fait de son unification précoce. À l’inverse de l’Europe qui, divisée, aurait été encouragée à développer des armées et des armes de plus en plus performantes. Du fait de son contenu moral et de sa validité empirique, cet argument mérite une discussion approfondie.
Guerre et innovation technologique
Sur le plan de la morale et des modes historiographiques, il est clair que nous nous situons dans un contexte particulier : pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, puis encore plus pendant et après le Viêt Nam, l’argument le plus répandu parmi les historiens consistait à mettre en évidence la destruction des ressources productives opérée par la guerre. Cet argument était employé non seulement pour étudier le XXe siècle mais aussi le XIXe siècle, dont la croissance spectaculaire était expliquée par l’absence de guerres. Ce même argument servait à expliquer les guerres désastreuses du XVIe et du XVIIe siècle et, pire encore, du Moyen Âge. Bref, la guerre était négative pour la croissance économique55.
Puis, à partir des années 1990 et encore plus de nos jours, de plus en plus nombreux sont les historiens ayant renversé ce jugement et souligné les bienfaits économiques des guerres, source d’innovation et de croissance économique. C’est dans ce cadre que le « retard » chinois est expliqué par l’absence de guerres sur son territoire. Un des cas extrêmes de cette attitude est proposé par l’historien économiste Phil Hoffman, qui explique le succès européen face à la Chine à partir d’un modèle de théorie des jeux dits du « tournoi ». Il reprend en des termes économiques l’intuition de l’historien néerlandais Huizinga qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mettait en évidence les dangers des jeux militaires et reliait les sociétés d’ancien régime au jeu56. En simplifiant à l’excès cet argument, Hoffman se livre à un tout autre exercice : il considère que l’Europe moderne fonctionnait comme un tournoi permanent auquel participaient les princes et monarques du continent. Chacun était obligé de participer et de gagner afin de légitimer son pouvoir. D’où la compétition, l’innovation militaire et économique et le succès européen. À l’inverse, en Chine, la centralisation précoce de l’empire aurait évité ce genre de compétition – d’où le peu d’innovation et la décadence chinoise57. Laissons de côté les aspects éthiques de ces raisonnements qui risquent de nous conduire bientôt à qualifier les guerres mondiales du XXe siècle de « championnats » du monde de l’art militaire. Laissons également de côté les tentatives d’explications de toute l’histoire mondiale à partir d’un modèle de théorie des jeux, comme si les alliances, mariages, connexions entre États européens n’étaient pas la règle, et comme si les décisions militaires n’étaient nullement influencées par les dynamiques sociales et économiques.
Plus sérieusement, l’idée d’expliquer le retard chinois par le manque de guerres est surprenante car elle ignore les campagnes militaires fréquentes en Chine et elle se limite à reprendre les pires lieux communs d’une certaine historiographie nationaliste chinoise, qui a peu à voir avec la réalité. C’est là
55 De Braudel à Hobsbawm, en passant par la Cambridge Economic History, tous mettaient l’accent sur la destruction de ressources due à la guerre. 56 Johan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1988 [1938]. 57 Philip Hoffman, Why was it the Europeans conquered the world?, Working Paper, Caltech, 2009, 2010, http ://federation.ens.fr/ydepot/semin/texte0910/HOF2010WHY.pdf.
que les imaginaires politiques européen et chinois se rejoignent. Les Européens aiment penser à la Chine comme à un empire depuis longtemps unifié ; cette image donne à la petite Europe et à ses conquêtes une valeur considérable. À leur tour, de nombreux historiens chinois ont vendu cette même image qui sert à légitimer le pouvoir intérieur et la Chine face au monde extérieur. Cependant, l’histoire de la Chine est celle de ses multiples partitions, reconstitutions et fusions avec les peuples avoisinants. « Barbares » et « Chinois » (les uns et les autres étant différemment identifiés suivant les époques et les groupes au pouvoir en Chine) ne cessent de se mélanger des millénaires durant. La « Chine » telle que nous la connaissons de nos jours ne l’est qu’à des époques limitées de son histoire : à la fin du XVIIIe siècle, et après 1949 ; autrement, elle se limite tantôt à sa partie septentrionale, tantôt à ses régions côtières, tantôt à sa partie sud-occidentale (voir infra le chapitre 2). Les Chinois n’ont pas vendu à l’Europe que leurs vases Ming, faussement originaux et répondant en réalité à la demande européenne, à son tour fondée sur un imaginaire de la Chine dans les cours européennes de l’époque. Les Chinois ont aussi vendu à l’Occident l’idée d’une Chine unifiée depuis des millénaires, sans guerre et pour cela puissante. Cet argument a bien marché jusqu’à ce que les Européens ne réévaluent le rôle économique de la guerre et, à partir de là, expliquent le déclin chinois face à l’Occident par l’absence de guerres sur son territoire. La paix est dite mauvaise pour l’économie58.
En réalité, aucun lien n’a été prouvé entre absence de guerre et manque d’innovation. Pour quelles raisons les innovations seraient-elles liées exclusivement à la guerre ? L’histoire est riche de cas où le développement économique s’est fait en dehors de tout intérêt militaire ; cette perception propre au XXe siècle est relativement bien fondée pour cette époque, moins pour d’autres temps et d’autres lieux. Ainsi, la plupart des innovations du XIXe siècle, loin d’être négligeables, n’avaient aucun lien avec la guerre. La dynamique agricole commencée au XIIe siècle et poursuivie, tant bien que mal, jusqu’au XVIIe, puis au XVIIIe siècle, était moins liée aux guerres en elles-mêmes qu’aux incertitudes climatiques et aux oscillations des récoltes. Sans oublier la Russie, pour laquelle deux arguments parfaitement contradictoires s’affrontent : certains considèrent que les dépenses militaires excessives auraient plombé la croissance tsariste, puis celle des soviétiques59. D’autres, en revanche, considèrent que, face aux limites structurelles de la société et du pouvoir russes, seule l’armée a toujours su affirmer une efficacité comparable à celle de l’Occident60.
La relation entre guerre, innovation et croissance est néanmoins importante, à la condition qu’on essaie d’y répondre sans passer par des raccourcis . Par exemple, pour quelles raisons la guerre serait-elle un facteur de progrès lorsque nous comparons l’Europe à la Chine, tandis qu’elle devient source de gaspillage et de retard dans l’Espagne du XVIIe siècle ou dans l’Inde moghole ? Une réponse immédiate consisterait à affirmer que la guerre en Europe s’appuyait sur des institutions économiques efficaces, une fiscalité correcte et un État centralisé, ces éléments faisant défaut aux Moghols. Le problème est que, précisément à partir de ces éléments – fiscalité et armée décentralisées –, les Moghols ont bâti leur empire. Comment ont-ils fait ?
Aucune réponse véritable à ces questions n’est possible en partant simplement de l’issue des conflits : rien ne prouve que l’Angleterre se soit imposée en Inde du fait de sa fiscalité ou de son armée. Nous verrons que, en réalité, ces deux éléments faisaient défaut : l’armée anglaise avait du mal à s’imposer dans la plupart des régions indiennes ; quant à la centralisation fiscale, elle fut encore loin à venir : les
58 C’est peut-être que, à défaut de financements de la part des ministères de la Recherche, les historiens espèrent-ils trouver des subventions intéressantes auprès des militaires ? 59 Christopher Duffy, Russia’s Military Way to the West: Origins and Nature of Russian Military Power, 1700-1800, Londres, Routledge, 1981. 60 David Holloway, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, Yale University Press, 1994.
levées d’impôts en Inde ont été menées par l’East Indian Company, véritable État dans l’État. Les difficultés que rencontrait la couronne britannique pour contrôler la Compagnie des Indes n’étaient pas nécessairement inférieures à celles qu’avaient les Moghols pour maîtriser leurs finances au Deccan ou au Pendjab. Bref, il faudra chercher ailleurs que dans quelques lieux communs les raisons du succès anglais en Inde.
Afin de sortir de cette impasse, certains historiens économistes ont alors décidé de mettre de côté les institutions ; leur raisonnement peut se résumer ainsi : oublions toute différence entre les institutions chinoises, indiennes, russes et européennes. Pour l’essentiel, ces institutions auraient déjà été très proches à l’époque moderne. Remarquons que cet argument ne tient la route qu’à la condition d’éviter de regarder de près les institutions propres à chacun de ces pays, et que sultans, rajas, Chambre des lords, mandarins, famille hindou et famille élargie, catholiques et orthodoxes se rejoignent dans la seule et même ambition de « minimiser les coûts de transaction » (manière un peu compliquée que les économistes ont trouvé pour dire que, à côté des coûts monétaires, il existe des coûts liés aux négociations et aux échanges). Robert Allen, professeur à Oxford et partisan de cette approche, conclut que seule l’offre et la demande sur un socle de distribution différente de ressources énergétiques permet de différencier l’Angleterre de la Chine. En Europe, la guerre aurait alors conduit à augmenter le coût du travail, d’où la recherche d’innovations intensives en capital. D’où la révolution industrielle. Inversement, en Chine, l’absence de guerre et le poids du nombre auraient encouragé l’adoption de techniques intensives de travail et retardé l’industrialisation61.
La complexité des systèmes sociaux et l’absence dans la réalité d’une rationalité instrumentale font apparaître ces explications comme de simples exercices d’application de modèles économiques. Ces auteurs partent d’une équation assez simple reliant l’offre et la demande de travail au salaire et ce dernier à la guerre ; l’exercice est amusant, mais il n’améliore pas notre compréhension des mécanismes militaires et socio-économiques dans le monde moderne. Pour quelles raisons les Russes arrivent-ils à mettre en place une conscription efficace tandis que les Chinois n’y parviennent qu’en partie et les Moghols y renoncent ? Le fait que la densité de la population soit plus élevée en Inde que dans les steppes russes ne suffit pas à transformer les paysans en soldats. Les relations particulières entre propriétaires fonciers, élites militaires, État et paysans – donc les aspects institutionnels et sociaux – comptent beaucoup dans ces trajectoires historiques.
Ce n’est pas un hasard si certains ont alors essayé d’analyser les dynamiques des empires asiatiques sans accorder un poids excessif aux aspects militaires et en évitant des comparaisons faites à partir de types idéaux. C’est le cas, entre autres, de Kenneth Pomeranz, à l’origine d’un véritable tournant historiographique, celui de la « grande divergence ». La dynamique chinoise est expliquée à partir des mêmes critères utilisés pour l’Europe, à savoir : l’essor démographique, la protection de la propriété privée, la dynamique commerciale et proto-industrielle62. La thèse de la « grande divergence » affirme que, jusque vers la fin du XVIIIe siècle, la croissance chinoise n’était nullement inférieure à celle de l’Europe et ses institutions n’étaient guère hostiles au marché. Seules les ressources coloniales auraient permis à l’Occident de s’imposer, en économie comme dans l’art militaire. La conquête, plutôt que la guerre, différencie l’Europe des autres pays. Il s’agit en partie d’un argument qui avait déjà été invoqué par des historiens marxistes comme Hobsbawm lorsqu’il avançait que l’Asie n’avait pas le goût occidental pour la conquête63. Ce même argument se retrouve chez une pléiade d’auteurs, dont Jared Diamond, soulignant lui aussi l’attitude belliqueuse de l’Occident reliée aux techniques 61 Robert Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 62 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, op. cit. 63 Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes, Paris, Éditions Complexe, 1999 [1994].
métallurgiques d’une part, à l’élevage et aux parasites, virus et bactéries animaux, d’autre part64. L’avantage de ces approches est qu’elles ne tombent pas dans le piège des comparaisons faciles mentionnées auparavant autour de la guerre et de l’économie ; elles évitent aussi de célébrer l’Occident et, comme toutes les démarches d’histoire globale, celles de ces auteurs avancent des solutions importantes à la question des liens entre les spécificités des différentes parties du monde et leur connexion dans un ensemble plus large.
Le problème est que ces interprétations ont du mal à trouver une confirmation empirique ; le volet écologique et l’exploitation des ressources coloniales par l’Europe apparaissent plus comme des ambitions des colonisateurs que comme des réalités historiques. De même, les guerres n’ont pas moins ponctué l’histoire de l’Asie que celle de l’Europe. Comme nous allons le voir, l’Asie centrale, la Chine, l’Inde et la Russie sont assez souvent en guerre ; l’unité chinoise est un mirage, tout comme celle du sous-continent indien ou, encore, la destinée impériale des Russes. Dans tous ces cas, les constructions impériales qui s’ensuivent constituent des résultats historiques souvent inattendus et qu’il faudra dès lors expliquer.
À cette fin, il serait trompeur de focaliser notre attention uniquement sur une confrontation-comparaison entre l’Orient et l’Occident. La guerre froide vient tout juste de se terminer que nous cherchons déjà d’autres adversaires ; à défaut de méchants communistes, nous trouvons les Chinois protectionnistes, pollueurs et exploiteurs d’enfants. Il est temps de mettre fin à ce type de considérations. La question consiste plutôt à savoir comment et pourquoi Chine, Russie et Inde moghole arrivent, chacune à sa manière, à élargir leurs territoires respectifs entre le XVIe et le XVIIIe siècle et pour quelles raisons elles suivent des parcours différents par la suite. Pour chacun de ces empires, je relierai la fiscalité à l’organisation territoriale de l’armée afin de mettre en évidence l’interrelation entre colonisation, approvisionnement des villes et de l’armée et dynamiques économiques. Ensuite, je montrerai que, dans une perspective eurasiatique, il faut nuancer l’idée que les guerres tuent le commerce. Cette idée vient d’une représentation quelque peu mythique de l’Occident médiéval, avec les chevaliers offrant la protection aux paysans et aux marchands. Les historiens se sont évertués à montrer les stratégies d’accumulation liées à ces formes de protection. En réalité, le lien entre commerce et guerre était bien plus complexe dans l’Occident médiéval et assurément différent en Asie. Comme nous allons le voir, les conflits asiatiques se font le plus souvent en laissant le commerce libre de se développer. Ce qui ne signifie pas qu’il faille considérer la guerre comme un facteur du progrès économique, mais simplement que, afin de comprendre les empires eurasiatiques à l’époque moderne, il faut arrêter de penser aux soldats, aux paysans, aux colons, aux militaires et aux élites administratives comme à des entités séparées. Leur superposition, encore plus que leur interaction, conduit à rendre compte de ces dynamiques impériales.
À partir de là, il est possible de remettre en discussion le schéma de Tilly, opposant capital et coercition, par lequel nous avons commencé cette discussion. Le commerce et le capital ont joué un rôle important en Asie et il est dès lors peu crédible d’opposer l’Asie despotique et coercitive à l’Europe capitaliste. Capital et coercition se superposent en Asie comme en Europe. La coercition s’appuie sur le capital et ce dernier a largement recours à la coercition. La question est celle de comprendre de quelle manière ces deux éléments interagissent dans l’organisation sociale, dans les stratégies militaires et dans la construction étatique. La Russie était nettement moins coercitive qu’on l’affirme d’habitude, tandis que la Chine inscrivait les approvisionnements de l’armée dans les dynamiques marchandes et que l’Inde moghole s’appuyait sur une décentralisation à la fois des
64 Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, Paris, Gallimard, 2000.
capitaux et de la coercition. Si, en Europe, la solution a été celle de centraliser la fiscalité et d’organiser une conscription gérée par l’État, en Asie le monopole de la violence n’a pas toujours été à l’affiche. À partir de là, ce sont les notions mêmes de territoire, de frontière, de ville et d’État qui méritent d’être réévaluées.
Frontières, territoires et empires nomades
Il faut éviter d’identifier des entités appelées « Russie », « Inde » et « Chine » en pensant à leurs frontières actuelles ou à celles du XIXe siècle. De manière générale, ces espaces impériaux se modifient au fil du temps aussi bien du point de vue territorial que du point de vue des hiérarchies sociales et politiques. Le cœur de notre récit porte moins sur l’État-nation que sur l’empire, moins sur les villes et les capitales que sur les frontières. Ces dernières ne seront pas envisagées comme des limites, mais au contraire comme des espaces à géométrie variable. La frontière renvoie aux modalités de l’expansion des empires et, suivant la période étudiée, elle se réfère tantôt à une région tantôt à une autre. Par exemple, à la différence de ce que l’historiographie nationaliste chinoise affirme, il n’y a pas d’expansion de la civilisation chinoise à partir du bassin du Yangtzee (le fleuve Jaune) vers les autres régions. Au contraire, le cœur de la région appelée « Chine » a changé à des époques différentes : le sud, le nord, les steppes, avec une influence cruciale, quoique tenue cachée par les historiens chinois, des pouvoirs mongols65. L’archéologie a contesté cette interprétation. La véritable frontière n’est pas seulement représentée par la steppe mongole ; suivant les périodes, elle se situe tantôt dans le nord, tantôt dans le sud de la Chine. Les steppes et la mer conditionnent à la fois, mais selon un poids relatif différent suivant les époques, l’équilibre impérial chinois66.
De même, la Russie n’a pas toujours eu son centre à Moscou ou Saint-Pétersbourg ; Kiev et Novgorod en ont été le cœur à des époques différentes ; le barycentre du pouvoir se modifiait en fonction de la direction de l’expansion territoriale. En ce cas aussi, l’influence mongole a été décisive quoique occultée par l’historiographie nationale russe puis soviétique. Même à l’époque où la capitale se situait à Moscou, le monde des steppes a été le véritable cœur des institutions russes et de leur évolution67. Finalement, le pouvoir moghol non plus ne naît pas à Delhi pour s’étendre ensuite au nord et au sud de la péninsule. Au contraire, ce pouvoir vient lui aussi d’Asie centrale et, initialement, son cœur se situe à Kaboul. Le nord de l’Inde et l’Afghanistan constituent les premiers berceaux du pouvoir moghol. Ce n’est qu’au fil du temps, avec l’expansion des Safavides, des Ottomans et des Russes que les Moghols se recentrent vers le sud, dans la péninsule indienne proprement dite68. Et, dans ce cas, où se trouvent le centre et la frontière ?
Les frontières mobiles des empires eurasiatiques conduisent à remettre en discussion deux points forts des explications historiques : le rôle des puissances territoriales vis-à-vis des nomades et celui des villes par rapport aux campagnes. Ainsi, l’argument reliant le faible développement économique de la Chine au XIXe siècle à celui de ses villes s’appuie sur le présupposé suivant lequel le monde moderne est essentiellement le produit de l’urbanisation69. La ville « rend libre » : elle est censée casser les liens féodaux, stimuler la croissance et l’industrialisation, apporter la civilisation contre les campagnes arriérées. Ces lieux communs sont assez répandus en Europe et difficiles à éradiquer. Ainsi, une
65 Frederick W. Mote, Imperial China, 900-1800, Boston, Harvard University Press, 2003. 66 Peter C. Perdue, China Marches West, op. cit. ; Nicola Di Cosmo, “State formation…”, art. cit. 67 Michael Khodarkovsky, Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500-1800, Bloomington-Indianapolis, Indiana University Press, 2002 ; Jane Burbank, Frederick Cooper, Empires in World History, op. cit. 68 Jos Gommans, Mughal Warfare, op. cit. 69 De Max Weber jusqu’à David Landes en passant par Fernand Braudel, tous ont souligné cette différence entre l’Europe et l’Asie.
variante du schéma d’Allen (mettant l’accent sur les coûts comparés) mentionné plus haut, est celui qui vient d’être proposé par Rosenthal et Wong70. En s’appuyant eux aussi sur un modèle de théorie des jeux (voir chapitre 4), ces auteurs montrent que la guerre en Europe aurait poussé les artisans et les paysans-artisans à se réfugier en ville, d’où le rôle moteur de cette dernière. En revanche, en Chine, le pays aurait laissé l’industrie disséminée dans les campagnes et, de ce fait, réduit tous les avantages de l’urbanisation.
Il s’agit là d’un lien indirect entre les guerres et l’activité économique ; au lieu de rechercher l’impact des guerres sur la croissance économique, ces auteurs établissent une relation entre la localisation des activités économiques et les guerres. Cet argument part d’une représentation quelque peu caricaturale du féodalisme européen qui, comme dans les interprétations savantes du début du XXe siècle et dans les manuels scolaires jusqu’à nos jours ou presque, l’associe à la protection que les seigneurs offraient aux paysans et aux artisans. Cette interprétation a été depuis fortement nuancée, voire remise en question. Le commerce n’avait pas disparu après la chute de l’empire romain d’Occident, les « barbares » n’avaient pas tout détruit sur leur passage et le féodalisme était autre chose que la protection des paysans par les seigneurs71. Contestée par les historiens, l’image mythique du féodalisme revient pourtant dans les études récentes en histoire comparée du fait précisément de l’attitude qui consiste à mettre face à face des types idéaux : la Chine et l’Occident, la féodalité et le capitalisme.
La question qui se pose est double : d’une part, il s’agit de comprendre la pertinence de ce modèle pour l’Europe elle-même et, d’autre part, de mesurer les possibilités de l’étendre à d’autres mondes. Ainsi, ces dernières années, de nombreuses études ont nuancé le poids de l’urbanisation en Europe. Le monde rural n’est désormais plus envisagé comme synonyme de stagnation et de retard. Tout au contraire, paysans et propriétaires s’intègrent davantage dans la vie marchande qu’on l’affirme d’habitude, non seulement en Angleterre capitaliste, mais aussi dans la France d’Ancien Régime, et même en Europe centrale, en Prusse, en Europe orientale et en Russie. Partout, la croissance agricole et l’évolution des mentalités sont importantes dès le XVIIe siècle72. Inversement, la ville ne s’impose comme centre véritable de la vie économique, sociale et culturelle que très tardivement. Le XIXe siècle connaît partout le succès des ouvriers-paysans, « alternant activités agricoles et travail dans les manufactures urbaines73. La fabrique centralisée de Smith et de Marx demeure relativement marginale à cette époque. La ville et ses industries sont très visibles parce que nouvelles ; cependant, dans la réalité, elles ne deviennent dominantes qu’au XXe siècle. Avant cette date, la proto-industrie et l’agriculture gardent un poids très important presque partout en Europe74. Ce n’est pas un hasard si les tensions sociales et politiques liées à l’urbanisation et au déclin du paysannat ont lieu au XXe siècle et
70 Jean-Laurent Rosenthal, Bin Wong, Before and Beyond Divergence: The Politics of Economic Change in China and Europe, Boston, Harvard University Press, 2011. 71 Pierre Bonnassie, From Slavery to Feudalism in South-Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 ; Léopold Genicot, Rural Communities in the Medieval West, Baltimore, John Hopkins University, 1990 ; Georges Duby, Les Trois Ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978 ; John Munro, “Crisis and change in the later medieval English economy”, Journal of Economic History, 58 (1), 1998, p. 215-219 ; Tom Scott (ed.), The Peasantries of Europe. From the Fourteenth to the Eighteenth Centuries, Londres, Longman, 1998. 72 Tom Scott, The Peasantries, op. cit. ; Philip T. Hoffman, Growth in a Traditional Society. The French Countryside, 1450-1815, Princeton, Princeton University Press, 1996. 73 Sur les relations entre villes et campagne au XIX
e siècle en France, voir Gilles Postel-Vinay, “The dis-integration of traditional labor markets in France: from agriculture and industry to agriculture or industry”, in George Grantham, Mary MacKinnon (ed.), Labor Market Evolution: The Economic History of Market Integration, Wage Flexibility and the Employment Relation, Londres-New York, Routledge, 1994, p. 64-84. 74 Sheilagh Ogilvie, Markus Cerman (ed.), European Proto-industrialisation, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
non pas au début du XIXe siècle75. Les émeutes paysannes et ouvrières, le fascisme et le communisme expriment ce choc des mondes, le déclin des élites terriennes, des paysans et des ouvriers-paysans. Un siècle plus tôt, il s’agissait d’autre chose : de réactions à la famine, aux évolutions des techniques agricoles, aux rapports de force complexes entre seigneurs, paysans et « bourgeois ». Les historiographies libérales et marxistes ont eu intérêt à interpréter ces phénomènes en termes soit de luttes des classes soit d’avènement de la bourgeoisie. Ces auteurs anticipaient en quelque sorte le XXe siècle ; cependant, ils se trompaient sur les phénomènes et les tensions sociales du tournant des XVIIIe et XIXe siècles.
Ces doutes sur la pertinence du modèle urbain comme moteur de la croissance à l’époque moderne et au début de l’industrialisation sont encore renforcés lorsque nous envisageons les mondes non européens. En ce cas, il est tout à fait inopportun de raisonner, comme une certaine historiographie le fait, en termes de carences par rapport à une Europe idéale. Absences de la bourgeoisie, de la propriété privée, de la ville, de la démocratie, etc. ont été invoquées afin de justifier les retards russe, indien et chinois76. Cette approche eurocentrique doit être abandonnée : ces autres mondes méritent d’être étudiés à partir de leurs spécificités et de leurs modalités propres d’entrer dans la modernité. La différence n’est pas forcément synonyme de retard. En particulier, la ville asiatique a eu un rôle tout à fait différent de la ville européenne sans qu’elle puisse toutefois être identifiée comme source du blocage économique. La ville en Chine, en Inde et en Russie n’est jamais qu’un simple phénomène administratif, comme l’affirme une certaine théorie fonctionnaliste de ces sociétés. Les marchands y jouent un rôle important, même à des époques tout à fait révolues. Et, même là où l’administration paraît s’imposer, elle vise en réalité à créer des liens et des réseaux, à mélanger les groupes ethniques, bref, à bâtir l’empire. Chacun à sa manière, Braudel, Chaudhuri et Lombard ont mis l’accent sur le caractère relativement instable de la ville en Inde et en Asie du Sud-Est, sans toutefois que ce phénomène limite outre mesure l’essor commercial de ces régions. Le blocage est plutôt associé au lien entre instabilité des villes et lenteur du processus d’industrialisation77. D’autres ont été plus loin et mis en évidence que, dans le cas de l’Inde et de l’Asie en général, le processus de croissance économique ne doit pas forcément être lié à l’urbanisation. Les moteurs des dynamiques sociales, économiques, voire politiques dans ces régions ont été les déserts et les océans, plutôt que les villes. Les vastes étendues des steppes ont forgé l’Empire chinois et l’Empire russe78 ; le désert du Nord et l’océan ont orienté la construction de l’Empire moghol79. Le fait que le développement bien réel de ces pays ait eu lieu sans des formes d’urbanisation du type occidental milite précisément pour une autre approche, misant sur les diversités des parcours historiques. Ce n’est qu’en comprenant les modalités de ces différences dans le passé qu’il devient possible de comprendre les raisons pour lesquelles, de nos jours, l’urbanisation semble l’emporter partout. Une fois de plus, c’est un phénomène propre à la période contemporaine qu’il n’est pas fondé de plaquer sur les siècles passés.
75 Arno Mayer, La Persistance de l’Ancien Régime. L’Europe de 1848 à la Grande Guerre, Paris, Flammarion, 1992. 76 Alexander Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1962. Sur la Chine, voir parmi d’autres Joel Mokyr, The Lever of Riches, op. cit. ; David Landes, Richesse et pauvreté des nations, op. cit. Sur le retard de l’Inde et sa critique, voir Christopher Alan Bayly, Imperial Meridian. The British Empire and the World, 1780-1830, Londres, Longman, Pearson Education, 1989. 77 Kirti N. Chaudhuri, The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660-1760, Cambridge, Cambridge University Press, 1978 ; Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, op. cit. ; Denys Lombard, Le Carrefour javanais, Paris, EHESS, 3 vol., 1990 (reéd. 2004). 78 Michael Khodarkovsky, Russia’s Steppe Frontier, op. cit. 79 Michael Pearsons, The Indian Ocean, Londres, Routledge, 2003.
Ce qui conduit à examiner un autre aspect de la frontière, à savoir la relation entre sédentaires et nomades. J’ai déjà évoqué le fait que l’analyse historique ne permet guère de confirmer cette opposition commune aux historiographies des pouvoirs sédentaires. Les nomades d’Asie centrale disposaient pour la plupart d’institutions territoriales fortes et, même là où les aspects tribaux et nomades étaient particulièrement marqués, ils s’intégraient en réalité parfaitement bien au cadre des unités territoriales. Les nomades participaient au commerce et aux alliances stratégiques de groupes davantage sédentarisés. À terme, c’est l’acculturation réciproque entre ces groupes qui s’impose dans les dynamiques eurasiatiques. Le problème est qu’une historiographie nationaliste en Inde, en Chine et en Russie minimise cet impact. Bin Wong oppose les Empires ottoman, safavide et moghol aux Empires chinois et russe. Les premiers auraient été confrontés à la même menace de populations kazakhes d’Asie centrale et auraient été incapables d’y faire face, en raison de leur faible taux de centralisation bureaucratique et fiscale80. Cependant, à la différence des pays européens, la centralisation chinoise et russe aurait été celle des grands empires autocratiques et « agraires » et, de ce fait, incapable de mobiliser des ressources à des fins productives. Suivant Wong, encore plus que la Chine, la Russie a donné vie au joug autocratique précisément parce que son expansion s’est réalisée dans des territoires vides, sans trop de présence européenne. C’est là une différence, par exemple, avec l’Inde et, en partie, la Chine.
Ces affirmations ne font que conforter l’a priori négatif dont souffre la Russie non seulement en Europe mais aussi en Chine (ou auprès des Chinois américanisés) ; ces a priori servent à bâtir une image idéalisée de l’Europe ou de la Chine ; ils n’aident guère à comprendre les réalités historiques. Le fait de parler de l’occupation de territoires « vides » exprime en partie le mépris de la culture han vis-à-vis des peuples d’Asie centrale. En réalité, l’occupation doit non seulement se faire, mais aussi se maintenir. Le vide ne se maintient pas par le vide et il est inutile d’évoquer le despotisme et la coercition pour expliquer l’expansion russe dans les steppes. Au lieu d’opposer les grands empires asiatiques aux nomades et aux Kazakhs, il faudra s’interroger sur les formes d’alliance puis d’intégration de ces derniers au sein des empires. Cette insertion ne se réalise pas de la même manière en Chine, en Inde et en Russie ; la gestion administrative et militaire, y compris l’approvisionnement de l’armée et, donc, le rôle des seigneurs et des paysans sont liés à ces modalités différentes d’intégration des groupes nomades.
La frontière, le paysan-colon, les hiérarchies sociales et la construction étatique. Ensemble, ces éléments conduisent à identifier les analogies et les différences principales entre empire des Qing, Empire moghol et Empire russe :
L’empreinte des steppes est centrale dans toute la dynamique eurasiatique. Cette influence est évidente en Chine, très nette en Inde, et importante aussi dans l’organisation militaire et administrative russe. Une véritable culture politique des steppes se met en place dans les trois empires. Ces origines communes favorisent la circulation des hommes, des idées, des marchandises, de la religion et de l’art de la guerre.
La ville n’est pas toujours le centre des dynamiques politiques économiques et sociales. Le rôle des océans et des déserts, avec toutes les implications en termes d’identification des pouvoirs territoriaux (le droit maritime est encore de nos jours source de conflits inépuisables) et d’exploitation des ressources économiques, est central en Eurasie. Ces espaces mobiles affectent les notions et les pratiques de frontière et de pouvoir territorial, les nuancent par rapport aux perceptions qui sont les
80 Bin Wong, « Entre monde et nation : les régions braudeliennes en Asie », Annales HSS, 2001, 56 (1), p. 5-41.
nôtres. Les changements trouvent leur source dans les déserts et la mer. C’est la fluidité territoriale, sociale et politique qui l’emporte.
Le succès de l’Occident est assez tardif et temporaire. Il se mesure sur l’espace de deux ou trois siècles et il a déjà excessivement excité l’imaginaire occidental. En revanche, la force actuelle de l’Inde, de la Russie et de la Chine présente des durées beaucoup plus longues, indépendamment de toute stabilité de leur pouvoir territorial. La puissance de la Chine et a fortiori celle de la Russie et de l’Inde ne viennent pas de leur tradition ni de leur unité millénaire (les deux ne résistant pas à l’analyse historique), mais, au contraire, des multiples partitions de leur territoire et des croisements répétés avec les populations des steppes.
Ni la taille, ni le nombre ne suffisent à expliquer la force des empires eurasiatiques. L’espace se bâtit, se modifie au fil du temps, et même les frontières officielles (bien plus fragiles que les frontières réelles) ne se tiennent pas toutes seules. Affirmer que la force de l’Inde, de la Chine et de la Russie réside dans l’étendue de leur territoire signifie prendre le résultat pour la cause. La taille d’un pays et son maintien doivent être expliqués plutôt qu’être pris comme donnés. Surtout qu’elle n’est pas nécessairement source de force, elle peut tout aussi bien être à l’origine des faiblesses politiques et institutionnelles. Ce qui a d’ailleurs été évoqué sans cesse pour la Chine, l’Empire byzantin et, avant lui, pour les empires anciens qui sont censés avoir éclaté précisément du fait de leur taille excessive. En réalité, cet élément en soi ne peut se présumer être ni un facteur de force ni de faiblesse ; c’est la manière dont cette taille est atteinte qui compte : l’élargissement puis le maintien éventuel de l’étendue de l’empire ne se réalisent pas de la même manière en Inde, en Chine et en Russie. Les relations entre seigneurs, paysans et armée influencent lourdement ces processus.
Comme l’espace, la population aussi est souvent évoquée pour justifier la force de l’Inde et de la Chine et, inversement, la faiblesse de la Russie. Argument risible, qui remonte au moins à l’arithmétique politique du XVIIIe siècle et qui depuis ne cesse de hanter les débats publics. Suivant les époques et les pays, la population a été tantôt présentée comme source de croissance, tantôt comme origine de la pauvreté. Dans le cas de l’Inde, ces deux interprétations ont été avancées au fil du temps. Il ne sera pas question ici de développer ce point. Au lieu de me pencher sur le lien entre population et croissance économique, j’interrogerai la relation entre dynamique démographique et organisation militaire. Quel est le lien entre nombre et dispersion de la population, d’une part, et formes d’organisation militaire, d’autre part ? De quelle manière les populations paysannes sont-elles mobilisées ? Quel lien existe-t-il entre marché du travail et marché de la guerre, entre paysans-soldats et cavaliers-propriétaires ?
Les relations entre institutions, armée, territoire, économie et groupes sociaux aident à comprendre les différentes modalités d’expansion des trois empires mais aussi leurs réactions différentes face à l’Occident. L’Inde moghole s’effrite du fait de la décentralisation de la violence et de la fiscalité ; en même temps, les principaux sultanats et principautés qui la forment résistent parfois des décennies durant aux Anglais. En revanche, au XIXe siècle, la Chine plie face aux puissances occidentales. En réalité, ces dernières ne contrôlent que quelques régions côtières et le marché de l’opium. Finalement, le contrôle des propriétaires fonciers par l’autocratie russe conduit à une conscription massive, à une centralisation des activités militaires et à une interaction constante avec l’Occident. Ce dernier n’arrivera jamais à imposer quoi que ce soit à la Russie.
Je commencerai par examiner la Chine ; je soulignerai l’absence de toute unité territoriale pendant une très large partie de son histoire ; à partir de là, j’étudierai les formes d’organisation de l’armée, ses critères d’approvisionnement et les relations entre armée, institutions et société. J’analyserai ensuite la
dynamique de l’Asie centrale, puis l’émergence du pouvoir russe, en mettant un accent particulier sur la flexibilité du servage et sur le rôle joué par les steppes dans l’ingénierie sociale et dans l’évolution politique russe. Enfin, je me focaliserai sur l’Inde moghole, son marché de l’armée, sur le rôle des seigneurs de la guerre et des propriétaires fonciers, jusqu’aux formes de résistance aux Anglais des États post-moghols.
Ce partage ne doit pas laisser penser à des comparaisons figées. Car, finalement, l’origine commune des steppes, de la circulation des hommes, des marchandises et des idées, voire des projets impériaux se reliant à une culture politique des steppes, ajoute une dimension circulatoire forte à ma démarche. Ces origines et éléments communs et ces phénomènes circulatoires complètent la comparaison et permettent de rendre compte des analogies et des différences dans l’espace et dans le temps. La circulation des idées, des hommes et des marchandises, des armes, des techniques, des semences, des arts et des religions constitue une composante essentielle des dynamiques eurasiatiques. D’autres ont déjà mis en évidence ces éléments81 et je ne les traiterai pas in extenso. En revanche, je mettrai en évidence le rôle crucial du commerce de chevaux d’Asie centrale en Russie, en Inde et en Chine et, avec eux, celui de la circulation des pratiques militaires, voire des armes entre Russie et Inde, Chine et Russie et, en partie, Inde et Chine. À ces éléments, il faudra ajouter le rôle des religions en tant que facteur de transmission des idées, des pratiques commerciales82, mais aussi de la mise en place de réseaux relativement stables entre l’Asie centrale et l’Inde pour l’époque étudiée, l’Inde et la Chine pour des époques plus anciennes. La diffusion de ces éléments accompagne l’essor des trois empires suivant une conjoncture trop proche pour être le simple fruit du hasard. Le développement des marchés accompagne l’expansion moscovite et chinoise aux dépens des pouvoirs d’Asie centrale, celle des Moghols aux frais des formations territoriales présentes en Inde. Mon argument va être que, loin de tuer le commerce par leurs pratiques prédatrices, ces trois empires appuient leur construction précisément sur l’importance qu’ils accordent au commerce et aux marchands83.
81 Pour les relations entre Inde et Asie centrale, voir Scott Levi, India and Central Asia. Commerce and Culture, op. cit. ; Stephen Dale, Indian Merchants and Eurasian Trade, 1600-1750, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; pour l’océan Indien et les relations entre Chine, Inde et Afrique, Philippe Beaujard, “The Indian Ocean in Eurasian and African world-systems before the sixteenth century”, Journal of World History, 16 (4), 2005, p. 411-465 ; Kirti N. Chaudhuri, Asia Before Europe: Economy and Civilization in the Indian Ocean from the Rise of Islam to 1750, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 82 Muzzafar Alam, The Languages of Political Islam, op. cit. 83 Ce point est aussi celui de Christopher A. Bayly, Imperial Meridian, op. cit., et de Muzaffar Alam, Sanjay Subrahmanyam (ed.), The Mughal State, op. cit.