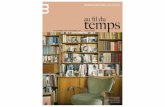Balances en os de l'âge du Bronze dans le sud-est du bassin parisien
Transcript of Balances en os de l'âge du Bronze dans le sud-est du bassin parisien
Balances en os DANS LE SUD-EST DU BASSIN PARISIEN
PAR REBECCA PEAKE ET JEAN-MARC SÉGUIER
La découverte d'un fléau de balance en os dans une sépulture à
incinération, attribuée au tout début du Bronze final, de la nécropole de
La Croix de la Mission à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) a incité à des
recherches plus approfondies sur l'objet lui-même (fabrication, utilisation,
signification) et sur son contexte de découverte. D'autres fléaux ont été
par la suite identifiés, provenant de contextes similaires des vallées
de la Seine et de l'Yonne mais aussi du bassin de la Charente. Fig.1
a mise en évidence d'un tel instrument dès cette époque apporte un éclairage nouveau sur l'économie, les savoir-faire et la structure de la société du début du Bronze final. Le fait que des étalons de mesure aient été employés à l'âge du
Bronze est évidemment induit par la maîtrise de la métallurgie (composition des alliages). Toutefois, l'existence d'instruments de mesure de précision ne pouvait jusqu'à présent qu'être supposée. Au-delà des aspects techno-écono-miques, ces fléaux, tous retrouvés en contexte funéraire, conduisent à s'interroger sur le sta-tut et la fonction des individus qui les possé-daient et les utilisaient.
La nécropole de La Croix de la Mission à Marolles-sur-Seine La nécropole de La Croix de la Mission à Marolles-sur-Seine (Peake, Delattre 1999) a été fouillée en 1997 dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive du programme " Bassée " (coord. Daniel Mordant). Elle com-portait 13 enclos circulaires associés à 9 inhu-mations et à 32 incinérations. L'analyse 14 C d'une inhumation dépourvue de mobilier
(2024-1713 BC cal.) a permis de montrer que la fondation de la nécropole remontait au Bronze ancien ; cependant, la majorité des sé-pultures appartient au Bronze final. Six inci-nérations de l'étape ancienne du Bronze final se démarquent par leur caractère prestigieux. Cinq incinérations de l'étape moyenne du Bronze final (RSFO) sont localisées au sein d'un groupe où la plupart des dépôts sont en conte-nant périssable. La sépulture la plus récente, datée au ' 4C de 1202-913 BC cal. et donc à si-tuer dans l'étape moyenne ou finale du Bronze final, est une inhumation déposée dans le fossé, en cours de comblement, d'un des plus grands enclos du site. Le premier fléau à avoir été interprété comme tel (fig.2, n° 1) provient de l'incinération 13, malheureusement arasée, localisée au centre d'un petit enclos de 13 m de diamètre, et où ont également été trouvés deux gobelets à dé-cor cannelé typiques du début du Bronze final, ainsi que deux tubes confectionnés à partir de tôles de bronze recourbées sur elles-mêmes. Ce fléau est constitué d'une tige en os d'origine animale de 11,4 cm de long en forme de fu-seau, épaisse de 4,5 mm en son centre et de 2,5 mm à chaque extrémité (fig.1). Elle est per-
o Archéopages n°1 • Juin 2000
2
de l'âge du Bronze Fig.2
25 km de 0100 m
de 100 200 rn
de 200 400 m
0
1 3
• 1/ Le fléau
en os de La Croix de
la Mission (éch. 1/1)
(cl. C. Valero/Afan).
Il> 2/ Les fléaux de
balance en matière
dure animale de l'âge
du Bronze du sud-est
du Bassin parisien et
l'emplacement de
leur découverte :
1/ Marolles-sur-
Seine/La Croix de la
Mission ;
2/ Marolles-sur-
Seine/Les Gours aux
Lions ;
3/ Passy-Véron/Les
Prés Pendus ;
4/ Monéteau (dessin
P. Pihuit/Afan).
► 3/ Détail de la
perforation de la tige
(cl. C. Valero/Afan).
4
forée d'un trou de 1,5 mm de diamètre (fig.3) en son milieu. Les deux extrémités portent des disques de 7 mm de diamètre à section ellip-soïdale ; les disques sont munis de perforations de 1,5 mm de diamètre, disposées selon un axe décalé par rapport à la tige.
Histoire du fléau de balance en os En raison de l'état de conservation relativement médiocre des surfaces qui sont vermiculées par les radicelles, il n'a pas été possible de distin-
guer de traces susceptibles d'éclairer directe-ment sur la technique de fabrication. On ten-tera toutefois de restituer, à titre d'hypothèse, les principales étapes de cette dernière. Le fléau, y compris les disques, a été réalisé d'un seul tenant à partir d'une baguette d'os probablement prélevée, par rainurage ou par sciage, dans un métapode de grand mammi-fère (cerf ou boeuf) en raison de sa rectitude et de sa longueur - la structure ne permettant pas d'envisager l'utilisation de bois de cervidé. La symétrie presque parfaite de l'objet alliée à sa
Juin 2000 • Archéopages n°1
0 Le tour à archet usage du tour à archet est
démontré dès l'âge du
Bronze dans la chaîne
opératoire de production
d'objets en métal. Cette
utilisation est en effet
suggérée dès l'étape ancienne
du Bronze final pour la finition
et le décor des épingles
métalliques à tête discoïdale
massive, par exemple, du type
de celles qui composaient
l'essentiel du dépôt de
Villethierry dans l'Yonne (Mordant et al. 1976: 139-
141, fig. 126). Dans ce cas, le
mode de fixation envisagé est
le mandrin.
Cette technique étendue au
façonnage de l'os, la plus sûre
et la plus efficace, se
généralise en Europe
occidentale à partir de
l'époque romaine, période à
laquelle la tabletterie va
connaître un développement
considérable. Elle est alors
largement attestée dans
l'atelier du tabletier (Béai
1983 : 30-34) pour la
confection de nombreux
objets, que ceux-ci soient fins
ou massifs comme les
épingles, les fuseaux ou les
poinçons (Béat 1983: 151-
211). Ils associent une
morphologie élaborée à un
ajustage et à un calibrage très
précis comme c'est le cas, par
exemple, pour les éléments
composites ou articulés :
charnières, pyxides, éléments
de montants de lits, etc. (Béai
1983: 79-86, 101-126).
Encore très rares, des indices
d'une apparition bien plus
précoce de cette technique
sont toutefois attestés, et ce,
au moins dès le Hallstatt final.
Les longues perles à
renflements ou cannelures qui
décoraient les comes à boire
de la sépulture aristocratique
de Hochdorf datée du vr s.
av. J.-C. ne peuvent avoir été
obtenues que selon ce
procédé (Biel et al. 1987:
176-177).
Fig.4
Détail de
l'un des disques
(cl. C. Valero/Afan).
minceur et à sa fragilité, en particulier aux ex-trémités de la tige, suggèrent que le façonnage est le résultat d'une action mécanique constante et régulière. Il est difficile de restituer la chaîne opératoire de fabrication. Trois hypothèses peuvent être avancées. La mise en forme a pu être réalisée par percussion à l'aide d'un burin. On peut aussi envisager l'emploi d'un outil abrasif ou per-mettant de racler la baguette (couteau). Enfin, on ne peut écarter l'hypothèse selon la-quelle le dégrossissage a été réalisé à l'aide d'un
touret actionné par un archet rotatif (encadré A). Dans ce cas, deux systèmes de fixation sont pos-sibles : la baguette d'os pouvait être fixée à l'ex-trémité d'un mandrin ou bien était coincée entre deux poupées de serrage. Le percement du trou de suspension qui tra-verse la partie la plus épaisse du fléau évoque, lui aussi, une technique élaborée : parfaitement cylindrique et très étroit (1,5 mm de diamètre pour 4,5 mm de profondeur), il trahit proba-blement l'usage d'une mèche de foret fine et longue entraînée par un tour à archet ; on no-
Archéopages n°1 • Jrul 2000
tera d'ailleurs que le calibre de cette perforation est du même ordre que celui des perforations les plus fines qui aient été observées dans la tabletterie gallo-romaine (Béal 1983 : 29). Enfin, le fléau a reçu une finition soignée — ce qui suppose une remarquable maîtrise non seu-lement de la chaîne opératoire, mais aussi des contraintes spécifiques liées au matériau — dont subsistent des traces sous la forme de stries lon-gitudinales bien visibles à la loupe binoculaire. Ces marques de polissage se limitent à de fines stries sur la partie centrale, alors qu'elles se trans-forment en légères cannelures vers les extrémi-tés, donc moins bien finies, car moins acces-sibles au polissoir en raison de la proximité des disques très fragiles. Dans ces conditions, il est tout à fait compréhensible qu'il puisse ne sub-sister aucune trace d'un façonnage rotatif, celles-ci ayant pu être effacées par le polissage final, comme, d'ailleurs, sur la très grande majorité des épingles d'époque hellénistique et romaine. Eoutillage utilisé dans cet artisanat des matières dures animales est méconnu. Mais, en raison des parentés technologiques que nous propo-sons de voir avec le travail du métal au début du Bronze final, on ne peut exclure, sans pour autant pouvoir le prouver, que ce fléau ait été confectionné dans la sphère d'activités liées à la métallurgie et, sinon dans l'atelier même d'un bronzier, peut-être avec de l'outillage emprunté à ce dernier voire, pourquoi pas, par celui-là même.
Le fonctionnement de la balance Quant au fonctionnement de la balance, la sy-métrie des deux branches assure l'équilibre des tensions appliquées par le poids des plateaux ou des sachets qui devaient être suspendus par les trous situés sur les disques (fig. 4). Cependant, le diamètre de ces trous est trop étroit pour laisser passer plusieurs fils et donc pour autoriser une suspension directe des pla-teaux. Il convient donc d'envisager une pièce intermédiaire, peut-être un anneau ou une boucle en matière organique rigide, suspendue à l'extrémité du fléau, à laquelle étaient atta-chés les fils de suspension du plateau (fig. 5). Ce type de montage assure une tension égale de ces derniers et donc une pesée exacte. La • perforation centrale de la tige correspond for-cément au point de suspension de la balance. Son épaississement central, autour de la per-foration, est destiné à renforcer la solidité de l'objet : en compensant les forces appliquées aux extrémités lors de la pesée, il permet d'évi-ter une flexion des branches et une cassure au point le plus faible du dispositif qu'est juste-ment le trou de suspension. Les exemplaires des Gours aux Lions à Marolles-sur-Seine (cf. infra) et de Monéteau dans l'Yonne, comme ce-lui de Vilhonneur (Peake et al. 1999) sont do-tés de goupilles en bronze servant visiblement d'intermédiaire entre le fléau proprement dit et le système de suspension et de préhension
Fig.5
Essai de restitution
d'un fléau de balance
du type de celui de
La Croix de la Mission
à Marolles-sur-Seine
(dessin R Pihuit/Afan).
0 5 cm
• Archeopages n 1
Fig.6
Marolles-sur-Seine/Les
Gours aux Lions :
A/ agencement des
objets du dépôt
(d'après Mordant 1970) ;
B/ emplacement
présumé du contenant ;
CI restitution proposée
de la sacoche
(dessin P. Pihuit/Afan).
006
• Tubes en bronze • Autre objet en bronze O Or
• Balance en os
) Ambre Silex, roche verte
A
0 Contenant en matière
périssable restitué Batonnet-fermoir restitué
0 Tubes en bronze
B
0
10 cm 0
10 rrn
qu'exige la manipulation de tels instruments de précision. Une interrogation demeure quant à l'utilisation de matière dure animale, pour le moins inhabituelle, dans la réalisation d'une balance. Le fait reste à peu près sans équiva-lent et, sous réserve d'une recherche systéma-tique, la seule autre exception connue est une balance pliable à tare fixe du xiie s. trouvée dans le cloître de Hirsau en Bade-Wûrttemberg (Feugère et al. 1996 : 355).
Les autres fléaux du secteur Seine-Yonne L identification du fléau de La Croix de la Mission a conduit à reconsidérer plusieurs mentions anciennes d'épingles ou de tiges d'os trouvées en contexte funéraire dans le sud-est du Bassin parisien. Le premier objet (fig. 2, n° 2) provient de la célèbre incinération 5 de la nécropole des Gours aux Lions à Marolles-sur-Seine, locali-sée à 3 km seulement de La Croix de la Mission (Mordant, Mordant 1970 : 64 et fig. 31). Cette nécropole, attribuée au début du Bronze final, comprend six enclos et une tren-taine de sépultures à inhumation et à inciné-ration. L'incinération 5, qui se trouve au centre
d'un enclos de 13 m de diamètre, est une des sépultures les plus riches de la nécropole. On y a trouvé huit récipients en céramique et un ensemble de petits objets placés sur l'amas os-seux. Ce mobilier funéraire est composé d'ob-jets en métal, en pierre et en os. Parmi des ob-jets métalliques, on note un rasoir à double tranchant, un poignard à deux rivets, des pin-cettes, trois tubes en bronze, une tige à extré-mité aplatie, une épingle du type de Courtavant ainsi que de petits fragments de bronze et d'or. Les autres objets sont un fléau de balance en os, un fragment d'ambre, une pierre à aiguiser et une petite hache en roche tenace. Le fléau en os est très semblable à ce-lui de La Croix de la Mission. La tige, dont les extrémités ne sont pas conservées, est longue de 10,5 cm ; son diamètre maximal est de 5,5 mm. Une perforation, dans laquelle sub-siste une goupille constituée d'un fil de bronze, est située au milieu de la longueur conservée. Il semble qu'un troisième fléau ait été mis au jour anciennement dans une inhumation lo-calisée le long de la route de Monéteau aux Bries (Yonne) (fig. 2, n° 4). C'est du moins ce que suggèrent les données extraites d'une no-tice consacrée à ce site par l'abbé Joly (Joly
o Archéopages n°1 • Juin 2000
C.)
1965). Plusieurs objets accompagnaient le dé-funt : un gobelet en céramique ; un rasoir en bronze se situant à hauteur de la hanche droite ; le fléau en os et deux tubes en bronze remplis de plomb se trouvant à hauteur du bras gauche. Le fléau semble avoir été trouvé incomplet. La tige, dont n'est conservé qu'un tronçon de 5 cm en forme de fuseau, est mu-nie d'une perforation dans laquelle est enga-gée une goupille en bronze. Cette dernière forme une boucle d'un côté alors que de l'autre les deux extrémités du fil ont été retournées pour la garder en position. Enfin, il est possible qu'un quatrième fléau provienne d'une inhu-mation de la nécropole des Prés Pendus à Passy et Véron (Yonne) (fig. 2, n° 3). Le site, composé de 10 enclos, a révélé une dizaine d'inhumations et autant d'incinérations (Depierre et al. 1999). Les offrandes de l'inhumation 18 étaient com-posées d'un dépôt céramique (urne, gobelet), d'un poignard en bronze, d'une épingle du type de Courtavant et d'un ensemble localisé près des vertèbres lombaires et comportant un rasoir, une pierre à aiguiser, deux anneaux en bronze ainsi qu'une tige en os brisée. Ce dernier objet, que l'on peut interpréter avec prudence comme étant un fléau, est une tige rectiligne polie en os, à sec-tion circulaire de 8 cm de long. Il semble avoir été brisé à la hauteur de l'épaississement qui pou-vait porter la perforation centrale : dans ce cas, il serait possible de restituer un fléau long d'au moins 16 cm. On ne peut clore cette liste sans signaler d'autres trouvailles. Eabbé Lacroix mentionne dans la nécropole de La Colombine, à Champlay, deux "épingles" en os de 4 et 5 cm de long (Lacroix 1957 ; Mordant, Mordant 1970), dont l'interprétation serait sans doute à réactualiser à la lumière de nos découvertes et en raison de l'absence totale d'épingle en os au Bronze final dans le Bassin parisien. Suite à l'interprétation du fléau de La Croix de la Mission, au moins deux éléments similaires ont pu être identifiés dans le bassin de la Charente par J. Gomez de Soto dans la grotte des Perrats, à Agris, et dans celle du Bois du Roc, à Vilhonneur, dans des contextes a priori non funéraires datés du Bronze final (Peake et al. 1999).
Une sacoche pour contenant Les contextes de découverte des balances de Monéteau et de La Croix de la Mission n'au- torisent aucune observation sur le mode de
mise en dépôt de ces objets dans les sépul-tures. En revanche, celle des Gours aux Lions était étroitement mêlée au lot d'objets hétéro-clites déjà signalé, ensemble déposé dans l'urne funéraire sur les restes incinérés (Mordant, Mordant 1970). L'agencement des objets évoque un contenant périssable (fig. 6, A). Le possible fléau de l'inhumation de Passy et Véron était également étroitement associé à un lot d'objets (cf. supra) dont la disposition, très serrée, évoque un contenant semblable. Dans son étude, C. Pare note que certaines sé-pultures danoises de l'âge du Bronze particu-lièrement bien conservées livrent de modestes objets — fils de laine, fragments de cuir, de bois ou d'écorce — correspondant à une partie du petit attirail personnel du défunt (Pare à pa-raître). Ces objets hétéroclites étaient souvent regroupés dans des sacoches en cuir. C'est un contenant de même nature que l'on propose de restituer dans le cas de l'incinéra-tion 5 des Gours aux lions. En effet, trois tubes en bronze alignés sur un même axe étaient dé-posés sur les objets (fig. 6, B). Ils correspon-dent probablement à un système de fermeture dont on peut proposer la restitution suivante : cousus sur chaque bord de l'ouverture d'une sacoche (deux tubes à chaque extrémité sur un bord, un tube au centre sur le bord op-posé), ces tubes seraient alignés lors du rap-prochement des deux côtés de la sacoche pour la fermer en y introduisant une baguette (en bois ?) coulissante (selon la restitution pro-posée fig. 6, C). Ce type de fermeture, très simple, peut être confectionné à l'aide de boucles souples en cuir ou en sparterie et est encore largement utilisé de nos jours. L'utilisation de tubes en métal n'est peut-être pas motivée par la fonction spécifique de telles sacoches, mais peut s'inscrire dans la lignée du prestige lié à ce matériau. Coïncidence ou non, les fléaux de La Croix de la Mission et de Monéteau sont eux aussi as-sociés à des tubes en bronze. Par ailleurs, d'autres éléments similaires proviennent de contextes funéraires du début du Bronze final du secteur Seine-Yonne. Dans le cas de la né-cropole des Prés Pendus à Passy et Véron, in-humation 103, on retrouve la même disposi-tion de trois tubes associés à des fragments de bronze et alignés, sur le thorax de l'individu (Depierre et al. 1999: 15, fig. 9). Pour l'inhu-mation 27 de la nécropole des Gours des Lions, un tube en bronze a été trouvé au ni-veau du bassin, près de deux pierres à affûter
Juin 2000 • Archemages r•l
RE
CH
ER
CH
ES I
MM
en grès et d'un fragment d'or (Mordant, Mordant 1970 : 43, fig. 14). Dans ce dernier cas, les auteurs notent la présence de terre noi-râtre, correspondant à un coffre ou à un sac en matière périssable, autour d'une épingle et d'un rasoir placés à proximité de l'épaule droite du défunt. Un dernier exemple provient de la nécropole de Richebourg à Passy, où l'inhu-mation 7, localisée au centre d'un enclos cir-culaire, comprend parmi les objets métalliques trois tubes alignés sur un rasoir, un poignard et une tige en bronze (Thevenot 1985 : 206, fig. 39). La disposition de ces objets reflète l'existence d'un sac en matière périssable, placé à la tête du défunt. Le caractère récurrent de cette observation donne plus de corps à la tentative de restitu-tion de sacoches ayant un système de ferme-ture tel que nous le proposons pour certaines sépultures privilégiées du Bronze final Mb du sud-est du Bassin parisien.
Comparaisons L'identification fonctionnelle des fléaux de balance repose uniquement sur les simili-tudes morphologiques que présentent ces éléments avec les trébuchets ou balances à plateaux et à branches égales en métal qui se répandent en Europe occidentale à partir de la fin de l'âge du Fer. On met en général leur développement sur le compte de la gé-néralisation progressive de l'économie mo-nétaire et de la production même de mon-naie dans les centres de pouvoir et dans les centres religieux. On en connaît bon nombre d'exemplaires, tous en bronze, sur divers op-pida ou agglomérations de plaine : on citera les exemples de Stradonice, Manching, Bâle - Gasfabrik, etc. (Furger-Gunti, Berger 1980 : 80-81). Localement, l'habitat groupé du Marais du Pont à Varennes-sur-Seine, situé à hauteur de la confluence entre l'Yonne et la Seine, en a livré un exemplaire dans une
0-
2
Fig.7
Comparaisons de
fléaux de balance de
diverses époques :
1/ Marolles-sur-
Seine/La Croix de la
Mission ;
2/ Hochdorf ;
3/ Varennes-sur-
Seine/Le Marais du
Pont ; 4/ Marolles-
sur-Seine/Le Chemin
de Sens ; 1/ os ;
2-4/ bronze (dessin
P. PihuitJAfan).
3 •
4
5 cm
Archeopages n - 1 •
o La pesée du métal e la fin de l'âge du Fer au haut
Moyen Âge, les trébuchets se
retrouvent toujours liés à une
production artisanale et à un
contexte privilégié, qu'il soit domestique ou funéraire. Dans
tous ces cas, on a pris l'habitude de
mettre en relation la présence de
balances de précision avec la
fabrication et/ou le contrôle des monnaies ou bien avec la
manipulation de métaux précieux, or
et argent, que le contexte de
circulation monétaire soit affirmé ou
plus incertain. Si cette interprétation
peut être légitimement privilégiée
pour des périodes au cours
desquelles la monnaie joue un rôle essentiel dans les échanges et dans
la taxation des biens circulant sur le
marché, elle ne saurait constituer
l'unique explication de la découverte
de tels objets. A fortiori, c'est
logiquement un tout autre type de
pesée qu'il faut envisager pour les
objets de l'âge du Bronze.
fosse de La Tène D2 (fig. 7, n° 3) (Séguier 1996). C'est également dans des contextes de pro-duction monétaire ou de contrôle de l'aloi des monnaies que vont se retrouver les fléaux de trébuchet à l'époque romaine. Pour s'en tenir au contexte local, on mentionnera le fléau gradué de l'habitat du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine (fig. 7, n° 4), daté de la fin du ou du début du Nr s. de n. è. (Séguier 1995). C'est précisément au cours de l'Antiquité tardive que la balance passe à nouveau dans le domaine funéraire en Europe occidentale. On connaît en particu-lier en Allemagne des modèles réduits de tré-buchets (fléaux et plateaux) associés à un at-tirail agricole également miniaturisé : sépultures de Kohln, Bruhl ou Rodenkirchen (Ferdière 1988 : 47-48). C'est enfin essentiellement en contexte fu-néraire que se situent les nombreuses trou-vailles de trébuchets du haut Moyen Âge da-tés pour la plupart de la fin du w et du virs. (Feugère et al. 1997 : 351-353). Ce type per-durera sans changement notable à l'époque médiévale et moderne. On notera enfin que le seul intermédiaire entre nos exemplaires du mir s. av. J.-C. et l'apparition des fléaux en bronze à partir de la fin du ii' s. av. J.-C. en Europe continentale est un fléau en bronze de l'habitat de Hochdorf (Biel 1995 : 21, fig. 9), daté du y' s. av. J.-C., qui a été Mis en relation, un peu abusivement à notre sens, avec une activité de pesée de monnaies (fig. 7, n° 2). La ressemblance morpholo-gique de cet instrument avec le fléau de La Croix de la Mission est assez frappante : il s'agit d'une tige fusiforme en bronze, longue de 11,5 cm, dotée à chaque extrémité d'un disque circulaire portant un anneau. Un sys-tème de suspension à anneau se situe au mi-lieu de la tige. Une branche de la balance porte des encoches destinées à étalonner l'instrument à l'aide d'une tare mobile et in-dique un système pondéral peut-être plus sophistiqué que dans le cas des balances du Bronze final.
Signification de l'objet Les balances de l'âge du Bronze trouvées lo-calement proviennent exclusivement de contextes funéraires relativement privilégiés. Celles des Gours aux Lions, de Passy-Véron et de Monéteau sont associées à un ensemble de plusieurs objets, comprenant au moins
une épingle, un couteau ou un poignard et parfois un rasoir. D'autres objets peuvent y être associés : pincettes, objets en pierre, frag-ments ténus de bronze ou d'or, d'ambre et éventuellement des restes de faune qui ne paraissent pas traduire des offrandes en rai-son de leur valeur alimentaire très faible voire nulle (dents, métapodes). Tous ces objets font partie de l'équipement personnel du défunt. Ils sont aussi des sym-boles de l'appartenance sociale de l'individu et de sa fonction. Les fléaux sont, de ce point de vue et au même titre que les autres ob-jets, lourds de sens : ils sont sans doute un signe de reconnaissance d'individus qui oc-cupent une fonction et un statut particuliers : artisans, colporteurs, médecins ou chamans. La présence dans ces tombes d'objets re-marquables (armes, rasoirs, perles ou grains d'or) est moins notable que les dépôts pres-tigieux qui caractérisent les sépultures d'in-dividus de très haut rang : parures arciformes et jambières spiralées des nécropoles de La Colombine, à •Champlay, et de Barbuise-Courtavant ; appliques en or de Barbuise-Courtavant (Gouge et al. 1994 ; Lacroix 1957 ; Collectif 1999 ; Mordant, Gouge, Mordant 1992), etc.
Utilisation La première hypothèse qui vient à l'esprit est celle de la pesée de petites quantités de mé-tal (encadré B). Il est exclu que de telles ba-lances aient pu être utilisées dans le dosage
Juin 2000 • Archéopages n°1
RE
CH
ER
CH
ES
MIN
I
des composants des alliages (cuivre, étain et plomb) dans la mesure où les masses mises en jeu sont incompatibles avec la résistance des fléaux en os. Il n'en va certainement pas de même de l'or que l'on va retrouver, de ma-nière relativement régulière, dans les sépul-tures de l'étape ancienne du Bronze final de la région. Il s'agit de très petites perles en ru-ban ornées au repoussé ou de fils enroulés, de poids très faible, de l'ordre de 1 à 2 g ou de simple fragments de tôle : Les Gours aux Lions incinération 5 et inhumation 27 (Mordant, Mordant 1970) ; Les Réaudins à Balloy, incinération 1 (Gouge et al. 1994) ; La Bichère à Vert-Saint-Denis (fouille A. Koehler). Dans l'incinération 5 des Gours aux Lions, l'association du fléau en os et des fragments d'or constitue en ce sens un in-dice intéressant. Ce dépôt comprend aussi un fragment poli de roche verte et une ha-chette, objets qui auraient pu éventuellement servir comme pierre de touche pour tester le titre de l'or. thypothèse de sépultures d'ar-tisans peut dans ce cas être jugée comme va-lide. Une autre hypothèse consiste à voir dans ces balances des instruments destinés à peser des substances légères intervenant en quan-tité très faible dans certaines préparations pharmaceutiques, cosmétiques ou même alimentaires : drogues, parfums, épices, herbes, colorants, etc., dont ne devaient pas manquer de faire usage les populations protohistoriques. Trois des quatre fléaux mentionnés ci-dessus sont associés à des ra-
soirs, objet aujourd'hui interprété par cer-tains chercheurs comme étant un instrument de scarification rituelle (Pare 1999). Dans cette optique, les sépultures contenant des fléaux pourraient être celles de "chamans" par exemple, dont la sacoche renfermerait des objets n'entrant pas forcément dans la sphère du profane mais dans celle, bien plus difficilement accessible à l'archéologie, de la médecine, de la magie et de la religion.
Conclusion La présence de fléaux de balance de préci-sion dans les sépultures du début du Bronze final illustre la diversité du mobilier funé-raire et la multiplicité des pistes qui autori-sent à interpréter ces assemblages. Il ne fait guère de doute qu'ils reflètent le rang, le sta-tut et l'importance des individus. Ces der-niers sont enterrés avec une panoplie d'ob-jets d'accompagnement : objets de prestige —épingle, couteau/poignard et parfois rasoir —, mais aussi objets plus anodins — pierre à aiguiser, pincettes, fragments de métal ou d'ambre, fléau en os, aiguilles ou hameçon. La présence de cette deuxième catégorie d'objets reste difficile à expliquer, hormis qu'il s'agisse des effets personnels du défunt, portés dans une sacoche. Par leur nature fonctionnelle, ils indiquent les activités des personnes inhumées. Le fléau permet de pen-ser à un individu évoluant dans le milieu de la métallurgie, de la médecine ou éventuel-lement de la religion. La mise en évidence de la pratique du dépôt
Les objets en os découverts dans les vallées de la Seine et de l'Yonne
- l'exception des
"pectoraux" en canines
de suidé (par exemple aux
Cent Arpents à Barbey
[Gouge et al. 1994], dans
l'inhumation 101 de La
Colombine à Chamblay
[Lacroix 1957, Collectif 1999]
ou encore dans la sépulture 2
de la nécropole de Barbuise-
Courtavant) et de quelques
pendeloques tirées de dents
de cervidés ou de carnivores,
on ne connaît que très peu
d'objets en matière dure
animale en contexte funéraire
au début de l'âge du Bronze.
Le corpus se limite à un
poinçon en os de suidé
(incinération 81 de La Croix de
la Mission [Peake, Delattre
1999]), un mors de cheval en
bois de cerf (sépulture 48 de
Passy-Véron [Depierre et al.
1999]) et à une hache-marteau
en bois de cerf également
(incinération 21 des Gobillons
à Châtenay-sur-Seine
[Bontillot et aI.1975]).
Étant donné que l'habitat du
début du Bronze final est
encore peu connu dans la
région, il faut attendre
l'extrême fin de l'âge du
Bronze et le début du premier
âge du Fer pour trouver dans
les fosses-dépotoir de
nombreux habitats un corpus
plus étoffé, bien que
numériquement encore limité,
d'objets confectionnés sans
des matières dures animales
(bois de cervidé, os) : haches-
marteaux, poinçons, boutons
et montants de mors sont les
plus nombreux.
o Archéopages n°1 • Juin 2000
d'objets diversifiés dans les sépultures de-vient plus difficile à partir de la phase moyenne du Bronze final et coïncide avec la généralisation de l'incinération (Mordant, Gouge 1992). Bien que le mobilier funéraire soit encore largement représenté dans les tombes de cette nouvelle phase, il semble moins diver-
sifié et surtout les effets "personnels" y sont plus discrets, parce qu'ils accompagnent le défunt sur le bûcher funéraire. Cette pra-tique ainsi que l'apparence moins privilégiée des sépultures (absence de monuments, ré-duction du nombre d'objets dans les tombes) rendent la lecture sociale moins accessible (Mordant, Gouge 1992). ■
Bibliographie Béai 1983 : BÉAL (J.-C.). Catalogue des ob-jets de tabletterie du musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon. Centre d'Études romaines et gallo-romaines de l'université Jean-Moulin-Lyon III. Lyon, 1983, 421 p., LXXI pl. h. t.
Biel et al. 1987 : BIEL (J.), CZARNETKI (A.), EICHLORN (P.), HUNDT (H. J.), KÔRBER-GROHNE (U.), GAUER (W), HARTMANN (A.). Hochdorf. In: MOHEN (j.-P.), DUVAL (A.), ÉLUÈRE (C.) dir. Trésors des princes celte, catalogue de l'ex-position du Grand Palais. Paris : Éd. Réunion des musées nationaux, 1987, p. 95-187.
Biel 1995 : BIEL (J.). Le Hohenasperg et l'habitat de Hochdorf. In : BRUN (P.), CHAUME (B.) dir. Vix et les éphémères principautés celtiques, les VI'-V siècles avant
J.-C. en Europe centre-occidentale, actes du colloque de Chatillon-sur-Seine. Paris : éd. Errance, 1995, p. 17-22, 9 fig.
Bontillot et al. 1975: BONTILLOT (J.), MORDANT (C.), MORDANT (D.), PARIS (J.). La Nécropole des Gobillons à Châtenay-sur-Seine (Seine-et-Marne). Bull. SPF, t. 72, n° 8, 1975, p. 416-456, 27 fig.
Collectif 1999 : I:âge d'or de l'âge du Bronze, les vallées de la Seine et de l'Yonne aux XIII' et XII' siècles avant J. C., catalogue d'exposition. Nogent-sur-Seine/ Nemours : musée municipal Paul Dubois-Alfred Boucher/musée de la Préhistoire d'Ile-de-France, 1999, 82 p.
Depierre G. et al. 1999: DEPIERRE (G.), JACQUEMIN (M.), MULLER (F.), COL-LET (S.), MORDANT (C.) col. La nécro-pole des " Pré Pendus " sur les communes de Passy et de Véron (Yonne). RAE, 48, 1999, p. 3-50.
Ferdière 1988 : FERDIÈRE (A.). Les tech-niques et les productions rurales en Gaule.
Les Campagnes en Gaule romaine, tome 2. Paris : éd. Errance, 1988, 243 p.
Feugère et al. 1996 : FEUGÈRE (M.), DEPEYROT (G.), MARTIN (M.). Balances monétaires à tare fixe. Typologie, métrolo-gie, interprétation. Gallia, 53, 1996, p. 345-362.
Gouge et al. 1994: GOUGE (P), MORDANT (C.), PIHUIT (P). Nécropoles de la Bossée, Age du Bronze, Présentation analytique des ensembles fouillés (1960-1994). Travaux du centre départemental d'archéologie de la Bassée.
Joly 1965 : JOLY (J.). Informations archéo-logiques. Gallia Préhistoire, t. 8, 1965, p.72-73.
Lacroix 1957 : LACROIX (B.).La Nécropole protohistorique de la Colombine. Société des fouilles archéolo-giques de l'Yonne, Cahiers d'archéologie et d'histoire de l'art, n° 2.
Mordant, Mordant 1970 : MORDANT (C.), MORDANT (D.). La Nécropole proto-historique des " Gours aux Lions "à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne). Mémoires de la SPF, t. 8. Paris ; SPF, 138 p., 66 fig.
Mordant et al. 1976 : MORDANT (C.), MORDANT (D.), PRAMPART 0.-Y.) Le Dépôt de Bronze de Villethierry (Yonne). IXe
supplément à Gallia Préhistoire. Paris : éd. CNRS, 1976, 237 p., 190 fig.
Mordant, Gouge 1992 : MORDANT (C.), GOUGE (P.). toccupation du sol au Bronze final dans les vallées de l'Yonne et de la Haute Seine. In : L'habitat et l'occupation du sol et l'âge du Bronze en Europe, actes du colloque inter-national de Lons-le-Saunier, 16-19 mai 1990. 1992, p. 133-164.
Muller 1992 : MULLER (F.). — Nécropole du Néolithique ancien à La Tène moyenne au
lieu dit" Les Terres de Prépoux " sur la com-mune de Villeneuve-la-Guyard (Yonne). Mémoire de maîtrise de l'École pratique des hautes études, Dijon, 1992.
Pare à paraître : PARE (C.). Weights and Weighing in Bronze Age Central Europe. In : Eliten der Bronzezeit. Proceedings of a conference in Mainz, nov. -
dec. 1996. RGZM Monographien.
Peake, Delattre 1999 : PEAKE (R.), DELATTRE (V). La Nécropole de l'âge du Bronze de " La Croix de la Mission " à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne). Bulletin de la SPF, tome 96, n° 4,1999, p. 581-605.
Peake et al. 1999 : PEAKE (R.), SÉGUIER (1.-M.), GOMEZ DE SOTO (J.). Fléaux de balances en os de l'âge du Bronze. Bulletin de la SPF, tome 96, n° 4, 1999, p. 643-644.
Séguier 1996 : SÉGUIER dir. Occupations préhistoriques et habitat groupé de La Tène finale à Varennes-sur-Seine (Seine -et-Marne). DES de sauvetage urgent - Bazoches-lès-Bray : Centre départemen-tal d'archéologie de la Bassée ; Saint-Denis : Service régional de l'Archéologie d'Ile-de-France, 1996, 182 p., 99 fig. h.t.
Séguier 1995 : SÉGUIER dir. Un gisement archéologique de l'interfluve Seine-Yonne du Paléolithique supérieur à l'Antiquité tardive à Marolles-sur-Seine (Seine -et-Marne), DFS de sauvetage urgent - Bazoches-lès-Bray : Centre départemental d'archéologie de la Bassée ; Saint-Denis : Service régional de l'Archéologie d'Ile-de-France , 1995, 2 vol.
Thevenot 1985 : THEVENOT Informations archéologiques, circonscrip-tion de Bourgogne. Gallia Préhistoire, t. 28, 1985, 210 p., 43 fig.
Remerciements Nous tenons à
remercier C. Mordant et C. Pare pour les
informations qu'ils ont bien voulu nous
fournir et pour leurs encouragements lors de nos recherches ;
merci également à J. Biel qui nous a
autorisés à publier le
fléau de Hochdorf.
Juin 2000 • Archéopages n°1