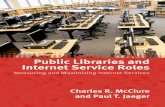Anthropologie et linguistique: influences, séparations et dialogues
Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS...
Transcript of Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS...
�
$8725,7��9(5686�/,%(57�"7K«RORJLH�HW�VDYRLU�UDWLRQQHO�GDQV�OHVSDFH�SXEOLF6WHIDQR�%LDQFX
(GLWLRQV�GX�&HUI�_�m�5HYXH�G«WKLTXH�HW�GH�WK«RORJLH�PRUDOH�}�
�������Qr����_�SDJHV����¢����,661����������
$UWLFOH�GLVSRQLEOH�HQ�OLJQH�¢�ODGUHVVH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������KWWS���ZZZ�FDLUQ�LQIR�UHYXH�G�HWKLTXH�HW�GH�WKHRORJLH�PRUDOH��������SDJH����KWP��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3RXU�FLWHU�FHW�DUWLFOH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6WHIDQR�%LDQFX��m�$XWRULW«�YHUVXV�OLEHUW«"�7K«RORJLH�HW�VDYRLU�UDWLRQQHO�GDQV�OHVSDFHSXEOLF�}��5HYXH�G«WKLTXH�HW�GH�WK«RORJLH�PRUDOH���������Qr������S��������'2,���������UHWP�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'LVWULEXWLRQ�«OHFWURQLTXH�&DLUQ�LQIR�SRXU�(GLWLRQV�GX�&HUI�k�(GLWLRQV�GX�&HUI��7RXV�GURLWV�U«VHUY«V�SRXU�WRXV�SD\V�
/D�UHSURGXFWLRQ�RX�UHSU«VHQWDWLRQ�GH�FHW�DUWLFOH��QRWDPPHQW�SDU�SKRWRFRSLH��QHVW�DXWRULV«H�TXH�GDQV�OHVOLPLWHV�GHV�FRQGLWLRQV�J«Q«UDOHV�GXWLOLVDWLRQ�GX�VLWH�RX��OH�FDV�«FK«DQW��GHV�FRQGLWLRQV�J«Q«UDOHV�GH�ODOLFHQFH�VRXVFULWH�SDU�YRWUH�«WDEOLVVHPHQW��7RXWH�DXWUH�UHSURGXFWLRQ�RX�UHSU«VHQWDWLRQ��HQ�WRXW�RX�SDUWLH�VRXV�TXHOTXH�IRUPH�HW�GH�TXHOTXH�PDQLªUH�TXH�FH�VRLW��HVW�LQWHUGLWH�VDXI�DFFRUG�SU«DODEOH�HW�«FULW�GHO«GLWHXU��HQ�GHKRUV�GHV�FDV�SU«YXV�SDU�OD�O«JLVODWLRQ�HQ�YLJXHXU�HQ�)UDQFH��,O�HVW�SU«FLV«�TXH�VRQ�VWRFNDJHGDQV�XQH�EDVH�GH�GRQQ«HV�HVW�«JDOHPHQW�LQWHUGLW�
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
69
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
REVUE D ’ É TH IQUE ET DE THÉOLOG I E MORALE | N • 2 5 2 | DÉCEMBRE 2 0 0 8 | P . 6 9 - 8 9
S t e f a n o B i a n c u
AUTOR I T É V E R SU S L I B E R T É "?
Théo l o g i e e t s a vo i r r a t i o nne ld an s l ’ e s p a c e pub l i c
« Comment peut une pensée être en même tempsliée et libre »"?
Paul Ricœur
Dans ces pages, j’essaye d’aborder la question générale de lafoi religieuse dans l’espace public, selon la perspective parti-culière de la légitimité de la présence de la théologie à l’univer-sité. Cette perspective se concentre sur la question de la légi-timité de la présence du savoir (scientifique) de la foi dansl’espace public du savoir (scientifique), c’est-à-dire la questionde la théologie comme science critique parmi d’autres sciencescritiques. Le défi consiste en ce sens à vérifier si une telle pers-pective particulière peut nous aider à mieux aborder et penserla question plus générale des rapports entre foi religieuse etraison publique.
J’envisage précisément d’interpréter le désaccord entre lathéologie et les autres domaines du savoir – désaccord quianime encore aujourd’hui de nombreuses querelles « politiques »sur le futur de la théologie à l’université"ë – comme un des
1.\Il me semble utile de rappeler brièvement l’occasion qui est à l’origine de cesréflexions. Pour toute une série de circonstances, je suis appelé à travailler à chevalsur deux mondes qui, bien que très diöérents, semblent aujourd’hui unis par la gestiond’un problème commun qui porte sur la théologie. En Italie, je suis chargé de coursà la Faculté de philosophie et lettres de l’Université catholique de Milan, qui est – àce que je sache – la seule université catholique au monde dépourvue d’une facultéde théologie. Cette situation implique la résurgence périodique – et plutôt vive – dela question du manque d’une confrontation avec le savoir théologique, alors qu’unetelle absence ne constitue aucunement une exception à l’intérieur du modèle
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
70
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
incontournables lieux d’émergence de la séparation modernenon (encore) résolue entre l’autorité et la liberté"í. La thèse queje propose n’est certainement pas nouvelle. Elle s’inscrit – pro-bablement bien plus que je ne réussirai à l’expliciter dans cespages – au sein du tournant herméneutique qui a traversé lapensée occidentale pendant le siècle passé (en tout cas dans latradition continentale). Je me réfère ici à l’idée selon laquelle,dans n’importe quel domaine de la connaissance, la réalité d’unsavoir absolument libre représente toujours, en définitive, unidéal régulateur et non pas une donnée originale de départ. Eneöet, comme le faisait remarquer Ricœur dans ses études sur lesymbole, il faut reconnaître que la pensée se présente toujours,inextricablement, liée et libre. Dans ce sens, la théologie, en tantque savoir qui ne se comprend pas comme étant libre maislibéré, non seulement ne constitue pas une exception dansl’universitas des savoirs, mais peut véritablement mettre à dis-position des savoirs son expérience d’une liberté qui se reconnaîtintimement liée à une autorité, et qui se comprend comme gé-nérée par une autorité qui la précède et dont elle ne peutjamais disposer entièrement"ì. La recherche nécessaire d’uneappropriation critique des données de la connaissance ne peutdonc pas se traduire par une négation de présupposés fina-lement inatteignables. Cette humble vérité d’une humble vérité
Suite note 1universitaire italien, qui, à court terme, n’envisage pas de réformes significatives. EnSuisse, par contre, je travaille comme chercheur – en tant que boursier du Fonds nationalSuisse – auprès de la Faculté de Théologie et de Sciences des religions de l’Universitéde Lausanne, qui, depuis quelque temps, est engagée dans une discussion acharnéeautour de la survie de la théologie à l’université. Que l’on parte du manque ou de laprésence de la théologie, celle-ci constitue, toujours et n’importe où, un problèmecomplexe : une véritable pierre d’achoppement par rapport aux catégories philoso-phiques et politiques usuelles, avec lesquelles la laïcité est aujourd’hui communémentpensée en Europe.2.\Sur le conflit moderne entre autorité et liberté et sur la consécutive crise de l’autorité,voir : H. ARENDT « What is Authority"? », in : EAD., Between Past and Future, NewYork, Viking Press, 1961, p. 91-141"; G. CAPOGRASSI, Riflessioni sull’autorità e la sua crisi(1921), in: M. D’addio (éd.), Milan, Giuörè, 1977.3.\Il me faut préciser le sens que j’attribue au terme « autorité », correspondant, aufond, à son sens étymologique d’auctoritas, qui « implique l’idée d’un excédent auniveau du contenu comme réserve fructueuse, dépôt d’or"; comme surplus qui conti-nuellement se produit"; comme écart par rapport aux logiques prévisibles parce quepréparées à l’avance"; comme ressource symbolique de dernière instance, ”institution-nelle“ et pourtant jamais totalement constituable, délimitable » (voir G. PRETEROSSI,Autorità, Bologne, Il Mulino, 2002, p. 12).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
71
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
(mais généalogiquement très riche) peut paraître hétérodoxe encomparaison des chemins d’une modernité qui a compris laliberté comme une donnée originaire par rapport à laquellen’importe quelle autorité a fini par acquérir la forme d’une (illé-gitime) limitation. Cependant, elle trouve une première vérifi-cation dans un important avertissement de Theodor W. Adorno,qui, dans ses Minima moralia, rappelait que la pensée quirepousse avec passion son propre conditionnement par amourde l’inconditionné, est destinée à tomber sans le savoir, et doncencore plus fatalement, sous la coupe du monde"î.
Le défi qui anime ces pages réside dans la tentative de vérifiersi les acquis du tournant herméneutique quant à la nécessité dereconnaître la réalité d’une pensée qui se présente toujours etde toute manière liée et libre, ne doivent pas être pris au sérieuxen ce qui concerne également l’ordre (politique) des disciplines.On se demande ainsi si l’ordre politique des disciplines nereprésente pas, au fond, l’épiphénomène d’une épistémologieet, finalement, d’une anthropologie, c’est-à-dire un des lieuxclés de l’émergence de la figure moderne d’un homme consi-déré comme originairement libre et autonome, par rapportauquel l’altérité est toujours vécue comme une limitation etune frustration. À la fin, il ne sera pas diúcile de rattacher lesretombées générales de mon propos à la question générale dela foi religieuse dans l’espace public.
D E U X P R É M I S S E S(D E R R I D A E T B A R T H )
La question de déceler quelle place la théologie occupe àl’intérieur du savoir critique – de ce savoir qui est propre àl’université – me semble avoir besoin de deux prémisses. Exparte universitatis, il faut bien cerner la position – et la vo-cation – de l’université quant à l’inconditionné dont parlaitAdorno : l’université peut-elle renoncer à l’idéal d’un savoirinconditionné"? Peut-elle donc se penser autrement que commeuniversité « sans conditions »"?
4.\Voir Th."W. ADORNO, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben(1951), Francfort, Suhrkamp Verlag, 2008 (Gesammelte Schriften, t. 4), § 153.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
72
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
En 1998, à l’université de Stanford, Jacques Derrida avait parléà ce sujet de la nécessité de se poser radicalement dans laperspective d’une université « sans condition », qu’il définissaitcomme étant « le lieu dans lequel rien n’est à l’abri duquestionnement, pas même la figure actuelle et déterminée dela démocratie"; et pas même l’idée traditionnelle de critique,comme critique théorique, et pas même l’autorité de la forme”question“, de la pensée comme ”questionnement“"ï ». Je pro-pose de considérer la position que Derrida avait jadis expriméecomme le préalable incontournable de notre discussion : uneprémisse que j’appellerais d’hygiène (largement) épistémolo-gique. Dans ce sens, le fait de prendre au sérieux l’inconditionnésignifie que l’idée même de critique ne peut qu’être à son tourcritiquable et critiquée. Autrement dit : une pensée critique dontl’idéal régulateur est la recherche et la passion pour l’incondi-tionné ne peut que tenir pour conditionnée l’idée traditionnellede critique, qui est au fond l’idée d’une critique originairementet radicalement dépourvue de présupposés.
Le fait de prendre au sérieux l’exigence d’une telle méta-critique implique de reconnaître que, comme le relevait Derrida,la figure actuelle et déterminée de la démocratie ne pourrafinalement prétendre se poser « sans conditions »"; ni, non plus,la fiction (politiquement nécessaire) d’une liberté et d’une égalitéoriginaires, qui constituent les présupposés nécessaires de l’Étatlibéral moderne, prétendument libre de toute condition.
En eöet, si l’autorité apparaît – en tant que négation de l’égalitéet limitation de la liberté – incompatible du point de vue politiqueavec les conquêtes de la modernité, elle ne l’est pourtant pasdu point de vue pédagogique"ñ (par « pédagogique », on dé-signe, au sens large, les stratégies, plus ou moins traditionnelles,d’humanisation de l’homme). La fiction (politiquement néces-saire) de croire que l’on naît déjà libre et donc porteur, dès lepremier instant, de droits et de devoirs, risque de nous faireoublier que la liberté, du point de vue anthropologique, est aussiun bien qu’il faut conquérir et cela grâce notamment à la ren-contre avec des autorités qui font autorité et qui nous libèrent.
5.\J. DERRIDA, L’Université sans condition, Paris, Éditions Galilée, 2001, p. 16 (c’estnous qui soulignons).6.\Voir H. ARENDT, What is Authority"?, op. cit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
73
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
Ex parte theologiae, ceci n’est pourtant pas encore suúsant.En eöet, s’il est vrai qu’une authentique passion pour l’incondi-tionné ne peut pas impliquer (pour les savoirs) un oubli de cequi – toujours nécessairement – est réellement soumis àcondition, il est tout aussi vrai que la survie de la théologie àl’université ne peut pas représenter un absolu et un incondi-tionné. C’est pourquoi je propose une deuxième prémisse – quej’appellerai d’hygiène (strictement) théologique –, que l’on peuttirer des pages de l’un des pères de la théologie du XX§ siècle :Karl Barth, qui, pour notre discussion, se présente comme unmaître véritablement au-dessus de tout soupçon"ó.
Avec Barth, il faut rappeler à la conscience théologique – etc’est notre deuxième prémisse, d’ordre théologique – que, mêmesi elle « ne doit pas être méprisée », « la question de savoir cequ’il faut penser de la théologie à l’université et de quel droitelle s’y rattache comme une science sui generis, modeste, libre,critique et joyeuse », cette question doit en tout cas représenter« une cura posterior » : « une question par rapport à laquelled’autres questions sont en fait beaucoup plus importantes ». Eneöet, il ne faut pas oublier que l’eöort de la théologie « surtoutau XIX§ siècle, de justifier son existence, afin de s’assurer toutau moins une petite place au soleil de la science universelle »,« n’a guère favorisé son travail ». « Chose étrange » – continuaitBarth –, « on n’a commencé à prendre un peu au sérieux lathéologie, non sans quelque mauvaise humeur d’ailleurs, que dèsl’instant où, renonçant provisoirement à toute apologétique,c’est-à-dire à toute caution extérieure, elle a cherché de nouveauà se consacrer plus étroitement à sa propre tâche"ò ».
Il s’agit donc d’un défi pour la crédibilité, présente et future.Si l’université veut sauvegarder sa crédibilité, elle ne peut quereconnaître le caractère conditionné du présupposé de l’idéetraditionnelle de critique : autrement dit, le présupposé de lapossibilité d’une radicale absence de présupposés. D’ailleurs, si
7.\Sans trop nous arrêter sur la pensée de Barth, il me semble nécessaire de rappelerla célèbre et significative accusation que Dietrich Bonhoeöer lui adresse, celle d’opérerun « positivisme de la révélation » : une écoute de la révélation à partir d’une négationradicale de toute présupposition humaine à une telle écoute.8.\K. BARTH, Einführung in die evangelische Theologie, Zurich, EVZ-Verlag, 1962";trad. fse de F. Rysier, Introduction à la théologie évangélique, Genève, Labor et Fides,1962, p. 17-18.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
74
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
la théologie – en tant que savoir de la foi (où le génitif est aussibien subjectif qu’objectif) – veut elle-même oörir un témoignagecrédible, elle ne peut que lier de manière nécessaire sa propresurvie à la permanence dans l’université. Malgré tout, une théo-logie sans université et une université sans théologie restent despossibilités complètement ouvertes.
L A T H É O L O G I E E T S E S P R É S U P P O S I T I O N S( D UQ UO C , W E B E R , B Ö C K E N F Ö R D E )
Selon Christian Duquoc, notre modernité finissante révèle lestraits d’une « conjoncture inhospitalière » pour la théologie, etce à cause de divers facteurs : « la culture indiöérente à la re-ligion, la connaissance en rupture avec la poésie et la symbo-lique, l’hégémonie de la technique, le caractère gestionnaire dela politique, le constat que l’histoire est sans finalité, la margi-nalisation sociale du christianisme, l’étude neutre de l’Écriture,la sympathie accordée à la pluralité religieuse, la peur aöectantles autorités ecclésiales"ô ». La théologie se trouverait donc en exildans la culture contemporaine. Ceci, selon Duquoc, à cause deson « allégeance inconditionnelle à l’autorité d’une Écriture oud’une Église ». Une allégeance qui est finalement retenue commeinacceptable : « inquiétante parce que proche de l’intolérance"ëê ».
En rappelant – en tant que petit correctif à la position deDuquoc – que toute période a sa part d’inhospitalité pour lathéologie (et qu’il y avait des débats très « modernes » à cesujet dès l’Antiquité"ëë), je trouve en tout cas emblématique, etencore aujourd’hui très représentative de notre koiné culturelle,la position de Max Weber. En 1917, dans sa conférence sur LeMétier et la Vocation de savant, Weber avait en eöet observéqu’« il n’existe pas de science entièrement exempte de présup-positions et qu’aucune science ne peut apporter la preuve desa valeur à qui rejette ses présuppositions ». S’il faut donc une
9.\Ch. DUQUOC, La Théologie en exil : le défi de sa survie dans la culture contem-poraine, Paris, Bayard, 2002, p. 16.10.\Ibidem, p. 8.11.\Je dois ce petit « correctif » à la riche et stimulante confrontation que j’ai eue, àpartir de la réception de mon texte, avec le Professeur Claire Clivaz de l’Université deLausanne, que je désire ici remercier nommément.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
75
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
acceptation préalable des présupposés d’une science pour ren-trer dans son cercle herméneutique – et ainsi s’en assurerl’intelligibilité (et la crédibilité) –, la théologie ne semble pasprésenter de caractères particulièrement hétérodoxes par rapportà l’universitas scientiarum. Au contraire.
Et pourtant, Weber avait aussi remarqué que, par rapport auxautres sciences, « la théologie ajoute encore d’autres présuppo-sitions qui lui sont propres, principalement en ce qui concerneson travail et la justification de son existence » : « la présuppo-sition que le monde doit avoir un sens » (qui, d’ailleurs, relève« essentiellement de la philosophie de la religion »)"; la pré-supposition « qu’il faut croire à certaines ”révélations“ qui sontimportantes »"; et, finalement, la présupposition « qu’il existecertains états et activités qui possèdent le caractère de la sainteté ».Ces présuppositions « appartiennent à une sphère qui se situeau-delà des limites de la ”science“ » et ne « constituent donc pasun ”savoir“ au sens habituel du mot, mais un ”avoir“ [Haben]"ëí ».Une évidente marche arrière, par rapport à ce qu’on avait aúrméquelques lignes plus haut.
Toutefois, les considérations de Weber ne sont pas sansimportance, au contraire. Il est évident qu’une bonne partie desprésuppositions propres à la théologie appartiennent à unesphère qui se situe « au-delà des limites de la ”science“ ». En cesens, et dans une perspective que l’on pourrait appeler in bonampartem, Ernst-Wolfgang Böckenförde peut davantage nous aiderà comprendre la configuration d’une raison face à la foi. Selonle juriste allemand, plusieurs fois lauréat d’un doctorat honoriscausa en théologie, le rapport entre conscience et autorité (etindividuation de la norme, dans le cas de l’éthique) doit êtredéterminé d’une autre manière pour la foi chrétienne que pourla philosophie (à savoir : l’éthique philosophique). En eöet,pour la foi chrétienne, la raison et la conscience ne sont pasdes organes de formation des normes, mais plutôt des organesde connaissance et d’application des normes : la raison entreici en action comme raison qui apprend et comprend, et non
12.\M. WEBER, Wissenschaft als Beruf (1917), in : Max Webers Gesamtausgabe, vol. I/17,Tübingen, Mohr, 1992, p. 71-111"; trad. fse de J. Freund, Le Métier et la Vocation desavant, in : M. WEBER, Le Savant et le Politique, Paris, Union Générale d’Éditions,1963.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
76
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
comme raison constitutive. La conscience n’est pas autonome,c’est-à-dire qu’elle n’est pas productrice de normes"ëì.
Le savoir de la foi est donc un savoir qui ne se reconnaît pascomplètement autonome : au contraire, il se sait conditionné.La référence à une autorité lui est, en quelque sorte, essentielle.
Cela dit, il me semble qu’il s’agit de poser deux types dequestions diöérentes. Le premier ordre, ad extra, se déclineraitde cette façon : la configuration d’une raison qui n’est pas d’abordproductrice, mais qui travaille depuis toujours à partir de donnéesqu’elle n’a pas posées, est-elle exclusivement propre à la théo-logie"? Ne s’agit-il pas d’une caractéristique propre à chaquetype de savoir humain"?
Le deuxième, ad intra, pourrait être ainsi formulé : quelle estla forme d’autorité à laquelle la raison est confrontée dans letravail théologique"? Le thème est très vaste et certainementbrûlant. Je me limite donc à formuler quelques considérations,encore une fois dans le sillage de Böckenförde"ëî. Il est évidentqu’une telle forme d’autorité ne peut pas être réduite à uneconfiguration exclusivement politique. À l’intérieur de l’Église– d’une Église-communion, où chacun prend part aux dons duSalut –, le modèle ne peut pas être celui du rapport entrecommandement et obéissance (qui est finalement un modèlepolitique). Le seul modèle possible est celui que la tradition nouslivre dans les termes d’un rapport entre traditio et receptio. Ilne s’agit donc pas d’une soumission inconditionnelle : il s’agitau contraire d’une possibilité de procéder à une critique àl’intérieur d’un « sentir » cum ecclesia. En d’autres termes : si
13.\Voir E."W. BÖCKENFÖRDE, Autorität – Gewissen – Normfindung. Thesen zur weiterenDiskussion (1992), dans ID., Kirche und christlicher Glaube in der Herausforderungender Zeit. Beiträge zur politisch-theologischen Verfassungsgeschichte 1957 – 2002,Berlin-Hambourg, Münster, LIT Verlag, 2004, p. 383-388, ici 383-384 : « Das Verhältnisvon Autorität – Gewissen – Normfindung ist auf der Grundlage des christlichen Glaubensmöglicherweise anders zu bestimmen als im Rahmen einer philosophischen Ethik. (...)Daher kann richtigerweise gesagt werden, dass Vernunft und Gewissen insoweit nichtOrgane der Normbildung sind, sondern solche der Normerkenntnis und –anwendung:die Vernunft tritt als vernehmende und nachvollziehende, nicht als konstituierendeVernunft in Aktion. (...) Das Gewissen ist in dieser Hinsicht nicht ”autonom“, nichtnormerzeugend. »14.\Voir E."W. BÖCKENFÖRDE, « Über die Autorität päpstlicher Lehrenzykliken : am Beispielder Außerungen zur Religionsfreiheit », Theologische Quartalschrift, 2006, vol. 186, n• 1,pp. 22-39"; Id., Autorität – Gewissen – Normfindung. Thesen zur weiteren Diskussion,op. cit.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
77
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
l’autorité dans l’Église n’est évidemment pas réductible à unesimple proposition parmi d’autres, elle est en même tempsthéologiquement équilibrée par une condition nécessaire : laréception par le sensus fidelium. L’un des aspects les plusrévélateurs de l’actuelle crise de l’Église – observe Böckenförde –est précisément l’extranéité marquée entre l’oúce doctrinal etle sensus fidelium.
Par conséquent, si l’on veut penser et comprendre la naturede l’autorité dans l’Église, les catégories que la modernité nousa livrées – celles de « public » et de « privé » – ne se montrentpas à la hauteur de leur objet. À mon sens, aussi bien la traditioncatholique que celle de la Réforme ont encore du travail à faire.D’une part, on ne peut pas considérer l’exercice de l’autorité dansl’Église comme étant simplement public : il n’est pas extrinsèqueaux consciences, qui participent avec le don reçu par l’Esprit àla nécessaire réception ecclésiale de la doctrine. D’autre part, onne peut pas réduire l’exercice de l’autorité dans l’Église à un faitéminemment privé : le sensus fidelium n’est pas la somme desensibilités individuelles"ëï.
« COMM E N T P E U T U N E P E N S É EÊ T R E E N M Ê M E T E M P S L I É E E T L I B R E "? »
(R I CΠU R )
Reprenons alors notre première question : la configurationd’une raison qui n’est pas d’abord productrice, mais qui tra-vaille depuis toujours à partir de données qu’elle n’a pas posées,est-elle spécifique à la théologie"?
Je propose ici de reformuler la question dans les termescélèbres de Paul Ricœur, dans son article « Le symbole donneà penser » (1959) : « Comment peut une pensée être en mêmetemps liée et libre"ëñ »"?
Comme" le" dit" Pierre" Gisel" dans" son" récent" livre" intituléLa Théologie : « se mettre au clair quant à ce que peut être la
15.\Voir GROUPE DES DOMBES, Un seul Maître. L’autorité doctrinale dans l’Église, Paris,Bayard, 2005"; D. VITALI, « La funzione della chiesa nell’intelligenza della fede », Rassegnadi teologia, 49 (2008), p. 13-30.16.\Voir P. RICŒUR, « Le symbole donne à penser », Esprit, 7-8, Juillet-Août 1959,p. 60-76 : 68.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
78
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
théologie dans le débat contemporain exige [...] que soitconvoquée une généalogie large de l’histoire occidentale"ëó ».Or, à mon avis, cela signifie nécessairement deux choses : d’unepart, une généalogie compréhensive de ce que l’histoire occi-dentale a explicitement conquis et aúrmé"; mais, d’autre part,une généalogie compréhensive de ce que l’histoire occiden-tale a aussi simplement présupposé, en risquant de l’oublier.J’aimerais ici très rapidement rappeler deux lieux d’émergencede ce risque d’oubli : l’idée de liberté et le rapport constitutifentre langage et pensée.
Trois idées de liberté (Grillo).La question de la liberté, d’abord. Selon le théologien italien
Andrea Grillo (professeur à l’Athénée pontifical Saint-Anselmede Rome"ëò), l’organisation caractéristique des rapports juridiqueset politiques de la modernité a été très féconde au niveaupolitique, mais elle a, en même temps, bloqué la maturation dela réflexion sur l’expérience éthique et religieuse des peuples,où elle s’est développée.
Selon Grillo, on comprend maintenant la nécessité d’une plusample articulation de l’expérience de l’homme, qui ne soit pasréductible au couple conceptuel « fait/droit » (niveau politique),mais aussi articulée dans les couples « tâche/devoir » (niveauéthique) et « don/grâce » (niveau théologique). En d’autrestermes, l’expérience de l’homme connaît une nécessaire indiöé-rence politique, mais aussi une non-indiöérence éthique et uneconfiance religieuse.
Ce qui s’est passé, c’est que l’on a identifié le conceptd’« autorité » à celui de « pouvoir ». Et ce d’une telle façon quele modèle politique des rapports entre la raison et la foi s’estimposé partout sous la forme d’une extériorité radicale entre laliberté et l’autorité. En dérive l’idée de laïcité abstraite et radicale,selon laquelle l’homme est pensé originairement libre, sansaucune généalogie de sa liberté dans la relation historique àd’autres (sujets qui font autorité).
17.\P. GISEL, La Théologie, Paris, PUF, 2007, p. 15.18.\Voir A. GRILLO, Evidenza della libertà e libertà dell’evidenza. Per una genealogiadell’umanità dell’uomo, in : S. BIANCU (éd.), Sapere che sa di fede. Lo spazio dellateologia all’interno del sapere, Assise, Cittadella, 2007í, p. 69-85"; ID., « Passi sulla viadella pace ». Libertà e autorità agli inizi del XXI secolo, Noli, Natrusso, 2007.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
79
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
Ce manque d’attention pour des expériences « non poli-tiques » de la liberté (et de l’autorité) est devenu la conditiond’inscription de la pensée théologique sous le signe de l’« auto-ritaire ».
Au modèle de l’évidence de la liberté – selon lequel chacunest originairement libre et n’a donc pas besoin de quelqu’und’autre pour le devenir –, il faudrait alors opposer, en tant quecorrectif, le modèle d’un rapport constitutif d’autorité et deliberté, qui reconnaît que chaque sujet a besoin de quelqu’und’autre pour rencontrer sa liberté. Une antériorité qui reste« in-évidente » et qui peut seulement être révélée, crue, té-moignée, espérée, aimée.
Si cette « in-évidence » est toujours intéressée, l’évidence peutréellement être désintéressée : mais ce désintéressement et cetteindiöérence, qui semblent être la seule garantie de scientificité,risquent en même temps de se révéler comme l’abstraction laplus grossière de la réalité du phénomène.
Par conséquent, en redécouvrant une phénoménologie res-pectueuse de la complexité du phénomène de la liberté, onpourrait dire que l’on est, en même temps, politiquement libreface à l’autorité, éthiquement libre en rapport avec l’autorité etreligieusement libre grâce à elle. Il y a donc une « in-évidence »qui fonde l’évidence et sans laquelle l’évidence même n’estqu’une forme captieuse de cécité et d’oubli.
En ce sens, ce qui est « public » ne dégénère pas en « publi-cité », à la seule condition de garder une profondeur éthique etreligieuse, qui repose sur un lien strict entre l’autorité et la li-berté. On peut le constater dans les symboles et dans les ritesreligieux (mais non exclusivement religieux"ëô).
Dans cette perspective, et encore selon Grillo, la théologiepourrait prétendre au rôle de science comme science de la li-berté « en-tant-que-don-de-l’autorité ». C’est-à-dire, une théo-logie comme science qui atteste et témoigne d’une expériencehumaine large et qu’on a toujours la tentation d’oublier. Unethéologie qui peut, finalement, nous aider à redécouvrir lagénéalogie riche de notre humanité.
Comme l’a écrit le théologien Ghislain Lafont :
19.\Même si chaque symbole vit finalement dans une profondeur religieuse.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
80
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
Qui sait si toute notre théologie n’est pas ici une rééducationpénible pour des gens qui ont oublié les lois premières de l’artde vivre"? Comme si notre abondance nous avait fait perdre devue le seul rythme qui sauve, celui du don et de l’accueil"! Uneseule réalité se joue, se recueille et s’amplifie au travers des grandssymboles dont notre existence est tissée : procurer de vivre et,simplement, les accepter"; échanger des caresses, répandre etaccueillir la semence"; laisser couler son sang et changer notrevie parce que l’Autre est mort. Avec des variations d’intensité,c’est toujours l’unique mouvement de la vie qui se manifeste etse réalise"íê.
Le langage.Cependant, l’idée de liberté n’est pas le seul lieu d’émergence
de l’(insuúsante) articulation moderne entre l’autorité et laliberté. Je me propose de considérer un deuxième lieu d’émer-gence de cette nécessité de respecter la complexité et la ri-chesse de l’expérience humaine : le langage et ses rapports àla pensée.
Dans l’article susmentionné, Paul Ricœur estimait que seuleune « méditation sur les symboles » était en mesure de répondre« à une certaine situation de la philosophie et peut-être mêmede la culture contemporaine ». Une méditation sur les symbolesreprésentait en ce sens « une tentative pour échapper auxdiúcultés du point de départ en philosophie » et à « la déceptionqui s’attache à l’idée de philosophie sans présupposition ». Eneöet, « au contraire des philosophies du point de départ, uneméditation sur les symboles part du plein du langage et du sensdéjà là » : « elle veut être la pensée avec toutes ses présuppo-sitions ». Ricœur faisait remarquer la nécessité de « rechargernotre langage », de repartir du « plein du langage », au-delà du« désert de la critique"íë ». Autrement dit, il aúrmait la nécessitéde reconnaître que la communication (en tant que valeur instru-mentale) n’épuise pas l’essence du langage et qu’au fond dulangage habite quelque chose d’inexprimé : chaque mot est àson tour une métaphore, un mythe condensé. Le langage n’estdonc pas simplement une traduction, une allégorie totalementréversible entre la chose et le mot, mais il est symbole : un
20.\G. LAFONT, Eucharistie. Le repas et la parole, Paris, Cerf, 2001, p. 38.21.\Voir P. RICŒUR, « Le symbole donne à penser », art. cit., p. 60-61 (c’est nous quisoulignons).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
81
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
condensé inépuisable de stratifications de sens. Le langage n’estdonc pas totalement disponible et, s’il est vrai qu’on maîtrise unelangue, il est en même temps vrai de dire que la langue nousmaîtrise et que notre expérience est depuis toujours symboli-quement – et donc linguistiquement – instituée"íí. En ce sens,le lieu propre à la médiation symbolique (et donc, a fortiori, àcette forme particulière et fondamentale de médiation symbo-lique qu’est la médiation linguistique)"íì n’est pas l’espace quis’ouvre entre la perception et le concept, mais – bien avant –l’espace qui vit entre la sensation et la perception : il n’y a pasde perception en dehors d’un horizon symbolique déterminé"íî.Il faut en somme reconnaître, comme disait Pierre Bourdieu, que« le mot ou, a fortiori, le dicton, le proverbe et toutes les formesd’expression stéréotypées ou rituelles sont des programmes deperception"íï ». Autrement dit : les faits sont la chose la plus
22.\Comme le disait É. BENVÉNISTE : « Nous n’atteignons jamais l’homme separé dulangage et nous ne le voyons jamais l’inventant » (De la subjectivité dans le langage[1958], dans : Problèmes de linguistique générale, vol. I, Gallimard, Paris, 1966,p. 258-266 : 259).23.\Si, en eöet, il est vrai de dire que la médiation linguistique (au sens de la langue)est une forme particulière de médiation symbolique, il est, pourtant, tout aussi vrai dedire que chaque production symbolique présente un caractère linguistique (au senslarge de langage).24.\Il me semble qu’ici apparaît très clairement l’insuúsance d’une perspective à laCassirer, qui, comme on le sait, situait le lieu de la médiation symbolique entre laperception et le concept. En ce sens, le symbole ne serait rien d’autre qu’une fonctionformatrice a priori appliquée à une perception amorphe qui permettrait le passage àl’abstraction, ordonnée, du concept (voir E. CASSIRER, An Essay on Man. An Introductionto a Philosophy of Human Culture, New Haven et Londres, Yale University Press, 1944).En réalité, pour que le symbole puisse véritablement exercer sa propre médiation, ilfaut en définir le lieu à l’intérieur d’une expérience qui est, dès le départ, symboli-quement constituée. Ce n’est donc qu’entre la sensation et la perception que le symboleagit (voir L.-M. CHAUVET, Symbole et Sacrement. Une relecture sacramentelle del’existence chrétienne, Paris, Cerf, 1987)"; et c’est déjà en ce lieu, intérieur à la consti-tution de l’expérience, que la culture et le désir entrent en jeu, en tant qu’instancescollectives et individuelles, symbole et imagination. On ne peut oublier que l’expériencenécessite déjà un ordre et une orientation cohérente, bien avant ce qu’exige le conceptabstrait. Un ordre de ce type n’est jamais uniquement naturel ou uniquement culturel.Cela implique, c’est évident, que l’expérience se présente à nous chargée d’une certaineopacité : elle n’est jamais complètement traduisible en des concepts, jamais complè-tement transparente. On ne parvient jamais au moment où le monde du concept peutabandonner le monde de l’expérience après l’avoir traversé d’un bout à l’autre, en ayantcapté le message entier. Au fond, l’expérience n’est jamais complètement de l’ordre dusigne, mais elle est elle-même symbolique.25.\P. BOURDIEU, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Fayard, 2001, p. 156.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
82
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
abstraite qui soit, car ils n’existent que dans la mesure où ils sontimprégnés de symboles et de significations"íñ.
En ce sens, il me semble que le paradigme du langage seraitplus pertinent que celui de la raison pour exprimer la conditionde la connaissance humaine"íó : son indépassable point de dé-part. Le langage a toujours une histoire, mais il est universel,il se trouve partagé entre diöérentes communautés linguis-tiques, mais une traduction est toujours possible (même si,évidemment, jamais sans restes). Il faut, enfin, reconnaître qu’iln’y a pas de pensée, d’intelligence, en-dehors de l’horizon dulangage"íò. On pense toujours dans une langue. Notre penséepart toujours de présupposés linguistiquement et symboli-quement constitués : elle est donc depuis toujours à la fois liéeet libre.
Or, tout le monde connaît les risques liés à une telleperspective. Il s’agit, avant tout, du risque de tomber dans cequ’on a appelé le « nationalisme ontologique » (Jean-PierreLefebvre)"íô : une sorte de fausse réponse à l’universalismelogique, indiöérent aux langues (et tout à fait traditionnel enOccident), qui croit que les idées naissent indépendamment dulangage, et donc qu’il nous faut tout simplement trouver destraductions linguistiques (conventionnelles) pour les communi-quer. C’est l’idée moderne de l’ars characteristica universalis,plutôt que le rêve contemporain d’un anglais lingua franca :ce qu’on a appelé une conception bourgeoise, instrumentale,de la langue"ìê.
26.\Voir E. ZOLLA, Volgarità e dolore, Milan, Bompiani, 1966ì, p. 83.27.\Sur la distinction entre ces deux paradigmes interprétatifs – celui de la raison etcelui du langage –, je suis redevable à une conférence donnée par Rémi Brague àBossey (Genève) en janvier 2006.28.\En ce sens, Merleau-Ponty observait que « Le pur soi, l’esprit, s’il est bien commeune instance critique que nous opposons à la pure et simple intrusion des idées quinous sont suggérées par le milieu, ne s’accomplit en liberté eöective que par l’instrumentdu langage et en participant à la vie du monde » : M. MERLEAU-PONTY, Causeries 1948,St. Menasé (éd.), Paris, Seuil, 2002, p. 49.29.\Cité par B. CASSIN (éd.), Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire desintraduisibles, Paris, Seuil – Le Robert, 2004, p. XIX.30.\Voir P. FLORENSKIJ, Magicnost’ slova, trad. it. de G. Lingua, Il valore magico dellaparola, Milan, Medusa, 2003"; W. BENJAMIN, Schriften, Francfort, Suhrkamp Verlag,1955"; G. SCHOLEM, Der Name Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, Francfort,Suhrkamp Verlag, 1970"; J. DERRIDA, Force de loi. Le « fondement mystique de l’autorité »,Paris, Galilée, 1994.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
83
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
Mais le nationalisme ontologique n’est évidemment pas moinsdangereux. Si chaque langue est finalement incommensurableavec les autres, la possibilité d’une communication entre diöé-rentes cultures ne serait alors qu’une illusion. Notre question estdonc de savoir si nos présuppositions nous ouvrent au mondeou si, au contraire, elles nous privent de la possibilité de pro-duire un discours public qui soit universellement valable etcompréhensible. Il faut évidemment essayer de concilier les deuxsoucis : le souci de sauvegarder la possibilité d’un discoursuniversellement public et celui de ne pas faire abstraction à bonmarché des conditions concrètes dans lesquelles ce discoursprend réellement forme.
Une modernité alternative : Giambattista Vico.Je pense qu’il faut rappeler que la modernité n’a pas été, sur
ce point, à sens unique. En 1744, dans la toute dernière versionde sa Science nouvelle (=Sn44"ìë), Giambattista Vico considéraitqu’il était nécessaire de repérer ce qui est commun à tous leshommes"; et ce non pas dans une rationalité abstraite, maisdans des « idées communes », dans un « sens commun"ìí », quis’exprime dans une « langue mentale commune » aux peuples(Sn44, 161-162). Cette langue est à son tour fondée sur un« vocabulaire mental commun » à toutes les langues articulées(Sn44, 35, 162, 445). C’était la rencontre de la philosophie et dela philologie"ìì : non pas, tout simplement, pour reconstruireune histoire ou une collection de faits, de langues, ou de cou-tumes prérationnels, mais pour essayer d’en connaître l’unifor-mité, les traits communs, et ce dans le dessein de reconstruireune « histoire idéale éternelle » : à savoir, la loi éternelle, uni-
31.\G."B. VICO, Principi di una scienza nuova intorno alla comune natura delle nazioni(1744), in : Opere, A. Battistini (éd.), Milan, Mondadori, 1990, tome I, p. 411-971"; trad.fse de A. Pons, Principes d’une science nouvelle relative à la nature commune desnations, Paris, Fayard, 2001"; dorénavant, le chiöre qui suit indique le paragraphe dutexte de Vico d’après l’édition établie par F. Nicolini, référence de toutes les éditionsmodernes.32.\À savoir : « un jugement sans aucune réflexion, senti en commun par tout unordre, par tout un peuple, par toute une nation ou par le genre humain tout entier »(Sn44, 142).33.\En eöet, Vico pensait qu’avant lui avaient « échoué à moitié les philosophes quine donnèrent pas à leurs raisonnements une certitude tirée de l’autorité des philologues,et les philologues qui ne se soucièrent pas de donner à leur autorité le caractère dela vérité grâce aux raisonnements des philosophes » (Sn44, 140).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
84
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
forme (et donc vraie) du développement des esprits et descivilisations"ìî.
Dès les premières pages, dédiées à l’explication de la gravure(« dipintura ») mise en exergue à son œuvre, Vico faisait étatd’un « nouvel art critique » (Sn44, 7, 143, 348). « Nouveau » quantà la matière : non plus les choses de la nature, mais les chosesciviles, les productions humaines. Et « nouveau » quant à laméthode : non plus une critique qui prétende partir du vide(comme celui du cogito cartésien, qui fait epoché de tout àl’exception de la pensée), mais une critique qui interroge laphilologie, c’est-à-dire « les histoires des langues, des coutumeset des faits des peuples dans la paix comme dans la guerre »(Sn44, 7)"ìï. Une critique, donc, qui parte du plein d’une histoire.Par conséquent, une science nouvelle aussi bien pour la matière :l’homme et ses productions, que pour la méthode : une philo-sophie fondée sur la philologie, une raison fondée sur l’autorité,un commun inséparable du particulier. Une vérité vérifiée.
Vico voulait faire de la science, mais il pensait que sa sciencene pouvait commencer qu’à partir du moment où son objetcommence eöectivement"ìñ. Il ne fallait donc pas partir de laréflexion des philosophes, mais de la première pensée humaine,qui a été une pensée guidée par le « certain » de l’autorité dusens commun. Une autorité anthropologique et sauvage, que laréflexion critique a toujours eu la tentation d’oublier (Vico parleà ce propos de deux vanités : celle des doctes et celle des
34.\Voir Sn44, 35, 145; les principes de l’histoire idéale sont exposés aux paragraphes§ 239-245, puis encore jusqu’aux paragraphes § 294, 349, 393, où l’histoire idéale éternelleest la même SN parce que considérée dans l’un de ses aspects.35.\Alors que Descartes pensait pouvoir trouver un savoir certain dans le vide formeldu cogito, Vico – relativement au principe du verum-factum – pensait que la seule véritécertaine résidait dans le monde produit par l’homme : le monde civil (cfr. Sn44, 349).Déjà dans le De Ant. (1710), Vico avait établi que le critère de vérité d’une chose résidedans le fait de l’avoir produite (cfr. G."B. VICO, De antiquissima italorum sapientia,éd. M. Sanna, Rome, Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, livre I, chap. I, § III). Et bienavant, dans le De nostri temporis studiorum ratione (1708), Vico avait écrit : « Geometricademonstramus, quia facimus"; si physica demonstrare possemus, feceremus » (voirG."B. VICO, Il metodo degli studi del nostro tempo, éd. B. Loré, Florence, La Nuova Italia,1993, chap. IV). Aúrmation qui sera reprise à l’identique dans le De Antiquissima,chap. III.36.\Vico était en eöet convaincu que la compréhension de la nature d’une chose dé-pendait de l’étude des modalités de sa naissance : « La nature [natura] des choses n’estrien d’autre que leur naissance [nascimento] en certaines manières [guise]"; tels sont lestemps et les manières, telles et non autres naissent toujours les choses » (Sn44, 147).
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
85
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
peuples"ìó), mais aussi une autorité qu’on ne peut pas nier sil’on veut finalement faire de la science. La langue joue ici le rôlede médiateur, et ce grâce à la constitution linguistique de l’auto-rité (sauvage) du corps, et de la vérité (critique) de la raison"ìò.Le corps assure une médiation entre le dedans et le dehors, ilassimile le monde extérieur en le traduisant et en l’humanisant(du point de vue de la production des mythes également). Laraison, quant à elle, travaille sur des données déjà linguisti-quement instituées et digérées. Le plein à partir duquel la critiqueest appelée à travailler est ainsi – selon les mots de Ricœur –le « plein du langage » : elle ne peut donc se configurer quecomme philosophie à partir de la philologie.
Il n’y a donc pas d’idées qui naissent en-dehors de la langue– qui a aussi une histoire : de la langue muette des gestes rituels,à travers la langue des formules stéréotypées, standardisées et,pour certaines, jusqu’à la langue articulée du discours (Sn44, 31).Mais, à leur tour, les diöérentes langues articulées se fondentsur un vocabulaire mental commun, qui remonte aux temps del’autorité sauvage du corps, qu’aucune d’entre elles ne peutépuiser totalement. Chaque langue est ainsi une Weltans-chauung, une vision du monde, qui en saisit un aspect sanspourtant l’épuiser.
Selon Vico, ce qui est commun aux hommes est donc l’auto-rité d’un plein symboliquement institué, qui constitue la façonoriginaire du rapport au monde et qui, en même temps, n’est
37.\Vico était persuadé que sa recherche de ce qui était « comune » aurait permis dedépasser les deux vanités (« borie ») qui, avant lui, empêchaient une compréhensioncorrecte de l’homme : la vanité « des nations » (Sn44, 53; 330), selon laquelle chacuned’entre elles se considérait comme la plus antique au monde, et la vanité « des doctes »(Sn44, 59, 127, 284, 330, et dans d’autres passages encore où les deux vanités apparaissentsimultanément), selon laquelle chacun d’entre eux considérait que son savoir étaittout aussi ancien que le monde. J. Trabant, qui a vu dans la critique de Vico une reprisede la critique de Bacon sur les Idola, traduit avec finesse la suúsance des doctes dansle logocentrisme (aspect qui rapprocherait Vico de Derrida) et la suúsance des nationsdans l’ethnocentrisme : voir J. TRABANT, Die neue Wissenschaft von alten Zeichen.Vicos Sematologie, Suhrkamp, Francfort, 1994.38.\Voir Sn44, 1045 : « En résumé, l’homme n’étant proprement qu’esprit [mente], corpset parole, et la parole étant comme placée au milieu entre esprit et corps, le certainrelativement au juste commença dans les temps muets avec le corps"; ensuite, quandles langues dites articulées eurent été trouvées, il passa à des idées rendues certainespar des formules verbales"; enfin, quand notre raison humaine fut entièrement dé-veloppée, il parvint à son terme dans le vrai des idées relatives au juste, telles qu’ellessont déterminées par la raison d’après les moindres circonstances des faits. »
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
86
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
jamais totalement disponible et traduisible dans des concepts etdans des discours. En d’autres termes : un plein qui donnetoujours à penser (et qui exige d’être pensé) et une penséequi est depuis toujours à la fois liée et libre. La critique ne seconfigure pas en opposition à la tradition"; au contraire, elle estune de ses fonctions"ìô.
Une confrontation avec Jean-Marc Ferry.Afin d’essayer de traduire dans des termes plus contemporains
ce discours d’une critique à partir d’un plein et non pas, selonle modèle cartésien du cogito, à partir d’un vide, je crois qu’ilest utile de se référer à un livre récent de Jean-Marc Ferry intituléLes Grammaires de l’intelligence"îê. Le dernier chapitre – « Laformation de l’intelligence critique. Du sens commun à la raisonpublique » – est tout à fait pertinent pour nos réflexions. Onn’a pas besoin de s’attarder sur les diöérences évidentes entreVico et Ferry : entre un « commun » aux hommes, qui est trouvépar Vico dans un commun symboliquement constitué, et parFerry dans des structures grammaticales et syntactiques for-melles. L’élément qui, à mon sens, rapproche les deux propo-sitions réside dans l’idée que la critique travaille à partir d’uneopacité archaïque et, en même temps, que c’est la critique qui,finalement, nous permet de comprendre la valeur de ce qui(nécessairement) la précède, la fonde et l’accompagne. En cesens, c’est l’intelligence critique, la « grammaire 4 » (l’expressionest de J.-M. Ferry), qui peut finalement reconnaître, en permettantde distinguer entre diöérents ordres de validité, la valeur de« détecteur de réalité » (l’expression est de P. Ricœur"îë) desgrammaires 1 et 2 – les grammaires propres à l’intelligence desicônes et des indices (les manifestations d’ordre symbolique del’inconscient – individuel et collectif – et des cultures archaïques).C’est seulement la grammaire 4 – la seule, je le répète, apte àdistinguer entre diöérents ordres de validité – qui peut reconnaî-tre la vérité du « certain » de l’autorité (sauvage) des symboles,et la vérité des énoncés verbaux propres à la grammaire 3 (lagrammaire propositionnelle, conjonctive et syntaxique). La gram-
39.\Voir E. ZOLLA, Che cos’è la tradizione, Milan, Adelphi, 2003í, p. 143.40.\J.-M. FERRY, Les Grammaires de l’intelligence, Paris, Cerf, 2004.41.\P. RICŒUR, « Le symbole donne à penser », art. cit., p. 74.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
87
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
maire 4, qui est également en mesure d’appliquer à soi-mêmeson discours, en reconnaissant que sa propre vérité critique setrouve toujours dans l’ordre des recommandations et non desconstatations. C’est-à-dire qu’elle est moins un point de départqu’un principe régulateur. La grammaire 4 découvre la valeur devérité des grammaires non argumentatives 1 et 2, et elle découvreégalement qu’il n’est pas possible de les délaisser, à cause deleur capacité d’ouvrir, de découvrir et de déchiörer des domainesd’expérience. Les symboles constituent alors « la langue » indé-passable des expériences fondamentales de la vie : la médiationnécessaire dans notre rapport au monde. Mais ici, on est peut-être allé au-delà des intentions de Ferry.
En tout cas, je crois que ce n’est pas un hasard si les propo-sitions de Vico et de Ferry se rencontrent dans une conceptiongénétique de la liberté"îí, et donc dans une perspective tout à faithétérodoxe par rapport à la fiction moderne d’un homme quel’on considère comme déjà libre dès sa naissance. Comme lesouligne Ferry, le premier article de la Déclaration universelledes droits de l’homme ne fait sens que comme énoncé régulatif,tandis qu’il est faux et presque absurde comme énoncé consta-tif"îì : on est toujours en chemin vers notre liberté. Notre penséeest toujours en même temps liée et libre. Le fait de ne pas le re-connaître signifie qu’on s’en remet à des mythologies de la raison.
E N G U I S E D E C O N C L U S I O N :L A S C I E N C E E T L ’ A U T O R I T É D E L ’ O B J E T
La conjoncture inhospitalière actuelle rappelle à une théologietrop tentée d’arriver aux réponses sans s’arrêter sur la valeur desquestions, que l’espérance dont elle est porteuse n’est pasévidente pour tous. Et donc qu’elle n’est pas évidente en soi(et ce, même si la théologie sait très bien que son espérance« in-évidente » est tout à fait précieuse pour l’évidence mêmede l’espace public). La théologie doit, d’une part, reconnaîtrecomme sienne la tâche de traduire dans la langue des hommesdu XXI§ siècle le trésor qu’elle a reçu et qui a la valeur d’une
42.\Voir J.-M. FERRY, op. cit., p. 16.43.\Ibidem, p. 201.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
88
R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N • 2 5 2
autorité inépuisable, qui donne toujours à penser. Une autoritéqui demande par là même à être pensée : fides quaerensintellectum. Cette tâche essentielle, la théologie peut vraimentl’honorer, même en-dehors de l’université (non sans que l’onenregistre des pertes pour la théologie et pour l’université).
Cependant, de nos jours, la théologie peut avoir égalementune autre tâche : celle de se présenter comme un modèle pourune science qui soit capable de prendre au sérieux l’autorité deson objet, ainsi que de ses manifestations.
Je précise mon propos. Comme le disait Georges Chantraine,à la question « en quoi la théologie est-elle ”scientifique“"? », ilfaut répondre que « comme toute science, elle l’est en ce quesa connaissance est déterminée par son Objet"îî ». C’est en cesens qu’on pourrait paradoxalement se demander, avec Barth :« L’objet même de la théologie ne devrait-il pas être pour toutescience l’archétype et le modèle de l’originalité et de l’autoritédes objets dont elle s’occupe"; et, de même, la primauté de larationalité de l’objet de la théologie par rapport à la connaissancehumaine, ne devrait-elle pas être exemplaire pour la pensée etl’expression scientifique en général"îï"? » En ce sens – encoreselon Barth –, la théologie « est en toute modestie une sciencelibre, c’est-à-dire respectant la liberté de son objet, et parconséquent une science sans cesse libérée par son objet"îñ ».« De ce point de vue, elle est une science éminemment cri-tique, c’est-à-dire constamment exposée à la crise qui lui vientprécisément de son objet et dont elle n’est jamais aöranchie"îó. »À la question de savoir quel est le lieu propre de la théologie– l’Église ou l’université"? –, il faut donc répondre que « lascientificité constitue la modalité spécifique selon laquelle lathéologie réalise sa propre qualité ecclésiastique"îò ». La théo-
44.\Mais le théologien jésuite ajoutait encore que si la théologie « remplit cette conditionpropre à la science, elle le fait d’une manière qui n’appartient qu’à elle seule » : « commetoute science, elle vise son objet"; mais bien davantage, dans sa démarche essentielle,elle procède de cet Objet même » (G. CHANTRAINE, Vraie et fausse liberté du théologien,Paris – Bruxelles, Desclée de Brouwer, 1969, p. 82).45.\K. BARTH, Einführung in die evangelische Theologie, Zurich, EVZ-Verlag, 1962";tr. fr. cit., p. 89.46.\Ibidem, p. 11.47.\Ibidem, p. 12.48.\Voir" A." BERTULETTI," La" legittimazione" della" teologia," in :" G." COLOMBO" (éd.),Il teologo, Milan, Glossa, 1989, p. 164-200, ici 195.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
89
A U T O R I T É V E R S U S L I B E R T É
logie est donc en même temps science et crise du concept descience : elle peut non seulement prétendre être une science,dans la mesure où il n’y a pas de science totalement exemptede présuppositions, mais elle peut également jouer un rôle decritique radicale des idéologies, dans la perspective de ce qu’ona appelé, avec Derrida, une université « sans condition ».
Comme le disait déjà Max Weber, dans sa conférence sus-mentionnée : « S’il en est ainsi, on voit que, malgré la théologie(ou plutôt à cause d’elle), il existe une tension insurmontable (queprécisément la théologie nous révèle) entre le domaine de lacroyance en la ”science“ et celui du salut religieux"îô. » Tensioninsurmontable (et théologiquement révélée) qui peut vraimentcontribuer à nous délivrer de l’emprise d’une croyance naïve etimplicite dans la science et ses dieux.
On pourrait finalement appliquer à la théologie la tâche queRémi Brague a indiquée à l’Europe : elle devra faire preuve àla fois de Selbstbewusstsein et de Self-consciousness : deuxapparents synonymes qui désignent en fait des contraires. Lathéologie devra faire preuve de Selbstbewusstsein et donc êtreconsciente de sa valeur, par rapport à la barbarie de notre temps,trop tenté d’oublier la complexité de l’humanité de l’homme :de la richesse de son expérience et de la généalogie de sondevenir homme. Mais elle devra, en même temps, faire preuvede Self-consciousness : être consciente de son indignité, parrapport à ce dont elle n’est que la messagère et la servante"ïê.
S t e f a n o B i a n c uUniversité de Lausanne,
Université catholique de Milan
49.\M. WEBER, Wissenschaft als Beruf, p. 108"; trad. fse, p. 95.50.\Voir R. BRAGUE, Europe, la voie romaine, Paris, Criterion, 1992, p. 169.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
- -
84.
221.
163.
104
- 07/
08/2
016
16h2
9. ©
Edi
tions
du
Cer
f Docum
ent téléchargé depuis ww
w.cairn.info - - - 84.221.163.104 - 07/08/2016 16h29. ©
Editions du Cerf
![Page 1: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Autorité versus liberté? Théologie et savoir rationnel dans l'espace public [Authority VS Freedom? Theology and Rational Knowledge in the Public Space], «Revue d'Ethique et de](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051512/6344e175596bdb97a908aab8/html5/thumbnails/22.jpg)