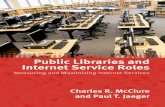éclairage public
-
Upload
univ-mosta -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of éclairage public
Plan de travail: Introduction. Définition. Objectifs . les fonctions . Classification et principes d’éclairage par type de voies. Lumière Et L’urbanisme. Relation espace / lumière. Différentes méthodes d’implantation des candélabres. Les composants d’un lampadaire . les types d'ampoules . Les types de lampadaires : Luminaires à éviter. Luminaires à conseiller. Les horaires de fonctionnement . Choisir le mode de fonctionnement . Les solutions nouvelles en terme d’éclairage . Conclusion . Résumé . Bibliographie .
Introduction : Qu'est-ce qu’un Éclairage ? Bien que chacun de nous passe sa vie entière dans des milieux éclairés, il est bien difficile de caractériser spontanément ce qu'est l'Éclairage, Souvent confié à l'électricien quand il est artificiel, et au Bon Dieu quand il est naturel
la notion la plus importante De l'éclairage : la vision. Mais pour mettre en œuvre la vision, il faut de la lumière c'est l'association entre la lumière et la vision qui définit l'Éclairage et qui introduit cette science particulière et complexe : L'Éclairagisme.
L’éclairage public (EP ) consiste à installer un système de plusieurs appareils d’éclairage qui permettent d’offrir une ambiance confortablement éclairée selon l’espace considéré et suivant la luminance moyenne .de la chaussé proposée par les norme.
L’éclairage des espaces considérés comme espace public sont:
éclairage des espace verts . éclairage décoratif (projecteur) . éclairage routier (voirie) .
Définition :L'éclairage public est l'ensemble des moyens d‘éclairage mis en œuvre dans les espaces publics , à l'intérieur et à l'extérieur des villes, très généralement en bordures des voiries et places, nécessaires à la sécurité ou à l'agrément de l'homme.
Objectif d’éclairage public : Les recommandations distinguent un éclairage « fonctionnel » (amélioration de la visibilité), d’une part, et trois usages de l’éclairage spécifiques au milieu urbain : l’aspect paysager (perception de l’espace, continuité visuelle, esthétique), l’ambiance lumineuse, et le guidage visuel. L’amélioration de la visibilité permet, selon les recommandations :
→ de favoriser la sécurité des déplacements .
→ de diminuer l’éblouissement du aux feux de véhicules .
→ d’améliorer l’estimation des distances .→ de favoriser la sécurité des personnes et des biens .
→ de permettre une vie urbaine nocturne . → de valoriser les espaces publics.
les type d’éclairage: Actuellement, l’éclairage occupe plusieurs fonctions au sein de
l'environnement public extérieur. Il sécurise, guide, balise, mais aussi met en valeur, donne une ambiance aux espaces.
L'éclairage se divise en plusieurs catégories, dont chacune remplit des fonctions bien spécifiques . On a ainsi différents types d’éclairage :
o L'eclairage fonctionnel : L'enjeu premier est de sécuriser. L'esthétique du matériel d'éclairage et le rendu des couleurs ne sont pas prioritaires. Il s’agit souvent d’un éclairage uniquement routier.
o L'eclairage decoratif :Le mobilier et l'éclairage participent à l'esthétique urbaine. Ils doivent rendre le lieu agréable à vivre, tout en le sécurisant. Le matériel d'éclairage doit donc procurer un bon rendu visuel diurne, comme nocturne . L’éclairage d’agrément sera utilisé pour un éclairage routier, piétonnier ou mixte routier/piéton.
L'eclairage d'accentuation :l’éclairage doit mettre en valeur un site, en créant une ambiance singulière. Il lui offre ainsi un visage nocturne par une illumination et/ou un balisage adapté. L'éclairage d'accentuation n'est à priori pas destiné à sécuriser un lieu.
les illuminations festives : ces illuminations non permanentes s'attachent à un évènement particulier, souvent synonyme de fête. Les illuminations festives ne sont pas destinées à sécuriser un lieu.
Un projet d’éclairage doit être spécifié dans un cahier des charges contenant, notamment, les enjeux urbains, les objectifs du projet et les contraintes techniques. Les fonctions du site et ses usages doivent, autant que possible, être connus avant la réalisation du projet, de jour comme de nuit.
Classification et principes d’éclairage par type de voies et places :
Trois types de voies sont identifiés, selon la nature du trafic : voies motorisées (autoroutes), voies mixtes (rues ou avenues), espaces prioritairement piétonniers. On résume ci-dessous les principes d’éclairage correspondant aux principales sous-catégories :
• Voies mixtes : Le « vélum lumineux » est défini comme le volume virtuel formé par les sources lumineuses. C’est un paramètre de l’aménagement qui peut orienter le choix du projet, en fonction des connotations que l’on veut donner à une avenue.
• Un projet doit tenir compte à la fois de la hauteur et de la qualité architecturale du bâti, de la présence éventuelle d’arbres et d’enseignes lumineuses, et de la nature des différents quartiers traversés.
• Voies piétonnes : La priorité est la création d’une ambiance « agréable ». La visibilité et l’absence d’éblouissement sont des critères importants, ainsi que la lisibilité des lieux, notamment les transitions avec le réseau à dominante automobile. On recommande d’éclairer le façades, de manière à agrandir le « vélum ». On recommande également de contractualiser ou de réglementer l’éclairage commercial, de manière à l’intégrer aux projets.
• Voies plantées : L’ombre portée des arbres, en été, impose la disposition des luminaires (entre deux arbres, avec une crosse qui tient compte du volume du feuillage), et le plus souvent l’éclairage spécifique des trottoirs. Des régimes d’éclairage différents selon la saison doivent être envisagés.
Places : L’essentiel est de hiérarchiser les priorités visuelles et les ambiances nocturnes, en concordance avec les différentes voies accédant à la place.
Carrefours : L’objectif principal est d’assurer la lisibilité du carrefour, donc de créer une rupture pour les axes accédant au carrefour, tout en insérant celui-ci dans l’espace urbain. En ville, l’utilisation d’un candélabre central n’est pas conseillé.
Entrées d’agglomération : Même si la sécurité de la circulation doit rester l’objectif prioritaire, notamment à travers une incitation à réduire la vitesse, d’autres paramètres doivent être intégrés au projet : la lisibilité de la ville et de ses accès, le repérage et l’orientation.
Promenades et espaces verts : L’éclairage de cheminements « proposés » est un outil important à la disposition des concepteurs. Le respect de zones d’ombres et l’utilisation judicieuse du balisage lumineux apparaissent également comme des principes directeurs utiles. L’éclairage paysager des parcs doit tenir compte de l’aspect qu’ils présentent, de l’extérieur, pendant les heures de fermeture.
• Lumière Et L’urbanisme:
La conception de la lumière ne peut plus être dissociée de la programmation des équipements et de la façon dont seront pratiqués et gérés les espaces urbains.
La lumière doit participer à l’urbanisme car elle détermine le caractère de la ville.
C’est au sein d’une équipe de conception regroupant les compétences de l’urbaniste, de l’ingénieur, de l’artiste, du gestionnaire, que doit s’élaborer le projet lumière .
Relation espace / lumière: La nuit efface la
ville, les espaces non éclairés disparaissent du paysage urbain; certains lieux; retrouvent leur propre identité (Édifices remarquables, monuments, espaces de promenade et de rencontre, tc.) La lumière est un révélateur d’espaces.
unilatérale : quelque soit la voirie, l’implantation ne se fait que sur un seul côté
Ce type d’implantations proposées dans la condition ou h (hauteur de candélabre) est supérieur ou égale à largeur de la voie de circulation. Ceci est choisi pour que la route soit bien éclairée.
Différentes méthodes d’implantation des candélabres: o La plupart du temps, les mâts sont
implantés d’un seul côté de la rue à éclairer. Cette installation est le moins onéreuse. lh
• Les points lumineux sont implantés des deux côtés de la chaussée. Ils sont en vis-à-vis lorsqu'ils se font face ou sont en quinconce lorsqu'ils sont implantés à mi-distance longitudinale les uns des autres. Cette solution convient particulièrement lorsque la chaussée à éclairer est large. Pour les routes à chaussées séparées, lorsque la bande de séparation des voies n'est pas suffisamment large, les mâts sont implantés de cette façon pour éclairer le tout.
En quinconce et bilatérale : Les candélabres doivent être installées
d’une manière alternée de part et d’autre de la voirie .
Cette configuration est choisie pour la condition
Implantation en opposition ( bilatérale vis-à-vis Cette implantation est choisie si :
lhl 32
232 lhl
d ) implantation axiale Cette configuration
est proposée dans le cas où h>l• L’implantation axiale :
• Est également adaptée aux voies piétonnes((il faut que les luminaires soient fixés en top sur les mâts, et que leurs flux soient symétriques de façon à ce qu'ils éclairent d'une façon homogène tout autour de chaque mât). On choisira alors un luminaire ayant un flux symétrique permettant d’éclairer tout autour du mât.
o La hauteur des mâts varie de 4 m à 10 m environ.
o Elle est définie selon la largeur d’éclairage voulue. Sur ces mâts, des crosses peuvent être
o installées à différentes hauteurs, en un, deux, voire en un plus grand nombre de points.
A proximité de bâtiments, les luminaires peuvent être accrochés directement en applique murale, évitant ainsi la mise en place de mâts.
Dans la catégorie des éclairages décoratifs, on retrouve les bornes et les colonnes d’éclairage. Elles sont principalement adaptées aux espaces piétonniers.
L'implantation des mâts (hauteur, inter-distance entre les candélabres) se fait en fonction des études photométriques, en fonction du rendu visuel souhaité et en fonction des critères propres à chaque site, tels la largeur de la voirie, la fréquentation de la rue, la composition du lieu, les coûts à respecter...
Chaque projet doit être scrupuleusement étudié dans tous les détails pour que sa réalisation soit la plus appropriée au site. Les différents éclairagistes, spécialisés dans le domaine, réalisent sur demande, ce genre d’études.
Exemple d’études d’éclairagiste – A gauche : Rendu 3D – A droite : Rendu fausse couleur
. Quels types d'ampoules ?
Utiliser pour l’éclairage public :• des lampes au sodium basse pression .• des lampes au sodium haute pression .• des lampes de température de couleur < 2 300 K. Il faut dans la mesure du possible éviter la lumière
blanche et privilégier les ampoules au sodium à dominante jaune, qui permettent de limiter la réponse des organismes vivants à la lumière artificielle.
Les lampes au sodium offre par ailleurs une problématique de cycle de vie (production, recyclage , élimination) sans inconvénient significatif.
V- Lampes à vapeur de sodium : Ce sont les lampes à décharge qui donnent le maximum d’efficacité
lumineuse. Elles sont en deux types selon la valeur de la pression de vapeur de sodium que règne dans le tube à décharge : basse pression ou haute pression.
Ces lampes fonctionnent sous une tension de 220v avec un ballast selfique, l’amorceur pouvant être incorporé ou externe.
1- Lampes à vapeur de sodium basse pression : Elles se présentent sous la forme de tube en U protégé par une
ampoule cylindrique en verre. Les principales caractéristiques sont : Gamme de puissance : 18 à 180w Efficacité lumineuse 130 à 180 lm/w Durée de vie : 8000 à 12000 heures Indice de rendu des couleurs : lumière jaune-orange
2- Lampes à vapeur de sodium haute pression : Elles peuvent se présenter sous la forme de tube linéaire, d’ampoule
ovale satinée ou d’ampoule cylindrique. Le tube à décharge logé à l’intérieur est réalisé de manière à
supporter la température et la pression élevées. Les principales caractéristiques sont :
Gamme de puissance : 50 à 1000w Efficacité lumineuse : 60 130lm/w Durée de vie : 1000 à 12000 heures Indice de rendu des couleurs : 25
Quels types de lampadaires ? Utiliser uniquement des réflecteurs• à haut rendement• sans émission lumineuse au dessus de l’horizon L’utilisation de réflecteurs dirigeant la lumière seulement
vers les zones où elle est nécessaire autorise l’emploi de lampes d’une puissance électrique moins élevée. De plus, toute émission vers l’horizon, est éblouissante, et au-dessus de l’horizon, inutile, éclairant le ciel (pollution lumineuse).
Si de plus, du fait de l’inclinaison de la crosse, le luminaire n’est pas orienté horizontalement, son efficacité énergétique est réduite très significativement, et contribue de nouveau à une émission horizontale, motif principal des intrusions de lumières dans les propriétés et les habitations.
Certains disposent de réflecteurs efficaces qui dirigent la lumière là où elle est nécessaire, et d’autres pas. Le meilleur type – c’est celui que nous préconisons – est celui des lampadaires à « défilement absolu » dit « Full Cut Off ».
L’allumage est alors fonction de la luminosité effectivement mesurée
Les horaires de fonctionnement :
Allumage le soir : quand la luminosité descend sous 20 lux pendant plus de 10 minutes. Extinction durant la nuit (p. ex. 23h30 – 05h30).
Réduction de l’intensité lumineuse la nuit si une extinction n’est pas possible (variation de la puissance lumineuse ou extinction partielle).
L’allumage par minuterie est parfois imprécis. Il est préférable d’asservir l’allumage :
. sur une horloge dite astronomique, qui prend en compte les variations journalières des paramètres crépusculaires .
sur un capteur de luminosité, pour lequel on devra s’assurer de l’absence de salissures ou d’ombre. L’allumage est alors fonction de la luminosité effectivement mesurée.
Choisir le mode de fonctionnement : Dans certaines communes l’éclairage public est encore allumé de façon permanente de la tombée de la nuit au lever du jour. Or, on peut se poser la question de l’utilité d’un tel éclairage sur la totalité du territoire d’une commune ?
La diminution de la pollution lumineuse et les économies d’énergie poussent aujourd’hui les communes à réfléchir sur leur façon d’éclairer. Il existe des équipements qui permettent de gérer précisément les durées d’allumage et les puissances. On peut ainsi faire le choix :
d’un éclairage réduit : le niveau d’éclairement est maximum à la tombée de la nuit et au lever du jour alors que la puissance d’éclairage baisse en pleine nuit. Cette solution est possible grâce à des réducteurs de puissance. Cela contribue à une petite réduction de la pollution lumineuse et à la réalisation d’économies d’énergie.
d’un éclairage interrompu : les points lumineux sont éteints pendant une période de la nuit. En comparaison avec l’éclairage réduit cité précédemment les diminutions de pollution lumineuse et les économies d’énergie sont plus importantes. Toutefois, cet éclairage ne peut être utilisé que sur des axes ou espaces peu fréquentés voir pas fréquentés la nuit.
Les solutions nouvelles en terme d’éclairage : L’éclairage LED : Les LED offrent des solutions à basse consommation énergétique. Les gammes de produits LED sont en constante évolution. On arrive aujourd’hui à trouver des produits d’éclairage LED aussi bien en domaine routier qu’en domaine urbain ou pour les illuminations festives.
Les LED sont un facteur d’avenir cohérent avec les notions de développement durable car :
leur efficacité lumineuse est en progrès constant elles offrent des possibilités de variation d’intensité instantanée pour économiser l’énergie elles sont dépourvues de mercure et affichent une longue durée de vie (à confirmer au fur et à mesure des retours d’expérience)
Il est toutefois important de préciser qu’aujourd’hui le coût des appareils à LED reste élevé et que malgré les économies d’énergie le temps de retour est assez long.
A noter également que : le coût de fonctionnement risque d’être assez important du fait du remplacement complet de la lanterne à LED le recyclage des lanternes à LED est assez flou
Cinq avantages des LED pour l’éclairage public1. Grande efficacité énergétique2. Longue durée de vie3. Bonne régulabilité (lumière immédiate, bon réglage du flux)4. Lumière blanche avec un bon rendu des couleurs5. Lumière dirigée avec une faible dispersion Cinq inconvénients des LED pour l’éclairage public1. Technique coûteuse, investissements élevés2. Disponibilité des pièces détachées pas toujours assurée3. Composants non standardisés (dépendance d’un produit)4. Inexpérience sur la longue durée5. Evolution technique non encore aboutie
Les lampadaires à énergie solaire: L'énergie solaire en alimentation d’un éclairage peut
apporter des solutions intéressantes en ce qui concerne l'éclairage urbain, notamment lorsqu’il n’existe pas de ligne électrique à proximité du candélabre.
Son installation doit être bien étudiée. Le panneau photovoltaïque devra être parfaitement bien orienté pour recevoir un maximum d’ensoleillement. La taille du panneau est calculée en fonction de l’ensoleillement et de l’usage du lampadaire (voie très passante, lieu calme…). Plus le panneau photovoltaïque est grand, plus le prix d’achat du matériel sera important.
Ainsi, dans une zone géographique où les temps d’ensoleillement sont moyens, un tel lampadaire sera peut-être plus adapté à des zones où l’éclairage demandé n’est pas trop intensif (à proximité d’un arrêt de bus isolé, sur un parking utilisé ponctuellement…).
Même si les frais d’installation sont moindres et les économies d’énergie non négligeables, le prix d’achat d’un tel matériel reste élevé.
Enfin, le risque de vandalisme surtout en lieu isolé, doit être pris en considération.
Les lampadaires hybrides utilisant lesénergies éolienne et solaire:
Plus autonome qu’un luminaire LED alimenté uniquement par l’énergie solaire, ce type de matériel permet un éclairage plus intensif de l’espace public. Son utilisation, aujourd’hui plutôt expérimentale, tend à se développer. Ce type de matériel étant une solution marginale, son prix d’achat est élevé.
Enfin, le risque de vandalisme, surtout en lieu isolé, doit être pris en considération.
Conclusion : Lumière est un autre monde quotidien élément a part entière de qui a deux dimensions :
Positive : la lumière est source de plaisir de confort de rêve et de d’émotion .
Négative : la lumière peut être une source de gène d’inconfort et perturbant le champ visuel ou l ’ésotérique urbaine .
La fusion de deux dimensions conduit à s’interroger sur la lumière urbaine actuelle de nos ville et la notion de maitrise des ambiances urbaine nocturne .
Résumé 7 étapes vers un éclairage extérieur à impact
environnemental maîtrisé, avec 3 points de vigilance pour lesquels il faut être particulièrement attentif :• Plafonner la température de couleur des lampes,• Plafonner la puissance lumineuse moyenne des installations,• Plafonner la consommation énergétique des installations.
Bibliographie : Exposé éclairage public ______slideshare (
http://fr.Slideshare.Net/saamysaami/eclairage-publique?Related=1)
Http://www.Solalgerie.Com/index.Php?Option=com_content&view=article&id=27&itemid=57
Http://www.Solar-constructions.Com/wordpress/eclairage-led-solaire-parc/
r réseaux d’éclairage public PDF (http://fr.Slideshare.Net/fetrasoa/eclairage-public?Related=2) .
Éclairage urbain PDF . Exposé éclairage lumière en architecture PPT . Guide l’éclairage public, Vers un éclairage juste .
PDF Recommandations techniques pour l‘éclairage public.
PDF Dossiers « La Lumière Durable » et « L’Eclairage
Public au Cœur » . Site Internet : http://eclairagepublic.free.fr Site Internet : http://energies-nouvelles-
entreprises.fr Site Internet : http://
solutionsnouvelles.ex-flash.com . http://www.calameo.com/read/0008998694f958338254a .