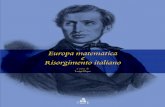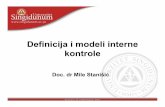La maladie de Minamata et le conflit pour la reconnaissance (Ebisu 2003)
ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET EN MEDECINE INTERNE AMBULATOIRE LIBERALE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET EN MEDECINE INTERNE AMBULATOIRE LIBERALE
10
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
ATTEINTE OCULAIRE AU COURS DE LA MALADIE DE BEHÇET EN
MEDECINE INTERNE AMBULATOIRE LIBERALE Said Elkettani
Cabinet de médecine interne Bd Abderrahmane Skiraj, N°2, Settat, Maroc
RESUME
Introduction, Objectif La maladie de Behçet est une
vascularite systémique. L’atteinte oculaire en
représente l’un des critères majeurs de diagnostic et de
pronostic. Les séries publiées concernent presque
exclusivement les patients suivis dans des hôpitaux. Ce
travail a été entrepris pour déterminer les particularités
cliniques, diagnostiques et pronostiques de l’atteinte
oculaire de patients, pris en charge, dans un cabinet
libéral de médecine interne, d’une ville moyenne
marocaine en l’occurrence Settat.
Patients et méthodes. Il s’agit d’une étude descriptive
rétrospective réalisée de septembre 2009 à mars 2014.
Elle a concerné 89 patients âgés de 13 à 65 ans, dont
47,6% sont de sexe féminin, présentant une maladie de
Behçet retenue sur l’une des quatre définitions les plus
utilisées à savoir, Masson et Barns, Groupe
International d’étude sur la maladie de Behçet, Comité
de recherche japonais sur la maladie de Behçet et
Davatchi. Les patients, atteints de maladie de Behçet,
ont été divisés en deux groupes. Un premier groupe
composé de 40 patients (44,9%) présentant une atteinte
oculaire et un deuxième groupe composé de 49 patients
(55,1%) sans atteinte oculaire.
Résultats. L’atteinte oculaire occupe la deuxième
place (44,9%) après l’atteinte cutanéo-muqueuse
(97,8%) et avant l’atteinte articulaire (21,3%). La
moyenne d’âge est de 42,4 ± 12,7 ans dans le premier
groupe vs 38,9 ± 9,2 ans dans le deuxième groupe (p =
0,14). La même différence est constatée lorsqu’on
compare les moyennes d’âge présumé du début de la
maladie de Behçet. La proportion des hommes est plus
élevée dans le premier groupe. L’aphtose bipolaire est
significativement plus rare dans le premier groupe. Les
manifestations oculaires sont dominées par l’atteinte
uvéale (95,0%). Les vascularites rétiniennes ont été
observées dans 12,5% et exclusivement chez les
hommes. L'atteinte oculaire est bilatérale chez 47,5%
des patients. Le choix du traitement dépendait du type
de l’atteinte oculaire. Il s’agit d’une maladie
particulièrement grave, 30,0% des patients ont une
cécité. La cécité est significativement plus fréquente
chez les hommes (p = 0,04).
Conclusion. L’atteinte oculaire en milieu ambulatoire
de médecine interne, dans une ville moyenne se
singularise par sa fréquence et sa gravité.
Mots-clés : Maladie de Behçet, cécité, manifestations
ophtalmologiques, uvéite, vascularite.
SUMMARY
Ocular involvement in Behçet's disease in
outpatient internal medicine liberal
Introduction, Purpose Behçet's disease is a systemic
vasculitis. Ocular involvement represents one of the
major criteria for diagnosis and prognosis. The series
published almost exclusively relates to patients
followed in hospitals. This work was undertaken to
determine the clinical features, diagnosis and prognosis
of ocular involvement of patients, supported in a
private practice of internal medicine, a Moroccan city
average, namely Settat.
Patients and methods. This is a retrospective study
from september 2009 to mars 2014 , which involved 89
patients aged 13-65 years, 47.6 % were female, with
Behçet's disease as defined by one of the four most
used definition namely Masson and Barns ,
International study Group for Behçet's disease,
Japanese research Committee on Behçet's disease and
Davatchi.
The patients with Behcet disease, were divided into
two groups. A first group of 40 patients (44.9 %) with
ocular involvement and a second group of 49 patients
(55.1 %) without ocular involvement.
Results. Ocular involvement is in second place (44.9
%) after reaching mucocutaneous (97.8%) and before
joint damage (21.3 %). The average age was 42.4 ±
12.7 years in the first group vs 38.9 ± 9.2 years in the
second group (p = 0,14). The same difference is found
when comparing the averages presumed age of onset
Behçet's disease. The proportion of men was higher in
the first group. Bipolar ulceration were significantly
lower in the first group. Ocular manifestations are
dominated by uveal involvement (95.0%). Retinal
vasculitis was observed in 12.5% and exclusively in
male patients. Ocular involvement is bilateral in 47.5%
of patients. The choice of treatment depends on the
type of ocular involvement. This is a particularly
serious disease, 30.0 % of patients suffer from
blindness. Blindness was significantly higher among
males (p = 0.04).
Conclusion. Ocular involvement in outpatient internal
medicine in a small town is distinguished by its
frequency and severity.
Keywords: Behcet's disease, blindness, ocular
manifestations, uveitis, vasculitis.
INTRODUCTION
La maladie de Behçet (MB) est une vascularite, à
prédominance veineuse, responsable de manifestations
systémiques diverses. Son étiologie est inconnue. Elle
11
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
évolue par une alternance de poussées entrecoupées de
rémissions. Elle associe une aphtose buccale et/ou
génitale récidivante à d’autres manifestations, les plus
fréquentes étant cutanées (pseudofolliculite nécrotique,
érythème noueux), articulaires, oculaires, vasculaires
(thromboses, anévrysmes), neurologiques
(encéphalomyélite, méningite, hypertension
intracrânienne) et digestives. Les manifestations
ophtalmologiques sont dominées par les uvéites, les
vascularites rétiniennes et les thromboses veineuses
rétiniennes. La MB se distingue par l’absence de
marqueurs biologiques spécifiques. Son diagnostic est
purement clinique, il repose sur des critères
diagnostiques nombreux, donc plus ou moins sensibles
et spécifiques [1]. L’atteinte oculaire en représente l’un
des critères diagnostiques majeurs [2]. Elle présente
également un intérêt pronostique et thérapeutique. La
cécité en est la complication la plus redoutable [1, 3].
Les séries, de MB publiées, concernent presque
exclusivement les patients suivis dans des hôpitaux.
L’objectif de notre travail est de rechercher les
particularités épidémiologiques, cliniques et
pronostiques des manifestations ophtalmologiques des
patients suivis en milieu ambulatoire dans un cabinet
libéral de médecine interne d’une ville moyenne
marocaine, Settat en l’occurrence.
MATERIEL ET METHODES
Type d’étude : Il s’agit d’une étude descriptive
rétrospective, sur une période s’étalant de septembre
2009 à mars 2014, portant sur 89 patients suivis, au
cabinet de médecine interne. Ces patients sont adressés
par des confrères ophtalmologistes dans 28,1% des cas,
par d’autres confrères (13,5%) ou sont auto-référés
(58,4%). Les patients présentant une atteinte
ophtalmologique ont été adressés par les confrères
ophtalmologistes dans 62,5 % des cas.
Le diagnostic de MB a été retenu sur la présence d’au
moins une des 4 définitions (les critères diagnostiques),
Masson et Barnes [4], International study group for
Behcet disease de 1990 [2] Behcet disease research
Comitee of Japan de 1972 [5] et les critères de
Davatchi [6].
Fiche de dépouillement, données recueillies et
examen
Chaque patient a bénéficié d’un examen clinique
complet avec recueil de renseignements anamnestiques.
Un bilan biologique minimum avec une vitesse de
sédimentation, une évaluation de l’hypersensibilité
cutanée au point de piqûre ou de prélèvement sanguin
(point de prélèvement) voire un test pathérgique
(aiguille stérile 21G). L’examen ophtalmologique
systématique a comporté la mesure de l’acuité visuelle
(AV), l’examen à la lampe à fente et l’étude du fond
d’œil. Il a été complété par l’angiographie à la
fluorescéine, chaque fois que possible. Nous procédons
au dépistage précoce des atteintes ophtalmologiques
chez tous les patients MB identifiés. L’AV a été
classée en normale, basse et cécité (à partir de compte
les doigts qui est la définition légale de la cécité). Ont
également été précisées les données thérapeutiques et
évolutives. Les résultats des différentes atteintes
oculaires sont exprimés en nombre de patients et
d'yeux. Nous avons défini les formes sévères comme
celles comportant une atteinte postérieure ou une
vascularite.
Analyse statistique
Les patients ont été divisés en deux groupes. Un
premier groupe présentant une atteinte oculaire et un
deuxième groupe sans atteinte oculaire. Pour comparer
les fréquences des différentes variables étudiées (à
savoir l’âge, le sexe, l’existence de cas familiaux de
MB et l’association à d’autres atteintes graves
notamment vasculaires et neurologiques) dans chacun
des deux groupes, nous avons utilisé le test du χ2 de
Pearson. Après cette analyse univariée, deux modèles
de régression logistique non conditionnelle ont été
élaborés. Le premier pour déterminer les facteurs
prédictifs de l’atteinte oculaire (variable dépendante 1).
Le deuxième pour déterminer les associations entre la
sévérité de l’atteinte oculaire (variable dépendante 2) et
toutes les autres variables (variables indépendantes). La
sélection des variables pour le modèle est réalisée à
l’aide de la procédure de sélection pas à pas (stepwise)
où les critères d’entrée et de sortie des variables dans le
modèle ont été fixés à 10 %. Pour les analyses simples
et les modèles de régression logistique en analyse
principale, le seuil de signification statistique a été fixé
à 5 % (p < 0,05) [7]. Les analyses ont été réalisées à
l’aide du logiciel SPSS, version 20.
RESULTATS
I- Caractéristiques démographiques
Sur les 89 patients présentant une MB, suivis durant la
période de l’étude, 40 ont une atteinte oculaire, soit
44,9% des cas constituant le premier groupe.
Les patients du premier groupe sont plus âgés que les
autres, leur moyenne d’âge, lors de la première
consultation, est de 42,4 ± 12,7 ans (extrêmes : 23 à 65
ans) contre uniquement 38,9 ± 9,2 ans (extrêmes : 13 à
58 ans) dans le deuxième groupe (p = 0,14). La même
différence est constatée lorsqu’on compare les
moyennes d’âge présumé du début de la MB.
Il y a plus d’hommes dans le premier groupe (Tableau
1). Par ailleurs, lorsqu’on compare le sexe ratio selon
les tranches d’âge présumé du début de la MB on
constate que la proportion d’hommes diminue
progressivement selon les tranches d’âge (Tableau 2).
Les antécédents familiaux de MB sont retrouvés dans
2,5% des cas dans le premier groupe et dans 8,2% des
cas dans le deuxième groupe (p = 0,32).
12
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
Tableau I : Caractéristiques cliniques des 89 patients présentant une MB
Signes cliniques Premier groupe : Patients avec
atteinte oculaire N(%)
Deuxième groupe : Patients
sans atteinte oculaire N(%)
P
Total 40 (44,9%) 49 (55,1%) --
Féminin 17 (42,5%) 22 (44,9%) 0,82
Masculin 23 (57,5%) 27 (55,1%)
Sexe ratio 1,4 1,2 0,99
Age moyen lors de la première
consultation 42,4 ± 12,7 38,9 ± 9,2 0,14
Age MB 33,2 ± 11,6 30,9 ± 8,5 0,28
Antécédents familiaux 1 (2,5%) 4 (8,2%) 0,24
Aphtose buccale 38 (95,0%) 49 (100,0%) 0,11
Aphtose bipolaire 18 (45,0%) 46 (93,9%) 0,00
Atteinte cutanée 9 (22,5%) 19 (38,8%) 0,10
Thrombophlébite 1 (2,5%) 4 (8,2%) 0,24
Manif digestives 1 (2,5%) 3 (6,1%) 0,24
Arthrite 10 (25,0%) 9 (18,4%) 0,44
Manif neurologiques 5 (12,5%) 1 (2,0%) 0,05
Test pathergique 3 (7,5%) 9 (18,4%) 0,13
Tableau II : Variation du sexe ratio selon les tranches de l’âge présumé du début de la MB
de l’ensemble des 89 patients
Féminins (nb) Masculins (nb) M/F P
12 à 29 ans 15 26 1,7
0,161 30 à 49 ans 20 23 1,2
50 ans et plus 4 1 0,3
Total 39 50 1,3
II- Manifestations extra-oculaires
La fréquence de l’aphtose bipolaire est
significativement plus basse dans le premier groupe
(p = 0,00). Les fréquences de l’aphtose buccale,
l’atteinte cutanée, l’atteinte digestive et les
antécédents familiaux sont plus basses dans le
premier groupe. Alors que les fréquences de
l’atteinte articulaire et de l’atteinte neurologique
sont plus fréquentes dans le premier groupe. La
thrombophlébite a été observée moins fréquemment
dans le premier groupe, tous ces patients sont de
sexe masculin (Tableau 1).
III- Manifestations oculaires
Chez 22,5% des patients l’atteinte ophtalmologique
a précédé les autres signes de la MB, chez 7,5% des
patients les signes étaient concomitants et chez 70%
des patients les signes ophtalmologiques sont
survenus après les signes cutanéo-muqueux ou
articulaires.
L’âge moyen du début présumé de l’atteinte
oculaire est de 35,9 ± 12,5 ans. L’AV est normal
chez 30,0% des patients et basse chez 40,0%. Dans
notre série les manifestations oculaires de la MB,
observées à la suite de l'examen ophtalmologique et
des données de l’angiographie à la fluorescéine,
sont dominées par l'uvéite (95,0%). Elle est
postérieure chez 42,5% % des patients. Les autres
lésions observées sont par ordre décroissant :
vascularite rétinienne (12,5 % des cas),
maculopathie (7,5 %), hyalite (uvéite intermédiaire)
(5,0 %) et une sclérite (2,5%). L’angiographie à la
fluorescéine, réalisée chez trois patients, a montré la
présence d’une fluorescence sous fovéale et d’un
œdème maculaire (Tableau 3).
L’atteinte est bilatérale chez 47,5 % des patients.
Donc en nombre total d’yeux 73,8% sont atteints.
La sévérité comme définie précédemment concerne
47,5% des patients. Il s’agit de 16 hommes (soit
une prévalence de 69,6%) contre uniquement 3
femmes (soit une prévalence de 17,6%) (p = 0,001).
La cécité est plus manifeste chez les patients qui ont
une forme sévère.
Tableau III : Signes oculaires et leur évolution chez les 40 patients, du groupe 1
Nb patients Nb Yeux Sévérité
Total 40 (100,0%) 59 (73,8%) 19 (47,5%)
AV : Normale 12 (30,0%) 16 (20,0%) 3 (25,0%)
13
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
AV : Basse 16 (40,0%) 21 (26,3%)
4 (25,0%)
AV : Cécité 12 (30,0%) 22 (27,5%) 12 (100,0%)
Total des uvéites 38 (95,0%) 56 (70,0%) 18 (47,4%)
Uvéite antérieure 31 (77,5%) 43 (53,8%) 10 (31,3%)
Uvéite postérieure 17 (42,5%) 31 (38,8%) 17 (100%)
Intermédiaire 2 (5,0%) 4 (5,0%) 2 (1000%)
Uvéite totale 10 (25,0%) 19 (23,8%) 10 (100,0%)
Vascularite Rétinienne 5 (12,5%) 8 (10,0%) 5 (100,0%)
Atteinte Maculaire 3 (7,5%) 5 (6,3%) 3 (100,0%)
Sclérite 1 (2,5%) 1 (1,3%) 1 (100,0%)
Guérison 12 (30,0%) 16 (20,0%) 4 (33,3%)
Chronicité et récidives 4 (10,0%) 5 (6,3%) 0 (0,0%)
Séquelles & cécité 24 (60,0%) 38 (47,5%) 15 (62,5%)
Traitement :
Le traitement dépend du type de l’atteinte oculaire
et de sa sévérité. Le traitement local à base de
corticoïdes en collyre ou en injection et de
cycloplégiques (atropine) a toujours été instauré
associé en premier lieu, à la corticothérapie orale à
la dose de 0,5 à 1 gr/kg/j avec dégression
progressive. Le recours au Methyl-prédnisolone en
bolus a été réalisée dans 1 cas et au
Cyclophosphamide (1 gr en perfusion : chaque
mois pendant 6 mois) dans 6 cas. Malheureusement
2 malades n’ont pas pu continuer les 6 mois, ils ont
été perdus de vue ! La colchicine, à la dose de 1 à 2
mg/jour, a été prescrite chez tous les patients en
association aux autres traitements pendant la phase
d’entretien.
Evolution Comme le montre le tableau 3, sur les 40 patients,
70,0% ont une complication ou une séquelle. La
cécité a touché 30 % des patients. La cécité est
significativement plus fréquente chez les hommes
avec 43,5% contre uniquement 11,8% chez les
femmes (p = 0,046). Elle systématiquement
observée dans les formes sévères.
Les synéchies irido-cristalliniennes avec parfois la
présence de pigments iriens sur la cristalloïde
antérieure ont été observées chez 50,0 % des
patients. La cataracte a touché 7,5% des patients.
D’autres complications ont été observées, 2,9%
chacune : secclusion pupillaire (adhérence complète
ou presque complète du bord pupillaire de l'iris au
cristallin), décollement rétinien et glaucome.
La prévalence de la cécité chez les hommes est de
43,5% contre uniquement 11,8% chez les femmes
(p = 0,04).
Analyse multivariée
L’atteinte oculaire est significativement plus
fréquente chez les hommes, les porteurs d’aphtes
bipolaires et les patients qui présentent des
manifestations neurologiques (Tableau 4).
L’atteinte oculaire est significativement plus
sévère chez les patients masculins (Tableau 5).
Tableau IV : Régression logistique avec SPSS 20, pour l’ensemble des sujets d’étude : Regression binary
logistic Méthode (Backward stepwis:LR) : Facteurs prédictifs de l’atteinte oculaire
14
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
Variables indépendantes Coefficient β Ecart type de β Wald P
Modèle initial :
Sexe (Féminin versus Masculin) -1,46 0,78 3,49 0,06
Age MB -,04 0,04 1,00 0,31
Aphtose bipolaire -4,92 1,12 19,07 0,00
Aphtes buccaux -36,578 30433,41 0,00 0,99
Thrombophlébite -2,78 2,60 1,14 0,28
Lésions digestives -25,65 40192,97 0,00 0,99
Arthrite 1,09 0,87 1,56 0,21
Manifestations neurologiques 5,18 2,65 3,82 0,05
Antécédents familiaux -3,53 2,18 2,61 0,10
Test pathergique -1,62 1,33 1,49 0,22
Constant 43,05 30433,41 0,00 0,99
Modèle final : Step 8
Sexe (Féminin versus Masculin) -1,41 0,71 3,89 0,04
Aphtose bipolaire -4,21 0,94 19,83 0,00
Manifneurologiques 3,88 1,79 4,68 0,03
Antécédentsfamiliaux -2,88 1,64 3,09 0,07
Constant 44,34 27854,12 0,00 0,99
Tableau V : Régression logistique avec SPSS 20, pour les patients du premier groupe : Regression binary
logistic Méthode (Backward stepwis:LR) : Facteurs pronostiques de l’atteinte oculaire
Variables indépendantes Coefficient β Ecart type de β Wald P
Modèle initial :
Sexe (Féminin versus Masculin) -2,74 1,16 5,58 0,01
Tranches d’Age MB 0,67 0,71
Aphtose bipolaire -40,54 56841,46 0,00 0,99
Aphtes bucaux 19,78 40192,96 0,00 1,00
Arthrite 0,81 1,09 0,55 0,45
Manif neurologiques 21,62 18800,47 0,00 0,99
Thrombophlébite 0,02 44372,65 0,00 1,00
Antécédents familiaux -21,64 40192,97 0,00 1,00
Test pathergique 1,93 1,91 1,02 0,31
Constant -38,44 44839,99 0,00 0,99
Modèle final : Step 10
Sexe (Féminin versus Masculin) -2,48 0,89 7,74 0,00
Manif neurologiques 21,67 16644,33 0,00 0,99
Constant 0,53 0,47 1,28 0,25
DISCUSSION
Du fait de la particularité ambulatoire de nos
malades nous allons privilégier dans la comparaison
les séries nationales.
I- Caractéristiques épidémiologiques
Dans notre série l’atteinte oculaire occupe la
deuxième place après l’atteinte cutanéo-muqueuse
comme cela est rapporté dans la majorité des séries
[8, 9, 10, 11, 12]. Alors que dans d’autres séries elle
occupe la troisième place après l’atteinte cutanéo-
muqueuse et l’atteinte articulaire [3, 13, 14, 15].
(Tableau 6)
La fréquence de l’atteinte oculaire au cours de la
MB varie selon les séries, les modes de recrutement
et les critères de définition. Par exemple dans les
critères du groupe international, l’atteinte oculaire
n’est pas majeure. Certaines séries n’incluent pas
les kératites, les épisclérites, les oedèmes papillaires
et les syndromes secs dans les manifestations
oculaires et classent les névrites optiques
rétrobulbaires dans les manifestations
neurologiques [3, 15]. En dehors des séries
15
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
ophtalmologiques qui observent 100% d’atteinte [8,
16, 17], les séries dermatologiques observent entre
36 et 45% [10, 14, 18], alors que les services de
médecine interne observent des fréquences qui
varient entre 21,5 et 67% [3, 9, 11- 13, 15, 19]
(Tableau 6). La fréquence (44,9%) observée dans
notre série se situe, donc, dans la fourchette des
séries nationales et internationales.
Le sexe ratio varie de 0,71 [18] à 18,7 [13] chiffre
enregistré au service de médecine interne de
l’hôpital militaire de Marrakech, où le recrutement
est presque exclusivement masculin ! Lorsqu’on
élimine cette série nous constatons que la
proportion d'hommes diminue régulièrement avec
le temps et donc la prédominance masculine
diminue comme l’illustre la Figue 1. Notre série,
récente, enregistre donc l’un des sexes ratio les plus
faibles. Cette notion a été décrite par Zouboulis en
1999 au niveau de plusieurs pays [20]. B’chir a
observé en Tunisie que le sexe ratio a diminué
lorsqu’il a comparé les patients suivis avant 1995 et
ceux suivis après cette date [3]. Cette notion
d’évolution vers la parité entre les sexes pourrait
être expliquée par l’augmentation de l’âge des
patients comme dans notre série où la parité
s’installe à partir de 30 ans et plus.
Figure 1 : Evolution du sexe ratio selon le service et la dernière année de l’étude.
Plusieurs séries ont observé que l’atteinte
ophtalmologique était plus fréquente chez les
hommes [15, 21], parfois de manière significative
(p < 0,05) [10] (p<0,001) [3], avec dans certaines
séries une prédominance de formes graves : plus
d’œdème maculaire, de dégénérescence maculaire,
de cataracte et de décollement rétinien avec un
risque de perte de la vision utile à cinq ans et à dix
ans [8, 22]. C’est notre cas puis que l’analyse
multivariée a montré que le sexe masculin est lié
significativement avec l’atteinte oculaire et sa
sévérité. La cécité est significativement plus
fréquente chez les hommes (p = 0,04). Les
vascularites ont été exclusivement observées chez
les hommes.
L’âge de début réel de la maladie ou l’âge de
diagnostic sont parfois difficiles à préciser et
certaines séries ne le mentionnent pas. La MB
débute généralement pendant la troisième décade de
la vie [8, 9, 12, 20, 23]. Les âges extrêmes varient,
selon les séries, entre 11 à 45 ans et 5 à 65 ans. Les
séries récentes enregistrent des sujets de plus de 60
ans parfois. Dans notre série les âges extrêmes ne
différent pas des séries nationales. A noter que dans
le cabinet de médecine interne nous ne recevons les
enfants âgés de moins de 12 ans que sur lettre d’un
médecin.
Des antécédents familiaux de MB sont observés
entre 2,9% et 16,2% des séries. Les formes
familiales semblent être plus graves que les formes
sporadiques, et seraient fortement associées à
l’antigène HLA B51 [8, 10, 15, 19]. Dans notre
série, pour l’ensemble des patients la prévalence
des formes familiales est de 5,6%, alors que dans le
groupe 1 un seul patient a présenté une MB
familiale et présente une forme non grave (uvéite
antérieure qui a guérie).
II- Caractéristiques cliniques, thérapeutiques et
évolutives
Janati [10], avait observé que l’atteinte oculaire
était plus fréquemment associée à l’atteinte
neurologique et/ou vasculaire, ce qui témoignait
selon lui de la présence de formes graves de la
maladie. Dans notre série les patients qui ont une
atteinte oculaire ont significativement moins
4,85
3,26
2,4
1,271,46
0,71
1,4
2,3
1,4
0
1
2
3
4
5
6
Médecine interne Dermatologie Ophtalmologie
1992 [14]
1996 [9]
2006 [12]
2007 [15]
2009 [11]
2000 [18]
2003 [10]
2012 [8]
2013 [Notre série]
16
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
d’aphtes bipolaires. Aucun n’a présenté de
thrombophlébite.
Dans notre série l’atteinte oculaire était révélatrice
de la MB dans 23,5% des cas. Dans la littérature,
cette atteinte peut être inaugurale dans 8 à 71% des
cas [9, 10]. Elle est le plus souvent initialement
unilatérale. Cependant, la bilatéralisation des
lésions semble inéluctable en l’absence de
traitement et surviendrait deux à trois ans après le
début de la maladie [16]. La bilatéralisation en
cours de l’évolution apparaissait selon les séries
dans 13% et 33% des cas [10, 16]. Dans notre série
l’atteinte est bilatérale dans 47,5%. L’atteinte
ophtalmologique peut être d’emblée bilatérale, cela
a été observé dans des séries entre 60 et 64% des
cas [10, 16].
La comparaison des types d’atteinte oculaire selon
les séries est parfois difficile, certains auteurs
donnent leurs pourcentage selon le total des
malades, d’autres les donnent selon les patients qui
présentent une atteinte oculaire, d’autres donnent le
pourcentage des uvéites par fois en ne précisant pas
uvéite antérieure seule, postérieure seule et
panuvéite.
Dans notre série l’atteinte uvéale est la plus
fréquente (95,0%). Elle est antérieure dans 77,5%,
postérieure dans 42,5% et totale dans 42,5% des
cas. Dans les autres séries l’atteinte uvéale est la
plus fréquente [8- 10, 16, 17] (Tableau 6).
Le pourcentage de l’uvéite antérieure varie entre 20
et 57% (pour les séries avec % selon l’atteinte) nous
enregistrons le % le plus élevé (77,5%) cela est
certainement en rapport avec le caractère
ambulatoire de nos patients. L’atteinte postérieure
varie entre 21 et 52,1% notre pourcentage de
42,5% est dans cette fourchette.
L'hypopion, souvent associé à un tyndall de la
chambre antérieure, dû à la diffraction de la lumière
sur les particules en suspension dans le liquide, est
le signe le plus évocateur, sans être
pathognomonique, de la MB. Il est présent dans 6 à
12,1% des cas [8, 10, 11, 16]. Dans notre série une
uvéite antérieure de l’œil gauche avec tyndall a été
observée (2,5%).
Les vascularites rétiniennes représentées par les
périphlébites du pôle postérieur et de la périphérie
rétinienne, sont fréquentes. Selon les auteurs elles
sont observées dans 6,7% à 54,2%. [8 - 12, 16, 17,
19]. Nous avons observé 12,5%, tous ces patients
sont des hommes !
La maculopathie au cours de la MB serait sous-
estimée du fait des lésions oculaires associées qui
gênent la visibilité du fond d’œil. Elle représente un
critère de sévérité de l’atteinte du pole postérieur.
Elle est rapportée dans 10,8 à 50,8% selon les
auteurs [8, 10, 11, 24]. Dans notre série la
fréquence est de 7,5%.
La neuropathie optique se traduit par un œdème
papillaire inflammatoire et ischémique. A long
terme, elle évolue vers l’atrophie optique. Certains
auteurs classent les névrites optiques rétrobulbaires
dans les manifestations neurologiques [3]. La
fréquence de la neuropathie optique serait sous
estimée. Lamari et collaborateurs dans une étude
qui a porté sur 400 cas de MB, entre 1992 et 1999
à Casablanca ont observé une fréquence de 37%. Le
pronostic est réservé, 44% des malades avaient une
AV de moins de 1/10 malgré un traitement. Les
auteurs insistent sur l’urgence thérapeutique avec le
recours d’emblée aux immunosuppresseurs [23].
Les manifestations oculaires mineures
(conjonctivite, épisclérite kératite, myosite et
sclérite) occupent une fréquence variable de 2,4% à
7,8% selon les séries [8, 25]. Dans notre série la
sclérite a été observée dans 2,5% des cas.
Le pronostic de l’atteinte oculaire est souvent
grave. Les lésions évoluent par poussées
successives et conduisent à des complications
majeurs : cataracte, hypertonie et cécité par atteinte
du segment postérieur. Les synéchies irido-
cristalliniennes sont fréquentes, le traitement
dilatateur à temps, permet souvent de lever les
adhérences, il persiste alors parfois des pigments
iriens sur la capsule antérieure du cristallin, témoins
de synéchies anciennes traitées à temps. Malgré un
traitement bien conduit, environ un quart des
patients deviennent aveugles [26].
Le traitement de l’atteinte oculaire de la MB
dépend du type de l’atteinte et de sa gravité. En
pratique, l’inflammation oculaire nécessite un
traitement anti-inflammatoire local ou général
urgent, voire agressif, pour supprimer
l’inflammation, prévenir les récidives et les
complications. De nombreux auteurs s’accordent à
utiliser rapidement les immunosuppresseurs, soit
d’emblée soit en fonction de la sévérité ou de la
bilatéralité des lésions Ils facilitent par ailleurs le
sevrage cortisonique [10, 27, 28].
De nombreux immunosuppresseurs ont démontré
leur efficacité [10]. Les bolus de cyclophosphamide
sont actifs sur l’atteinte oculaire, neurologique et
vasculaire [27, 28, 29]. L’azathioprine (Imurel*) (à
la dose de 2,5 mg/kg/jour ou 50 à 150 mg/jour)
[10], le Chloraminophene (Chlorambucil*) à la
dose de 2 mg/jour et progressivement augmentée à
la dose totale de 5 à 12 mg/jour, la ciclosporine A
(2 à 16 mg/kg/jour en deux prises avec une
posologie moyenne de 10 mg/kg/jour) [10, 27] le
méthotrexate à la posologie de 7,5 à 15 mg/semaine
(per os ou IM) le mycophenolate mofetil (MMF)
[27, 29], l’infliximab, anti-corps monoclonal de
type IgG dirigé contre le TNF-α [10, 26, 30] et
l’interféron α [27, 30] peuvent également être
prescrits. Pendant de nombreuses années, le
traitement de choix été représenté par la
ciclosporine, actuellement plutôt remplacée par
l’infliximab.
L'EULAR (Ligue européenne contre le
rhumatisme) a recommandé en 2006 de traiter toute
MB avec atteinte ophtalmologique postérieure par
17
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
au moins des corticoïdes par voie générale (IV ou
orale) associée à l’Azathioprine. Et en cas d'atteinte
sévère définie par une baisse d'au moins 2/10ème
de l'AV, et/ou présence d’une vascularite rétinienne
ou d’une atteinte maculaire de traiter par infliximab
ou ciclosporine A associés aux corticoïdes et à
l’azathioprine. L’interféron α pourrait être utilisé
comme altérative avec ou sans association aux
corticoïdes [30].
Alpsoy propose un algorithme fondé sur les preuves
(tableau 7) [27]. Dans les uvéites antérieures, le
plus souvent le traitement local se compose de
corticoïdes en collyre ou en injections péri-
oculaires et de mydriatiques ou agents
cycloplégiques (atropine). Dans une deuxième
étape, le plus souvent, on associe une
corticothérapie orale [10, 27, 28] (20 à 30mg/jour)
avec dégression progressive selon l’évolution
clinique. Devant la présence de signes de sévérité
(hypopion, hyalite, panuvéite et vascularite
rétinienne), la répétition des poussées, la bilatéralité
des lésions, et surtout l’atteinte postérieure, il est
judicieux de recourir à la corticothérapie en bolus,
relayée par une corticothérapie orale, voire aux
immunosuppresseurs [8, 10, 27, 28]. Dans les cas
les plus graves de vascularite rétinienne ou
d’atteinte maculaire, la ciclosporine ou l’infliximab
peuvent être combinés avec l'azathioprine et les
corticostéroïdes [27].
Tableau VII : Algorithme thérapeutique de l’atteinte
oculaire de la maladie de Behçet [27]
1ère ligne Traitement local* : corticoïdes+
mydriatiques ± agents cycloplégiques
Voie systémique : Corticostéroïdes,
Cyclosporine-A, Azathioprine
2ème ligne Interféron α, Anti-TNF-α
3ème ligne Méthotrexate, Mycophénolate mofétil,
Cyclophosphamide, Rituximab
*Le traitement local seul doit être limité
uniquement aux patients présentant une uvéite
antérieure légère.
Le référentiel marocain de la MB en cours de
publication classe le Cyclophosphamide et
l’Azathioprine en première ligne puis la
Cyclospirine, les Anti-TNF α et l’interferon α en
deuxième ligne.
Certaines complications peuvent nécessiter la
chirurgie, la photocoagulation ou la cryothérapie.
La guérison est possible sans séquelles quand le
traitement est prescrit précocement. C’est le cas de
30,0 % de nos patients. L’évolution peut être
émaillée de récidives fréquentes surtout dans les
uvéites antérieures et de séquelles ou complications.
Le pronostic oculaire de la MB est très mauvais
surtout lors qu’il y a un retard ou une mauvaise
observance thérapeutique. L'uvéite antérieure a un
pronostic meilleur par rapport la panuvéite. Le
pronostic est également altéré si l'uvéite tend à se
chroniciser. Les complications oculaires de la MB
sont secondaires aux poussées inflammatoires et
sont en rapport avec l'évolutivité des lésions et les
effets secondaires des traitements.
Elles sont dominées par, la cataracte 9,7 à 38,5% [8
- 10, 22]. La cataracte est secondaire à
l’inflammation intraoculaire (uvéites chroniques) et
à l’usage des corticoïdes au long cours par voie
générale. Elle a été rapportée dans 12% des cas de
la série de Janati qui évoque que le Behçet
expliquerait 20% de toutes les cataractes dans le
Nord du Maroc [10]. Dans notre série la cataracte a
été observée dans 7,5% des cas, plus fréquemment
chez les hommes.
Les autres complications sont représentées dans
l’uvéite antérieure par le glaucome 2,4 à 13% [8, 9]
les troubles du tonus, les synéchies
iridocristalliniennes. Dans l’uvéite postérieure les
complications sont le décollement de rétine dans
1,3 à 12% [8, 22] et l’atrophie optique.
La cécité uni ou bilatérale a été rapportée selon les
séries entre 2,8% et 32,5% [3,8-13, 15,19]. Dans
notre série la cécité a été observée dans 30,0 % des
cas, significativement plus fréquemment chez les
hommes (p = 0,04). Elle est bilatérale dans 83,3 des
cas. (Figure 2).
Ce taux de cécité important, peut être expliqué par
un recours aux soins souvent tardif, des ressources
diagnostiques et thérapeutiques limitées.
L’importance de l’atteinte ophtalmologique et son
évolutivité sont souvent sous estimées par les
malades. Ils assimilent les poussées oculaires à de
simples conjonctivites allergiques ou virales avec la
hantise de l’automédication. Dans le cabinet le délai
de consultations ne pose pas de problème
comparativement à l’hôpital. Nous dépistons
systématiquement les atteintes ophtalmologiques
chez tous nos patients atteints de MB. Une
coordination avec nos confrères ophtalmologues
s’impose pour une bonne adaptation du traitement
aux lésions observées. L’observance du traitement
est un autre volet qu’il faut assurer. Une éducation
thérapeutique soutenue avec une sensibilisation des
patients, de leur famille et des pharmacies s‘impose.
Le pronostic de l’atteinte oculaire s’est amélioré
avec le temps. Cela serait du à la prise en charge
plus intensive des uvéites avec utilisation de bolus
de methyl prédnisolone et des immunosupprésseurs.
B’chir [3] rapporte que les séries tunisiennes
anciennes observaient des cécités plus fréquemment
que les séries récentes. Une étude japonaise [31] a
observé une amélioration significative (p < 0,001)
du pronostic visuel évalué par le pourcentage d’AV
< 20/200 entre la décade 1980 et la décade 1990.
Aux Etats unis d’Amérique une étude similaire a
observé une amélioration significative de l’AV et
de l’inflammation entre les décennies 1960, 1989 et
1990 [32].
CONCLUSION
18
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
Notre série confirme l’évolution vers la disparition
de la prédominance masculine de la maladie de
Behçet. Comme la majorité des séries l’atteinte
oculaire occupe la deuxième place après l’atteinte
cutanéo-muqueuse et avant l’atteinte articulaire. Il
s’agit essentiellement des uvéites antérieures. La
cécité touche 30,0% des patients. L’atteinte est
significativement plus grave chez les hommes. Une
collaboration étroite entre ophtalmologistes et
internistes, une amélioration de l’accès aux soins et
une sensibilisation des patients améliorera la pise
en charge thérapeutique.
REFERENCES
1 1- Saadoun D, Wechsler B. Behçet's disease.
Orphanet Journal of Rare Diseases 2012;7:20.
2- International Study Group for Behçet’s Disease.
Criteria for diagnosis of Behçet’s Disease. Lancet
1990;335:1078-80.
3- B'chir Hamzaoui S, Harmel A, Bouslama K,
Abdallah M, Ennafaa M, M’rad S, et al. Behçet's
disease in Tunisia. Clinical study of 519 cases. Rev
Méd Interne 2006; Oct;27(10):742-50.
4- Masson RM, Barnes CG. Behçet's syndrome
with arthritis. Ann Rheum Dis 1969;28:95-103.
5- Behçet’s Disease Research Committee of Japan..
Behçet’s disease: Guide to diagnosis of Behçet’s
disease. Jpn J ophthalmol 1974;(18):291-4.
6- Davatchi F, Chitsaz S, Jamshidi AR, Nadji AH,
Chams-Davatchi C, Shams H, et al. New simple
way to use the classification tree for the diagnosis
of Behçet’s disease. APLAR J Rheumatol
2005;8:43-4.
7- Falissard B. Comprendre et utiliser les
statistiques dans les sciences de la vie. 2ème édition.
Paris, Masson 2001.
8- Benatiya Andaloussi I, Alami B, Abdellaoui M,
Bhallil S, Bono W, Tahri H. Les manifestations
ophtalmologiques de la maladie de Behçet, à propos
de 33 cas. Pan Afr Med J 2012;13:83.
9- Filali-Ansary N, Tazi-Mezalek Z, Mohattane A,
Adnaoui M, Aouini M, Maaouni A, et al. Behçet
disease. 162 cases. Ann Med Interne (Paris).
1999;150(3):178-88.
10- Janati K, EL Omari K, Benchiki H, Hamdani
M, Lakhdar H. Les manifestations oculaires de la
maladie de Behçet (étude de 50 patients consultant
en dermatologie). Rev Méd Interne 2005;(26):771–
6.
11- Zahlane M, Erras S, Benjilali L, Essaadouni L.
Profil clinique de la maladie de Behçet en
Médecine Interne. Service de Médecine Interne
CHU Mohammed VI – Marrakech. Présentation
orale congères de Médecine Interne 2009.
12- Benamour S, Naji T, Echchilali K, Hamimouch
S, Moudatir M, Alaoui FZ, et al. Study of 1034
cases of Behcet's Disease. 12th International
Conference on Behcet's Disease 2006; Lisbon
(Portugal), Abstract B2.
13- Ait Badi MA, Zyani M, Kaddouri S, Niamane
R, Hda A, Algayres J-P. Les manifestations
articulaires de la maladie de Behçet. A propos de 79
cas. Re Méd Interne 2008;(29):277-82.
14- Ait Ourhrouil M, Bennouna-Biaz F, Yazidi A,
Senouci K, Hassam B, Heid E. Maladie de behcet -
profil dermatologique. (A propos de 82 cas).
Médecine du Maghreb 1993;(37):7-11.
15- Khammar Z. La maladie de behçet (à propos de
127 cas). Thèse de médecine CHU Fès N°48, 2008.
16- El Belhadji M, Hamdani M, Laouissi N,
Zaghloul K, Amraoui A, Benamour S. L'atteinte
ophtalmologique dans la maladie de Behçet - A
propos de 520 cas. J Fr Ophtalmol.
1997;20(8):592–8.
17- Ouazzani B, Benchekroun N, El Aouni A, Hajji
Z, Chaoui Z, Berraho-Hamani A. Devenir de la
maladie de Behçet en milieu ophtalmologique
marocain. J Fr Ophtalmol. 1995;18:373–5.
18- El Fajri S, Benchikhi M, Jarmouni RI, Lakhdar
H. Comparaison des critères diagnostiques de la
maladie de Behçet chez des malades marocains.
Ann Dermatol Venereol 2000;127:1068–72.
19- Jira M, Sekkach Y, Elomri N, Mekouar F,
Amezyane T, Abouzahir A, et al. Maladie de
Behçet : Aspects épidémiologiques et cliniques à
propos de 200 cas. Rev Méd Interne 2011;
(32), n° S2 :424-5.
20- Zouboulis C. Epidemiology of Adamantiades-
Behçet's disease. Ann Med Interne (Paris).
1999;150(6):488–98.
21- Yazici H, Tuzun Y, Pazarli H, Yurdakul S,
Ozyazgan Y, Ozdogan H, et al. Influence of age at
onset and patient sex on the prevalence and severity
of manifestations of Behçet’s syndrome. Ann
Rheum Dis 1984;33:783–9.
22- Tugal-Tutkun I, Onal S, Altan-Yaycioglu R,
Altunbas HH, Urgancioglu M. Uveitis in Behçet
disease: an analysis of 880 patients. Am J
Ophtalmol 2004;138:373–80.
23- Lamari H, Baha-Ali T, Benhaddou M, Alikane
O, Hamdani M, Zaghloul K, et al. Les atteintes du
nerf optique au cours de la maladie de Behçet (A
propos de 148 cas) Bull Soc Belge Ophtalmol.
2003;289:9–14.
24- Benchekroun O, Lahbil D, Lamari H, Rachid R,
El Belhadji M, Laouissi N, et al. La maculopathie
dans la maladie de Behçet. J Fr Ophtalmol.
2004;27(2):154–9.
25- Matsuo T, Itami M, Nakagawa H, Nagayama
M. The incidence and pathology of conjunctival
ulceration in Behçet's syndrome. Br J Ophthalmol.
2002;86(2):140–3.
26- Niccoli L, Nannini C, Benucci M, Chindamo D,
Cassara E, Salvarani C, and al. Long-term efficacy
of infliximab in refractory posterior uveitis of
Behcet’s disease: a 24-month follow-up study.
Rheumatology 2007;46;1161–4.
27- Alpsoy E. New Evidence-Based Treatment
Approach in Behçet's Disease. Pathology Research
19
Conduite à tenir Journal Marocain des Sciences Médicales 2014, Tome XIX ; N°3
Article original
International 2012; Volume 2012, Article ID
871019, 11 pages
28- Sakane T, Takeno M, Suzuki N, Inaba G.
Behçet’s disease. N Engl J Med 1999;341:1284–91.
29- Davatchi F, Shahram F, Chams H, Akbarian M.
Pulse cyclophosphamide in ocular manifestations of
behcet’s disease: a double blind controlled
crossover study. Arch Iranian Med 2004;7(3):201–
205 Archives of Iranian Medicine, Volume 7,
Number 3, July 2004 201.
30- Hatemi G, Silman A, Bang D, Bodaghi B,
Chamberlain A-M, Gul A, et al, “EULAR
recommendations for the management of Behçet's
disease: report of a task force of the European
Standing Committee for International Clinical
Sstudies Including Therapeutics
(ESCISIT),” Annals of the Rheumatic Diseases
2008;67:1656-62.
31- Yoshida A, Kawashima H, Motoyama Y,
Shibui H, Kaburaki T, Shimizu K, and al.
Comparison of patients with Behçet’s disease in the
1980s and 1990s. Ophtalmology 2004;111:810-5.
32- Kump L.I, Moeller K.L, Reed G.F, Kurup S.K,
Nussenblatt R.B, Levy-Clarke G.A. Behcet’s
Disease- Comparing Three Decades of Treatment
Response at the National Eye Institute. Can J
Ophthalmol. 2008;43(4):468-72.