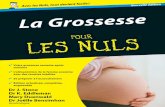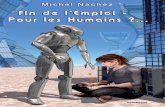Analyse sémantique et description lexicographique de marqueurs pragmatiques construits avec 'vrai'...
-
Upload
usherbrooke -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Analyse sémantique et description lexicographique de marqueurs pragmatiques construits avec 'vrai'...
DÉPARTEMENT DES LETTRES ET COMMUNICATIONS
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
ANALYSE SÉMANTIQUE ET DESCRIPTION LEXICOGRAPHIQUE DE MARQUEURS PRAGMATIQUES CONSTRUITS AVEC VRAI EN FRANÇAIS
QUÉBÉCOIS : VRAIMENT, PAS VRAIMENT, POUR DE VRAI, POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE ET À DIRE VRAI
par
FRANCIS LAPOINTE
Bachelier ès arts (Études françaises)
de l’Université de Sherbrooke
MÉMOIRE PRÉSENTÉ
pour obtenir
LA MAÎTRISE ÈS ARTS(Études françaises incluant un cheminement en linguistique)
Sherbrooke
JUILLET 2005
Composition du jury
ANALYSE SÉMANTIQUE ET DESCRIPTION LEXICOGRAPHIQUE DE MARQUEURS PRAGMATIQUES CONSTRUITS AVEC VRAI EN FRANÇAIS
QUÉBÉCOIS : VRAIMENT, PAS VRAIMENT, POUR DE VRAI, POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE ET À DIRE VRAI
Francis LapointeUniversité de Sherbrooke
Ce mémoire a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :
Gaétane Dostie, directrice de recherche(Département des lettres et communication de la Faculté des lettres et sciences humaines)
Louis Mercier, examinateur(Département des lettres et communication de la Faculté des lettres et sciences humaines)
Marie-Thérèse Vinet, examinatrice(Département des lettres et communication de la Faculté des lettres et sciences humaines)
2
RÉSUMÉ
Cette étude porte sur certains marqueurs pragmatiques construits avec le mot vrai d’après
l’usage québécois : vraiment, pas vraiment, pour de vrai, pour dire vrai, à vrai dire et à
dire vrai. L’analyse et la description linguistique de ces mots suivent les lignes directrices
de la méthode lexicographique propre au modèle Sens-Texte. L’étude fait état de la
polysémie des marqueurs et de la cohérence du champ lexical qu’ils forment. On y
explore le sémantisme du mot vrai, de son sens le plus primitif à son sens métaphorique,
en passant par celui faisant appel au concept de caractéristiques prototypiques à la source
de certaines lexies « intensificatrices » de vraiment et pour de vrai. On y dévoile aussi,
entre autres, le mécanisme d’euphémisation propre à la locution pas vraiment et les
fonctions de connecteurs textuels des locutions pour dire vrai, à vrai dire et à dire vrai.
3
TABLE DES MATIÈRES
RÉSUMÉ………………….………………………………………………………….. 3
REMERCIEMENTS……………………………………………………………… …. 4
TABLE DES MATIÈRES……………………………………………………………. 5
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES……………………………………………..8
INTRODUCTION………………..………………………………………………....... 10
I. Présentation de l’étude…………………………………………………..……....10II. Objet de l’étude……………………………………………………..…..…...… 10III. Justification de l’étude……………………………...……………………….... 11IV. Méthodologie de l’étude……………………………………..…...................... 13V. Structure de l’étude…………………………………..………………………... 15
CHAPITRE 1 – ANALYSE LINGUISTIQUE……………………………………..... 16
1.1. VRAI adjectif……………………………………………………………...…. 161.1.1. VRAI1………………………………………………………………...…18
1.1.1.1. Sémantisme de VRAI1…………………………………………………………… 181.1.1.2. Relations paradigmatiques de VRAI1………………………………………….… 211.1.1.3. Syntaxe de VRAI1…………………………………………………………..…… 211.1.1.4. Phonologie de VRAI1……………………………………………………………..21
1.1.2. VRAI2………………………………………………………………………....221.1.2.1. Sémantisme de VRAI2…………………………………………………………… 221.1.2.2. Relations paradigmatiques de VRAI2……………………………………………. 231.1.2.3. Syntaxe de VRAI2…………………………………………………………….…..231.1.2.4. Phonologie de VRAI2………………………………………………………..........24
1.1.3. VRAI3………………………………………………………………..….241.1.3.1. Sémantisme de VRAI3………………………………………………………. ….. 241.1.3.2. Relations paradigmatiques de VRAI3……………………………………..……... 251.1.3.3. Syntaxe de VRAI3…………………………………………………………….…..251.1.3.4. Phonologie de VRAI3………………………………………………………….… 25
1.1.4. VRAI4a…………………………………………………………….........251.1.4.1. Sémantisme de VRAI4a……………………………………………………….…. 251.1.4.2. Relations paradigmatiques de VRAI4a…………………………………………... 281.1.4.3. Syntaxe de VRAI4a…………………………………………………………….....281.1.4.4. Phonologie de VRAI4a……………………………………………………..……. 28
1.1.5. VRAI4b……………………………………………………………….…281.1.5.1. Sémantisme de VRAI4b…………………………………………………………..281.1.5.2. Relations paradigmatiques de VRAI4b………………………………………..….311.1.5.3. Syntaxe de VRAI4b……………………………………………………………….311.1.5.4. Phonologie de VRAI4b………………………………………………………..…. 31
1.1.6. Conclusion sur le vocable VRAI…………………………………….….31
1.2. VRAIMENT…………………………………………………………………..33
5
1.2.1. VRAIMENT1………………………………………………………...… 341.2.1.1. Sémantisme de VRAIMENT1…………………………………………………… 341.2.1.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT1………………………………….… 361.2.1.3. Syntaxe de VRAIMENT1………………………………………………………... 361.2.1.4. Phonologie de VRAIMENT1…………………………………………………….. 37
1.2.2. VRAIMENT2…………………………………………………………... 371.2.2.1. Sémantisme de VRAIMENT2…………………………………………………… 371.2.2.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT2……………………………….…….411.2.2.3. Syntaxe de VRAIMENT2…………………………………………………….….. 421.2.2.4. Phonologie de VRAIMENT2…………………………………………………….. 42
1.2.3. VRAIMENT3………………………………………………………...… 421.2.3.1. Sémantisme de VRAIMENT3…………………………………………………….421.2.3.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT3……………………………………. 441.2.3.3. Syntaxe de VRAIMENT3…………………………………………………….….. 441.2.3.4. Phonologie de VRAIMENT3…………………………………………………….. 44
1.2.4. VRAIMENT4…………………………………………………………..……. 451.2.4.1. Sémantisme de VRAIMENT4…………………………………………………….451.2.4.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT4……………………………………. 471.2.4.3. Syntaxe de VRAIMENT4……………………………………………………..…. 481.2.4.4. Phonologie de VRAIMENT4………………………………………………..…… 48
1.2.5. VRAIMENT5………………………………………………………..…. 491.2.5.1. Sémantisme de VRAIMENT5…………………………………………………….491.2.5.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT5…………………………………… 501.2.5.3. Syntaxe de VRAIMENT5…………………………………………………………501.2.5.4. Phonologie de VRAIMENT5……………………………………………….…… 51
1.2.6. VRAIMENT6………………………………………………………...… 511.2.6.1. Sémantisme de VRAIMENT6………………………………………………..….. 511.2.6.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT6…………………………………….531.2.6.3. Syntaxe de VRAIMENT6…………………………………………………………531.2.6.4. Phonologie de VRAIMENT6……………………………………………….…… 53
1.2.7. Conclusion sur le vocable VRAIMENT……………………………..… 54
1.3. PAS VRAIMENT……………………………………………………...…… 551.3.1. Sémantisme de PAS VRAIMENT…………………………………………………….. 581.3.2. Relations paradigmatiques de PAS VRAIMENT…………………………………….. 591.3.3. Syntaxe de PAS VRAIMENT…………………………………………………………. 591.3.4. Phonologie de PAS VRAIMENT……………………………………………….…….. 591.3.5. Conclusion au sujet de PAS VRAIMENT………………………………………….…. 59
1.4. POUR DE VRAI……………………………………………………………. 611.4.1. POUR DE VRAI1……………………………………………….……. 63
1.4.1.1. Sémantisme de POUR DE VRAI1……………………………………………… 631.4.1.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI1……………………………… 641.4.1.3. Syntaxe de POUR DE VRAI1…………………………………………………. 641.4.1.4. Phonologie de POUR DE VRAI1………………………………………………. 65
1.4.2. POUR DE VRAI2………………………………………………….…. 651.4.2.1. Sémantisme de POUR DE VRAI2……………………………………………… 651.4.2.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI2……………………………… 651.4.2.3. Syntaxe de POUR DE VRAI2………………………………………………….. 661.4.2.4. Phonologie de POUR DE VRAI2…………………………………………….… 66
1.4.3. POUR DE VRAI3…………………………………………………….. 661.4.3.1. Sémantisme de POUR DE VRAI3…………………………………………….. 661.4.3.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI3……………………………… 67
6
1.4.3.3. Syntaxe de POUR DE VRAI3………………………………………………….. 671.4.3.4. Phonologie de POUR DE VRAI3……………………………………………… 67
1.4.4. POUR DE VRAI4…………………………………………………….. 681.4.4.1. Sémantisme de POUR DE VRAI4……………………………………………… 681.4.5.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI4……………………………… 681.4.5.3. Syntaxe de POUR DE VRAI4………………………………………………….. 681.4.5.4. Phonologie de POUR DE VRAI4………………………………………………. 69
1.4.5. POUR DE VRAI5…………………………………………………….. 691.4.5.1. Sémantisme de POUR DE VRAI5……………………………………………… 691.4.5.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI5……………………………… 701.4.5.3. Syntaxe de POUR DE VRAI5………………………………………………….. 701.4.5.4. Phonologie de POUR DE VRAI5……………………………………………… 70
1.4.6. POUR DE VRAI6…………………………………………………….. 701.4.6.1. Sémantisme de POUR DE VRAI6……………………………………………… 701.4.6.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI6……………………………… 721.4.6.3. Syntaxe de POUR DE VRAI6………………………………………………….. 721.4.6.4. Phonologie de POUR DE VRAI6………………………………………………. 72
1.4.7. POUR DE VRAI7…………………………………………………….. 721.4.7.1. Sémantisme de POUR DE VRAI7……………………………………………… 721.4.7.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI7……………………………… 751.4.7.3. Syntaxe de POUR DE VRAI7………………………………………………….. 751.4.7.4. Phonologie de POUR DE VRAI7………………………………………………. 75
1.4.8. Conclusion sur le vocable POUR DE VRAI………………………….. 75
1.5. POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI………………….. 771.5.1. Variation d’utilisation de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE
et À DIRE VRAI……………………………………………………………… ….. 771.5.2. Morphologie de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI………… 771.5.3. Sémantisme de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI…………. 781.5.4. Relations paradigmatiques de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE
et À DIRE VRAI……………………………………………………………………. 801.5.5. Syntaxe de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI……………… 811.5.6. Phonologie de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI…………... 811.5.5. Conclusion au sujet de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI…. 81
CHAPITRE 2 – TRAITEMENT LEXICOGRAPHIQUE…………………………… 83
2.1. VRAI adjectif……………………………………………………………….... 832.2. VRAIMENT…………………………………………………………………. 872.3. PAS VRAIMENT…………………………………………………………... 932.4. POUR DE VRAI …………………………………………………………… 952.5. POUR DIRE VRAI…………………………………………………………. 1022.6. À VRAI DIRE ……………………………………………………………… 1032.7. À DIRE VRAI ……………………………………………………………… 104
CONCLUSION…………………...…………………………………………………...105
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………….107
7
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES
Tableau 1 – Variation morphologique de POUR DIRE VRAI,À DIRE VRAI et À VRAI DIRE…………………………………. 78
Figure 1 - Typologie des marqueurs pragmatiques………………………….…….13
Figure 2 - Réseau polysémique de VRAI adjectif……..…………………………... 32
Figure 3 - Réseau polysémique de VRAI adjectif et VRAIMENT……..…….…...54
Figure 4 - Réseau polysémique de VRAI adjectif, VRAIMENTet PAS VRAIMENT……………………………………………………..60
Figure 5 - Réseau polysémique de VRAI, VRAIMENT, PAS VRAIMENT, et POUR DE VRAI……………………………………………………... 76
Figure 6 - Réseau polysémique de VRAI, VRAIMENT, PAS VRAIMENT,POUR DE VRAI, POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI………………………………………………….…….. 82
8
Introduction
I. Présentation de l’étude
Les locuteurs d’une langue éprouvent le besoin d’ancrer leur discours dans le monde réel
et de se positionner par rapport à celui-ci. Il leur faut des marqueurs pour confirmer leurs
propos, les rectifier, les intensifier, signifier leur étonnement à leur sujet, etc. Le concept
de (vrai) semble avoir un rôle important à jouer dans ce type d’activité linguistique. En
effet, on rencontre un grand nombre de locutions employées comme marqueurs
pragmatiques qui sont construites avec le mot vrai.
II. Objet de l’étude
Ce mémoire a pour objet la description de marqueurs pragmatiques construits avec le mot
VRAI dans la variété de français parlée au Québec.
Il a fallu faire un choix parmi les nombreux vocables du champ lexical à l’étude. Étant
donné le manque d’informations et de compétences linguistiques intuitives à leur sujet,
nous avons écarté les vocables vieillis ou rares comme DANS LE VRAI, COMME DE
VRAI, AU VRAI, DE VRAI et EN VRAI. Pour des questions d’homogénéité, nous
avons préféré concentrer notre étude sur les marqueurs ayant surtout des emplois
d’adverbes, de connecteurs textuels et de marqueurs d’interprétation, plutôt que sur
d’autres, très pragmaticalisés, plus proches des marqueurs de réalisation d’actes
illocutoires, comme PAS VRAI, C’EST PAS VRAI, C’EST VRAI. L’étude de ces
derniers est pleine de promesses, mais dépasse les limites matérielles de ce mémoire.
10
Les vocables que nous avons choisi d’étudier nous apparaissaient fréquents et forment un
ensemble relativement homogène au point de vue sémantique et catégoriel. Ces vocables
sont VRAIMENT, PAS VRAIMENT, POUR DE VRAI (qui présente les variations
POUR LE VRAI et POUR VRAI), POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE
VRAI.
Comme tous ces vocables sont construits à partir du mot VRAI, nous avons également dû
ajouter cet adjectif à notre liste. L’analyse de VRAI nous fournira les outils sémantiques
nécessaires à l’examen des marqueurs retenus.
L’analyse sémantique se trouve au premier plan dans cette étude. Le prétexte à cette
analyse est l’écriture d’articles de dictionnaire pour chacun des marqueurs étudiés. La
terminologie et la méthode utilisées sont empruntées au travail de Gaétane Dostie sur les
marqueurs pragmatiques, travail qui se situe lui-même dans le cadre de la théorie Sens-
Texte (voir 1.4).
III. Justification de l’étude
Les marqueurs pragmatiques (MPr) font encore partie d’une zone floue en linguistique.
Tant la typologie qui leur est relative que les critères permettant de les classer varient
selon les auteurs et les cadres théoriques. Nous sommes en accord avec Dostie
(2004 : 45) pour qui la « compréhension de plus en plus raffinée des MD [marqueurs
discursifs] (et autres unités du genre) pris de façon individuelle conduira à des
propositions plus générales que celles dont nous disposons à l’heure actuelle à la fois sur
leurs fonctions et sur leur classification ». Nous espérons ainsi que notre étude
11
contribuera à une meilleure compréhension d’un des micro-systèmes des MPr du
français. Plus particulièrement, nous aimerions participer à l’effort de modélisation de ces
marqueurs dans le cadre du modèle Sens-Texte.
Précisons dès à présent que les termes « marqueurs pragmatiques » désignent la catégorie
des lexies jouant un rôle dans les interactions entre locuteurs (délimiter les tours de
parole, indiquer les ruptures thématiques, structurer les conversations, ancrer les énoncés
au contexte, réaliser des actes illocutoires…) (Dostie 2004 : 45). Ces lexies ont la
caractéristique d’être « non descriptives », c’est-à-dire qu’elles sont « destinée[s] à
effectuer soit un acte de parole performatif, soit un acte de parole informatif qui n’est pas
une communication mais un signalement. » (Iordanskaja et Mel'cuk 1999a). De plus,
elles n’acceptent pas la négation, l’interrogation ou la modification (Iordanskaja et
Mel’čuk 1999b : 5).
La figure 1 présente l’esquisse d’une typologie des marqueurs pragmatiques proposée
dans Dostie (2004). Nous rappelons que cette catégorisation des marqueurs ne se prétend
pas parfaite et définitive. La recherche au sujet des marqueurs pragmatiques, comme
toute recherche, est un processus de clarification qui va et vient de la théorie à l’analyse
pratique. Poser les bases d’une typologie est un impératif méthodologique qui enrichit et
guide l’analyse.
12
Figure 1Typologie des marqueurs pragmatiques
Nous réalisons qu’une typologie n’est significative que dans la mesure où elle est
expliquée en détails, ce que nous ne pouvons faire ici. C’est pourquoi nous renvoyons le
lecteur qui voudrait des explications à son sujet à Dostie (2004).
IV. Méthodologie de l’étude
Nous adhérons aux objectifs du modèle Sens-Texte qui se propose de mettre au point un
système explicite de règles, logiques et discrètes, permettant de passer d’une structure
sémantique à un texte d’une langue particulière. Nous prendrons pour acquis que le
lecteur connaît déjà les bases de cette théorie, plus particulièrement en ce qui a trait à la
méthode lexicographique (pour une introduction générale voir Mel’cuk 1997 et pour une
présentation de la méthode lexicographique explicative et combinatoire voir Mel’čuk et
al. 1995).
marqueurs pragmatiques (MPr)
marqueurs discursifs (MD) connecteurs textuels (CT)
marqueurs illocutoires marqueurs d’interaction
MI MRAI MAÉ MÉ MB
Légende :MAÉ = marqueurs d’appel à l’écoute
MI = marqueurs d’interprétation MÉ = marqueurs d’écouteMRAI = marqueurs de réalisation d’un acte illocutoire MB = marqueurs de
13
Nous adhérons également au principe selon lequel « tout mot sémantiquement complexe
peut être expliqué à l’aide d’une paraphrase exacte composée de mots plus simples et
plus intelligibles que l’original » (Wierzbicka 1972). Ainsi, sauf dans le cas de primitifs
sémantiques, le sens de chacun des mots d’un texte peut, en théorie, être entièrement
rendu par une paraphrase exacte. Cela devrait être également vrai pour les marqueurs
pragmatiques.
Notre travail s’aligne sur l’ouvrage Pragmaticalisation et marqueurs discursifs de
G. Dostie (2004 : 185-192). L’ouvrage propose l’inclusion d’éléments propres aux
marqueurs discursifs dans la description lexicographique. Par exemple :
- prise en compte de certains éléments du contexte dans les définitions : utilisation de
termes déictiques (JE, TU), de variables représentant des textes, d’adresses à des
coénonciateurs;
- prise en compte des fonctions pragma-sémantiques des marqueurs et des actes de
langage auxquels ils sont associés;
- prise en compte des combinaisons syntagmatiques (ex : Vraiment là!);
- prise en compte de la fixation plus ou moins fortement réalisée d’éléments constitutifs
des phrasèmes;
- prise en compte de la dimension prosodique et de la gestuelle (dimension kinésique).
Une grande partie des exemples cités dans notre mémoire sont tirés de la Banque de
données textuelles de l’Université de Sherbrooke (BDTS). Les quelques exemples à
valeur historique ont été tirés de FRANTEXT. Enfin, il a été parfois nécessaire de forger
14
certains exemples pour les bienfaits de la démonstration, d’autres ont été entendus et
retranscrits sur le vif ou encore lus.
V. Structure de l’étude
Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous analysons tour à tour les propriétés
linguistiques des six vocables à l’étude et proposons les paramètres de leur modélisation.
Chaque vocable y est divisé en lexies, dont les sens et les propriétés sont décrits à l’aide
des objets formels propres à notre cadre théorique.
Dans le deuxième chapitre, nous présentons le traitement lexicographique des vocables,
c’est-à-dire les articles qui leur correspondent, comme s’ils étaient insérés dans un
Dictionnaire explicatif et combinatoire.
15
Chapitre 1 – Analyse linguistique
Ce chapitre constitue le cœur du mémoire; on y fait l’analyse d’une partie du champ
lexical des marqueurs pragmatiques construits avec VRAI en français québécois.
L’analyse particulière des vocables et lexies, puis leur comparaison et leur mise en
relation permettront de mettre en lumière les différents liens de synonymie et
d’hyperonymie entre les unités de ce champ.
Notre première tâche est de distinguer les différentes lexies de chacun des vocables.
Chacune des lexies doit ensuite être analysée, afin que ses propriétés linguistiques
puissent être modélisées, c’est-à-dire décrites à l’aide des objets formels propres à notre
cadre théorique : une définition et une liste de fonctions lexicales concernant le signifié
des lexies, puis la description de leurs caractéristiques syntaxiques et phonologiques,
ainsi qu’une figure représentant le réseau polysémique du vocable et des autres vocables
du champ étudié.
1.1. VRAI adjectif
Les signifiés des unités que nous analyserons contiennent presque tous des composantes
sémantiques d’une lexie ou d’une autre du prédicat VRAI. Nous devons donc commencer
par analyser celui-ci.
Cette analyse ne porte que sur l’adjectif VRAI et non pas le nom, que l’on retrouve par
exemple dans l'énoncé suivant :
(1) J’ai vu un peu de vrai dans ses paroles.
16
Nous n’étudierons pas non plus le VRAI adverbe, comme dans l’énoncé (2) :
(2) Ton petit frère, il est malade vrai.
Ni le VRAI marqueur pragmatique, exemplifié par l’énoncé (3), qui peut être remplacé
par C’EST VRAI :
(3) Vrai, ma famille a pas toujours fait que des bons coups à Bonaventure.
VRAI entre aussi dans la formation de locutions semi-figées. Celles-ci sortent également
du cadre de notre analyse. Ainsi, les phrasèmes FAIRE VRAI, DIRE VRAI et
PARLER VRAI sont des « expressions » qui demandent une analyse qui leur est
propre :
(4) Ce décor est bien construit, il fait vrai.
(5) L’enfant dit vrai, laisse-le partir.
Les énoncés suivants présentent différentes utilisations de VRAI en tant qu’adjectif. Suite
à leur lecture, il est difficile de conclure que ce vocable n’a qu’un seul sens.
(6) C’est vrai ce qu’elle dit.
(7) C’est un vrai Picasso!
(8) Je trouve qu’il n’est pas vrai comme personne, t’sais.
(9) Ce poème est si vrai, si beau!
(10) Enfin, j’ai des vraies vacances.
(11) Les frites sont un vrai poison.
17
Les arguments de VRAI dans les énoncés (6), (7), (8) et (9) sont de natures différentes et
semblent associées à divers sens de VRAI. En (6), l’argument sémantique de VRAI est
une proposition ou un ensemble de propositions. En (7), cet argument est un objet. En
(8), l’argument de VRAI est une personne et en (9), une œuvre d’art. Les énoncés (10) et
(11), quant à eux, présentent des VRAI qui ont rapport avec l'idée de traits prototypiques,
ce qui n’est pas le cas des autres énoncés.
L’exposé qui suit explique pourquoi nous avons choisi de considérer les VRAI de (6) et
(7) comme étant une seule lexie et les VRAI de (8), (9), (10) et (11) comme autant de
lexies différentes.
1.1.1. VRAI1
1.1.1.1. Sémantisme de VRAI1
Le VRAI des énoncés (6) et (7) est certainement celui dont le sens est le plus « basic ».
Cette lexie de VRAI est la cible d’une très longue investigation philosophique et
linguistique, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. La littérature sur le sujet est si vaste
qu’en énumérer certains aspects, auteurs et œuvres clés demanderait plusieurs dizaines de
pages. Disons seulement que certains ont émis l’hypothèse que la vérité était une question
de cohérence (B. Russell, J. Habermas, J.O.Young, W. Quine…), d’autres que la vérité
était pragmatique, c’est-à-dire subjective et liée à l’utilité qu’on lui donne (C.S. Pierce,
W. James…), mais que, traditionnellement, la vérité est conçue comme indiquant une
correspondance entre une proposition et le monde réel (Aristote, A. Tarski…).
18
Ainsi, un mot sans référent réel ne peut être dit « vrai » : dans notre monde, Alice au pays
des merveilles n’est pas vraie, les licornes ne sont pas vraies… La conception
déflationniste de la vérité utilise l’équation suivante pour caractériser la vérité (Field
2004) :
(12) « p » est vrai si et seulement si p
La variable entre guillemets réfère au nom d’une proposition, tandis que la variable sans
guillemets réfère au signifié de la proposition. Ainsi, la proposition « Nicolas est né à
Londres » est vraie si et seulement si Nicolas est né à Londres. Le mot vrai a la propriété
de « déguillemettiser » ou « déciter » (disquotate) un contenu propositionnel (Stoljar
1997). Dans l’exemple suivant, la proposition « l’Ontario a des hôpitaux de haute
qualité » ne peut être vraie que s’il y a des hôpitaux de haute qualité en Ontario dans la
réalité relative au contexte de production de l’énoncé.
(13) Comme vous savez, nous avons des hôpitaux qui sont de très haute qualité partout dans la province du Nouveau-Brunswick et nous livrons un service de qualité. Mais probablement que le même est vrai dans la province de l'Ontario.
D’un autre coté, la vérité d’une chose peut aussi faire l’objet d’une convention, c’est-à-
dire qu’elle peut être considérée dans le cadre d’un monde imaginaire. L’énoncé (14) est
acceptable, même si ni Milou ni Tintin ne sont pas de vrais êtres :
(14) C’est vrai que Milou est le compagnon de Tintin.
On voit ainsi que cette lexie de VRAI n’est pas synonyme de RÉEL. Qu’une arme à feu
soit vraie ou fausse, elle reste réelle.
19
Nous considérons que ce sens de l’adjectif VRAI est un primitif sémantique, c’est-à-dire
que son signifié ne peut être divisé en éléments plus simples et aisés à comprendre. La
primitivité de VRAI est en ce moment admise par les tenants du métalangage sémantique
naturel qui a été développé, entre autres, par Anna Wierzbicka et Cliff Goddard :
Moreover, we have argued and sought to demonstrate that the concept ‘true’ is a linguistic universal and that in all languages people can say the exact semantic equivalent of “this is true” and “this is not true”. 1 (Wierzbicka 2002)
Selon cette théorie, les primitifs sémantiques sont un petit nombre de concepts qui sont
présents, sous la forme de mots ou d’éléments flexionnels, dans toutes les langues
naturelles. Leurs sens ne peuvent être divisés en éléments plus simples (Wierzbicka 1972;
1996).
Cette lexie étant considérée comme un primitif sémantique, on ne peut la définir. En
revanche, elle servira elle-même à définir les autres lexies du vocable. C’est donc la lexie
de base du vocable.
La forme propositionnelle de VRAI1 peut être exprimée de cette façon : « X [est] vrai ».
Le verbe ÊTRE est mis entre crochets afin de symboliser la possibilité de produire
l’adjectif sous la forme d’une copule.
1.1.1.2. Relations paradigmatiques de VRAI1
1 Traduction : « De plus, nous avons posé l’hypothèse et cherché à démontrer que le concept de ‘vérité’ est un universel linguistique et que dans toutes les langues on peut dire l’équivalent sémantique exact de ‘ceci est vrai’ et ‘ceci n’est pas vrai’. »
20
VRAI1 étant primitif, ses synonymes ont tous un sens plus étroits que lui. Lorsque
VRAI1 a une proposition comme argument, il est un marqueur épistémique comme
CERTAIN, PROBABLE... Lorsqu’il a comme argument un objet, il commute avec
RÉEL. Ces différentes relations paradigmatiques peuvent être modélisées à l’aide de
fonctions lexicales (FL). Ces listes ne sont probablement pas exhaustives et l’ordre
d’apparition des valeurs est arbitraire :
Syn⊂ : réel, véritable, certain, sûr, juste, évident, assuré, garanti, attesté, certifié
Anti : faux
Anti⊂ : irréel, incertain, improbable, fautif, douteux, erroné, fictif, feint, impossible
Adv0 : vraiment1
1.1.1.3. Syntaxe de VRAI1
VRAI1 se place habituellement avant son actant sémantique qui peut être exprimé en
syntaxe profonde par un syntagme nominal. Ce syntagme peut être une proposition, un
ensemble de propositions, un pronom ou un nom.
1.1.1.4. Phonologie de VRAI1
Le système de notation phonologique utilisé dans ses pages n’est destiné qu’à jeter les
bases d’une description des signifiants à l’étude. Les différentes possibilités de réalisation
phonologique des lexies telles que notées ici ne sont pas le fruit d’observations
objectives. Nous trouvons pertinent de les présenter dans la mesure où elles sont parfois
liées à certains phénomènes sémantiques.
21
Peut-être à cause de son rôle sémantique « fondamental », VRAI1 a plus souvent
l’occasion d’être accentué que la plupart des adjectifs.
[vRE] [`vRE]
1.1.2. VRAI2
1.1.2.1. Sémantisme de VRAI2
VRAI a pris un sens particulier lorsqu’il est attribué à une personne ou à un personnage.
Il a alors le sens d’AUTHENTIQUE tel que défini par le Petit Robert 2003 : « Qui
exprime une vérité profonde de l’individu et non des habitudes superficielles, des
conventions. ».
Un énoncé comme (15) est ambigu : il peut signifier soit (Mélanie existe en chair et en
os), soit (Mélanie est authentique).
(15) Mélanie est vraie.
Une personne (vraie) pense comme elle le dit et agit en accord avec ses principes moraux.
Ses comportements traduisent sa vraie nature.
Pour cerner de manière plus précise le sens de cette lexie, il faudrait (dans le cadre d’une
étude plus large) l’opposer à d’autres lexies du même champ sémantique comme
HONNÊTE, SINCÈRE, AUTHENTIQUE, MENTEUR.
Pour l'instant, nous attribuons à VRAI2 la paraphrase suivante:
2. X [est] vrai ≅
22
(La personne X se comporte selon sa vraie1 natureI.4.)
Le mot NATURE utilisé dans cette définition demande bien entendu à être désambiguïsé.
Nous allons, pour l’instant, devoir confier cette tâche au Petit Robert (2003) qui définit
cette lexie ainsi : « I.4. La nature de qqn, une nature : ensemble des éléments innés d’un
individu ».
1.1.2.2. Relations paradigmatiques de VRAI2
Syn∩ : authentique, droit, honnête, sincère, franc
Anti : faux
Anti∩ : menteur, trompeur, perfide, mythomane, hypocrite, sournois, dissimulé, fourbe, insidieux
1.1.2.3. Syntaxe de VRAI2
Cette lexie a la forme propositionnelle de l’adjectif; sa portée est limitée à un syntagme
nominal qui doit être une personne. L’actant syntaxique de VRAI2 doit se placer avant
l’adjectif, comme en (16a), à défaut d’en changer le sens :
(16a) Un homme vrai. ( VRAI2)
(16b) Un vrai homme. ( VRAI4a)
1.1.2.4. Phonologie de VRAI2
VRAI2 est souvent accentué.
[vRE] [`vRE]
1.1.3. VRAI3
1.1.3.1. Sémantisme de VRAI3
23
Lorsque VRAI a comme argument une quelconque représentation de la réalité comme
une œuvre d’art, une théorie ou une hypothèse, il peut prendre un sens particulier que le
Petit Robert (2003) définit ainsi : « Qui s’accorde avec le sentiment de la réalité du
spectateur, de l’auditeur (en général par la sincérité et le naturel). »
On retrouve par exemple ce sens dans des contextes de scène où des personnages sont
joués par des acteurs :
(17) Si tel personnage est vrai, c'est parce que j'en ai emprunté les traits et une partie des agissements à des personnes réelles et que j'en ai complété la mise en forme avec mes propres désirs, mon propre rapport aux choses et à l'histoire.
Nous attribuons à VRAI3 la paraphrase suivante :
3. X [est] vrai ≅(X est la représentation de vraies1 choses.)
Nous croyons que le mot REPRÉSENTATION, dont la définition formelle gagnerait à
être faite, est suffisamment vague pour permettre l’utilisation de cette paraphrase dans
tous les contextes de VRAI3, tant lorsqu’il qualifie une représentation artistique, comme
en (17), que lorsqu’il qualifie une représentation scientifique, comme en (18) :
(18) Je pense que la théorie du Big Bang est vraie.
1.1.3.2. Relations paradigmatiques de VRAI3
Syn∩ : crédible, exact, authentique
Anti : faux
Anti∩ : erroné, inexact
24
1.1.3.3. Syntaxe de VRAI3
Comme dans le cas de VRAI1.2, cette lexie a la forme propositionnelle de l’adjectif. Sa
portée est limitée à un syntagme nominal qui doit être une « représentation » de quelque
chose.
1.1.3.4. Phonologie de VRAI3
VRAI3 peut être légèrement accentué.
[vRE] [`vRE]
1.1.4. VRAI4a
1.1.4.1. Sémantisme de VRAI4a
On a vu que VRAI1 peut caractériser un argument sémantique comme étant vrai en
opposition à un état faux, feint ou fictif. VRAI4a caractérise plutôt un argument comme
étant vrai en opposition à un état imparfait ou incomplet. Par exemple :
(19) Une vraie amour, une grande, une catholique, rien que du coeur, pas de cochonneries.
L’ « amour » de l’énoncé (19) n’est pas imparfait, il a les caractéristiques les plus
importantes qu’un amour doit avoir et il les a à un haut niveau.
La lexie VRAI4a servirait ainsi à caractériser un élément comme se rapprochant du
prototype d’une catégorie. Le prototype « est conçu comme étant le meilleur exemplaire
communément associé par les sujets parlants à une catégorie » (Kleiber 1993 : 104).
Selon les théories de la sémantique des prototypes, les caractéristiques essentielles d’un
prototype serviraient de critères à la catégorisation. Lorsqu’en discours un locuteur
25
associe un élément à une catégorie (en disant « ceci est un 'X' »), il attribue par le fait
même les traits caractéristiques de cette catégorie à cet élément. Mais lorsque le locuteur
dit « ce X est un vrai ‘X’ », il le fait afin d’insister sur le fait que les caractéristiques
essentielles de la catégorie « X » sont fortement présentes dans le X en question. C’est ce
que fait VRAI4a dans l’énoncé suivant :
(20) En arrière, vous aviez une cour, une cour entourée d'une haute palissade : le vrai p'tit coin propice pour les tête-à-tête entre chattes et matous.
Le « p’tit coin propice pour les tête-à-tête entre chattes et matous » dont il est question en
(20) a tout ce qu’il faut pour l’être; il a fortement les caractéristiques essentielles d’un
p’tit coin propice pour les tête-à-tête entre chattes et matous, c’en est un vrai4a.
Une façon simple de traduire le concept de « essentiel » propre à la lexie qui nous
intéresse est la suivante : (X est essentiel à Y) ≅ (X est ce qui fait que Y est un «Y»). En
ajoutant une composante intensificatrice à cette paraphrase, nous arrivons à décrire le
signifié de VRAI4a :
4a. vrai X ≅(X a fortement les caractéristiques qui font d’un « X » un vrai1 « X ».)
Nous préférons cette formulation à une autre qui ferait appel au mot ESSENTIEL du
type : (X a fortement les caractéristiques essentielles d’un vrai1 X.). Cette formulation ne
rend pas bien le lien sémantique qu’entretiennent VRAI4a et VRAI1. D’autre part, il se
pourrait bien que le signifié de la lexie d’ESSENTIEL qui nous intéresse soit plus
complexe que la seule composante (X est ce qui fait que Y est un «Y»). Or il est
impossible de définir une lexie simple à l’aide d'une lexie plus complexe.
26
Le mot FORTEMENT est le plus « neutre » et le plus simple que nous avons trouvé afin
de rendre compte de la composante intensificatrice de VRAI4a. La composante
(fortement) respecte, à notre avis, la méthode de paraphrasage de la FL [Magn] telle que
proposée par S. Popovic (2004). Cette composante est centrale dans le signifié de la lexie
VRAI4a. Les énoncés (21) et (22a) présentent VRAI1 et VRAI4a. On voit que la
différence est mince entre les deux lexies.
(21) C’est pas un vrai oiseau, c’est une autruche en carton. ( VRAI1)
(22a) L’autruche n’est pas un vrai oiseau. ( VRAI4a)
(22b) L’autruche n’est pas un oiseau qui a fortement les caractéristiques qui font d’un oiseau un vrai1 oiseau.
1.1.4.2. Relations paradigmatiques de VRAI4a
L’existence d’une lexie VRAI4a différente de VRAI1 est corroborée par une différence
dans leur dérivation. Alors que l’adverbialisation de VRAI1 donne VRAIMENT1,
l’adverbialisation de VRAI4a donne VRAIMENT4.
Syn∩ : pur, véritable, parfait
Adv0 : vraiment4
Anti∩ : espèce de, genre de, sorte de
1.1.4.3. Syntaxe de VRAI4a
Cette lexie se place toujours immédiatement avant le nom qu’elle modifie : « vrai X ».
Contrairement à VRAI1, sa portée ne permet pas les formations de ce genre : « *c’est
vrai4a que X ». Elle ne peut pas non plus être utilisée en copule : « *Le repas est vrai4a ».
1.1.4.4. Phonologie de VRAI4a
27
VRAI4a est souvent accentué et parfois allongé.
[vRE] [`vRE] [`vRE:]
1.1.5. VRAI4b
1.1.5.1. Sémantisme de VRAI4b
Cette lexie correspond à l’emploi métaphorique de la précédente. Les métaphores sont
des outils fréquents dans la langue, mais dans le cas du mot VRAI, l’emploi
métaphorique est si fréquent, qu’il semble codifié dans le système linguistique. Il est
donc opportun d’en faire une lexie particulière.
Dans l’énoncé (23), les frites ne sont pas présentées comme du poison au sens littéral,
mais elles sont tenues comme ayant fortement les caractéristiques qui font qu’un poison
est un poison. Elles sont donc, en partie, sémantiquement… du vrai poison, c’est-à-dire
une « substance capable de troubler gravement ou d’interrompre les fonctions vitales
d’un organisme […]. » selon le Petit Robert (2003).
(23) Voilà la chère voiture de frites et son petit sifflet avertisseur. Molles et mal cuites? Peut-être. Oui, peut-être « mauvais pour la santé » comme disent les grands et les vieux, mais on s'en fiche. « Un cornet m'sieur! Cinq sous? Les voilà! » Et on a droit au sel en masse et au vinaigre en quantité. Ça coule à travers le sac pointu? Et puis après? C'est si bon. « Du vrai poison », marmonne le petit père Laroche, toujours sérieux et pompeux. Et puis après?
Associer POISON et FRITES est ainsi quelque chose de sémantiquement plausible à
cause des complications pour la santé que leur consommation à long terme entraîne. On
voit que les traits prototypiques d’un mot (d’une catégorie) peuvent servir à qualifier
d'autres objets que ceux normalement dénotés par ce mot.
28
Ce type de phénomène, lié à l’utilisation du mot VRAI, est à notre avis celui dont il est
fait allusion dans l’Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire (Mel’čuk et
al. 1995 : 31), où on donne comme exemple la paire d’énoncés suivante :
(24a) Mon père est un VRAI médecin (Mon père exerce réellement la profession de médecin).
(24b) Mon père est un VRAI médecin (Mon père, qui n’est pas médecin, a des aptitudes pour soigner).
Il semble que dans (24b) le substantif MÉDECIN soit utilisé pour les traits prototypiques
de la catégorie qu’il dénote plutôt que pour sa capacité de désignation.
Comme le remarquent les auteurs de l’ouvrage, « ces deux sens différents sont
indissolublement liés à deux prosodies différentes » (Mel’čuk et al. 1995: 31). D’ailleurs,
la prosodie ainsi que le contexte d’énonciation d’un énoncé peuvent faire naître ce type
de phénomène en l'absence du mot VRAI :
(25a) J’en reviens pas. Le gars le plus paresseux qu’il y a sur la terre. Il est en train de construire une maison!
(25b) Wow! Regarde-moi cette niche : il a même fait une poignée pour la porte et mis un petit tapis. Il est en train de construire une maison!
En (25b), le substantif MAISON est utilisé pour les traits prototypiques de sa catégorie
plutôt que pour sa capacité de désignation. C’est une métaphore. NICHE est associée au
signifié de MAISON de façon à lui attribuer certaines de ses caractéristiques. À quoi sert
le mot VRAI dans un contexte semblable si la métaphore peut avoir lieu de toutes
29
façons? VRAI4b sert à confirmer la métaphore, à la rendre plus explicite (voir à ce sujet
Legallois 2002).
L’utilisation métaphorique de VRAI est suffisamment lexicalisée pour justifier qu’on la
distingue de VRAI4a. La paraphrase qui lui est associée est pratiquement identique à
celle de VRAI4a. La seule différence réside dans l’identité de la catégorie dont les
(principales caractéristiques) sont issues. Dans le cas de VRAI4a, il y a correspondance
entre l’argument (X) et la catégorie à laquelle on l’associe. Dans le cas de VRAI4b, la
relation entre l’argument (X) et la catégorie à laquelle on l’associe est métaphorique.
4b. X est un vrai « Y » ≅ (X a fortement les caractéristiques qui font d'un « Y » un vrai1 « Y ».)
1.1.5.2. Relations paradigmatiques de VRAI4b
Syn : véritable
1.1.5.3. Syntaxe de VRAI4b
VRAI4b se place toujours immédiatement avant l’actant Y qui doit être un syntagme
nominal. L’actant X peut ne pas se réaliser en syntaxe de surface.
1.1.5.4. Phonologie de VRAI4b
VRAI4b est souvent accentué et parfois allongé.
[vRE] [`vRE] [`vRE:]
1.1.6. Conclusion sur le vocable VRAI
30
La présentation des lexies de l’adjectif VRAI est maintenant terminée. En résumé,
VRAI1 est le sens primitif, VRAI2 est attribué à des personnes et a le sens
d’(authentique), VRAI3 est attribué à des représentation de la réalité, VRAI4a situe un état
de chose comme ayant fortement les caractéristiques prototypiques de sa catégorie et
VRAI4b situe un état de chose comme ayant fortement les caractéristiques prototypiques
d’une autre catégorie.
Notre analyse permet d’expliquer des cas mystérieux comme en (26a) :
(26a) A : C’est une vraie théorie ce que tu dis là! B : En fait, c’est une vraie théorie, mais elle n’est pas vraie, bien sûr.
Nous pouvons étiqueter les différents VRAI afin de les désambiguïser :
(26b) A : C’est une vraie4b théorie ce que tu dis là! B : En fait, c’est une vraie1 théorie, mais elle n’est pas vraie3, bien sûr.
Une théorie peut donc être à la fois vraie dans le sens où elle est existe (que des
scientifiques la proposent) et à la fois être non-vraie, dans le sens où elle ne représente
pas de vraies choses. La théorie dont il est question en (26) n’est donc probablement pas
cohérente avec la réalité et ne représente pas bien le réel, comme une théorie doit l’être.
Pour terminer, il nous est possible de représenter le réseau polysémique des lexies de
VRAI adjectif à l'aide d'une figure. Les flèches symbolisent l’inclusion des sèmes d’une
lexie dans une autre. A B, signifie que A est inclus dans B.
31
1.2. VRAIMENT
Cette partie est consacrée à l’analyse de l’adverbe VRAIMENT et de ses usages
discursifs. Rencontré dans un texte, rien dans la morphologie de VRAIMENT ne permet
de savoir s’il s’agit d’un adverbe ou d’un MD. Que l’on choisisse ou non de regrouper
toutes les lexies de VRAIMENT sous un même article de dictionnaire, leur analyse gagne
à être menée en même temps : les MD sont issus de la pragmaticalisation des sens
lexicaux et sont, par conséquent, souvent liés sémantiquement à ceux-ci.
Les trois premières lexies de VRAIMENT sont directement liées au primitif sémantique
VRAI1 :
(27) Est-ce que tu penses vraiment que c’est une bonne idée?
(28) Je suis le descendant de Louis XIV. Vraiment.
(29) A : J’aime bien Jean Charest.B : Vraiment?
Le VRAIMENT de l’énoncé (27) est un adverbe « normal », tandis que ceux de (28) et
(29) sont des « mot-phrases ». Trois autres lexies du vocable sont liées au VRAI4a :
(30) Il fait vraiment trop froid ici.
(31) Vraiment, il est temps que l’hiver finisse.
(32) [A renverse sa tasse de café sur les papiers de B.]B : Vraiment là! T’es ben maladroit.
En (30), VRAIMENT est un adverbe intra-phrastique, en (31), il est adverbe
« d’énonciation » et en (32), « mot-phrase ».
1.2.1. VRAIMENT1
33
1.2.1.1. Sémantisme de VRAIMENT1
Le VRAIMENT de l’énoncé (27) est construit avec VRAI1. C’est un « adverbe » dont la
portée est dite « extra-prédicative », c’est-à-dire que son argument sémantique est une
phrase complète. Comme VRAI1, VRAIMENT1 permet, entre autres, de confirmer un
état du monde ou de l’opposer à un état du monde fictif ou imaginaire. Par exemple :
(33a) Il y a deux militaires qui ont sauvé vraiment la vie d'une personne qui était menacée d'hypothermie en plein champ. Ils l'ont sauvée.
Dans l’énoncé (33a), VRAIMENT1 confirme la vérité de la phrase dans lequel il se
trouve.
De nombreux adverbes qui ont la forme « Adj-ment » se définissent facilement à l’aide
de la paraphrase « de manière Adj ». Par exemple, l’adverbe CORDIALEMENT, peut se
définir par « de manière cordiale ». Cette façon systématique de décrire les adverbes est
appropriée au projet du DEC. La portée extra-prédicative de VRAIMENT1 rend
cependant impossible un paraphrasage de ce type : (P-er de manière vraie1). En effet, si
on substitue cette paraphrase à VRAIMENT1 dans l’énoncé (33a), le résultat n’a pas le
même sens :
(33b) Il y a deux militaires qui ont sauvé de manière vraie la vie d'une personne qui était menacée d'hypothermie en plein champ. Ils l'ont sauvée.
≠ VRAIMENT1
Nous devons attribuer à VRAIMENT1 une paraphrase dans laquelle la portée de VRAI1
englobe toute la phrase dont il est le prédicat sémantique. Par exemple : « C’est vrai1 que
34
P ». La substitution de VRAIMENT par cette paraphrase ne modifie pas le sens
propositionnel de l’énoncé (33a) :
(33c) C’est vrai qu’il y a deux militaires qui ont sauvé la vie d'une personne qui était menacée d'hypothermie en plein champ. Ils l'ont sauvée.
La paraphrase (C’est vrai1 que P) permet aussi de traiter les cas où l’argument sémantique
de VRAIMENT1 est une phrase interrogative. Une transformation est parfois nécessaire,
comme dans l’énoncé (34b) où la modalité interrogative est rendue par « est-ce que »
alors qu’elle était exprimée par l’ordre verbe-sujet dans (34a) :
(34a) Raymond, penses-tu qu'on a pris la bonne décision, penses-tu vraiment que c'est ça qu'il faut faire?
(34b) Raymond, penses-tu qu'on a pris la bonne décision, est-ce que c’est vrai que tu penses que c'est ça qu'il faut faire?
Le paraphrasage de VRAIMENT1 par (C’est vrai1 que P) pose un problème de syntaxe
dans les cas où l’argument sémantique est une phrase subordonnée. La grande portée de
VRAIMENT1 oblige à faire des paraphrases avec le mot QUE dont la répétition dans ce
cas transgresse une règle de grammaire en français :
(35a) Ce qui est vraiment arrivé ce soir-là est secret.
(35b) ? Ce qui est vrai qui est arrivé ce soir-là est secret.
Nous considérons cette paraphrase comme étant bonne malgré cette contrainte stylistique,
à défaut d’avoir mieux.
1. Vraiment P ≅ (C’est vrai1 que P.)
1.2.1.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT1
35
La relation entre VRAIMENT1 et VRAI1 peut être représentée par la FL [A0] qui permet
l’adjectivisation d’une lexie sans en modifier le sens :
A0 : vrai1
Syn : ┌pour de vrai┐1
1.2.1.3. Syntaxe de VRAIMENT1
VRAIMENT1 a les propriétés syntaxiques d’un adverbe « intra-phrastique », mais avec
un peu plus de liberté de mouvement que la plupart d’entre eux. Contrairement à la
plupart des adverbes, il ne peut porter exclusivement sur un autre adverbe ou sur un
adjectif : sa portée englobe toujours le verbe et ses arguments. On utilise la variable « P »
pour symboliser son argument sémantique.
La grande portée de VRAIMENT1 lui permet une relative liberté de mouvement dans la
phrase, ce qui peut parfois provoquer des phénomènes étonnants où deux phrases
différentes ont le même sens :
(36a) Ils veulent vraiment savoir ce qui s'est passé cette journée-là.
(36b) Ils veulent savoir vraiment ce qui s’est passé cette journée-là.
Le VRAIMENT1 de (36a) peut être interprété comme portant sur tout l’énoncé : (C’est
vrai qu’ils veulent savoir ce qui s’est passé cette journée-là.) Mais le VRAIMENT1 de
(36a) peut aussi, comme celui de (36b), porter seulement sur la partie de l’énoncé dominé
par SAVOIR : (Ils veulent que ce soit vrai qu’ils sachent ce qui s’est passé cette journée-
là.)
(36c) Ils veulent savoir ce qui s'est vraiment passé cette journée-là.
36
(36d) Ils veulent savoir ce qui s'est passé vraiment cette journée-là.
On voit qu’en (36c) et (36d), VRAIMENT1 peut se placer soit entre l’auxiliaire et le
participe passé, soit juste après ce dernier sans modifier le sens de l’énoncé. Il porte dans
les deux cas sur la subordonnée : (Ils veulent savoir ce qui est vrai qui s’est passé cette
journée-là.)
1.2.1.4. Phonologie de VRAIMENT1
VRAIMENT1 est prononcé avec une mélodie généralement plane, sa première syllabe
peut être accentuée et allongée.
[vREm2] [`vREm2] [`vRE:m2]
1.2.2. VRAIMENT2
1.2.2.1. Sémantisme de VRAIMENT2
VRAIMENT2 est issue de la pragmaticalisation de VRAIMENT1. La pragmaticalisation
est la migration d’une unité lexicale ou grammaticale vers la zone pragmatique (Dostie
2004). Par exemple SAVOIR, qui est un verbe, donc une unité lexicale, a donné T’SAIS,
qui n’est plus un verbe, mais un marqueur pragmatique.
VRAIMENT2 appartient à la classe des lexies parenthétiques. Selon Iordanskaja et
Mel’čuk (1999a), les lexies parenthétiques portent sur des énoncés entiers, elles peuvent
occuper des positions variées dans la phrase, elles présentent des intonations particulières
et sont souvent séparées du reste de la phrase par des pauses.
37
Selon la terminologie que nous avons adoptée, VRAIMENT2 est un marqueur
d’interprétation, c’est-à-dire le signalement par l’énonciateur d’un commentaire
concernant son discours. Dans le cas de VRAIMENT2, ce commentaire est relativement
simple; il peut se paraphraser ainsi : (c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise
en question] par l’énoncé « Q » est vraie1). Les crochets et la barre oblique indiquent que
la paraphrase peut se lire soit avec la composante (communiquée) soit avec la composante
(mise en question).
Dans l’énoncé (37), par exemple, une des interprétations possibles de VRAIMENT est
celle où il ne fait que confirmer que ce qui est communiqué par son énoncé « je suis
amoureux » est vrai :
(37) Je n'irai pas par quatre chemins. Maman, je suis amoureux! Vraiment! Et j'ai le sentiment - une espèce de certitude si heureuse - de l'être pour la première fois.
L’argument sémantique du marqueur d’interprétation VRAIMENT2 n’est pas
nécessairement un énoncé descriptif. Par exemple, il peut être à l’impératif, car malgré le
fait qu’un énoncé à l’impératif ne peut être ni vrai ni faux, ce qui est communiqué par un
tel énoncé peut l’être. Ainsi, la phrase « Arrête ça tout de suite » communique « Je te
demande d’arrêter ça tout de suite. ». Un énoncé comme (38) est donc possible :
(38) Arrête ça tout de suite. Vraiment.
De façon similaire, la phrase « Merci beaucoup! », qui est non descriptive, peut être
paraphrasée de façon descriptive par « Je te remercie beaucoup! ». L’énoncé (39) est
donc possible :
38
(39) Merci beaucoup! Vraiment.
La composante (met en question) de la paraphrase permet de traiter les cas où
VRAIMENT2 est produit en réponse à une question :
(40) A : Est-ce que tu es vraiment médecin?B : Vraiment. Oui.
On voit que ce n’est pas l’argument de VRAIMENT2 qui est qualifié de VRAI, mais ce
qui est communiqué ou mis en question par cet énoncé.
Le fait que VRAIMENT2 soit impossible au tout début d’un discours n’en fait pas un
connecteur textuel, puisqu’il ne relie pas deux parties de discours ensemble, mais donne
un commentaire sur un discours.
En (41), l’argument de VRAIMENT2 est la courte phrase « Beaucoup. » qui le précède et
non « Il a beaucoup d'élégance. » qui le suit. Ainsi, Eddy ne veut pas insister sur le fait
que le briquet a beaucoup d’élégance (auquel cas il aurait utilisé VRAIMENT4 ou
VRAIMENT5), mais plutôt confirmer qu’il est sincère quand il dit qu’il aime beaucoup
le briquet.
(41) MADELEINE […] Le briquet te plaît ? EDDY - Beaucoup. Vraiment. Il a beaucoup d'élégance.
Nous proposons la paraphrase suivante pour VRAIMENT2 :
2. Q. Vraiment ≅(Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1.)
39
Le caractère non descriptif d’une lexie doit se refléter dans sa définition. Par convention,
nous utilisons le verbe SIGNALER. Comme l’affirment Iordanskaja et Mel’čuk (1999a :
31), « Le verbe français signaler ne correspond pas bien au sens que nous voulons lui
donner […] : ainsi, il présuppose le destinataire (Je vous signale que je peux plus
tolérer…), ce qui ne devrait pas être le cas pour la composante sémantique (signaler). »
Nous préférons l’utilisation du (je) aux composantes (énonciateur) et (locuteur) proposées
par L. Iordanskaja et I. Mel’čuk (1999a et 1999b). Nous reconnaissons l’importance de la
question d’ « insubordonnabilité syntaxique », c’est-à-dire « [l]’incapacité de certaines
lexies non descriptives à être utilisées dans le discours rapporté » (1999a). Nous croyons
que dans certains cas, une lexie utilisée en discours rapporté est différente d’une lexie qui
ne l’est pas. La première est descriptive tandis que l’autre ne l’est pas.
Nous croyons que la lexie EN FAIT, discutée par les auteurs, utilisée en discours direct
de façon non descriptive comme en (43a), ne devrait pas avoir la même définition que
celle utilisée en discours rapporté comme en (43b) :
(43a) Pierre a dit : en fait, j’ai décidé de rester chez moi.
(43b) Pierre a dit qu’en fait, il avait décidé de rester chez lui.
Cette hypothèse est issue de l’observation d’autres types de lexies comme le verbe
performatif REMERCIER qui présente des formes différentes selon qu’il est utilisé de
façon descriptive (42a) ou non (42b).
(42a) Pierre lui a dit qu’il le remerciait.
40
(42b) Pierre lui a dit : merci.
La définition d’une lexie non descriptive comprend donc la composante (je signale) et
celle d’une lexie descriptive ne la comprend pas.
La composante (c’est vrai1 que), qui exprime l’idée de confirmation, est la paraphrase
exacte de VRAIMENT1. On peut donc dire que VRAIMENT1 est présent dans la
définition de VRAIMENT2, ce qui est cohérent avec le fait que ce dernier est issu de la
pragmaticalisation du premier.
1.2.2.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT2
Syn : ┌pour de vrai┐2
Syn∩ : ┌c’est vrai┐
1.2.2.3. Syntaxe de VRAIMENT2
Cette lexie est un « mot-phrase » qui réfère à un énoncé qui communique une information
ou qui la met en question. Un mot-phrase est un mot qui constitue à lui seul une phrase; il
est figé (invariable) et son signifié est « complet », c’est-à-dire que sa définition doit être
une phrase complète (dont le sens contient au moins un prédicat et ses arguments).
1.2.2.4. Phonologie de VRAIMENT2
Le mot-phrase VRAIMENT2 est prononcé avec une mélodie descendante ou plane, sans
accentuation.
[vREm2] [vREm2]
41
1.2.3. VRAIMENT3
1.2.3.1. Sémantisme de VRAIMENT3
VRAIMENT3 est un marqueur de réalisation d’un acte illocutoire qui permet à
l’énonciateur d’interroger le co-énonciateur au sujet de la vérité d’une information
communiquée par son énoncé et d’exprimer en même temps son étonnement au sujet de
cet énoncé. En français québécois, cette lexie est beaucoup moins utilisée (d’après une
consultation de la BDTS) que POUR DE VRAI3 qui a un sens équivalent. Son
utilisation semble limitée au registre littéraire (il n’apparaît pas dans les sections orales de
la BDTS).
Dans l’énoncé (44), A réagit à l’affirmation de B en lui demandant de la confirmer et en
lui signalant qu’elle l’étonne.
(44) A : Comment vous êtes-vous connus?B : Je ne me rappelle pas. A : Vraiment? Tu ne te rappelles pas ?...
Par cette lexie, l’énonciateur réalise donc deux actes illocutoires simultanément, le
premier directif et le second expressif.
L’énonciateur de VRAIMENT3 réagit obligatoirement à une information communiquée
par un énoncé « Q » antérieur, normalement produit par le co-énonciateur. Par
« information », on entend le sens communicatif d’un énoncé. Un énoncé à l’impératif,
une expression non descriptive (« Zut! ») ou même un geste communiquent des sens. Un
énoncé à l’impératif ne peut être sujet à interrogation, mais l’information qu’il
présuppose peut l’être. Par exemple, l’intervention de A en (45) implique l’affirmation
42
« Je te signale de ne pas l’appeler “Guillaume” » dont la véracité peut être sujet à
interrogation :
(45) A : Ne l’appelle pas « Guillaume ».B : Vraiment?
De façon semblable, le geste de A en (46) est l’équivalent discursif d’un énoncé du genre
« Je mise tout ce qui me reste d’argent! », lequel est un énoncé performatif qui, en plus de
réaliser un acte, le décrit :
(46) [Au cours d’une partie de poker, A met tout ce qui lui reste d’argent au centre de la table.]
B : Vraiment?
Par contre, VRAIMENT3 peut difficilement être produit en réponse à une question
directe, car ce type de phrase ne présuppose pas la proposition qu’elle met en
interrogation :
(47) A : Est-ce qu’il y a une soucoupe volante dehors?B : Vraiment! (≠ VRAIMENT3, mais pourrait être VRAIMENT6)
Les actes illocutoires réalisés par VRAIMENT3 sont paraphrasés à l’aide de tournures
déclaratives. La fonction interrogative est réalisée par la composante (je te demande si) et
la fonction expressive est rendue par la composante (qui m’étonne).
3. Q. Vraiment ≅(Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1.)
1.2.3.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT3
Syn : ┌pour de vrai┐3
Syn∩ : ┌sans blague┐, ┌pas vrai┐
43
1.2.3.3. Syntaxe de VRAIMENT3
VRAIMENT3 est un mot-phrase.
1.2.3.4. Phonologie de VRAIMENT3
En contexte écrit, la lexie VRAIMENT3 est suivie d’un point d’interrogation, ce qui est
cohérent avec la composante (je te demande si) qui rend compte de l’acte de question.
VRAIMENT3 est produit avec une intonation montante, ce qui est typique de la forme
interrogative. L’accentuation peut aussi être mise sur la dernière syllabe.
[vRE`m2:] [vREm2]
1.2.4. VRAIMENT4
1.2.4.1. Sémantisme de VRAIMENT4
Cette lexie de VRAIMENT a une composante intensificatrice assez évidente. À cause de
son sens d’intensification, elle doit porter sur un syntagme muni d’une composante
graduable. Ainsi, en (48a), aucune composante de « porter des jeans noires » ne peut être
intensifiée; ce syntagme ne peut donc pas être argument de VRAIMENT4 (ni de
BEAUCOUP d’ailleurs) :
(48a) Je porte vraiment des jeans noires. ( VRAIMENT1)
(48b) *Je porte beaucoup des jeans noires.
44
Par contre, en (48c), VRAIMENT4 a comme argument le syntagme « porter souvent des
jeans noires » dont la composante (souvent) est graduable. VRAIMENT4 et TRÈS sont
donc possibles ici :
(48c) Je porte vraiment souvent des jeans noires. ( VRAIMENT4)
(48d) Je porte très souvent des jeans noires.
Pour Gezundhajt (2000 : 268-269) l’étiquette d’« adverbe intensif » n’est pas totalement
justifiée dans le cas de VRAIMENT : « [S]i vraiment a une fonction intensificatrice on
peut se demander pourquoi l’énonciateur combine les deux adverbes dans un énoncé
comme :
320. Bernard Pivot : - Ne craignez-vous pas des représailles de leur part? Parce que ils peuvent être vraiment très furieux contre vous […] »
Il est parfois impossible de substituer TRÈS ou BEAUCOUP à VRAIMENT, alors que
d’autres adverbes aux propriétés similaires à VRAIMENT s’utilisent dans ces cas :
(49a) Il fait vraiment trop froid ici.
(49b) * Il fait très trop froid ici
(49c) Il fait absolument trop froid ici.
(49d) Il fait crissement trop froid ici.
Nous croyons que VRAIMENT4 est le résultat de l’adverbialisation de VRAI4a. Comme
VRAI4a, il possède donc la composante (fortement), ce qui lui donne son côté
intensifieur, mais son sens ne se limite pas à cette composante. Dans l’énoncé (50a), par
exemple, on sent bien que le sens de VRAIMENT4 n’égale pas (fortement) :
(50a) Je suis sur le point de vraiment comprendre.
45
La paraphrase « ? de manière vraie4a » n’est pas appropriée dans le cas de VRAIMENT4
à cause du comportement syntaxique de la lexie considérée qui doit habituellement se
placer juste avant le nom qu’elle qualifie. En effet, si on remplace VRAIMENT4 par
« ? de manière vraie4a » dans un énoncé comme (49e), cela crée une confusion et le sens
de VRAIMENT4 n’est pas bien rendu :
(49e) ? Il fait trop froid de manière vraie!
La paraphrase de VRAIMENT4 devra donc être formulée différemment afin d’être
grammaticalement et sémantiquement correcte. Nous proposons :
4. P-er vraiment ≅(P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est vraiment1 « P-er ».)
La composante (les caractéristiques qui font que « P-er » est vraiment1 « P-er ») tient lieu
de traits prototypiques; elle joue le même rôle que jouait la composante (qui font
qu’un « X » est un vrai1 « X ») dans la définition de VRAI4a.
Voici ce qui arrive lorsqu’on applique cette paraphrase aux différentes séries d’énoncés
problématiques introduites plus haut :
(48e) Je porte souvent, d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « porter souvent » est vraiment « porter souvent », des jeans noires.
(49f) Il fait trop froid d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « faire trop froid » est vraiment « faire trop froid ».
46
(50b) Je suis sur le point de comprendre d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « comprendre » est vraiment « comprendre ».
1.2.4.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT4
VRAIMENT4 s’inscrit dans le paradigme des adverbes intensifieurs.
Syn : ┌pour de vrai┐4
Syn∩ : absolument, franchement, crissement, parfaitement, résolument, ┌pas pour rire┐, ┌en crisse┐…
Anti∩ : ┌pas du tout┐, ┌pas pantoute┐
1.2.4.3. Syntaxe de VRAIMENT4
VRAIMENT4 peut avoir comme argument un prédicat verbal graduable ou un prédicat
adjectival graduable. Dans les cas où l’argument de VRAIMENT4 est un adjectif, le
paraphrasage nécessite une transformation :
(51a) T’écoutes de la vraiment bonne musique.
Le syntagme « de la vraiment bonne musique » peut être transformé en un syntagme sous
la forme d’une copule :
(51b) T’écoute de la musique qui est vraiment bonne.
Où la substitution de VRAIMENT4 par sa paraphrase fonctionne :
(51c) T’écoute de la musique qui est bonne d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « être bon » est vraiment1 « être bon ».
1.2.4.4. Phonologie de VRAIMENT4
47
VRAIMENT4 se prononce avec une mélodie neutre ou en cloche en accentuant et
allongeant la première syllabe.
[`vRE:m2] [`vRE:m2]
48
1.2.5. VRAIMENT5
1.2.5.1. Sémantisme de VRAIMENT5
Le déplacement de VRAIMENT4 en tête de phrase, ou en position détachée, a un effet
sur sa portée et sur son sens. Il se pragmaticalise en devenant un marqueur
d’interprétation.
Cette lexie exprime une insistance sur la véracité d’une énonciation (plutôt que sur un
syntagme de l’énoncé). Ainsi, on ne peut pas substituer au VRAIMENT5 de (52a) les
sens de VRAIMENT1 (paraphrasé en 52b) ou VRAIMENT4 (tel qu’utilisé en 52c) :
(52a) Vraiment, Jeanne, je n'insisterais pas à ta place.
≠
(52b) C’est vrai que, Jeanne, je n'insisterais pas à ta place.
≠
(52c) Jeanne, je n’insisterais vraiment pas à ta place.
C’est plutôt le « dire » que le « dit » qui est qualifié en (52a), tandis qu’en (52b) et (52c),
c’est le contenu propositionnel qui est qualifié.
Comme VRAIMENT2, VRAIMENT5 représente le commentaire d’un locuteur sur son
énonciation. Leurs paraphrases ont des similitudes, mais, alors que VRAIMENT2 était
construit à partir de VRAIMENT1, VRAIMENT5 est construit à partir de VRAIMENT4.
La composante (je signale que c’est vrai1 que) de VRAIMENT2 est donc remplacée par la
composante (j’insiste vraiment4 sur le fait que).
5. Vraiment « Q » ≅(J’insiste vraiment4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1.)
49
Cette paraphrase permet de traiter les cas où VRAIMENT5 est utilisé avec une phrase à
l’impératif :
(53a) Vraiment, avoue-le lui le plus tôt possible.
(53b) J’insiste vraiment4 sur le fait que l’énoncé [suivant] communique une information vraie : avoue-le lui le plus tôt possible.
1.2.5.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT5
Syn : ┌pour de vrai┐5
Syn∩ : ┌en vérité┐, franchement, sérieusement, ┌sans blague┐
1.2.5.3. Syntaxe de VRAIMENT5
Il est possible de postposer là à VRAIMENT5 contrairement à VRAIMENT4, ce qui
indique qu’il s’agit bel et bien d’une lexie distincte. Ainsi, on voit qu’en (54a)
VRAIMENT4 est possible, mais pas en (54b) :
(54a) Si les choses sont comme tu dis : vraiment4 d'accord, tout à fait.
(54b) * Si les choses sont comme tu dis : vraiment4 là d'accord, tout à fait.
Par contre, en (55a) et (55b), les formes vraiment et vraiment là sont interchangeables, ce
qui indique qu’il s’agit de VRAIMENT5 :
(55a) Si elle l'avait entendu, pauvre maman, il y a tout à parier qu'elle aurait souri. Ah oui, vraiment, elle aurait souri de voir papa examiner le caveau comme une autre de ses possessions en discutant le prix à tue-tête pour savoir s'il en avait pour son argent.
(55b) Si elle l'avait entendu, pauvre maman, il y a tout à parier qu'elle aurait souri. Ah oui, vraiment là, elle aurait souri de voir papa examiner le caveau comme une autre de ses possessions en discutant le prix à tue-tête pour savoir s'il en avait pour son argent.
50
L’argument sémantique de VRAIMENT5 est quelques fois implicite. Il peut, par
exemple, avoir été évoqué précédemment par un co-énonciateur. En règle générale,
l’argument de VRAIMENT5 suit de très près le marqueur. Contrairement à
VRAIMENT2 ou VRAIMENT3, VRAIMENT5 n’est pas complètement indépendant
syntaxiquement et prosodiquement de son argument; ce n’est donc pas un mot-phrase.
1.2.5.4. Phonologie de VRAIMENT5
L’intonation et l’accentuation de VRAIMENT5 est similaire à celle de VRAIMENT4 : le
marqueur a une mélodie neutre ou descendante et sa première syllabe est habituellement
accentuée. Contrairement aux mot-phrases introduits plus haut, il n’y a pas une coupure
prosodique totale entre cette lexie et l’affirmation sur laquelle elle porte.
[`vRE:m2] [`vRE:m2]
1.2.6. VRAIMENT6
1.2.6.1. Sémantisme de VRAIMENT6
VRAIMENT6 est une autre lexie mot-phrase. Elle sert à exprimer l’exaspération du
locuteur face à un comportement ou une série d’évènements. Elle semble être issue de la
pragmaticalisation de VRAIMENT4.
En (56), B exprime que le comportement de A l’exaspère.
(56) [A échappe un verre de lait]B : Ah! Vraiment! T’es don ben maladroit!
51
VRAIMENT6 n’est pas nécessairement produit en présence de l’auteur du comportement
exaspérant ni même adressé à celui-ci :
(56) [A voit un graffiti sur un mur et dit :] Vraiment!
Un comportement peut être une énonciation :
(57) A : Je trouve que Bouchard a mérité ce qui lui est arrivé. B : Vraiment! C’est niaiseux pas mal ça.
L’exaspération peut aussi être causée par une série d’évènements :
(58) [A se coupe le doigt, se cogne la tête sur le coin de la pharmacie, échappe le pansement dans la toilette puis dit : ] Vraiment!
Il est étrange que VRAIMENT6 puisse difficilement être produit dans d’autres contextes
que ceux que nous avons illustrés. Une série d’évènements pouvant être vue comme le
comportement d’un destin personnifié, il serait peut-être possible de regrouper les
composantes (comportement) et (série d’évènements) sous une seule formulation (que
nous n’avons pas encore découverte).
Par ailleurs, une composante d’intensification est définitivement présente dans le signifié
de ce VRAIMENT, ce qui permet d’envisager l’inclusion de VRAIMENT4 dans sa
paraphrase et d’établir ainsi un pont sémantique entre les deux lexies.
Comme nous l’avons vu, l’argument sémantique de VRAIMENT6 n’est pas un
« énoncé », mais un comportement ou une série d’évènements. Nous utilisons la variable
α pour symboliser cet argument extra-linguistique.
52
6. Vraiment α ≅(Je signale que le comportement ou la série d’évènements α m’exaspère vraiment4.)
1.2.6.2. Relations paradigmatiques de VRAIMENT6
Syn∩ : franchement, voyons1
1.2.6.3. Syntaxe de VRAIMENT6
Le comportement syntaxique de VRAIMENT6 est comparable à ceux de VRAIMENT2
et VRAIMENT3 : il est un mot-phrase.
1.2.6.4. Phonologie de VRAIMENT6
En contexte écrit, nous écrivons VRAIMENT6 avec un point d’exclamation afin de
rendre compte de l’acte expressif qu’il réalise.
La prosodie de cette lexie est, quoique variable, très caractéristique : elle peut être
prononcée avec une mélodie en cloche (montante puis descendante) et ses deux syllabes
peuvent être accentuées et allongées.
[`vRE:`m2:] [`vRE:m2:] [vRE`m2:] [vRE:`m2:] [`vREm2:] …
53
1.2.7. Conclusion sur le vocable VRAIMENT
En résumé, VRAIMENT1 est dérivé du primitif sémantique VRAI1, VRAIMENT2 est un
mot-phrase qui confirme la vérité d’une énonciation, VRAIMENT3 est un mot-phrase qui
réalise des actes illocutoires expressifs et directifs, VRAIMENT4 est un adverbe qui
caractérise un syntagme verbal comme ayant fortement certains traits prototypiques,
VRAIMENT5 insiste sur la véracité d’un énoncé et VRAIMENT6 sert à exprimer
l’exaspération.
La figure 3 permet de tracer le chemin de la pragmaticalisation de plusieurs lexies de
VRAIMENT. On voit que VRAIMENT3 est issu de VRAIMENT2 qui est issu de
VRAIMENT1, qui lui-même est le résultat de la dérivation de VRAI1. On voit aussi que
VRAIMENT4, créé par la dérivation de VRAI4a, se pragmaticalise en VRAIMENT5 et
VRAIMENT6.
Figure 3Réseau polysémique de VRAI adjectif et VRAIMENT
54
vrai1
vrai2 vrai3
vrai4b vrai4a
vraiment1
vraiment3
vraiment4
vraiment6 vraiment5
vraiment2
1.3. PAS VRAIMENT
La pragmaticalisation de VRAIMENT4 sous la forme négative a mené à la formation
d’un phrasème utilisé comme mot-phrase.
Un phrasème est une combinaison de mots dont le sens est différent de celui donné par
leur simple addition et dont la forme ne peut être modifiée ou très peu, selon qu’elle est
figée ou semi-figée. La plupart des syntagmes ou des phrases d’un texte sont des suites de
mots non-figées, c’est-à-dire des mots alignés produisant du sens en vertu de principes de
combinatoire et de règles grammaticales sans que leur ordre précis ne fasse l’objet d’une
convention lexicale.
Dans l’énoncé (59), le locuteur utilise la négation de VRAIMENT4 pour euphémiser son
affirmation qui risquerait d’être offensante :
(59) J’ai pas vraiment le goût de venir souper chez ta mère à soir.
La même construction peut être utilisée comme mot-phrase, comme en (60) où B
euphémise sa réponse négative à la question de A :
(60) A : Est-ce que tu as le goût de venir souper chez ma mère à soir?B : Pas vraiment…
Avant d’analyser PAS VRAIMENT, il est nécessaire de clarifier certaines
caractéristiques de l’utilisation de VRAIMENT4 intra-phrastique sous la forme négative
dont il est issu.
55
Deux interprétations de (61) sont possibles : la négation peut porter sur le syntagme
verbal (est vraiment bon) ou elle peut porter uniquement sur VRAIMENT4.
(61) Le pain est pas vraiment bon.
Ces deux interprétations correspondent à deux syntaxes profondes différentes. L’une
accepte le « n’ » avant le verbe et peut être représentée comme en (62) et l’autre accepte
moins bien le « n’ » et peut être représentée comme en (63) :
(62) Le pain n’est pas « vraiment bon »
(63) Le pain est « pas vraiment bon »
De plus, à l’oral l’accentuation aide à distinguer la différence de portée de NE PAS.
Lorsque la négation porte sur le verbe, il y a une rupture prosodique entre PAS et
VRAIMENT et ce dernier est accentué. Lorsque la négation fait bloc avec l’adverbe les
mots PAS et VRAIMENT sont prononcés ensemble, sans rupture prosodique.
L’interprétation de (62), qui implique que NE PAS porte sur le syntagme verbal (est
vraiment bon), peut se paraphraser à l’aide de la définition de VRAIMENT4 :
(64) Le pain n’est pas bon d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font qu’« être bon » est vraiment1 « être bon ».
L’interprétation de (63) où NE PAS porte sur VRAIMENT4 peut se paraphraser ainsi :
(65) Le pain est bon d’une manière qui n’a pas fortement les caractéristiques qui font qu’« être bon » est vraiment1 « être bon ».
56
Cette différence de sens peut sembler minime, mais elle est pertinente d’un point de vue
pragma-sémantique. L’énoncé (62) n’implique pas que le pain est mauvais, tandis que
l’énoncé (63) le fait. Une construction comme (63) est souvent utilisée comme moyen
d’euphémiser une affirmation négative. Un locuteur attribue les qualités prototypiques
d’une catégorie à un nom ou un verbe, mais, du même coup, retranche de ce prototype
toutes ses caractéristiques essentielles. C’est pourquoi un énoncé comme (66) est
pratiquement sémantiquement équivalent à un énoncé comme (67) :
(66) J’ai pas vraiment fait mon devoir.
(J’ai fait mon devoir d’une manière qui n’a pas fortement les caractéristiques qui font que « faire son devoir » est vraiment « faire son devoir ».)
(67) Je n’ai pas fait mon devoir.
La négation de VRAIMENT4 sous-entend la négation du syntagme verbal au lieu de le
faire de manière explicite.
On ne peut pas dire que cette utilisation de PAS et VRAIMENT4 forme un phrasème
parce que le même type de construction est possible avec d’autres adverbes. Les paires
d’énoncés (68) et (69) illustrent le même phénomène avec les mots TRÈS et SUPER :
(68a) Il n’est pas « très beau ».
(68b) Il est « pas très beau ».
(69a) Je me sens pas « super bien ».
(69b) Je me sens « pas super bien ».
57
VRAIMENT4 sous une forme négative a ainsi la propriété d’euphémiser une affirmation.
Cette utilité pragmatique de la forme PAS + VRAIMENT4 est sans doute un facteur qui a
contribué à sa lexicalisation sous les traits d’un marqueur discursif.
1.3.1. Sémantisme de PAS VRAIMENT
Il semble que le phrasème PAS VRAIMENT est issu de la pragmaticalisation de
l’utilisation de PAS + VRAIMENT.
PAS VRAIMENT est un mot-phrase qui ressemble aux mot-phrases de VRAIMENT. Sa
paraphrase est, par conséquent, bâtie sur un modèle semblable. Comme pour
VRAIMENT2, PAS VRAIMENT peut être produit en réponse à une question, ce qui
justifie la composante alternative ([communiquée / mise en question]) :
« Q » ┌pas vraiment┐ ≅(Je signale que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1 d’une manière qui n’a pas fortement les caractéristiques qui font qu’ « être vrai1 » est vraiment1 « être vrai1 ».)
Cette définition est bizarre : elle semble dire quelque chose et en même temps le nier. Or
cela est tout à fait caractéristique d’un euphémisme. En (70), par exemple, le locuteur
marque son hésitation quant à l’appartenance d’Anne Hébert à la collectivité québécoise.
D’un côté, Hébert est née au Québec et, d’un autre, elle a surtout vécu en France.
(70) Est-ce qu’on peut dire que Anne Hébert est une auteure québécoise? Pas vraiment.
58
1.3.2. Relations paradigmatiques de PAS VRAIMENT
Syn∩ : ┌plus ou moins┐, non
Anti∩ : absolument, parfaitement, oui
1.3.3. Syntaxe de PAS VRAIMENT
PAS VRAIMENT est un mot-phrase.
1.3.4. Phonologie de PAS VRAIMENT
La prononciation du mot-phrase PAS VRAIMENT est descendante. Le PAS et le
VRAIMENT sont prononcés en bloc, mais l’accentuation est mise sur la première syllabe
qui peut être allongée.
[`pOvREm2] [`pO:vREm2]
1.3.5. Conclusion au sujet de PAS VRAIMENT
Le mot-phrase PAS VRAIMENT est issu de VRAIMENT4 dont il reprend les sèmes en
leur appliquant la négation. C’est un marqueur pragmatique semblable à VRAIMENT2 et
VRAIMENT5. La figure 4 met en évidence ces différentes relations sémantiques de PAS
VRAIMENT.
59
Figure 4Réseau polysémique de VRAI adjectif, VRAIMENT et PAS VRAIMENT
60
vrai1
vrai2 vrai3
vrai4b vrai4a
vraiment2
vraiment1
vraiment3
vraiment4
vraiment6 vraiment5 ┌pas vraiment┐
1.4. POUR DE VRAI
Les mots VRAI et POUR ont donné naissance à un marqueur qui ressemble beaucoup à
VRAIMENT sur le plan sémantique.
La morphologie du vocable POUR DE VRAI est sujette à des variations. Les formes
POUR DE VRAI, POUR LE VRAI et POUR VRAI semblent être des allomorphes de
la même locution, c’est-à-dire que l’une peut se substituer à l’autre sans modifier le sens
du phrasème.
Le choix par un locuteur d’utiliser l’une ou l’autre de ces formes s’explique sans doute
par des variations topolectales ou sociolectales, comme l’âge des locuteurs. Nous n’avons
pas suffisamment d’informations sur ce sujet pour en tirer des conclusions précises.
Disons seulement que la forme POUR LE VRAI est moins fréquente que les deux autres
dans la banque de données que nous avons consultée (BDTS).
Nous avons choisi d’utiliser la forme POUR DE VRAI pour représenter formellement le
phrasème. C’est la forme la plus caractéristique, d’une part parce qu’elle est très
fréquemment utilisée (dans la BDTS) et, d’autre part, parce que la suite de mots POUR +
DE + VRAI se trouve plus rarement associée librement en discours que les suites POUR
+ LE + VRAI et POUR + VRAI. L’énoncé (71) est un exemple d’une telle suite de mots
(qui est rare) :
(71) Il a pris ces tulipes en plastic pour de vraies tulipes.
61
La forme POUR DE VRAI a donc plus de chance d’être reconnue comme un phrasème
que les formes POUR LE VRAI et POUR VRAI.
La relation entre VRAI et POUR DE VRAI est similaire à celle qui existe ente VRAI et
VRAIMENT. En conséquence, plusieurs lexies de POUR DE VRAI sont synonymes de
lexies de VRAIMENT. Nous allons réduire au minimum les explications à leur sujet.
POUR DE VRAI1 est synonyme de VRAIMENT1; c’est un adverbe intraphrastique
aléthique basé sur VRAI1 :
(72) Est-ce que je devrais lui dire que je ne viens pas d’Italie pour de vrai?
POUR DE VRAI2 est synonyme de VRAIMENT2; c’est un mot-phrase issu de POUR
DE VRAI1 dont le sens ressemble à celui du phrasème « Je t’assure! » :
(73) A : Il garde sa tuque même pour dormir.B : Shit!A : Oui, oui, pour vrai.
POUR DE VRAI3 est synonyme de VRAIMENT3; c’est un mot-phrase issu de POUR
DE VRAI2 à l’interrogatif qui exprime l’étonnement et appelle une réponse :
(74) A : Je pensais. Ça a valu la peine que je perde quinze livres ! B : Pour vrai ? A : C't'affaire!
POUR DE VRAI4 est synonyme de VRAIMENT4; c’est un intensifieur formé sur
VRAI4a :
62
(75) J'avais hâte de débarquer. J'étais malheureux pour le vrai!
POUR DE VRAI5 est synonyme de VRAIMENT5; c’est un marqueur d’interprétation
issu de POUR DE VRAI4 qui sert à marquer une insistance sur la véracité d’une
énonciation :
(76) Ne pars pas en voyage, pour de vrai.
POUR DE VRAI6 ne trouve pas d’équivalent chez VRAIMENT; c’est un adverbe de
manière qui s’emploie en opposition à un univers imaginaire ou feint :
(77) Ok. On arrête de niaiser. Maintenant, on va jouer la chanson pour de vrai.
POUR DE VRAI7 n’a pas d’équivalent chez VRAIMENT non plus; c’est un connecteur
textuel qui introduit une réfutation :
(78) Je lui ai dis que j’avais 20 ans. Pour de vrai, j’en ai 25.
1.4.1. POUR DE VRAI1
1.4.1.1. Sémantisme de POUR DE VRAI1
POUR DE VRAI1 est construit avec VRAI1, comme l’est VRAIMENT1. Les
observations que nous avons faites plus haut sur le sémantisme de VRAIMENT1 sont
également valables ici. On ne peut définir cette lexie par la paraphrase (de manière
vraie1), parce que VRAI1 ne porte pas sur un syntagme verbal, mais sur tout un énoncé.
Dans la plupart des cas, la paraphrase (C’est vrai1 que P) fonctionne sans heurts :
63
(79a) Je n’ai pas connu Elvis pour de vrai.
(79b) Ce n’est pas vrai que j’ai connu Elvis.
Dans d’autres cas, quand POUR DE VRAI1 est placé dans une relative avec QUE,
(C’est vrai1 que P) pose problème :
(80a) Lui, cet homme là, assis à côté de moi, c'était Jésus-Christ. Vous allez me prendre pour une sonnée, mais j'le dis pareil. Y avait des ressemblances, peut-être pas avec le vrai Jésus-Christ qui a existé pour vrai, ça, on l'sait pas à quoi il ressemblait.
(80b) ?? […] Y avait des ressemblances, peut-être pas avec le vrai Jésus-Christ que c’est vrai qu’il a existé, ça, on l'sait pas à quoi il ressemblait.
Nous attribuons tout de même cette paraphrase à POUR DE VRAI1 à défaut d’avoir
mieux :
1. P pour de vrai ≅ (C’est vrai1 que P.)
1.4.1.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI1
A0 : vrai1
Syn : vraiment1
1.4.1.3. Syntaxe de POUR DE VRAI1
POUR DE VRAI1 a une portée à grande amplitude et sa position dans la phrase peut
varier, mais il demeure un adverbe intra-phrastique. Contrairement à VRAIMENT1, il se
place après la proposition sur laquelle il porte.
1.4.1.4. Phonologie de POUR DE VRAI1
64
Comme pour VRAIMENT1, il y a une possible accentuation et un allongement du
morphème VRAI lors de la prononciation de POUR DE VRAI1.
[pURdevRE] [pURde`vRE] [pURde`vRE:]
[pURlevRE] [pURle`vRE] [pURle`vRE:]
[pURvRE] [pUR`vRE] [pUR`vRE:]
1.4.2. POUR DE VRAI2
1.4.2.1. Sémantisme de POUR DE VRAI2
Comme VRAIMENT2, POUR DE VRAI2 est le signalement par l’énonciateur d’un
commentaire concernant la véracité de son discours :
(81) A : J’ai déjà fini.B : Shit!A : Oui oui, pour vrai.
En (81), A confirme ce qu’il a dit à l’aide de POUR DE VRAI. La paraphrase de cette
lexie est la même que celle de VRAIMENT2 :
2. « Q » ┌pour de vrai┐ ≅(Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1.)
1.4.2.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI2
Syn : vraiment2
Syn∩ : ┌c’est vrai┐
1.4.2.3. Syntaxe de POUR DE VRAI2
65
Cette lexie est un mot-phrase, son argument sémantique doit être un énoncé qui
communique une information vraie ou la met en interrogation.
1.4.2.4. Phonologie de POUR DE VRAI2
Ce mot-phrase est prononcé avec une mélodie neutre et avec une légère accentuation sur
sa dernière syllabe.
[pURde`vRE]
[pURle`vRE]
[pUR`vRE]
1.4.3. POUR DE VRAI3
POUR DE VRAI3 est beaucoup plus utilisé que VRAIMENT3 à l’oral et
particulièrement les formes POUR DE VRAI et POUR VRAI. Nous n’avons pas
trouvé d’occurrence de la forme POUR LE VRAI dans ce contexte (dans la BDTS ou
ailleurs).
1.4.3.1. Sémantisme de POUR DE VRAI3
Le sens de POUR DE VRAI3 est similaire à celui de VRAIMENT3.
(82) A : Je pensais. Ça a valu la peine que je perde quinze livres ! B : Pour vrai ? A : C't'affaire!
Comme l’indique sa paraphrase, cette lexie réalise simultanément des actes directif et
expressif :
66
3. « Q. » ┌pour de vrai┐ ≅(Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1.)
1.4.3.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI3
Syn : ┌vraiment┐3
Syn∩ : ┌sans blague┐, ┌pas vrai┐
1.4.3.3. Syntaxe de POUR DE VRAI3
Cette lexie est un mot-phrase, son argument sémantique doit être un énoncé qui
communique une information, ce qui exclut les questions.
1.4.3.4. Phonologie de POUR DE VRAI3
En contexte, nous écrivons POUR DE VRAI3 avec un point d’interrogation pour les
mêmes raisons que nous écrivons VRAIMENT3 de cette façon.
Ce mot-phrase est prononcé avec une intonation montante, typique de la forme
interrogative. La première syllabe peut être allongée et la dernière accentuée.
[pURdevRE] [pURde`vRE] [pUR:de`vRE]
[pURlevRE] [pURle`vRE] [pUR:le`vRE]
[pURvRE] [pUR`vRE] [pUR:`vRE]
1.4.4. POUR DE VRAI4
1.4.4.1. Sémantisme de POUR DE VRAI4
67
POUR DE VRAI4 est issu de l’adverbialisation de VRAI4a et a le même signifié que
VRAIMENT4. C’est un adverbe qui intensifie les traits prototypiques d’un son argument
sémantique. En (83), la personne qui s’est soûlée avait fortement les caractéristiques
essentielles de quelqu’un de soûl :
(83) Il s’est soûlé pour vrai.
La paraphrase de POUR DE VRAI4 est pratiquement la même que celle de
VRAIMENT4. La seule différence est le remplacement de VRAIMENT1 par POUR DE
VRAI1 :
4. P-er ┌pour de vrai┐ ≅(P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est « P-er » pour de vrai1.)
1.4.5.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI4
Syn : vraiment4
Syn∩ : absolument, franchement, crissement, parfaitement, résolument, ┌pas pour rire┐, ┌en crisse┐
Anti∩ :┌pas du tout┐, ┌pas pentoute┐
1.4.5.3. Syntaxe de POUR DE VRAI4
Contrairement à VRAIMENT4, POUR DE VRAI4 se postpose au syntagme verbal
graduable qu’il qualifie.
1.4.5.4. Phonologie de POUR DE VRAI4
POUR DE VRAI4 est prononcé avec une mélodie plane ou un peu descendante et sa
première syllabe a tendance à être accentuée et parfois allongée.
68
[`pURdevRE] [`pUR:devRE] [`pURdevRE] [`pUR:devRE]
[`pURlevRE] [`pUR:levRE] [`pURlevRE] [`pUR:levRE]
[`pURvRE] [`pUR:vRE] [`pURvRE] [`pUR:vRE]
1.4.5. POUR DE VRAI5
1.4.5.1. Sémantisme de POUR DE VRAI5
POUR DE VRAI5 est issu de la pragmaticalisation de POUR DE VRAI4. Il exprime
une insistance sur la véracité d’une énonciation. Selon une des interprétations possibles
de (84), le phrasème POUR DE VRAI5 ne sert pas à confirmer la proposition (c’est un
bon film), mais à insister sur sa véracité :
(84) C’est un bon film, pour vrai.
La paraphrase de POUR DE VRAI5 est semblable à celle de VRAIMENT5, excepté que
VRAIMENT4 y est remplacé par POUR DE VRAI4 :
5. ┌pour de vrai┐ « Q » ≅(J’insiste ┌pour de vrai┐4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1.)
1.4.5.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI5
Syn : vraiment5
Syn∩ : ┌en vérité┐, franchement, sérieusement, ┌sans blague┐
69
1.4.5.3. Syntaxe de POUR DE VRAI5
Cette lexie est détachée de l’énoncé dont elle est le prédicat, mais elle n’est pas
complètement indépendante de celle-ci syntaxiquement.
1.4.5.4. Phonologie de POUR DE VRAI5
La prosodie de POUR DE VRAI5 est similaire à celle de POUR DE VRAI4, avec une
mélodie plane ou un peu descendante et une accentuation de la première syllabe qui tend
à être allongée.
[`pURdevRE] [`pUR:devRE] [`pURdevRE] [`pUR:devRE]
[`pURlevRE] [`pUR:levRE] [`pURlevRE] [`pUR:levRE]
[`pURvRE] [`pUR:vRE] [`pURvRE] [`pUR:vRE]
1.4.6. POUR DE VRAI6
1.4.6.1. Sémantisme de POUR DE VRAI6
POUR DE VRAI6 semble être un adverbe de manière. Le POUR DE VRAI de
l’énoncé (85) peut difficilement être confondu avec POUR DE VRAI1 :
(85) Ça va être la première fois que je vois Tom Cruise pour de vrai.
≠
(86) Ça va être la première fois que ça va être vrai que je vois Tom Cruise.
70
Le POUR DE VRAI de (85) sert plutôt à situer le verbe VOIR par rapport au monde
fictif des médias, de la télévision par exemple. On voit que, contrairement à POUR DE
VRAI4, cette lexie n’est pas obligée de porter sur un syntagme graduable. Le Trésor de
la Langue Française (1994 : 1364) commente ainsi cette lexie sous l’article de VRAI :
« Par référence au monde ludique, imaginaire, par opposition à pour du beurre, pour de
rire. »
L’énoncé (87) permet de mettre en lumière l’ambiguïté de POUR DE VRAI :
(87) J’ai pas dis ça pour de vrai.
Le phrasème POUR DE VRAI peut y prendre trois sens. Dans le cas où le phrasème est
POUR DE VRAI1, l’énoncé signifie : (C’est pas vrai que j’ai dit ça.) Dans le cas où le
phrasème est POUR DE VRAI6, l’énoncé signifie : (Je n’étais pas sérieux quand j’ai dit
ça.) Et dans le cas où le phrasème est POUR DE VRAI7 (introduit plus loin), l’énoncé
signifie : (En réalité, je n’ai pas dit ça).
La paraphrase de POUR DE VRAI6 fait appel à la composante (de manière vraie1) et
rajoute la composante (qui n’est pas fictive ou pour rire).
6. X-er ┌pour de vrai┐ ≅(De manière vraie1, qui n’est pas fictive ou pour rire.)
1.4.6.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI6
Syn : ┌en réalité┐1
Anti∩ : ┌pour rire┐
1.4.6.3. Syntaxe de POUR DE VRAI6
71
Contrairement aux autres lexies de POUR DE VRAI, POUR DE VRAI6 accepte
l’enchâssement : « c’est pour de vrai que P ».
1.4.6.4. Phonologie de POUR DE VRAI6
POUR DE VRAI6 a une intonation plutôt neutre et sa dernière syllabe est parfois
accentuée.
[pURdevRE] [pURde`vRE]
[pURlevRE] [pURle`vRE]
[pURvRE] [pUR`vRE]
1.4.7. POUR DE VRAI7
1.4.7.1. Sémantisme de POUR DE VRAI7
POUR DE VRAI7 est un connecteur textuel qui signale que le texte produit par le
locuteur est la réfutation d’une information communiquée par un texte précédent. Cette
lexie n’a pas d’équivalent dans le vocable VRAIMENT :
(89) Je lui ai dit que j’avais 20 ans. Pour de vrai, j’en ai 25.
≠
(90) ? Je lui ai dit que j’avais 20 ans. Vraiment, j’en ai 25.
Aucune lexie de VRAIMENT ne permet d’introduire un élément explicitement en
contradiction avec ce qui vient d’être dit. Le VRAIMENT de (90) a soit la fonction de
confirmer (VRAIMENT2) ou la fonction d’insister (VRAIMENT5). Or aucune de ces
fonctions n’est cohérente dans ce contexte.
72
POUR DE VRAI7 a plutôt EN RÉALITÉ2 comme synonyme :
(91) Je lui ai dit que j’avais 20 ans. En réalité, j’en ai 25.
Les connecteurs textuels mettent en relation des informations communiquées par des
textes quelconques. Ces textes peuvent être composés de plusieurs énoncés. Les
arguments sémantiques de ces lexies ne sont donc pas du même type que ceux des
marqueurs d’interprétation ou des marqueurs de réalisation d’actes illocutoires. Nous
utilisons les variables T1 et T2 pour symboliser ces textes.
Dans le cas de POUR DE VRAI7, l’information réfutée par T2 est communiquée ou
sous-entendue par T1. En (92), A sous-entend que le film est inintéressant et B réfute ce
fait en affirmant qu’il est bon :
(92) A : Tout le monde trouve ce film plate. B : Ben, pour de vrai, il est bon.
Nous proposons une paraphrase qui reprend les idées de base de l’article « Traitement
lexicographique de deux connecteurs textuels du français contemporain : EN FAIT vs
EN RÉALITÉ » de Iordanskaja et Mel’čuk (1999a). La définition de EN RÉALITÉ2
donnée dans cet article soulève et résout plusieurs questions au sujet de ce type de
connecteur :
2.┌En réalité┐, = L’énonciateur signalant que l’information au
sujet de l’┌état de choses┐ α véhiculée par « ε » - un énoncé précédent ou une croyance qu’on pourrait avoir comme résultat des énoncés précédents - est fausse et que
73
Q.Q?
« Q » est il veut que la réponse à la question « Q? » soit une réfutation de
« ε », véhiculant une information vraie au sujet de α, .
Nous avons essayé de simplifier cette paraphrase. Pour les raisons invoquées lors de la
discussion sur VRAIMENT2, la composante (L’énonciateur signalant) est remplacée par
(Je signale). Ensuite, la composante (au sujet de l’┌état de choses┐ α) nous semble
superflue et est éliminée. Puis la composante (l’information […] véhiculée par « ε » - un
énoncé précédent ou une croyance qu’on pourrait avoir comme résultat des énoncés
précédents -) est remplacée par (l’information communiquée ou sous-entendue par T1). Le
fait que l’argument T2 du connecteur peut être une question est rendu par la composante
facultative ((je veux que la réponse à)). Enfin, ce qui est présupposé par la lexie est
déplacé avant les deux barres obliques.
7. T1 Pour de vrai T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas vraie//je signale que (je veux que la réponse à) T2 communique une information vraie1 qui réfute l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
1.4.7.2. Relations paradigmatiques de POUR DE VRAI7
Syn : ┌en réalité┐2
Syn∩ : ┌en fait┐, ┌pour dire vrai┐, ┌à vrai dire┐, ┌à dire vrai┐
1.4.7.3. Syntaxe de POUR DE VRAI7
Même si la lexie POUR DE VRAI7 est extra-phrastique, elle est liée au texte T2 de
manière prosodique. Elle se place immédiatement avant, immédiatement après ou à
74
Q.Q?
l’intérieur de celui-ci. À cause du présupposé de POUR DE VRAI7, le texte T1 doit déjà
avoir été produit lors de l’énonciation de ce marqueur.
1.4.7.4. Phonologie de POUR DE VRAI7
La prononciation de cette lexie se fait avec une mélodie neutre et avec une légère
accentuation possible sur la dernière syllabe.
[pURdevRE] [pURde`vRE]
[pURlevRE] [pURle`vRE]
[pURvRE] [pUR`vRE]
1.4.8. Conclusion sur le vocable POUR DE VRAI
En résumé, POUR DE VRAI1 est l’adverbe dérivé de VRAI1 primitif sémantique,
POUR DE VRAI2 est un mot-phrase qui confirme un énoncé, POUR DE VRAI3
exprime l’étonnement, POUR DE VRAI4 intensifie les traits prototypiques d’un
syntagme verbal, POUR DE VRAI5 insiste sur la véracité d’un énoncé, POUR DE
VRAI6 situe un état de choses comme n’étant pas fictif ou pour rire et POUR DE
VRAI7 introduit un texte qui réfute un texte précédent.
Nous avons vu qu’il existe une grande similarité entre VRAIMENT et POUR DE VRAI
(les lexies 1, 2, 3, 4 et 5 sont synonymes). Ces vocables ont aussi des particularités :
POUR DE VRAI n’a pas de lexie équivalente à VRAIMENT6 et VRAIMENT n’a pas
de lexies équivalentes à POUR DE VRAI6 et POUR DE VRAI7. Ces observations,
75
ainsi que les liens entre les lexies de POUR DE VRAI et VRAI, sont représentés par la
figure 5 :
Figure 5Réseau polysémique de VRAI, VRAIMENT, PAS VRAIMENT,
et POUR DE VRAI
vrai1
vrai2 vrai3
vrai4b vrai4a
vraiment2 / ┌pour de vrai2┐
vraiment1 / ┌pour de vrai1┐
vraiment3 / ┌pour de vrai3┐
vraiment4 / ┌pour de vrai4┐
vraiment6 vraiment5 / ┌pour de vrai5┐
┌pour de vrai7┐
┌pour de vrai6┐
┌pas vraiment┐
76
1.5. POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Les trois vocables que nous analysons en terminant sont des connecteurs textuels. Aucun
de ces vocables n’est polysémique. De plus, leurs sens sont très comparables. Ils sont
similaires à POUR DE VRAI7, mais, alors que celui-ci réfute une information, les
phrasèmes POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI rectifient ou
précisent une information. Ainsi, en (93), le locuteur produit À VRAI DIRE, afin
d’annoncer que ce qu’il va dire est une rectification de ce qu’il vient de dire :
(93) Denis Drouin partait de Montréal pis il se rendait jusqu'icitte. Ça y prenait cinq jours, cinq nuits. À vrai dire six jours, cinq nuits. C'est ça.
1.5.1. Variation d’utilisation de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Le vocable À VRAI DIRE est d’utilisation plus fréquente que les deux autres, tandis que
le vocable À DIRE VRAI est très rare et semble limité au registre littéraire (BDTS).
1.5.2. Morphologie de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
La locution À VRAI DIRE est figée, tandis que les locutions POUR DIRE VRAI et À
DIRE VRAI sont semi-figées, c’est-à-dire que leur morphologie est variable dans une
certaine mesure. Comme indiqué par le tableau suivant, il est possible de placer VOUS
avant DIRE et LE avant VRAI dans le cas de POUR DIRE VRAI et À DIRE VRAI,
mais pas dans le cas de À VRAI DIRE.
77
Vocable + VOUS + LE + VOUS + LE
Pour dire vrai Pour vous dire vrai Pour dire le vrai Pour vous dire le vrai
À dire vrai À vous dire vrai À dire le vrai À vous dire le vrai
À vrai dire *À vrai vous dire *À le vrai dire *À le vrai vous dire
Tableau 1Variation morphologique de POUR DIRE VRAI, À DIRE VRAI
et À VRAI DIRE
L’énoncé (94) illustre l’une de ces variations :
(94) Vous allez me demander si c'était ben le nom du bonhomme, ça : « Ticane ». Pour vous dire vrai, je le sais pas.
Dans cet énoncé, le texte « Vous allez me demander si c’était ben le nom du bonhomme,
ça « Ticane ». » sous-entend que le locuteur est susceptible de connaître la réponse à cette
question. Cette information sous-entendue est rectifiée par le texte qui suit « je le sais
pas. ».
1.5.3. Sémantisme de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Notre analyse suit celle que font Iordanskaja et Mel’čuk (1999a) au sujet de EN FAIT.
Leur définition de EN FAIT est semblable à celle de EN RÉALITÉ2:
78
┌En fait┐, = L’énonciateur signalant que l’information au
sujet de l’┌état de choses┐ α véhiculée par « ε » - un énoncé précédent ou une croyance qu’on pourrait avoir comme résultat des énoncés précédents – n’est pas (┌tout à fait1┐) bonne et que
« Q » est il veut que la réponse à la question « Q? » soit une rectification
ou une précision de « ε », véhiculant une bonne information au
sujet de α, .
Les mêmes types de modifications sont amenées à cette définition qu’à celle de EN
RÉALITÉ2.
Contrairement à POUR DE VRAI7, la composante ((je veux que la réponse à T2)) n’est
pas possible dans le signifié de POUR DIRE VRAI, À DIRE VRAI et À VRAI
DIRE. Ces vocables sont différents de EN FAIT à ce sujet. Dans l’énoncé (95), B
signale à l’aide de EN FAIT qu’il veut que la réponse à sa question « Viendra-t-elle
seule? » précise ce qui a été dit par A :
(95) A : Anne m’a confirmé qu’elle allait venir au party. La question est de savoir à quelle heure.
B : Viendra-t-elle seule, en fait?
Lorsqu’on remplace EN FAIT par À VRAI DIRE, comme en (96), le résultat est plus
ou moins acceptable. À la limite on peut interpréter l’énoncé de B comme étant une
affirmation et non une question. Il voudrait alors dire : (La vraie question à poser est
« Viendra-t-elle seule? »).
79
Q.Q?
Q.Q?
(96) A : Anne m’a confirmé qu’elle allait venir au party. La question est de savoir à quelle heure.
B : ? Viendra-t-elle seule, à vrai dire?
La composante facultative ((┌tout à fait1┐)) est cohérente avec le rôle de T2 qui est de
rectifier ou de préciser et non de carrément réfuter comme c’était le cas avec POUR DE
VRAI7.
Les paraphrases des trois marqueurs sont identiques :
T1 ┌Pour dire vrai┐ T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
T1 ┌À dire vrai┐ T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
T1 ┌À vrai dire┐ T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
1.5.4. Relations paradigmatiques de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Syn⊂ : ┌en fait┐
Syn∩ : ┌en réalité┐2; ┌au fond┐; ┌plus précisément┐; ┌pour de vrai┐7
1.5.5. Syntaxe de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Ces vocables sont des connecteurs textuels. Bien qu’étant extra-phrastiques, ils sont en
partie liés prosodiquement et syntaxiquement au texte T2. Comme POUR DE VRAI7,
80
ils présupposent qu’une information qui n’est pas (tout à fait) vraie a été produite par un
texte en amont.
1.5.6. Phonologie de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Le morphème [`vRE] de chacun de ces phrasèmes est habituellement accentué. Il n’y a
pas de mélodie particulière qui leur est associée.
[pURdIR`vRE]
[a`vREdIR]
[adIR`vRE]
Les morphèmes [vu] et [le] qui peuvent s’ajouter à POUR DIRE VRAI et à À DIRE
VRAI n’ont pas tendance à être accentuées.
[pURdIR`vRE] [pURvudIR`vRE] [pURdIRle`vRE] [pURvudIRle`vRE]
[adIR`vRE] [avudIR`vRE] [adIRle`vRE] [avudIRle`vRE]
1.5.5. Conclusion au sujet de POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
Les trois connecteurs textuels que nous venons d’étudier sont légèrement différents quant
à leur variation morphologique et leur fréquence, mais ils semblent avoir le même sens.
81
La figure 6 illustre la relation entre les connecteurs POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE
et À DIRE VRAI et les autres lexies du champ lexical qui était l’objet de notre étude.
On voit que ces phrasèmes sont très proches de POUR DE VRAI7.
Figure 6Réseau polysémique de VRAI, VRAIMENT, PAS VRAIMENT, POUR DE VRAI,
POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
vrai1
vrai2 vrai3
vrai4b vrai4a
vraiment2 / ┌pour de vrai2┐
vraiment1 / ┌pour de vrai1┐
vraiment3 / ┌pour de vrai3┐
vraiment4 / ┌pour de vrai4┐
vraiment6 vraiment5 / ┌pour de vrai5┐
┌pour de vrai7┐
┌pour dire vrai┐
┌à vrai dire┐
┌à dire vrai┐
┌pour de vrai6┐
┌pas vraiment┐
82
Chapitre 2 – Traitement lexicographique
2.1. VRAI adjectif
VRAI, /vRE/, adjectif
LE VOCABLE
Tableau synoptique
1. Primitif sémantique. [C’est vrai ce qu’elle dit; un vrai Picasso.]
2. La personne X se comporte selon sa vraie1 natureI.4. [un homme vrai]
3. X est la représentation de vraies1 choses. [Cette vielle carte du monde n’est plus vraie.]
4a. X a fortement les caractéristiques qui font d’un « X » un vrai1 « X ». [Une vraie vodka ne goûte pas l’alcool à friction.]
4b. X a fortement les caractéristiques qui font d'un « Y » un vrai1 « Y ». [C’est un vrai petit monstre ton enfant.]
Réseau polysémique
vrai1
vrai2 vrai3
vrai4b vrai4a
83
LES LEXIES
VRAI1
Définition1. X [est] vrai Cette lexie est un primitif sémantique.
Fonctions lexicalesSyn⊂ : réel, véritable, certain, sûr, juste, évident, assuré, garanti, attesté,
certifié
Anti : faux
Anti⊂ : irréel, incertain, improbable, fautif, douteux, erroné, fictif, feint, impossible
Adv0 : vraiment1
Exemples
(1) C’est vrai quand tu y penses. (2) Est-ce ta robe est en vraie soie? (3) Sa carabine tire des vraies balles!
VRAI2
Définition2. X [est] vrai ≅La personne X se comporte selon sa vraie1 natureI.4.
Fonctions lexicalesSyn∩ : authentique, droit, honnête, sincère, franc
Anti : faux
Anti∩ : menteur, trompeur, perfide, mythomane, hypocrite, sournois, dissimulé, fourbe, insidieux
Exemples(1) Mélanie, est vraie. Elle bullshit pas. (2) Juste à sa façon d’écrire, on voit que Simone de Beauvoir est une femme
vraie.
VRAI3
84
Définition3. X [est] vrai ≅X est la représentation de vraies1 choses.
Fonctions lexicalesSyn∩ : crédible, exact, authentique
Anti : faux
Anti∩ : erroné, inexact
Exemples(1) Cette carte est trop vielle pour être vraie.(2) Le conte La cigale et la fourmi est bien vrai(3) Aujourd'hui, par contre, la plupart des physiciens seraient probablement
d'avis que cette proposition n'est tout simplement pas vraie.
VRAI4a
Définition4a. vrai X ≅X a fortement les caractéristiques qui font d’un « X » un vrai1 « X ».
Fonctions lexicalesSyn∩ : pur, véritable, parfait
Adv0 : vraiment4
Anti∩ : espèce de, genre de, sorte de
Exemples(1) Voilà les vraies questions.(2) La vie adulte commence, la vraie vie!(3) Je sais maintenant c’est quoi avoir un vrai mal de tête.
VRAI4b
Définition4b. X est un vrai « Y » ≅ X a fortement les caractéristiques qui font d'un « Y » un vrai1 « Y ».
Fonctions lexicalesSyn : véritable
Exemples
85
(1) Ma tante, c’est une vraie tarte. (2) Les feuilles ou les aiguilles constituent une vraie usine de fabrication
d'énergie, fournissant la nourriture pour l'arbre.
86
2.2. VRAIMENT
VRAIMENT, /vREm2/, adverbe et marqueur discursif
LE VOCABLE
Tableau synoptique
1. C’est vrai1 que P. [Des hommes ont vraiment posé les pieds sur la lune.]
2. Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1. [J’ai réussi! Vraiment.]
3. Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1. [A : J’ai gagné à la loterie. B : Vraiment?]
4. P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est vraiment1 « P-er ». [Le chardon est vraiment efficace pour guérir le foie.]
5. J’insiste vraiment4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1. [Vraiment, ça pas d’allure être paresseux de même.]
6. Je signale que le comportement ou la série d’évènements α m’exaspère vraiment4. [C’est la quatrième fois que tu l’échappes. Vraiment!]
Réseau polysémique
vrai4a
vrai1
vraiment3
vraiment2
vraiment1
vraiment4
vraiment5vraiment6
87
LES LEXIES
VRAIMENT1, adverbe
Définition1. Vraiment P ≅ C’est vrai1 que P.
Fonctions lexicalesA0 : vrai1
Syn : ┌pour de vrai┐1
Exemples(1) Ce qui est vraiment arrivé ce soir-là est secret.(2) La corporation n’a pas levé le voile sur ce que seront vraiment les
conséquences de leurs actes.
VRAIMENT2, marqueur discursif
I. Plan du signifiéDéfinition
2. Q. vraiment ≅Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur d’interprétation- Fonction : sert à l’énonciateur à confirmer un élément qu’il a énoncé ou à confirmer un élément mis en question par le coénonciateur.
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour de vrai┐2
Syn∩ : ┌c’est vrai┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[vREm2] [vREm2]
SyntaxeMot-phrase.
88
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : oui, oui oui, ben oui…
Exemples(1) A : Est-ce que tu es vraiment médecin?B : Vraiment. Oui.
(2) A : Le briquet te plaît ? B : Beaucoup. Vraiment. Il a beaucoup d'élégance.
VRAIMENT3, marqueur discursif
I. Plan du signifié
Définition3. Q. Vraiment ≅Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur de réalisation d’un acte illocutoire- Fonction : sert à exprimer l’étonnement du locuteur à l’aide d’une question rhétorique- Actes de langage : exprime l’étonnement et questionne
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour de vrai┐3
Syn∩ : ┌sans blague┐, ┌pas vrai┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[vRE`m2:] [vREm2]
SyntaxeMot-phrase.
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : hein?, non?...
Exemples(1) A : Comment vous êtes-vous connus?B : Je ne me rappelle pas. A : Vraiment? Tu ne te rappelles pas ?...
(2) A : Ne l’appelle pas « Guillaume ».B : Vraiment?
89
VRAIMENT4, adverbe
Définition4. P-er vraiment ≅P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est vraiment1 « P-er ».
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour de vrai┐4
Syn∩ : absolument, franchement, crissement, parfaitement, résolument, ┌pas pour rire┐, ┌en crisse┐
Anti∩ : ┌pas du tout┐, ┌pas pentoute┐
Exemples(1) Il y a des gens qui sont vraiment malheureux.(2) Ça m’a vraiment marquée.
VRAIMENT5, marqueur discursif
I. Plan du signifié
Définition5. Vraiment « Q » ≅J’insiste vraiment4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur d’interprétation- Fonction : sert à insister sur la véracité de l’énoncé
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour de vrai┐5
Syn∩ : ┌en vérité┐, franchement, sérieusement, ┌sans blague┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[`vRE:m2] [`vRE:m2]
SyntaxeAdverbe d’énonciation.
Relations syntagmatiques
90
Unités postposées : là
Exemples(1) Je me suis promis d'y aller avec ma femme, juste nos deux pis passer
encore quatre, cinq jours, vraiment là, pas à m'occuper des enfants, ça va être moi, l'enfant.
(2) Vraiment, Jeanne, je n'insisterais pas à ta place.
VRAIMENT6, marqueur discursif
I. Plan du signifié
Définition6. Vraiment α ≅Je signale que le comportement ou la série d’évènements α m’exaspère vraiment4.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur de réalisation d’un acte illocutoire- Fonction : sert à intensifier l’expression de l’exaspération.- Acte de langage : exprime l’exaspération
Fonctions lexicalesSyn∩ : franchement, voyons1
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[`vRE:`m2:] [`vRE:m2:] [vRE`m2:] [vRE:`m2:] [`vREm2:], etc.
SyntaxeMot-phrase.
Relations syntagmatiquesUnités postposées : là
Exemples(1) A : Je trouve que Bouchard a mérité ce qui lui est arrivé. B : Vraiment! C’est niaiseux pas mal ça.
(2) [A se coupe le doigt, se cogne la tête sur le coin de la pharmacie, échappe le pansement dans la toilette. Il s’exclame : ] Vraiment!
91
2.3. PAS VRAIMENT
PAS VRAIMENT, /pOvREmÃ/, marqueur discursif
Réseau polysémique
I. Plan du signifiant
Définition« Q » ┌pas vraiment┐ ≅Je signale que l’information [communiqué / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1 d’une manière qui n’a pas fortement les caractéristiques qui font qu’ « être vrai1 » est vraiment1 « être vrai1 ».
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur d’interprétation- Fonction : sert à euphémiser une affirmation
Fonctions lexicalesSyn∩ : ┌plus ou moins┐
Anti∩ : absolument, parfaitement, oui
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[`pOvREm2] [`pO:vREm2]
SyntaxeMot-phrase.
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : bien, ben, euh…Unités postposées : là
Exemples
┌pas vraiment┐
vraiment4
93
(1) A : Est-ce que tu as le goût de venir souper chez ma mère à soir?B : Pas vraiment…
(2) Je prévois travailler tout l’été. En fait, pas vraiment.
94
2.4. POUR DE VRAI POUR DE VRAI, /pURdevRE/, /pURlevRE/, /pURvRE/, adverbe, marqueur discursif et connecteur textuel
LE VOCABLE
Tableau synoptique
1. C’est vrai1 que P. [T’aimes cette musique pour de vrai?]
2. Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1. [J’ai déjà fait mes devoirs. Pour vrai!]
3. Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1. [-Ils annoncent 30 degrés demain. -Pour vrai?]
4. P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est « P-er » pour de vrai1. [Tu t’en viens chauve pour vrai!]
5. J’insiste ┌pour de vrai┐4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1. [Pour de vrai là, c’est pas une bonne idée d’y aller.]
6. De manière vraie1, qui n’est pas fictive ou pour rire. [Dis-tu ça pour vrai ou pour niaiser?]
7. […] je signale que […] T2 communique une information vraie1 qui réfute l’information communiquée ou sous-entendue par T1. [Je lui ai dit que j’avais 20 ans. Pour de vrai, j’en ai 25.]
95
Réseau polysémique
Morphologie
Allomorphes à l’oral : /pURdevRE/, /pURlevRE/ et /pURvRE/.
Allomorphes à l’écrit : pour de vrai, pour le vrai et pour vrai.
vrai1
vrai4a
┌pour de vrai2┐
┌pour de vrai1┐
┌pour de vrai3┐
┌pour de vrai4┐
┌pour de vrai5┐
┌pour de vrai7┐
┌pour de vrai6┐
96
LES LEXIES
POUR DE VRAI1, adverbeDéfinition
1. P pour de vrai ≅ C’est vrai1 que P.
Fonctions lexicalesA0 : vrai1
Syn : vraiment1
Exemples(1) Je ne viens pas d’Italie pour de vrai.(2) T’aimes pas jouer à la pétanque pour de vrai?
POUR DE VRAI2, marqueur discursif
I. Plan du signifié
Définition2. « Q » ┌pour de vrai┐ ≅Je signale que c’est vrai1 que l’information [communiquée / mise en question] par l’énoncé « Q » est vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur d’interprétation- Fonction : sert à l’énonciateur à confirmer un élément qu’il a énoncé ou à confirmer un élément mis en question par le coénonciateur.
Fonctions lexicalesSyn : vraiment2
Syn∩ : ┌c’est vrai┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques[pURde`vRE][pURle`vRE][pUR`vRE]
SyntaxeMot-phrase.
Relations syntagmatiques
97
Unités postposées : oui, oui oui, ben oui…
Exemples(1) A : J’ai déjà fini.B : Non?A : Oui oui, pour vrai.
(2) À dix ans, je croyais encore au Père Noël. Pour de vrai!
POUR DE VRAI3, marqueur discursif
I. Plan du signifiéDéfinition
3. « Q. » ┌pour de vrai┐ ≅Je te demande si l’énoncé « Q », qui m’étonne, communique une information vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur de réalisation d’un acte illocutoire- Fonction : sert à exprimer l’étonnement du locuteur à l’aide d’une question rhétorique- Actes de langage : exprime l’étonnement et questionne
Fonctions lexicalesSyn : ┌vraiment┐3
Syn∩ : ┌sans blague┐, ┌pas vrai┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[pURdevRE] [pURde`vRE] [pUR:de`vRE]
[pURlevRE] [pURle`vRE] [pUR:le`vRE]
[pURvRE] [pUR`vRE] [pUR:`vRE]
SyntaxeMot-phrase.
Relations syntagmatiquesUnités postposées : hein?, non?...
Exemples
98
(1) A : Ils annoncent 30 degrés demain. B : Pour vrai?
(2) A : Ça fait beau les flamands roses sur la pelouse, hein?B : Pour de vrai?
POUR DE VRAI4, adverbe
I. Plan du signifié
Définition4. P-er ┌pour de vrai┐ ≅P-er d’une manière qui a fortement les caractéristiques qui font que « P-er » est « P-er » pour de vrai1.
Fonctions lexicalesSyn : vraiment4
Syn∩ : absolument, franchement, crissement, parfaitement, résolument, ┌pas pour rire┐, ┌en crisse┐
Anti∩ :┌pas du tout┐, ┌pas pentoute┐
Exemples(1) Tu t’en viens chauve pour vrai!(2) Mon grand-père, il connaissait ça pour de vrai la mécanique.
POUR DE VRAI5, marqueur discursif
I. Plan du signifié
Définition5. ┌pour de vrai┐ « Q » ≅J’insiste ┌pour de vrai┐4 sur le fait que l’énoncé « Q » communique une information vraie1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : marqueur d’interprétation - Fonction : sert à insister sur la véracité d’un énoncé
Fonctions lexicalesSyn : vraiment5
Syn∩ : ┌en vérité┐, franchement, sérieusement, ┌sans blague┐
II. Plan du signifiant
99
Éléments prosodiques[`pURdevRE] [`pUR:devRE][`pURlevRE] [`pUR:levRE] [`pURvRE] [`pUR:vRE]
SyntaxeAdverbe d’énonciation.
Relations syntagmatiquesUnités postposées : là.
Exemples(1) C’est un bon film, pour vrai.(2) Pour de vrai là, c’est pas une bonne idée d’y aller.
POUR DE VRAI6, adverbe
Définition6. P-er ┌pour de vrai┐ ≅De manière vraie1, qui n’est pas fictive ou pour rire.
Fonctions lexicalesSyn∩ : ┌en réalité┐1
Anti∩ : ┌pour rire┐
Exemples(1) Ça va être la première fois que je vois Tom Cruise pour de vrai.(2) A : Est-ce qu’il danse pour de vrai là? B : Ben non, il niaise.
POUR DE VRAI7, connecteur textuel
I. Plan du signifié
Définition
100
7. T1 Pour de vrai T2 ≅L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas vraie//je signale que (je veux que la réponse à) T2 communique une information vraie1 qui réfute l’information communiquée ou sous-entendue par T1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : connecteur textuel. - Fonction : sert à introduire une réfutation.
Fonctions lexicalesSyn : ┌en réalité┐2
Syn∩ : ┌en fait┐, ┌pour dire vrai┐, ┌à vrai dire┐, ┌à dire vrai┐
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques[pURdevRE] [pURde`vRE][pURlevRE] [pURle`vRE] [pURvRE] [pUR`vRE]
SyntaxeLe connecteur est lié syntaxiquement à T2 : peu ou pas de pause le sépare de celui-ci et il se place immédiatement avant ou immédiatement après.
Exemples(1) Je lui ai dit que j’avais 20 ans. Pour de vrai, j’en ai 25.(2) A : Tout le monde trouve ce film plate. B : Ben, pour de vrai, il est bon.
101
2.5. POUR DIRE VRAI
POUR DIRE VRAI, /pURdIRvRE/, connecteur textuel
I. Plan du signifié
DéfinitionT1 ┌Pour dire vrai┐ T2 ≅L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : connecteur textuel- Fonction : sert à introduire une rectification ou une précision.
Fonctions lexicalesSyn : ┌à vrai dire┐, ┌à dire vrai┐
Syn⊂ : ┌en fait┐
Syn∩ : ┌en réalité┐2; ┌au fond┐; ┌plus précisément┐; ┌pour de vrai┐7
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[pURdIR`vRE]
SyntaxeLe connecteur est lié syntaxiquement à T2 : une légère pause le sépare de celui-ci et il se place immédiatement avant ou immédiatement après.
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : ben, euh, ouais, mais…Unités postposées : là.
Exemples(1) J’ai été en plein pôle nord, ou du moins au nord nord de la Finlande pour
dire vrai. (2) Hier, j’ai pêché une truite immense, en fait, pour dire vrai, c’est ma sœur
qui l’a fait mordre, mais c’est moi qui la ramenée sur le bord.
102
2.6. À VRAI DIRE À VRAI DIRE, /avREdIR/, connecteur textuel
I. Plan du signifié
DéfinitionT1 ┌À vrai dire┐ T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : connecteur textuel- Fonction : sert à introduire une rectification ou une précision.
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour dire vrai┐, ┌à dire vrai┐
Syn⊂ : ┌en fait┐
Syn∩ : ┌en réalité┐2; ┌au fond┐; ┌plus précisément┐; ┌pour de vrai┐7
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[a`vREdIR]
SyntaxeLe connecteur est lié syntaxiquement à T2 : une légère pause le sépare de celui-ci et il se place immédiatement avant ou immédiatement après.
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : ben, euh, ouais, mais…Unités postposées : là.
Exemples(1) La soirée était tellement plate. À vrai dire c’est les invités qui l’étaient. (2) A : Combien t’as de cours cet été? B : À vrai dire, aucun. Je fais un tutoral.
103
2.7. À DIRE VRAI À DIRE DIRE, /adIRvRE/, connecteur textuel
I. Plan du signifié
DéfinitionT1 ┌À dire vrai┐ T2 ≅(L’information communiquée ou sous-entendue par T1 n’étant pas (┌tout à fait1┐) vraie1//je signale que T2 communique une information vraie1 qui rectifie ou précise l’information communiquée ou sous-entendue par T1.)
Fonctionnement pragma-sémantique- Type de marqueur : connecteur textuel- Fonction : sert à introduire une rectification ou une précision.
Fonctions lexicalesSyn : ┌pour dire vrai┐, ┌à vrai dire┐
Syn⊂ : ┌en fait┐
Syn∩ : ┌en réalité┐2; ┌au fond┐; ┌plus précisément┐; ┌pour de vrai┐7
II. Plan du signifiant
Éléments prosodiques
[adIR`vRE]
SyntaxeLe connecteur est lié syntaxiquement à T2 : une légère pause le sépare de celui-ci et il se place immédiatement avant ou immédiatement après.
Relations syntagmatiquesUnités antéposées : ben, euh, ouais, mais…Unités postposées : là.
Exemples(1) Je cherchais comme un fou où j’avais mis mes clés, sans savoir, à dire
vrai, pourquoi je les cherchais. (2) On utilise encore le même calendrier que les Romains. À dire vrai, on a
changé un ou deux détails, mais c’est en gros le même.
104
Conclusion
L’approche polysémique s’est révélée être un outil efficace pour notre analyse
sémantique. Grâce au mot d’ordre du Modèle Sens-Texte « distinguer et séparer », nous
avons vu que différents sens du vocable VRAI sont à l’origine de différents sens des
adverbes VRAIMENT et POUR DE VRAI. Nous avons aussi constaté qu’un même
signifiant peut présenter des lexies appartenant à plusieurs catégories très différentes,
allant de l’adverbe au connecteur textuel, en passant par les marqueurs d’interprétation et
les marqueurs de réalisation d’actes illocutoires.
Nous avons également vu comment un primitif sémantique peut donner naissance à
plusieurs lexies au sein d’un vocable qui, elles, peuvent donner naissance à d’autres
vocables qui appartiennent à d’autres catégories grammaticales. Ainsi, il est important
d’étudier un champ lexical de la manière la plus large possible plutôt que chacune des
unités linguistiques qui le constituent de manière isolée. Comme le disait Saussure,
« dans la langue chaque terme a sa valeur par son opposition avec tous les autres termes »
(Saussure 1969 : 126).
Il va sans dire que les analyses présentées dans ce mémoire gagneraient beaucoup en
finesse si elles étaient étendues à d’autres lexies des différents champs sémantiques
abordés. Ainsi, nous pourrions mieux comprendre le sens de VRAI1 en le comparant
avec des mots comme RÉEL et VÉRITABLE, notre définition de VRAI2 bénéficierait
d’une étude des mots HONNÊTE, AUTHENTIQUE, SINCÈRE… et les connecteurs
105
textuels POUR DE VRAI7, POUR DIRE VRAI, À VRAI DIRE et À DIRE VRAI
pourraient être décrits plus justement si d’autres connecteurs textuels étaient examinés.
Une analyse minutieuse de quelques mots permet d’en apprendre beaucoup sur les
caractéristiques générales des catégories auxquelles ceux-ci appartiennent. Ainsi, il nous
plaît de voir la présente étude comme une contribution au processus de description de la
classe des marqueurs pragmatiques.
106
BIBLIOGRAPHIE
DOSTIE, Gaétane, 2004, Pragmaticalisation et marqueurs discursifs, Analyse sémantique et traitement lexicographique, Bruxelles : Duculot / De Boeck.
FIELD, Hartry, 2004, « Deflationist Views of Meaning and Content » dans SCHMITT,
Frederick F., Theories of Truth, Bloomington : Blackwell.
GEZUNDHAJT, Henriette, 2000, Adverbes en –ment et opérations énonciatives, Analyse linguistique et discursive, Bern : Peter Lang.
IORDANSKAJA, Lidija, Igor A. Mel’čuk, 1999a, « Traitement lexicographique de deux connecteurs textuels du français contemporain : ┌EN FAIT┐ vs ┌EN RÉALITÉ┐ » dans MEL’ČUK, Igor A et al., 1999, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques IV, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal, 29-41.
IORDANSKAJA, Lidija, Igor A. Mel’čuk, 1999b, « Textual Connectors Across Languages : French EN EFFET vs. Russian V SAMOM DELE » dans RASK, 9/10, ed. J. Mey, E Pluribus Una, 305-347.
KLEIBER, Georges, 1993, « Prototype et prototypes : encore une affaire de famille » dans Sémantique et cognition, catégories, prototypes, typicalité, Sous la direction de Danièle Dubois, Paris, CNRS ÉDITIONS, 103-129.
LEGALLOIS, Dominique, 2002, « Incidence énonciative des adjectifs vrai et véritable en antéposition nominale » dans Langue Française, no 136, 46-59.
MEL’ČUK, Igor A. et al., 1995, Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire, Louvain-la-Neuve : Duculot.
MEL’ČUK, Igor A, 1997, Vers une linguistique Sens-Texte. Leçon inaugurale, Paris : Collège de France, <http://www.olst.umontreal.ca/FrEng/melcukColldeFr.pdf>.
MEL’ČUK, Igor A. et al., 1984, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques I, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
MEL’ČUK, Igor A. et al., 1988, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques II, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
MEL’ČUK, Igor A. et al., 1992, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques III, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
107
MEL’ČUK, Igor A. et al., 1999, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques IV, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.
POPOVIC, Stefan, 2004, Paraphrasage des liens de fonctions lexicales, Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l’Université de Montréal en vue de l’obtention du grade de M.A. en linguistique, 86 p.
SAUSSURE, Ferdinand de, 1969, Cours de linguistique générale, Paris : Payot.
STOLJAR, Daniel, 1997, « Deflationary Theory of Truth » dans ZALTA, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 1997 Edition), Stanford : Stanford University.
WIERZBICKA, Anna, 1972, Semantic Primitives, Frankfurt : Athenäum.
WIERZBICKA, Anna, 1996, Semantics: Primes and Universals. Oxford: Oxford University Press.
WIERZBICKA, Anna, 2002, «Right and wrong: from philosophy to everyday discourse » dans Discourse Studies, London, Sage publications.
<http://dis.sagepub.com/cgi/reprint/4/2/225>
Dictionnaires
Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2003, Josette Rey-Debove et Alain Rey (directeurs), Paris : Dictionnaires Le Robert.
Le Trésor de la Langue Française, Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960), 1994, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris : Gallimard.
Banques de données
BDTS (Banque de données textuelles de Sherbrooke), Université de Sherbrooke. Base qui comprend des textes variés (textes littéraires, entrevues, émissions de télévision, etc.). Texte en partie postérieurs à 1970. (Adresse du site : <www.usherbrooke.ca/Catifq/bdts>)
FRANTEXT (Base textuelle Frantext), CNRS – ATILF. Un important corpus de textes français, du XVIème au XXème siècle, saisis sur support informatique. Le corpus est constitué d'environ 3500 oeuvres (soit plus d'un milliard de caractères). Il contient à peu près 80% d'oeuvres littéraires et 20% d'ouvrages techniques
108