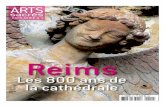LE DURCISSEMENT DE L'EUROPE : IMMIGRER ENTRE LA FRONTIÈRE GRECQUE ET LE CENTRE BELGE
2014_ Les grandes étapes de l'Europe du médicament
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2014_ Les grandes étapes de l'Europe du médicament
61
Revue d’histoiRe de la phaRmacie, lXii, N° 381, 1er tRim. 2014, 61-74.
les grandes étapes de l’europe du médicament
par Fernand Sauer*
l’europe du médicament s’est faite sur deux générations. le présent témoignage porte sur des étapes importantes de ce processus d’euro-péanisation du médicament, auquel j’ai participé à la tête de l’unité
pharmaceutique de la commission européenne, puis comme directeur exécutif de l’agence européenne des médicaments, et enfin comme directeur de la santé à la commission jusqu’en 2005. certaines publications décrivant plus en détail des moments cruciaux à divers moments de cette longue histoire figurent dans les références bibliographiques1.
l’harmonisation des législations pharmaceutiques amorcée en 1965 s’est intensifiée dans les années 1980 entre pays européens, puis au plan international à partir des années 1990. au cours de cette première période, la communauté économique européenne (cee) était passée de six à quinze États membres. une deuxième période importante commençait avec le démarrage de l’agence européenne des médicaments en 1995 à londres. une phase de consolidation s’ouvrit après la codification de la législation pharmaceutique européenne en 2001 et un élargissement majeur de l’union européenne (ue) à 25 pays en 2004 (28 pays en 2013, après adhésion de la croatie).
en tant que directeur de la santé à la commission européenne, j’ai été respon sable de l’harmonisation des dispositions concernant les substances thérapeutiques d’origine humaine. J’ai suivi de près le renforcement de la pharmaco vigilance à l’agence européenne des médicaments et milité pour que la spécificité des produits de santé soit reconnue. l’article 168 du traité de lisbonne, consacré à la santé publique, inclut depuis 2009 tous les pro-duits de santé.
* ancien directeur exécutif de l’agence européenne des médicaments. 12 avenue de la marne, 13260 cassis.
Étude
62 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
La période d’harmonisation des législations
en 1964 était signée la convention de pharmacopée sous l’égide du conseil de l’europe. À Bruxelles, le conseil de la cee fixait en 1965 les principes de l’autorisation de mise sur le marché des médicaments (amm), suite à la catas-trophe de la thalidomide. parmi les pionniers de la première époque se détache la figure de léon Robert, directeur de la pharmacie du luxembourg, premier président à la fois du comité des spécialités pharmaceutiques (cpmp) à Bruxelles jusqu’en 1982 et de la commission de pharmacopée européenne à strasbourg. ayant créé une cellule pharmaceutique internationale au ministère de la santé en 1976, j’ai eu le privilège de participer aux réunions de la cee à Bruxelles et du conseil de l’europe à strasbourg.
J’ai rejoint la commission européenne en octobre 1979 pour démarrer le secré-tariat du comité des spécialités pharmaceutiques et prendre en charge le dossier pharmaceutique au sein de l’unité2 que j’allais diriger de 1985 à 1994. partant de traditions pharmaceutiques très diverses entre France, allemagne, Royaume-uni et les autres pays, l’europe a réussi à unifier en quelque années la législation appli-cable aux médicaments. il ne sera pas question ici des dispositions concernant la reconnaissance des diplômes et l’accès à la profession pharmaceutique adoptées en 1985 et confirmées vingt ans plus tard par la directive 2005/36/ce.
tableau 1 : Harmonisation européenne des législations applicables aux médicaments
1964 signature de la convention de pharmacopée du conseil de l’europe1965 principes de l’autorisation mise sur le marché dans la communauté économique européenne1975 exigences de tests de qualité, sécurité et efficacité, création du comité des spécialités(cpmp)1981 législation des médicaments vétérinaires et comité vétérinaire(cvmp)1985 livre blanc sur l’achèvement du marché unique (dont 13 mesures pharmaceutiques)1986 mesures d’incitation pour les produits de biotechnologie et de haute technologie1988 directive sur la transparence des prix et du remboursement des médicaments1989 extension de la législation aux dérivés du sang, vaccins et radio-pharmaceutiques1990 Règlement sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments1991 début des conférences internationales d’harmonisation « ich » (ue/us/Japon) mise à jour des normes techniques pour les essais et les bonnes pratiques (Gmp, Glp, Gcp)1992 certificat d’extension de 5 ans des brevets pharmaceutiques directives publicité, distribution en gros, classification, notice, homéopathie mise à jour des normes techniques des médicaments vétérinaires1993 Règlement et directives sur procédures d’autorisation centralisées et décentralisées1994 adhésion de l’union européenne à la pharmacopée européenne (conseil de l’europe) espace economique européen avec Norvège, islande et lichtenstein1999 début des conférences internationales d’harmonisation vétérinaire (v-ich)2001 codes européens des médicaments (usage humain, usage vétérinaire) directive sur les essais cliniques
euRope du mÉdicameNt 63
1.1. L’unité pharmaceutique à la Commission européenne
avec l’aide de mon adjoint, patrick deboyser, qui me succédera en 1994 à la tête de l’unité pharmaceutique, d’importants résultats seront atteints, dans une ambiance dynamique et innovante. J’ai pu établir des rapports transparents avec les représentants européens de l’industrie de recherche (eFpia) et notamment Nelly Baudrihaye, de l’automédication (aesGp), de l’industrie vétérinaire (Fedesa), et plus tard de la biotechnologie (euRopaBio) des génériques (eGa) et des grossistes (GiRp), mais aussi avec les médecins et pharmaciens (cmpe et Gpue). en l’absence, à l’époque, de représentants des patients au niveau européen, je me suis adressé au comité consultatif des consommateurs, et au Bureau européen des consommateurs.
le comité des spécialités pharmaceutiques (cpmp), composé de représen-tants scientifiques des États membres, met en place trois groupes d’experts pour approfondir les normes à introduire dans la mise au point de nouveaux médicaments. le professeur alexandre joue un rôle clé dans la mobilisation précoce de l’expertise européenne dans toutes les disciplines et notamment des experts français.
un régime de coordination volontaire des demandes autorisations avait débuté en 1978. la directive 83/570/cee introduisit une procédure plus souple de coordination « multi-États » prévoyant que les États tiendraient dûment compte de l’amm déjà délivrée dans un autre État. les méthodes de pharmacovigilance et la collecte des informations restent embryonnaires et le cpmp tente de les développer en les harmonisant. une nouvelle procédure de concertation pour les médicaments de haute technologie voit le jour en 1987.
outre mon travail législatif, je me suis efforcé d’organiser et de développer le concept de notes explicatives, ou guidelines, appelées à constituer des normes scientifiques validées par les autorités, en consultation avec les milieux concer-nés, pour l’interprétation des exigences des directives européennes. d’autres méthodes peuvent être proposées, à condition d’être correctement validées par les chercheurs et ensuite reconnues par les autorités. les projets de guidelines sont diffusés pour avis aux représentants des industries et des professions de santé, ainsi qu’aux représentants des consommateurs (et plus tard des patients). après révision des groupes de travail concernés et adoption par le cpmp, ces guidelines sont publiés par la commission.
en parallèle, j’ai créé le groupe des inspecteurs pharmaceutiques pour commen cer l’élaboration de bonnes pratiques de fabrication générales et spéci-fiques à certains types de produits. ce travail aboutira à la publication d’un guide européen très complet en 19893.
les textes législatifs (usage humain et vétérinaire), ainsi les guidelines et avis aux demandeurs sont rassemblés dans « la réglementation des médicaments à
64 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
usage humain dans la communauté européenne » diffusée sur l’internet (http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex).
1.2. Les avancées pharmaceutiques du Livre blanc de 1985
en juin 1985, la publication par la commission delors de son Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur me donne l’occasion d’introduire treize sujets pharmaceutiques sur les 300 thèmes retenus pour l’ensemble des secteurs d’acti-vité.
Fin 1986, le conseil adoptait sur proposition de la commission un premier « paquet » de six directives4 (87/17, 87/18, 87/19, 87/20, 87/21 et 87/22/cee). il déléguait à la commission le soin d’adapter au progrès technique les annexes scientifiques de la directive « normes et protocoles d’essais », après consultation d’un comité de règlementation composé de représentants des ministres de la santé. il instituait les bonnes pratiques de laboratoire, ainsi qu’une procédure de concertation pour la mise sur le marché des médica-ments de biotechnologie et de haute technologie et un enregistrement simpli-fié des génériques bio-équivalents à des médicaments présents sur le marché depuis au moins dix ans.
il était important de définir des éléments de politique industrielle5, en tenant compte de la jurisprudence de la cour de justice européenne sur les importations parallèles. en décembre 1988, le conseil adoptait sur proposition de la commission la directive 89/105/cee concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix et le remboursement des médicaments, avec créa-tion d’un comité de représentants nationaux.
en 1989, une deuxième vague de directives du conseil étend la législation communautaire à des domaines présentant des difficultés de nature technique pour les médicaments immunologiques (directive 89/342/cee : vaccins, toxines, sérums ou allergènes) et les radio-pharmaceutiques (directive 89/343/cee). pour les médicaments dérivés du plasma humain, il convenait également d’intro-duire les principes de sécurité et de consentement du don non rémunéré pour tendre vers l’autosuffisance européenne, en accord avec les principes éthiques du conseil de l’europe (directive 89/38/cee). la directive 89/341/cee renforçait les exigences de bonnes pratiques et de contrôle des médicaments fabriqués, importés ou exportés du territoire européen.
en 1992, le conseil adoptait une troisième vague de directives6 pour un usage rationnel des médicaments et pour sécuriser l’ensemble du circuit pharmaceutique :
• directive 92/25/cee: distribution en gros des médicaments à usage humain ;
• directive 92/26/cee: classification de délivrance sur prescription ou auto-médication ;
euRope du mÉdicameNt 65
• directive 92/27/cee: étiquetage et notice des médicaments à usage humain ;
• directive 92/28/cee : publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain ;
• directive 92/73/cee : enregistrement des médicaments homéopathiques.en 1992, après des négociations difficiles, le conseil adoptait le Règlement
(cee) n° 1768/92 instaurant un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, qui permet d’étendre de 5 ans la protection par brevet pour tenir compte des longs délais de recherche avant mise sur le marché.
À partir de 1995, la plupart des mesures nouvelles concernent l’agence européenne des médicaments. en 2001, la codification formelle de toutes les dispositions concernant les médicaments humains et vétérinaires est finali-sée.
1.3. Harmonisation pharmaceutique internationale
le processus d’harmonisation communautaire a eu un impact important sur d’autres pays candidats ou non à l’élargissement. la Norvège, l’islande et le lichtenstein l’ont accepté dans le cadre de l’accord sur l’espace économique européen, signé en 1994.
l’industrie pharmaceutique européenne reste le principal exportateur de médicaments dans le monde et porte donc une lourde responsabilité pour assu-rer la qualité de ses produits et lutter contre les contrefaçons. il en va de même pour les autorités européennes compétentes. Nous avons entamé la préparation d’accords de reconnaissance des inspections (mRas) avec les pays de l’ocde. des mécanismes spécifiques ont été introduits pour protéger les pays en déve-loppement :
• bonnes pratiques de fabrication applicables à toutes les exportations depuis l’europe ;
• la certification de qualité de l’oms s’impose aux autorités européennes ;• les essais cliniques provenant des pays tiers doivent obéir aux bonnes pra-
tiques cliniques et aux principes éthiques de la déclaration d’helsinki.les pharmacopées jouent un rôle important pour la standardisation de la qua-
lité des matières premières fabriquées dans le monde, notamment après expira-tion des droits de brevets. la convention de pharmacopée rassemble un grand nombre de pays européens et connaît un rayonnement mondial. J’ai entamé de longues et difficiles négociations diplomatiques pour assurer la révision de cette convention du conseil de l’europe, recueillir l’accord des pays non communau-taires et enfin obtenir la décision d’adhésion de nos propres États membres. J’avais signé en 1991 un contrat pluriannuel pour soutenir le programme de stan-dardisation biologique et soutenu les efforts de la nouvelle direction de la qualité
66 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
des médicaments du conseil de l’europe (edQm), dirigée par agnès artiges, pour lancer un programme d’essais collaboratifs entre les laboratoires nationaux de contrôle des médicaments (omcl) et pour assurer la déclaration de confor-mité aux monographies de la pharmacopée européenne7. le conseil des ministres me chargea de signer les instruments de ratification en 1994, au nom de la communauté européenne.
dans les années 1980, j’avais conduit plusieurs missions aux usa et au Japon pour explorer les obstacles sanitaires aux échanges, accompagnés des présidents des groupes scientifiques du cpmp. en 1989, en marge d’une conférence de l’oms à paris, j’avais obtenu l’accord de principe des collègues américains et japonais8. c’est à Bruxelles au siège de l’eFpia en avril 1990 que j’ai eu l’occa-sion de présider la réunion constitutive des conférences internationales d’harmonisation (ich) pour un programme ambitieux d’harmonisation des exigen ces d’essais des médicaments9.
ich consiste essentiellement en un processus informel d’échanges scienti-fiques et de consultations visant à mettre en évidence les meilleures réponses scientifiques et réglementaires posées par le développement de nouveaux médi-caments. dans les années 1990, de grandes conférences « ich » réunissant plu-sieurs milliers de scientifiques ont été organisées. J’ai eu l’occasion de présenter ma vision en séance plénière de ich1 à Bruxelles en 1991, ich2 à orlando en 1993, ich3 à Yokohama en 1995, puis enfin ich5 à san diego en 200010.
dans ce processus, la commission, puis dès sa création, l’agence européenne des médicaments, ont fait appel aux membres de comités scientifiques européens et de leurs groupes de travail. les projets de guidelines sont soumis aux mêmes procédures de consultation publique avec tous les milieux intéressés que les autres textes européens. les régulateurs des trois régions demeurent souverains pour incorporer les résultats dans leur législation interne. une soixantaine de normes internationales (ich guidelines) ont été finalisées au cours des années 1990, cou-vrant les 3/4 du dossier de recherche, permettant ainsi de réduire la répétition de tests chez l’homme ou l’animal et de freiner la croissance des frais de recherche.
depuis 2000, l’accent a été mis sur la mise à jour de ces normes trilatérales et leur dissémination dans le reste du monde, par l’internet et à l’occasion de confé-rences régionales grâce à une structure dédiée (ICH Global Cooperation Group). les débats de la conférence internationale d’harmonisation (ich) sont ouverts aux chercheurs et aux régulateurs du monde entier (http://www.ich.org).
1.4. Les médicaments vétérinaires et leurs résidus dans l’alimentation
les premières directives relatives aux médicaments vétérinaires sont adoptées en 1981. J’organise la mise en place du comité des médicaments vétérinaires (cvmp) et de ses premiers groupes de travail.
euRope du mÉdicameNt 67
la directive 90/677/cee prévoit des dispositions pour les médicaments vété-rinaires immunologiques. les procédures de coordination des autorisations nationales de mise sur le marché, similaires à celles applicables aux médicaments humains, restent peu utilisées. par contre, la fixation des limites maximales de résidus dans les aliments (viandes, lait, œufs, poissons) constitue une tâche lourde et complexe. le Règlement (cee) n° 2377/90, concerne les limites de résidus de substances nouvelles mais aussi la révision de nombreuses substances déjà sur le marché.
des contacts préliminaires avaient eu lieu dans le cadre du Codex Alimentarius et de l’organisation internationale des épizooties (oie, paris). Nous avons pro-posé en 1996 de créer v-ich sur le modèle de ich. une première grande réunion publique s’est tenue à Bruxelles en 1999. À l’issue de quatre grandes conférences internationales publiques, v-ich a produit jusqu’à présent une cinquantaine de guidelines harmonisés (voir http://www.vichsec.org).
Création et consolidation de l’Agence européenne des médicaments
l’harmonisation complète, de 1975 à 1993, des législations sanitaires concer-nant les médicaments humains et vétérinaires constituait un préalable nécessaire, mais encore fallait-il parvenir à la convergence des décisions nationales d’auto-risation de mise sur le marché. or les rapports successifs sur le fonctionnement de ces procédures montraient les faiblesses de la reconnaissance mutuelle comme solution générale. J’avais sondé les États membres et toutes les parties intéres-sées sur un modèle combinant une procédure communautaire centralisé réservé aux innovations et une procédure de reconnaissance avec clause d’arbitrage pour la reconnaissance mutuelle des médicaments conventionnels. ce modèle ne sup-primait pas les agences nationales, mais les obligeait à coopérer de façon beau-coup plus intense et quotidienne.
afin de coordonner les ressources scientifiques mises à sa disposition par les autorités compétentes des États membres, nous proposions d’élargir les réseaux existants (cpmp et cvmp) à un réseau plus large, piloté par une agence. les propositions de la commission ont été transmises au conseil et au parlement en novembre 1990 et ont donné lieu pendant trois ans à des débats passionnés. la procédure décentralisée et les dispositions visant à ajuster les activités natio-nales au nouveau système ont été introduites en juin 1993 pour les médicaments à usage humain (directive 93/39/cee) et les médicaments vétérinaires (directive 93/40/cee). c’est en juillet 1993 que le conseil établit, par le Règlement (cee) n° 2309/93, les procédures pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et une agence européenne pour l’évalua-tion des médicaments. ces procédures seront élargies en 2004 par le Règlement (ce) n° 726/2004 du parlement et du conseil.
68 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
tableau 2 : Évaluation de l’Agence européenne des médicaments1990 propositions de la commission sur le « système futur d’autorisations »1993 Règlement sur l’agence européenne des médicaments et siège de l’agence à londres1995 ouverture de i’emea, et premières autorisations européennes1998 Renforcement de la reconnaissance des autorisations nationales1999 Reconnaissance des amm par Norvège, islande et pays d’europe centrale2000 Règlement et mesures incitatives pour les médicaments orphelins à l’emea2004 Réforme du système européen d’autorisation, renforcement de i’emea2006 mesures incitatives pour les petites et moyennes entreprises Règlement sur les médicaments pédiatriques2007 Règlement sur les thérapies avancées2010 Renforcement de la pharmacovigilance européenne2011 authentification et contrôle renforcé des matières premières
NB : Le sigle « EMEA» devient « EMA» en 2010
2.1. Les débuts de l’Agence européenne des médicaments
après présélection des candidats, le conseil d’administration m’avait élu en avril 1994 comme directeur exécutif pour prendre fonction en septembre 1994. Je lançais aussitôt les publications et les procédures pour le recrutement des cadres et de plusieurs collaborateurs. après le démarrage de l’agence, philippe Brunet est devenu l’adjoint, puis le successeur de patrick deboyser à la tête de l’unité pharmaceutique de la commission. le pays hôte désigné n’avait pas sou-haité offrir des locaux ou une aide financière pour l’installation, le conseil d’ad-ministration a porté son choix en juillet 1994 sur le nouveau site de canary Wharf, à l’est de la city de londres. J’ai supervisé dans un délai de six mois les aménagements de plusieurs étages d’un immeuble sis 7 Westferry circus, com-prenant notamment trois salles de conférences et des bureaux de passage pour les délégués natioanaux11. l’inauguration a lieu le 26 janvier 1995.
dès le départ, l’agence, dont le sigle initial emea a été simplifié en 2010 en ema, a publié sur l’internet (www.ema.europa.eu), un grand nombre de docu-ments scientifiques et de gouvernance, en particulier des rapports annuels d’ac-tivités très détaillés. l’agence européenne devait satisfaire aux mêmes enjeux d’indépendance, de compétence et de transparence que ses homologues au plan national. elle devait inventer, de surcroît, des mécanismes innovants de pilotage et de gestion de réseaux administratifs et scientifiques étendus et complexes, en réunissant des cultures très diverses12.
l’agence a réussi à réduire considérablement les délais d’examen des demandes d’autorisation, de six ans à moins d’un an en moyenne, avec une qua-lité d’évaluation supérieure aux évaluations purement nationales son travail est largement reconnu au plan international. la recherche européenne en a tiré un avantage significatif en termes de restauration de la protection par brevets et de
euRope du mÉdicameNt 69
possibilité de consultations précoces avec l’agence durant la phase de recherche et de développement.
de nombreux médicaments innovants ont bénéficié d’une autorisation euro-péenne de mise sur le marché, par la commission, après évaluation par l’agence européenne des médicaments. les dispositifs d’alerte et de surveillance des effets indésirables (pharmacovigilance) ont été renforcés et harmonisés progres-sivement.
2.2. Structures de l’Agence européenne des médicaments
l’agence est gouvernée par un conseil d’administration où siègent les repré-sentants de États membres, et ceux de la commission et le parlement européen. de plus, prennent part aux réunions, en tant qu’observateurs, la Norvège, l’islande et le lichtenstein, ainsi que les représentants des professionnels de santé et des patients. en tant que directeur exécutif, j’ai bénéficié du soutien du conseil d’administration qui m’a réélu à l’unanimité en 1999 pour un nouveau mandat de cinq ans. appelé par le commissaire Byrne pour devenir le directeur de la santé au sein de la nouvelle direction générale de la santé, je quittais mes fonctions fin 200013. thomas lönngren m’a remplacé pour deux mandats com-plets et son successeur, Guido Rasi, a pris ses fonctions en novembre 2011.
le personnel administratif et technique de l’ema compte actuellement plus de 600 employés. il assure, sous l’autorité du directeur exécutif, la coordination des évaluations, des alertes de pharmacovigilance, des inspections nationales et extra-européennes, ainsi que la gestion informatisée des procédures documen-taires et de communication avec les États membres. le secrétariat de l’ema a comme tâche principale d’assurer le suivi des dossiers et des procédures d’arbi-trage dans le respect des délais prescrits. il fournit un soutien administratif et logistique aux comités scientifiques et à leurs nombreux groupes d’experts, et assure une coordination appropriée des évaluations, rédige les rapports d’évalua-tion publics (epaRs) et coordonne la finalisation des projets de décision d’auto-risation. il gère directement les procédures de variations administratives des dossiers de médicaments autorisés, ainsi que les modifications plus substantielles en consultation avec les comités scientifiques. l’agence organise plus de 500 jours de réunions par an. l’agence a progressivement mis en place des outils informatiques puissants : « eudratrack » et « eudrapharm » pour les autorisa-tions centralisées, « eudraWatch » puis « eudravigilance » pour les effets indé-sirables, « eudraGmp » pour les inspections et la certification, « eudract » pour le registre des essais cliniques.
les diverses redevances d’examen, d’inspection et de maintenance payables à l’agence sont fixées par le conseil des ministres. le parlement européen déter-mine le montant de la subvention d’équilibre, sur proposition de la commission.
70 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
en 2012, le budget d’environ 230 millions € était alimenté aux trois-quarts par les redevances des firmes et le restant par le subside du budget européen. les activités d’expertise externe représentent plus de la moitié des dépenses. en particulier, plus du tiers de ce budget est reversé aux agences nationales au titre de l’expertise qu’ils fournissent à l’ema sur base de contrats publics.
l’utilisation d’internet a, dès le départ, représenté un moyen important pour permettre aux professionnels de santé et au grand public d’accéder aux docu-ments de l’ema, notamment par la publication fréquente des rapports européens publics d’évaluation (epaR). J’avais organisé en octobre 1997, puis à nouveau en octobre 2000, une conférence publique pour améliorer la transparence de cette nouvelle agence. cette ouverture au public et aux professionnels a encore été améliorée récemment.
2.3. Activités scientifiques de l’Agence
l’activité des comités scientifiques de l’ema repose en grande partie sur l’exper tise fournie en réseau par les 42 agences nationales compétentes. les quelque 4 500 experts appelés à collaborer actuellement avec l’agence figu-rent sur une liste publiée sur internet. les États membres se portent garants de la compétence de l’intégrité des experts proposés. leurs déclarations d’intérêts et leurs qualifications sont accessibles au public.
deux comités scientifiques sont responsables de la préparation de l’avis de l’agence : le comité des médicaments à usage humain (cpmp, renommé chmp) et le comité des médicaments vétérinaires (cvmp). chaque comité est composé de membres nommés par chaque État membre, en fonction de leur rôle et de leurs connaissances en matière d’évaluation des médicaments, assistés de six experts indépendants. tous les membres des comités scientifiques agissent indépendamment des autorités qui les ont nommés. leur indépendance est éga-lement garantie par une déclaration d’intérêt et un curriculum vitae à la disposi-tion du public.
en 1999, j’ai mis en place le comité chargé de la désignation des médicaments orphelins (comp) créé par le Règlement (cee) 141/2000. ce comité d’experts des États membres, où siègent également pour la première fois deux représen-tants des patients, ouvre la possibilité de conseils et de mesures d’incitation pour la mise au point de solutions pour le diagnostic et le traitement des maladies rares. la recherche pharmaceutique de pointe et les autorités publiques ont été mobilisées au service des malades atteints d’affections rares. l’ema a permis la désignation de près de 1 100 médicaments orphelins, afin qu’ils puissent bénéfi-cier de mesures incitatives pour la recherche et leur accès au marché. en aval de cette assistance au développement, 80 médicaments orphelins sont déjà autorisés pour le traitement de maladies rares en europe.
euRope du mÉdicameNt 71
le système européen pour l’autorisation des médicaments a exigé une mise au point rapide de beaucoup d’aspects pratiques concernant les nouvelles procé-dures centralisées et décentralisées14. au départ, la procédure centralisée, dans laquelle les demandes sont directement déposées auprès de l’ema, est obliga-toire pour les produits dérivés de la biotechnologie et optionnelle pour d’autres médicaments innovants. À partir de 2005, la procédure centralisée devient éga-lement obligatoire pour le traitement du vih/sida, du cancer, du diabète et des maladies neuro-dégénératives, et tous les médicaments désignés comme « orphe-lins ». de même, tous les médicaments vétérinaires comme améliorateurs de croissance ou de productivité des animaux traités, doivent passer par la procé-dure centralisée. cette procédure est également disponible si le demandeur peut montrer le médicament constitue une innovation thérapeutique, scientifique ou technique significative, ou qu’il est dans l’intérêt de la santé humaine ou animale.
les demandes sont soumises électroniquement sous format international (e-ctd) à l’ema, qui pilote l’ensemble de la procédure. À la clôture de l’éva-luation scientifique, menée en 210 jours au sein de l’agence, l’avis du comité scientifique est transmis à la commission européenne afin d’être transformé en une autorisation de mise sur le marché communautaire valable dans l’ensemble de l’union européenne.
la procédure de reconnaissance mutuelle d’une autorisation nationale, et à partir de 2005, la procédure décentralisée (coordination de demandes nationales déposées en parallèle), sont applicables aux autres médicaments. les demandes sont déposées auprès des États membres choisis par le demandeur. le secrétariat de l’ema fournit un important soutien logistique pour la coordination de ces activités. lorsque l’évaluation d’origine ne peut pas être reconnue, les points litigieux sont soumis à l’arbitrage de l’ema. l’avis du comité scientifique est transmis à la commission européenne.
les avis de pharmacovigilance, préparés par le comité concerné, conduisent à des restrictions d’emploi, voire au retrait des médicaments examinés. le réseau informatique de collecte et de gestion des données nationales de pharmacovigilance (eudravigilance) rassemble les rapports urgents ou pério-diques que les firmes ou les autorités doivent échanger en application de la législation communautaire. il possède depuis récemment une possibilité d’ac-cès du public, avec incorporation directe des notifications des patients en appli-cation de la directive 2010/84/ce du parlement du conseil concernant la pharmacovigilance.
au cours des cinq dernières années ont été établis plusieurs nouveaux comités scientifiques : médicaments pédiatriques, thérapies avancées, plantes médici-nales, et pharmacovigilance.
pour toutes ces procédures, la commission européenne arrête sa décision avec l’assistance d’un comité permanent composé de représentants des ministères de
72 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
la santé des États membres. la commission tient un registre public15 de toutes les autorisations communautaires, qui contient plus de 800 nouveaux médica-ments, et 150 nouveaux médicaments vétérinaires.
en outre, les comités scientifiques fournissent des avis scientifiques aux firmes innovatrices, soit lors du développement de nouveaux médicaments16, soit sous la forme de lignes directrices sur les essais relatifs à la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments. l’activité de conseil scientifique et d’assistance aux protocoles est assurée par une structure mixte de représentants des comités scientifiques et du secrétariat. plus de 3 000 avis ont été donnés aux chercheurs, dont 2/3 concernant les essais cliniques.
de nouvelles perspectives pour la politique européenne du médica-ment
l’expérience a montré l’extrême prudence avec laquelle les nouveaux médi-caments devaient être constamment surveillés, depuis leur conception, puis leur fabrication, jusqu’à leur distribution et enfin leur bon usage. la réglementation européenne doit être régulièrement mise à jour pour tenir compte de l’évolution rapide des connaissances scientifiques. alors que les résumés des conditions de mise sur le marché et les notices sont depuis longtemps accessibles, mais peu consultés, il est essentiel de mieux disséminer les connaissances auprès des pro-fessionnels et du public par des outils interactifs et des sites, officiels mais plus conviviaux.
les compétences et les expertises indépendantes nécessaires sont bien en place à l’agence européenne. les experts doivent savoir intégrer, au-delà de leur spécialité, les impératifs de santé publique et la sécurité des patients17. la phar-macovigilance est en cours de renforcement significatif, ce qui devrait rassurer les citoyens européens, notamment après le scandale du Benfluorex en France. de nouvelles mesures sont prises pour prévenir l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaine de distribution.
l’industrie pharmaceutique européenne de recherche reste importante au plan mondial, malgré certaines faiblesses en matière de biotechnologie. la fragilité de la recherche pharmaceutique a conduit les ministres européens de la Recherche à accepter en 2008 une initiative originale pour les médicaments innovants (imi), sous forme de partenariat public/privé entre la commission européenne et l’in-dustrie pharmaceutique européenne (eFpia). afin de mieux ancrer la recherche pharmaceutique en europe, la commission finance la recherche académique et les petites et moyennes entreprises à hauteur d’un milliard d’euros jusqu’en 2017, à condition que l’industrie autofinance de nouveaux efforts de R&d sur le sol européen pour un montant équivalent (www.imi.europa.eu).
euRope du mÉdicameNt 73
Bien que les décisions de remboursement continuent à relever des autorités nationales, la commission européenne a encouragé les États membres à coopérer en matière d’évaluation des technologies de santé (hta). cette approche multi-disciplinaire vise à rendre les technologies de santé sûres, efficaces et accessibles (prévention, diagnostic, traitement), dans le prolongement des évaluations tech-niques réalisées par l’ema. le programme européen de santé soutient le déve-loppement d’un réseau de 33 autorités nationales, coordonné par la haute autorité de santé (http://www.eunethta.eu).
l’avènement des traitements personnalisés et de la pharmaco-génomique nécessitent une révision en profondeur des procédures d’évaluation et d’autori-sation, actuellement conçus pour une médication de masse. une meilleure connaissance des caractéristiques génétiques de chaque patient devrait permettre d’augmenter l’efficacité, tout en réduisant la toxicité de ces nouvelles molécules qui apparaissent dans des domaines aussi divers que les cancers et les maladies auto-immunes. l’autorisation de mise sur le marché devra se transformer à l’ave-nir en un processus continu et, en partie, individualisé.
BiBliographie
1. B. hauray, L’Europe du médicament_ politique, expertise, intérêts privés, paris, presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2006.
2. F. sauer, R. hankin, « Rules governing medicines in the european community », Journal of Clinical Pharmacology, 27 (1987): 639-646.
3. F. sauer, « vision européenne des inspections et audits », stp pharma pratiques, volume 16, n° 5, septembre/octobre 2006, p. 403-410, paris.
4. F. sauer, « Évolution de la réglementation des médicaments dans la communauté européenne », Revue du Marché Commun, n° 320, septembre 1988, p. 450-454, paris.
5. a. mc lachlan, F. sauer, « What does the future hold for the european pharma indus-try », Chemistry & Industry, 21 June 1993, p. 450-453, london.
6. p. deboyser, « le marché unique des produits pharmaceutiques », Revue du Marché Unique Européen, 3-1991, p. 101-176, paris.
7. F. sauer, « place de la pharmacopée européenne dans la nouvelle réglementation du médi-cament en europe », pharmeuropa, volume 6, n° 2, juin 1994, p. 76-80, strasbourg.
8. l. horton, « european leader on Fda and ich », in FDA, a Century of Consumer Protection, Food and drug law institute, Wayne l. pines editor, pp. 122-123, 2006, Washington.
9. Numéro spécial consacrée à ich, European Pharmaceutical Law Notebooks, vol. ii, n° 4, may 1996, ceFi/cedeF, madrid.
10. Proceedings of the International Conference on Harmonisation, the Queen’s university of Belfast, Greystone Books, antrim, uK.
11. F. sauer, « small is beautiful », E-SHARP, march/april 2006, p. 52-54, london.12. F. sauer, « the european medicines evaluation agency and approvals-efficiency,
transparency and accountability », in The EC Agencies between Community Institutions and Constituents, european university institute, Robert schuman center, February 1998, p. 95-100, Florence.
74 Revue d’histoiRe de la phaRmacie
13. F. sauer, « agence européenne d’évaluation des médicaments: bilan de cinq ans d’expé-rience », Bulletin et Mémoires de l’Académie royale de médecine de Belgique, volume 155, année 2000, n° 5-6, p. 254-262, Bruxelles.
14. F. sauer, « l’europe du médicament: rôle de l’emea », Annales pharmaceutiques fran-çaises 2000, 58, p. 278-285, masson, paris.
15. http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm. 16. F. sauer, i. moulon, « Role of the emea in accompanying product development », Focus
on Pharmaceutical Research, volume i, 1999, p. 9-23, ios press, amsterdam.17. F. sauer, « l’expertise pharmaceutique en question », Revue française de santé publique,
février 2012, paris.
résumé
Les grandes étapes de l’Europe du médicament – suite au livre blanc de 1985 sur l’achèvement du marché intérieur, une série de mesures d’harmonisation des législations pharmaceutiques ont été adoptées à l’unanimité four favoriser les médicaments issus de la biotechnologie, assurer la trans-parence de la fixation des prix, rapprocher les règles de prescription, de distribution et de publicité pharmaceutique.cette harmonisation européenne s’est poursuivie au plan international, avec la Norvège et à l’islande, par l’élargissement à de nouveaux États membres et de grandes conférences internatio-nales avec les usa et le Japon (ich).depuis 1995, l’agence européenne des médicaments a mis en place un système performant d’auto-risation de mise sur le marché de nouveaux médicaments à usage humain et vétérinaire. ce système a été étendu aux médicaments pédiatriques et aux thérapies avancées. la surveillance des effets indésirables (pharmacovigilance) a été renforcée par étapes successives.
summary
????????????????????????????????????????? – under the 1985 White paper on the comple-tion of the single market, several pharmaceutical harmonisation measures were unanimously adop-ted, in favor of biotech products and on pricing transparency, legal status of prescription, wholesale distribution and advertising.the european pharmaceutical harmonisation was extended to Norway and iceland, to new acces-sion member states and through major international conferences with the us and Japan (ich).starting in 1995, the european medicines agency has produced an efficient marketing authorisation system for new human and veterinary medicines. the system was extended to pediatric medicines and advanced therapies. the monitoring of drug adverse effects (pharmacovigilance) has been gra-dually strengthened.
mots-clés
harmonisation pharmaceutique internationale, agence européenne des médicaments.