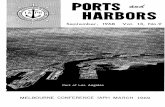1968 A propos des rapports entre la Pannonie et la Dacie
Transcript of 1968 A propos des rapports entre la Pannonie et la Dacie
ACTA CLASSICAUNIV. SCIENT. DEBRECEN. IV. 1968. p. 69—78.
A PROPOS DES RAPPORTS ENTRE LA PANNONIE ET LA DACIEP A R L O U I S B A L L A E T E T I E N N E T Ô T H
Le sort de la Pannonie et celui de la Dacie se trouvaient étroitement reliés non seulement par les nécessités militaires et politiques, l’appartenance au système de défense du front danubien ou la menace commune, représentée par les Sarmates-Iazyges : les rapports établis suile plan de l’histoire «interne» — démographique et économique — occupaient une place également importante dans la vie des deux provinces.1 A l’intérieur des sources épigraphiques, ce sont surtout les inscriptions indiquant une origo, une natio ou une domus qui fournissent des données particulièrement importantes pour l’étude de ces derniers problèmes. En ce qui suit, nous présentons d’abord une nouvelle liste de ces documents2, avec leur interprétation historique.
Voici les monuments épigraphiques du territoire de la Dacie faisant mention de Panno- niens:
Dacia Superior.1. Sarmizegetusa. Autel.2 Aesculapio et Hygiae Augustfis). C. Titius Agathopus Aug(usta-
Iis) col(oniae) Sisciae et Sann(izegetusae) ex voto. — IIe siècle. La personne offrant l’ex- voto était affranchi des Titii de Siscia, connus d’autres inscriptions; il fut d’abord Augustalis dans cette colonie du Sud-Ouest de la Pannonie, pour obtenir ensuite cet honneur religieux purement formel à la capitale régionale de la Dacie aussi. Il est bien connu que cette fonction sacerdotale perpétuelle demandait en général un sacrifice matériel considérable et que les
1 Cf. A. Alfôldi, Szâzadok 70 (1936) 149 suiv.; CAH XI (1936) 553 suiv.; Szâzadok 74 (1940) 140, 159 suiv. Pour l’histoire «intérieure» de la Pannonie: A. Môcsy, Die Bevôlkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen. Bp. 1959; L. Barkôczi, Acta Arch. Hung. 16 (1964) 257 suiv.; A. Môcsy,Pannonia. RE Suppl.IX. (1962),en particulier Abschn.IV 5,6.,VII,IX,Xll.(en ce qui suit: Môcsy, Bevôlkerung; Barkôczi, Acta; Môcsy, Pannonia); on n’a pas encore fait d'étude systématique sur la démographie de la Dacie; cf. C. Daicoviciu, Siebenbürgen im Altertum. Bukarest 1943, 117 suiv., D. Tudor-M. Macrea, Istoria Romîniei, I. (Bucuresti 1960) 382 suiv., avec bibliogr.
2 Cf. le recueil d’A. Dobô: Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes3 4. Diss. Pann. I, 1. (Budapest 1940, en ce qui suit: Dobô).
3 B. Jânô, Arch. Ért. 32 (1912) p. 405.; Dobô 75: 447; A. Kerényi, A dâciai személynevek. Diss. Pann. I, 9 (Bp. 1940) 1809. (en ce qui suit: Kerényi) — Pour la chronologie: G. Alfôidy, Acta Ant. Hung. 6 (1958) p. 438, 442. Autrement: Barkôczi, Acta, 330: 26/66. Sur les Titii de Pannonie: Môcsy, Bevôlkerung, 57, 160, 212: 57/17, 18. et Barkôczi, Acta p. 303. Sur les corps des Augustales en général et au point de vue pannonien: G. Alfôidy, op. cit. 433 suiv., avec bibliogr.; au point de vue de de la Dacie: D. Tudor, Dacia NS 6 (1962) 199 suiv. Pour la matière épigraphique en rapport avec tout l'Empire, v. A. v. Premerstein (réd.): Ruggiero, Diz. ep. I., pour le problème de 1 'Augustali tas «double», cf. le phénomène du decurionatus double: L. Balla, Acta Class. Debr. 2 (1966) 86 suiv. — Sur le commerce entre provinces: M. Rostovtzeff, SEHRE2 (Oxford 1957) 150 suiv., et F. Oertel, CAH XII2 (1956) 244 suiv. Sur les affranchis commerçants: A. Môcsy, Acta Ant. Hung.4 (1956) 222 suiv. — Pour les exportations orientales des ateliers de Siscia, v. C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan. Beitr. zur Vôlkerk. von Südosteur. V/2. (Wien- Leipzig 1937) 165 suiv.; Môcsy, Pannonia, 662 suiv., 688, Id., Bevôlkerung, 25 suiv., 96 suiv., 100 suiv. ; sur l’importance de Sarmizegetusa : V. Christescu, Viafa economicâ a Daciei Romane. Piteçti 1929, p. 120, v. encore la matière épigraphique de 1 'ordo Augustalium: D. Tudor, op. cit., 201 suiv.
69
corps des Augustales étaient constitués surtout d’affranchis aisés, donc de commerçants et de banquiers. Dans les cas ou quelqu’un était revêtu de la charge d" Augustalitas dans plusieurs villes ou dans des colonies de provinces diverses à la fois, les inscriptions renvoient régulièrement à un homme de fortune, notamment à un homme d’affaires, dont la richesse provenait, pour une part considérable, du commerce à grande distance, surtout du commerce entre provinces (cf. CIL III 1069 et avec celle-ci: 1440, 3836, 4153, CIL XI 6358=Dessau 6654= Dobô 76 : 461, CIL XII 3203 etc.). L’autel de Sarmizegetusa a dû être dressé par un tel entrepreneur, et il est probable qu’Agathopus fut le commis-affranchi, l’agent d’une maison de commerce de Siscia. Tout cela concorde avec les observations selon lesquelles les exportations des briqueteries et usines de sigillata de Siscia se dirigaient, le long de la Save et du Bas-Danube comme de la Tisza et du Maros, vers la Mésie et la Dacie. — De nombreuses inscriptions témoignent encore du rôle que la ville de Sarmizegetusa et ses hommes d’affaires ont joué en Dacie, dans le trafic intérieur et extérieur.
2. Apulum (Alba Iulia= Gyulafehérvâr). Pierre sépulcrale.4 [ . . ,si?]siat(a?) Vaussi( ?)fil. Claudia Savaria vixit annis XXXV. *Iestinus Super coniugf i) benemerenti h [ .............. ]. —IIe siècle. La femme était originaire de Savaria, le mari devait être né, d’après son nom, dans le Nord de l’Italie (à Aquilée?) ou en Occident, et c’est également de Pannonie — de Savaria, de la région du limes ou de Pannonie Orientale — qu’il devait passer en Dacie directement. Dans ce dernier cas, on peut surtout prendre en considération Aquincum, Sopianae ou Mursa. On peut démontrer la présence relativement massive de Pannoniens occidentaux (donc de Savariens aussi) dans ces agglomérations-là pour la première moitié du IIe siècle.
3 .Apulum. Fragments de pierre, appartenant au même sépulchre.N/. m. Ael( ius) Propi (n)- cus libr. [eo]s. vixit [an]n. XXX[II.] — [■■■] Siscia [ . . .rniljes leg. X [III g.] positi f t ........]us eqfues. . .] lier [es .......... 7. Le terminus post quem est défini par le nomen et lelibr. cos.: 167/168. Il s’agit d’un indigène ayant reçu droit de cité sous Adrien ou Antonin le Pieux, au cognomen caractéristique de l’anthroponymie des territoires occidentaux ou celtiques.
4. Ostrov (Nagy-Osztrô, ager Sarm.). Titulus honorarius.4 5 6 7 . . . Siscius Valerius (centurio) leg. XIII. gem. . . . — 211—217 de notre ère. Personne originaire de Siscia? — Soldat d’une unité pannonienne, muté dans la légion d’Apulum: .. . Tib. Cl(andins) Valerianus ( centurio) leg. XIIIg. et [leg.] I aitricis (= adiutricis) . . . (CIL III 981).7 II est peut-être d’origine sava- rienne (cf. l’inscription citée sous le n° 2).
4 CIL III 1221; Dobô 42: 222. Pour compléter l’inscription: I. I. Russe, AISC 5 (1944-1948) p. 292. Pour la chronologie: Barkôczi, Acta 334: 58/39. Pour les noms: /. I. Russe, op. cit., p. 292, CIL V 8399 (Aquileia), Môcsy, Bevôlkerung, 192: s. v. Super, Sisiata: CIL III 4181 (Savaria). Pour l’histoire démographique de Savaria: Môcsy, Bevôlkerung, 36 suiv.; Barkôczi, Acta, 264 suiv. Sur les mouvements des Pannoniens occidentaux en direction orientale: Môcsy, Bevôlkerung, p. 98 (Brigetio: p. 58; Aquincum: 67 suiv.; Sopianae: p. 74, Mursa: 74 suiv.). A propos de Sopianae, cf. encore: F. Fïilep, Pécs rômaikori emlékei. Pécs 1963, 20 suiv., illustr. 11 et 15 (Caesernii, Apulei, Annii).
5 I. Berciu-A. Popa, Apulum 3 (1965) 195 suiv.: n° 12. — Sur les Aelii de Siscia: Môcsy, Bevôlkerung, p. 26. Sur le cognomen: Ici, op. cit., p. 187, et Barkôczi, Acta, p. 321, cf. encore I. Berciu-A. Popa, op. cit., p. 196. Sur les rapports celtiques de l'anthroponymie des Sisciani: G. Al- fôtdy, Arch. Ért. 87 (1960) 97 suiv. Pour la chronologie: A. Stein, Die Reichsbcamten von Dazien. Diss. Pann. I 12. (Bp. 1944) 37 suiv.
G CIL III 1464; Dobô 46: 242; Kerényi 1299; Barkôczi, Acta 354: 178/81; H. G. Pfiaum, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain, II. (Paris 1960) 691: 257. — Le nomen ne se rencontre qu’ici, comme cognomen, on le relève en Pannonie: Môcsy, Bevôlkerung, p. 191.
7 Kerényi, 635. Pour le nom, v. Môcsy, Bevôlkerung, p. 38, 149, 195; Barkôczi, Acta, 264, 298 suiv., 326 suiv. — Des centurions d’origine pannonienne dans l'armée d’autres provinces: Môcsy, op. cit., 118 suiv., surtout: 90/11, 39, 48: des Savariens; Id., Pannonia, col. 645; Barkôczi, op. cit., 285 suiv.
70
s
5. Alburnus Maior (Roçia M ontanâ= Verespatak). Tabula cerata (cautio de empto puero).8 Dasius Breucus emit mancipioque accepit puerum Apalaustum . . . pro uncis duabus (denariis) DC de Bellico Alexandri. . . — An 142 de notre ère. Breucus est un second nom, il ne désigne pas l’origine. C’est un peregrinus de Pannonie, issu, selon toute vraisemblance, de la tribu des Breuci, qu’on peut localiser dans la partie Sud-Ouest de la Pannonie Inférieure. L'apparition de Pannoniens méridionaux à Alburnus Maior et dans la zone des mines d’or les plus importantes de la Dacie est liée, d’après Mommsen et d’autres, à la colonisation précoce de ces territoires. On peut évoquer, en outre, la possibilité du rapport avec la translatio des troupes auxiliaires pannoniennes en Dacie (cf. n° 7). Dasius s’occupait probablement de l’exploitation des mines d’or: on peut supposer qu’il était conductor (cf. CIL III 948 p. suiv.,ÏX-XI.)
6. Alburnus Maior. Pierre sépulchrale.9 D. M. Arria Marna vix ami. XXV. pos(uit) B(r?)eucus ser(vus) coniugi b. m. — IF siècle. La conjecture relative au nom de l’esclave est peu sûre, il ne peut d’ailleurs renvoyer à la tribu du Sud de la Pannonie qu’indirectement. Les deux personnes appartenaient à la famille des Arrii (cf. CIL III 8020); B(r?)eucus pouvait être servus agens (actor ; cf. CIL III p. 951, XIII), Marna était affranchie.
Dacia Porolissensis.7. Gherla (Szamosüjvâr). Diplôme militaire.10 Sepenestus Rivi / . . . ex pedite coh. I
Britannicae (miliariae) in Dacia Porolis(sensi). — 133 de notre ère. La leçon amendée de l’indication d’origine serait COR(I)NON d’après C. Daicoviciu et D. Protase; PANNON(io) [ou CORNA(cati)] d’après Môcsy.Il est à présumer que Sepenestus fut recruté déjà après que la cohorte avait dû se rendre en Dacie (en 106 de notre ère?), vers 108, notamment — d’après la leçon de Môcsy — d’entre les Cornacates au Sud-Est de la Pannonie. — Palatovo (Thrace). Diplôme militaire.11 Sextus Busturionis f. Pann( onius) ex pedite cohort. I Batavor( uni) ( miliariae) in Dacia Porolis(s)ensi. — 164 de notre ère. Le soldat entra dans la cohorte vers 139, c’est-à-dire pendant le séjour de celle-ci en Dacie, évident à partir de 133. Le nom celtique. Busturio et le nom Sextus n’offrent pas de possibilité pour constater son appartenance tribale: il était peut-être originaire du Nord-Est de la Pannonie. Il est connu que, non seulement en Dacie Porolissensis mais encore en Dacie Supérieure, une partie considérable des forces de défense auxiliaires étaient constituées par des unités venues de Pannonie — surtout du limes
8 CIL III p. 940, VII.; Dobô 43: 226; Kerényi, 1639; D. Tudor, Istoria sclavajului în Dacia Romanâ. Bucuresti 1957, 266: 118. Pour le nom: Môcsy, Bevolkerung, 115 suiv., 171 : s ,v.Das(s)sius, 167: s. v. Breucus (seulement en Pannonie!). Sur les Breuci: Môcsy, op. cit., p. 75, et G. Alfôldy, Acta Arch. Hung. 16 (1964) 247 suiv. Le nom illyrique Das(s)ius et ceux, apparentés, de Dasas, Dasa et Daza, en Dacie, se rencontrent surtout en Dacie Supérieure et dans la Porolissensis, v. Kerényi, p. 140 suiv.; I. I. Russu, AISC 4 (1941-1943) 201 suiv.; cf. encore Apulum 5 (1965) 592 suiv. (Alburnus Maior). Sur la colonisation de la Dacie: Mommsen, CIL III p. 213; Hirschfeld, Kleine Schriften. Berlin 1913, 747 suiv.; K. Patsch, op. cit., 176 suiv., 193 suiv.; récemment: C. Daicoviciu, Dacia NS 2 (1958) 259 suiv.
3 CIL III 7830=1263; Kerényi, 1674; I. I. Russu, AISC 4, p. 201, AISC 5, p. 285; D. Tudor, op. cit., 265: 117. Breucus comme nom d’ esclave: Dobô 43: 229; v. Môcsy, Bevolkerung, 75, 234/4. Pour Marna: D. Detschew, Die tlirakischen Sparchreste. Wien 1957, 283 suiv. s. v. Marna. Les inscriptions des Arrii de Dacie: Kerényi, 302, 1948; D. Tudor, Oltenia Romanà2. Bucuresti 1958, 386: 35.
10 C. Daicoviciu-D. Protase, JRS 51 (1961) 63 suiv., AMN 1 (1964) 163 suiv.; Ant. Tan. 12 (1965) 126 suiv.; A. Môcsy, Ant. Tan. 11 (1964) 113 suiv., 12 (1965) 130 suiv. — Emplacement du camp: Casei = Alsô-Kosâly.
11 CIL XVI 185; Môcsy, Bevolkerung, 264: 238/13. Pour l’histoire de cette unité, v. C. Daicoviciu-D. Protase, op. cit., avec bibliogr.; ses camps se trouvaient à Romita, à Potaissa (Turda = = Torda). Pour le nom: Môcsy, op. cit., p. 167, 190, et Dobô 32: 112.
71
I
de la Pannonie du Nord-Est, sous Trajan et durant les premières années du règne d’Hadrien.12 On trouve parmi ces troupes les coh. I Britannica (mill.) et I Batavorum (mill.). Pour compléter ces unités, ainsi que les autres alae et cohortes de 1 'exercitus Daciae, on avait recours, dans la première moitié di IIe siècle encore, surtout aux territoires où elles avaient séjourné antérieurement ou à ceux d’autres provinces.1211
Personnes originaires de Dacie en Pannonie.138. Carnuntum (Deutsch-Altenburg). Pierre sépulchrale.14!). M. Valeria Dionysia do(mo)
Sa[r(mizegelusa)] Da(ciae) S(uperioris) h(ic) sfita est) v. a. XX. C. Valerius Sarnus coni- ugi dulcissimae fec. — Première moitié ou milieu du IIe siècle: entre 119 et 167. D ’après Môcsy, c’étaient des affranchis commerçants. Vu son cognomen, Valeria était peut-être d’origine est-balkanique ou orientale; Sarnus pouvait être issu d’une famille de Dalmatie, quoiqu'il soit probable qu’il venait directement de Dacie. Nous avons encore un témoignage de l’activité que des gens d’affaires de Sarmizegetusa ont menée en Pannonie occidentale(près de la Drave), par un fragment d’inscription de Norique (Villach): [ ..........cjol(oniae)Da[c(icae)] Sar[mijzaegethusae v. s. I. m. (AE 1957, 109; cf. encore l’inscription suivante).
9. Germisara (Cigmâu= Csigmô, Dacia Sup., Apulensis). Pierre sépulchrale.15 . . .Aure- liai Florai . . . defunctae P(o)etovio(ne) .. . Pater: M. Aurel. Crescens Auggg. lib., coniunx: Ael. Iulianus, peut-être identique à 1’Augustalis de Ia colonia Apulensis portan le même nom (cf. CIL III 1001). — 209-211 de notre ère. Cf. n° 8.
10. Aquileia. Pierre sépulchrale.10 . . . M. Secundi Genialis domo Cl. Agrip(pina) nego- tiat. Dacisco. .. — IIe siècle. A. Dobô: «Hic negotiator, qui Coloniae Agrippinae natus est, mercaturam per Savum Danuviumque usque ad Daciam fecit».
11. C'est en empruntant les mêmes voies que les Titi Fabii, de Treviri, développèrent leur activité commerciale à Aquilée et en Dacie.17 La famille passa directement d’Aquilée en Dacie, dans la ville des camps d’Apulum, durant la première moitié du IIe siècle: T. Fabio lb[l]iomaro domo Augus. Treve[r] quond. dec[ur(ioni) kjanabar(um) . . . Fabii Pulcher, Romana, Aquileiensis per tutores suos pos. (CIL III 1214). Après la mort du père, c’est le fils aîné, Fabius Pulcher, qui continua à faire du commerce entre Apulum et Aquilée (cf. CIL V
12 Dacia Superior: alae I Batavorum (mill.), I Gallorum et Bosporanorum, cohortes I Vindelicorum (mill.), VIII Raetorum c. R. eq., I Gallorum Pannonica eq., I Aug. Ituraeorum sag.; Dacia Porolissensis: ala Siliana Tungrorum Frontoniana, cohortes II Hispanorum scutata Cyrenaica, II Aug. NerviaPacensis (mill.) Brittonum, IHispanorum (?), IBatavorum (mill.), IBrittonum (mill.), I Britannica (mill.). — V. W. Wagner, Die Dislokation der rômischen Auxiliarformationen. Berlin 1938, s. v. et C. Daicoviciu-D. Protase, op. cit. V. encore Môcsy, Pannonia, 617 suiv. s. v.
12a V. K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau. Bern 1951, 52 suiv., cf. encore G. Forni, Athenaeum NS 36 (1958) 184 suiv., B. Gerov, Klio 37 (1959) 196 suiv.
13 Nous ne nous occuperons plus des inscriptions des esclaves et affranchis, originaires de Dacie et passés en Pannonie (cf. Dobô, nos. 58, 60, 75, 233), ni des monuments de Poetovio des deux légions de Dacie provenant de l’époque de Gallien, v. Barkôczi, Acta, p. 263. D’autres monuments épigraphiques de la légion XIII g. en Pannonie: Barkôczi, op. cit. 38/7, 77/25, 105/12 (IIe— IIIe siècle).
14 CIL III 4501; Môcsy, Bevôlkerung, 50, 242: 156/52. Sarnus: H. Krahe, Lex. altillyr. PN. Heidelberg 1929, 100; Môcsy, op. cit., p. 189, D. Rendic-Miocevic, ZA 10 (1960) p. 165. Dionysia: Kerényi, p. 165. — Des commerçants de Dalmatie en Dacie: G. Alfôldy, Bevôlkerung und Gesell- schaft der rômischen Provinz Dalmatien, Bp. 1965, p. 121 (Aequum).
10 CIL III 1399; Kerényi 374, 511; D. Tudor, op. cit. 265: 113. Cf. encore D. Tudor, Dacia NS 6 (1962) p. 203. Pour les rapports est-balkaniques et orientaux de Poetovio cf. Môcsy, Bevôlkerung, p. 29; Barkôczi, Acta, p. 263.
10 CIL V 1047 = Dessau 7526; Dobô 130: 228. Cf. V. Christescu, op. cit., p. 125; Môcsy, Bevôlkerung, p. 101. Sur les rapports entre Aquilée et la Dacie: S. Panciera, Vita economica di Aquileia in età romana. Lido-Venezia 1957, 90 suiv., 106.
17 Kerényi 1662, 714, 715. Cf. encore CIL III 1207; Kerényilll (Apulum) : Fabia Lucilia e. m. v. filia (IIe—IIIe siècle). — V. Christescu, op. cit., p. 121; D. Tudor, op. cit., p. 203, 207. V. encore S. Panciera ,op. cit.
72l
8229 Aquileia et CIL III 1157 Apulum; selon cette seconde inscription, Fabius Pulcher devint Augustalis de la colonia Aurelia d’Apulum).
12. Aquincum (Ôbuda). Pierre sépulchrale.18 [D. M. P. Aelio Ba?]sso Cissiani (filio) militi leg. I l adi. . . . Porolisse[n]si pro( y incia) D ( acia) . . . — Première moitié ou milieu du IF siècle. Oriental, il est probablement de Palmyre. Le service militaire, dans la legio II adiutrix, de personnes venant d’autres provinces et ainsi de Dacie, après Trajan mais encore avant les guerres de Marc Aurèle, s’explique, selon Môcsy19, par le fait qu’en Pannonie Inférieure, on ne disposait pas encore, à l’époque, d’un assez grand nombre d’habitants suffisamment romanisés.
13. Vetus Salina (Adony). Fragment d’un diplôme militaire.20 [ex dec- vel centjurione[ ........] f Lucilianus Porol(isso) — Entre 168 et 190 de notre ère à peu près, 189 selon J. F it/.Il était déjà citoyen au moment de son recrutement; il entra dans une troupe auxiliaire de Pannonie Orientale vers 164 peut-être.'21 Occidental ou oriental.
Au point de vue de l’histoire démographique, les inscriptions examinées font ressortir le rôle qu’ont joué en Dacie les éléments arrivés de Pannonie directement ou indirectement: provinciaux illyriens-celtiques, Italiques, Dalmates, occidentaux.22 Les populations d’origine orientale, est-balkanique, dalmate et occidentale, transplantées de Dacie en Pannonie, n’ont jamais atteint cette importance.
Si des Pannoniens passaient en Dacie en grand nombre, c’était à l’intérieur des unités militaires qu’on dirigeait vers cette province;23 24 en outre, au moment où celles-ci furent complétées par des Pannoniens (cf. 7) et à la suite d’un service militaire (cf. 3, 4). Les relations commerciales entre les deux provinces avaient aussi un certain rôle, et peut-être établit-on en Dacie, après l’organisation de la province, non seulement des Balkaniques septentrionaux (ainsi des Dalmates) et des orientaux mais des habitants originaires de Pannonie aussi.21 Les lieux des inscriptions et les données des diplômes militaires laissent conclure qu’on peut compter avec l’établissement de Pannoniens surtout dans les régions du Nord de la Dacie, ainsi dans certaines zones de la Dacie Supérieure et de la Porolissensis.
En ce qui concerne les personnes venant de Dacie en Pannonie, nous avons pu démontrer la présence de quelques gens d’affaires et soldats seulement. On peut supposer cependant que la majorité des éléments est-balkaniques et orientaux (d’Asie Mineure et de Syrie),25 qu’on remarque, à partir de la première moitié du IIe siècle, dans plusieurs applomérations pan- noniennes, provenaient de l’autre province danubienne directement, comme en témoignent
18 CIL III 3556; Dobo 104: 53; Môcsy, Bevôlkerung, 250: 185/22 (il ne rapporte pas le nom du soldat). — Kissos: Pape p. 665, de là, la formation latine de Cissianus. Cissus en Dacie: CIL III p. 928, II. (158 de notre ère). Le manque de filins renvoie déjà en lui-même à un territoire de langue grecque: Môcsy, op. cit. 116, note 254. La matière anthroponymique des orientaux de Dacie se trouve dans Kerényi,p. 154suiv., 183 suiv.Palmyriens: nos.2151,2154,2152,2163.Pour la population de Porolissum, v. C. Daicoviciu, RE «Porolissum» 267 suiv.; CIL XVI 68, et C. Daicoviciu, Dacia NS 1 (1957) 191 suiv.
19 Bevôlkerung, p. 85.20 CIL XVI 132; J. Fin, Acta Ant. Hung. 7 (1963) 432 suiv., 11 (1963) 279 suiv., Acta Arch.
Hung. 11 (1962) p. 59; Barkôczi, Acta, 349: 143/2. Pour le nom: Barkôczi, op. cit., p. 316; Kerényi 304,1019,1021.
21 Cf. L. Balla, Arch. Ért. 92 (1965) 146 suiv.; G. Barta, Acta Class. Debr. 2 (1966) p. 82.22 V. A. Alfoldi, Szâzadok 74 (1940) p. 140, Id., Zu den Schicksalen Siebenbürgens im Altertum.
Bp. 1944, 15 suiv.; Mommsen, op. cit., Hirschfeld, op. cit.; Polaschek, RE ,,Pirustae" 1731 suiv., C. Patsch, op. cit., 176 suiv., 193 suiv.
23 V. A. Alfoldi, Szâzadok 74 (1940) 160 suiv.24 V. les ouvrages cités dans les notes 8 et 22, ainsi que l’inscription citée le n° 5.25II siècle: Môcsy, Bevôlkerung, 102 suiv., 28 (Poetovio), 50 (Carnuntum), 58 (Brigetio),
68 (Aquincum et ses environs) et 259: 213/1. — II—III0 siècles: Barkôczi, Acta, passim; L. Balla, Acta Arch. Hung. 15 (1963) 235 suiv.
73
les indications d’origine des inscriptions.20 * * * * * 26 Des habitants de la Dacie du Nord ne pouvaient entrer dans Yexercitus de la Pannonie Inférieure en nombre considérable qu’avant les guerres de Marc Aurèle.27
*
Plusieurs des inscriptions étudiées fournissent des données relatives au trafic de marchandises et aux relations commerciales entre la Pannonie et la Dacie (cf. 1, 2?, 6 ?, 8, 9, 10, 11), en soulevant quelques problèmes, surtout en ce qui concerne la Dacie.
Il a été montré plusieurs fois que la Pannonie exportait certains produits industriels — sûrement de la poterie — dans les provinces du Bas-Danube, ainsi en Mésie Supérieure et en Dacie.28 ,,Auf die keramische Industrie Dakiens hat P(annonien) einen nicht unerheb- lichen EinfluB ausgeübt. In diesem EinfluB hat sich dieselbe wirtschaftliche Notwendigkeit ausgewirkt wie in P(annonien) beim italischen EinfluB zur Zeit der Ausbildung der lokalen Industrie.“29 En ce qui concerne l’exportation des marchandises pannoniennes en Dacie, il faut prendre en considération, d’après les recherches effectuées jusqu’ici, surtout les ateliers de la Pannonie orientale et méridionale, comme la fabrique de Pacatus à Aquincum, ainsi que les briqueteries et les ateliers de sigillata à Siscia.30 L’inscription de C. Titius Agathopus, trouvée à Sarmizegetusa, confirme ce qu’a reconnu Alfôldi déjà, relativement aux exportations des ateliers de Siscia en Dacie31, tandis que le monument de pierre d’Iestinus Super, à Apulum, laisse supposer qu'au cours du IIe siècle, les marchandises de certaines villes de la route de l’ambre parvenaient également sur le territoire de la province danubienne récemment organisée.32 Il a été dit ci-dessus que l’élan, pris par l’économie de la région du limes pannonien à la fin du Ier siècle,33 attirait dans les agglomérations importantes de la Pannonie du Nord-Est et de l’Est — à Brigetio, à Aquincum, à Sopianae, à Mursa — non seulement des gens d’affaires de la Gaule du Sud ou de Germanie mais encore beaucoup de Pan- noniens occidentaux, par exemple de Savaria. Lorsque, par la suite, «le cadre de l’évolution . . . des provinces du Moyen-Danube . . . s’élargit considérablement par l’occupation de la Dacie» (Alfôldi), les gens d’affaires de la Pannonie occidentale de Siscia, de Savaria etc. poursuivirent la conquête économique de l’Est, séduits par ces territoires bas-danubiens, qui leur offraient de nouvelles possibilités.31 Il est nécessaire de souligner ici que l’activité des gens d’affaires pannoniens en Dacie était certainement en rapport avec la translatio des unités militaires pannoniennes en Dacie et avec leur participation aux guerres de cette province.35
20 Cf. Môcsy, Bevôlkerung, p. 103. Ici, on doit prendre en considération surtout les noms renvoyant à une origine d’Asie Mineure, cf. à ce propos J. Dobias, «Bidlùv Sbornik» (Prague 1928) 26 suiv.; C. Daicoviciu, Siebenbürgen im Altertum. Bukarest 1943, 133, 139 suiv.; Kerényi p. 155 suiv., M. Rostovtzeff, op. cit. 246 suiv.
27 Cf. ci-dessus note 19; lors du déplacement de la legio V Macedonica (167-168), on out recours à la population locale dans une mesure beaucoup plus grande qu’auparavant.
28 A. Alfôldi, Szâzadok 70 (1936) p. 155; Môcsy, Bevôlkerung, p. 103, Id., Pannonia 687 suiv. (avec bibliogr.).
29 Môcsy, Pannonia 687 suiv.30 Cf. note 28. Des briques de Sirmium portant l’inscription SISC: Môcsy, Bevôlkerung, p.
138, et le long du Maros, extra fines Daciae: Radnôti-Barkôczi, AÉ 78 (1951) p. 95, note 262.31 Szâzadok 70 (1936), op. cit.32 Cf. Môcsy, Pannonia, 675 suiv., 688.33 E. Gren, Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftl. Entw. der rôm. Kaiserzeit. Uppsala-
Leipzig 1941, p. 95; Môcsy, Bevôlkerung, p. 102, 136.34 Cf. U. Kahrstedt, Kulturgesch. der rôm. Kaiserzeit. Bern 1958, 205 suiv.35 L’apparition des commerçants occidentaux en Pannoniè, à la fin du Ier siècle, était également
en rapport avec les troupes occidentales des légions, envoyées ici à l’époque, A. Môcsy, Pannonia tôrténete. Bp. 1963, p. 56.
74
Pourtant, incontestablement, la Pannonie était moins une exportatrice de ses propres produits industriels qu’une médiatrice des marchandises occidentales (et d’Italie du Nord?), quant à son rôle joué dans la vie économique de la Dacie, qui avait également grand besoin d’importations.30 * * * * * 36 Ce trafic, allant de l’Ouest vers l’Est et effectué sur le territoire de la province, le long de la Save et du Danube, ainsi que dans la vallée de la Drave37, était dirigé surtout par des gens d’affaires occidentaux (de Gaule et de Germanie), qui contrôlaient, au cours du IIe siècle, non seulement les importations,38 mais encore une partie considérable des exportations occidentales de la Dacie (cf. 10, 11).39 Vers le milieu du IF siècle, l’industrie locale était en train de naître en Dacie même, en développant un groupe de commerçants, qui forts par leurs capitaux, avaient des relations, en dehors des provinces danubiennes, avec des régions plus lointaines aussi (cf. 10, 11 : Aquilée, 8: Norique).40 Il est probable que les negotiatores Dacisci (cf. 10), dont le groupe se formait d’occidentaux, de Dalmates, d’orientaux etc., faisaient parvenir en Pannonie non seulement les matières premières et la poterie de leur province41 mais des marchandises provenant d’Asie Mineure et de l’Est de la péninsule balkanique aussi42.
*
La communication entre la Pannonie et la Dacie était assurée par la route du limes et la voie fluviale le long du Bas-Danube (celles-ci réunissant le trafic des vallées de la Save et de la Drave), ainsi que par les routes traversant la terre des Sarmates et par la voie fluviale Maros-Tisza.43 Le commerce privé se servait naturellement surtout de la voie danubienne, sûre et bon marché, donc il accédait à la Dacie du côté de la Mésie Supérieure, pour emprunter ensuite les routes partant des passages de Viminacium, de Dierna et de Drobeta vers les zones intérieures de la province.44 Parmi ces routes on peut considérer comme la plus importante celle entre Dierna-Tibiscum-Sarmizegetusa (resp. Drobeta-Sarmizegetusa etc.).45
En ce qui concerne le nombre, la direction, le rôle et l’importance des routes passant par la grande plaine hongroise, le problème est très peu élucidé jusqu’ici, faute de données directement utilisables,46 et, abstraction faite des lignes Micia (Vecel = Vetel)-Szeged-Lugio (Dunaszekcsô) et Micia-Szeged-Acumincum (Slankemen)47, aucune voie de communication n’a pu encore être posée avec certitude. Pour le limes de la Pannonie Inférieure, la recherche a supposé, avec plus ou moins de probabilité, devant Aquincum, Intercisa et Lugio, des
30 Cf. Mocsy, Bevôlkerung, 96, 100 suiv., 103 suiv., Id., Pannonia tort. 71 suiv.; Dacie:V. Christescu, op. cit. 58 suiv.; E. Gren, op. cit., 79 suiv., 85 suiv.
37 Cf. Mocsy, op. cit., avec bibliogr.38 Cf. V. Christescu, op. cit.39 Pour les inscriptions des commerçants et décurions de Dacie, trouvées extra fines provinciae,
v. Christescu, op. cit., 119 suiv.40 V. Christescu, op. cit.41 V. Mocsy, Pannonia, col. 685, avec bibliogr.42 Mocsy, op. cit., col. 686 et notes 25, 26.43 V. Mocsy, Pannonia, 666 suiv.44 Cf. Christescu, op. cit., 100 suiv., et C. Putsch, op. cit., 165 suiv., note 6.43 V. le nom d'une station routière sur la section Dierna-Tibiscum: Ad Pannonios! CIL III p.
248 (Tab. Peut.). Pour le rôle de Dierna, v. C. Patsch, op. cit., 165 suiv., note 6 et AÉp. 1952.195.46 Cf. dernièrement Mocsy, Pannonia, col. 667, J. Fitz, Alba Regia 4-5 (1965) 81 suiv.47 Les résultats des fouilles au château fort de Szeged (dernièrement: Mocsy, Pannonia, col.
627, 667 et P. Lakatos, Ant. Tan. 12 [1965] 91 suiv.), ainsi que l’importance qu’on a le droit d’attribuer à la voie fluviale Maros-Tisza (cf. C. Patsch, op. cit., 138 suiv.) rendent presque certain quela liaison par ces routes existait pendant toute l’histoire de la Dacie.
75
routes partant vers des zones plus éloignées de la terre sarmate48, tandis que, à la frontière occidentale de la Dacie, Porolissum (Moigrad) et le camp d’auxiliares de Bologa (Sebesvâr- alja) pouvaient être de telles stations routières au Nord, ainsi que Micia près du Maros.49 La station frontière pannonienne du trafic fluvial sur le Maros et la Tisza, qu’on peut considérer comme certain malgré l’absence des données concrètes, ne pouvait être qu’Acumin- cum.50 On peut donc supposer, entre les deux provinces, une liaison directe à travers la grande plaine dans les quatre directions suivantes : par les lignes Aquincum-Porolissum, Intercisa- Bologa, Lugio-Szeged-Micia et Acumincum-Szeged-Micia. Ce sont la route Lugio-Sze- ged-Micia et la voie fluviale Maros-Tisza qui devaient avoir le plus d’importance au point de vue du rapport entre les deux provinces et du trafic commercial,61 tandis que les routes du Nord ne servaient le plus souvent qu’à l’armée.62
*
Enfin quelques mots sur une catégorie particulière des relations entre les provinces, appartenant à la vie spirituelle,63 notamment sur les ressemblances, que présente le culte de Sylvain en Pannonie et en Dacie, et sur les rapports qui les relient avec certitude dans ce domaine. Comme on sait, le culte du dieu des forêts, provenant de l’Italie ancienne, ou, pour mieux dire, le culte local, voué à un dieu de ce nom mais se rattachant au Pan grec et surtout à diverses divinités autochtones, eccupait une place éminente dans la vie religieuse de certaines provinces danubiennes, notamment de la Dalmatie et de la Pannonie, ainsi que de la
18 Cf. Môcsy, Pannonia, col. 667, et J. Fitz, op. cit. — Intercisa: L. Barkôczi, Intercisa, II. (Bp. 1957) p. 514, Id., Intercisa, I. (Bp. 1954) p. 36. — La colonie des commerçants de Sopianae pouvait avoir de l’importance au point de vue du trafic entre Lugio-Szeged-Micia (pour la route Szeged-Lugio: Môcsy, op. cit., col. 666); en revanche, le développement de ce trafic durant la première moité du II siècle (d’après les caractères, Alfôldi renvoie l’inscription de Szeged à l’époque d’Antonin le Pieux. Bp. T. [Bp. 1942] p. 191) pouvait influencer l’évolution de Sopianae qui prit de l’élan à ce moment-là. On peut supposer un rapport semblable entre la station frontière d'Inter- cisa et Gorsium.
49 Cf. C. Patsch, op. cit., 130 suiv., 140, 138 suiv., C. Daicoviciu, RE «Porolissum» col. 269, cf. les inscriptions trouvées à Carei, qui, d’après C. Daicoviciu, furent enlevées probablement de Mojgràd: Dacia 7-8 (1937-1940) 323: 1-3. On doit attribuer une importance particulière à l’inscription votive de [Fe]lix Aug. n. vil(icus) (probablement indentique avec CIL III 7853, Micia), qui renvoie à des stations douanières de Porolissum, cf. Vittinghoff, ,,Portorium” col. 368;/. Winkler, AMN 1 (1964) 215 suiv. On peut se demander cependant si les monuments de pierre mentionnés n’ont pas été trouvés à leur place originale: dans ce cas-là, à la place de Carei (Nagykâroly), il y eut une station de poste impériale (Ulpianum?) (cf. le fragment d’inscription de Szeged qui parle également d’un vilicus) — extra fines Daciae! C’est avec une telle station que J.Fitz (op. cit. p. 82) a mis en relation le sarcophage romain trouvé à Debrecen, cf. L. Balla, Arch. Ért. 89 (1962) p. 89. Bologa: M. Macrea, ACMITr 4 (1932-38) 450 suiv. — Micia: Fhtss, RE «Micia (1932) 1518 suiv.; C. Daicoviciu, ACMITr 1930, 2 suiv., Â. Dobô, Publicum portorium Illyrici. Diss. Pann. II 16. (Bp. 1940) p. 161, 169. Très caractéristique: CIL III 7853 (1351) = Dessau 1860=A. Dobô, op. cit. 179: 83: IOM terrae Dac(iae) et genio p. R. et commerci Felix Caes. n. se[r.] vil. etc. Cf. encore les inscriptions des Augustales de Sarmizegetusa à Micia: CIL III 1385; Dolgozatok 4 (1913) p. 260= C. Daicoviciu, op. cit. 39: 11. Le nombre remarquablement grand des inscriptions connues de Micia, tout comme les monuments de pierre des Augustales et des collèges de cérémonie funèbre soulignent sans équivoque l’importance de la agglomération qui est due surtout au trafic sur les rives du Maros.
50 Sur le camps situé à Acumincum, dernièrement: J. Fitz, Acta Arch. Hung. 14 (1962) 70suiv.
51 Cf. A. Alfôldi, Szâzadok 70 (1936) 154 suiv., et la note 47.52 Cf. C. Patsch, op. cit., 130 suiv.53 A propos des rapports de la taille de pierre en Pannonie avec la Dacie: A. Alfôldi, Szâzadok
70 (1936) 155 suiv.; C. Daicoviciu, Siebenbürgen im Altertum. 137. On trouve des données nouvelles dans A. Burger, FA 13 (1961) p. 58 (représentation de la lupa Capitolina en Dacie Supérieure).
76
Dacie.51 * * 54 En Dalmatie, la formule italique de Sylvain incarne, en dernière analyse, des idées religieuses illyriques,55 tandis qu’en Pannonie,56 le culte de ce Sylvain «interprété» comprenait non seulement les traditions illyriques mais intégrait encore la religiosité celtique, profondément ancrée dans la vie de larges territoires de la province.57 Donc, tant en Dalmatie qu’en Pannonie, le fond du culte de Sylvain réunissait, à une conception d’origine uniformément italique, la survivance de la tradition religieuse locale, c’est-à-dire illyrique et celtique. C’est par là que s’expliquent le plus facilement l’exceptionnelle expansion du culte dans ces provinces, le caractère de «Landesgott» de Sylvain (Domaszewski), ainsi que les traits particuliers qui nous autorisent à parler d’un «culte de Dalmatie» et d’un «culte de Pannonie» à part.58 Ce culte se présente autrement en Dacie59 : en effet, là, aucune particularité essentielle de la religion de Sylvain ne caractérise cette province exclusivement — par contre, à propos des aspects invoqués de cette divinité, on découvre une parenté frappante avec le culte d’Illyrie. Tout cela se comprend parfaitement si l’on considère, d’une part, le rapport étroit de Sylvain-Pan avec la tradition religieuse illyrique et celtique, et, d’autre part, le fait notoire que, dans les provinces à base ethnique thrace, l'interprétation «classique» de la religiosité locale ne s’est pas réalisée en premier lieu dans le culte de Sylvain mais dans celui d’autres divinités, ainsi de Liber-Dionysos ou d’Apollon et de Diane.60 Il a été supposé par A. v. Domaszewski déjà, dans une étude fondamentale, que la religion de Sylvain se répandit en Dacie à la suite d’une sorte d’«importation spirituelle»61, due au fait que la province fut peuplée d’habitants de la Dalmatie.62 Nous avons cependant vu que la population de la Dacie fut en partie fournie par la Pannonie, donc un autre territoire où le culte de Sylvain était très répandu: il ne peut donc pas être fortuit que ses aspects domesticus et silvestris, si souvent invoquées en Dacie, ne se retrouvent presque nulle part ailleurs, excepté dans le culte pan- nonien. En Pannonie, tout comme en Dacie, on le sait, la plupart des ex-voto offerts à Sylvain s’adressaient à la divinité «domestique, bienveillante».63 D ’ailleurs, ces inscriptions se localisent d’une manière, qui semble confirmer notre hypothèse : elles ont été trouvées sans exception en Dacie Supérieure et dans la Porolissensis, l'extension du culte coïnctd donc essentiellement avec les zones dont les rapports pannoniens peuvent être montrés, commq)'nous venons de le voir, avec le plus de vraisemblance. Il est remarquable encore que la mat) jorité des témoignages du culte de Sylvain ont été fournis par la région du Maros : Mic et
51 En résumant: A. V. Domaszewski, Abh. zur rom. Relig. Leipzig-Berlin 1909, 76 suiv.R. Peter, Myth. Lex. «Silvanus» 869 suiv. ; G. iVissowa, RuKdR2 München 1912, p. 215.
55 Cf. Domaszewski, op. cit. ; K. Kerényi, Magyar Nyelv 28 (1932) p. 287.50 Sur l’ensemble du culte pannonien: Môcsy, Pannonia, 741 suiv., avec bibliogr.57 Sur les rapports celtiques du culte, à propos de la Pannonie: G. Alfôldy, Ant. Tan. 7 (1960)
46 suiv., en général: P. Lambrechts, Contributions à l'étude des divinités celtiques. Brugge 1942,108 suiv., 167 suiv., 183 suiv.
58 Cf. le rassemblement des matériaux épigraphiques par Domaszewski, op. cit., 76 suiv., et Môcsy, Pannonia, op. cit. — Nous voudrions consacrer une étude à part aux problèmes du culte de Sylvain en Pannonie, et en particulier, aux rapports quîl présente avec la religiosité celtique.
50 En détail: I. Tôth, Acta Class. Debr. 3 (1967) 77 suiv., avec bibliogr.60 Liber: A. Boclor, Dacia NS 7 (1963) 211 suiv., Apollon et Diane: Todorov, Paganizmôt vô
Dolna Mizija. Sofia 1928, 57 suiv., 61 suiv. Cf. encore G. Kazarow, Die Denkmâler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien, Diss. Pann. IL 4. (Bp. 1928) 3 suiv.
61 Op. cit., p. 78, note 5.62 Sur le culte de Sylvain en Dacie en rapport avec la Dalmatie, en détail: I. Tôth, op. cit. 03 En Dacie, parmi les 75 inscriptions à peu près, s’adressant à Sylvain, 40 ont invoqué Silvanus
domesticus, cf. I. Tôth, op. cit., en Pannonie: Môcsy, op. cit. 742 suiv. — Au point de vue de tout l’Empire: R. Peter, op. cit. 849 suiv.
77
Apulum, ainsi que par la zone des mines d’or (Ampelum, Alburnus Maior), qui se trouvais en étroite liaison avec Apulum, et il n’est pas sans intérêt non plus qu’à Micia,où le culte connut une popularité frappante, Sylvain le domestique et Mercure furent invoqués deux fois ensemble: preuve d’un culte dont l’objet était un Sylvain protégeant l’activité commerciale.64 Tout cela rappelle notre attention aux rapports entre la Dacie et la Pannonie.05
« CIL III 7861, ACMITr 1929, 310:2, = ACMITr 1930, 38: 8. Sur l’autre face de ce dernier autel, on lit encore une inscription: Marti. Ala I Bosporfanorum) cui praest CI. Sosius pr[aef]
65 Naturellement, le culte de Sylvain pouvait avoir des traits locaux en Dacie aussi (cf. Todorov, op. cit., p. 51 suiv., et Kazarow, op. cit., p. 14, qui rapportent les témoignages du culte en Mésie Inférieure et le rattachent au culte, à racines locales, du héros thrace, ainsi que d’Apollon et de Diane; Sur ces monuments cependant, la divinité figure toujours avec l’adjectif sanctus). De toute façon, cela est probable dans le cas d’une divinité qui se rattache à un tel point à la réalité de tous les jours, du lieu, du paysage. Il paraît cependant incontestable que la forme sous laquelle se présente le culte de Sylvain en Dacie fut modelée, d’une manière décisive, par l’influence de la Pannonie et de la Dalmatie (cf. pour les détails, I. Toth, op. cit.).
78

























![Stoffer, subkultur og 1968: myte, bevidsthed, historie [Drugs, subcultures and 1968: myth, consciousness, history]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633abd3d3e7c0c2307022105/stoffer-subkultur-og-1968-myte-bevidsthed-historie-drugs-subcultures-and-1968.jpg)