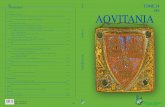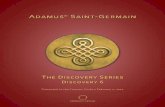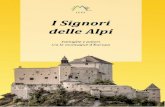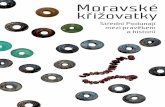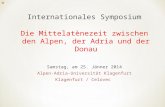La Tène, la collection Schwab (Bienne, Suisse), CAR, Lausanne 2013.
Videau G. 2006 : Un ensemble céramique de La Tène Finale à Saint-Germain-en-Montagne (Jura)
Transcript of Videau G. 2006 : Un ensemble céramique de La Tène Finale à Saint-Germain-en-Montagne (Jura)
173
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du xxixe colloque international de l’AFEAF ; Bienne, 5-8 mai 2005. Barral P., Daubigney A., Dunning C., Kaenel G., Roulière-Lambert M.-J. (éds.), Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006 (Annales Littéraires ; Série « Environnement, sociétés et archéologie »)
Un ensemble céramiqUe de la Tène finale à sainT-Germain-en-monTaGne (JUra)GréGory Videau*
Résumé
Le site de St-Germain-en-Montagne est connu pour être une agglomération antique. Son occupation (1er-4e siècle ap. J.-C.) et ses activités économiques sont directement liées au sanctuaire gallo-romain du Mont-Rivel tout proche. La découverte récente d’un ensemble céramique de La Tène finale tend à montrer que le site aurait une origine plus précoce à l’instar d’autres agglomérations antiques. Le caractère particulier que revêt cet ensemble (surreprésentation d’un même type de vase, crémation de la moitié des tessons) pourrait constituer un dépôt votif au sein d’un habitat ouvert gaulois. Mais l’absence de toute autre structure ne permet pas d’être catégorique sur la nature précise du site. Néanmoins, cette découverte a le mérite d’étoffer la documentation lacunaire concernant l’occupation du territoire séquane à La Tène finale.
Abstract
The site of St-Germain-en-Montagne is acknowledged as being an antique town. its settlement (1st - 4th century AD) and its economic activities are directly linked to the nearby Gallo-Roman sanctuary of Mont-Rivel. The recent discovery of a ceramic set dating from late La Tène tends to prove that the origin of the site could be more ancient, like some other antique towns. The particularities of this set (characterized by an over-representation of a same type of vase and the cremation of half the shards) could indicate that this was a votive deposit in an open Gallic settlement. But in the absence of any other structure, we cannot be adamant on the precise nature of this site. Nevertheless, this discovery contributed to enriching the incomplete documentation on the settlement of the Sequane territory in late La Tène.
1.1. L’agglomération secondaire antique
L’agglomération antique de Saint-Germain se situe au nord de la ville de Champagnole. Elle se trouve à environ 1 km du village actuel de Saint-Germain-en-Montagne, au pied du Mont Rivel sur lequel a été mis au jour un sanctuaire gallo-romain. Le site s’étend sur une surface de 4 ha, mais son emprise totale pourrait atteindre 20 ha (Rothé, 2001). Cette agglomération, connue sous le nom de Placentia (Rousset, 1855) est liée à plusieurs voies (dont une qui la reliait directement au Mont Rivel).
Elle a fait l’objet de plusieurs campagnes de fouilles successives entre 1966 et 1968, puis en 1991 et 1992. Des activités artisanales diverses (métallurgie, séchage et fumage de la viande) et agricoles, liées à un habitat, ont été mises en évidence. Toutefois, sa principale fonction semble se rattacher à l’accueil et au ravitaillement des voyageurs et des pèlerins qui se rendaient au Mont Rivel. L’occupation du site s’étend de la première moitié du Ier siècle à la fin du IVe siècle ap. J.-C. (Leng, 1990 a et b ; Leng, 1991 ; Rothé, 2001).
1. Présentation du site (Fig. 1 et 2)
* Laboratoire de Chrono-écologie, UMR 6565 CNRS, UFR Sciences et Techniques, 16 route de Gray, F-25030 Besançon [email protected]
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
174
1.2. une origine plus précoce
Ph. Barral souligne que nombre d’aggloméra-tions gallo-romaines se sont développées à partir d’un noyau plus précoce. Saint-Germain, comme d’autres sites jurassiens (Grozon et Lons-le-Saunier) (Rothé, 2001), illustre cette évolution.Les quelques potins gaulois présents, aussi bien sur le site de Saint-Germain qu’au Mont Rivel (sanctuaire gallo-romain proche qui pourrait, lui aussi, avoir une origine gauloise), sont autant d’indices qui vont dans le sens d’une occupation gauloise antérieure. La découverte, il y a peu, d’un ensemble céramique de La Tène finale lors d’un tri du matériel céramique d’une des quatre caves de Saint-Germain fouillées lors de la campagne 1991 (Leng, 1991), est un argument de plus à l’appui de cette hypothèse.
Fig. 1 : Localisation et situation de Saint-Germain par rapport aux principaux habitats de La Tène finale de l’est de la Gaule.
Fig. 2 : Localisation de Saint-Germain.
2. Le matérieL de La cave 403 (Fig. 3 à 5)
Prélevé comme un seul ensemble stratigraphique, la céramique gauloise se trouve mêlée à du maté-riel gallo-romain (une dizaine d’individus, soit 177 fragments pour 2 kg) provenant probablement d’une couche supérieure non discernée lors de la fouille. Ces tessons, fragments de cruche impor-
tée en pâte claire, de sigillée, de métallescente, de paroi fine et de plat à engobe rouge interne, appar-tiennent à la période du Ier-IIe siècle ap. J.-C.Si l’on excepte la présence intrusive de tessons gallo-romains, il est évident que nous sommes en présence des matériaux les plus précoces du site. Le
Videau G. - Un ensemble céramique de La Tène finale à Saint-Germain-en-Montagne (Jura)
175
Fig. 3 : Planche céramique. Saint-Germain- en-Montagne, cave 403, contexte LT C2-D1 : 1-11 : vases bouteilles en céramique tournée fine claire peinte.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
176
Fig. 4 : Planche céramique. Saint-Germain-en-Montagne, cave 403, contexte LT C2-D1 ; 12-14 : vases tonnelets en céramique tournée fine claire peinte ; 15-18 : écuelles carénées en céramique tournée fine claire peinte ; 19-24 : vases bouteilles en céramique tournée fine claire peinte / non peinte.
Videau G. - Un ensemble céramique de La Tène finale à Saint-Germain-en-Montagne (Jura)
177
matériel, d’une homogénéité remarquable, compte 97 individus et 2 543 fragments pour un poids légè-rement supérieur à 25 kg. Fait remarquable, envi-ron la moitié de ces tessons portent des traces de surcuisson qui se caractérisent par des variations de teintes et des déformations. Si aucun élément ne permet de rattacher cet ensemble à un contexte précis, l’étude céramologique permet néanmoins de distinguer un ensemble cohérent attribuable à La Tène D1.
2.1. description du matériel
Les importations sont quasi inexistantes. La céra-mique importée à vernis noir ou à pâte claire est totalement absente. Les amphores peu nombreu-ses (Leng, 1991), attribuables au type Dressel 1, représentent seulement deux individus (référence orale S. Humbert).La céramique indigène se divise en deux grandes catégories techniques : la céramique tournée fine (ou de présentation) et la céramique non tournée (ou à usage utilitaire / culinaire). Cette dernière (3 % des ind.) se caractérise par une pâte claire à dégraissant siliceux. Son répertoire est composé de formes classiques : jattes/écuelles à bord rentrant et pots qui peuvent porter un décor peigné (Fig. 5, n° 35-37).La céramique tournée se décline en plusieurs sous- catégories caractérisées par le mode de cuisson. La céramique tournée fine grise, noire à pâte rouge et fine sombre est peu représentée avec respecti-vement 1, 4 et 4 % des individus. Le répertoire de la céramique fine grise et noire à pâte rouge est uniquement constitué de bols hémisphériques (Fig. 5, n° 32-33). La céramique tournée fine som-bre se distingue par un répertoire plus varié allant de l’écuelle à bord rentrant au pot à lèvre éversée (Fig. 5, n° 34) en passant par le bol hémisphérique.La céramique tournée fine à pâte claire rassem-ble la presque totalité du matériel (88 % des indi-vidus). De couleur beige/orange, elle peut avoir une surface brute ou peinte. Le vaisselier se com-pose majoritairement de bouteilles (68 ind., Fig. 3,
n° 1-11, Fig. 2, n° 20-24, Fig. 4, 25-31), qui se décli-nent en plusieurs modules et variantes (lèvres éversées arrondies, trapézoïdales ou effilées, fond en couronne avec un bourrelet d’une épaisseur variable ou pied épaté (Fig. 2, n° 19), épaulement plus ou moins large), et de quelques tonnelets peints (6 ind., Fig. 4, n° 12-14). Le décor de ces vases peints s’organise le plus souvent en une alternance de bandes blanches et rouges (parfois lie de vin). Cette disposition du décor est bien connue sur les vases similaires de Besançon (Videau, 2001) et ceux de la vallée de la Saône (Barral, 1992, Barral, 1994 a) à LT D1. Certains vases à liquide possè-dent, en plus de leur décor peint, un décor verti-cal exécuté à la pointe sèche (Fig. 3, n° 4-5, Fig. 4, n° 13 et 21). Enfin, dix écuelles carénées à lèvre éversée (Fig. 4, n° 15-18) complètent le répertoire. Toutes peintes, leur décor s’ordonne toujours de la même manière (partie supérieure peinte en blanc et partie inférieure peinte en rouge) sauf pour un individu [Fig. 4 n° 15]. Nous pouvons rapprocher ces écuelles de types similaires présents à Bâle Gasfabrik (Furger-Gunti et Berger, 1980), à Verdun- sur-le-Doubs (Barral, 1989) et à Nitry (Nouvel et Champeaux, 2002) que l’on retrouve en contextes précoces (LT C2 pour Nitry et LT D1 pour Bâle et Verdun).
2.2. datation de l’ensemble
La datation de cet ensemble repose uniquement sur la vaisselle indigène. Les bouteilles et les ton-nelets sont sans conteste attribuables à un faciès La Tène D. Mais ce sont leurs décors aux codes de couleur « standardisés », similaires aux ensembles de La Tène D1 voisins (Besançon, Verdun-sur-le-Doubs pour ne citer que quelques exemples), qui affinent la datation de cet ensemble. Les écuelles carénées peintes, formes relativement précoces, confirment cette datation et permettent de propo-ser une fourchette chronologique, pour cet ensem-ble, comprise entre la transition LT C2-D1a et la fin de LT D1b.
3. un déPôt votiF ?L’ensemble, constitué d’un répertoire peu varié, est très homogène. Sa composition très particulière montre clairement que nous sommes en présence d’une sélection effectuée au sein de la vaisselle domestique utilisée au cours de la deuxième moi-tié du IIe siècle av. n. è. Elle se caractérise par une faible représentation de la céramique non tournée (à usage utilitaire ou culinaire) et se distingue par une concentration inhabituelle des vases de pré-sentation, illustrés majoritairement par les vases
à liquide (bouteilles, tonnelets). Ces traits particu-liers présentent de nombreuses similitudes avec la fosse 1182 du sanctuaire celtique des Bolards à Nuit-Saint-Georges (Barral et Guillaumet, 2001). En comparant les deux ensembles (Fig. 6), on observe le même phénomène de sélection privilégiant la vaisselle de présentation au détriment de la vais-selle utilitaire ou culinaire. On remarque égale-ment que les vases du sanctuaire des Bolards ont subit une cuisson secondaire avant leur enfouisse-
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
178
Fig. 5 : Planche céramique. Saint-Germain-en-Montagne, cave 403, contexte LT C2-D1 ; 25-31 : vases bouteilles en céramique tournée fine claire peinte / non peinte ; 32-33 : bols hémisphériques en cérami-que tournée fine noire à pâte rouge ; 34 : pot en céramique tournée fine grise ; 35-36 : pot en céramique non tournée grossière claire ; 37 : écuel-le en céramique non tournée grossière claire.
Videau G. - Un ensemble céramique de La Tène finale à Saint-Germain-en-Montagne (Jura)
179
ment comme à peu près la moitié des tessons de Saint-Germain. La crémation de la céramique sem-ble être une constante sur les sanctuaires à une époque précoce comme on peut le voir également à Nitry (Nouvel et Champeaux, 2002). Cette pratique intentionnelle est généralement interprétée comme les restes visibles d’un rituel de destruction et de mutilation des offrandes (Barral et Guillaumet, 2001). Sans parler de sanctuaire dans le cas de Saint-Germain, l’hypothèse d’un dépôt privilé-gié doit être envisagée. Les pratiques relevées à Saint-Germain, très proches de celles observées aux Bolards, permettent d’interpréter cet ensem-
ble comme un dépôt à caractère cultuel à l’instar de la fosse 1182. Toutefois, le caractère particulier de cet ensemble ne permet pas de statuer sur la nature précise du site de Saint-Germain puisqu’il ne se rattache à aucune autre structure gauloise. Néanmoins, l’éventualité d’un dépôt privilégié au sein d’un habitat ouvert semble la plus probable si on considère que l’agglomération secondaire anti-que est la persistance d’un habitat plus précoce. En attendant des informations plus récentes et plus précises, cette découverte ponctuelle a au moins le mérite d’étoffer les connaissances acquises sur l’oc-cupation du territoire séquane à La Tène finale.
Figure 6 : Comparaison des ensembles céramiques de La Tène finale de l’habitat de Saint-Germain-en-Montagne et du sanctuaire celtique des Bolards à Nuits-Saint-Georges.
Fig. 6 : Comparaison des ensembles céramiques de La Tène finale de l’habitat de Saint-Germain-en-Montagne et du sanctuaire celtique des Bolards à Nuits-Saint-Georges.
Figure 6 : Comparaison des ensembles céramiques de La Tène finale de l’habitat de Saint-Germain-en-Montagne et du sanctuaire celtique des Bolards à Nuits-Saint-Georges.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
180
Barral, 1989 : BARRAL (Ph.). - Approche d’une étude de la céramique gauloise dans la moyenne vallée de la Saône : le matériel du Petit-Chauvort (Verdun-sur-le-Doubs), mémoire de DEA, Besançon, Université de Franche-Comté, 1989, 118 p.
Barral, 1992 : BARRAL (Ph.). - Note sur la céramique indigène de La Tène finale dans la vallée de la Saône. in : KAENEL (G.), CURDY (Ph.) éds. - L’Age du Fer dans le Jura, actes du xVe colloque de l’AFEAF (Pontarlier-Yverdon, mai 1991), Lausanne, 1992, p. 271-278 (Cahiers d’Archéologie Romande, 57).
Barral, 1994 a : BARRAL (Ph.). - Céramique indigène et faciès culturel dans la vallée de la Saône, thèse de doctorat, Besançon, Université de Franche-Comté, 1994, 3 vol.
Barral et Guillaumet, 2001 : BARRAL (Ph.), GUILLAUMET (J.-P.). - La céramique de La Tène finale (fosse 1182 et niveaux précoces). in : POMMERET (C.) dir. - Le sanctuaire antique des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or). Dijon : Revue Archéologique de l’Est (16 e supplément), 2001, p. 309-326.
Furger-Gunti et Berger, 1980 : FURGER-GUNTI (A.), BERGER (L.). - Katalog und Tafeln der Funde aus der spätkelteische Siedlung Basel-Gasfabrik. Derendingen-Solothurn, Habegger Verlag, 1980.
Leng, 1990 a : LENG (F.). - Mont Rivel : site gallo-romain en Franche-Comté. Édition de la Taillanderie, 1990, 256 p.
Leng, 1990 b : LENG (F.). - L’agglomération gallo-romaine du Mont Rivel à Équevillon (Jura). Revue Archéologique de l’Est., CNRS, 41, fasc. 1, n° 157, 1990, p. 69-82.
Leng, 1991 : LENG (F.). - Saint Germain-en-Montagne (Jura). Rapport de fouille archéologique programmée, Besançon, SRA, Franche-Comté, 1991.
Nouvel et Champeaux, 2002 : NOUVEL (P.), CHAMPEAUX (D.). - Le sanctuaire rural d’origine laténienne de Nitry Champagne (Yonne). Rapport de fouille archéologique programmée, Dijon, SRA, Bourgogne, 2002, 80 p.
Rothé, 2001 : ROTHÉ (M.-P.) et coll. - Le Jura. Volume de la Carte Archéologique de la Gaule (collection dirigée par M. Provost), 39, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2001.
Rousset, 1855 : ROUSSET (A.). - Dictionnaire géographique, historique et statistique des communes de la Franche-Comté et des hameaux qui en dépendent, classés par département. Département du Jura, vol. 3, 1855.
Videau, 2001 : VIDEAU (G.). - La céramique de La Tène finale du site du Palais de Justice à Besançon (Doubs). Analyse typo-chronologique et culturelle, mémoire de DEA, Besançon, Université de Franche-Comté, 2001, 171 p.
BiBLiograPhie