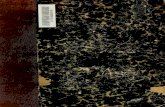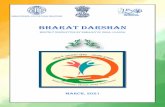Vamos Construir!: Revendications Foncières et Géographie du Pouvoir à Luanda, Angola
-
Upload
johannesburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Vamos Construir!: Revendications Foncières et Géographie du Pouvoir à Luanda, Angola
« VAMOS CONSTRUIR ! » : REVENDICATIONS FONCIÈRES ETGÉOGRAPHIE DU POUVOIR À LUANDA, ANGOLA Claudia Gastrow Editions Karthala | Politique africaine 2013/4 - N° 132pages 49 à 72
ISSN 0244-7827
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2013-4-page-49.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastrow Claudia, « « Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda, Angola »,
Politique africaine, 2013/4 N° 132, p. 49-72. DOI : 10.3917/polaf.132.0049
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Editions Karthala.
© Editions Karthala. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine n° 132 - décembre 2013
49
Claudia Gastrow
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda, Angola
Cet article se penche sur les questions de propriété, de citoyenneté et d’autorité de l’État à Luanda. Il étudie la façon dont les victimes de démolitions urbaines, en essayant d’obtenir compensation pour la perte de leur propriété, remettent en cause des formes établies de relations entre État et citoyens. L’auteure avance que la croyance dans le pouvoir du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) a conduit de nombreuses victimes de démolitions à s’en éloigner précisément parce qu’elles le considéraient comme responsable de leurs malheurs. En prenant comme point de départ une réflexion sur l’autorité de l’État constituée de façon dialogique par la reconnaissance mutuelle entre État et citoyens, l’article montre comment les victimes de démolitions ont essayé de déplacer leur quête de reconnaissance endehors de la sphère du parti vers d’autres sphères que sont la loi et l’esthétique urbaine. Ce faisant, elles offrent une alternative au type de relations politiques qui sont à la base du pouvoir du MPLA, contribuant à l’érosion de son hégémonie.
Par une matinée chaude et orageuse de novembre, je prends part à une conférence de presse organisée par des victimes de démolitions à Luanda 1. En bas de la colline où les organisateurs ont installé quelques rangées de chaises en plastique blanc pour accueillir l’auditoire, les ruines de maisons en briques surmontées de taules de fer ondulées ponctuent le paysage. La conférence a lieu à proximité des campements où les victimes se sont réinstallées afin de sensibiliser le public à la dure réalité de leur condition actuelle. Les paroles anti-régime d’un groupe de hip-hop contestataire retentissent dans l’air
1. Il m’a été possible de collecter les données nécessaires à la rédaction de cet article grâce au généreux soutien de la National Science Foundation Doctoral Dissertation Improvement Grant, de la Social Science Research Foundation International Dissertation Research Fellowship et de la fondation Andrew W. Mellon, ainsi qu’à l’obtention de la Wenner-Gren Foundation Doctoral Fieldwork Grant. Je tiens également à remercier le Centro de Estudos e Investigação Cientifica (CEIC) de l’Université catholique d’Angola pour son soutien institutionnel et la richesse des discussions académiques que j’ai pu avoir lors de mon terrain à Luanda. Un grand merci aux relecteurs anonymes de Politique africaine dont les commentaires et les suggestions ont beaucoup apporté à cet article.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes50
pendant que des représentants de la communauté, des membres de Housing Now 2, des journalistes et des sympathisants à la cause prennent place.
Après avoir donné la parole à un homme pour qu’il partage son expérience personnelle avec l’assemblée, Bernardo, le directeur de Housing Now, reprend le micro et s’adresse au public avec fougue : « Est ce déjà arrivé que New Hori-zons 3 ou le gouvernement provincial se déplacent jusqu’ici pour s’adresser à vous ? ». La foule gronde « Non » d’une seule voix. « S’ils ne mettent pas de logement à votre disposition et s’ils ne vous informent pas que vous devez quitter cette zone [afin d’être relogés], nous les poursuivrons en justice! », hurle Bernardo. Au moment où les derniers mots parviennent aux spectateurs, un vieil homme s’exclame depuis les derniers rangs : « Allons construire ! » (Vamos construir !). Dans le contexte de Luanda, où les démolitions perpétrées par l’État et la nouvelle législation ont transformé l’autoconstruction 4 en une transgression urbaine, le commentaire de ce vieil homme provoque des rires nerveux au sein de l’auditoire. L’analyse croisée de ces deux déclarations permet de mettre en lumière l’émergence de nouvelles façons de se positionner dans la relation avec l’État angolais. Nées sur les ruines des démolitions orchestrées par les autorités publiques, ces nouvelles stratégies s’écartent de la logique existante de clientélisme de parti.
Depuis la fin de la guerre civile en Angola (19752002), l’accès au logement est devenu un enjeu de luttes. Après le conflit, le secteur du bâtiment a connu un important essor qui s’est traduit par des investissements publics et privés dans la construction d’infrastructures et dans le secteur immobilier. Ceci a radicalement transformé l’apparence esthétique de Luanda ainsi que la démographie et la géographie de la ville 5. Comme c’est souvent le cas,
2. J’utilise des pseudonymes pour désigner les personnes, les entreprises, les lieux, les organisations de la société civile et les ONG que j’ai rencontrés. Housing Now est un groupe de la société civile formé par d’anciennes victimes des démolitions ; ses membres accompagnent aujourd’hui les habitants menacés par ces démolitions dans leurs démarches pour l’obtention de dommages et intérêts.3. New Horizons est le consortium privé chargé de la gestion de Casas do Sol, le complexe d’habi-tation dont l’expansion a été la raison de la démolition des Bairros 1, 2, 3 et 4.4. J’utilise le terme d’« autoconstruction » au sens de James Holston, « Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries », City and Society, vol. 21, n° 2, 2009, p. 245-267. Il s’agit de désigner les habitants de zones périurbaines qui ont construit leurs maisons sans avoir été guidés dans ce processus ou sans avoir obtenu l’autorisation préalable des autorités publiques. Il ne faut pas confondre ce terme avec l’idée d’« autoconstruction dirigée » (auto-construção dirigida) qui fait référence à une politique du logement populaire (mais inefficace) menée par l’État angolais depuis l’Indépendance. En théorie, cette dernière prévoit que l’État met à disposition des individus et des communautés prêts à construire leur maison des lots clairement délimités, des kits de construction ainsi que des plans et des experts. 5. M. Power, « Angola 2025 : The Future of the “World’s Richest Poor Country” as Seen Through a Chinese Rear-View Mirror », Antipode, vol. 44, n° 3, 2012, p. 993-1014 ; C. U. Rodrigues, « Angolan Cities : Urban (Re)Segregation », in F. Locatelli et P. Nugent (dir.), African Cities : Competing Claims on Urban Space, Leiden, Brill, 2009, p. 37-53.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda51
la multiplication des démolitions et des évictions forcées constituent le revers de la médaille de la réhabilitation urbaine 6. Il n’existe pas de rapport officiel permettant de chiffrer ces évictions et il est d’autant plus difficile d’évaluer leur nombre qu’elles ont été réalisées selon des procédures diverses par le gou-vernement provincial, le gouvernement central ou des compagnies privées. Au moment où j’effectuais ma recherche à Luanda, Housing Now s’occupait activement de quatorze communautés victimes d’expropriation. Zango, la plus grande zone de relogement de Luanda, accueillerait pas moins de 200 000 per-sonnes ayant fait l’objet d’une mesure de relogement depuis sa création en 2001 7, un nombre inconnu d’autres personnes ayant été livrées à elles-mêmes suite à cette vague de démolitions. Les victimes de ces dernières les vivent comme la matérialisation concrète du peu d’intérêt que leur porte l’État, alors même qu’elles sont censées passer par la voie officielle afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété et à terme, être dédommagées.
Pourtant Christian Lund souligne dans l’introduction de ce dossier qu’« au - cune institution porteuse d’une autorité publique ne contrôle pleinement la propriété et la citoyenneté ; plutôt, c’est une multitude d’insti tutions qui rivalisent entre elles à propos de leur compétence et de leur auto rité ». La nature dialogique de cette recon naissance – les institutions détiennent le pouvoir parce qu’elles disposent d’un certain statut, mais également parce que leur autorité découle de la légitimité de leurs actions aux yeux de la population 8 – signifie que même en Angola, où l’État est souvent décrit à la fois comme omniprésent et inefficace, un espace de négociation subsiste. Alors même que sur le terrain la plupart de mes interlocuteurs considèrent que la reconnaissance de l’État est une condition sine qua non pour l’avancée de leurs revendications, la façon dont l’État traite ces demandes est en réalité loin d’être uniforme. Dans cet article, je cherche à comprendre comment les victimes de démolitions, en mobilisant des discours multiples et en négociant (parfois de façon contradictoire) avec des institutions sous la tutelle de l’État angolais, donnent à penser l’État dans la complexité de ses formes. En agissant de la sorte, ces victimes s’éloignent inconsciemment du fonctionnement clien- téliste traditionnellement associé à la politique angolaise en adoptant un comportement politique basé sur une vision citoyenne du rapport à l’État.
6. Pour mieux saisir la relation qui existe entre les projets de réhabilitation urbaine et les évictions forcées, voir l’article de D. Koenig, « Urban Relocation and Resettlement : Distinctive Problems, Distinctive Opportunities », in A. Oliver-Smith (dir.), Development and Dispossession : The Crisis of Forced Displacement and Resettlement, Santa Fe, School for Advanced Research Press, 2009, p. 119-139.7. Entretien mené avec un représentant de l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht, Luanda, 23 juillet 2012.8. C. Lund, « Property and Citizenship. Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa », Africa Spectrum, vol. 46, n° 3, 2011, p. 1-3.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes52
Les travaux portant sur l’Angola mettent en avant la forte centralisation du pouvoir politique dans le pays. Cette centralisation est généralement décrite comme un héritage du passé, conséquence d’une confusion entre l’État et le parti au pouvoir, le MPLA (Mouvement populaire de libération de l’Angola), et des pouvoirs conséquents dont a historiquement joui le président 9. La violence et le clientélisme constituent des menaces inhérentes à ce système, mais la cooptation a souvent été considérée comme la méthode favorite du MPLA pour faire face à la critique 10. Pourtant, aucune hégémonie ne peut être absolue. Christine Messiant, même si elle décrit sans concession les méca-nismes démocratiques utilisés par le MPLA afin de renforcer son pouvoir, note qu’il « est important de souligner que le régime ne peut plus unifier le pays sur la base d’un discours idéologique […]. Personne ne croira un seul instant que l’oligarchie qui domine actuellement va évoluer vers un modèle de dévelop-pement qui aboutira […] au «progrès» 11 ». La vague de manifestations urbaines qui a vu le jour en 2011 était l’expression d’une variété de mécontentements allant du non-paiement des pensions d’anciens combattants à un ressen- timent général à l’égard de la longévité du mandat du président qui entamait alors sa 33e année à la tête du pays 12.
Alors que cette franche opposition au pouvoir en place semble ouvrir la voie à un renouveau politique, il est important de garder à l’esprit que des formes plus subtiles de « citoyenneté insurgée 13 » se mettent en place. Achille Mbembe soutient depuis longtemps l’idée que les signes de l’autoritarisme dans les anciennes colonies sont fondamentalement instables. Le peuple retravaille souvent les discours du pouvoir d’une façon qui déstabilise les régimes, même si le recours à ces signes inscrit ceux qui en sont les auteurs dans la logique du pouvoir. Il peut donc y avoir reconfiguration du sens du pouvoir, même si celle-ci suppose la complicité de la population 14. Il ne faut donc pas penser ces actions comme des « formes de résistance » au pouvoir
9. C. Messiant, « The Mutation of Hegemonic Domination », in P. Chabal et N. Vidal (dir.), Angola : The Weight of History, New York, Columbia University Press, 2007, p. 93-123 ; C. Roque, « Angola’s Façade Democracy », Journal of Democracy, vol. 20, n° 4, 2009, p. 137-150 ; P. C.-J. Faria, The Post-War Angola : Public Sphere, Political Regime, and Democracy, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2013.10. J. Schubert, « “Democratisation” and the Consolidation of Political Authority in Post War Angola », Journal of Southern African Studies, vol. 36, n° 3, 2010, p. 657-672.11. C. Messiant, « The Mutation of Hegemonic… », art. cit., p. 120.12. R. Marques de Morais, « Alternating Demonstrations : Political Protest and the Government Response in Angola », The Fletcher Forum of World Affairs, vol. 36, n° 2, 2012, p. 57-78.13. J. Holston, « Insurgent Citizenship… », art. cit., p. 1-2.14. A. Mbembe, « The Aesthetics of Vulgarity », in A. Mbembe, On the Postcolony, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 102-141.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda53
en place, mais comme une redéfinition subtile des relations qui existent entre les gouvernants et les gouvernés.
Cet article s’intéresse à la mobilisation de discours de reconnaissance alternatifs par les victimes de démolitions à Luanda et, plus largement, à la reconfiguration de l’expression du pouvoir politique en Angola. La thèse proposée est la suivante : suite à la démolition de leur logement, les habitants de Luanda s’appuient sur des arguments légalistes et esthétiques pour obtenir une indemnisation. Ils se soustraient à l’emprise du parti en manipulant les discours officiels afin d’adresser leurs requêtes à plusieurs sphères de compétence. En agissant ainsi, les plaignants réinventent les conditions de leur reconnaissance ainsi que le rôle des institutions en mesure de leur accorder cette reconnaissance. Même s’ils ne défient pas directement l’État dans la rue, leurs actions quotidiennes émoussent les contours de son hégémonie.
Afin de comprendre les processus par lesquels les revendications pour l’accès à la propriété entraînent une reconfiguration du pouvoir politique à Luanda, j’ai choisi de centrer mon analyse sur l’histoire d’un groupe de victimes de démolitions : les habitants de Bairro (quartier) 1 et des quartiers voisins de Bairro 2 et Bairro 3. Ces habitants négocient les conditions de leur relogement depuis 2004, leurs maisons ayant été détruites à la fin de la guerre civile pour laisser place au développement du premier et principal projet immobilier financé par l’État, Casas do Sol. Pour se faire entendre, ils ont mis en place de puissantes stratégies s’appuyant sur leurs connexions avec le parti, l’élaboration de discours légalistes et la mise en avant de critères d’esthétique urbaine. Ces stratégies ont porté leurs fruits puisqu’en juin 2013, de nouveaux logements ont été attribués aux habitants de Bairro 3. Dans un premier temps, je m’attacherai à la question des terres et du logement à Luanda afin de replacer les trajectoires des habitants de ces quartiers et les actions qu’ils mettent en place dans un contexte précis. Dans un deuxième temps j’aborderai, selon une perspective historique, les tentatives de reconnaissance et de dédommagement successives des victimes des démolitions ainsi que les diverses manières dont elles détournent les discours officiels dans leur quête de reconnaissance, ce qui permettra d’identifier les différentes formes du pouvoir de l’État qu’elles mobilisent afin de servir leur cause 15.
15. Cet article se base sur une mission de recherche de huit mois à Luanda entre mars 2011 et septembre 2012, et sur les informations récoltées lors d’un terrain complémentaire de six semaines mené entre juillet et août 2013. Si je n’ai résidé ni à Bairro 1 ni dans les quartiers voisins de Bairro 2 et Bairro 3, j’ai passé beaucoup de temps avec les habitants de ces quartiers. J’ai également assisté aux réunions qui ont eu lieu au sein de la communauté, notamment celles avec Housing Now, et à des conférences de presse. J’ai mené là des entretiens collectifs et individuels auxquels s’ajoutent les interviews que j’ai pu faire avec des victimes de démolition originaires d’autres quartiers de Luanda,
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes54
Propriété et logement dans la reconstruction de l’Angola
d’après-guerre
L’Angola a connu durant 27 années (1975-2002) une guerre civile qui opposa le MPLA et l’Unita (Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola) et prit fin brutalement avec la mort de Jonas Savimbi, leader de l’Unita. Dans un premier temps, les confrontations les plus violentes eurent lieu à l’intérieur du pays, entraînant l’exode massif d’Angolais fuyant le conflit vers les villes de la côte. Ajouté à la croissance démographique naturelle, ce mouvement de population provoqua une explosion démographique à Luanda. Selon les estimations 16, la population de la ville est passée de 480 613 à 3 276 991 d’habi-tants entre 1970 et 2000. Cette croissance s’est accompagnée d’un effondrement des infrastructures urbaines et de l’expansion rapide, tout particulièrement dans les années 1990, des quartiers dits « informels » (communément appelés musseques).
Pour les habitants de ces quartiers, aujourd’hui dans une situation précaire en raison de l’opacité qui a entouré les modalités d’attribution des terres, être propriétaire d’une maison constitue une étape incontournable de leur inté-gration à la ville. En effet, les protocoles pour l’inscription administrative des terres n’étaient pas monnaie courante au lendemain de l’Indépendance. Bien que des mesures de régulation furent mises en place dans les années qui suivirent, les conditions à réunir pour déclarer une propriété étaient coûteuses tandis que la validation des dossiers pouvait prendre des années. Cela n’empêcha pas la ville de s’étendre grâce à des négociations ad hoc, permettant aux habitants d’obtenir un terrain sans passer par une procédure légale d’enregistrement de leur titre de propriété 17. Durant les premières années qui suivirent l’Indépendance, la population était autorisée à s’installer sur des terres situées en périphérie de la ville 18. Les membres d’une même famille cédaient parfois une partie de leur terrain à leurs proches ou se portaient garants afin de leur garantir un accès préférentiel aux terres disponibles dans le quartier. En parallèle de ces pratiques, le marché foncier était dynamique. Plusieurs de mes informateurs m’ont expliqué que par le passé, il suffisait d’écumer la ville pour rencontrer une personne désirant vendre sa terre. Dans des zones périphériques, cela revenait à acheter la terre d’un paysan ou d’un
ainsi qu’avec les représentants des associations pour les droits de l’homme et les représentants officiels de l’État sur la question des démolitions et de la réhabilitation urbaine.16. C.-M. Lopes, F. Amado et R. Muanamoha, « Dinâmicas populacionais em Luanda e Maputo », in J. Oppenheimer et I. Raposo, Subúrbios de Luanda e Maputo, Lisboa, Edições Colibri, 2007, p. 37-64.17. P. Robson et S. Roque, Aqui na Cidade nada sobre para Ajudar : Buscando Solidariedade e Acção Colectiva em Bairros Peri-Urbanos de Angola, Luanda, Development Workshop, 2001.18. Ibid., p. 61.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda55
fermier (camponese). Dans des zones plus proches du centre-ville, les comités de quartier (comissões de moradores) – unités informelles en charge de la gou-vernance locale et bien souvent (mais pas exclusivement) proches du MPLA – prenaient également part à la transaction qu’elles étaient en charge d’ap-prouver 19. Une fois le terrain acheté, une petite annexe (annexo) faite de taule ondulée était généralement érigée afin d’indiquer que la transaction avait eu lieu : le terrain était dorénavant la propriété officielle de l’acheteur.
Ces transactions valaient comme titre de propriété aux yeux des habitants de ces quartiers bien qu’elles aient lieu en dehors du cadre imposé par la loi angolaise. La reconnaissance accordée à ces ventes était possible parce qu’elles étaient en général encadrées par les comités de quartiers et qu’aucune insti-tution étatique n’intervenait pour prévenir la construction de nouveaux logements. Nombre d’habitants interprétaient ce silence comme une auto-risation tacite leur permettant d’occuper ces parcelles et, a fortiori, la reconnais-sance de leurs droits de propriété. Le détour par l’histoire des stratégies d’occupation de terres à Luanda nous éclaire sur les raisons pour lesquelles, aujourd’hui, la plupart des Luandais ne possède pas de titres de propriété 20. L’absence d’un enregistrement formel des titres de propriété auprès de l’administration locale constitue à présent une source de vulnérabilité dans le système politique angolais.
À Luanda, la fin de la guerre civile s’est accompagnée d’une augmentation sans précédent des investissements publics et privés dans le secteur du bâtiment. Le gouvernement, qui s’appuyait sur des fonds émanant de crédits liés à ses actifs pétroliers, a initié un vaste programme de reconstruction nationale afin de rénover les infrastructures du pays en déliquescence. Ce projet comportait également des mesures concernant la reconstruction des réseaux de transport en Angola, la réhabilitation des infrastructures urbaines et un ambitieux plan d’expansion urbaine pour la capitale 21. Cependant, ces projets n’ont pu être réalisés qu’à travers l’éviction forcée de centaines de
19. Le nom ainsi que le statut officiel de ces comités ont changé au cours des années. Les habitants s’accordent néanmoins sur le fait que ces entités ont été impliquées depuis longtemps dans la répartition et la vente de terrains. Alors que je menais ma recherche à Luanda, je n’ai pas constaté que les autorités traditionnelles aient une influence importante dans ces quartiers. Le rôle joué par le seul soba (chef coutumier) mentionné par mes informateurs est sujet à controverse. En général, les habitants que j’ai interrogés se réfèrent aux comités de quartiers pour l’obtention de documents et la résolution de conflits locaux, mais ce constat n’est valable que pour les zones que j’ai étudiées.20. A. Cain, « Housing Microfinance in Post-conflict Angola : Overcoming Socioeconomic Exclusion through Land Tenure and Access Credit », Environment and Urbanisation, 2007, vol. 19, n° 2, p. 361-390.21. S. Croese, « 1 Million Houses ? Angola’s National Reconstruction and Chinese and Brazilian Engagement », in Emerging Powers in Africa Initiative, Strengthening Civil Society Perspective. Series II : China and Other Emerging Powers in Africa., Cape Town/Fahamu, 2011, p. 7-27.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes56
milliers d’Angolais, tout particulièrement à Luanda. En ce sens, reconstruction et démolition sont deux processus intimement liés, la fin de la guerre ayant accentué les menaces de démolition qui pèsent sur les habitants de Luanda 22. La législation angolaise établit explicitement ce lien dans un décret du 13 avril 2007 qui statue sur le Programme pour le Relogement de la Population (Programa de Realojamento da População). Le décret indique clairement que ce programme a été créé afin de coordonner le relogement des personnes déplacées au profit de projets de construction du gouvernement central 23. Par conséquent, l’attribution d’un logement aux populations les plus démunies semble une conséquence directe de la destruction de leur habitation. Nombre d’entre elles ont pourtant subi ces démolitions sans avoir fait l’objet d’une procédure de relogement. Des habitants, persuadés que leur droit de propriété avait été préservé pendant des décennies, se retrouvent aujourd’hui forcés de quitter des terrains constructibles ayant acquis une valeur immobilière certaine, ce qui a bien sûr contribué à augmenter les tensions sociales en ville.
Le gouvernement, lorsqu’il ne minimise pas l’importance des démolitions, tente de mettre fin au problème par le biais de deux discours dominants : l’un porte sur le bien commun, l’autre sur la légalité. Le premier présente ces mesures d’éviction comme nécessaires pour le bien de la population, utilisant l’argument selon lequel les habitants ont élu domicile sur des sites dangereux ou que leurs habitations ne se conforment pas aux standards urbain. L’État prétend ainsi porter assistance aux habitants en les forçant à quitter leur rési-dence. Cette tendance est renforcée par la façon dont le gouvernement utilise les réclamations formulées par ces mêmes habitants afin de prouver qu’il répond aux demandes du « peuple ». La promesse non tenue du président, qui s’était engagé lors de la campagne électorale de 2008 à construire un million de logements entre 2008 et 2012, illustre bien cette stratégie. Lors de la campagne électorale du MPLA en 2012, les supposés efforts du gouvernement firent l’objet d’une large campagne publicitaire à la radio, pendant que des spots télévisés destinés à relayer le succès de cette entreprise mettaient en scène le bonheur florissant de familles réinstallées dans une zone résidentielle en périphérie de Luanda. Alors que quelques habitants de cette zone apprécient les maisons qui leur ont été attribuées, la majorité de ceux que j’ai pu interroger
22. Sur les conséquences des démolitions en Angola, voir le rapport d’Amnesty International, Mass Forced Evictions in Luanda. A Call for a Human Rights-Based Housing Policy, AI Index 12/007/03, novembre 2003 ; Amnesty International, Lives in Ruins : Forced Evictions Continue, AI Index 12/01/2007, janvier 2007 ; Human Rights Watch, They Pushed Down the Houses, vol. 19, 7 (A), mai 2007. Voir également, le site internet Quintas de Debate d’Omunga, une organisation de la société civile angolaise qui produit des rapports sur les destructions de maisons : <http://quintasdedebate.blogspot.com>.23. Diário de República, Series I, n° 45, Dispatch 8/07, 13 avril 2007.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda57
évoquent le traumatisme qu’a représenté la perte de leur travail, l’arrêt de leur scolarisation ou encore l’isolement.
Les principes juridiques invoqués par le gouvernement sont simples : les habitants occupent illégalement des zones réservées au développement urbain. Malgré le fait que la législation foncière en vigueur en Angola recon-naisse divers degrés de propriété privée, dont le droit de superficie, elle stipule que le territoire national est une propriété fondamentale de l’État 24. L’article 6 de la loi sur la possession de terres de 2004 exclut explicitement tout droit de propriété qui découlerait d’une occupation informelle. La loi fait état des mécanismes formels par lesquels doit s’effectuer toute acquisition de terre et l’article 8 déclare nulle toute modalité d’acquisition non sanctionnée par la loi. Cela sape les bases sur lesquelles un large nombre d’acquisition de terre se sont déroulées. Néanmoins, le Code civil continue de reconnaître les droits qui dérivent d’une occupation de bonne foi (articles 1293 à 1297, et article 1528). L’augmentation des évictions forcées constitue une conséquence peu surpre-nante de cette ambiguïté latente du droit foncier, les autorités disposant d’un argument simple : au regard de la loi, ces terres sont la propriété de l’État.
La vulnérabilité des habitants de Luanda ne n’explique pas uniquement par l’obstacle légal qui les empêche de faire valoir leur titre de propriété. La possibilité même de faire valoir ce type de droit est conditionnée par des réalités politiques qui s’inscrivent dans un contexte géographique et temporel particulier 25. Les populations les plus démunies doivent généralement se battre afin de faire entendre leur voix et de mettre en place une procédure légale faisant état de leurs réclamations 26. L’important écart qui existe au sein de la sphère politique angolaise entre le nombre de demandes de compensation enregistrées suite à une démolition et la probabilité qu’elles soient acceptées met en évidence une maîtrise inégale des mécanismes formels nécessaires à la reconnaissance d’un titre de propriété. Cette asymétrie s’explique par
24. La constitution de 2010 mise à part, les législations principales concernant la gestion des terres en milieu urbain sont les suivantes : loi de 2004 (3/04) sur l’aménagement du territoire, loi foncière de 2004 (9/04, 9 novembre), loi de 2007 sur la régulation foncière (58/07, 13 juillet), loi sur la famille de 1988 (1/88, 20 février), ainsi que le Code civil angolais. Il existe un certain nombre de décrets et de résolutions qui statuent également sur des points précis, sur des projets urbains spécifiques ou encore des politiques publiques, comme la création de parcs naturels au sein de la province de Luanda. Pour une vision globale de l’histoire de la législation foncière en Angola, voir J. Clover, « Land Reform in Angola. Establishing the Ground Rules », in C. Higgin et J. Clover (dir.), From the Ground Up : Land Rights, Conflict, and Peace in Sub-Saharan Africa, Pretoria, Institute for Security Studies and the African Centre for Technology Studies, 2005, p. 347-379.25. C. Lund, Local Politics and the Dynamics of Property in Africa, New York, Cambridge University Press, 2008.26. A. Appadurai, « The Capacity to Aspire : Culture and the Terms of Recognition », in R. Vijayendra et M. Walton (dir.), Culture and Public Action, Stanford, Stanford Social Sciences, 2004, p. 59-84.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes58
le fait que l’État est dominé par le MPLA et peut donc agir sans craindre des représailles immédiates. Comme l’explique Nito, militant de la société civile, « si le gouvernement avait tenté de faire ce qu’il fait actuellement dans cette zone [pendant la guerre civile], le pouvoir aurait été renversé. À présent, il peut agir en toute impunité 27 ». Pourtant, la présence de longue date du MPLA au sein de l’administration d’État et par conséquent son implication dans les projets de construction actuels, amènent les détracteurs de la reconstruction nationale à questionner les résultats et les directives d’un gouvernement dirigé par le MPLA.
Ainsi, des sentiments anti-MPLA se concrétisent au fur et à mesure qu’il devient de plus en plus difficile de trouver un terrain à un prix abordable dans les parties convoitées de la ville et que, en raison de l’essor du secteur du bâtiment, les victimes de démolitions rencontrent de grandes difficultés à se remettre des pertes financières entraînées par la démolition de leur maison. Certaines d’entre elles ont même réinterprété le récit officiel de la guerre civile angolaise par le MPLA. Après m’avoir raconté comment la pro-pagande du MPLA l’avait convaincu, alors qu’il était adolescent, que Savimbi n’était qu’à moitié humain, un homme m’explique comment son expérience personnelle l’a amené à questionner les revendications passées et présentes du MPLA : « Savimbi est mort, et son décès fut une mauvaise chose. Pourquoi est-ce que les gens disent ça ? Parce que quand Savimbi était en vie, les destructions de logement n’avaient pas lieu. Savimbi a toujours été le défenseur de la cause du peuple… C’est juste [qu’à l’époque] le peuple ne l’avait pas encore compris 28 ». Cette désillusion grandissante a progressivement déplacé la question des démolitions vers le cœur du débat politique en Angola.
Pendant les élections de 2012, les deux principaux partis d’opposition, l’Unita et CASA-CE (Convergence ample pour le salut de l’Angola-plateforme électorale 29) ont promis à leur électorat de changer de politique et de mettre fin aux démolitions arbitraires 30. Les mouvements de jeunes se saisissent alors
27. Entretien avec un militant de la société civile, Cazenga, 5 juillet 2011.28. Entretien avec un habitant, Bairro 1, 24 février 2012.29. CASA-CE est une coalition électorale formée en avril 2012 par Abel Chivukuvuku, ancien membre de l’Unita. Il quitta le parti après sa défaite aux élections internes pour la présidence du parti, durant la deuxième campagne électorale qu’ait connu l’Angola après la guerre civile. Le parti a réussi à s’instituer comme une troisième voie pertinente au sein de l’échiquier politique angolais historiquement dominé par le MPLA et l’Unita, emportant 6 % des votes lors de l’élection de 2012. CASA-CE a tout particulièrement gagné l’électorat des zones urbaines en emportant le vote de jeunes Angolais et Angolaises déçus par le MPLA, mais qui n’auraient pas voté pour l’Unita à cause de son passé controversé.30. Dans son programme électoral, l’Unita promettait au peuple qu’en cas de victoire, il « mettrait fin aux démolitions arbitraires. Dans les cas où il serait vraiment nécessaire de démolir pour des raisons d’État, un gouvernement mené par l’Unita fera en sorte d’établir au préalable des conditions
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda59
de la question du logement et en font le symbole des multiples protestations qui accompagnent la campagne électorale de 2012. Les partisans de ce mou-vement rendent visite aux victimes de démolitions et entrent en contact avec Housing Now. En décembre 2011, une marche solidaire est organisée afin de soutenir les communautés ayant souffert de démolitions. Ces communautés, de plus en plus nombreuses à rejoindre les rangs des protestataires, affirment leur opposition grandissante aux politiques du gouvernement.
Les démolitions ont fonctionné comme un catalyseur, provoquant un changement radical de comportement et de perception du politique « par le bas ». Des individus qui n’auraient pas osé critiquer ouvertement le MPLA par le passé n’hésitent plus à exprimer haut et fort leur insatisfaction, faisant de leurs revendications une cause publique et évoquant leur mécontentement dans leurs conversations quotidiennes comme dans les discussions formelles auxquelles ils prennent part. L’État et les entreprises privées légitiment régu-lièrement leurs actions en présentant ces démolitions comme nécessaires à une « bonne » reconstruction de la ville. Le fait qu’un individu victime de ces démolitions soit capable de protester contre les conséquences de celles-ci constitue une remise en cause des formes traditionnelles du pouvoir de l’État comme des modalités du débat politique en Angola. Plus largement, en rejetant un modèle de réhabilitation urbaine s’appuyant sur des démolitions arbitraires, les habitants de Luanda questionnent la pertinence du plan de reconstruction mis en place par l’État angolais, lequel met en avant la reconstruction matérielle du pays en privilégiant bâtiments et infrastructures au détriment d’une réforme substantielle du système politique angolais 31. Ces enjeux politiques se sont imposés aux habitants de Bairro 1 lorsque les démolitions ont commencé à prendre de l’ampleur en 2004.
La mise en place d’un réseau d’influence alternatif :
le cas de Bairro 1
« On était là, il était quelque chose comme quatre heures du matin, lorsqu’on s’est réveillé le quartier était déjà encerclé par la police. On n’avait pas été averti qu’ils souhaitaient négocier, ou qu’ils avaient prévu de démolir le quartier. Bref, ils sont arrivés avec l’armée…
de relogement dignes pour tous les citoyens, et ne commencera à démolir qu’une fois ces conditions réunies » : Unita, Manifesto Eleitoral, 2012, p. 21.31. Pour plus d’informations sur la question de la reconstruction et sur le fait que l’environnement bâti et la mise en place d’infrastructures peuvent constituer un frein à des changements consé-quents au sein de la sphère politique angolaise, voir R. Soares de Oliveria, « Illiberal Peacebuilding in Angola », Journal of Modern African Studies, vol. 49, n° 2, 2011, p. 287-314 ; S. Croese, « 1 Million Houses ?…, art. cit., p. 12-13.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes60
et la police, et leurs machines [bulldozers], puis ils nous ont dit qu’on s’était accaparé la zone et ils ont commencé à détruire nos maisons 32 ».
Les résidents de Bairro 1 ne sont pas prêts d’oublier cette nuit où leur quartier à été détruit. Les membres de la Police d’intervention rapide, de la Police militaire et de sociétés de sécurité privées ont travaillé main dans la main afin de mettre en pièces le quartier, dépouillant les habitants de leur abri et de leur investissement financier le plus conséquent : leur maison. Le quartier hébergeait des personnes généralement considérées comme marginales en ville : chauffeurs de taxi, marchands ambulants, individus vivant du com-merce informel. La plupart d’entre elles se sont installées dans ces quartiers dans les années 1990 ou au début des années 2000, essayant tant bien que mal de gagner leur vie au beau milieu de la guerre civile. Deux ans après la fin de la guerre, elles étaient une fois encore menacées d’expropriation.
La destruction de ce quartier faisait partie d’une série de démolitions pla- nifiée dans cette zone. Bairro 1 est l’un des quatre quartiers (Bairro 1, Bairro 2, Bairro 3 et Bairro 4 33) établis aux abords de Casas do Sol, l’un des premiers grands projets d’habitation lancé par le gouvernement angolais après l’Indé-pendance, initialement prévu pour loger des fonctionnaires d’État. À la suite des démolitions menées en 2004, alors que ce projet était en pleine expansion, Bairro 1 et les quartiers voisins, Bairros 2 et 3, subirent trois vagues de démo-litions supplémentaires 34. Chaque éviction fut le théâtre d’importantes vio-lences, des habitants étant arrêtés lorsqu’ils essayaient de s’opposer à la police. Malgré ces démolitions, les résidents n’abandonnèrent pas complètement leurs terres. Le projet ne s’étendit pas immédiatement à l’ensemble des zones qui faisaient l’objet de démolitions. Par conséquent, les résidents refusèrent de quitter leur parcelle sous prétexte qu’acheter un terrain dans un autre quartier était au-dessus de leurs moyens et que le gouvernement provincial ou New Horizons – la compagnie en charge de Casas do Sol – étaient dans l’obligation de leur proposer une solution de relogement. En 2007-2008, la construction du projet connut un ralentissement. Bien que les démolitions cessèrent pour
32. Entretien avec un habitant, Bairro 1, 24 février 2012.33. Selon une étude menée en 2006, deux années après les premières démolitions, la population des quatre quartiers informels était composée de 1 224 habitants, hommes, femmes et enfants confondus. À noter que ce chiffre ne comprend que les personnes restées sur place après les démo-litions de 2004 pour demander des compensations.34. Bairro 4 devait subir l’une des premières vagues de démolition, mais le projet fut abandonné après que les habitants du quartier eurent insisté pour reconstruire leurs maisons en briques. Comme je l’exposerai ci-après, Bairro 4 apporta aux quartiers environnants la preuve qu’il existait des façons alternatives de négocier avec l’État.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda61
un temps, le projet continua de menacer les habitants de la zone, le plan officiel de Casas do Sol incorporant des terres qu’ils occupaient toujours.
Les évidences matérielles de la démolition qui subsistent à l’intérieur du quartier sont saisissantes. Les ruines d’anciennes maisons sont encore visibles entre les cabanes en taules ondulées dans lesquelles logent dorénavant les résidents. À Luanda, être propriétaire d’un bâtiment en briques (bloco) n’a pas la même signification que de posséder une cabane en taule ondulée (chapa). Posséder une maison en briques constitue un marqueur parmi d’autres de stabilité financière et de réussite : on est alors reconnu comme un citadin à part entière. Les ruines des maisons en briques qui jonchent les quartiers alentours rappellent à tous les pertes considérables, tant financières que symboliques, de ces habitants. En une seule nuit, ils ont perdu leur statut de citadins prospères pour connaître la précarité de « déplacés ». En trame de fond, le projet, avec ses routes goudronnées, ses jardins, ses promesses : l’accès à des infrastructures élémentaires et des maisons neuves composées de trois chambres. Sa progression constitue une menace constante pour les habitants. L’opposition esthétique entre les lotissements entourés d’asphalte et l’insalubrité des quartiers environnants rappelle la distinction coloniale qui existait entre la ville « en dur » (cidade de cimento) et le bidonville (musseque). Enfin, les conditions de vies précaires associées aux quartiers rappellent sans cesse aux habitants qu’ils n’ont pas leur place au sein d’une vision moderne/officielle de la ville.
Pendant neuf années, les habitants se sont battus pour leur droit à obtenir un logement. Comme je le démontrerai plus loin, ces revendications ont pris des formes diverses : négociations avec le MPLA, recours en justice, usage stratégique de l’argument esthétique. Bien que le MPLA ait toujours constitué une figure centrale pour les habitants de ces quartiers, ils ont pourtant tenté de distinguer l’État du parti et se sont approprié, de façon progressive, des conceptions de l’État et du pouvoir qui dépassent celles imposées par le MPLA. Pour des raisons heuristiques, la démonstration présente ces tentatives de façon séquentielle bien qu’en réalité, les individus aient tendance à combiner ces multiples stratégies. Il est plus rare qu’ils utilisent une seule de ces stratégies à chaque action menée. Même s’ils reconnaissent à l’État la capacité de légitimer leurs doléances, ils remettent inconsciemment en question l’autorité du MPLA, en invoquant différentes sources de pouvoir dans l’espoir de voir leurs revendications reconnues.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes62
Renégocier l’omnipotence du parti
Comme je l’ai décrit précédemment, le pouvoir se caractérise historiquement en Angola par un degré élevé de centralisation dans la personne du pré- sident ainsi que par une répartition opaque du pouvoir entre le MPLA et les organes d’État. S’il semble possible, d’un point de vue analytique, de séparer l’État du parti, des hommes d’influence ou encore de l’administration, la population ne distingue pas nettement le pouvoir détenu par chacun de ces acteurs.
À Luanda, ce manque de clarté entre le rôle du parti et celui de l’État se retrouve au niveau des institutions locales comme les comités de quartier et les Comités d’action du Parti (CAP). Les comités de quartier fonctionnent comme un micro-gouvernement qui renseigne de façon informelle l’adminis-tration communale des problèmes de quartiers tout en relayant les politiques publiques au niveau local. Ils remplissent plusieurs fonctions d’importance, étant par exemple en charge de délivrer les documents nécessaires à l’ins-cription de terres sur le registre administratif et de la résolution de conflits de voisinage. La plupart des Luandais que j’ai interrogés pensent qu’il est inutile d’élire des membres des comités de quartier qui ne soient pas déjà membres du MPLA : selon eux, de tels représentants ne seraient pas en mesure d’assurer le « développement » du quartier. À l’inverse, les CAP constituent des branches locales du MPLA. Bien qu’ils soient en théorie des entités distinctes des comités de quartier, la frontière est poreuse : dans de nombreux districts, les habitants occupent des fonctions au sein de ces deux comités ou passent de l’un à l’autre. Dans certains quartiers, les bureaux de ces deux comités sont parfois voisins. Beaucoup de Luandais pensent que la mise en place d’un CAP constitue une preuve suffisante de leur loyauté envers le parti pour les protéger de toute mesure d’éviction.
À l’époque où je menais des entretiens à Bairro 1, la majorité des habitants étaient excédés par le parti. Ce faible engouement pour le parti dans les années qui suivirent les démolitions n’empêcha pas les politiciens de faire campagne dans le quartier durant la période électorale de 2008, porteurs de promesses à foison. Les habitants de Bairro 1 et Housing Now crurent d’abord que ces hommes politiques étaient des membres du MPLA, alors qu’ils se révélèrent par la suite être des représentants de l’État. Ils affirment également qu’Higino Carneiro, alors ministre des Travaux publiques et membre éminent du MPLA, mandata personnellement un intermédiaire pour mener des négociations avec eux. On les informa alors que s’ils cédaient quelques-unes de leurs terres, ils pourraient bénéficier d’une mesure de relogement. Un débat eut d’ailleurs lieu autour de la construction de deux immeubles dans la zone afin de reloger
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda63
l’ensemble des habitants du quartier 35. À l’issue de ces discussions, les habitants de Bairro 1 refusèrent de céder leurs terres, tandis que ceux des autres quartiers acceptèrent, avec pour seul résultat de se retrouver à l’étroit sur de plus petites parcelles. Les habitants affirment également qu’au moment des élections de 2008, un membre du Bureau politique – l’organe central du MPLA – est venu à leur rencontre pour les informer qu’une zone de relogement leur était d’ores et déjà réservée. Pour les habitants de Bairro 1, cet incident s’apparente à un « plan mensonger » visant à les inciter à quitter leurs terres. Bien qu’il soit difficile de vérifier si les personnalités citées tentèrent de négocier avec les personnes que j’ai interviewées, il est évident que différents organes du MPLA tentèrent d’utiliser une forme de cooptation à leur profit, probablement dans le but de réduire au silence les habitants de ces quartiers dont les revendications commençaient à gagner l’attention des organisations internationales œuvrant pour la protection des droits de l’homme. Si Bairro 1 avait négocié directement avec le MPLA, les habitants se seraient présentés comme des sujets du parti et auraient reconnu qu’en définitive – comme le soulignent nombre d’analyses de la politique angolaise –, c’est toujours le parti qui tranche en dernière instance36.
Bien que la confusion entre le pouvoir de l’État et le pouvoir détenu par le MPLA ait souvent été interprétée comme un mécanisme primaire de domi-nation de la part de ce dernier, dans le cas des démolitions, cette ambiguïté est devenue une menace pour sa position. La population angolaise pense le parti comme un acteur incontournable. Ainsi, même s’il est difficile d’établir un lien de causalité entre le parti et la situation des victimes, les démolitions à répétition et l’absence de solutions de relogement sont interprétées comme intentionnelles de la part du MPLA. Plusieurs de mes informateurs m’ont confié qu’« [ils avaient] déjà souffert à cause du MPLA37 ». Les habitants de Bairro 1, notamment, pensent de plus en plus que le parti ne tient plus ses promesses et ne les protège plus comme avant. Ce sentiment provient du fait que la reconnaissance d’un quartier par les institutions du parti, qui se manifeste par la mise en place d’un CAP, ne signifie plus que ce quartier est à l’abri des démolitions. Les quartiers de Bagdad et Iraque, rasés en 2009 malgré leur soutien actif au MPLA, sont souvent cités en exemple. Alors que certains quartiers ont abandonné toute négociation avec le MPLA, les habitants de
35. Entretien avec Bernardo, membre de Housing Now, Luanda, 14 Août 2013.36. N. Vidal, “The Angolan Regime and the Move to Multiparty Politics”, in P. Chabal et N. Vidal, Angola. The Weight of History, Londres, Hurst, 2007, p. 124-174. Il ne s’agit pas ici de dire qu’aucune tentative de négociation eut lieu avec le MPLA, il est cependant fort probable que nombreux furent ceux qui votèrent pour le MPLA lors des élections de 2008 et 2012 dans l’espoir qu’ils seraient récompensés par une mesure de relogement ou/et l’attribution d’un terrain.37. Entretien avec un habitant, Bairro 1, 18 novembre 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes64
Bairro 1, conscients que soutenir le parti ne pourrait ni prévenir la démolition de leur quartier ni leur garantir le versement de dommages et intérêts, ont fait le choix de mobiliser des stratégies alternatives afin de faire entendre leur voix.
La fabrique de l’État de droit
La loi est également utilisée comme une ressource bureaucratique par les habitants de ces quartiers. Comme l’ont démontré Jean et John Comaroff, dans le monde contemporain les conflits politiques glissent progressivement vers le domaine légal38. Nombreux sont ceux qui pensent que la loi est un espace neutre propice au juste traitement de toute revendication. Dans un contexte comme celui de l’Angola, la loi n’a bien sûr rien de neutre, mais cela n’a pas empêché les habitants de Bairro 1 de recourir à la voie légale pour faire reconnaître leurs revendications. En agissant ainsi, ils essaient d’invoquer le pouvoir des structures d’un État libéral par opposition à celui des réseaux clientélistes. Avec l’aide de Housing Now, qu’ils ont sollicité après les démo-litions, ces habitants ont donc pris la plume pour écrire quantité de lettres à l’administration municipale, l’administration provinciale, l’Assemblée nationale et même au président. Ces courriers s’adressaient aux gouvernants en tant que représentants de l’État plutôt qu’en tant que membres du parti, soulignant l’importance de leurs obligations légales. Dans une lettre datée du 16 octobre 2009, les habitants de Bairro 1, Bairro 2 et Bairro 3 s’adressent en ces termes au Gouverneur de Luanda :
« Votre honneur, les victimes de démolitions illégales et de déplacements forcés des communautés de […], vivant aujourd’hui dans la pénurie et dans des conditions inhumaines et dégradantes, demandent que leur situation soit réexaminée afin que le gouvernement, incapable de garantir une protection élémentaire à ses citoyens, échappe au discrédit. Cette requête est formulée sur la base de vos obligations au regard de la loi, définies par l’article 12, partie 4 de la Constitution [L’État s’engage à respecter et à protéger la propriété des individus comme des personnes morales, ainsi que les droits de propriété et la possession de terres par les fermiers, à l’exception de toute expropriation menée pour cause d’utilité publique] et le Décret-Loi n°16-A/95 du 15 décembre, article 38 [Les individus concernés doivent impérativement être informés des décisions administratives
38. J.-L. Comaroff et J. Comaroff, « Law and Disorder in the Postcolony : An Introduction », in J. Comaroff et J.-L. Comaroff, Law and Disorder in the Postcolony, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. 1-56.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda65
prises à leur encontre lorsque celles-ci créent, étendent, augmentent ou diminuent leurs droits ou la protection juridique de leurs intérêts 39…] ».
Les victimes se réfèrent ici à la loi constitutionnelle angolaise de 1992 – qui statue sur les missions de « l’État » par rapport à son « peuple » – et s’adressent au Gouverneur comme un représentant de l’État (ainsi que le souligne l’assertion « vos obligations au regard de la loi ») et non comme un membre du parti, ce qu’il est néanmoins. Ainsi, le répertoire mobilisé fait-il appel aux droits légalement rattachés au statut de citoyen, sans plus se référer aux réseaux de dépendance mis en place par le parti.
Nombre de lettres furent envoyées à divers organes d’État au cours de ces neuf dernières années, soulignant régulièrement l’incapacité de ces institu- tions à répondre aux attentes des citoyens. Cette démarche est révélatrice d’une modalité de revendication de plus en plus courante en Angola. Celle-ci consiste à essayer de faire advenir un État de droit en mettant en scène non seulement la façon dont les plaignants incarnent la loi dans leur pratique, mais en se montrant en cela plus respectueux de la loi que ne l’est l’État lui-même. En utilisant la voie juridique, les habitants de Bairro 1 ne se réfèrent pas seulement à une citoyenneté libérale classique, au sein de laquelle un indi-vidu s’affirme comme citoyen sur la base d’un ensemble de droits et d’obligations juridiquement reconnus par l’État : ils imposent cette visions citoyenne contre l’approche technique que l’État angolais a des droits démocratiques, faisant de tout écart par rapport à la norme citoyenne le résultat d’une négligence particulièrement coupable.
La plupart de ces termes juridiques sont devenus monnaie courante à Bairro 1 et dans les autres quartiers en raison de leur interaction constante avec Housing Now, qui les encourage à utiliser des moyens légaux et institutionnels dans leurs rapports avec l’État. Cette référence constante à la loi constitue une mesure de protection pour les habitants, en ce que leur adhésion à la loi conjure de fait les accusations qui les désignent comme des fauteurs de troubles. L’objectif de Housing Now est également de faire prendre conscience aux habitants qu’il existe une nette distinction entre le MPLA et la source de leurs droits. Un représentant de Housing Now m’expliquait au début de mon terrain que « la loi, c’est la loi. Le parti, c’est comme la préférence religieuse, ça n’a rien à voir avec la loi 40 ». Lors des réunions tenues par l’organisation, les militants mettent en garde les habitants : ils ne doivent pas croire que le parti est en mesure de résoudre tous leurs problèmes. À une
39. J’ai eu accès à ces données en consultant les archives de Housing Now. L’organisation conserve en effet des copies de toute la correspondance entretenue avec les représentants de l’État.40. Entretien avec Bernardo et Nuno, membres de Housing Now, Maianga, 5 mai 2011.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes66
occasion, Bernardo rappela aux habitants que « votre maison n’appartient pas au parti, elle est à vous 41 ». Le temps passant, les habitants ont développé une compréhension fine de la législation de la terre en Angola ainsi qu’une conscience aiguë des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ils sont maintenant en mesure de soutenir avec assurance l’argument selon lequel gouvernement a « enfreint la loi » en les expropriant sans même leur fournir une alternative.
Les questions du foncier et du logement ont été conçues comme résultant de l’incapacité du gouvernement à protéger les droits des citoyens angolais. C’est sur cette base que les habitants de Bairro 1 ont adopté la manifestation comme forme d’action politique. La Constitution angolaise de 2010 reconnaît en effet aux citoyens le droit de manifester s’ils en informent les autorités compétentes à l’avance – en général le gouvernement provincial. Le 7 mars 2011, inspiré par les révoltes du Printemps arabe, un petit groupe de Luandais s’est réuni afin de protester contre la longévité du mandat du président José Eduardo dos Santos 42. Rapidement encadrée par la police, cette manifestation a entraîné une vague de contestations lui octroyant une légitimité nouvelle. Lors des entretiens que j’ai pu mener avec des militants, la constitutionnalité du droit de manifester est souvent citée comme une preuve que l’État a outre-passé ses droits en s’en prenant aux organisateurs de la manifestation. Selon les militants, l’argument constitutionnel devrait également garantir aux victimes de démolitions le droit de manifester si elles le souhaitent. Depuis que les habitants ont pris conscience que la manifestation est un droit reconnu par la loi, ils essayent timidement d’en faire une stratégie politique d’interaction avec l’État. Bien que ces tentatives s’éloignent de leurs stratégies habituelles (recours en justice, rédaction de lettres), le fait que la manifestation soit devenue un mode d’action plus largement reconnu – grâce à la sanction légale que lui a accordé la Constitution de 2010 – témoigne de la judiciarisation de l’univers politique des acteurs de la lutte pour des compensations.
En juin 2011, après avoir menacé d’organiser une manifestation pour dénoncer leurs conditions de vie, les habitants de Bairro 1 et des autres quartiers furent convoqués par l’administrateur municipal, qui leur demanda de renoncer à leur action. Pour la toute première fois, le gouvernement provincial leur remit un document officiel promettant de les reloger entre septembre 2011 et avril 2012. Les habitants décidèrent alors d’annuler la manifestation, leur objectif ayant été atteint. Ce résultat, obtenu grâce à la mobilisation d’un cadre légal, est évoqué comme un succès significatif par
41. Observation participante à la réunion organisée par Housing Now, Benfica, 27 mai 2011.42. Pour une analyse fine de la portée de ce mouvement de protestation, voir R. Marques de Morais, « Alternating Demonstrations… », art. cit. p. 57-66.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda67
les membres de la communauté. Pour les militants, il constitue une preuve supplémentaire qui devrait inciter les habitants à adresser ce type de revendications à l’État de droit plutôt qu’au parti. Malheureusement, malgré la nature concrète de la promesse obtenue, en janvier 2012 aucune mesure n’avait été mise en place, ce qui amena les habitants de ces quartiers à adopter une nouvelle stratégie : reconstruire.
De l’usage stratégique du critère esthétique
En janvier 2012, face à l’inertie du gouvernement provincial, les comités de quartier de Bairro 1 et Bairro 2 organisaient une série de réunions pour décider de la marche à suivre. Ils s’accordèrent sur le fait que les habitants devaient commencer à reconstruire leurs maisons de sorte que cette action, à défaut de mieux, force les autorités à statuer sur leur situation. Selon un résident de Bairro 1, les habitants du quartier espéraient que leur démarche connaîtrait le succès de Bairro 4 et de Gaiolas, un quartier voisin situé près des quartiers riches de Talatona dont les habitants négociaient avec le gouvernement provincial tout en reconstruisant leurs maisons en briques :
« Nous, «le peuple» [o povo], souhaitons urbaniser le quartier en reconstruisant nos maisons et nous espérons qu’en agissant de la sorte, nous obtiendrons une réponse de la part du gouvernement. Si le gouvernement reste silencieux alors, si Dieu le veut, nous construirons nos maisons et resterons ici jusqu’à la fin de nos vies 43 ».
De leur côté, les habitants de Bairro 3 jugèrent que commencer à reconstruire risquait d’être interprété comme une provocation par l’État. Bien qu’enthou-siastes à l’idée de maintenir leurs revendications légales, ils réengagèrent le dialogue avec les structures du MPLA. Lorsque je leur ai demandé quelles étaient les raisons qui les avaient poussés à faire une nouvelle fois confiance au parti, l’un des leaders de Bairro 3, convaincu que son statut de « citoyen » angolais obligerait le MPLA à le respecter, me répondit : « Le parti, c’est le parti. C’est presque comme une Église » (« Partido é partido, é quase igrejá »).
Les deux autres quartiers de Bairro 1 et Bairro 2 ne se tournèrent donc pas vers le parti, mais continuèrent à se soucier de l’inaction de celui-ci. Samuel, membre du comité de quartier de Bairro 1, voyait dans cet immobilisme le signe que le MPLA était convaincu de remporter les élections dans la zone. Il s’inquiétait qu’une fois l’élection terminée, le parti use de la force afin de « tout nettoyer [détruire] » (limpar tudo). Pour cette raison, il préconisait
43. Entretien avec un habitant, Bairro 1, 24 février 2012.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes68
la construction de maisons en taule ondulée plutôt que de maisons en briques, les premières constituant un affront moindre aux yeux des forces publiques.
Les habitants continuent en parallèle de mobiliser un répertoire juridique, écrivant des lettres aux institutions étatiques, aux médias, et aux organisations internationales afin de les informer de leur intention de construire. En faisant de leur cause un problème public, ils pensent disposer d’une protection minimale contre les démolitions, prouver leur bonne foi aux autorités et échapper ainsi aux accusations qui leur sont faites de fomenter ces actions en secret. Leur projet de construction se base également sur un certain degré de légalité. En effet, les habitant de ces quartiers n’ont pas seulement prévu de reconstruire leurs maisons, ils ont prévu de les reconstruire selon les standards promus par l’État en matière de « bon urbanisme ».
Ces critères officiels en matière d’esthétique urbaine sont véhiculés par des publicités télévisées offrant des visions panoramiques de nouvelles zones de logement construites sur un plan quadrillé, par la presse écrite et les brochures publiées par le gouvernement faisant l’éloge du passage d’une « désorganisation informelle » à une « organisation formelle ». Les médias reviennent constamment sur la nécessité de mettre fin au développement de « quartiers désorganisés » (bairros desorganizados). Le terme, qui recouvre à la fois l’idée de désorganisation légale (au sens où les habitants ne disposent pas de titres de propriété officiels) et de désordre esthétique (exprimé par les images de quartiers construits sans planification préalable), associe l’idée de légalité à la notion d’esthétique. Les habitants en sont venus à identifier ces critères d’esthétique urbaine comme la condition de la légitimation de leur occupation aux yeux de l’État.
Quand les habitants ont pris la décision de reconstruire, il est évident qu’ils concevaient la construction comme un acte qui, bien que conflictuel, pouvait en même temps être porteur d’une réconciliation. Jorge, l’un des membres du comité de quartier, me montre le plan du quartier et m’explique qu’ils ont le projet de s’aligner sur les choix esthétiques de leurs voisins plus riches et de suivre les directives de l’État en matière d’« organisation ». Ce plan présente un quartier divisé selon un quadrillage parfait : chaque bloc est constitué de huit parcelles de taille équivalente, chacune de ces parcelles débouchant sur une route assez large pour laisser passer les voitures. Certaines parcelles font l’objet d’un traitement spécial : elles sont réservées à l’hébergement d’un bureau du comité de quartier, d’une école, d’un marché, d’une église et d’une aire de jeu pour les enfants. Le quartier répond ainsi de façon « organisée » à l’ensemble des besoins élémentaires des habitants de Bairro 1. Jorge me décrit les murs identiques qu’ils ont prévu d’élever autour des maisons afin qu’on
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda69
ne puisse les distinguer les unes des autres de l’extérieur, justifiant ainsi son propos : « Il [le gouvernement] dit habituellement que nos constructions ne suivent aucune logique, mais avec un mur, une maison a une autre apparence 44 ».
Le jour suivant, Samuel m’explique que les habitants de Bairro 1 ont choisi de construire en accord avec le quadrillage et les normes architecturales imposées par l’État, en partie pour que les habitants de Casas do Sol n’aient pas l’impression de vivre aux portes d’un « bidonville » (bairro desorganizado). Il espère qu’à terme, ces mesures leur permettront d’éviter tout problème. En indexant volontairement leur projet sur une conception du développement urbain soutenue par l’État, il présente ce projet comme une forme d’auto-construction encadrée par l’État, en ce que l’architecture des maisons garantit l’accès aux routes et aux services à l’ensemble des habitants. Pour lui, ces maisons ne seront en aucune façon différentes de celles qu’il nomme les « bidonvilles de luxe » (musseque de luxo) qui bordent l’autre extrémité de Bairro 1. Dans les années 1990, les parcelles de cette zone ont été regroupées en lots par consortium public-privé à destination de la classe moyenne émergente angolaise. Cependant, ces lots n’étaient pas réellement aménagés au moment de la vente : « Ils ont fait exactement ce que ce nous essayons de faire ici », explique Samuel, « on construit des routes pour que, dans le futur, le gouver nement puisse venir jusqu’ici mettre en place des infrastructures 45 ».
Les habitants de Bairro 1 tentent de faire valoir leurs revendications actuelles en reproduisant les standards des projets de logement gouver nementaux. Comme les autorités étatiques ont toléré l’existence du « bidonville de luxe », les habitants de Bairro 1 ressentiraient toute action d’expropriation comme une profonde injustice alors qu’ils satisfont aux exigences esthétiques impo-sées et s’efforcent de se fondre dans le paysage urbain. Tout comme les recours en justice qu’ils continuent de déposer, leur démarche esthétique sollicite une forme particulière de pouvoir : en faisant de leur planification particulière une source de légitimité nouvelle pour leurs revendications, ils entremêlent les notions de légalité et d’esthétique et s’éloignent de la logique clientéliste.
Les modalités de la reconfiguration du pouvoir à Luanda
Lorsque j’ai quitté Luanda en septembre 2012, les habitants de Bairro 1 et Bairro 2 n’avaient pas reconstruit leurs maisons. New Horizons, en partenariat
44. Observation participante, Bairro 1, 27 mars 2012.45. Observation participante, Bairro 1, 28 mars 2012.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes70
avec le gouvernement provincial, leur avait offert, ainsi qu’aux résidents de Bairro 3, des logements. Des négociations s’engagèrent et s’étalèrent sur plusieurs mois. Au départ, les habitants de Bairro 3, qui soutiennent mas si-vement le MPLA, devaient être relogés en premier mais un nouveau président – membre actif du MPLA – fut nommé à la tête du comité de quartier de Bairro 2 au dernier moment. Les membres de Housing Now affirment qu’il se déplaça pour rencontrer en personne un représentant de New Horizons qui, selon eux, avait également sa carte du parti. Suite à cette rencontre, Bairro 2 fut le premier quartier à bénéficier d’une mesure de relogement alors qu’il était censé venir en dernier. Les habitants furent relogés à Zango en juin 2013, Bairro 1 devant être le prochain quartier à faire l’objet d’une mesure similaire.
Lorsque je demandai à un habitant de Bairro 3 son opinion à propos du fait que les habitants de son quartier seraient finalement les derniers à faire l’objet d’une mesure de relogement, il me rétorqua que selon lui la menace de reconstruction brandie par les habitants de Bairro 1 et Bairro 2 avait influencé la décision de New Horizons ainsi que celle du gouvernement. Lorsque je posai la même question à un membre de Housing Now, il me répondit que les habitants de Bairro 3 avaient oublié le proverbe qui dit que « n’est pas du MPLA qui veut, mais qui le mérite » (Não é do MPLA quem quer, mas quem merece). Le parti n’est pas toujours un partenaire heureux lorsqu’il s’agit de négocier : en témoigne le bureau du CAP flambant neuf installé à Bairro 3, qui n’a pas valu aux habitants d’être récompensé pour leur zèle. En septembre 2013, les habitants de Bairro 1 et Bairro 3 étaient encore en attente d’être relogés. Pour mes interlocuteurs, il est évident qu’aucune autorité en particulier n’émerge comme un acteur clé qui, par sa seule action, aurait permis que la procédure de relogement commence enfin. Du point de vue des habitants, la mobilisation de la loi, de critères esthétiques ou de leurs connexions avec le MPLA constituent autant d’éléments qui ont abouti à des résultats concrets.
Bien que le MPLA continue d’exercer un contrôle considérable sur les institutions d’État, les négociations autour de la question du relogement permettent de repenser la politique et les droits des citoyens hors du cadre partisan, ce qui indique une reconfiguration des représentations du pouvoir de l’État en Angola. Bien que les actions menées par les victimes d’expropriations soient moins visibles que les manifestations organisées par la jeunesse, elles suggèrent néanmoins la formation de fissures, certes encore microscopiques, dans l’hégémonie du MPLA. Le découpage des terres urbaines et la remise en cause des demandes d’accès à la propriété ont été historiquement des outils de distribution inégale des droits entre les citoyens46.
46. A. Mbembe, « Necropolitics », Public Culture, vol. 15, n° 1, 2003, p. 11-40.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
Politique africaine
« Vamos construir ! » : revendications foncières et géographie du pouvoir à Luanda71
Les efforts déployés par les résidents afin de reconfigurer les modalités de la reconnaissance mutuelle – à la base de leurs revendications de droits – sont selon eux l’expression de luttes visant à replacer la source de l’autorité publique sur des bases davantage à la portée des Angolais ordinaires. Ce déplacement de l’autorité est une menace pour le pouvoir établi.
Afin de faire entendre leurs revendications, les résidents mobilisent progressivement de nouveaux registres en dehors de la sphère du MPLA, ce qui entraîne une lente érosion du pouvoir du parti. Comme Lund le suggère en introduction de ce dossier, la reconnaissance mutuelle qui existe entre une autorité politique et ses sujets est nécessaire non seulement pour permettre aux citoyens de formuler des demandes, mais également pour que les insti-tutions en question puissent exercer leur pouvoir. Même si, dans un contexte politique dominé par un parti-État, les citoyens pourraient être contraints d’accepter l’ordre établi – le possible recours à la violence par l’État sous-jacent à toute action politique ne doit pas être négligé en Angola –, les négociations sur le droit à la propriété et la citoyenneté contribuent à redéfinir les liens entre parti et État et, partant, à questionner le sens même de l’« État » dans sa pratique quotidienne.
Le recours que font les résidents à des arguments juridiques et esthétiques laisse à penser que, même dans un contexte où le pouvoir de l’État semble par moment écrasant, subsiste un espace de négociation où les acteurs ont la capacité de combiner les discours et les symboles au travers desquels l’État se met en scène. L’engrenage dans lequel sont pris les habitants – les démolitions amenant à un relogement – que le régime présente comme une preuve de son « souci » de protéger sa population joue finalement le rôle de catalyseur en permettant un tournant dans la nature des expériences quo-tidiennes du pouvoir à Luanda. Ces nouvelles pratiques du pouvoir, comme c’est le cas de la refonte des discours officiels sur l’esthétique urbaine, échappent dorénavant à la seule influence du parti et ouvrent de nouvelles perspectives quant au futur politique du pays n
Claudia Gastrow
Université de Chicago
Traduction : Chloé JosseDurand
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala
le Dossier
Propriété et citoyenneté dans l’Afrique des villes72
Abstract« Vamos Construir! »: Property Claims and Locating Authority in Luanda, AngolaThis article explores questions of property, citizenship, and state authority in
contemporary Luanda. It examines how, in the process of attempting to gain compensation for their losses, victims of urban demolitions are undoing established forms of statecitizen relationships. The author argues that the belief in the power of the Movimento popular de libertação de Angola (MPLA) has led to significant disaffection with it amongst demolition victims as they believe that the party is responsible for their suffering. Beginning from the starting point that state authority is dialogically constituted through the mutual recognition between states and citizens, the article shows how demolition victims attempt to move relations of recognition outside of the party realm to other spheres, namely those of law and urban aesthetics. In the process they inadvertently rework the political relationships upon which MPLA power is based, eroding its hegemony.
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
Har
vard
Uni
vers
ity -
-
128.
103.
149.
52 -
10/
02/2
014
20h1
3. ©
Edi
tions
Kar
thal
a D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - Harvard U
niversity - - 128.103.149.52 - 10/02/2014 20h13. © E
ditions Karthala