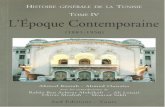UE HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT : Histoire des sources du Droit
-
Upload
univ-rennes1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of UE HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT : Histoire des sources du Droit
UE HISTOIRE DES SOURCES DU DROIT :
Histoire des sources du Droit.
Conseil Bibliographie :
CARBASSE Jean-Marie, Manuel d’introduction historique au droit, PUF, col «Droit fondamental», Paris, 2003 (2e édition).THIREAU Jean-Louis, Introduction historique au Droit, Flammarion, Col «Champs Université», Paris, 2001.FONTETTE (François de -) : Les grandes dates du Droit, PUF, col. « Que sais-je » n°2890, Paris, 2006 (3e édition).
Examen :Vendredi 10 Janvier à 13h (3h)
INTRODUCTION : La place centrale de l’écrit dans la construction intellectuelle du droit
Le point de départ du droit c’est l’introduction générale au droit. La norme écrite occupe tout l’espace juridique en se déclinant sous plusieurs formes :
La loi, les normes, etc...De règlements.Décisions juridictionnelles.
Le droit c’est de l’écrit mais le droit et l’écrit juridique ne se confondent pas et ne se confondaient pas dans le passé et même ne se confondent pas encore totalement maintenant.
La coutume orale a eu une grande importance en droit français mais aussi européen et en particulier avant. Au XIIIe le droit coutumier n’avait pas été rédigé par des particuliers (juge, administrateur,...) qui écrivaient à titre privé. La coutume était purement oral. Puis la coutume a eu aussi une importance dans la vie juridique du monde, et les systèmes anglo-saxons et systèmes juridiques anciens du continent africain et américain.
Le système anglo-saxons : c’est la Common law, c’est un ensemble de coutume qui a prit une force égale à la suite d’un usage mémorial et avec le consentement express ou tacite du pouvoir législatif (pour en Grande Bretagne le pouvoir du roi à l’époque). Elle se présente sous la forme d’un tout homogène pour l’ensemble du royaume d'Angleterre dans la société de l’époque. Cette cohérence est due a une synthèse faite au XIIIe établie par des juges royaux itinérants qui parcours toute l'Angleterre et cet ensemble est le fruit d’un mélange de plusieurs traditions juridiques :Traditions juridiques normandes.Traditions juridiques danoises.Traditions juridiques saxonnes.
Il faut retenir pour la Common law va rester au stade coutumier car il n’y a pas comme en France, une rédaction officielle des coutumes qui leur donne une force légale.
Le droit coutumier a été étudier au cours du XXe par des anthropologues, sociologues, on réfléchit sur tout ça etc... Et en Amérique du Nord, anthropologue LEVI-STRAUSS, GURVITCH et MAUSS sont des sociologues.Pour l’Afrique il y a clairement 2 périodes a ne pas opposer complètement :
Période coloniale : le colonisateur va respecter les « coutumes indigènes » notamment pour ce qui concerne le droit de la famille, coutumier et privé pour éviter des révoltes contre les colonisateurs. On le voit pour l’Algérie, il y a un décret de 1866, un décret français qui dispose que la loi musulmane régie toutes les conventions et contestations civiles et commerciales entre musulman. Ce droit musulman va être mit par écrit et traduit en français, par des juges, des militaires, des personnes ecclésiastiques, ...En même temps, ce droit coutumier est perçu comme un droit inférieur au code français car il y a le Code civil et a coté les coutumes indigènes.
Après la décolonisation : il va y avoir une volonté d’utiliser la coutume dans un dynamique nationaliste, car cette coutume est un ordre social et juridique alternatif opposable a l’ordre occidental. C’est en 1975, que lorsque la Papouasie de Nouvelle Guinée, se voit reconnaitre son indépendance par l’ONU, une décolonisation pacifique qui va se fait et ce qui est mis en avant c’est un droit coutumier qui n’a rien a voir avec la Common law. C’est un territoire propre reconnu. Parallèlement les pays d’Afrique ont une grande attirance pour les systèmes juridiques de l’ancienne puissance colonisatrice, en particulier du code civil pour la France.Ce qui fait que la place du droit coutumier est une place restreinte du point de vue officiel mais par contre une place très réelle dans la vie quotidienne.Exemple : la place des ordalies, c’est demander à un Dieu de trancher un litige entre 2 personnes en manifestant par un fait tangible la personne qui dit la vérité.
A l’heure actuelle, le coutume reste quand même important pour les pays Africains.Pour l’Amérique, la reconnaissance d’un droit coutumier Amer-indien a été plus tardif et ne s’est vraiment faite qu’avec une forte démocratisation dans les années 1870.Exemple : la cours suprême du Canada reconnaît l’existence d’un droit de pèche et de chasse coutumiers pour les indiennes vivant sur le territoire.
L’écrit occupe une place centrale dans la construction intellectuelle du droit mais pas totalement.
Chapitre 1. L’héritage de l’antiquitéSection 1. La naissance du Droit au Moyen-Orient
I. Contenu des premières règles de Droit
Les premières règle de droit, on les trouve en Mésopotamien et dans le territoire de la Palestine.
A. La Droit mésopotamien : le Code d’Hammourabi (-1750 avant J.C)
En vérité, la Mésopotamie développe une riche civilisation du IIIe millénaires avant notre ère avec l’agriculture et les premières normes juridiques promulguées par des Rois remontent à -2100 avant J.C il s’agit d’un code du Roi d’ UR-NAMMU.Par contre, en -2100 on on a le code d’HAMMOURABI car on a trouvé sur une grande stèle gravée en 1902 sur un site de fouille et ce code contient un prologue et de nombreux articles de droit pénal, droit rural, droit de la famille.Exemple : Si quelqu’un apparu à un procès pour un faux témoignage cet Homme est passible d’une peine capitale.Exemple : droit de la famille, si X a une épouse et s’en va, elle part avec un autre. Ils ont des enfants. X revient alors la femme doit retourner avec X et les enfants suivront chacun leur père.
Il y a des sanctions pénales en cas de faux témoignage, ou en cas de découpage d’arbre, règles concernant des enfants né d’une femme abandonnée par son mari.
B. La Bible, témoin du Droit hébraïque primitif (-1200 avant J.C)
Dans le début de la Bible, on trouve le Décalogue (= les 10 commandements) et aussi le code de Deutéronome, il est reconnu par les chrétiens et par les juifs. On y trouve des règles de droits pénal « Tu ne tueras point », « tu ne connaîtras point d’adultères », etc… Il s'agit de préceptes de droit, il n'est pas vraiment question de religion. On trouve aussi dans le Deutéronome, des théories plus juridiques techniques comme des dispositions s’apparentant au droit moderne de l’urbanise.Exemple : l'obligation de mettre une balustrade sur le toit plat d’une maison neuve pour ne pas souiller la maison avec « du sang ».
II. Nature du Droit primitif : un Droit sans juriste, supposé être venu directement des Cieux
Ces textes ne sont pas considérés comme des textes de nature humaine donc ce ne sont pas des textes qui créerait le droit en fonction de la volonté du législateur ou qui mettrait en coutume juridique pré-existante.
Alors qu’est-ce que c’est ?Dans cette approche primitive du droit, l’Homme est un simple traducteur ou un exécuteur de la volonté divine c’est-à-dire l’Homme écrit le droit sous la dictée de ou d’un Dieu ou autrement reçoit le droit gravé de façon surnaturelle et donc on peu considéré que ce droit est un droit sans juristes car venu directement des Cieux. (Il y a autant de temps entre nous et celui du Christ qu’entre cette époque du Christ et celui d’HAMMOURABI.)
Cette approche du droit on la retrouve dans la tradition Juive et Chrétienne puisqu’ils reprennent la Bible. Dieu est supposé donner à Moïse les tables de de la loi lors d’un orage sur le mont Sinaï. La symbolique des tables de la loi va rester vivace longtemps bien au-delà qu’on est sensé de croire à une origine divine.On a les ordonnances dans la peinture exaltant du XVIIIe par Louis XIV. On retrouve cette symbolique dans la DDHC en 1798 et aussi dans les blason des universités, institutions, et en particulier les facultés de droit.Pour le code d’ Hammourabi on trouve la même conception que le décalage car d’Hammourabi considère c’est le dieu du Soleil « Samas » qui lui l’a chargé de rendre le droit et lui a remit le texte.
Ce qui est curieux, un droit dicté par un Dieu n’est pas forcément religieux et en particulier le code d’Hammourabi ne contient pratiquement rien sur les croyances et pratiques religieuses de la Mésopotamie. On peut considérer que c’est un « droit séculier » d’origine divine.Pour la Bible (detéronome), les choses sont moins claires et il y a effectivement un mélange entre des règles séculières et juridiques et des dispositions incontestablement religieuses et en particulier le cas des premiers commandement.
Exemple : interdiction de l’adultère, du vol, etc...
Section 2. La place centrale du Droit RomainI. La « loi des douze tables », ou le passage à un droit revendiqué
comme une création de l’esprit humainA. Présentation générale
La nature de la loi est le contenu du droit. La loi des douze tables c’est un texte promulgué en -450 avant J.C qui correspond théoriquement à la 300e année de la création de Rome et ce texte intervient 60 ans après la mise en place de la République Romaine dans le cadre de la cité de Rome.
=> Rome a été créé en -750 avant J.C.
Au départ la cité Romaine est régit par un système monarchique, son premier Roi a en théorie été ROMULUS et ensuite les Romes ont été dirigés par des rois d’origines étrusques c’est-à-dire qui sont issues de la population sur le territoire de Rome avant l’arrivé des Romains, les étrusques issus sur le territoire de l’Asiome.
La loi des douze tables est un texte symbolique de la civilisation de la société romaine et qui va considéré que les romains sont les inventeurs du droit comme les Grecs, les inventeurs de la philosophie. Et en théorie ce droit est resté en vigueur pendant 1 millénaire dans le monde romain sous l’oeuvre de l’empereur d’Orient Justinien qui promulgue le Corpus juris civilis (= corps entier de la civilisation) en +530 après J.C. En réalité l’importance de la loi des douze tables est sur-estimées car les historiens romains ont découvert que de nombreuses dispositions ont été abrogées soit parce qu’elles étaient trop archaïques (=plus d’usage) soit parce qu’elles avaient été abrogé par des lois postérieures.
Le nom de la lo i des douze tables : ce texte a été gravé sur 12 tables en pierres accrochées sur le mur du forum, dont le but était de rendre public les règles juridiques dont le contenu n’étaient pas connu en détail par le peuple. Ce droit « secret » permettaient aux juges et sénats de statuer au droit arbitraire. Seuls les juges connaissaient réellement les règles. Ces lois sont détruitent 60 ans après par les Gaulois qui attaquent Rome. Elles sont rétablies par la suite sous la forme de tables en bronzes monumentales, mais elles ont été fondues après la chute de l’empire Romain en 476.
On connait partiellement le contenu des douze tables car des auteurs Romains en avaient inséré des morceaux dans leur oeuvres juridiques, notamment CICERON et par la suite, il y a eu des tentatives de restitution par des juristes français de la Renaissance et particulièrement par CUJAS, et cette loi va être commenter notamment par GODFROY (professeur de droit et protestant) et puis au XVIIIe par BOTHIER.
B. Nature de la loi des douze tables
Il s’agit d’une publication écrite officielle du droit qui s’oppose radicalement à la conception religieuse antérieure, elle a pour but d’établir pour tous l’égalité devant la cour. Une démarche moderne car le droit n’est plus l’expression d’un oracle divin. Au contraire, le droit s’inscrit dans un domaine social. Donc la loi des douze tables est le résultat d’un compromit destiné a rétablir la paix sociale dans le conteste d’un rapport de force particulier.
Le droit est un peu l’expression d’une façon modérée de la force car c’est un compromis et c’est issu d’un conteste inscrit dans le temps qui peut ne rien avoir de commun avec les rapports de l’époque extérieure. Donc le droit romain ne peut pas être considéré comme un moyen d’oppression. Donc la loi n’est pas un moyen d’oppression.Le contexte social de -489 c’est donc les édits de la cité des romaines établies en -510, depuis de la République de la cité Romaine qui fait suite au renversement du dernier Roi de Rome DARQIN qui a finit par se comporter en tyran. Il va y avoir ensuite une République comme il n’y a pas de roi. En réalité au début de la République, 2 conceptions s'oppose réellement :
République de type aristocratique, est voulu par les Romain, les Patriciens (= les plus riches) de vielles souches qui ont jouer un rôle déterminant dans le renversement de la monarchie et ceux sont de riches propriétés de terres fonciers qui domine l’Assemblé politique (= Sénat). —————————————————-Pour eux, la République doit être gouverné par l’autorité discrétionnairedes magistrats (= pouvoir sans limite), les dirigeants politique et cette République ne doit pas être gouvernée par des lois parce que la loi est parfois injuste et comme elle est inexorable même si elle est injuste on ne peut espéré ni rémissions, ni grâces . Avec la mise en place de du code pénal, on guillotine plus de personne et on en condamne beaucoup plus. Donc les circonstances atténuantes
vont y être introduit par la suite.
République plus populaire à Rome est réclamé par les Plébéiens (= citoyens moins riches que les patriciens) qui sont d’origines ethniques diversifiées et avant ils étaient exclus des affaires publiques sous la monarchie et sous le début de la République. Pour eux, la République doit se gouverne par des loi écrites certaines et parce que « L’âme des loi n’est d’autre que la raison qui est exempte de passion et tout ce que la loi prescrit est toujours juste » et si par malheur ce n’est pas le cas, et bien on peut remédier par la loi injuste par une juste interprétation.
Les Romains vont tenter un compris entre ces deux approches de la République (république de type aristocratique et république plus populaire) et du droit c’est-à-dire que la République sera gouvernée par des lois publiques écrites comme le souhaite les Plébéiens. Mais par contre le contenu de ces lois sera uniquement élaboré par une commission législative uniquement composée de Patriciens qui exclus les Plébéiens, et un garde fou (=limite) est posé, les lois doivent être utiles au 2 ordres, Patriciens et Plébéiens et devront assurer l’égalité et la liberté.
Dès le départ du droit, on a un idéal du droit de liberté et l’égalité, donc on a un objectif de liberté et égalité. Donc la commission législative commence par faire un voyage jusqu’a Athènes pour étudier le droit grec primitif et en particulier étudier les lois divulguées par un législateur athénien : SOLON. C’est un voyage probablement légendaire.
C. Contenu de la loi des douze tables
Il y a plusieurs choses que l’ont trouve dans le contenu de la loi des douze tables :
La loi des Douze tables permet de rendre public un certain nombre de normes publiques qui s’applique a tout les citoyens. Il y a d'abord le fait de rendre public un certain nombre de normes qui s'appliquent en matière de vie familiale, rurale, en matière de répression. Normes connues de tous. La loi des douze tables ne se contente pas d’édicter des normes théoriques.La loi des douze tables permet aussi de sanctionner la violation de la règle de droit c’est-à-dire elle fixe des règles de procédure permettant aux citoyens de faire reconnaitre leurs bons droits devant les institues judiciaires primitives de la cité Romaine.
1. Un corpus de droit privé primitif : droit pénal, droit de la famille, droit rural
En droit pénal on trouve beaucoup de dispositions pénales qui prévoit une répression sévère (des atteintes portées aux personnes et aux biens). Cette grande sévérité s’exprime par le contexte de conflit entre les plus pauvres (Plébéiens) et les riches (Patriciens). Ce contexte étaient propice à la multiplication des vols, assassinats, etc...Les dispositions pénales, on les trouve dans la IIe et dans la VIIe table :
La IIe table : « Des jugements et des vols ».Répression des volsExemple : « Si quelqu’un commet un vol de nuit et qu’il soit tué, celui qui l’aura tué ne suivra aucune peine ». ————— —— —-« Si le vol est fait de jour et si le voleur est prit en flagrant délit, il sera fustigé et donner en esclave a celui qu’il-aura volé ». ————————————- ——————— ——————- ——————— ————- ——— « Si le voleur est un esclave, il est fustigé et jeté de la roche Tarpédienne ».————————————— —- ——— « Si le voleur n’a pas atteint l’âge de puberté (14 ans), qu’il soit battu de berge à volonté et qu’on dédommage la partie civile. »
On peut voir 2 choses dans ces exemples : La première c’est qu’on a un droit très sévère. Et l’on a un droit relativement élaboré qui distingue plusieurs situations, qui est moderne.
La VIIe table : « Des délits », elle pose le principe général de la responsabilité civile et cette responsabilité c’est un des principes fondamentaux du XXe en Droit français.Exemple : « si on fait quelque dommage de propos délibérés, que ce dommage soit réparé ».
On trouve des dispositions pénales spécifiques pour certaines infractions spécifiques.
Le délit de presseExemple : « si quelqu’un diffame un autre par des discours ou des libelles, qu’il soit puni de bastonnades ».
Une peine du parricide (qui a tué son père ou sa mère) par une peine de mort aggravée. Le parricide est un crime tellement atroce, que le criminel ne mérite plus de voir le soleil et le code pénal de Napoléon prévoira encore en cas de parricide que le condamné à mort doit être exécuté la tête couverte.Exemple : « si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’on lui enveloppe la tête, qu’on le couse dans un sac et qu’on le jette dans le fleuve ».
Par ailleurs, cette table contient aussi des dispositions relatives a un droit très archaïque c’est-à-dire pour la répression des assassinats commit par la magie ou le poison.Exemple : « si quelqu’un a tué un homme libre et a envoyé à la mort par enchantement ou par poison, qu’il soit puni du dernier supplice. ».
On a aussi du droit civil et droit privé en matière familiale, qui est un droit qui donne toute autorité au chef de famille c’est-à-dire une autorité complète sur sa famille (sa femme et ses enfants) et ce modèle familial complet du père va se trouver dans le code civil de 1804 et perduré jusqu’en 1960 ou la femme est sous la tutelle de son mari.Exemple : nos grand-mères si elles voulaient ouvrir un compte en banque, il fallait avoir l’autorisation du père.
On peut dire aussi jusqu’en 1946 un père de famille pouvait également faire emprisonner à sa demande et a ses frais un enfant mineur ( -21 ans).
Texte du droit romain on trouve la table IV , « Du droit paternel et matrimonial » :On trouve que le père a sur ses enfants nés d’un mariage légitime le Droit de vie et de mort et la faculté de les vendre comme esclave (quelque soit l'âge de leur enfant).Qu’il soit permit au père de tuer sur le champ son enfant notablement difforme au jugement de 5 de ses voisins.Prévoit la situation des enfants posthume (né avant la mort du père).Exemple : « si un enfant est né après le 10e mois de dissolution du mariage (par la mort), qu’il soit réputé légitime ».
La table V s’intéresse au succession et au mécanisme de tutelle :Elle pose le principe d’une liberté absolu au manière de succession testamentaire :De quelque manière qu’un père de famille est disposé de ses biens et est réglé la tutelle de ses enfants que ses dispositions et force de loi. C’est une question qui va agiter le droit civil jusqu’à sous l’ancien régime.
C’est une source de débat au XXIe et les anglo-saxons reste attaché à la liberté testamentaire héritée des romains à l’encontre de certains enfants. Le code civil français a prit l’option de limité la liberté testamentaire afin de procédé au rééquilibrage du partage des fortunes.
On a des éléments de droit rural qui prévoit d’abord le régime de servitude et des droits du voisinage :
Table VIII : prévoit le cas d’un arbre s’inclinant sur le terrain d’autrui et dont les branches sont nuisibles au terrain voisin, les branches sont élagué d’une hauteur de plus de 15 pieds (15x30cm).Table VII des dispositions concernant la sécurité des biens à la campagne, le délit d'incendie volontaire ou involontaire.Exemple : « Que celui qui avec intention aura mit le feu à une maison ou un tas de blé près d’une maison, soit battu de verges et ensuite jeté au feu. Mais si c’est par imprudence, qu’il répare le dommage et s’il n’est pas en état qu’il soit puni mais moins sévèrement que s’il l'a fait volontairement ».
2. La mise en place d’une procédure permettant aux citoyens d’obtenir justice par la voie d’un procès.
L’idée de base, c’est que les règles de la loi des Douze Tables sont des normes juridiques a caractère impératif , cela ne veut pas dire qu'antérieurement à la loi des 12 tables il n’existait pas des règles de droit, il en existait, mais les citoyens ne pouvaient pas encore bénéficier de leur implication devant un juge car celui-ci pouvait refuser de se prononcer sur le bien-fondé de la demande.
Comment la justice était rendue dans la République Romaine avant la loi des 12 tables ?Elle était rendue de manière totalement discrétionnaire par l’un des deux magistrats (politiques) qui porte le nom de Consul ou le Préteur (deux termes synonymes).
Qui sont les Consuls ?Ces Consuls avaient hérité du pouvoir de commandement suprême nommé Imperium détenu par les rois, qui recouvre le pouvoir militaire et pouvoir judiciaire des anciens Rois. Ces Consuls n’étaient pas des Rois, ils étaient
élus par l’élite sociale des Sénateurs pendant 1 an.Quand un Consul était saisi d’une plainte ou d’une différence entre citoyens, il était totalement libre de donner la suite qu’il voulait donner à l’affaire et il pouvait aussi étouffer le conflit ou l'ignorer sans se justifier (c’est la toute puissance des Rois) car dans la typologie des régimes politiques élaborés par Aristote, la monarchie est caractérisée par le fait qu’un seul gouverne sans aucun partage mais dans l'intérêt général.
Avec la loi des Douze Tables, il y a un changement car tous citoyens a le droit de se voir reconnaître en justice . Chaque citoyen peut demander au juge une examination de la cause : il ne peut plus rejeter l'affaire. C’est un grand pas pour l’humanité mais juridiquement limité par des conditions d’ouverture d’un procès entouré d’un très grand formalisme. Ce formalisme montre qu’on est encore dans une époque archaïque du droit et d’un droit qui n’est pas encore totalement déconnecté du caractère surnaturel imaginaire. Le rituel d’un procès s’apparente à l’origine d’un rituel magique et des formules magiques et des simulacres de combats violents. Le procès n’est possible que dans les cas strictement défini par la loi des Douze Tables et ces lois confèrent dans le droit prévu des ACTIONS et ces actions c’est le droit de saisir la justice appelé « Actio legis » cela veut dire que chaque fois que la loi a prévu une action et que les conditions prévues sont remplies, le consul a l’obligation d’organiser un procès et ensuite cette obligation va peser sur un autre magistrat : le Préteur Urbain nommé Praetor urbannus. Si la moindre erreur est commise dans la demande, et bien le procès n’a pas lieu, notamment le cas où l'on emploi un mot pour un autre.Exemple : pour se plaindre d’un dégât commis dans une vigne, on n’utilise pas le mot « vigne » car la loi des douze tables précise seulement pour « arbre ».
Quelles sont ces Actios légis ?La loi des 12 tables prévoit 4 actions de la loi :
L’action d’enjeu sacré, c’est l’action de droit commun. C'est la reprise du droit qu'exerçaient les pontifes. Cette procédure était une procédure binaire (oui/ non) = action limitée.L’action de pétition du juge : Judicis postulationem. Cet action consiste dans la simple demande adressé aux magistrats de désigner un juge ou un arbitre.L’action de « mainmises » : Manus injectionem, la main qui s’injecte sur une personne. Cette voie d'exécution était surtout utilisée pour les débiteurs et ensuite va être élargie sur de nombreux pointsL’action de prise de gage : Pignoris capionem. (comme un prêteur sur gage, aujourd'hui ).
Pour toutes ces actions il y avait des paroles qui fallait impérativement prononcer et des gestes rituels qu’il fallait effectuer.Exemple : pour l’action d’enjeu sacré, utilisé pour revendiquer la propriété d’une chose mobile (= esclave), le revendiquant tient à la main un baguette et il appréhende l’objet du litige en utilisant la formule « Cet Homme m’appartient car je lui ai imposé la Vindicte (= Vindicta, petite baguette qu’il a à la main) et son adversaire prononce les mêmes paroles avec les mêmes gestes. Ensuite, le préteur déclare « lâchez tout de l’Homme ».
Avec le temps, ces actions de système de la loi est regardé comme étant de plus en plus archaïques et va tomber en désuétude et il va être supprimé par une réforme en -120 avant J.C, et a ce moment le système primitif est remplacé par le système formulaire.Le système formulaire où le magistrat public écrit une formule qui défini avec précision la mission et les pouvoirs du juge dans le procès qui va commencer, et qui précise la règle de droit qui va devoir être appliqué . Pour comprendre, il faut rentrer légèrement dans les détails. L’organisation d’un procès dans la Rome Républicaine s'organise différemment d’un procès en France au XXIe mais certaines règles du procès équitables trouvent leur pratique dans la pratique judiciaire romaine, en particulier le principe du contradictoire. L’idée de base pour le procès a Rome, il s’organise de 2 étapes distinctes :
La première étape est confiée à un magistrat public qui va être le consul ou préteur urbain.La deuxième étape est confiée à un juge privé.
Dans le système romain le magistrat exerce une magistrature de type politique et il ne juge pas lui-même mais il va désigner un particulier choisi parmi les notables qui va dire le droit dans le conflit en cours conformément à la loi des douze tables.
Distinction entre les 2 : distinction symbolique et de la hauteur du droit car ce magistrat public, il est la voix du droit et il doit le déclarer : Juris dictio. Ce magistrat va faire exécuter la décision en disposant de la puissance publique, de l’Impérium. Par contre, le magistrat ne va pas s’abaisser a rentré dans le détail complexe des deux individus et il ne s’abaisse pas a entendre les arguments et éventuellement mensonge des deux partis, il ne règle pas le contentieux et il désigne un juge qui va examiner les faits de la cause. Ce juge va devoir entendre les parties en conflits avant d’arrêter son opinion et c’est l’origine du principe contradictoire et enfin il va rendre une
sentence : Santentia signifiant opinion au sens large.
La loi des douze tables introduit au-delà des actions de la loi, des garanties de procédure dont certaines survivent à l’époque contemporaine. Ainsi la table I est consacré aux situations en justice, le principe c’est que toute personne appelée en justice pour un procès doit comparaitre et a défaut, le requérant peut le faire arrêté en présence de témoins. La loi des douze tables prévoit aussi le cas du défendeur malade ou vieux, on lui donne un cheval ou un char. En terme de procédure, la loi des douze tables règle aussi la durée des audiences qui ne peuvent dépasser le couché du soleil avec l’idée qu’on ne juge pas très bien quand on juge tard le soir . De plus, l’éclairage n’est pas encore bien connue. Principe des cautions qui est que seul un homme riche peut être caution d’un riche par contre toute personne peut être caution d’un pauvre.
Conclusion : Finalement quelque soit les limites et les archaïsmes du droit mit en place par la loi des douze tables, cette reforme a eu l’immense mérite qui est de faire quitter la règle de Droit du domaine de l’abstraction et désormais le droit en tant que création du droit humain est reconnu comme un outils, qui peut être mit en oeuvre par les citoyens devant une autorité judiciaire avec une procédure bien défini.
II. Le développement de la loi dans la civilisation romaine.
Le mot « loi » apparait en latin dans le titre de « la loi des Douze Tables », LEX (=loi) LEGIS, (= écrite) ce qu’il faut dire c’est que l’idée selon laquelle Rome serait la patrie de la loi écrite car même a Rome la loi écrite n’a pas occupé tout l’espace normative du point de vue quantitatif parce que pendant toute l’époque République, 5 siècles, il y a relativement peu de lois véritables, 800 loi en 5 siècle. C’est sous l’Empire que les lois deviennent vraiment nombreuses.Pendant toute l’époque républicaine, la loi c’est un acte particulièrement fort et solennelle et elle est principalement reversée a des questions relativement politiques relevant du droit public. Finalement dans toute l’histoire de la République, il n’y a eu que 24 lois se rattachant au droit civil, cela veut dure qu’a coté de la loi il y a de nombreuses autres normes juridiques qui sont écrites.
A. La variété originelle des normes écrites sous la République, concurremment avec les lois Stricto sensu
Ces normes juridiques sont soit écrites, soit non écrites et relèvent alors du concept de coutume. En réalité, au départ, l’essentiel du droit privé est de nature coutumière puisque au-delà des principes majeurs posés par la loi des douze tables, les relations juridique dans le détails sont régit par la coutume.Il faut nuancer, si le droit civil romain repose au départ sur un force socle coutumière, au cours des siècles et particulièrement à l’Empire, de multiples normes écrivent vont se superposer à la coutume pour finalement formé ensemble : le droit civil romain classique.
Les romains ont une terminologie pour désigner la coutume, qui évolue avec la complexification du droit. Au départ, le terme utilisé est MOS : c’est un usage et aussi une manière de se comporter qui donnera le mot « moeurs » avec l’idée que dans les moeurs il y a des idées coutumières.
Vers la fin de la République un autre mot utilisé pour désigner la coutume : Consue tudo, il va être reprit par le latin pour désigner les coutumes médiévales. La coutume est définie par la fin de la République, par Cicéron « la coutume c'est un droit qu’un long espace de temps a laissé obligatoire par la volonté de tous et sans l’intervention de la loi ».Les juristes de l’époque République reconnaissent à la coutume, une importance juridique comparable à celle de la loi car une coutume peut faire tomber la loi en désuétude.Puisque les juristes romains en plus de la coutume reconnaissaient qu’en dehors de la coutume, qu’il existait des catégories de normes écrites en plus de la loi au sens stricte. A l’époque de la République, Il y a 4 sources de droit écrit, en plus de la loi définie par Gaïus :
« Les plébiscites, « c’est ce que la plèbe prescrit et établie ». Sous le nom de peuple on comprend tous les citoyens : les plébéiens et praticiens, et la plèbe ceux sont les citoyens non patriciens.Autre norme : SENATUS CONSULTE, c'est ce que le Sénat prescrit et établi.Les édits des magistrats du peuple romains, plusieurs types édits :Les édits des prêteurs urbains, ceux sont les normes promulguées dans les cités des provinces romains.Les édits des EDILES CURULES ceux sont des magistrats inférieurs des cités romaines qui ont a la fois des attributions municipales : approvisionnement de la cité en grains et eau potable et organisations des jeux publics et les activités juridictionnelles (juge pour affaires pénales). Ces édits peuvent promulguer des édit pour la cité.
Les réponses des Prudents, ceux sont des consultations juridiques données par des personnes auxquelles il a été accorder de créer du droit. Cette réponse est un concept intermédiaire entre doctrine et jurisprudence (= réponses des prudents) des tribunaux de notre ère actuelle.
B. L’élaboration de la loi romaine
La généralité, l’idée au départ sous la République, il y a plusieurs types de normes écrits parallèles et une seule catégorie porte officiellement le titre de loi au sens strict, c’est ce que le peuple prescrit et établit. Et pour désigner cette loi, les romains utilise l’EX ROGATA (= loi votée par le peuple).
Il va y avoir une importante évolution, et plusieurs appellations vont renvoyer à des actes normatifs qui ont acquis la même valeur juridique et donc qui peuvent tous être assimilé au concept de loi, ainsi les Plébiscites acquièrent valeur législative par une réforme en -287 (IIIe siècle avant notre ère) c’est ce qu’on appelle L’EX HORTENSIA issu par un magistrat romain, qui est un dictateur provisoire : HOSTENSUIS opposant les Plébéiens aux Hortensiens et les Plébiscites sont entièrement assimilés aux lois.L’évolution se poursuit parce que dans le IIe siècle de l’Empire, les réponses des Prudents acquièrent aussi une force de lois a conditions que tous les auteurs soient d’accord entre eux, réforme dut à l’Empereur HADRIEN.A propos de la loi Strito sensu , il vaut distinguer :
La période RépubliqueLa période Impériale
Mais en même temps les procédures d'élaboration ne doivent pas être opposé de façon systématique parce que la procédure législative République continu de fonctionner durant le 1er de l’Empire, en particulier, on vote toujours des Plébiscites qui ont valeurs législatives depuis que la l’Ex rogata est tombé en désuétude.
Au début de l’Empire, l’ancien système perdure parallèlement avec la promulgation de nouvelles règles qui sont la constitution des Empereur, qui font prendre une place de plus en plus importante.
1. L’élaboration de la loi à l’époque de la RépubliqueDans quelle mesure, la conception moderne de la loi, s’applique-t-elle sur la tradition du droit romain ?Qu’est-ce que la loi à l’époque de la République ?Gaius : « la loi est ce que le peuple prescrit et établi », et cette loi elle est désigner sous un terme plus long que la loi, c’est la Lex rogata (= loi officiellement demandée et voté par le peuple)». Pour le vote de cette loi, il y a 3 étapes :
L'initiative, seul peuvent prendre l’initiative de loi des magistrats publics appelé « Consuls », qui sont les plus hauts personnages politiques de la République. Ils sont élus pour un mandat d’un an. Ces consuls se sont substitués au Roi après l’abrogation de la monarchie (= proclamation de la République).Exemple : Consuls les plus connus « Jules César » (-59 avant J.C).
Un des deux plus hauts personnages politiques de la République romaine : les Consuls. Dès qu’ils ont écrit un projet de loi, il est affiché sur le forum.
Le vote de la loi, appartient à l’Assemblé des Comices : le nom donné à l’Assemblé Politiques du peuple romain. Cette assemblée qui reprend l’ensemble des citoyens romain comprend :Les citoyens Plébéiens (roturiers).Les citoyens Patriciens (aristocrates).Les patriciens sont les membres d’une cinquantaine de familles particulièrement anciennes et riches.
Les Comices qui votent la loi se tiennent uniquement dans la ville de Rome, à des jours favorables qui ont été désignés par les Hospices (= les intersignes, la couleur des boyaux des poissons, le vol des hirondelles...). Il y a la fois une notion de modernité et d’archaïsme.
Les Comices rassemblent une forte population. Pour des raisons pratiques, les citoyens romains ont été subdivisés en 200 groupes appelés « Centuries » (= phénomène de démocratie directe). Une centurie ne correspond pas à 100 citoyens, mais au contraire le nombre de citoyens est variable d’une centurie à l’autre , en particulier les citoyens les plus riches et les plus aisées sont rassemblés dans des centuries à effectif faible ont le même poids électoral que des centuries qui comportent beaucoup plus de citoyens. Ce système revient a donner un poids politique supérieur aux personnes riches. Ce système de Comices, de poids relatif supérieur aux
personnes aisées est retrouvé dans le système des états généraux de la France sous l’ancien régime, car les états généraux sont répartis en trois Assemblées :
La chambre du premier ordre (Clergé).La chambre du second ordre (Noblesse).La chambre du troisième ordre (Tiers-Etats).
Chaque chambre pèse 1/3 dans le vote de la décision sous l’ancien régime autocratique ou tyrannique. Ces comices, une fois assemblés, vont discuter du texte proposé par les Consuls en un débat public (personne qui n’ont pas le statue de citoyens romains, étrangers ou gens du reste de l’Italie peuvent y accéder). Les citoyens membres des Comices ne peuvent pas amender le projet proposé par les Consuls. Donc leur, vote en réalité est plutôt un avis positif ou négatif sur le texte. Si les débats montrent une hostilité des citoyens, ils peuvent être interrompus à tout moment par un Consul. Chaque signe peut servir de prétexte pour stopper le débat (droit archaïque, liaison avec la magie).
La confirmation de la loi, le vote des Comices n’est pas suffisant en soi pour rentre la loi exécutoire. Il faut que cette loi soit confronté par une institution appelée « Le Sénat Romain » . C’est le Sénat qui va rendre la loi exécutoire en lui transmettant son autorité. Le Sénat va revêtir la loi de son Autoritas par le biais d’un acte juridique : Le Sénatus consulte. Cette décision du Sénat est un pouvoir discrétionnaire : il a le dernier mot et peu refuser de rendre exécutoire une loi approuvée par les Comices sans se justifier.
Le Sénat Romain existe dès l’origine de Rome, dès l’origine monarchique. Il va survivre a tous les régimes (Monarchie, République, Empire). Au départ, le Sénat est une sorte de conseil de gouvernement qui aide le Roi à diriger la coté de Rome. On trouve dans ce Sénat une assemblée aristocratique composée de citoyen appartement à l’ordre équestre, catégorie plus large que celle des patriciens. Au départ on y trouve les citoyens chois par le Roi pour former les cavaliers dans l’armée romaine, qui est avant toute une armée de fantassins, beaucoup de légionnaires à pieds. Les citoyens les plus aisés ont un cheval et font partie de l’ordre équestre. Il y a une évolution au cours de la République : l’ordre équestre se transforme dans sa composition, il se fait plus nombreux et il n’a plus de fonction militaire. On y trouve surtout des administrateurs, des banquiers, des collecteurs d'impôts.
La compos ition de Sénat : au départ est choisi discrétionnairement par le Roi parmi les citoyens de l’ordre équestre. Sous la République, la désignation des sénateurs est faite par un magistrat politique, public, chargé de tenir à jour les listes électorales, appelé censeur. Faire le recensement, issu de censeur. Pour pouvoir être choisi comme sénateur par le censeur, il fallait appartenir à l’ordre équestre et avoir déjà exercé des magistratures politiques. Le nomination au sein du Sénat est une récompense après une carrière politique.
Les sénateurs sont 300 au départ, puis 600 et ont un mandat à vie. On retrouve cette idée très longtemps, après, par exemple sous la IIIe République française de 1870, la C e 1875 prévoit 75 sénateurs qui le seront jusqu’a la fin de leur vie.
Les sénateurs ont le dernier mot sur la loi. S’ils ne veulent pas donner l’Autoristas, la loi n’existe pas. Cependant, cette situation peut générer des frictions avec une partie du peuple, et avec les Plébéiens. Le peuple a imposer une modification de la procédure en -339 avant JC, dans les débuts de la République. Désormais le Sénat est consulté avant le vote des Comices et rend simplement un avis sur le projet de loi déposé par les Consuls . Pour la plus grande partie de la République romain, le dernier mot appartient donc aux Comices.
Question pratique : la diffusion de la loi. Le texte de loi déposé un Temple appelé « le Trésor du peuple », il ne fait pas l’objet d’une publication officielle par affichage comme de la loi des douze tables. La législation romaine va conserver un caractère relativement secret. Ceux qui vont bien connaitre la législation romaine sin les prêtres des Temples, les Pontifes.
Loi Stricto sensu = la Lex rogata.
Il y a une fusion entre les lois et les Plébiscites : évolution de la norme législative. Les plébiscites étaient des normes juridiques qui ne s’applique qu’aux citoyens Plébéiens, mais pas aux Patriciens. Au départ les plébiscites n’étaient pas considéré comme des normes législatives, loi comme la Lex rogata.Il va y avoir une évolution progressive qui tient à l’affaiblissement des Sénateurs et des Patriciens dans l’élaboration de la loi véritable la Lex rogata car depuis -339 avant JC les Comices dominent l’élaboration de la loi, et à l’intérieur des Comices les Plébéiens occupent une écrasante majorité. A la fin de la République, il n’y a plus que 14 familles Patriciennes (50 au départ). L’aristocratique s’est affaiblie aux cours des siècles.En -287, réforme due à un dictateur, Hortensius . Les Plébiscites vont devenir des normes générales et
impersonnelles qui s’imposent à tous, aussi bien aux Plébéiens qu’aux Patriciens. Procédure législative très proche de celle des lois véritables et la Lex rogata. Elle est simplifiée du fait que, au départ, les Plébiscites ne s’appliquent qu’aux Plébéiens et pas aux familles Patricienne. L'initiative n’appartient pas aux Consuls mais à un magistrat public un peu inférieur, le Tribum de la Plèbe, c’est celui qui parle pour défense les intérêts de la Plèbes et ce Trubum est celui qui préside l’assemblé de la Plèbe (plèbe + patricien). Ensuite le vote, ce fait ensuite par l’assemblé des Comices organisés en tribus (plébéiens) et pas en centuries.
Pour les plébiscites, il n’y a pas de confirmation par le Sénat leur conférer l’Autoritas. Les plébiscites ont une valeur juridique, contrairement à ce qu’on pourrait penser, ils sont considérés comme ayant une valeur sacrée le droit applicable uniquement à la Plèbe est considéré comme étant un droit « Sacro-saint », qui ne peut jamais être abrogé en théorie.
2. L’élaboration de la loi sous l’Empire
L’Empire a été proclamé en -27 avant JC en faveur d’un fils adoptif de Jules César. Octav qui a reçu le titre d’Empereur Augustin.Les Empereur vont ménager sur le long terme la transition entre la forme républicaine du gouvernement et la forme monarchique, ce qui veut dure que pendant les 2 premiers siècles de notre ère, les institutions Républicaines continuent a exister du point de vue formel même si elles sont vidées de toute leur substance. Au début les Empereurs n’osent pas revendiquer l’exercice d’un pouvoir législatif. Ils vont en faire la conquête en 3 étapes :
Les Empereurs vont exercer dans les faits, certains pouvoir législatif par le biais des Sénatus consultes. Le terme Sénatus consulte désigne deux réalités différentes : Sénatus consultes qui investissent la loi de l’autorité suprême de Sénat.Sénatus consultes ordinaire qui sont des simples avis du Sénats, en dehors du vote de la loi et apparu dans les 2 derniers siècles de la République, ils ne sont pas des lois véritables car il sont dépourvu de sanction. En théorie, les magistrats politiques et judiciaire étaient libre des les exercer ou non. En réalité, ces Senatus consultes jouissaient d’un immense prestige qui est le reflet de la place centrale occupée par le Sénat dans les institutions de la République Romaine. Il sont d’ordinaires sont exécutés, ils ont été à l’origine de plusieurs réformes législatives importantes.
Avec la mise en place de l’Empire, l'Empereur va pouvoir présider le Sénat et il peut proposer le sujet d’un Sénatus consulte en prononçant un discours « le discours du prince », l’Oratio principis. Après le discours, Sénatus consulte lui-même est la mise en forme juridique et technique de la volonté de l’Empereur. L’autorité personnelle de l’Empereur impose a tous d’appliquer scrupuleusement le Sénatus consulte, même si en théorie, il ne prévoit pas des sanctions pénales.
Conséquence : reforme qui a lieu durant le règne de l’Empereur Hadrien en 133 après JC, qui règne de 117-138, la réforme assimile pleinement les Sénatus consultes à la loi véritable la Lex rogata.Cette réforme est appelée le Sénatus consults tertullien, car même sous l’Empire, on conserve la pratique héritée de la République, consistant à nommer les Sénatus consultes et les lois par le nom du Consul en charge. Durant l’Empire, la fonction de Conseil n'a pas été abolie mais est devenue un titre honorifique. Ce premier sénatus-consulte législatif est un sénatus-consulte qui réforme le droit successoral et qui, désormais, autorise les femmes à succéder à condition qu'elles aient été mère d'au moins 3 enfants.
Avec le temps l'évolution se poursuit et le Sénat ne prend même plus la peine de rédiger un véritable Senatus-consulte, et désormais le « discours du prince » tient lieu de Senatus-consulte. Ces Senatus-consultes devenus inutiles vont tomber en désuétude au IIIe siècle . Finalement ils ont surtout été utilisés de manière transitoire par les Empereurs pour préparer l'acceptation d'un véritable pouvoir législatif.
L’utilisation par l'Empereur d’un droit reconnu à l’époque Républicaine à tous les magistrats du peuples romains : le droit d’édicter.
À l'époque républicaine, tout magistrat public ont le droit de promulguer des édits applicables pour la durée de leur mandat correspondant à une année. Ces édits sont des prescriptions d'ordre général valables sur tout le territoire de la République mais qui ne concernent que certaines catégories de personnes. Les Empereurs vont utiliser cette prérogative, mais vont la débarrasser de ses limites traditionnelles. Ils vont pouvoir promulguer des édits à n'importe quel moment de leur règne et sur n'importe quel domaine. En théorie, les édits impériaux s'imposent à tous sans contestation possible. En pratique, les Empereurs font preuve de prudence et ménagent la transition politique en respectant quelques formes républicaines, en particulier, les édits ne comportent par la
formule « l'Empereur ordonne » mais « l'empereur est d'avis que ».
Le transfert à l'Empereur du pouvoir suprême qui, en théorie, était détenu par le peuple sous la République. Ce pouvoir suprême était l'imperium. Ce transfert se fait dans la deuxième moitié du IIe siècle. L'Empereur est investi de l'Imperium désormais, et qu'à ce titre il peut librement élaborer des normes juridiques appelées les Constitutions Impériales. Le mot Constitution devient alors un terme juridique qui désigne toutes les décisions impériales permanentes prises par l'empereur.
Ces Constitutions sont élaborés par le conseil de l'Empereur et parfois en présence de l'Empereur mais ces Constitutions impériales ne donne lieu a aucun vote. Gaïus « on n’a jamais douter que les Constitutions impériales aient forme de loi parce que l’Empereur se voit conférer le pouvoir impérial par la loi ». Il y a trois types de Constitutions impériales :
Les édits, est le pré-emploi de la terminologie des magistratures républicaines. Sont une Constitution impériales a portée générale et impersonnelle qui constitue une véritable norme législative. Ils s’appliquent à tous dans l’ensemble de l’Empire et peut avoir une portée limitée à certaines provinces ou certaines catégories de personnes.Les rescrits, expression de la volonté de l‘Empereur pour des questions d’importance moindre. C’est la réponse apportée par l’Empereur à une question juridique inédite qui n’a pas encore été résolue, qui a été soumise à son conseil par un conseil de l’empire ou un simple citoyen. La réponse est faite sur la lettre contenant la question qui est réutilisé.Les décrets, le mot doit être compris avec précision car il ne correspond pas au sens actuel. C'est un jugement définitif rendu par l'empereur dans le cadre de procès importants montés jusqu'à lui. Ce jugement impérial va rapidement acquérir une force normative. Elle va constituer un précédent qu'il sera obligatoire de suivre dans tous les cas similaires. Au niveau suprême de l’État, il peut y avoir des procès dont la décision devient impérative. À l'origine du droit administratif français, jurisprudentiel, conseil d’État qui, pendant la première moitié du XIXe siècle, était présidé par le chef d'Etat.
Progressivement, les juristes romains vont théoriser le pouvoir législatif de l'Empereur. Pour eux, la volonté impériale, lorsqu'elle est exprimée sous un acte public, a force de loi en vertu d'une délégation générale du pouvoir législatif que lui a donné le peuple romain lors de l'investiture impériale. Ce principe sera repris par les juristes médiévaux pour donner au Roi le pouvoir législatif.
C. La civilisation partielle et progressive de la « Jurisprudence »
Le concept romain de jurisprudence, Luris prudentia, fait référence à ce que les romains appelaient les « réponses des prudents » : ce sont des sentences des consultations rendues par ceux auquel il a été accordé le droit de créer du droit. Ces « réponses des prudents » s'apparentent au concept actuel de doctrine juridique, ça ne correspond pas a concept moderne de jurisprudence.Le début de cette doctrine remonte vers l'an -200. À ce moment, on assiste à une laïcisation et démocratisation de la possibilité de dire le droit en dehors des procédures législatives. Avant, la possibilité éventuelle de donner des « consultations juridiques » était réservée aux pontifes.
Au IIe siècle, on voit apparaître les premiers jurisprudents, jurisconsultes laïcs. Ce sont des avocats et des praticiens du droit qui rédigent des avis très techniques sur des questions pratiques qui vont être très ponctuelles. Progressivement, ces jurisconsultes vont quitter cette idée de recette juridique pour avoir une approche plus abstraite du droit sous l'influence de la philosophie grecque, d'Aristote. Ils vont commencer à comparer les règles juridiques en vigueur, et essayer de les regrouper selon une certaine logique. Ils vont adopter les même démarches dans le cadre de décisions prises dans le cadre de procès entre particuliers. Petit à petit, ces jurisconsultes vont commencer à créer des catégories juridiques et vont opérer un début de théorisation. Cicéron disait : « l'art du bon et du juste ». Ces praticiens vont devenir des sages en droit, des jurisprudents. Les jurisprudents sont ceux qui ont la sagesse du droit. Ils restent des personnes privées, mais vont souvent être consultés par des magistrats publics, notamment le préteur.
Ces jurisprudents vont jouer un rôle majeur dans la formation de la science du droit. Dans les premiers siècles de l'Empire, la renommée des jurisprudents augmente encore. Lors d'une réforme de l'année 134 par Hadrien, la réponse des prudents doivent être considérées comme ayant force de droit lorsque les divers auteurs sont d'accord entre eux. Il y a quatre juristes célèbres :
Gaïus (vit au milieu du IIe siècle).Papinien (début IIIe siècle, né en Syrie, préfet du prétoire, contrôle la justice pénale pour toute l'Italie, sauf
Rome, meurt en 212, condamné à mort par Caracalla).PaulUlpien (meurt en 223).
L’autorité de ses jurisconsultes est relative car il reste des personnes privées même si leurs consultations peuvent être utilement utilisées dans les procès. Les choses vont changer au Ve siècle, à l’extrême fin de l’Empire romain puisque un l’Empereur Théodose va reconnaitre officiellement l’autorité des 4 jurisconsultes : Gais, Papinien, Paul et Ulpien. Cette reconnaissance apparait en 426.Ceux sont désormais les seuls qui puissent être invoqués lors d’un procès, ils ne peuvent plus utiliser le point de vue des autres jurisconsultes. Les écrits de ses 4 jurisconsultes ont force de loi. L’empereur envisage le cas où ces 4 jurisprudents ne sont pas d’accord : il faut obligatoirement adopter l’opinion de la majorité (3 contre 1). L’empereur prévoit qu’une cas d’égalité d’opinion contraire, l’opinion de Papinien doit être suivie. De surcroit, si on connait bien ces auteurs c’est car leurs œuvres juridiques vont être mise à disposition lors de la codification du droit par l’empereur Justinien d’Orient entre l’année 529 et 565.
III. La codification de droit romain
On parle de « codification » du Droit romain parce qu’il s’agit essentiellement d’une compilation résonné et sélective de l'ensemble du droit romain existence et encore en application a cette époque. Cette idée de compilation/codification ne correspond pas totalement a notre concept moderne de codification car le mot « codification » a 2 sens :
La codification formelle ou codification administrative, c’est la réunion dans un seul ouvrage de toutes les dispositions législatives ou règlementaires déjà existant en une matière, en apportant quelque modification de forme pour rendre les règles de Droit cohérentes. Cette codification correspond bien à la codification romaine. Mais le mot « Code » de nos jours a aussi un autre sens.La codification réelle : un ouvrage neuf issue d’un profond mouvement de réforme opéré par le législateur.Exemple : le code civil de Napoléon de 1804.
Justinien occupe une place centrale mais pas toute la place. Le phénomène de codification était déjà lancé.
A. Les prémices de la codification
Globalement, le droit romain a été transmis au Moyen Age occidental et à notre époque au travers de la compilation réalisée au VIe siècle par l'Empereur Justinien, à travers le Corpus Juris Civilis. Pour autant dès avant le Ve siècle, la nécessité s'était faite sentir par le fait de mettre de l'ordre dans l'immensité des dispositions juridiques.
En -27 avant Jésus-Christ, C’est un fils adoptif de Jules César, Octav qui va avoir le titre d’Empereur et la mise en place de l’Empire. Ce besoin de présenté le Droit romain d’une manière cohérence a d’abord été ressenti par les jurisprudents les plus réputés et ces jurisprudents vont commencer a enseigner le droit et une réflexion intellectuelle.L’enseignement du droit à Rome (= tout l’Empire romain), il apparait au dernier siècle de la République, c'est-à-dire au moment ou arrive l'expansion territoriale de Rome qui va faire la conquête de tout l'Occident et cela entraine de nombreux échange économique et commerciaux sur ce territoire, il sera nécessaire de connaitre le droit en pratique car il faudra une nécessité juridique dans tout l’Empire.
Problème : jusque là, le droit restait un domaine mystérieux malgré la promulgation de la loi des douze tables, mais on ne connaissait rien car la loi était conservée dans les Temples. Ce qui veut dire qu’en connaissance du Droit se transmet à l'intérieur de quelque famille aristocratique entre père en fils, ou de maitre a disciple.Au début de l’Empire on voit apparaitre un enseignement public du droit qui se fait selon 2 axes :
Un axe théorique lié à la rhétorique c’est-à-dire la beauté de l’argumentaire et la logique.Un axe plus technique des règles juridiques liées au contenu des règles juridique.
Cet enseignement est donné par 2 catégories de personnes différentes :
Pour ce qui relève de la théorie : par les Rhéteurs, ceux sont professeur d'éloquence proche des philosophes et personne politiques, que des jurisconsultes. Ils forme les futurs avocats à l’art de la plaidoirie.Pour le coté pratique est enseigné par certains jurisconsultes qui acceptent que les gens assistent aux consultations juridiques qu’ils donnent aux particuliers. Certains jurisconsultes acceptent même d’enseigner en
plein air, publiquement en répondant à des questions qui leur sont soumises. Les meilleurs jurisconsultes ont élaboré un exposé systématique et une véritable théorie du droit. Et donc parmi ces jurisconsultes qui vont rédige une théorie du droit, Gaius (cours oral professé en 160) et les textes des cours professé par Paule et Ulpien.
Ce besoin de théoriser le droit, de l’enseigner n’est pas suffisant, car les praticiens, les avocats ont aussi besoin de disposer de recueils de textes qui donnent une version fiable des règles juridiques, et ont besoin de recueils de textes qui ne sont pas encombrer par toutes les lois tombées en désuétude. Le droit romain à 6 siècles d’existante, donc évolution = règles tombées en désuétude. Au départ, la loi romaine est très peu développée, plus on avance dans le droit plus il y a de textes.Plus on avance dans le temps et plus il y a de textes.
Au départ, les recueils de texte sont des textes résultants de l’initiative privée et ils font prendre le nom de CODEX qui donne le mot français « Code ».Qu’est-ce que sont ces codes ?C’est un terme générique qui n’est pas spécifique au droit et le code désigne tout écrit rédigé sous la forme d’un « livre » ( = ensemble de feuille parchemin ou papyrus, cousu ensemble relié par des petites blanches en bois). Ces libres sont une innovation apparue dans le premier siècle de l’Empire dans un souci de rationalisation administrative ou il y a de plus en plus d’écrits.Le codex permet une consultation très aisée en tournant simplement les pages. Avant il n’y avait pas de livre, les écrits étaient écrit sur des rouleaux d’environ 10 mètre de long appelé « Volumem » composé de feuille de papyrus collés les unes aux autres. 2 inconvénients :
C’est fragileManiement très compliqué.
Les juristes romains on immédiatement adopté cette forme de codex qui est plus pratique pour conversé les écrits. Ils sont très enthousiastes que le mot « Codex » va devenir un mot désignant un ouvrage juridique. C’est l’époque aussi pour la plupart des rouleaux sont retranscrit en format de livre mais pour autant l’apparition du codex ne fait pas immédiatement tomber en désuétude l’usage des rouleaux et leur usage va se maintenir dans l’Occident jusqu’au coeur du Moyen Age.
1. Les institutes de Gaius (160 après J.C)
Gaius est un professeur de droit, jurisconsulte originaire de l‘Est de l‘Empire romain où la langue est le grec. Il vit au IIe siècle entre 120 et 180 (règne de l’empereur Hadrien et Antonin, Marc Orel). En réalité il va professer un cours magistral théorique entre les années 160 et 162 et on dispose de la trace écrites de ses enseignements par des « Institutes ». Cet enseignement a un très grand retentissement, pour 2 raisons liées à sa nouveauté :
Grande clarté méthodologique.Présenté le droit comme un système complet et intellectuellement cohérent.
Ce retentissement est grand car on trouve trace à Berouth et également l’Empereur Justinien va intégrer de grands extraits des institutes de Gais dans un recueil s'appelant « Digeste » et également l’Empereur explicite qu’il va s’inspirer de Gais quand a sont tour il va promulguer des institutes officielles en 133.
Pourtant, le manuscrit complet des Institutes de Gais semblait avoir été perdu après la chute de l’Empire romain. Il va être redécouvert en 1816 en Italie sous la forme d’un « Palimpseste » (= document réemployé par grattage du texte primitif pour y substituer un nouvel écrit), le premier texte ne disparait complètement, il reste des slams par transparence. Les Institutes de Gais se retrouve sous un texte religieux du Moyen Age. Ce Palimpseste ne peut plus être étudier car les produits chimiques utilisés ont abimé le texte. Le contenu vise a synthétiser une démarche intellectuelle posée par Cicéron au niveau des principes :
Poser les définitions juridiques.Formuler des principes juridiques peu nombreux.On en tire un nombre important de conséquence selon une déduction logique.
Gais est le fondateur de la science juridique. Il défini les concepts fondamentaux du Droit et e n premier lieu, il va distinguer entre Droit civil et Droit des gens : le Droit civil « c’est le droit que chaque peuple s’est donné a lui-même et qui est propre à la cité », alors le Droit des gens c’est « le droit commun a l’ensemble du genre humains, il est établie entre tout les Hommes par la raison naturel et est observé de façon semblable chez tous les peuples
». Cette définition correspond à notre concept actuel de Droit naturel.Exemple : on n’a pas le droit d’assassiner des civils avec des armes chimiques.
Le Droit du positif du XXIe utilise la dénomination « Droit des gens » mais ce droit des gens ne correspond pas au droit de Gais mais au droit international public : les relations entre les Etats.
Gaius distingue entre le Droit des personnes, le Droit des choses et le Droit des actions c'est-à-dire le droit des procédures juridiques. Il va structuré chaque catégorie du Droit civil en différentes sous-catégories logiquement identifiées.La position de Gais sur le Droit des personnes : il va répa rtir le Droit des personnes en 2 sous-catégories :
Individu autonome.Ceux qui sont libres.Libre par leur naissance : les Ingénues.Libre par affranchissement c’est-à-dire d’ancien esclave.
Ceux qui sont théoriquement libre mais sous la tutelle ou curatelle ( = protection détachée de tout critère d'âge ou de filiation et vise les individus qui se mettraient en danger, appliqué aux furieux ou aux prodigues.) liée à la situation des enfants par rapport à leur père.Pour les fils, si à la mort de leur père, ils sont encore impubères.Pour les filles célibataires, mit en tutelle toute leur vie.
Individu soumit au Droit d ’autrui subdivisé en 3 sous-catégories.Individu en puissance d’autrui.Les esclaves.Les enfants légitimes aussi bien biologiques ou adoptif qui reste soumit à la puissance paternelle jusqu’a la mort du père.« Individu en main d’autrui » c’est l’épouse qui a passé 1an sans interruption avec leur mari.Les Individus « en main prose d’autrui ».
Du point de vue formel, comment se présente les institutes ?Le manuscrit de Gaius est subdivisé en plusieurs commentaires et cette subdivision correspond probablement à des semestres d’enseignement oral, en réalité les développements sont structurés selon un plan extrêmement logique :
Les personnes.La liberté.La suggestion.La protection.
Les choses.Les modalités de la propriété.Les mutations de propriété a titre universelle (succession a cause de mort, testamentaire ou non).Les obligations, avec distinction entre obligation contractuelle et obligation délictuelle.
Le contentieuxLes actions avec elles-mêmes. La forme, le sujet, la partie.Les exceptions de procédure.Les interdits permet d’achever un procès rapidement notamment lorsqu’il porte sur un bien dans la concession n’est pas contestée.
Au long des siècles, bien au-delà de l’antiquité, les juristes ne vont guère s’éloigner du plan de Gaius lorsqu’ils veulent exposé de façon synthétique l’ensemble du Droit civil et ce propos va être illustré par 2 exemples :
Le plan fidèlement suivit par Justinien dans ses institutes officielles publier à l’année 533.Le plan en grande partie suivit par le Code civil français dont la structure n’a pas été remise en cause depuis sa rédaction en 1804. la structuration des 3 premiers livres.Premier livre : Des personnesDeuxième livre : Des biens et des différentes modifications de la propriété.Troisième livre : différente manière dont on acquière la propriété avec la succession, les libéralités, des contrats ou des obligations conventionnelles en générale.
2. Les premiers Codes
Le code GREGORIEN, le code HERMOGENIEN et le Code THEODOSIE.
a. Les compilations privées : Code Grégorien, Code Hermogénien
Dès l’époque de Gaius, certains jurisconsultes publient et commentent certaines juridictions impériales rendues à leur époque. Mais il s’agit de premier code qui est des oeuvres privées donc des oeuvres sans valeur officielle.
Ces premiers codes du IIe siècles existe mais aucun n’a été conversé même pas extrasie.Les premiers codes dont de large extrait sont conversé remonte au IIIe siècle, ils datent de la fin du IIIe et sont dut a 2 J urisconsultes :
Grégorien, dont son code est achever vers 271, et il n’a rien a voir avec la réforme Grégorienne et avec le champs Grégorien du Moyen Age car ne n’est pas dut au juriste mais à l’ecclésiastique : Edouard le Grand.Hermogénien, c’est le code qui prolonge dans le temps du précédent code, pour la période 287 à 305.
Ces 2 codes sont des recueils de rescrits impériaux (= questions posées à l’empereur) classés méthodiquement. Il donne le résumé de chaque rescrit, le nom de l’empereur, la date avec précision et le particulier suscité. L’ensemble de ses 2 codes couvre l’activité normative impériale de 196 à 305 (tout le IIIe siècle).Ils ont été partiellement reconstitués au XVIe siècle par des extraits et citations par Jacques Cujas. (1522- 1590)
b. Le Code Théodosien, dû à Théodise II, Empereur de l’Empire romain d’orient (438)
Le contexte : il faut remonter à la deuxième moitié du IVe siècle, l’empire romain doit faire face à une infiltration lente et progressive de peuples considérés comme barbares et ces peuples vont franchirent les frontières et s’établissent à l’intérieur de l’Empire. Des populations non romaines s’établissent donc à l’intérieur de l’empire mais ils restent fidèles à leurs origines. Il y a des guerres.Exemple : dans l’est de l’empire il faut faire face à des attaques de Perse, en Gaulle il y a des combats avec les Goths, dans l’ile de Bretagne attaque des Scots (des Ecossais).
L’objectif pour les Empereurs est de mieux défendre l’empire, la solution est de le diviser en 2 et chaque partie de l’empire aura à sa tête un empereur différent. On a à l’Ouest l’Empire romain d ’Occiden t qui concerne Rome et à l’Est l’Empire romain d’Orient qui a pour capitale l’ancienne ville de Byzance est devenu Constantinople et aujourd’hui Istanbul.Cette division de l’Empire en deux est définitive en 395, c’est la mort de l’Empereur Théodose 1er (dernier empereur de l’ensemble de l’empire) et celui-ci est un officier natif d’Espagne été proclamé empereur en 379. En réalité cette division ne réussit pas à enrayer le déclin de l’empire d’Occident et celui-ci va sombrer progressivement dans des désordres multiples et la ville de Rome est attaquée et dévastée par les Wisigoths. L’empire tombe en décadence, et l’empire romain d'Occident s’achève en 476 avec le renversement de Romulus. (Dernier empereur en titre).
En Orient, va se développer une nouvelle civilisation qui va être la civilisation Byzantine et qui va vouloir assumer la totalité de l’héritage romain après 476 et cet empire romain d’Orient va durer très longtemps, 1 millénaire jusqu’en 1453, date de a prise de Constantinople par les Turcs. Théodose II est un empereur qui règne entre 408 et 450, c’est le petit fils de Théodose 1er, empereur puissant.
Réalisation du code Théodosien : Théodose veut renforcer la puissance politique d’Orient, il veut réguler plus efficacement le fonctionnement de l’empire du point de vue juridique. Théodose veut reprendre à son compte l’héritage législatif de l’empire dans son ensemble et en particulier Théodose va déplorer le très faible nombre de juristes à son époque et leur très faible niveau. Il identifie la cause du mal : c’est l’immense accumulation de livres juridiques et montagnes de constitutions impériales. Tout cela rend l’étude du droit presque impossible.Pour remédier à cela il veut rédiger, promulguer une compilation officielle de toutes les constitutions impériales depuis le règne de Constantin, le code d’Hermogénien. C’est une compilation de 132ans de droit. La tâche est confiée à une commission de 16 personnes qui doivent faire un tri dans la législation impériale, laisser de côté les textes tombés en désuétude et éventuellement remettre à jour d’autres textes qui nécessitent une modification.
Cela correspond à la conception de la codification réelle.La commission va travailler pendant 8ans et le code est approuver officiellement par l’empereur Théodose en février 438 et il a aussi été promulgué dans l’empire romain d’occident par Valentinien III, ce code Théodosien va donc régir l’ensemble de l’empire même si aucun manuscrit complet n’a été conservé. Ce code est divisé en 16 livres, tires méthodiquement classés où on trouve les constitutions impériales classées par ordre chronologiques, les 5 premiers livres sont relatifs au droit civil mais un sens plus restreint que celui donné par Gaius, le droit privé = le droit régissant les relations des individus entre eux. Les autres livres sont consacrés au droit public.Exemple : les magistratures, les matières militaires, fiscales, criminelles.
Le devenir de ce texte à partir de 439, le code Théodosien c’est la seule source du droit impérial mais il faut faire une distinction entre empire d'Occident et d'Orient.
L’empire d'Occident reste en application jusqu’à la fin (476), le code Théodosien est en grande partie intégré dans un recueil élaboré en l’année 506 pour les populations gallo-romaines qui habitent en Gaulle dans le royaume de Wisigoths. Par la suite Clovis qui va devenir le roi des Francs et qui va conquérir l’ensemble de la Gaulle jusqu’aux Pyrénées va considérer que le texte de l’année 506 doit continuer à être appliqué aux populations gallo-romaines. Et donc ce texte va rester partiellement en vigueur jusqu’au IXe siècle (époque de Charlemagne). Cette compilation des Wisigoths est appelé « bréviaire d’Alaric ». L’empire romain d’Orient, le code de Théodose est abrogé lors de la promulgation d’un nouveau code de l’empereur Justinien en 529.
B. Le Corpus juris civilis, oeuvre immortelle de l’Empereur Justinien
Corpus juris civilis : c’est le corps du droit civil, par « corps » il faut comprendre l’ensemble, et « droit civil » désigne le droit civil romain, donc cela désigner l’ensemble de la codification fait par Justinien, mais cette aussi une appellation créer a postériori qui a été donné par juristes du Moyen Aage occidentale et ils l’ont appeler ainsi par opposition au Corspus joris canonici, qui veut dire le corps du droit canon (= droit ecclésiastique).
1. L’élaboration du Corpus juris civilisa. Le contexte politique
L’Empereur Justinien est l’Empereur romain d’Orient dont la capital est Constantinople. Il va régner au milieu du VIe (de 517 à 565).Cette Empire romain d’Orient c’est la seule partie du droit romain qui existe encore car l’Empire romain d’Occident s’est effondré en 476.
La Gaulle a été conquise par les Francs, elle va devenir les royaumes des francs mais également conquise par les Wisitigoths mais aussi par les Burgondes, ils se sont établis à la Bourgonne.L’Italie est conquise par un autre peuple germanique : les Ostrogoths, ils prennent la ville de Rome et il la ravage, ils vont créer la ville Ravenne qui devient la capital des Ostrogoths.L’Espagne a été conquise par les Wisigoths et par les Vandales.Afrique du Nord qui faisait aussi parti de l’Empire romain d’Occident et a été conquise par les Vandales.
Justinien est le dernier natif d’une province nommée Illyrie, dans la ville de Skopje (République actuelle de la Macédoine), il n’est pas natif de Constantinople. Il est né en 482, il devient Empereur car il est le neveu d’un autre Empereur : Justin qui l’adopte comme son fils. Dès son avènement, il a un projet politique très clair : restaurer l’unité géographique et politique de l’Empire romain du point de vue de l’unité juridique . Cet Empire romain qui va laisser des traces fortes dans l’imagination, voeu de remettre en place cet Empire.
Du point de vue géographique, le règne de Justinien est caractérisé par de nombreuses guerres victorieuses, rendues possibles parce que l’Empire romain d’Orient possède une armée puissance dirigée par le générale Bélisaire. Dès l’année 533, il réussit a reconquérir l’Afrique du Nord et à la soumettre à l’Empire. Puis il fait la conquête de la Sicile, de l’Italie continentale et symboliquement conquête de la prise de Rome en 540, mais cette conquête est éphémère car les Ostrogoths réussissent a se rétablir et a chasser les groupes romaines d’Orient.A l’Est de l’Empire d’Orient va être stabilisé car la frontière avec la Perse n’est plus menacée suite à une contre-partie financière.
Du point de vue militaire, le règne est une réussite.
Du point de vue culturel, l’Empire romain d’Orient a abandonner l’usage courant du Latin au profit du Grec. Cet Empire a conservé le Christianisme qui était devenue la religion de l’Empire romain depuis le règne de
l’Empereur Constantin en 313. Simplement le Christianisme est divisé en plusieurs courants et Justinien va défendre vigoureusement le catholicisme orthodoxe (ne pas confondre avec la religion orthodoxe est issue du XIe par le schisme d’Orient), ce qui veut dire qu’il va réprimer les courants Chrétiens déviant et va réprimer de façon sanglante des Juifs dans la Palestine.L’oeuvre juridique de Justien est très profondément imprégné du Christianisme et placé sous l’invocation du Christ et de la sainte-Trinitée, elle peut apparaitre comme l’adaptation de droit romain classique d’une société Païenne a une société devenue Chrétienne. Cela explique pourquoi le Moyen Age Occidentale va pouvoir se ressaisir de l’héritage de Justinien.
Le droit romain qui va être rassemblé par Justinien est destiné a s’appliquer à une société Chrétienne très différente de la République romaine primitive. Cette différence explique qu’il va être nécessaire de faire un trie, une adaptation dans l’héritage juridique de Rome parce que Justinien a la volonté de restaurer ce droit et ensuite de le « transmettre aux générations futures comme le plus précieux des héritages » . L’ambition de Justinien est une ambition qui va se concrétiser et effectivement l’ensemble des systèmes juridiques sont hérités de ce droit romain.
La transformation générale opérée a l’intérieur de l’Empire romain d’Orient a l’époque de Justinien vont faire que cette Empire va prendre le nom d’Empire Byzantin car Byzance est le nom primitif de la ville de Constantinople.
b. La réalisation de la codification Justinienne
Justinien va mettre en oeuvre son projet dès le début de son règne et cette oeuvre va la mener avec persévérance jusqu’a sa mort (pendant 37 ans). En réalité Justinien ne le fait pas seul, en particulier le maitre d’oeuvre est un juriste s’appelant TRIBONIEN (500-547), au départ c’est un professeur de droit. Effectivement depuis un siècle, il existe un enseignement public et concerne aussi le droit qui ne se fait plus nécessairement par des consultations privées.
L’école générale est créée à Constantinople en 425 et dans cette école, il y a 2 professeurs de droit et 29 autres de philosophie, d’éloquence et de grammaire aussi bien en latin qu’en grec. Tribonien va mener une carrière de haut « fonctionnaire » dans l’Empire et il gravi tous les échelons, il devient Consul et Préfet puis Prétoire (dirige la garde de l’Empereur et supervise le fonctionnement de toute la justice pénal).Justinien charge Tribonien de 2 missions principales qui se complète :
Réunir et coordonnée toutes les parties éparpiller de l’Empire romain pratiquement depuis l’origine, donc on va trouver des compilations de la loi des douze tables.Faire la même chose pour les commentaires de toutes les Jurisprudents, mais ça va plus loin, car il faut en extraire les règles juridiques les plus significatives.
L’ensemble de se travail n’a pas pour objet de constituer une base pour une étude historique du droit romain, mais pour Justinien, ce travail s’inscrit comme une oeuvre créatrice de droit positif c’est-à-dire que pour lui, une fois qu’on l’aura réuni, ce droit devrai être appliqué théoriquement dans toute l’Empire romain y compris dans l’Empire romain d’Occident, mais aussi dans tout le monde connu. En réalité cette compilation de Justinien va s’appliqué exclusivement aux territoires qui relève politique de l’Empire romain d’Orient donc de l’Empire Byzantin, cela veut dire aussi que l’Occident ne va pas connaitre le Corpus juris civilis durant toute la partie du Moyen Age, et les premiers juristes du Royaume de France ne connaitront que des résumés plu s ou moins du code de Théodosien.Finalement, la redécouvert du Corpus juris civilis va en réalité être une découverte pour l'Occident.
Tribonien ne peut pas réalisé cette oeuvre tout seul, il va s’entourer des juristes les plus réputés de son époque avec 5 fonctionnaires au palais royale et 2 avocats et pour ce qui est du tri de toutes les oeuvres des juriconsults, il s’appuie une commission de 16 membres avec quelques fois la présidence de l’Empereur. Il s’agit d’étudier tous les auteurs de droit romain depuis la fin de l’époque républicaine jusqu'au IIIe siècle : la Jurisprudence classique. On se rend compte que cela représente 1600 ouvrages a analyser du a 38 auteurs. Le principe de cette commission des de diviser par 20 le volume des écrit juridique qui doivent être conservé et qui méritent d’être reconnue comme ayant encore pleine valeur juridique et donc finalement, on conserve 9000 extraits qui font être référencés avec précision, qui sont du au juristes Lupien et aussi des oeuvres de Gaïus, Paul, Papinien et Ulpien, ils ne sont pratiquement plus connu par ces extraits, car si leurs oeuvres étaient conservé dans les bibliothèque de Constantinople au Ve, elle avaient déjà disparu de la ville de Rome et ensuite ces manuscrits originaux ne vont pas survivre à la prise de Constantinople.Ce travail de diviser par 20 le travail est mené en 4ans. On a 4 ensemble différents :
Le code de Justinien : le Codex, a été réalisé en moins d’un an, il reprendre en bonne partie de code Théodosien. Les compilateurs ont tenté de donner une vision cohérente de toute la législation impériale. Pour que ce soit cohérent, ils ont écarté certaines lois tombées en désuétudes, ont trop liées à un contexte particulier, ils ont aussi modifier la forme du texte. Le code est achevé en avril 529 et publier solennellement en 536. La philosophie d'élaboration du code est préciser dans la préface du code de Justinien, il aurait permit de supprimer les préambules inutiles, les répétitions, les contradictions.
Le Digeste vient du terme latin Digero (= mettre en ordre, ranger, classer), on le trouve appelé aussi les Pandectes qui est l'appellation grecque de Digeste. C’est la partie la plus importante de la compilation de Justinien parce que la commission qui a été chargé de charger ça, elle ne s’est pas contentée de sélectionner des textes, elle a fait oeuvre créatrice de droit, les auteurs sont autorité par l'Empereur de corriger les libres des anciens jurisconsultes.
Son but c’est tirer de tous ces livres, un corps de Jurisprudence ne se trouve ni des lois semblables, ni de loi contraire.Ca pose un problème car les passages modifiés, coupé, réécrit n’est pas identifié donc ça laisse plané des doutes et des critiques forte des auteurs modernes. Il est officiellement et solennellement confirmé par Justinien en décembre 533, ensuite il est adressé a tous les juges de l’Empire et a partir de ce moment, il est interdit au Jurisconsultes d’écrire de nouveau commentaire sur les anciens jurisconsultes car la crainte de ces écrits est qu’il déformé, modifier les textes sélectionnés par Justinien. Il a été rédigé en Latin et traduit en français à l'extrême fin de l’ancien régime par HULOT.
Les Institutes : ouvrage a vocation pédagogique destinée a ceux qui commence l’étude du droit aux écoles qui existaient à Constantinople. Ces Institutes ont une valeur officielle et qui de surcroît, sont enseigné dans un lieu officiel. La rénovation juridique remise au gout du jour ne peut pas se concrétisé si elle n’est pas accompagnée par une réforme en profondeur de l’enseignement du droit.
C’est Louis XIV qui va réformer l’enseignement du droit en autorisant l’enseignement des coutumes et des lois royales et pas simplement l'enseignement du Digeste, aussi Napoléon Ier qui recrée officiellement des écoles de droit chargés d’enseigner le code civil alors que la révolution avant supprimer les universités. Le droit devait être suffisamment cjair pour être compris par tous les citoyens sans études particulières. Les Institutes de Justinien s’incrivent dans la tradition des Institutes de Gaïus et d’Ulpien. Il déclare qu’il s’agit d’une sorte de résumé du Digeste. Les Institutes rédigées par tribonien et deux professeurs de droit sont promulguées officiellement en novembre 533 et le texte des Institutes ont force de loi.
Les Novelles titre donné aux nouvelles Constitutions impériales promulguées par Justinien après le code pendant son règne. Novelle est le titre traditionnellement donné a ces nouvelles Constitutions depuis le MA c’est l’équivalent de « nouvelles » constitent en 558, les nouvelles Constitutions de Justinien ont été retranscrit dans les archives de l’Etat, mais elle nes C forment pas un recueil officiel comme le code. Les Novell es ne sont connues que par des collections constituées par des particuliers : Jean DANTIOCHE.
2. Contenu du Corpus juris civilisa. Le Code
Ce code va être divisé en 12 livres qui évoque symboliquement les 12 apôtres du Christ et ces livres de subdivisent en de nombreux titres.Exemple : Le 1er livre, 50 titres.
Dans le détail, les matières sont réparties aléatoirement.
Le livre 1 est consacré pour l’essentielle à la législation générale aussi bien en matière religieuse que civile.Le titre premier est intitulé « de la Sainte-Trinité de la foie Catholique et de la défense d’en discuter en public ».Le titre 14 « Des lois, des C des Empereur et des édits, des différentes charges publiques ».Le livre 2 consacré à la procédure civile, à l’organisation judiciaire et contient de nombreux développement sur la restitution d’un bien.Livre 3, des jugements.Le livre 4 des actions et des serments, du statue de la femme mariée et des successions et testaments.Le livre 5 parle du mariage et de la dot (= la somme remise au futur marié par le père de la mariée), des tutelles et curatelles.Le livre 6 aux esclaves.
b. Le Disgeste
Le Digeste est composé de 7 parties principales, qui portent chance. Justinien a dit que c’est une référence par la nature et au mystère des nombres premiers. Il représente 50 livres divisé en titre, en fragment et en paragraphe.
La première partie est intitulé « De la justice et du droit », le Digeste développe la division du droit entre droit public et droit privé. Pour le Digeste, le droit public est celui qui concerne l’administration de l’Etat, le droit privé concerne les intérêts de chacun.Ensuite le Digeste divise le droit privé en 3 catégories, en fonction de la source du droit :
Le droit naturel est défini comme étant celui que la nature inspire a tous les animaux y compris l’espèce humaine et il donne comme exemple le droit matrimonial qui descend de l’union du mâle et de la femelle.Le droit des gens propre a l’espèce humaine, donc plus restrictif que le droit naturel, l’obéissance du aux parents et à la patrie, pitié envers Dieu ou le droit de repousser la violence et les injures.Le droit civil
Les éléments issues du Digeste de la première partie font structurer toute la pensée juridique occidentale globalement jusqu’au XXe. La deuxième partie consacré au jugement. La Troisième consacré aux choses. La quatrième consacré au hypothèseLa cinquième consacré au testaments La sixième consacré aux successions La septième consacré aux stipulations et en particulier des engagements juridiques pour autrui.Les auteurs du Digeste ont analysé plus de 150 000 textes, en ont retenue 9 000.
c. Les Insitutes
Ils comporte les principes de base du droit qui font avoir un grand retentissement au Moyen Age et jusqu’à nos jours, en particulier au XVIIIe, le juriste français Claude de Ferrière donne une traduction française abondamment commentée des Institutes et s'efforçant de faire des parallèles entre les Institutes et le droit de l’ancien régime.Définition des Institutes a retenir :
Justice : c’est la volonté ferme et perpétuel de faire droit a chacun.La Jurisprudence : la science du juste et de l’injuste montrant qu’a l’origine le droit est mêlé au concept de morale et a une dimension éthiqueLes préceptes du droit : « c’est vivre honnêtement, ne pas léser autrui et rendre a chacun le sien (son dû)»Liberté : c’est la faculté naturelle que l’on peut faire ce qu’on veut, exempté ce qu’empêche la force ou le droit. Cette approche de la liberté sera reprise par la DDHC de 89 qui déclare « la liberté consiste a faire tout ce qui ne nuit pas a autrui » et n’est pas pour cette raison défendue par la loi.
Les Institutes présente des développement plus technique et ces développements vont se développer au Moyen-Aage et perdurer jusqu’à nous.Exemple : les Institutes définissent les grande lignes du mécanisme. « La tutelle est un pouvoir sur une tête libre donnée et autorisée par le droit civil pour protéger celui qui, à raison de son âge, ne peut se défendre lui-même. »Exemple : il y a aussi les bases du régime des obligations. « Les obligations se forment par le consentement dans les ventes, les sociétés et les mandats ».
d. Les novelles
Elles ont été rédigées en grecque, la langue courant parlé dans l’Empire Byzantin et concernent beaucoup le droit ecclésiastique avec le catholicisme avec la religion d’Etat.
Conclusion : bien évidemment a travers les populations de Justinien, les droits de l’Antiquité ont survécu à la société et au contexte produit et reste un droit vivant qui a des degrés divers va influencé tous les systèmes juridiques continentaux.Par contre l’impact du droit romain a été plus faible en Angleterre et par la suite dans les pays Anglo-saxons, ce qui s’explique par les retissantes politique anglaise par rapport à la papoté et aussi au Saint-Empire romain germanique.
Chapitre 2. L’ancien droit (Ve-XVIIIe siècle)
Le terme ancien droit est un terme générique qui désigne l’ensemble des règles juridiques applicables entre la chute de l’Empire romain du Ve siècle et la révolution française (1789) qui marque la période du droit intermédiaire qui dure jusqu’a la promulgation du Code civil de 1804 et a partir de cette époque, on se trouve dans la période du droit contemporain, même s’il n’est pas synonyme de droit positif car de nombreuses normes se rattachant à la période du droit contemporain ont été modifié, abrogé ou tombé en désuétude.
L’Ancien Droit couvre une période si vaste qu’il présente nécessairement des ruptures.
Dans un premier temps, à l’époque des premiers Rois de France (les mérovingiens) le droit non unifié à caractère ethnique. Ce droit tend à disparaitre au IXe, à l’époque de Charlemagne lorsqu’il n’est plus possible de connaitre l’origine ethnique des populations. Il s’en suit une période où le droit régresse et tant même a disparaitre et a partir du XII va renaitre un droit développé qui va revêt 2 forme :
Un droit coutumier d'inspiration locale et spontanée.La redécouverte du droit romain et l’application de certains principes.
L’ancien droit se retrouve caractérisé par le développement croissant des lois comme sources du droit, ce qui est le reflet du développement de l’Etat et la mise en place de l’absolutisme étatique au XVIIe.
Section 1. La pluralité des sources de Droit durant le Moyen Age (Ve-XVe siècles)
Deux idées de bases, cette longue période peut s’analyser en 2 phases :
La période mérovingienne (première race) et carolingienne (seconde race) jusqu'au Xe siècle. C'est la période où règnent des Rois descendants de Clovis que l'on appelle les mérovingiens , du grand-père de Clovis, Merové. Cette période dure jusqu'à 751, où les rois de France sont les carolingiens (de Charlemagne). Ce sont les descendants d'un roi qui a pris le pouvoir en 751, Pépin le Bref. Les sources du moyen âge utilisent le mot « race » et non « dynastie ».L a période de grand désordre au cours du Xe siècle , caractérisé par une période d'invasion scandinave sur le littoral, en particulier l'invasion des normands (= vikings) qui vont fonder la Normandie. Cette phase est marquée par la disparition du droit pendant presque un siècle.
À partir de 986 (début du règne de Hugues Capet) : dynastie des capétiens, un nouveau système juridique se met en place, qui n'a que très peu de liens avec le système juridique des mérovingiens et des carolingiens. Mais leurs prolongements se font sentir encore aujourd'hui.
I. L’éphémère mise en place d’un Droit « ethnique » à l’époque mérovingienne
A. Le contexte de l'affaiblissement puis de la disparition de l'Empire Romain d'Occident
C'est un phénomène historique qui se produit progressivement pendant les deux premiers tiers du Ve siècle : 410 la prise de Rome par les Wisigoths, 476 la déposition du dernier Empereur d'Occident par un barbare qui avait intégré la garde impériale puis s'était révolté contre l'empereur. Il va renvoyer les insignes de l'empereur à Constantinople pour dire qu'il n'y avait plus d'empereur.
Il ne faut pas penser que la chute d'un empire millénaire s'est produite sous la forme d'un raz-de-marée de soldats barbares qui dévastent tout et exterminent la population des gallo-romaines. En réalité, l'Empire romain, même à son déclin, exerce une fascination sur les peuples au-delà des limites de l'Empire. L'Empire romain incarne l'opulence parce qu'il y a la bonne exploitation d'immenses domaines agricoles, il est aussi le symbole de la civilisation urbaine avec des villes ayant des monuments publics, des arènes, des amphithéâtres. Les barbares veulent profiter des bonnes choses de Rome sans l'anéantir.
Les populations situées hors des limites de l'Empire sont appelées des « barbares » par les romains, ils les qualifient de barbarus. Ce mot, dans un premier temps, désigne un étranger, quelqu'un qui n'est ni romain, ni grec. Le barbare, c'est la personne étrangère. C'est par la suite que cet adjectif va signifier inculte, sauvage, cruel, grossier...Les limites de l'Empire romain vont de la mer du Nord jusqu'à la mer Noire (du Rhin au Danube).
Tous les peuples en dehors des frontières sont les « germains ». Ils se subdivisent en plusieurs groupes ethniques :
Les Francs : c’est un peuple établi de façon sédentaire dans les actuels Pays-Bas et dans le Nord-Ouest de l'Allemagne. Il existait les France Saliens et les Francs Ripuaires.Les Goths : c’est un peuple semi-nomade habitant le centre de l'Europe, plusieurs sous-groupes :Les Ostrogoths de l’Est, actuel Ukraine.Les Wisigoths à l'Ouest.Les Burgondes, en actuelle Pologne.Les Alamans au Sud de l'Allemagne actuelle.
De tout temps les peuples frontaliers avaient fait des incursions rapides dans l'Empire Romain (en particulier au IIIe siècle) et après avoir ramassé un solide butin, repartaient sur leurs terres d'origine . Les attaques des « barbares », ce n'est pas une chose nouvelle au Ve siècle.Cependant, à la fin du IVe siècle, les romains se rendent compte qu'ils ne sont plus capables de soumettre définitivement ces barbares du point de vue militaire. Puisqu'ils ne peuvent pas les éradiquer, les romains décident de traiter avec certains de ces peuples étrangers pour en faire des troupes appelées « confédérés », des troupes alliées. En contre-partie de cet accord, les romains les autorisent à s'établir à l'intérieur de l'Empire redevenues incultes après avoir été dévastées.
Beaucoup de chefs Francs vont faire une carrière d'officier dans l'armée romaine car ils sont appréciés pour leurs talents militaires. Les troupes Francs vont constituer le principal partenaire de l'armée romaine en Gaulle. Ces troupes sont dirigées par un chef qui porte le titre de roi. Celui-ci est soumis à l'Empereur romain. Ils vont recevoir officiellement en 360 le droit de s'établir à l'intérieur de l'Empire dans l'actuelle Belgique et dans le Nord de la Gaulle. Ce royaume Franc va avoir pour capitale Tournet, et les Francs vont représenter 20 % de la population.
Les Wisigoths surviennent dans le nord de l'Italie en 410, dans l'idée de gagner la péninsule ibérique. Ils ravagent Rome. L'empereur d'Occident, Honorius, va décider de stopper leur progression par un traité qui les autorise à s'établir dans le Sud-Ouest de la Gaulle (de Toulouse à Bordeaux). Les Romains appliquent à ces Wisigoths comme aux Francs le régime juridique de l'Hospitium, régime juridique de l'hospitalité. Rome conserve le pouvoir civil sur le territoire où les barbares sont autorisés à s'établir. Par contre, ces Wisigoths sont investis des pouvoirs militaires. Ils sont chargés de défendre le territoire possédé contre les éventuelles incursions d'autres barbares. En échange de cette protection, les populations gallo-romaines doivent payer un impôt aux Wisigoths. Les grands propriétaires gallo-romains doivent céder aux Wisigoths les 2/3 de leurs terres et 1/3 de leurs esclaves. Avec ce système, les peuples vont créer un véritable royaume indépendant à l'intérieur même de l'Empire Romain à l'agonie.
La décomposition de l'Empire Romain d'Occident va connaître une brusque accélération au milieu du Ve siècle, suite à un vaste mouvement de population nomade extrêmement guerrière.Ce mouvement se produit extrêmement loin, en Asie suite à une période de chaos politique : les Huns, qui se trouvent au départ de l'autre côté de la muraille de Chine. Une grande partie de la population des Huns va franchir la muraille et une partie va partir vers l'Ouest, conquérir l'Inde du Nord, de l'Iran, ils vont dévaster le Sud de la Russie, la Turquie et s'établissent au-delà de l'Empire Romain dans la Hongrie.
Cette arrivée des Huns va avoir pour conséquence logique de repousser massivement les populations d'Europe Centrale vers l'Ouest, leur faire franchir massivement les limites de l'Empire Romain. Les Huns vont poursuivre les peuples germaniques jusqu'à la Gaulle, ils vont assiéger Lutèce. Les Huns vont être battus en 451 dans une bataille appelée des « Champs Catalauniques », gagnée par une armée composée de troupes romaines, de troupes wisigothiques et de Francs, dirigés par Merové (le grand-père de Clovis).En 476, lors de la fin de l'Empire Romain d'Occident, le territoire de la Gaulle se présente politiquement en 4 entités distinctes
Une partie centrale qui va de la Somme jusqu'à la Loire. Elle reste une province romaine qui est gouvernée par un général romain établi à Soisson. Elle n'a plus aucune communication avec Rome.Au Nord de la Gaulle, il y a un petit royaume Franc (l'actuelle Belgique).Il y a le sud-ouest : le Royaume des Wisigoths (1/5 de la Gaulle).le Nord-Est de la Gaulle, le Royaume des Burgondes (Jura).
Evolution très rapide car les Francs vont réussir en trente ans à reconstituer à leur profit l'unité de la Gaulle sous la conduite d'un chef militaire qui est Clovis, officiellement considérée comme le premier roi de France.La monarchie française commence avec Clovis (fin du Ve siècle). Il part en guerre et conquiert la province romaine de Soisson en 486. Il établit en 493 sa capitale à Paris (Luthèce). En l'an 500, il bat les ennemis Burgondes et épouse la fille du Roi, le royaume est ainsi intégré. Il fait la conquête du royaume Wisigoths sept ans plus tard, en 507, en tuant le Roi qui s'appelle Alaric. Le royaume de Clovis va préfigurer le territoire de la France actuelle. L'armoric va ressentir l'arrivée de populations extérieure : les Bretons de l'île de Grande Bretagne. Ce ne sont pas des barbares. Le succès de Clovis s'explique par deux facteurs :
Un facteur militaire.Un facteur religieux , Clovis a décidé de se faire baptiser dans la loi catholique en 496 avec 3000 de ses soldats. Il va bénéficier de l'appui de toute l'institution ecclésiastique gallo-romaine.
Une fois établie la maîtrise politique sur la plus grande partie du territoire de la Gaulle, il va vouloir pérenniser la conquête en rétablissant la paix, et particulier de régler sur une base pacifique les rapports entre les Francs et les populations gallo-romaines vaincues. C'est une condition pour que survive le royaume Franc compte tenu de l'immense disparité démographique. Environ 200 000 personnes en Gaulle. Les gallo-romains : 18 000 000 de personnes. Clovis va recourir au droit et il va mettre en place un système de la personnalité des lois, il va garantir à chaque ethnie implantée en Gaulle la possibilité de conserver son droit propre. Même après la constitution du grand royaume Franc, les Wisigoths seront régis par la loi wisigothique, etc...
Le système de la personnalité des lois veut dire que Clovis envisage également de mettre en place un système judiciaire rudimentaire où chacun est jugé selon le droit de son groupe ethnique d'appartenance. Dans la procédure primitive, chaque procès commence par la demande de la loi du demandeur « sous quelle loi vis-tu ? » Prononcé par le juge (si c'est la loi wisigothique, burgonde, etc….).
B. La loi salique
Le point de départ est le système de la personnalité du droit qui rend nécessaire de fixer avec précision par écrit le droit des vainqueurs.Le problème, c'est que jusque là les divers peuples germaniques implantés en Gaulle n'étaient régis que par des usages oraux très réglementaires : la coutume des ancêtres.La nouvelle situation politique rend nécessaire de codifier le droit des ancêtres. Pour cette codification, on va s'inspirer pour des raisons de prestige, de la pratique romaine en particulier Clovis va faire rédiger la loi des Francs saliens en latin. La loi des Francs ne va pas être rédigée dans leur langue (le francique) ni dans l'écriture des Francs. Les prêtres de Germanie avaient un mode d'écriture resté secret qui s'inspirait de l'écriture phénicienne : l'écriture runique.
L'initiative de mettre par écrit la loi salique appartient à Clovis, ses modalités de rédaction restent obscures parce que la loi salique est théoriquement restée en vigueur jusqu'au IXe siècle, jusque Charlemagne. Le texte a été modifié et complété à plusieurs reprises en l'année 768. On ne sait pas vraiment ce qui est de l'époque de Clovis. On sait simplement qu'elle aurait été rédigée par 4 sages Francs. Ils résidaient toujours dans le berceau primitif du peuple Franc. Le texte a probablement été débattu par des réunions réunissant les chefs militaires et ecclésiastiques.
La loi est subdivisée en 71 titres, chaque titre comporte jusque 12 articles. Ces titres se succèdent sans grande logique apparente et reviennent souvent sur des questions déjà évoquées avant. Ces articles s'attachent aux
différentes contestations qui peuvent s'élever, soit entre populations franques, soit entre Francs et Gallo-romains.
Le fond de la loi : on voit que, manifestement, la loi salique traduit un droit germanique assez archaïque qui a peu subi l'influence du droit romain. Elle est essentiellement un code pénal, il s'intéresse à de très nombreuses catégories d'infractions, se préoccupe assez peu des rapports purement civils (= la vie au sein des familles, notamment le droit familial, de succession). Il existe des éléments sur des questions de droit civil et de procédure civile.Exemple : le titre 1 s'intéresse au système des assignations en justice. Le titre 48 s’intéresse aux donations. Titre 62 : le droit des biens.
Article 6 : « à l'égard de la terre salique, aucune portion de l'hérédité ne sera recueillie par les femmes ; mais l'hérédité toute entière sera dévolue aux mâles ». Ce système héréditaire masculin ne concerne que les alleux. Pour les autres biens, les femmes peuvent succéder à défaut d'héritier masculin. L'article va se révéler très important au point de vue de l'histoire du droit. Il va recevoir une dimension politique lors de sa redécouverte au Moyen-Âge au cours de la guerre de Cent Ans. La monarchie française va se fonder sur cette disposition de la loi salique pour justifier sa spécificité en matière de dévolution politique qui est la masculinité. Les rois de France se succèdent uniquement de père en fils (ou à neveu) à l'exclusion complète des femmes.L'utilisation de la loi salique au Moyen-Âge a pour but d'éviter qu'un roi d'Angleterre descendant d'un roi de France par sa mère puisse régner à la fois sur l'Angleterre et sur la France.
On remarque un fort archaïsme qui résulte des modalités pénales retenues. La loi salique se présente essentiellement comme un tarif pénal, c'est-à-dire que pour chaque infraction, chaque crime, est associée une somme que le coupable doit verser à sa victime sans discussion possible et sans prise en compte de circonstances atténuantes.Exemple : du vol des chiens : 45 sous d'or.
Dans ce système, l'indemnisation de la victime est la question principale. La sanction du trouble à l'ordre public apparaît très secondaire. Lorsqu'une amende est prévue, elle est très inférieure à la sanction de la victime.
L'approche pénale de la loi sacrée est très privative. Le contexte de son émergence et sa mise par écrit : l'émergence coutumière, c'est l’État du droit tel qu'il était pratiqué par les Francs saliens à l'époque où ils étaient encore situés aux limites extérieures de l'Empire romain. Le contexte de la mise par écrit est que les Francs primitifs étaient incapables d'organiser un système judiciaire vraiment fiable et de garantir le respect de la paix, ils sont trop nombreux pour dire qu'on allait appliquer un droit pénal à tout le territoire. L'entourage même de Clovis au moment de la rédaction définitivement de la loi salique. Après sa conversion au christianisme, il est entouré de très nombreux évêques parce que l’Église est la seule institution stable de l'époque. Ceux-ci insistent sur la nécessité de mettre en valeur la vertu chrétienne du pardon et de la réconciliation. Ils s'opposent à la vengeance privée. La loi salique impose à la victime et à sa famille de renoncer à se venger en acceptant l'indemnisation financière.
La loi salique est essentiellement un tarif pénal. Modalités de composition : on se rend compte que les indemnisations pénales ne sont pas fixées de façon aléatoire. Il y a une gradation des sommes prévues qui se réfèrent toutes à un étalon central : la valeur humaine, le prix de l'Homme, que la loi salique désigne sous le terme de Wergeld. Ce prix est 200 sous d'or pour un Franc, 100 sous d'or pour un gallo-romain. Ces sommes peuvent être nettement augmentées en cas de crime particulièrement grave.Exemple : 700 sous d'or pour l'assassinat d'une femme franque enceinte, 600 sous d'or pour le meurtre d'un Franc de moins de 12 ans.
La loi salique a prévu un traitement bien différencié selon que l'infraction commise par un Franc a pour victime un autre Franc ou un gallo-romain. Dans l'optique de la loi salique, la valeur humaine d'un gallo-romain vaut deux fois moins que celle d'un Franc. Elle est nettement supérieure à celle d'un esclave.
On constate que Clovis ne s'est pas préoccupé de préciser le statut juridique des gallo-romains, car il s'est contenté de reprendre un texte qui existait déjà pour les gallo-romains dans le royaume des Wisigoths et qui avaient été promulgués par le Roi Alaric qui est battu et tué par Clovis.
C. Le droit appliqué aux descendants des populations gallo-romaines : le Bréviaire d'Alaric
Le point de départ, c'est la situation de la Gaulle Romaine. Dans la Gaulle Romaine du Ier au IIe siècle, le droit
romain classique ne s'est pas appliqué intégralement dans cette Gaulle car seuls les véritables citoyens romains pouvaient bénéficier du droit civil romain. Les gaulois conquis, dans un premier temps, n'ont pas la citoyenneté romaine. Ils vont acquérir cette citoyenneté par une réforme du IIIème siècle par l'Empereur Caracalla, en 212 : réforme générale qui donne la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire Romain sans distinction d'origine.Pendant les 2 premiers siècles, les romains ont laissé aux gaulois leur droit coutumier spécifique. Les gaulois savaient écrire mais écrivaient très peu, ils n'ont pas mis ce droit par écrit.
À partir du IIIème siècle, les gallo-romains vont pouvoir faire usage du droit romain. Ils conservent un droit local vaguement issu des traditions gauloises que l'on appelle le droit de la cité.
Avec les siècles, à la fin de l'empire, on assiste à un appauvrissement du droit romain réellement appliqué en Gaulle. Ce droit romain est à la fois peu enseigné en dehors de Rome et il est confronté à des circonstances très locales. Il doit s'adapter à des circonstances très locales qui ne correspondent pas forcément aux situations du droit classique. En Gaulle se développe un droit romain vulgaire (=du peuple, du petit peuple).
Ve siècle : promulgation du code Théodosien en 438 qui s'applique aussi à l'Empire Romain d'Occident. Cette promulgation n'arrive pas à enrayer le phénomène d'appauvrissement du droit romain applicable car ce droit est trop complexe, au moins dans certaines de ses dispositions. À ce moment là, en Gaulle, on applique des résumés très simplifiés du code Théodosien, appelés des Interprétations. Celles-ci se substituent au code, trop compliqué.
La fin de l'Empire Romain d'Occident accélère la dégénérescence du droit romain.
Au début de la Gaulle mérovingienne, il y a donc de très grandes incertitudes sur les règles de droit qui s'appliquent à la majorité de la population. L'initiative de remédier à ces difficultés pour les gallo-romains n'est pas prise par un gallo-romain mais par un Roi barbare, le roi des Wisigoths, Alaric II à Toulouse.Les Wisigoths avaient entamé de façon précoce la mise par écrit du droit applicable dans la région de Toulouse et en Aquitaine puisque ils avaient codifié le droit wisigothique dès 476, bien avant la loi salique. L'année 476 : Promulgation du code d'Euric, roi des Wisigoths qui a régné entre 466-484.
506 : Promulgation du code d'Alaric, « La loi romaine pour les sujets romains ». Préface qui explique les intentions du roi. Il dit clairement qu'il s'agit de faire disparaître toute trace d'obscurité dans les lois romaines et du droit applicable. Désormais, ce code se substitue à tous les autres textes de droit romain. Il est défendu d'y recourir et ce à peine de mort.
Le « Bréviaire » d'Alaric car lorsqu'on redécouvre les plus anciens manuscrits de ce texte, on pense qu'il s'agit d'un libre de prières. Ce code est une vaste compilation du droit romain qui a été faite très rapidement et presque sans ordre logique. On y trouve la plus grande partie du code Théodosien, des commentaires du code, des Novelles de plusieurs empereurs d'Orient et d'Occident, un résumé des Institutes de Gaïus et des éléments de droit local des différentes cités.Ce code d'Alaric a de nombreuses imperfections mais il a quand même le grand mérite d'exister car il n'y a rien d'autre pour les gallo-romains dans ce contexte. C'est parce qu'il existe que Clovis, après avoir battu et tué Alaric en 507, va maintenir la loi gallo-romaine pour le territoire wisigothe, mais aussi étendre la loi d'Alaric à tous les gallo-romains du royaume Franc. Le recueil d'Alaric va plus ou moins continuer de s'appliquer aux descendants des populations gallo-romaines jusqu'au XIXe, jusqu'à la fin du régime de la personnalité du droit.
Dans les royaumes mérovingiens et carolingiens, la codification de Justinien n'est pas connue.
D. Le passage du régime de la personnalité des lois au système de la territorialité du droit
Cette question n'est pas une problématique réservée à des temps très reculés. C'est une problématique qui alimente parfois le débat à l'époque contemporaine, notamment entre les modèles juridiques anglo-saxons et continentaux de type français. Il s'agit de savoir si, sur un territoire donné, il doit avoir un droit unique destiné à intégrer toutes les populations, quelle que soit leur origine, ou est-il possible de reconnaître des spécificités juridiques à certaines parties de la population.Exemple : les populations musulmanes.
Durant l'époque carolingienne, le système de la personnalité des lois va être progressivement abandonné pour plusieurs raisons :
Au bout de plusieurs siècles, on assiste à un mélange naturel des ethnies du fait des mariages. Les populations issues de ce mélange vont cesser de se définir par rapport à leur lointaine origine même si, en général, leur nom en conserve le souvenir. Ce phénomène est, à l'époque, puissamment encouragé par l’Église. En effet, l’Église pense que les populations qui vivent sur un même territoire et qui partagent la même religion doivent former un peuple unique à l'image de l'unité du peuple de Dieu. Elle a recours à des dispositions techniques. Elle va commencer à développer le droit canonique ou ecclésiastique. Ce droit prévoit des empêchements à mariage entre cousins et cousines, même à un degré relativement éloigné. Ces règles juridiques poussent les personnes à épouser quelqu'un d'une autre origine ethnique compte tenu du fait que la recherche d'un conjoint se fait dans un cercle géographique très restreint.
La possibilité qui était laissée aux individus de choisir la loi qu'il souhaitait se voir appliquer dans le cadre d'un procès. Dans la zone du royaume Franc primitif (au nord de la Loire), les gallo-romains ont tout intérêt à faire oublier leur origine. La loi salique leur est clairement défavorable s'ils sont victimes d'un délit pénal et considérés comme gallo-romains. Dans ces conditions, le Bréviaire d'Alaric, dans cette zone géographique, va progressivement tomber en désuétude.
Le contexte de la mise en place d'une nouvelle dynastie politique : les carolingiens. Elle va aspirer à reconstituer l'Empire Romain d'Occident en assumant une double-tradition à la fois germanique et romaine qui va fusionner.
Point de départ : 751 avec Pépin le Bref qui devient roi de France. Il n'appartient pas à la dynastie mérovingienne dont les derniers rois étaient qualifiés de rois fainéant.À cette époque la monarchie est élective. Le changement de dynastie n'est pas synonyme d'un coup d’État mais c'est quelque chose de naturel. Pépin le Bref est choisi comme roi parce que c'est le fils de Charles Martel, chef militaire qui avait arrêté l'expansion musulmane dans le royaume Franc et repoussé les troupes musulmanes dans les Pyrénées.
L'an 800 : Charlemagne, son fils, est sacré Empereur par le pape. Après Charlemagne, Louis le Pieux (814-840). L'impact de cette nouvelle dynastie sur la territorialité des lois résulte sur la grande importance accordée par les carolingiens à la conception chrétienne du pouvoir. Ils choisissent des évêques comme conseillers. Ce sont les seules personnes instruites. L’Église explique au Roi qu'il ne tient pas son pouvoir uniquement de son élection ou de son hérédité, mais il tient son pouvoir en premier lieu de Dieu. C'est le sens d'une nouvelle cérémonie symbolique qui apparaît avec Pépin le Bref : le Sacre du roi. Pour l’Église, la fonction royale n'est pas uniquement politique et militaire, mais avant tout un « ministère sacré ». Le roi a une mission religieuse qui est de se mettre au service du peuple chrétien pour le conduire sur la voie du salut. Pour faire son salut, le peuple doit se conduire dans la fraternité et la concorde. Ils ne peuvent être encouragés par l'unité du droit. Les carolingiens vont tenir cette mission en promulguant des normes obligatoires qui n'abrogent pas l'ancien droit ethnique dans son ensemble mais se superposent à lui : des Capitulaires. Ils complètent l'ancien droit Franc ou gallo-romain. Le cas échéant, ils complètement ou modifient l'ancien droit ethnique. Les Capitulaires contribuent au recul de ce droit. La pratique doit être nuancée : du point de vue juridique, ils restent très peu techniques. Cela s'explique par l'état de la société de l'époque, l'immense majorité des habitants de l'Empire ne sachant pas lire. Les lois, pour être portées à leur connaissance, vont faire l'objet de proclamations orales. Oralité = règles de procédure simples, droit pénal peu élaboré.
Bilan : Au milieu du IXe siècle (fin de l'Empire carolingien), on peut dire que la fusion des populations s'est opérée. Insensiblement, on est passé du royaume des Francs au royaume des Français : regnum francorum. On voit également un glissement dans la dénomination du territoire. On abandonne le terme gallia pour créer un nouveau terme latin, francia. On constate que lors des procès, les plaideurs ne se définissent plus par leur lointaine origine ethnique mais par le territoire où ils vivent. Ils vont se référer non plus à un droit personnel, mais à un droit territorial.Ce glissement d'un système de droit personnel à un système de droit territorial n’entraîne pas directement la disparition du droit romain. Cela change radicalement leur modalité d'application qui se définit par grandes zones géographiques et non pas par l'origine des populations.Au Sud de la Loire continuent à s'appliquer des restes du droit romain. Au Nord, ce sont les restes de la loi Salique qui s'appliquent. Ce clivage est daté par un texte officiel de 864 qui oppose d'un côté les territoires où les procès sont terminés selon la loi romaine, et les terres où il n'en va pas de mê me.La décomposition du pouvoir politique qui survient à la fin du XIXe siècle va balayer toute cette construction juridique. À la place va se développer la coutume juridique.
II. Le triomphe de la Coutume et des « privilèges »A. La mise en place d'une société nouvelle à partir du IXème siècle
1. Le contexte
Contexte doublement difficile : la fin de l'unité de l'Empire carolingien et le retour d'une période de profonde insécurité.
La fin de l'unité de l'Empire carolingien intervient en 843 par le traité de Verdun entre les trois petit-fils de Charlemagne qui, jusque là, se faisaient une guerre ouverte de succession :
L'aîné est Lothaire, il va conserver le titre d'Empereur et reçoit un territoire central qui va de l'actuelle Belgique et des Pays-Bas jusqu'au Nord de l'Italie en passant par la Bourgogne, la Lorraine et l'Alsace.Le deuxième fils, Louis le Germanique reçoit la partie orientale de l'Empire qui va annexer le royaume de Lothaire pour donner naissance au « Saint Empire Romain Germanique » qui va durer presque 1 000 ans (jusqu'en 1806).Le troisième fils : Charles le Chauve, partie ouest : Francia occidentalis. Cette partie est à l'origine directe de la configuration du royaume de France et de la France actuelle, mais les frontières Sud-Est du royaume sont fixées par le Rhône, Lyon est une ville frontalière. La politique des rois de France et jusqu'au IXème siècle, va être d’étendre le royaume vers l'Est, au détriment de l'Empire. C'est une des causes majeures des guerres à partir du XVIème siècle.
Le partage de Verdun est à l'origine de la configuration du Royaume de France , mais aussi de la langue française puisque le premier texte où va émerger les prémices du français à partir du latin est de l'année 842 : le serment de Strasbourg.
S’en suit invasion scandinave. Ils n'arrivent pas à prendre Paris mais vont remonter sur la Seine. Année 912 : Traité de Saint-Pierre-Sur-Epte, territoire de l'actuelle Normandie. Rollon : ancêtre de Rollon → Guillaume le Bâtard passe la manche et devient Guillaume le Conquérant. Bataille d'Hasting en 1066.
2. Le caractère général de la société de l'an 1000
Repli politique et géographique qui résulte du fait que les derniers rois carolingiens sont incapables d'assurer la défense des populations. Puisque le pouvoir central ne peut pas assurer la défense, une sorte d'auto-défense spontanée se met en place. Organisée au départ par des hauts fonctionnaires carolingiens qui ont le titre de Comtes ou de Ducs. Ils ne tardent pas à devenir pratiquement indépendants du pouvoir royal central. Ils vont constituer des principautés territoriales autonomes à l'intérieur même du royaume. Le principe de principauté intervient à la mort de Louis le Pieux. Nominoë, suite à une victoire à une bataille en 845, crée le royaume de Bretagne qui va être fragilisé par les incursion scandinaves.Ce système de déliquescence du pouvoir politique se poursuit au XIe siècle dans les principautés jusqu'à la paroisse (actuelle commune). On y trouve des chefs militaires à la tête de soldats plus ou moins professionnels qui créaient des petites forteresses (les mottes féodales). Ils s'érigent en seigneurs et vont exercer des compétences de nature politique. Ils perçoivent des impôts sur la population + justice féodale. Ce contexte va être propice à l'émergence du droit. Société profondément hiéra rchisée, ce qui est naturel dans la violence du contexte :
Des militaires qui ont la force pour eux se constituent en seigneurs.Des populations rurales appelées de manants ayant statut d'homme libre.Des populations qui sont dans une situation hérité de l'esclavage : les serfs.
L'homme pris dans son individualité propre va très peu compter. Il n'est considéré qu'en fonction de sa place dans la société. Cette place de l'Homme dans la société ne dépend pas de ses qualités et de ses capacités propres mais cette place lui est assignée par sa naissance et en partie par sa profession. C'est une conception qui va être théorisée autour de l'an 1,000 par Adalbéron, évêque de Laon (977-1030). Il existe pour lui 3 fonctions qui doivent être considérées comme stru cturant la société très rude de son époque :
La défense militaires.La prière et la connaissance intellectuelle.La production économique agricole.
Sur la base de cette idée, il va diviser la société en trois catégories appelées des « ordres ». Le premier ordre est ceux qui prient, les Oratores (le Clergé), les Bellatores (la noblesse combattante), les Laboratores (le Tiers-État). Chacune de ces catégories de personnes a un statut juridique spécifique qui est supposé lui donner des moyens
de se consacrer au mieux à la mission qui lui est socialement associée. Ces moyens juridiques sont, à l'époque, qualifiés de privilèges sans connotation péjorative.
B. Le droit Coutumier
La coutume est définie comme un ensemble de règles juridiques émanant de pratiques constantes élaborées de manière relativement spontanée par les populations d'un territoire donné et qui sont suivies durant une longue période. Ces règles ont une force obligatoire résultant du consensus social tacite dont elles bénéficient. Cela permet d'en réprimer judiciairement le non-respect.
1. L'émergence de ce droit
Malgré un contexte très difficile, la vie sociale continue dans les campagnes et dans les rares villes subsistantes. Cette vie se fait avec une monotonie quotidienne et un conformisme comportemental. Ce conformisme, imperceptiblement, finit par être considéré comme une véritable règle à caractère obligatoire et cela permet donc à la collectivité de sanctionner les esprits individualistes ou un peu frontales . La coutume juridique est avec ce conformisme en gestation. Cette coutume résulte de l'accumulation des précédents multiples qui vont concerner les rapports de voisinage, dans les habitudes culturales et agricoles, dans la transmission des biens, la dot de la femme.
Dans le même temps, les seigneurs sont désireux de maintenir la paix dans leur domaine en exploitant au mieux les habitants roturiers. Ces seigneurs comprennent que leur intérêt est de limiter leurs prétentions par rapport aux populations parce que celles-ci sont prêtes à la révolte si elles n'ont rien à perdre en étant déjà surexploitées.
Les exigences seigneuriales vont rester très nombreuses et très variées. Mais elles vont se stabiliser à un niveau traditionnel que le Seigneur s'engage à ne pas dépasser. Les habitants de la seigneurie restent « taillables et corvéables » mais ils ne sont plus « taillables et corvéables à merci », à la libre volonté des Seigneurs. Il y a donc une auto-régulation qui finit par devenir une coutume juridique et est intégrée au droit coutumier.
Accélération du rétablissement d'un État de droit. Début de l'administration, qui a pour vocation de générer du droit. Les premiers administrateurs sont les sénéchaux, agents chargés de gérer le domaine royal et princier. Ils doivent veiller à une bonne exploitation économique de ce domaine.
En 1172 en Bretagne, on voit apparaître un sénéchal de Bretagne qui est le supérieur de tous les sénéchaux locaux. Fonctions administratives, financières, militaires et judiciaires. On peut parler de fonctions judiciaires parce que la Constitution d'instance spécifique a été la conséquence de l'apparition de règles coutumières obligatoires. On voit se créer spontanément des tribunaux seigneuriaux qui vont mettre en pratique le droit coutumier pour aboutir à un règlement de type juridique des confits qui opposent les particuliers entre eux. On garde le souvenir de procédures judiciaires.La naissance spontanée des tribunaux seigneuriaux est aussi encouragée par la volonté des seigneurs qui veulent ajouter le droit de rendre justice aux autres prérogatives seigneuriales. Ce droit de rendre justice est le moyen de manifester un peu plus leur puissance. Dès le XIIème siècle, la mission assignée aux magistrats médiévaux n'est pas uniquement de servir les intérêts égoïstes des puissants. Se développe l'idée que les juges doivent servir le Juste. Ce qui est juste est défini par la doctrine de l'époque comme ayant à la fois une dimension éthique naturelle. Cette idée est rappelée par des grands auteurs ecclésiastiques tels que les traités de Saint Thomas d'Aquin, et aussi par le droit romain que l'on redécouvre et enseigne.
2. La mise par écrit de ce droita. Une approche générale de cette mise par écrit à titre
privé
Caractère purement oral. Cette oralité pose des problèmes aux personnes chargées de mettre ce droit coutumier en œuvre au moment où apparaissent des tribunaux et des juges professionnels. L'oralité pose problème en cas de conflits civils et aux premiers juges qui au départ sont des clercs et ensuite des juristes. Un clerc est un ecclésiastique qui n'a pas poussé sa formation jusqu'au grade de prêtre. Les juges de profession juriste arrivent avec l'apparition des universités à partir du XIIIe. Les difficultés liées à l'oralité du droit coutumier :
La difficulté de connaître les règles juridiques applicables ; pour les connaître il faut organiser des enquêtes auprès des personnes les plus sages du territoire (Enquêtes par Turbes, par Tourbes ou par Tubes). Il doit y avoir au moins 10 témoins.
Même quand on connaît ce droit, il y a de grandes incertitudes quand aux détails des dispositions coutumières car ils peuvent changer en fonction des informateurs.
Certains membres des tribunaux prennent l'initiative à titre privé de rédiger par écrit les règles coutumières qu'ils sont amenés à appliquer. Ils connaissent bien ces règles de par une longue expérien ce de leur fonction de juge.
Il s'agit de recueils juridiques manuscrits. En général, ils sont écrits en langue d'Oïl et parfois en latin. On appelle ces recueils « les Coutumes ». Ils revêtent des formes très variables en fonction du tempérament et du talent d'écriture de leurs auteurs. Dans cette première époque où le droit coutumier est mis par écrit d'une initiative privée, les coutumes ne forment pas un véritable code juridique organisé. Ce sont plutôt des œuvres littéraires à dominante juridique mais avec de très nombreuses digressions qui sont historiques, morales, des répétitions...
Ces premiers recueils sont clairement des créations intellectuelles et pas simplement la retranscription des résultats d’enquête sur les usages juridiques. Puisque les coutumiers sont une création intellectuelle, les auteurs ajoutent des éléments juridiques pour apporter des réponses à des questions complexes que le droit proprement local ne résout pas. Ces éléments rajoutés sont des éléments de droit romain, en particulier des Institutes de Justinien, concernant les définitions juridiques. Il y a aussi des éléments de droit romain concernant la validité des contrats. La présence du droit romain s'explique par le fait que les auteurs de ces premiers coutumiers sont des personnes qui ont suivi des études de droit dans les premières universités . Elles connaissent bien le droit romain, même dans les zones de la France où il est supposé ne pas s'appliquer comme une source directe de droit. Il y a aussi en ajout des éléments empruntés à d'autres coutumes géographiquement voisines. Ainsi, on a pu parler d'un groupe de coutumes de l'Ouest du royaume qui ont des points communs. Il y a aussi l'insertion d'éléments créés de toute pièce qui résultent de la volonté de l'auteur de modifier certains points de la coutume locale. Mais les auteurs ne présentent pas ces modifications comme un souhait de réforme mais comme l'état du droit déjà en vigueur.Exemple : d'un des plus célèbres auteur du droit coutumier, Philippe de Bomanoir qui est, juge de côté de Beauvais. Il est l'auteur de la coutume de Beauvaisie en 1283.
b. Le rôle précurseur de la Normandie dans le droit coutumier
Le premier recueil de droit coutumier est Normand, en 1199. Cette précocité dans la démarche de mise par écrit s'explique par le contexte politique très particulier et différente des autres provinces du royaume. La Normandie continue à faire partie théoriquement de la France. À partir du Xe siècle, elle va dépendre politiquement du royaume d’Angleterre après que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066 . Ses descendants vont posséder un double pouvoir jusqu'en 1204. Ils sont à la fois des Rois d'Angleterre et des Ducs de Normandie. Ces rois sont au départ les descendants directs de Guillaume le Conquérant, puis ensuite des descendants par les femmes dans la dynastie des Plantagenêt qui résulte du mariage de la princesse Mathilde, fille de Henry Ier avec le Comte de l'Anjou. Cette dynastie va conserver le pouvoir jusqu'au XVe siècle.Les Rois d'Angleterre contrôlent politiquement une grande partie de la France continentale :
La NormandieLes territoires possédés par les Plantagenêt avant de devenir Rois d'Angleterre : l'Anjou, la Touraine, le Maine, le Berry.Un vaste ensemble composé de toute la partie Sud de la France allant de la Loire aux Pyrénéennes.
Cette situation politique est propice à la mise en place très précoce d'un État de droit, et donc à l'émergence d'un droit coutumier, avant les autres régions. Puisqu'il apparaît très tôt, ce même droit va être rapidement mis par écrit. Il impose la proximité de l'administration et le gouvernement du Roi d’Angleterre.Il existe plusieurs versions médiévales successives concernant l'ancien droit coutumier Normand :
« Le très ancien coutumier de Normandie » , texte qui est rédigé en latin entre 1199 et 1223.
Traduction française donné vers 1220. Ce texte a été rédigé à titre privé par deux auteurs successifs dont on n'a pas les noms : un clerc du sénéchal du duc de Normandie et un clerc des environs de Bayeux qui rédige la suite du très ancien coutumier après la reconquête de la Normandie par le Roi de France Phillipe Auguste.Il y a des élément sur le régime des biens entre les époux, sur le régime successoral, notamment la situation des veuves et des orphelins, des éléments de droit pénal (la sanction des attaques sur les chemins, la répression des
assassinats, vols d'outils agricoles...), des points de régime féodale avec les droits des seigneurs. Cet ouvrage contient la retranscription d'une enquête destinée à constater les « droits des ducs rois ».
« Le grand coutumier de Normandie » . Texte rédigé au latin, dont le titre exact traduit est « L'ensemble des lois de la Normandie devant la juridiction laïque ».Le texte latin est considéré comme la référence officielle, mais il y a aussi des traductions en Français. L'auteur est un peu mieux connu. Il s'agit d'un clerc qui s'appelle Maucaël, qui compose son ouvrage entre 1235 et 1258.C'est un véritable traité qui a été mûrement réfléchi et organisé. Ce texte prend pour point de départ le « Très ancien coutumier » mais les textes sont réorganisés, parfois réécrits pour qu'ils soient plus clairs. Il va s' inspirer du droit ecclésiastique pour compléter en matière de droit de la famille notamment. Le plan retenu est celui du déroulement d'un procès. Ce grand coutumier accorde une grande place à la procédure.
À l'époque, ce texte est très vite considéré comme ayant une valeur officielle alors qu'il ne s'agit au départ qu'une initiative privée. La légende dit que ce texte a été rédigé sur les instructions de Phillipe Auguste. Ce grand coutumier va rester en application jusqu'en 1583 en Normandie. Il conserve encore partiellement force juridique à Guernesey au début du XXIe siècle.
c. L'exemple de la Bretagne
Le contexte politique breton est très différente de celui de la Normandie. Cela explique la mise par écrit beaucoup plus tardive (premier quart du XIVe). À ce moment là, la Bretagne est une principauté qui a le titre de duché, les ducs de Bretagne sont juridiquement vassaux du Roi de France. Ce duché de Bretagne s'est reconstruit à partir du Xe siècle lorsqu'un descendant du dernier Roi de Bretagne a chassé les Vikings, du nom de Alain Barbe Torte.L'histoire politique du duché est longtemps très agitée, ce qui recule le développement du droit parce qu'il y a des tentatives de domination politique sur la Bretagne à la fois des rois d'Angleterre et de France qui imposent des membres de leur famille comme ducs à la suite d'opérations militaires :
En 1082 c'est le mariage d'un fils du Roi Henry II de Plantagenêt avec la Duchesse Constance, bretonne. La Bretagne tombe dans l'orbite anglaise.En 1213, mariage d'un arrière petit fils du Roi de France Pierre de Dreux avec la Duchesse Alice de Bretagne.
À partir du milieu du XIIIe, la situation politique se stabilise sous les Ducs de la dynastie de Dreux Bretagne. C'est le début d'un siècle de paix civile et extérieure. Cette paix est propice au développement de l’État de droit. On constate durant ce siècle :
L'accroissement du pouvoir politique des Ducs.Le développement d'un droit coutumier commun à l'ensemble du duché qui dépasse les fluctuations purement locales propres à une ville ou à une seigneurie.Le droit coutumier, s'est suffisamment fixé au début du XIVe pour qu'on puisse envisager de le mettre par écrit. Le contexte est doublement favorable à cette époque :Contexte politique : la présence d'un règne long et pacifique du Duc Jean III le Bon (1312-1341). Il va mener une politique de ménagement à la fois vers le Roi de France et le Roi d'Angleterre.Contexte intellectuel et symbolique : l'importance de la figure symbolique d'un juriste et prêtre, Heloury qui a démontré par l'exemple de sa vie que l'on pouvait concilier le droit positif et la poursuite des causes justes. Heloury est né vers 1250 à Tréguier, il devient juge ecclésiastique à Rennes puis dans sa ville natale. Il a suivi de solides études de droit à la fois du droit ecclésiastique à la Sorbonne puis de droit civil romain à Orléans. De surcroît, parallèlement à sa fonction judiciaire, il accepte fréquemment d'assurer bénévolement la défense devant d'autres tribunaux que le sien des « misérables personnes, des pauvres, des veuves et des orphelins. » Heloury est très populaire de son vivant. Son action montre au plus grand nombre de personnes que le droit, ce n'est pas un moyen de domination des plus faibles mais au contraire un instrument de leur protection. Le développement et la popularité du droit en Bretagne début XIVème stimule et suscite la réflexion juridique, préalable nécessaire à la rédaction d'un ouvrage synthétisant du droit.
Concrètement, le coutumier breton va être connu sous le nom de la « Très Ancienne Coutume de Bretagne » pour distinguer ce texte des rédactions officielles du XVIe siècle, en 1539 et 1580. Cette très ancienne coutume est d'abord un travail anonyme. En réalité, c'est un texte collectif auquel trois personnes ont contribué. Ces auteurs sont : Pierre Copu dit le Sage, juge à Quimper, Eon de Treal dit Treal le fie r, magistrat à Nantes et Rennes, Maé, surnommé le Leal, c'est-à-dire le loyal.C'est un texte subdivisé en 335 chapitres. Il est écrit en un vieux français, très archaïque. Sa compréhension est difficile. Il s'agit pour l'essentiel de développements juridiques, mais ces développements sont entremêlés de
nombreuses considérations morales et religieuses, beaucoup plus fréquentes que dans les autres coutumiers de la même époque.
Du point de vue juridique, la très ancienne coutume commence par appeler explicitement la définition de la justice donnée par les Institutes de Justinien. C'est « une volonté établie et certaine qui doit faire droit à chacun ». Ensuite, on trouve des règles :
De procédure civile, elles expliquent les étapes successives d'un procès, les divers moyens de défense, ce qui concerne les manières de mettre à exécution une sentence.De droit civil, par exemple en matière de droit de la famille, le système du douaire qui est laissé à la veuve qui devient ainsi une douairière. On trouve aussi le partage égal des biens immeubles entre les enfants roturiers.De droit pénal, extrêmement rigoureuses, le droit pénal a joué un rôle moteur dans l'apparition du droit. Coutumier.De procédures pénales. Chapitre 112 : Comment les condamnés doivent être mis à mort.
Cette très ancienne coutume de Bretagne, malgré ses archaïsmes, va rester en vigueur jusqu'à la Renaissance, jusqu'à la rédaction officielle de 1539. En même temps, il y a à cette époque une rupture sur la forme tout en ayant une continuité sur le fond. La rupture sur la forme : on part d'un texte privé à un texte officiel.
Sur le fond : c'est un texte littéraire, on passe d'un texte rédigé sous une forme littéraire à un texte rédigé en articles beaucoup plus courts. La continuité est relative parce que les rédacteurs de la coutume officielle prennent pour base de leur travail le texte médiéval et cela se comprend puisqu'on reste dans un concept de droit coutumier et on considère que la coutume était restée vivante du Moyen-Age au XVIe. La rédaction officielle ne pouvait faire autre chose que de partir de la coutume existante tout en ne mettant plus par écrit les usages tombés en désuétude.
C. Les statuts privilégiés des ordres, des communautés d'habitants et des communautés professionnelles
1. L'organisation de la société en trois ordres dotés de privilèges
À partir de l'an 1000, la société française a été divisée en trois catégories, qui vont former trois ordres distincts :
Le clergéLa noblesseLe tiers-état, les roturiers
Ces trois ordres n'ont pas simplement une signification sociale. Ils ont aussi une lourde signification juridique. Le droit va leur donner un statut juridique différent. Ce statut est supposé permettre aux intéressés de remplir au mieux leur mission sociale. Mais l'idée est que pour cela, ils doivent collaborer théoriquement les uns avec les autres dans l'intérêt général.Exemple : La noblesse protège le tiers-état, le tiers-état nourrit la noblesse.
Au départ, il est clair que le système juridique des ordres n'avait pas pour but de protéger les intérêts égoïstes d'une catégorie sociale pour opprimer les autres. Le système des ordres, du point de vue théorique, ne procède nullement du concept de « lutte des classes ». Le système est donc globalement accepté durant le Moyen-Âge et même au-delà. Il est quand même globalement déséquilibré puisque le statut juridique des deux premiers ordres est surtout caractérisé par des avantages appelés privilèges. Ceux-ci sont destinés, normalement, à leur permettre de se consacrer au mieux au métier des armes et à la prière.Pour les deux premiers ordres, il existe des privilèges :
Honorifiques : cela concerne les nobles, en liaison avec leur mission militaire d'origine. Il y a le port de l'épée, le monopole de la chasse, monopole des armoiries, et monopole de colombier.Professionnels : ils concernent pour les nobles, les emplois réservés dans les grades supérieurs de l'armée. Accès réservé au sein de certaines cours souveraines de justice, les Parlements.Fiscaux : il y a une exemption de la plupart des impôts pour les nombres qui sont supposés verser l'impôt du sang pour la défense du royaume. Le clergé également ne paye pas d'impôts en théorie mais en pratique il doit verser au Roi une somme importante : le don gratuit qui est obligatoire.
Le statut juridique du tiers-état : historiquement, le tiers-état se voit reconnaître le monopole du travail perçu au
départ comme étant celui de l'enrichissement par des activités économiques. Cela va permettre l'apparition de la bourgeoisie au XIIIe siècle. Il est en conséquence interdit aux nobles de faire concurrence aux membres du tiers-état sur le domaine des activités commerciales et artisanales. Si un noble se livre à de telles activités, il déroge à la noblesse et perd définitivement le bénéfice de son statut, il va notamment payer des impôts. (L'exploitation de ses terres agricoles n'est par contre jamais considéré comme une dérogeance).
Sur la question de la dérogeance, il y a une spécificité du droit breton : le système de la « noblesse dormante » . Cela veut dire que le noble désargenté qui souhaite se livrer à une activité notamment commerciale peut. En Bretagne, en fait une déclaration à la justice en remettant symboliquement son épée. Pendant toute la durée de l'activité commerciale, le noble est assimilé à un roturier du tiers-état. S'il cesse cette activité, on considère que sa noblesse n'a été que « endormie » pendant quelques années et il peut récupérer toutes ses prérogatives aristocratiques.
Le bénéfice de l'activité économique ne concerne en réalité qu'une toute petite partie des membres du tiers-état qui constituent globalement le monde des négociants urbains, suffisamment aisés, qui vont donner naissance à la bourgeoisie. L'immense majorité des membres du tiers-état appartiennent cependant au peuple des campagnes. Pour eux, le statut est plutôt celui du monopole du plus dur labeur et celui de l'exploitation fiscale, puisque l'essentiel de la pression fiscale repose sur le tiers-état des campagnes.
Le système des ordres, jusqu'à l'époque de Louis XIV, est globalement accepté par l'ensemble de la population, il n'y a pas de révolte du tiers-état car :
Pendant longtemps, la noblesse continue à jouer un rôle défensif y compris au niveau local et ce au moins jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans (XVe)Le système des ordres n'est pas figé et il y a des passages d'un ordre à l'autre, des passages du tiers-état vers l'ordre de l’Église y compris dans la hiérarchie ecclésiastique. On a même des passages du tiers-état à la noblesse, ce qui fait que le système des ordres n'empêche pas l'ascension sociale.
Comment un roturier peut-il devenir noble ?Il peut y avoir un anoblissement express qui est fait par le roi ou un prince territorial. Cet anoblissement, en général, récompense soit une action militaire particulièrement réussie et dangereuse, soit quelqu’un qui a été fidèle à la monarchie dans les périodes difficiles , soit récompense un grand service rendu à l’État. Pendant longtemps l'anoblissement est très réel. Ce système permet à des gens d'origine modeste d'accéder aux plus hautes fonctions de l’État. Ex. un ministre de Louis XIV, Colbert, est le secrétaire de la maison du roi. C'est le fils d'un mercier (marchand de tissu) et le lointain descendant d'un maçon du XVe.
Autre manière de devenir noble : l'achat et/ou l'exercice d'un office professionnel anoblissant. Les offices professionnels sont à l'origine du système actuel des offices ministériels (notaires, huissiers, commissaires-priseurs). Pour pouvoir exercer ces professons, il faut en avoir les capacités techniques et aussi avoir acheté une charte professionnelle ou en avoir hérité. Au XXIème siècle, le système des offices est résiduel. Sous l'ancien régime, ces offices sont particulièrement nombreux et constituent la manière principale d'exercer une fonction publique. Pour rendre certains offices prestigieux particulièrement attractifs, et pour le rendre à un prix élevé, la monarchie décide que ces offices permettront à leurs acquéreurs roturiers de devenir noble et de transmettre héréditairement cette noblesse si ils meurent en fonction.
La dernière manière d'acquérir la noblesse, jusqu'au XVIIème siècle, est un anoblissement tacite très controversé par la noblesse d'origine. C'est pour certaines personnes aisées d'adopter un style de vie noble sur plusieurs générations et d'utiliser également le système successoral aristocratique qui attribue l'essentiel de la succession au fils aîné. En général, cet anoblissement tacite se conclut par l'achat d'un fief et l'adjonction du nom du fief au nom patronymique.
À partir du XVIIe siècle, le système des ordres va se figer et, en conséquence, va être de plus en plus difficilement accepté par le tiers-état, ce qui va préparer socialement la révolution française. Il se fige car :
L'anoblissement tacite devient impossible car Louis XIV s’efforce de démasquer ce type de nobles afin de les soumettre à payer des impôts.L'anoblissement par charge, par achat d'office, devient de plus en plus difficile car les offices de la magistrature tendent à rester au sein des mêmes familles sur plusieurs générations. Donc ces offices ne permettent plus d'anoblir de nouvelles personnes.On assiste, au XVIIIe siècle, à une réaction nobiliaire liée à l'inflation. Cette réaction se traduit en particulier par la volonté de mieux exploiter économiquement les seigneuries et donc d'appliquer avec beaucoup plus de rigueur la fiscalité seigneuriale aux paysans.
2. La structuration des professionnels en corporation de métiers investis de prérogatives officielles
a. L'apparition et le développement du système corporatif
L'idée, c'est que depuis le milieu du Moyen-Age et jusqu’à la Révolution française, une partie importante des artisans et commerçants qui exercent leur activité de façon indépendante et de leur propre coût , sont structurés en communautés de métiers que l'on appelle à l'époque des « jurandes », aussi appelées « corporations ». Terme apparu au moment où on les supprime.
Ces artisans ou commerçants réunis en corporations constituent la catégorie des métiers jurés. Cette existence de corporation n'est pas une spécificité française, et c'est un phénomène que l'on retrouve globalement dans toute l'Europe Occidentale du Nord au Sud. Ce système d'organisation professionnelle va être très fortement encouragé par le pouvoir royal à partir du Moyen-Age jusqu'au XVIIe. Le pouvoir royal considère que les corporations sont un des maillons qui permet d'intégrer les individus au système politique de la monarchie. En les intégrant au système politique de la monarchie, on est assurés de leur fidélité. Ce système politique est appelé le système des « corps intermédiaires ». C'est l'idée que chaque personne est symboliquement reliée au Roi à travers plusieurs strates successives d'institutions et chaque strate a des représentants qui contribuent à conseiller le Roi plus ou moins directement en émettant des avis purement consultatifs.
Cette théorie est liée aussi à l’organisation des États généraux. Ces États généraux sont une assemblée politique nationale qui est convoquée épisodiquement par le Roi, notamment en cas de crise politique ou financière. Les corporations professionnelles contribuent à la désignation des députés du tiers-état aux États généraux. Le système corporatif ne régit pas tous les commerçants d’artisans indépendants, seulement la moitié. C'est un système qui ne concerne que les métiers exercés d'une certaine importance où il y a suffisamment de professionnels qui exercent le même métier. Même dans les villes d'une moyenne importance, tous les artisans et commerçants ne forment par des jurandes.Exemple : la situation à Rennes au XVIIIe siècle. Il y a 104 professions différentes recensées pour le commerce et artisanat, et seulement 24 corporations. À St-Brieuc, il n'y a qu'une corporation. À Lamballe, il y a une jurande très réputée, celle des parcheminiers, créée au XVe siècle. Elle disparaît au XVIIe.
Pour les campagnes et les baux ruraux, les artisans sont relativement nombreux mais ils travaillent toujours en dehors du système corporatif. Ils sont quand même soumis au contrôle de l'administration royale et de la justice des seigneurs locaux : catégorie des métiers réglés (= réglementés).
L'origine de ces corporations. Il y a une double-origine en fonction des lieux :
Le Nord de la France, les pays germaniques et l'Angleterre. Les organisations professionnelles ont été au départ créées dans un soucis de défense des commerçants et des artisans. Ces commerçants veulent sécuriser leurs transactions, surtout quand elles s'étendent au loin. Ce type de corporation apparaît au XIIe siècle et prend au départ le nom de « guilde des marchants », ou « hanse des marchants ».Exemple : la hanse des Cordonniers de Rouan, la hanse des marchants de l'eau à Paris.
Le système des hanses va constituer un véritable réseau international de comptoir de commerce formé par les négociants des Flandres et de la sphère germanique. On a un réseau de villes hanséatiques qui s'étend des Flandres jusqu'à la Lettonie.
Les corporations de l'Ouest de la France et du Sud de la Loire. Les corporations résultent plutôt d'un phénomène à la fois religieux et social. C'est finalement la volonté des professionnels d'un même métier ou métiers voisins de se retrouver ensemble épisodiquement lors des étapes importantes de la vie, dont le mariage et le décès, ou à l'occasion des fêtes religieuses, lors de la fête du Saint-Patron des métiers.
Au départ, ces rassemblements professionnels se font dans le cadre d'une confrérie qui est à la fois religieuse et profane. Contrairement à une jurande véritable, l'accès de ses confréries est libre et ces confréries ne sont pas dotées de prérogatives exclusives. Au cours des siècles, certaines confréries professionnelles vont se transformer en corporations véritables et d'autres vont rester des confréries.À Paris, la transformation des confréries en corporations est particulièrement précoce puisqu'il y a de nombreuses jurandes dès l'époque de Saint Louis au XIIIe siècle. Pour la Bretagne, le phénomène est plus tardif puisque les premières transformations se situent à la fin du XIVe début XVe siècle. Pour St-Brieuc, il y a une importante confrérie de marchands fondée en 1710 mais elle ne se transforme jamais en jurande.
Le contrôle du roi sur les corporations artisanales et commerciales est la contre-partie des prérogatives et privilèges officiellement accordées aux jurandes par le pouvoir politique. Comment ce manifeste ce contrôle ?Ce contrôle se fait surtout au moment de la confirmation officielle des règles de fonctionnement et des statuts dont se sont dotés les professionnels, c’est l'homologation des statuts par le pouvoir royal. Ces statuts doivent être approuvés par le pouvoir politique (Roi ou Princes) pour qu'ils aient une force obligatoire vis-à-vis de tous les professionnels du métier et aussi vis-à-vis des membres des métiers voisins.
Compte tenu du système absolutiste, le roi est totalement libre d'approuver ou non les statuts qui lui sont proposés, il peut aussi décider de les modifier. Cette homologation se fait sous la forme d'une décision royale à valeur législative. On appelle cela des « Lettres Patentes ». Ces lettres patentes symbolisent le fait que le métier, érigé en corporation, a obtenu un statut juridique d'institution semi-publique. Elle sont investies d'une délégation de la puissance publique dans le domaine propre du fonctionnement professionnel.
Dans les limites du fonctionnement professionnel, les décisions prises par les jurandes vont s'imposer juridiquement à tous et donc elles vont former un véritable droit corporatif.
b. Le droit corporatif
Le droit corporatif émane pour l'essentiel des statuts dont se dotent les jurandes lors de leur création . Ces statuts sont une charte constitutive du métier qui peut être complétée au fil des siècles sous le contrôle du pouvoir royale avec des lettres patentes. Le contenu initial des statuts est élaboré avec une grande liberté par les professionnels à l'origine de la jurande. Il s'agit en quelque sorte de mettre par écrit les coutumes professionnelles qui, jusque là, étaient observées tacitement et oralement. Ces statuts au départ son élaborés par des professionnels qui se rassemblent en assemblée générale et procèdent à un vote. Pourtant, il existe de nombreux points communs entre les différents statuts. Cela s'explique par les emprunts faits par les corporations relativement récentes aux statuts des jurandes plus anciennes. Ces points communs permettent de dire qu'il y a un véritable droit commun des métiers jurés en France.L'idée générale est que ce droit a un triple objectif :
Limiter les effets de la concurrence.Instaurer une certaine solidarité entre les professionnels d'un même métier.Contrôler la qualité de la production.
Pour limiter la concurrence, ça passe sur quatre moyens :
Le monopole d'établissement reconnu aux seuls professionnels ayant obtenu le titre de « maître ». Pour autant, le fait qu'il y ait un monopole ne signifie pas qu'il y ait un Numerus closus, la limitation du nombre de maîtres autorisés à s'établir dans une ville donnée puisque cet examen de maîtrise résulte d'un examen et non pas d'un concours.
La maîtrise professionnelle est obtenue par une épreuve technique que l'on appelle « le chef d’œuvre ». Ici, le mot chef d’œuvre a un sens différent du sens actuel car ce « chef d’œuvre » n'est pas une prouesse technique réalisable simplement par une petite élite professionnelle. En terme de difficulté, le « chef d’œuvre » corporatif correspond à celui d'un BEP.
En réalité, la nécessité de passer cet examen de maîtrise contribue quand même à limiter le nombre d'artisans dans les métiers car en effet tout le monde ne veut pas ou ne peut pas se présenter à cet examen. Les artisans qui n'ont pas ce titre de maître ne peuvent travailler que comme salarié d'un maître et s'ils se hasardent à travailler à leur compte, ils sont considérés comme des travailleurs clandestins et sont condamnés à payer une lour de amende.
La limitation du nombre d'apprentis pouvant être formés par chaque maître. En général, ce nombre est un seul apprenti en plus des enfants du maître. L'objectif est double :Permettre à chaque apprenti de bénéficier d'une formation individuelle réelleEviter que les maîtres ne soient tentés de multiplier le nombre de leurs apprentis pour avoir de la main d’œuvre supplémentaire quasiment gratuite.
L'encadrement du recrutement des compagnons salariés par les maîtres . Au MA, le recrutement des salariés par les maîtres artisans ou commerçants est totalement libre. Chaque maître peut avoir autant de compagnons qu'il le désire. Le droit corporatif lui interdit simplement de débaucher un salarié travaillant chez un confrère en lui
proposant un salaire supérieur. Les employeurs ont parfois du mal à trouver des salariés. Il y a une évolution au XVIIIe siècle à la suite des pressions des organisations de compagnons qui tentent d'obtenir des salaires supérieurs. En réaction à cela, les jurandes mettent en place un système officiel de répartition des compagnons nouvellement arrivés dans la ville et qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, ils sont répartis selon leur ordre d'arrivé parmi les maîtres désirant embaucher.
La répartition équitable des matières premières par les dirigeants de la corporation. Ici, il s'agit d'éviter que ces matières premières soient accaparées par les maîtres les plus riches, empêchant ainsi les autres de travailler. C'est une règle fréquente au MA mais qui tend à disparaître à partir du XVIe siècle.
On souhaite aussi la mise en place d'une solidarité professionnelle. Pour le Moyen-Âge, c'est un objectif particulièrement important qui résulte de l'origine particulièrement religieuse de nombreuses corporations. Cette solidarité se caractérise par le fait que les jurandes rassemblent en leur sein les trois niveaux d'acteurs de la production artisanale : les maîtres, les compagnons salariés, les apprentis. La corporation a à ce moment là pour but de maintenir des rapports harmonieux entre ces acteurs. La corporation n'oppose pas les intérêts des employeurs aux salariés. Au contraire, les jurandes favorisent une collaboration constructive employeur/salarié.
Une évolution vient remettre en cause cet équilibre à partir du XVIe siècle en particulier suite à une très forte inflation. Elles tendent à devenir des organisations uniquement patronales. La solidarité entre les maîtres est en déclin par rapport au MA mais elle se maintient quand même en partie jusqu'à la fin de l'ancien régime. Elle se présente à la fois de façon symbolique et économique. Du point de vue symbolique, l'ensemble de la profession est associé aux grande étapes heureuses ou malheureuses de la vie de ses membres. Il y a notamment une obligation pour tous les maîtres d'assister aux funérailles de leurs collègues à peine d'amende. Du point de vue économique, au MA certaines corporations versent une rente hebdomadaires aux maîtres dans l'incapacité de travailler que cela soit suite à un accident, à la maladie ou la vieillesse. D'autres corporations versent également une rente hebdomadaire aux maîtres en chômage technique.
Jusqu'à la fin de l'ancien régime, la solidarité continue à se manifester en faveur des veuves des maîtres. Il leur est reconnu le droit de continuer l'activité de leur défunt mari alors qu'elles ne sont pas elle-même titulaires de la maîtrise. La seule condition est qu'elles embauchent un compagnon salarié compétent.
Le contrôle de la qualité de la production. Ce contrôle se fait par des visites des dirigeants corporatifs dans les ateliers et les boutiques des membres de la profession. Ces visites ont lieu soit à des dates régulières, soit à l'improviste et parfois sur dénonciation. Les objets présentant des malfaçons sont saisis et les auteurs peuvent être condamnés à une amende et à des dommages et intérêts par des tribunaux en charge de la police. Il y a une volonté de défendre le consommateur.
III. L’élaboration et la diffusion de « Droit savants », formant un véritable droit commun de l’Europe continentale.
Ve siècle, fin de l'Empire Romain. Cela n’entraîne pas la disparition du droit romain sur le territoire de l'Europe Occidental et sur le territoire de la Gaulle. Cette chute a contribué à un incontestable appauvrissement de la norme juridique. Appauvrissement que l'on remarque dans les lois de l'époque mérovingienne, notamment la loi salique, et on le remarque aussi dans la coutume, dans sa forme primitive purement orale. Durant toute cette époque (Ve-XIe) il y a bien des normes générales et impersonnelles à caractère obligatoire, il y a bien des règles de droit. Mais en cette même époque il n'y a pratiquement plus de réflexion juridique.
Les choses changent à partir de la fin du XIe siècle parce qu'on découvre en Italie le Digeste de Justinien qui n'était pas connu jusque là. Ce Digeste, c'est donc la découverte de la source la plus riche du droit romain du point de vue quantitatif. Dans le même temps on assiste à la naissance d'une nouvelle branche du droit sans rapport avec le droit romain, le droit canonique. Ce droit est relatif aux normes édictées par l'institution ecclésiastique, des canons de l’Église, et sont édictées par le Pape, etc. Le domaine d'application de ce droit canonique dépasse les simples prêtres, moines et religieux, et ce droit canonique au MA touche bien des aspects de la vie des laïcs, notamment dans le droit familial.Exemple : La définition implicite du mariage, union entre deux sexes différents.
Le XIIe siècle peut être considéré comme marquant la seconde naissance du droit en Occident. Ce droit romain que l'on redécouvre et le droit canonique sont à ce moment perçus comme des droits savants. On les oppose à la
coutume puisque au départ, les coutumes contiennent des normes juridiques élaborées sans véritable logique juridique d'ensemble. Ces droits savants vont avoir un impact direct sur la coutume quand cette coutume va commencer à être mise par écrit à titre officieux, le plus souvent par des juristes ayant étudiant ces droits savants.
A. La redécouverte et la prééminence intellectuelle du Droit romain
La redécouverte intellectuelle du corpus juris civilis est localisée dans le Nord de l'Italie, en particulier à Bologne, mais en fait la connaissance va se diffuser très rapidement dans le reste de la péninsule italienne grâce à l'apparition de l'enseignement universitaire. Bologne restera la capitale européenne du droit au Moyen Age.
1. La redécouverte du Droit romain par l’Europe Occidentale
L'empire romain d'Occident n'a jamais connu le corpus juris civilis de Justinien. Il n'a connu que le code théodosien, pérennisé par sa reprise partielle dans le bréviaire d'Alaric. L’œuvre de Justinien a pénétré brièvement le Sud de l'Italie lors des opérations de reconquête de l'Italie occidentale à partir de 540.Une copie du Digeste faite au VIe siècle a été amenée au sud de l'Italie puis cachée dans une petite cité au nom d'Amalfi. Ce manuscrit a probablement été oublié par la suite. Il réapparaît six siècles plus tard dans le Nord de l'Italie à Pise. Il est déplacé à Florence suite à des guerres. Il est toujours conservé là-bas dans une bibliothèque publique aménagée sur les plans de Michel-Ange.
Plusieurs légendes expliquent cette redécouverte. Selon une légende, un mur s'écroule pendant une guerre et apparaît le corpus juris civilis (1137). En réalité, il y a un autre manuscrit du Digeste qui est attesté à Bologne dès les années 1070. C'est un manuscrit partiel, de moins bonne qualité que le manuscrit d'Amalfi.On sait qu'il y a un manuscrit à Bologne car en 1076 pour la première fois une règle directement tirée du Digeste est utilisée pour légitimer une décision judiciaire dans un procès rendu en Toscane. On sait qu'à l'occasion de ce procès, le Digeste est invoqué par quelqu'un qui a le titre de docteur en droit et qui, dans les sources latines, est appelé maître Pepo. On peut considérer que ce Pepo est le véritable redécouvreur du droit romain. En même temps on ne sait pratiquement rien sur lui, il n'a laissé aucune œuvre juridique. C'était probablement un professeur de grammaire et non pas un véritable juriste qui s'est intéressé au Digeste parce qu'il a été séduit par la beauté du latin de Justinien.
C'est un autre personnage qui permet de commencer l'étude juridique du Digeste : Irnerius (décède vers 1130). À l'origine c'est un grammairien, il est aussi juge à Bologne. Pendant une vingtaine d'année, il va donner des cours publics de grammaire et de droit. Il va commenter uniquement certains chapitres du Digeste. Il les commente oralement en donnant d'abord le sens littéral du passage étudié. Il s’efforce ensuite d'expliquer le sens juridique de la disposition. Cette méthode qui consiste d'abord à expliquer mot à mot le texte s'appelle la méthode de la Glose. Cela vient d'un terme grec qui signifie la langue et le mot. Irnerius est historiquement le premier des glossateurs. Il marque la naissance de la doctrine juridique médiévale. Comme il n'y a pas l'imprimerie, les élèves écoutent et prennent des notes. Cet enseignement et repris par quatre de ses élèves qui vont fonder des fondations juridiques : les quatre docteurs de Bologne. Ils laissent une œuvre juridique importante mais on ne sait pas grand chose de leur vie. Leurs noms sont :
Martinus, qui est professeur et particulièrement réputé au milieu du XIIe siècle.Bulgarus, qui meurt autour de 1166.HugoJacobus
Ces quatre docteurs de Bologne créaient un phénomène d'une renommée immense qui très vite atteint une renommée européenne. Ils ne sont pas toujours d'accord sur l'interprétation du Digeste. Mais ces divergences sont très positives car elles stimulent intellectuellement la controverse juridique et introduire dans l'enseignement du droit la disputatio, la dispute juridique. Les quatre docteurs forment des élèves qui vont ensuite revenir dans leur pays d'origine en tant que conseillers des principes ou des Rois. Ils créaient des écoles de droit plus ou moins éphémères. Parmi ces élèves, on peut donner deux noms :
Azon (XIIIème)Accurse, son disciple, qui va rédiger la Grande Glose, constamment réimprimé jusque la fin de l'Ancien Régime.
Le Digeste est introduit en France dès la fin du XIIe siècle par Placentin, originaire de Plaisance, il s'établit à Montpellier et va y enseigner le droit vers 1180. Se pose la question de l'enseignement du Digeste un peu
officieux. On voit la naissances des universités.
2. L'enseignement du droit romain dans les premières universités
C'est au milieu du XIIe siècle que va apparaître à Bologne en Italie la première structure d'enseignement supérieure que l'on peut qualifier d'université. Cette structure fait l'objet d'une reconnaissance officielle et d'une protection par le pouvoir politique. C'est l'empereur du Saint-Empire Germanique qui reconnaît l'université, Frédéric Barbe Rousse. Sa reconnaissance passe par une immunité judiciaire accordée aux étudiants et aux maîtres par rapports aux tribunaux royaux.
Des structures d'enseignement supérieur vont se retrouver en France dans le courant du XIIIe siècle.Exemple : Paris, 1215, Montpellier, 1289.
Les universités vont se généraliser au XIVe siècle, ils prennent une dimension européenne.Exemple : Orléans devient une université en 1306 mais qui disposait d'une importante école de droit depuis 1250.
En Europe entre 1200 et 1378, il y a 28 universités de créées, dont Oxford pour l'Angleterre, et Cambridge.
Pour le duché de Bretagne, la création d'une université n'a lieu que tardivement, en 1460. Cette création est due à l'initiative du dernier duc de Bretagne François II qui souhaite disposer dans sa principauté d'un lieu de formation des élites intellectuelles qui échappent en partie à l'influence française. Il obtient la reconnaissance de l'Université par le Pape. C'est l'origine directe de la faculté de droit de Rennes qui a été établie à Nantes jusqu'en 1735. À cette date a été transférée à Rennes par soucis de proximité avec le Parlement de Bretagne.
Le mot même d'université. Ce mot, à l'origine, n'est pas exclusivement utilisé pour désigner un établissement de type universitaire, il a un sens beaucoup plus large. En fait, le mot « université », au XI-XIIe siècle s'applique à tout groupe d'hommes ayant une appartenance commune ou bien unis par des liens organiques, par une organisation. On va par exemple parler de l'université des bourgeois d'une ville. On peut dire que au départ les universités d'étudiants ne sont qu'une université parmi d'autres.
L'apparition des Universités à partir du XIIe siècle ne constitue pas une totale innovation mais plutôt une évolution importante dans le système éducatif. Ces Universités sont bien une évolution car elles se greffent sur un système d'enseignement pré-existant. À aucun moment au Moyen-Âge la transmission des savoirs intellectuels n'a été totalement suspendue. Mais durant l'époque mérovingienne elle a été surtout assurée par l'institution ecclésiastique : l’Église a besoin de prêtres qui aient un minimum d'instructions pour célébrer la messe. Il faut qu'ils soient capables de lire et de comprendre correctement le latin et il faut qu'ils soient formés à des rudiments de théologie, littéralement la science de Dieu.Dès avant le Xe siècle, des écoles ecclésiastiques sont fondées par des évêques et des abbés. Ce sont donc des écoles épiscopales ou monastiques. Elles vont préparer à l'étude de la théologie mais avant de l'aborder, elles enseignent les Sept Arts Libéraux, selon une typologie mise en place au Ve siècle. On y enseigne la grammaire latine, la rhétorique latine, la dialectique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. On enseigne en fait ce que disait Aristote. Les enseignants et l'immense majorité des élèves sont des clercs. Ce sont des jeunes gens qui ont le premier degrés des Ordres permettant d'accéder à la prêtrise. À l'époque, le premier Ordre est la tonsure.
L'apparition des Universités va être le résultat de la volonté des enseignants et des élèves de s'émanciper de la tutelle trop stricte des élèves. Pour s'émanciper de cette tutelle, ils vont recourir à une double protection : la protection du pouvoir politique (l'empereur, le Roi ou le prince territorial) et la protection à la fois religieuse et temporelle du pape. Cette tutelle du pape sera beaucoup moins pesante à cause de l'éloignement. L'université est née d'une communauté d'intérêts des maîtres et des élèves car eux-deux revendiquent le droit de gouverner de manière très autonome sur la base de statuts qu'ils se sont donné.
Il y a une autonomie sur deux grands domaines. Il y a l'autonomie dans l'organisation des études et la délivrance des diplômes. Celle-ci se fait sous l'autorité d'un recteur de l'université qui est élu tous les trois mois et uniquement par les étudiants. L'autre aspect est l’autonomie du point de vue juridictionnel en étant soumis uniquement au tribunal ecclésiastique de l'évêque, appelé « officialité ». Les étudiants comme les enseignants échappent à la juridiction pénale ordinaire des juges royaux qui en général étaient beaucoup plus sévères pour réprimer les fréquentes bagarres des étudiants. Pour obtenir une telle autonomie il faut un acte officiel émanant de l'autorité morale la plus prestigieuse de l'époque, la papoté. Les Universités sont créées par une bulle pontificale. Il s'agit d'un grand parchemin récapitulant les immunités et qui est scellée d'un sceau en plomb.
Au Moyen Âge, une Université de plein exercice regroupe quatre facultés : studium generale, l'ensemble des études :
La faculté des Arts, c'est en réalité l'équivalent d'un lycée. Elle constitue en quelque sorte le cycle préparatoire permettant d'accéder aux trois autres facultés dites « supérieures ». Fréquentée surtout par des écoliers adolescents. Les études s'achèvent par l'obtention du baccalauréat S Art, premier diplôme universitaire.La faculté de théologie.La faculté de médecine.La faculté de droit.
L'année universitaire commence en octobre, comporte deux semaines de congé à Noël et à Pâques et deux mois de vacances l'été.
Il y a le baccalauréat et la maîtrise S Art pour sanctionner le premier cycle d'étude. Ensuite il y a la licence qui sanctionne cinq années d'étude en général. La licence, c'est le diplôme qui donne le droit, la licence d'enseigner. Après il y a le doctorat qui représente sept années d'étude, et même un doctorat de dix années pour le double doctorat, c'est-à-dire docteur en droit civil et romain, et religieux.Les facultés de droit enseignent principalement deux matières :
Le droit civil romain, le Digeste, le Code et les Institutes de JustinienLe droit canonique
Les étudiants en droit au moyen âge ont entre 18 et 25 ans. Au cours du XIVe siècle, on assiste à une sécularisation progressive des étudiants c'est-à-dire que des étudiants n'ont plus la tonsure, ne sont plus des clercs. Ceux-ci représentent 20 % des effectifs.
Les effectifs totaux des étudiants en droit demeurent relativement modestes. À la fin du XIVe siècle, Orléans et Angers : environ 400 par faculté. L'enseignement du droit est à l'origine de la création des Universités.
La place du droit romain est quand même parfois contestée au sein des universités pour des raisons politiques et religieuses.Exemple : le cas de l'Université de Paris.
Dès les premières années de son existence, le pape va prononcer une interdiction absolue d'y enseigner le droit civil. Honorius III : décrétale « super speculam ». Pour désigner un texte de pape, on cite les premiers mots du texte. Le pape interdit l'université de paris avec ce décrétale. Il craint que l'enseignement du droit romain ne nuise aux études de théologie puisque la réputation des études de théologie à Paris au XIIIe siècle est de réputation européenne. Saint Thomas D'Aquin va venir enseigner le droit à Paris. Le pape pense que de brillants élèves à Paris risquent de se détourner des études de théologie au profit des études de droit. Cette crainte par le Pape rejoint aussi les préoccupations du roi de France. Le roi se méfie d'une grande diffusion du droit romain qui pourrait être utilisé contre la monarchie française. Le droit romain est en grande partie impérial. Le roi de France n'a pas le titre d'empereur qui est réservé à l'empereur du saint empire romain germanique.
Cette interdiction va entraîner très rapidement la création d'une école de droit à Orléans. Cette école va devenir très réputée au milieu du XIIIe puis va donner naissance à l'Université d'Orléans.
On peut voir aussi que dans quelques autres pays d'Europe l'enseignement universitaire du droit romain se heurte à des réticences.Exemple : L'Espagne se dote d'une université en 1220. le droit romain y est enseigné au départ puis disparaît des programmes parce que les espagnols se montrent très attachés à leur droit coutumoier et refusent le principe d'une harmonisation du droit espagnol sur la base du droit romain
En Pologne, l'Université de Cracovie est créée en 1364. Le droit romain n'y est pas enseigné.En Angleterre, le droit romain est enseigné à l'Université d'Oxford et de Cambridge : le civil law. À partir de 1234, il est interdit à Londres.Au niveau européen, les universités qui enseignent le droit romain sont beaucoup plus nombreuses que celles qui le rejettent. Elles contribuent largement à faire que le droit romain devienne un droit commun de l'Europe continentale
B. Le Droit canonique, Droit de « l’Eglise universelle »
L’expression de droit canonique repose sur le mot « canon », attesté dan la langue française dès le XIIIe siècle pour désigner une règles religieuse. Ce mot vient lui-même du latin, c’est un terme qui désigne une règle, un modèle. Le droit canonique va désigner l’ensemble du droit de l’Eglise et de l’Eglise catholique.
Cette idée du droit est plutôt intéressante car au départ l’Eglise se construit en marge de toute préoccupation juridique. les premiers chrétiens ne se préoccupent que de fixer le dogme et la théologie ainsi les choses évoluent du IVe siècle par l’édit de Milan en 318. L’Empereur Constantin reconnait officiellement la religion chrétienne et met fin à la persécution des chrétiens.
Les évêques se voient reconnaitre un pouvoir disciplinaire sur les chrétiens en général et sur le prêtes puisqu’on considère que les chrétien n’ont pas a saisir les tribunaux romains considérés avant comme des tribunaux païens. Les évêques disposent d’un pouvoir juridictionnel qu’ils exercent pendant les premiers siècles, personnellement parce que les règles juridiques en application sont relativement simple et ne nécessitent pas de recourir à un juriste ecclésiastique professionnel.
Dans le même temps, a partir de la reconnaissance officielle du christianisme , un droit ecclésiastique se développe et est destinée à encadrer l’organisation de l’Eglise. On voit alors aussi se développer un droit ecclésiastique destiné à encadrer l'organisation de l’Église. Ce droit ecclésiastique a alors deux sources.
À l'époque mérovingienne, il s'agit essentiellement de dispositions adoptées par les évêques réunies en synodes plus ou moins importants. Un synode est une assemblée d'évêques. À l’intérieur des conciles, les papes n 'ont qu'une autorité très réduite. Les acteurs principaux de la législation conciliaire sont les évêques.
Seconde source appelée « les décrétales ». au départ ce sont les réponses données par les papes dans le cadre d'affaires particulières qui leur sont soumises par des instances locales, c'est-à-dire les évêques. Cette procédure rappelle un peu la procédure des rescrits du droit romain. Au cours des siècles et notamment à partir de l'époque carolingienne, l'importance des décrétales augmente et accompagne l'évolution de l’Église d'Occident puisque le Pape va se voir reconnaître un pouvoir supérieur qui tend à s'imposer aux conciles.
Avec l'accumulation des siècles, le droit canonique devient quantitativement de plus en plus important et va pouvoir atteindre plusieurs milliers de textes avec des risques d'incohérence. À partir du XIe siècle se fait sentir la nécessité de réaliser des compilations de ce droit canonique et ces recueils de compilations portent officiellement de nom de « décrets ».
La plus célèbre compilation est faite à Bologne en Italie au XIIe siècle (1140) par le moine Gracien. L'objectif du décret de Gracien est de rétablir la concorde entre les canons discordants. Ici, Gracien va s'efforcer de mener dans le domaine du droit ecclésiastique une œuvre un peu comparable à celle de l'empereur Justinien dans le Digeste. Mais la différence est que Gracien n'intervient qu'à titre purement privé et sans avoir une mission officielle de la papoté. Il rassemble et résume 4 000 textes basés surtout sur les canons dans conciles et les décrétales du Pape. Il y insère des règles de droit romain, des règles tirées des lois dites barbares . En réalité, sa démarche s'inspire complément de celle des glossateurs. Il explique les textes, discute les éventuelles difficultés suscitées par des incohérences et il propose des solutions. Cet ouvrage connaît immédiatement un immense succès. Il devient la base de l'enseignement du droit ecclésiastique dans les facultés de droit. L'évolution est achevée au XIIIe siècle lorsque le pape Grégoire IX interdit d'utiliser d'autres textes que le décret de Gracien pour l’enseignement du droit canonique à Paris, Bologne et Salamanque. Ces facultés sont désignées sous le nom de « décret de Gracien ».
La rédaction de cette compilation ne signifie pas la fin de la création du droit canonique car les papes continuent à promulguer de nombreuses décrétales pour suivre l'évolution de la société et les nouveaux problèmes qui se posent. Ces nouvelles décrétales font à leur tour l'objet de compilations, « Les décrétales de Grégoire IX », « Les Clémentines », décrétales du Pape Clément V, « Des nouvelles décrétales du pape Jean XXII » appelées « Les extravagantes ». Finalement, tous ces textes sont à leur tour rassemblés en une œuvre unique qui est le Corpus junis canonici. Il s'agit d'une compilation faite par des ecclésiastiques à titre privé sans approbation officielle de la papoté. Il va rester la base du droit canonique jusqu'à la publication du premier code de droit canoniqu e au début du XXème siècle.
Le contenu du droit canonique va avoir une importance réelle en terme de source du droit y compris du droit civil laïc. Il aborde aussi tout ce qui concerne les effets des sacrements religieux, en premier lieu des effets du mariage. Cela va être la base du droit de la famille. Le droit canonique va concevoir par exemple la possibilité de filiation adoptive. Le droit ecclésiastique s'intéresse aussi au testament dans la mesure où l’Église bénéficie de nombreuses donations testamentaires. La dernière chose, c'est que le droit canonique se préoccupe enfin de la
procédure devant être suivie devant les tribunaux ecclésiastiques. Ici, ils ressuscitent des grands règles du procès romain avec notamment le principe du débat contradictoire et de la neutralité du juge. On appelle cette procédure la « procédure romano-canonique ». Cette procédure est très en avance sur celle des tribunaux civils royaux et seigneuriaux et elle va donc profondément influencer la procédure civile séculiaire, laïque, dans l'Europe continentale.C'est encore un lègue au droit continental contemporain.
Section 2. L'élaboration d'un droit français spécifique à l'époque moderne (XVI-XVIIIe siècle)
L'époque moderne commence formellement en 1492, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Nous sommes contemporain depuis la République française. A partir de la République française, c'est le début de l'époque contemporaine. Cette typologie de l'histoire a été inventé mise en place par les historiens français dans les années 1840. L'époque moderne correspond a la période post 1492. elle termine en 1789. elle prend surtout son essor avec la période de la Renaissance. Cette renaissance marque culturellement une véritable rupture avec le Moyen Age. Cette rupture se traduit par une volonté de renouer avec l'héritage de l'antiquité greco-romaine. Ce qui nous intéresse est l'impact de cette évolution culturelle sur le droit. Double impact :
La renaissance est caractérisée par un profond renouveau dans l'étude du droit romain au point que l'on a pu parler de seconde renaissance du droit romain. Désormais, les juristes vont s'efforcer de replacer davantage le Corpus juris civilis dans son contexte historique de l'antiquité afin d'éviter les contresens dans l'interprétation des textes. Pour bien comprendre le droit romain de Justinien, il faut replacer les textes dans leurs contextes. Ce phénomène de renouveau du droit romain avec une dimension historique est marquée en France.
Cette approche historique on la trouve dans les oeuvres de grands juristes qui ont enseignés à l'université de Bourges et ils établissent des éditions commentés, beaucoup plus scientifiques du Corpus juris civilis. Deux grands juristes romains : Jacques CUJAS (né a Toulouse en 1522 et mort 1590), ces oeuvres sont étudiées dans toute l'Europe. Cujas est le grand juriste de l'époque et la bibliothèque de Paris porte le nom de Cujas; et l'autre est François le Douaren, il est breton , né a Moncontour en 1509 et meurt à bourges en 1559.
L'évolution des idées politiques : celle ci se traduit par le triomphe du concept de souveraineté, concept progressivement élaboré à partir du XIIIe siècle en rassemblant, en synthétisant 2 principes tirés du droit romain : l' Auc toritas et la Potestas.
L'Auctoritas est l'autorité supérieure de l'empereur romain qui est une notion qui a une dimension juridique mais aussi morale et religieuse. L'autre élément est la Potestas, cela désigne le pouvoir public. Cela désigne l'action politique qui répond au salut public ou à l'intérêt général. Ce concept de souveraineté qui se construit à partir du XIIIe siècle amène a théoriser différemment les pouvoirs du roi.Depuis les premiers capétiens, époque de Hugues Capet (Xe siècle), le roi était considéré comme le suzerain, c'est le seigneur supérieur à tous les autres seigneurs, mais cette supériorité se construit dans une vision féodale du pouvoir politique. Avec cette idée, on voit que la suzeraineté a un caractère purement relatif, le roi est plus grand que les autres seigneurs, dans la réalité, certains seigneurs était militairement et économiquement supérieur au roi bien que ils restassent théoriquement les vassaux du roi.
A partir du XIIIe siècle, le roi ne va pu être perçu comme le suzerain mais comme le souverain, les juristes le définissent comme « celui qui est investit de l'autorité et de la puissance suprême ». Le roi étant le souverain, son pouvoir est d'une autre nature que les seigneurs féodaux, c'est un pouvoir lié à l'idée de souveraineté mais aussi à dimension religieuse car l'on considère que c'est Dieu qui a béni la dynastie des rois de France. Avec la souveraineté, c'est quelqu'un qui est "à part". Le roi dispose d'une souveraineté absolue. La souveraineté ébauchée au Moyen Age va être formalisée au XVIe siècle par un juriste nommé Jean BODIN, père de la science politique moderne. Il est né à Angers en 1530 et meurt dans la vilel de Laon en 1596. On peut dire que la vie de BODIN est marquée par le contexte des guerres d e religion qui oppose les catholiques aux protestants et qui dégénèrent en guerres civiles. BODIN est un magistrat proche du roi Henri III et tente de trouver une voie médiane dans ce conflit civil, il est proche d'un courant : "Le groupe des politiques" qui constitue le tiers parti, ni catholique ni protestants. Sur cette base en 1576, Bodin va publier son oeuvre majeure, " Les six livres de la République". Le mot République doit être pris dans un sens très large et synonyme du mot Etat. Le mot République ne désigne pas forcément la force républicaine d'un gouvernement et il peut y avoir des républiques monarchiques.Pour bodin, la principale caractéristique de la souveraineté est le pouvoir législatif « sans dépendance et sans partage » et c'est le premier a le faire. Innovation par rapoort au Moyen Age qui ne liait pas souveraineté et législation.
La conséquence de l'idée de Bodin est que dans une république monarchique, il est reconnu au roi une pleine capacité d'exercer le pouvoir législatif et qu'il exerce seul dans aucun mécanisme de contrôle démocratique dans l'élaboration de la loi.La seule limite reste que la monarchie reste fondamentalement différente de la tyrannie définie par Aristote comme "l'exercice du pouvoir politique par un seul homme et dans son intérêt exclusif". Pour que la monarchie ne soit pas une tyrannie, il faut une double limite : le roi doit s'entourer de conseils pour élaborer la loi et ne doit pas agir par caprices, et la deuxième chose est que les institutions judiciaires suprêmes (parlements de justice) vont disposer d'un certain droit de regard sur les lois après leur promulgation.
I. La reconnaissance et le développement du pouvoir législatif du roiA. Un processus initié dès le Moyen-Age
1. Les prémices de l'époque carolingienne
A l'époque de Clovis et de ses descendants le fonctionnement de la monarchie mérovingienne est un fonctionnement primitif, on a le Bréviaire d'Alaric et la loi salique pour le droit. Et au niveau politique, il n'y a pas de règles de succession. Les rois n'envisagent même pas de pouvoir imposer à leurs sujets des lois générales et impersonnelles qu'ils auraient élaborer eux mêmes et de leur propre autorité. Et donc les rois n'ont pas de pouvoir législatif et il n'y a pratiquement pas de lois mérovingiennes au sens strict parce que les lois barbares et en premier lieu la loi salique ne sont que la mise par écrit de disposition coutumière mais il s'agit pas de normes provenant de la création du roi.
Les carolingiens (Charlemagne, fils, petit fils) la situation change mais de façon éphémère. Charlemagne dans sa volonté de reconstituer l'Empire Romain d'Orient considère qu'il est le protecteur de la chrétienté et il va contribuer à l'agrandissement territorial des Etats de l'Eglise autour de Rome. Puisqu'il est le protecteur de la chrétienté, il va considérer qu'il a moralement la mission de faire régner dans son Empire la paix chrétienne et pour cela, Charlemagne et ses successeurs immédiats, Louis le Pieux et Charles le Chauve vont publier deux grands textes pacificateurs qui abordent des questions très variées telles que la discipline ecclésiastique ou encore sur la vie civile de l'empire (répression du brigandage, texte interdisant la justice privée, modalités d'exploitation des domaines impériaux).Ces grands textes sont d'abord promulgués oralement par l'empereur et sont rédigés en latin et diviser en petits chapitres que l'on appelle des "capitulaires". Il y a 200 capitulaires conservés pour une centaine d'années, alors qu'en 3 siècles des mérovingiens il y a une dizaine de capitulaires. Ces capitulaires les plus importants font l'objet d'une discussion au sein d'une assemblée solennelle et cette assemblée va regrouper l'empereur, les grands dignitaires de l'empire, les évêques et des abbés. On a bien une législation impériale mais ce droit impérial ne va pas survivre longtemps au partage politique de l'empire d'époque de Charles chauve en 1843. Globalement, le pouvoir législatif des empereurs ou des rois va tomber en désuétude à la mort de Charles chauve en l'année 1877 parce qu'à l'intérieur même du royaume de France, il y a une dislocation du pouvoir royal.
2. Les premiers temps de la féodalité
Les premiers temps de la féodalité : X - XIe siècle. La loi n'est plus qu'un souvenir, on a conservé le souvenir de la loi salique, de la loi des romains. Ce n'est plus un processus normatif vivant, on n'élabore plus de lois pendant pratiquement 2 siècles.Evolution timide qui se fait pendant le règne du roi Louis VI le Gros (1081 – 1137). Elle se produit parce que la monarchie capétienne est encore fragile mais elle veut se renforcer politiquement et pour cela, elle pense à utiliser ou a ressusciter le pouvoir normatif. A partir de là, la loi commence a être associée à l'idée de majesté royale du point de vue de la doctrine. Cette réapparition de la loi va rester déconnecter de l'héritage romain parce que les rois de France ne prétendent pas encore récupérer les pouvoirs jadis exercer par les empereurs romains. Les rois doivent ménager politiquement les seigneurs les plus puissants du royaume parce que la monarchie française en théorie est encore élective. C'est au XIIIe siècle que les rois de France vont revendiquer l'exercice du pouvoir législatif des Empereurs en faisant triompher le principe juridique et politique « le roi est empereur en son royaume ». Il n'est pas subordonné à l'Empereur du Royaume St-Empire Romain-germanique et il peut revendiquer et exercer tous les pouvoirs reconnus aux Empereurs par le droit romain.
Le réveil du pouvoir législatif du roi à la fin du XIe siècle va se faire de façon beaucoup plus détournée, il va apparaitre comme étant le simple prolongement, la simple annexe du pouvoir de Justice. Ce pouvoir de justice est au coeur de la fonction royale pour des raisons religieuses. La raison d'être des rois dans la théorie politique de l'époque, est de préparer le royaume de Dieu sur Terre, en y faisant régner la justice. Cette mission du roi est
rappelée lors de son sacre par la remise d’un objet symbolique en or : la main de Justice, une main qui bénit. Elle fait pendant au sceptre du roi, ce dernier représente le pouvoir politique.Cette mission à partir de l'an 1000 se décline sous deux aspects :
Faire régner la justice c'est rétablir la justice lorsqu'elle a été troublée par un conflit c'est à dire la rétablir quand une injustice a été commise par un individu. Le roi doit intervenir pour juger le différend et prononcer une condamnation contre le coupable. Le roi exerce le pouvoir judiciaire suprême. Cela est traduit par un adage médiéval « le roi est source de toute justice ».La deuxième manière de faire régner la justice est de prévenir la commission d'injustice notamment celle qui porte atteinte à l'intérêt public. Et pour prévenir cela, il faut éditer des textes généraux qui prononcent des interdictions qui s'imposent à tous sous la menace d'une sanction. La mission de faire régner la justice conduit donc à l'exercice par le roi du pouvoir législatif au nom de la défense de l'intérêt général. Cette approche est à l'origine du principe de non-rétroactivité de la loi.
Les choses s'accélèrent au XIIIe siècle avec notamment les règles très puissantes et lourdes mises en place sous les règnes de Philippe Auguste ( né en 1865 règne à partir de 1880 ) et de Louis IX ( né en 1215 et règne de 1226 à 1270 ). On peut dire qu'à l'issue de ces deux règles, le pouvoir législatif du roi est entré dans les moeurs et la promulgation de normes législatives royales se fait régulièrement. Les rois vont rapidement être immités par les princes territoriaux à la tête de ces principautés autonomes qui existent à l'intérieur du royaume et en particulier le pouvoir législatif va être exercé par les ducs de Bourgogne et de Bretagne.
En Bretagne , la première loi promulguée par le pouvoir ducal intervient en 1185 et ce texte s'appelle « l’assise au comte Geoffroy ». Ce comte Geoffroy est Geoffroy Plantagenais , fils du roi Henri II d'Angleterre, et exerce la réalité du pouvoir politique en Bretagne au nom de son épouse : la duchesse Constance, fille du dernier duc breton. C'est un texte qui va poser le principe du droit d'ainesse pour les successions des nobles et qui va s'appliquer au grand fiefs existants à l'intérieur du duché de Bretagne . Ces fiefs doivent être intégralement transmis au fils ainé au décès du titulaire et puisque le fief est transmis uniquement à l'ainé, les cadets doivent verser une mention. En l'absence de fils ainé, le fief va passer au mari de la fille ainée. Cette loi a pour but de réformer un abus résultant du morcèlement des terres nobles à chaque décès car avant, il y avait un partage égalitaire. Ce partage territorial affaiblissait économiquement et militairement le seigneur. Cela porte préjudice au duc de Bretagne qui a besoin de l'aide militaire efficace de ces barons, puisqu'il n'y a pas d'armée permanente.
Du point de vue terminologique, au Moyen Age, le vocabulaire n'est pas fixé pour désigner la loi que ce soit en latin ou en français. On utilise tout un ensemble de termes synonymes du mot loi : les ordonnances, les édits royaux, le mot charte, le mot statut, le mot établissement, le mot assise (texte promulgué par les rois ou princes assis sur leurs trônes), le mot constitution. Au Moyen Age ,le mot constitution désigne une norme à valeur législative fondée par le roi mais ce n'est pas une norme constitutionnelle.
3. L’élaboration des lois royales au Moyen-Age
L'élaboration des lois royales au Moyen Age : on a eu une évolution dans le temps.
Point de départ : le XIIe siècle. Les rois ne sont pas suffisamment fort politiquement pour imposer véritablement leur volonté. Ils doivent donc ménager leurs vassaux s'ils veulent qu'ils appliquent la loi. La norme royale se présente sous la forme d'un accord entre le roi et les grands seigneurs réunis en assemblée solennelle. Cette norme royale prend une dimension contractuelle synallagmatique, c'est un contrat qui engendre des obligations réciproques entre les parties qui se répondent. Ce qui montre que les premières lois royales ont une dimension synallagmatique, c'est que la loi mentionne toujours expressément le nom des grands seigneurs qui jurent d'appliquer le texte et le roi s'engage de son côté. On trouve cela dans l'assise du comte Geoffroy mais aussi antérieurement dans une charte de 1155 dû au roi Louis VII qui institue une période de paix de 10 ans dans tout le royaume. Une loi à caractère synallagmatique est elle véritablement une loi puisque une des caractéristiques de la loi est d'être un acte unilatéral ?
La procédure législative a évoluée, la présence de quelques vassaux est encore mentionné mais leurs attributions ont radicalement changées : ils ne sont plus la pour accepter le texte pour ensuite le respecter mais ils sont là pour aider le roi en lui donnant des conseils qui n'ont rien d'impératif . Le texte de loi va utiliser des formules pour montrer cette évolution puisqu’il y a l'invention que la loi a été adoptée par le roi « dans sa science et autorité dans la plénitude de son pouvoir royal ». On voit apparaître une nouvelle formule qui précède la signature du roi sur le texte original de la loi « car tel est Notre plaisir », cela a donné naissance à l'idée du bon plaisir royal. Le mot plaisir est simplement à prendre au sens de volonté et pas au sens d'un caprice ; et la formule veut dire que la loi est uniquement issue de la volonté personnelle du roi et qu'il n'y a été contraint par
personne.
La loi est définitivement devenue un acte purement unilatéral sans que les assujettis aient à donner leur accord. Puisque la loi est un acte purement unilatéral, les lois royales antérieures à la République f rançaise présentent une différence radicale avec les lois contemporaines, ces dernières ne sont soumises à aucun vote politique avant leur entrée en application. Le droit français contemporain reconnait pleinement le caractère législatif des normes antérieures à la République française. Certaines sont encore en application. Les lois ne sont pas votées mais ce sont quand même des lois. Si les lois avant la République française sont encore considérées comme des lois cela veut dire qu'ils ne faut pas croire que les anciennes lois étaient l'expression d'un pouvoir tyrannique. Le contenu des ordonnances royales est des le Moyen Age mûrement réfléchi dans la phase d'élaboration . En particulier interviennent des professionnels du roi, des juristes attachés à la personne du roi, que l'on appelle des "légistes". Ces légistes ont reçus une formation juridique universitaire, et ils sont totalement dévoués au roi à qui ils doivent leur ascension sociale. En général, ils appartiennent à la petite noblesse, c'est un milieu assez aisé pour financer les études. Mais c'est une petite noblesse trop peu importante politiquement pour contester le pouvoir du roi.
Pour conclure, ce phénomène législatif a été initié au Moyen Age. Il va connaître son plein épanouissement au XVIIe siècle durant le règne de Louis XIV (1638 naissance, pouvoir jusqu'en 1715) qui marque l'apogée politique de l'absolutisme monarchique.
B. Les lois royales, instrument royal de l'absolutisme monarchique1. L'élaboration des lois royales
Louis XIV est parvenu très jeune au pouvoir. Dans son adolescence il doit faire face à une véritable révolte politique d'une partie de la grande noblesse parce que cette noblesse en se révoltant, veut enrayer sa marginalisation politique qui avait été initié dès la renaissance avec le triomphe du concept de souveraineté . Cette révolte que l'on appelle la "fronde aristocratique" va durer 5ans de 164 8 à 1653. Les frondeurs sont momentanément victorieux, le roi doit s'enfuir de Paris . Les frondeurs réussissent à imposer au roi de les associer systématiquement à l'élaboration des lois ainsi que les magistrats des cours de justice souveraine de Paris (parlement de paris, chambre des comptes).En 1661, le roi est âgé de 23 ans et il décide d'assumer personnellement le pouvoir. Et il le fait parce que cela correspond avec la mort de Mazarin qui était le premier ministre et qui jusque là avait gouverné la France. Louis XIV va entreprendre une profonde réorganisation du conseil du roi afin d'empêcher des troubles tels que l'affront, qui puissent toucher son autorité. Cette réforme consiste à scinder le conseil royal en plusieurs structures et chacune de ses structures a une composition et une fonction déterminée. Globalement, dans ce conseil du roi il va y avoir d'un côté les conseils de gouvernement qui concentre la réalité du pouvoir politique et le conseil d'Etat privé qui concerne les principales attributions juridictionnelles du conseil du roi.
Les conseils de gouvernement : c'est au sein de ces conseils que les lois sont élaborées avant d'être soumises à la signature du roi pour l'abrogation. Le roi contrôle totalement la composition de ses conseils de gouvernement puisque ces conseils sont uniquement composés de ministres et de secrétaires d'Etat choisi par le roi pour leur qualité et leur fidélité. Egalement, ce sont des ministres que le roi peut renvoyer discrétionnairement à tout moment. A l'intérieur de ces conseils de gouvernement, c'est le ministre de la Justice qui tient un rôle majeur dans l'élaboration des lois; et ce ministre dispose d'un grand prestige hérité du Moyen Age puisque lui seul est nommé à vie, il est inamovible. Il porte le titre de « chancelier ». Ce chancelier de surcroît cumule des fonctions de garde des sceaux, c'est à dire qu'il est chargé d'authentifier les lois royales en y apposant sa signature et le sceau de l'Etat. Il peut arriver qu'en cas de mésentente entre le roi et le chancelier, le roi lui retire la garde des sceaux pour le confier à un autre ministre, et cela revient à marginaliser complètement le chancelier. Les conseils de gouvernement se répartissent en 3 sous-divisions :
Le conseil d'En Haut = conseil le plus important du conseil de gouvernement, il se réunit 3 fois par semaine sous la présidence du roi dans un salon proche de la chambre du roi à Versailles.Le conseil des dépêches qui, globalement se préoccupe surtout de la politique intérieure de la France en examinant notamment toute la correspondance émanant des représentants du roi dans les provinces = les intentantsLe conseil royal des finances
Il y a le conseil d'Etat privé que l'on appelle aussi le « conseil des partis », saisis par les particuliers. C'est l'ancêtre direct du conseil d'Etat et de la Cour de cassation. Son existence résulte de la conception médiévale selon laquelle le roi est source de toute justice. Et donc, chacun doit pouvoir éventuellement le saisir directement pour faire juger un contentieux. Dans ce cas, le roi peut accepter de retirer la connaissance de l'affaire au tribunal normalement compétent, ou de juger lui même. En réalité il est très rare qu'il juge lui même mais il peut décider
de faire examiner cette affaire devant le conseil du roi. Le roi retient la délégation judiciaire accordée aux tribunaux et va exercer la justice retenue. Le conseil d'Etat privé est donc le principal organe de la justice privée.
Louis XIV laisse encore à certains grands seigneurs la possibilité de siéger dans le Conseil d’Etat privé. Mais en réalité cette présence de la haute est sans danger politique car ce Conseil d’Etat, pour l’essentiel, examine des conflits qui sont des conflits qui n'ont pas une dimension politique. Avec cette réforme, ces grand seigneurs continuent a avoir l’honneur de porter le titre de conseiller du Roi. Mais concrètement, ils siègent très rarement pare qu’il n’ont que très peu d’intérêt pour des débats essentiellement juridiques.
Le projet de loi est élaboré par le chancelier avec l’aide du personnel administratif de son ministère, le chancellerie. Ce projet est présenté au Conseil d’en Haut sont examiné et éventuellement approuvé par le Roi. A l’intérieur de Conseil d’en Haut, lors d’un projet, il y a un véritable débat entre le Roi et les ministres, suivit de vote. Ce vote est purement indicatif. Pourtant il semble en réalité que même sous Louis XIV au plus fort de l’absolutisme le Roi tient compte des avis des ministres et renonce a promulguer la loi si les ministres sont majoritairement contre. Cela s’explique par le faits que les ministres sont majoritairement contre. Cela s'explique par le fait que les ministres sont avant tout considérés comme des conseillers dévoués à la personne du Roi et non pas comme l'expression d'une majorité politique différente de la volonté royale. Il en reste une traduction jusqu'au XXIème siècle : même de nos jours il n'y a pas d'archives dans les conseils politiques.
Une fois le texte examiné, le Roi signe personnellement la loi et, à ce moment là, la loi est intégrée dans les lettres patentes, qui comportent les formules de promulgation. Elles comportent la formule de promulgation de la loi. Elles permettent de connaître la validité temporelle de la loi. Certaines lois vont être perpétuelles et sont encore applicables en 2013, à condition qu'aucune loi ne les ai modifiées, et d'autres lois ne sont applicables que pendant la durée du règne du Roi qui les a signées.La distinction entre loi perpétuelle et loi temporelle :
Les lois perpétuelles sont intégrées à des grandes lettres patentes. Elles commencent par la formule « à tous, présents et à venir, salut ».Concernant les lois dont l'effectivité est réduite à la durée de règne, la promulgation se fait avec des petites lettres patentes « à ceux qui ces présentes lettres verront, salut ».
Les régimes ultérieurs vont s’inspirer car les lois sont encore précédés par une formule de promulgation par le chef de l’Etat qui s’est perpétuellement simplifié.
Dans cette procédure de promulgation de la loi, il n’y a pas eu de vote par une assemblée politique délibérante.
La loi passe une dernière étape : l’apposition de la signaleur et du visa du chancelier et apposition du sceau de l’Etat, destinée à authentifier le texte. L’apposition du sceau se fait dans une audience de France. Cette procédure d’apposition du sceau de l’Etat et du visa ministériel a survécu jusqu’à nos jours, c’est l’origine de la pratique du contre-seing ministériel qui figure aux cotés de la signature du Président de la République.
2. La typologie des lois royales
Les lois revêtent un aspect très formel et solennel qui est destiné à en renforcer le prestige . Par ce prestige, on a une effectivité. Ce caractère solennel de la loi royale est directement inspiré du formalisme judiciaire. Cela s’explique par le fait que, initialement, la promulgation de normes législatives par le Roi étaient un moyen de remplir sa « mission » de faire régner la justice.La loi se présente toujours par un plan en quatre parties :
Une formule introductive, celle qui figure au début des lettres de promulgation.Un exposé des motifs, c’est la partielle la loi destinée à en justifier le contenu. Il s’agit de démontrer implicitement que la loi est fondée sur des raisons solides et non pas sur un quelconque caprice du Roi, bien qu’il soit un monarque absolu. Cette présentation des motifs de la loi est destinée a souligner qu’une monarchie, même absolutiste, ce n’est pas une tyrannie.Le dispositif de la loi. C'est le contenu de la loi elle-même qui peut parfois être subdivisé en article si ce dispositif est assez long.La formule excrétoire de promulgation « Si donnons mandement aux gens tenant notre Cour de Parlement qu’ils fassent lire et enregistrer les présentes signées de Notre main. Car tel est notre plaisir ».
A l’intérieur du cadre formel de la loi, il y a des différence en fonction de l’importance du sujet traité par la norme législative. Il va y avoir trois catégorie de lois royales :
Les ordonnances, normes législatives. Jusqu’au milieu du XVIIe siècle, elles ont souvent traité plusieurs matières à la fois. Ces ordonnances royales de droit public ou de droit privée est de remédier a un certain nombre d’abus et de supprimer les disposition archaïque. Assez souvent, elle font suite a une demande exprimée par les Etats généraux, assemblées politique consultatives. Les ordonnances répondent aux doléances formées par les habitants dans les cahiers de doléance remis aux députés.Exemple : L’ordonnance de Villers Cotteret, aout 1739 « Ordonnance sur le fait de la justice ». Une disposition de cette ordonnance est toujours en vigueur : celle qui impose de rédiger les décisions de justice exclusivement en français.
À partir du règne de Louis XIV on voit apparaître des grandes ordonnances thématiques qui sont pratiquement l’équivalent des codes modernes.Exemple : L'ordonnance de procédure civile de 1667. il précise dans le détail les différentes étapes d'un procès civil. Cette ordonnance est pratiquement recopiée à l'identique dans le code de procédure civil de 1806 resté en vigueur jusque 1985. Ordonnance de la marine de 1681 qui codifie les différentes branches du droit de la mer.
Vu leur importance, elles sont perpétuelles, toujours promulguées par grandes lettres patentes.Le concept d'ordonnance a été abandonné pendant très longtemps, car politiquement dangereux. Finalement, les ordonnances exécutives sont réapparues dans les années '30 de façon indirecte pour répondre à la crise économique. C'est finalement la Ve République qui va se répartirai le concept d’ordonnance, article 38 de la Constitution « Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Les édits. Ce sont des normes législatives qui, en général, ne s'intéressent qu'à une seule question. Ce sont aussi des textes qui ne s'implique qu'à une partie de la France. Ce sont des textes plus brefs mais rendus, en général, sous la forme de grandes lettres patentes.Exemple : l'édit de Nantes par Henry IV, qui organise la tolérance religieuse en France entre catholiques et protestants pour stopper les guerres civiles.
Ce texte prévoit des garanties judiciaires afin que la minorité protestante ne subisse pas d'injustice de la part de juges majoritairement catholiques. Dans les régions où le protestantisme est fortement implanté, il existe dans les tribunaux suprêmes une chambre dont les magistrats sont eux-même protestants. De même, cet édit reconnaît l'existence légales du protestantisme puisque les actes de baptêmes protestants sont reconnus comme des actes de naissance valables. Il reste en application jusqu'en 1685 où il est révoqué. À partir de cette date, le catholicisme est la seule religion autorisée en France. Les protestants n'ont aucune existence légale.
Les déclarations royales, comme l'Université. Ce sont des textes moins solennels dans leur forme, rendus sous la forme de petites lettres patentes. En général, ces textes viennent compléter, sur un point particulier, une ordonnance ou un édit antérieur et éventuellement ces déclarations, sous couvert d'interprétation, vont transformer totalement un texte antérieur.
Cette typologie de la norme législative sous l'ancien régime survit en partie à 1789, notamment pour ce qui concerne les ordonnances. Elles sont rétablies de 1814 à 1830 pendant la restauration monarchique. Il y a un débat profond sur la nature de ces ordonnances. S'agit-il toujours de normes législatives directement élaborées par le chef de l’État sans passer par un vote des assemblées politiques ? Notamment pour répondre à un contexte politique très troublé. Ou bien est-ce qu'il s'agit de normes élaborées discrétionnairement par le chef de l’État mais simplement dans le domaine de l'exécutif ? À ce moment là, elles doivent être subordonnées aux lois. Ce débat est au cœur de la Révolution de 1830 qui pousse le Roi Charles X à l'abdication. À partir de la Révolution de 1830, le caractère législatif a été dénié aux ordonnances qui sont donc uniquement des normes de l'exécutif.
À l'époque de l'absolutisme, le gouvernement royal peut encore promulguer d'autres normes qui peuvent avoir une portée générale : les arrêts du Conseil. Ces arrêts du Conseil contiennent soit des mesures de détail destinées à permettre l'application de l'ordonnance, soit des mesures individuelles, notamment de nomination. Ces arrêts du Conseil ne sont pas promulgués sous la forme de lettres patentes. Ils sont donc d'une utilisation beaucoup plus simple. Ils sont exécutoires dès leur promulgation et ils ne peuvent pas faire l'objet d'opposition de la part des Cours souveraines de justice car ils ne sont pas enregistrés. Ces arrêts du conseil sont à l'origine des décrets et règlements de l'exécutif élaborés en Conseil des ministres qui sont directement applicables après la promulgation sans le vote d'une assemblée législative.
Conclusion : La multiplication des lois au cours des siècles risque, à la longue, de générer des incohérences. Ce risque d'incohérences va faire émerger l'idée d'une nécessaire codification du droit. Jusqu'à la Révolution, la
monarchie va reculer devant l'idée d'une codification officielle de l'ensemble du droit privé par respect des coutumes juridiques. Seuls sont codifiés les domaines de la procédure civile et pénale ainsi que, sous Louis XV, quelques domaines très techniques du droit privé, en particulier la question des donations et des testaments. Cette dynamique de codification prépare les codifications napoléoniennes.En l'absence de toute codification officielle, on voit se réaliser dès le XVIe des tentatives de codification officieuses faites théoriquement à titre privé mais avec l'encouragement du pouvoir monarchique, en particulier le Code d'Henri III, 1787, dû à Brisson, magistrat du Parlement. Il est chargé par le Roi, en 1787, de « préparer une législation uniforme à partir de toutes les ordonnances ». Le président Brisson est accusé de ménager les protestants en 1791 par la ligue ultra-catholique qui a pris le contrôle de Paris. Il est pendu.
II. Le contrôle du Roi sur les coutumesA. L’institution des cours souveraines
Le point de départ est le principe selon lequel le Roi est source de toute justice . Tout particulier peut lui demander de trancher personnellement un litige qui l'oppose à une autre personne. Le Roi ne peut pas s'occuper particulièrement de toutes les affaires qui lui sont soumises par les particuliers. Donc il va, dans un premier temps, faire examiner ses affaires par les membres de son Conseil. Ce Conseil du Roi est une institution apparue au milieu du XIIe siècle, et qui comprend cinq catégories de personnes :
Les membres de la famille royale : fils et frères du RoiMembres de la très haute aristocratie du royaumeEcclésiastiques les plus importantsAgents de l’État considérés comme des grands officiers qui préfigurent les ministres, notamment le chancelier, ou le chambrier du Roi.Les clercs qui disposent d'une formation juridique, les légistes.
L'évolution du XIIIe siècle amène le Roi à agir de deux manières :
Le Roi peut traiter directement ses affaires en première instance, cela concerne notamment les procès qui concernent des nobles. Cela s'explique par le fait que selon la conception hiérarchique de la société féodale, les vassaux du Roi relèvent directement de la Cour du Roi. Progressivement, ce privilège va être restreint aux très grands seigneurs.Le Roi peut intervenir en appel contre des sentences des tribunaux royaux.
Face à cette augmentation du nombre des affaires judiciaires, le roi Saint Louis va les réserver aux membres de son Conseil qui ont le plus de connaissances en droit et qui vont se spécialiser dans des affaires contentieuses. Avec ces idées, à partir du milieu du XIIIe on voit s'établir une scission à l'intérieur de la Cour royale qui entoure le monarque :
La curia in consilio : le Conseil du RoiLa curia in parlemento : la Cour de Parlement. On peut considérer que l'autonomie de cette première cour de Parlement est acquise en 1254 sous le règne de St Louis.Point de vue concret et symbolique : l'institution est dotée par le Roi d'un local prestigieux qui est l'ancien palais royal construit par Philippe Auguste. Il le donne à la justice.La procédure : ce Parlement est érigé en organe suprême de la justice déléguée du Roi. On dit que le Parlement est une Cour de justice souveraine parce qu'il n'existe aucune juridiction supérieure à qui un plaignant mécontent pourrait déférer un arrêt rendu par le Parlement. On réserve le mot « arrêt » aux décisions de justice rendues en dernière instance. Pour les décisions judiciaires susceptibles d'un appel, on dit le mot « jugement ».
Il faut nuancer le sens du mot « Cour souveraine ». En dépit de cette appellation, le Roi reste source de toute justice. Puisque c'est la source suprême de toute justice, il peut décider à n'importe quel moment de suspendre momentanément la délégation de son pouvoir judiciaire accordé au Parlement. S'il suspend cette délégation, il exerce sa justice retenue. Du point de vue de la procédure, cela veut dire qu'une partie mécontente d'un arrêt définitif rendu par le Parlement peut le dénoncer au Conseil Politique du Roi. Cette saisie de la curia in consilio se fait par une requête en proposition d'erreur, notamment si le plaignant estime qu'il y a eu une violation de la règle de droit. Ce recours en proposition d'erreur est à l'origine directe du mécanisme du pourvoi en cassation.
Dès le XIVe siècle, ce Parlement va siéger en permanence dans la Sainte-Chapelle de Paris, dans le Palais de Philippe-Auguste. Le personnel va complètement se laïciser car les juges ne vont plus perte des clercs mais des conseillers au Parlement c'est-à-dire des magistrats laïques qui vont s’élever a près de 300 personnes sous le règne de Louis XIV. Le travail de ce Parlement se rationalise puisque les magistrats sont répartis en plusieurs
Chambres spécialisées :
La Chambre des enquête normalement compétente pour juger les appels civils rendu selon une procédure écrite.La Chambre de la Tournelle qui juge en appel les affaires pénales, criminelles au risque de devenir rigoureux ou trop laxistes.La Grande Chambre, la plus prestigieuse qui a une double mission :Elle a pour mission de juger en appel les procès civils commencés selon une procédure oral.Elle a pour mission de procéder à la retranscription des lois royales grâce à la procédure de l’enregistrement.
Dans un premier temps, au XVIIIe, le Parlement de Paris est la seule Cour souveraine du Royaume, ce qui pose des difficultés compte tenu de l’ampleur de son ressort territorial. C’est la raison pour laquelle le Roi se décide a créer des Parlements dans les provinces éloignées, en particuliers dans celle appartenant aux pays de droit écrit, et dans celles où la langue française n’était pas en usage. Ils sont constitués sur le modèle du Parlement de Paris.
A la fin de l’Ancien régime, il existe 13 Parlements en France. Plusieurs d’en eux ne se résultent as de création royales mas simplement de la transformation en Parlement d’anciennes Cours souveraines créées par les princes dans leur principauté en s’inspirant d’exemple royal. Le but des princes territoriaux était de renforcer l’autonomie de la principauté en empêchant leur population de saisir en appel le Parlement de Paris. C’est la naissance de 3 Parlement : Dijon (1455), Rouen (1515), Rennes (1554). La spécificité du Parlement de Bretagne tient a sa composition puisque cette institution doit obligatoirement recruter la moitié des magistrats parmi des personnes de la Bretagne à la France en évitant que le Parlement ne soit un bastion de résistance au droit français. Cela ne fonctionne pas bien jusqu’au XVIIIe siècle, le Parlement de Rennes revendiquera très fortement la défense des libertés britannique, ce qui contribue à créer un climat pré-Révolutionnaire.
B. L’enregistrement des lois royales, préalable impératif a leur mise en œuvre
A l’origine, la procédure d’enregistrement de la loi est simplement un acte matériel destiné a en permettre l’application. A une époque où on n’a pas inventé l’imprimerie, il n’y a pas de Journal Officiel. Le premier Journal Officiel sera créé en 1793, les lois sont adressées aux Cours souveraines pour qu’elles les retranscrives dans leur registre et rédigent des copies adressées aux juridiction inférieures.
Selon la conception médiévale qui veut que le Roi agisse dans l’intérêt général, il est accepté que les juges des Parlements puissent le conseiller sur la loi promulguée. Cela se comprend d’autant plus que la Cour de Parlement est issue du Conseil politique. Ce rôle de conseil reconnu aux juges des cours souveraines s'exprime par la possibilité d'adresser au Roi des remarques suspensives à la retranscription de la loi. Ces remarques s'appellent des « remontrances ». seule une toute petite partie des lois sont concernée par ces remontrances. À la réception des remontrances, le Roi a la possibilité d'en tenir compte et de modifier ou suspendre son texte mais il peut au contraire maintenir sa position primitive en adressant aux Parlements des lettres de jussion. Les magistrats conservent la possibilité d'adresser au Roi de nouvelles remontrances, des itératives remontrances. Si le Roi maintient sa position, en tant que source de toute justice il a le dernier mo t et il peut forcer les magistrats à l'enregistrement en tenant une « séance royale de lit de justice ». Le roi se déplace en personne au Parlement ou se fait représenter, et ordonne au greffier de retranscrire le texte.