Bonne Foi et Bon droit d'un génocidaire
Transcript of Bonne Foi et Bon droit d'un génocidaire
Droit et Société 73/2009 1
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Élisabeth Claverie
Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM), EHESS, 10 rue Monsieur le Prince, F-75006 Paris.
Résumé
À partir d’une ethnographie du procès de Vojislav Seselj devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, l’article s’interroge sur la forme de la défense d’un criminel notoire qui refuse tout avocat et se représente en personne. Il décrit comment l’accusé, qui plaide non coupable, met en scène une défense qui se donne pour défense de rupture, revendiquant une position symétrique à celle du procureur d’où lancer des contre-accusations visant le Tribunal dans son ensemble. Il montre ensuite que les membres du Tribunal se divisent lorsqu’il leur faut identifier la forme de défense de l’accusé et y répondre afin de garantir l’intégrité de la mission judiciaire qui leur est confiée.
Défense de rupture – « Forme affaire » – Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie – Violence – Vojislav Seselj.
Summary
A Genocidaire’s Good Faith and Good Cause
An ethnography of Vojislav Seselj’s trial before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia reveals the problematic nature of the defense adopted by a notorious criminal who has consistently refused the appointment of any counsel and defends himself. The article describes how the defendant, who has entered a plea of not guilty, stages in the courtroom a “rupture defense”. Building a position symmetrical to that of the prosecutor, he launches counter-accusations directed against the Tribunal as a whole. It then shows how the Tribunal became divided when its members tried to understand the true nature of the defendant’s defense and to defend the integrity of their judicial mandate.
“Affair” as a political form – International Criminal Tribunal for the former Yugosla-via – “Rupture defense” – Violence – Vojislav Seselj.
E. CLAVERIE
2 Droit et Société 73/2009
Introduction Parmi les justifications qui présidèrent à la création du TPIY 1, furent mis en avant les
gains démocratiques dont son projet de lutte contre l’impunité était porteur, et, par là, sa force de novation. On insistait surtout sur l’impact pédagogique qu’aurait une telle entreprise. Cette pédagogie avait deux destinataires : d’abord, les victimes, qui verraient que ces crimes allaient être publiquement reconnus, instruits et jugés, qu’ils ne seraient plus l’objet de dénégations, que ce jugement permettrait alors une catharsis personnelle et collective ; ensuite, la communauté internationale, qui verrait s’effectuer une démons-tration de justice démocratique, sans exceptions d’immunités, dans le monde cynique (ou réaliste) de la raison d’État et des seuls rapports de force. Le droit (kantien) remporterait une victoire sur le politique (machiavélien) et montrerait ses capacités pacificatrices. Cette institution internationale, supra-étatique, destinée à lutter contre l’impunité et contre le révisionnisme, pourrait montrer qu’il existait des liens concluants entre paix et justice en s’attaquant, par la recherche de la vérité judiciaire, aux mensonges, dénéga-tions et fausses allégations, réservoirs des violences futures.
Lorsque ce programme obtenu de haute et longue lutte fut en cours, les juges et pro-cureurs ne s’attendaient certainement pas à ce retournement de situation : les audiences de certains procès érigées comme tribune de justification des crimes que le tribunal allait être amené à juger et de dénonciation de l’unilatéralisme onusien, montré comme le signe même de sa partialité et de ses affiliations politiques. Si ces opérations de méta-dénonciations ne furent évidemment pas le cas général, cela arriva quelquefois, notamment et surtout lors du procès de Vojislav Seselj, le leader politique des ultranationalistes serbes.
Il semble bien, ainsi, que le type de difficultés qui, plus que d’autres, mirent le Tribu-nal à l’épreuve prit les traits critiques de la « défense d’obstruction » ou « défense de rupture » voire d’une défense violente ou même mafieuse. Cette position radicale fut jusqu’à présent employée devant cette Cour par plusieurs avocats qui, à l’occasion, en retenaient certains traits. Mais elle ne fut pleinement mise à l’œuvre que par Slobodan Milosevic, qui accepta cependant un avocat stand by, et, surtout, par Vojislav Seselj. Ces deux accusés choisirent l’un et l’autre de ne pas être représentés à l’audience par un avocat plaidant, mais de plaider eux-mêmes directement, décidés à affronter l’Accusation sans médiations, se transformant en avocats de leur propre cause et souvent en témoins de leur propre gloire. En endossant, via leur style de défense, tous les rôles judiciaires, et en les jouant dans leur extension maximale, ils parvinrent à perturber les lignes des fronts judiciaires en jeu lors des audiences du TPIY. Sans doute ces formes de défense s’engouffrèrent-elles dans la brèche ouverte par la justice internationale quand elle veut se fonder sur une revendication de neutralité du droit, considéré comme une protection 1. Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie. Ce Tribunal, rappelons-le, est en charge d’instruire et de juger les crimes commis en ex-Yougoslavie pendant le conflit qui a ravagé ce pays entre juin/ juillet 1991 et décembre 1995. Créé en pleine guerre (1993) sur décision d’une Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, cette Cour a compétence pour instruire, juger et sanctionner quatre types de crimes, et seulement ceux-là : crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide, infractions graves aux Conventions de Genève. Ce Tribunal, comme son Tribunal « frère », le TPI pour le Rwanda sis à Arusha, en Tanzanie, est appelé Cour « ad hoc » car il ne peut juger que les crimes commis pendant une période donnée et sur un territoire donné.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 3
minimale face à la violence des confrontations politiques tous azimuts qui sont journel-lement les siennes dans les diverses phases de son travail (les enquêtes surtout), ou face aux nécessités macro-diplomatiques qui la contraignent ici et là. Ce faisant, comme l’a montré Martti Koskenniemi, elle refuse de reconnaître et donc d’analyser de façon ouverte et réflexive la part politique de l’activité juridique en général, et l’inscription dans le politique de la sienne en particulier.
Vojislav Seselj
Connu pour avoir été – et être toujours – un des propagandistes publics les plus zé-lés de l’ultranationalisme serbe, Seselj s’était présenté « spontanément » à la Haye en provenance de Belgrade, le lundi 24 février 2003, après qu’un mandat d’arrêt lui ait été signifié, dix jours plus tôt 2. Arrêté à son arrivée à La Haye, il fut incarcéré dans l’unité de détention de l’ONU (Scheveningen), comme les autres détenus ex-yougoslaves dont les procès sont en cours. Il se présenta devant la Cour pour son audience de comparution initiale le surlendemain, 26 février 2003. Six ans plus tard, en mars 2009, son procès est toujours en cours, et pour l’instant (mars 2009) ajourné sine die, tandis que commence à son encontre une procédure d’outrage au tribunal, dont la première audience a débuté le 6 mars 2009. La justification de cette procédure particulière, l’outrage à la Cour, est indiquée dans la décision de la Chambre. Celle ci porte :
[Il est] fermement établi que le Tribunal a, de par sa fonction judiciaire, le pouvoir inhérent de veiller à ce que le pouvoir qui lui est expressément conféré par le Statut ne soit pas tenu en échec et que sa fonction judiciaire fondamentale soit sauvegardée. En tant que juridiction pé-nale internationale, le Tribunal a le pouvoir inhérent de sanctionner une conduite qui entrave le cours de la justice, qui y porte préjudice ou qui en abuse. Le Tribunal peut déclarer coupable d’outrage les personnes qui entravent délibérément et sciemment le cours de la justice 3.
À cet égard cependant, un juge, le juge Antonetti, juge président de l’affaire, publia une opinion dissidente de celle du bureau du procureur et de ses deux co-juges. Il esti-mait, lui, que le procès ne devait pas être arrêté mais continué et que, s’il y avait faute, elle revenait plutôt à la mauvaise gestion de l’ordre de comparution des témoins par le bureau du procureur qui, disait-il, savait depuis longtemps qu’existaient des allégations de menaces contre les témoins de l’accusation par les amis de Seselj dans la région. Quant à Seselj, il avait plusieurs fois déjà demandé que soit engagée une procédure d’accusation symétrique contre le procureur.
L’acte d’accusation
Dans et par son acte d’accusation, le bureau du procureur déclarait Seselj coupable au titre de sa responsabilité individuelle en tant que dirigeant politique d’un parti ultra-nationaliste grand recruteur de forces paramilitaires, « les hommes de Seselj », « les Seseljci », compétiteurs et alliés des hommes d’Arkan, en Croatie comme en Bosnie. Il était accusé d’avoir encouragé et ouvertement cautionné, par des discours publics viru-lents à la télévision, dans les journaux (il en avait créé un pour l’occasion) et lors de
2. C’est le 15 janvier 2003 que la procureure générale Carla del Ponte a paraphé le premier acte d’accusation contre Seselj, vérifié et confirmé le 14 février par le juge O-Gon-Kwon qui a alors signé le mandat d’arrêt. 3. Décision de la Première Chambre d’une procédure d’outrage.
E. CLAVERIE
4 Droit et Société 73/2009
nombreux meetings, une politique visant à réunir « tous les territoires serbes » des États de l’ex-Yougoslavie dans un État serbe homogène. Dans l’environnement multiethnique des États yougoslaves, cette homogénéité était obtenue, au long des conquêtes territoria-les, administratives et militaires, au moyen de procédés de tris, de séparation et d’expulsions massives, de meurtres de masse, c’est-à-dire d’un système organisé de per-sécutions des populations non-Serbes. Ces « persécutions commises pour des raisons politiques, raciales ou religieuses » prirent diverses formes comme le meurtre de nom-breux civils, l’emprisonnement, la torture et les sévices à l’encontre de civils détenus, les violences sexuelles, les discriminations à l’embauche ou dans l’emploi. Ces actes de nettoyage ethnique étaient commis sur des individus sélectionnés comme sur des collec-tifs. Il s’agissait de l’expulsion violente des habitants d’un lieu par familles entières préalablement triées par critères ethniques, du transfert forcé de villages entiers, de quar-tiers de villes ou d’immeubles, suivis du pillage et de la destruction délibérée de leurs maisons et villages, des biens publics de ces villages, bourgs et villes, de leurs édifices cultuels et mémoriels. Il s’agissait aussi de l’internement massif dans des camps dans lesquels sévissait la plus grande violence. Ceci s’accomplissait par l’action, entre autres forces militaires régulières, de groupes paramilitaires et se soutenait de discours nationa-listes incitatifs. Ces diverses formes de persécutions sont des chefs d’accusation de « crimes contre l’humanité », mais Seselj est également accusé de « violations des droits et coutumes de la guerre ». Pour ces deux crimes internationaux, Seselj est jugé au titre de sa participation individuelle à une entreprise criminelle commune. Ainsi :
Vojislav Seselj est individuellement pénalement responsable des crimes visés aux articles 3 et 5 du Statut du Tribunal et énumérés dans le présent acte d’accusation, crimes qu’il a planifiés, ordonnés, incité à commettre, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter. Par le terme « commettre », le procureur n’entend pas suggérer que l’accusé ait perpétré physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le pré-sent acte d’accusation, on entend par « commettre » la participation de Vojislav Seselj à une en-treprise criminelle commune. Par l’expression « a incité à commettre », le procureur entend suggérer que les discours, les déclarations, les actes et/ou omissions de Vojislav Seselj ont pesé sur la décision des individus qui ont commis les crimes allégués […]. Chaque participant ou coauteur à l’entreprise criminelle commune y a joué un rôle qui lui était propre et qui a large-ment contribué à la réalisation de l’objectif général de l’entreprise.
La défense et ses provenances : statuts du coupable et de l’innocent
Avant de présenter les questions posées par le mode de défense de Seselj, je voudrais revenir sur l’histoire d’un modèle de la défense, tel qu’il s’est lié à l’histoire politique de la critique et dont on peut toujours reconnaître aujourd’hui les traits prégnants, aussi bien dans l’univers défensif du droit pénal continental que du droit anglo-saxon, malgré leurs différences de mises en œuvre procédurales. Ce modèle, en effet, joue un rôle décisif dans la défense de Seselj par lui-même.
Une longue tradition juridique relayée et transformée de longue date par maints ou-vrages de littérature populaire a fait de la défense le cœur émotionnel et argumentatif du procès, voire le cœur moral autant que juridique du droit pénal, la preuve de son lien social avec des conceptions politiques plus ouvertes et démocratiques. Ayant travaillé sur l’histoire moderne de ce droit, en France, j’ai pu constater les particularités qui se sont attachées à sa naissance, s’agissant du droit criminel : ce que j’ai appelé « la forme
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 5
affaire ». Cette forme liée au projet d’émancipation des Lumières fut initiée au XVIIIe siècle, de l’extérieur de la sphère judiciaire, laquelle – selon les dispositions du premier code de procédure pénale, l’Ordonnance criminelle de 1670 – n’admettait pas, au criminel, de droit à la défense, au sens où aucun avocat ne se tenait aux côtés de l’accusé, ne le ren-contrait dans aucune phase de l’instruction ou du procès, n’était présent à l’audience dans cette procédure inquisitoire et non contradictoire. Ce sont en effet des « hommes de lettres » – de l’écrivain public à l’auteur célébré – qui ont, au XVIIIe siècle, largement contribué par leurs écrits à l’émergence de la notion moderne de défense et de ses théma-tiques. Cette sphère mêlait clercs de barreau et monde de l’écriture, En rédigeant des factums 4, qui relataient, à travers un récit pathétique, la plainte de l’accusé (toujours innocent), ils mirent progressivement en place une forme narrative. Deux procès firent alors figure d’emblèmes par l’achèvement formel de ce processus : celui de Jean Calas et celui du Chevalier de La Barre. Dans l’un et l’autre cas, Voltaire, par l’intermédiaire de ses factums, parvint à retourner toutes les positions de l’accusation. Au terme de sa dé-monstration, l’accusé, de coupable initial, deviendra l’innocent, et l’accusateur (le tri-bunal, le juge) deviendra le coupable. Ce schème renversé, mais surtout ce schème dyna-mique d’une réversibilité possible, deviendra le cœur symbolique universel de la Dé-fense, avec l’affaire Dreyfus pour acmé. Il sera le symbole, dans tous les cas, de la volonté de prise en compte, par principe, d’une possibilité d’innocence, et par là, de l’obligation juridique et morale de défense, mais il sera le symbole aussi du caractère relatif, ou politi-que, des positions d’innocence et de culpabilité, la preuve de la fragilité de ces posi-tions. Avec la « forme affaire » apparaissent donc plusieurs choses : le lien entre plaidoi-rie, fiction et cause, mais aussi une nouvelle figure du coupable. Se distingue, désormais objectivée, la conscience de ce que peut produire une opération de relativisation comme celle de Voltaire, avec la « dés-essentialisation » du coupable comme de l’innocent. Par là, toute scène de crime devenait configurable et reconfigurable.
Transformations du modèle voltairien
Il nous faut rentrer ici quelque peu dans les détails, pour comprendre les subreptices transformations opérées par Seselj sur le modèle voltairien de l’affaire et de la cause.
Au terme de l’opération de vérité de Voltaire, obtenue par une déconstruction du « ça va de soi » en cours, la figure du coupable s’était transmuée. Avec l’« affaire », le procès, de cas local, était devenu un modèle historique généralisable. Désormais, « le coupable » n’était plus une figure positive allant de soi, une identité rabattue sur une position par nature, comme les opérations antérieures de révélation de culpabilité avaient l’habitude d’en faire émerger la figure. Ainsi, par simple changement d’échelles des perspectives spatiales, historiques ou temporelles, il était devenu loisible de transformer un coupable
4. Pièces écrites officieuses, versées quelquefois au dossier comme partie des pièces écrites rassemblées, selon les usages de la procédure inquisitoire. Voir Sarah C MAZA, Private Lives and Public Affairs : The Causes Célèbres of Prerevolutionary France, Berkeley : University of California Press, 1993 ; ID., « Justice et opinion à Paris sous Louis XVI. Episodes de la Pré-Révolution judiciaire », in Jean-Jacques SUEUR (coord.), Justice et opinion publi-que, Paris : L’Harmattan, 2002, p. 177-196 ; Elisabeth CLAVERIE, « La naissance d’une forme politique : l’affaire du Chevalier de La Barre », in Philippe ROUSSIN (dir.) Critique et affaires de blasphème à l’époque des Lumières, Paris : Honoré Champion, 1998 ; Luc BOLTANSKI, Elisabeth CLAVERIE, Nicolas OFFENSTADT et Stéphane VA N
DAMME (dir.), Affaires, scandales et grandes causes, Paris : Stock, coll. « Les essais », 2007.
E. CLAVERIE
6 Droit et Société 73/2009
en un innocent non encore dévoilé. Désormais, les formes nouvelles de révélations de culpabilité se formaient dans le prétoire par le jeu de re-placement des acteurs de la scène du crime décrite par un descripteur nouveau capable d’organiser autrement les accents et les acteurs de la scène. Celui-ci était chargé de configurer les descriptions du crime et les qualifications qu’il voulait lui attacher lors du « transport » de la scène du crime vers la scène d’audience et ses contraintes juridiques. Mais cette description devait être conduite par un descripteur impartial, qui devait prouver qu’il était détaché de tous ses attachements. Dans le procès Seselj, mais sans doute aussi dans le cadre général dans lequel il opère, le « camp » va subrepticement se substituer au descripteur impartial, mais en conservant avec le choix de la partialité engagée la rhétorique de l’impartialité pour soi et de la partialité pour l’autre. Ce déplacement peut s’énoncer ainsi : virtuellement, un coupable l’est, parce que son cas est encore maintenu sous un voile d’opacité par le pouvoir interprétatif d’un camp dont les attendus politiques normatifs jouent au-jourd’hui en sa défaveur. Innocence et culpabilité entrent alors dans une relation spécu-laire, relation simplement articulée par la symétrie de causes adverses. Nous avons donc désormais « un coupable de l’accusation » transformé en « innocent de la défense », innocence relayée « par le tribunal de l’opinion » qui dévoilera, dans ce même geste, le jugement fallacieux de la tyrannie (l’Accusation aveuglée par ses préjugés et par ses intérêts).
On voit à quel point certains éléments du schème voltairien sont prégnants, le re-cours au public et au tribunal de l’opinion, et masquent les différences, lorsque 250 ans plus tard, un homme accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, Vojislav Seselj, déclare au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à l’instant même où le juge demande un huis clos d’audience (donc hors public) pour protéger l’identité d’un témoin :
En dehors de la publicité des débats, ce procès ne m’intéresse en rien. J’ai appelé votre at-tention à plusieurs reprises, Monsieur le Président, sur le fait que vous me jugez, mais que l’opinion vous juge, vous 5.
Seselj clamera sans cesse qu’il ne se défendait que parce que son procès était retrans-mis sur internet et que son propre site « était le site le plus visité du monde ». Que le public, l’opinion en général, serait vite gagné à sa cause, et que son public électif, les nationalistes serbes, le soutenait dans son combat : la révélation, aux yeux du monde et de son peuple, de la vérité, malgré les menées du tribunal tendant à réduire cette publicité.
Quel est le mode de défense de Seselj ?
Nous allons donc essayer d’analyser ce qu’il en est de ce schème lorsqu’il est reven-diqué comme forme de défense légitime par un homme ayant à répondre de crimes contre l’humanité. À certains égards, la tâche du tribunal est ici compliquée du fait que les cri-mes sont de notoriété publique, que ses traces, des ruines, sont partout visibles. Les crimes, comme leurs auteurs et responsables de toutes sortes, sont « avérés » aux yeux de l’opinion publique et des savoirs locaux par le biais de modes de certifications extra judiciaires (savoir des victimes, des communautés locales, des enquêtes de la communauté
5. Procès de Vojislav Seselj, audience du 25 février 2009.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 7
internationale, des ONG). Un tiers impartial a pu lire nombre d’informations valides transmises par des journalistes de la presse internationale, après enquêtes contemporai-nes des faits. Mais il s’agit, pour le tribunal, d’établir un autre type de savoir, via d’autre procédés : établir les faits, établir une politique de poursuites – ce qui opère un type de sélection parmi les trop nombreux responsables à l’intérieur d’un même « groupe ethni-que », d’une part, et parmi les diverses « ethnies » impliquées dans les crimes, d’autre part –prouver ces responsabilités et leur mode, faire valoir pendant la durée du procès, malgré tout, la présomption d’innocence, ce qui fait des prévenus des « criminels allé-gués », tandis que, dans le même temps, ces divers criminels de guerre sont considérés par certains groupes comme des héros et célébrés à ce titre dans leurs pays respectifs.
Constituées par le caractère offensif de ses initiatives, deux lignes de tensions traver-sent le procès de Vojislav Seselj : l’une, juridique, concerne ses techniques de défense et la question de leur identification par la Cour (est-ce légitime ? que font exactement à la cause en cours ces multiples et constants niveaux d’obstructions et de dénégations ?) ; l’autre, politique, concerne la qualification des faits opposant Seselj et le procureur. Bien entendu, la forme donnée par Seselj à sa défense est là pour créer un continuum entre les accusations qu’il lance contre le tribunal (suppôt des intérêts occidentaux, de l’Otan, en réalité « bandes de criminels en liberté »), et la défense de sa propre cause (loin d’être un criminel, je suis une victime des complots de l’Ouest, de même que « mon peuple ». (Ain-si, mes hommes, loin d’être des tueurs bestiaux et abrutis, sont la quintessence même de l’excellence, du courage guerrier et de l’honneur de ce peuple). C’est ainsi, par le moyen d’une perspective politique requalifiée selon les attendus politiques traditionnels de la défense en rupture et ses renversements symétriques que Seselj trouve les moyens d’une re-qualification des faits criminels qui lui sont imputés. Pour cela, il doit soumettre à la critique les actes de tous les protagonistes à l’affaire. Nous essaierons simplement d’observer ici la façon dont Seselj met en scène le cadre juridique de sa défense, celle-ci impliquant d’abord une reconfiguration du prétoire, que cette interpellation résume :
Je demande aussi à être assis dans la première rangée réservée à la Défense, de façon à être sur un pied d’égalité avec l’Accusation. J’ai déjà fait cette demande à la Chambre de pre-mière instance précédente, mais aucune décision n’a été rendue.
Sous couvert de défense en rupture, Seselj embarqua quelques passagers clandestin s non identifiés. C’est pour cela sans doute que les différents acteurs du jugement eurent et ont toujours beaucoup de mal à identifier ce qui se passait sous leurs yeux dans le pré-toire, à s’y adapter ou à trouver les arguments pour en récuser l’advenue. Au fil des au-diences, les divers membres de la Cour se divisèrent quant au diagnostic à poser sur « ce qui arrivait ». Ils se retrouvèrent en position défensive, juges et procureurs mêlés, obli-gés de composer au jour le jour avec une série d’innovations défensives, sans possibilité d’anticipation de leur part, ni de réponse collectivement articulée. S’il s’agit d’autre chose que d’une défense en rupture, comment, alors, constituer en regard une contre-accusation judiciaire publique légitime et organisée ? Comment refonder la place d’arbitre du juge ? Comment identifier, qualifier, juger des techniques qui, se donnant en salle d’audience pour celles d’une simple défense en rupture, de bonne foi, cachent la forme de ce qu’est vraiment la défense de Seselj : une défense violente, qui s’appuie sur des réseaux mafieux et criminels à l’extérieur et recourt à l’ « intimidation » des témoins ?
E. CLAVERIE
8 Droit et Société 73/2009
I. L’ouverture du procès I.1. Première audience, 26 février 2003
Vojislav Seselj annonça sa stratégie de défense dès son entrée en scène 6. Dans cette même salle de la Première Chambre, l’audience de Milosevic venait d’être écourtée d’une heure pour laisser la place à l’audience initiale de Seselj, qui ouvrait la phase prélimi-naire de son procès 7. Comme le voulait la procédure, le président de la Chambre, le juge Schomburg, demanda aux parties de se présenter, ce qu’elles firent. Il put dès lors consta-ter que le banc de la défense était vide : « Je vois qu’il n’y a pas de conseil de la dé-fense. » Réponse de l’accusé : « J’ai décidé de me défendre moi-même. » Le juge répondit qu’il venait en effet de se voir remettre une lettre de l’accusé, traduite en anglais, qui déclarait cette volonté et ajoutait une exigence (due à un avocat) : que le tribunal lui soumette tous les documents du tribunal et tous les documents de l’accusation « exclusivement en langue serbe » (caractères cyrilliques). Seselj précisera un peu plus tard dans cette même audience :
Ma décision de me défendre moi-même est définitive. Il se peut que je prenne un adjoint, un assistant juridique qui ne comparaîtra jamais en mon nom dans ce prétoire ; il ne se présentera pas dans ce prétoire. Je me réserve, en d’autres termes, l’exclusivité de la comparution en pré-toire en ma qualité d’accusé. Je n’ai pour autant pas la nécessité d’engager un conseil ou un ad-joint 8.
Mais, tout de suite, le juge déclara – dans un acte de reprise en main – que cette ques-tion serait traitée ultérieurement. Pour l’instant, marquant qu’il était le maître des sé-quences de la procédure, il devait d’abord faire savoir à Monsieur l’accusé que les alléga-tions portées contre lui étaient contenues dans un acte d’accusation daté du 15 janvier 2003, révisé et confirmé par un second juge de ce Tribunal le 14 février 2003. Il devait alors vérifier si l’inculpé était bien la personne accusée, et Seselj fut invité à décliner son identité et sa profession. Seselj déclara qu’il était serbe, né à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en 1954, qu’il était « docteur en droit, professeur à l’université, et membre du Parlement de la République et du Parlement fédéral ». Le président lui indiqua alors ses droits, la possibilité notamment de contester l’acte d’accusation, la possibilité de garder le silence 9.
Le président annonça alors le moment de la lecture de l’acte d’accusation. C’est la séquence au cours de laquelle le juge donne au prévenu, en public, connaissance offi-cielle des chefs d’inculpation qui pèsent sur lui et des circonstances des crimes allégués. L’acte d’accusation, acte de saisie du Tribunal, pièce écrite de plusieurs dizaines de pages, contient l’exposé des faits et leur qualification légale 10 . Au TPIY, vu l’atrocité
6. L’audience de comparution initiale était présidée par le juge Schomburg. Les procureurs étaient Dan Saxon et Madame Uertz-Retzlaff. 7. Cette phase préliminaire, qui dura plusieurs mois, se composait d’audiences de mise en état, c’est-à-dire de vérifications de l’avancée des dossiers et de l’état de la coordination entre les parties. 8. Procès de Vojislav Seselj, audience du 26 février 2003. 9. Ce droit est inscrit à l’article 14, paragraphe 3-g), du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politi-ques. 10 . C’est un droit fondamental de l’accusé d’être informé rapidement et en détail, dans une langue qu’il comprend, de ce dont on l’accuse – article 14(3)A du Pacte des droits civils et politiques de 1966. Il en va de même dans la Convention sur la protection des droits humains et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 6(3)A,
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 9
des faits et leur caractère massif, les accusés demandent en général que cette lecture éprou-vante pour eux ne soit pas faite, arguant du fait qu’ils connaissent déjà le texte, qu’ils ont lu individuellement dans leurs cellules. Seselj demanda au contraire que l’acte d’accusation lui soit lu dans son intégralité, à haute et intelligible voix, y compris les annexes comprenant le nom des victimes tuées ou torturées (255 noms lus à haute voix, uniquement pour l’annexe III de l’acte 11). Cette lecture prendra plus d’une heure et demie de lecture publique à haute voix par la greffière. C’est ainsi que Seselj commença de constituer et de mettre en scène sa place au tribunal en personne, en homme, selon les valeurs, qu’il allait bientôt déclarer, de grand chef voïvode. C’est ainsi qu’il montra, de façon spectaculaire et provocatrice, sa volonté de faire face aux allégations faites à son encontre. Dans cette première scène, il disait bien que les allégations de l’acte d’accusation ne l’atteignaient pas, ne le concernaient pas, qu’il était faux de dire qu’elles avaient un lien quelconque avec lui. Qu’il les combattrait seul, en guerrier, en voïvode.
Le président demanda ensuite à l’accusé s’il avait bien reçu l’acte dans une langue écrite qu’il comprenait. Laissant poindre une menace de récusation de l’acte, ce dernier répondit que, s’il avait bien reçu ce texte en langue serbe (caractères graphiques cyrilli-ques), des fautes montraient qu’il avait été rédigé par un Croate, ce qui rendait certains termes « totalement incompréhensibles ». Le juge lui demanda alors s’il comprenait la langue orale dans laquelle se déroulait l’audience. Question neutre visant simplement à s’assurer de l’intercompréhension linguistique des débats et de la qualité de l’interprétation. En effet, le personnel du tribunal, s’il appartient à divers pays, doit s’exprimer à l’audience dans une des langues de travail du Tribunal, l’anglais et le fran-çais. La même contrainte est exigée des avocats. Outre le fait d’appartenir à un Barreau national, ils doivent comprendre et parler l’anglais ou le français pour être reçus dans une juridiction internationale. Les prévenus, quant à eux, ressortissant de l’ex-Yougoslavie, s’expriment en « serbo-croate », la langue officielle et la langue parlée de l’ex-Yougoslavie, à côté du slovène et du macédonien. Cependant, ultranationalistes, de nombreux prévenus, au premier rang desquels Seselj, ne reconnaissent pas cette appella-tion 12 . Les États de l’ex-Yougoslavie ont d’ailleurs pris le relais de cette politique de nationalisme linguistique. Désormais, les Croates appellent cette langue « croate », les Serbes « serbe », les Bosniaques « bosniaque 13 », tandis que la Cour l’appelle « BCS »
où il est stipulé qu’un accusé doit être informé rapidement dans une langue qu’il comprend. Il s’ensuit que le Statut du Tribunal, à l’article 21(4)A stipule que l’accusé doit être informé dans le plus court délai dans une langue qu’il comprend. 11 . Le Président : « Madame la Greffière, merci beaucoup pour avoir lu à haute voix cette liste de 255 noms. Et, pour que chacun comprenne bien de quoi il est question, la liste de ces victimes est à relier au paragraphe 20 de l’acte d’accusation, où nous lisons ce qui suit – je cite – : « Le soir du 20 novembre 1991, les soldats ont trans-porté les victimes par groupes de 10 à 20 personnes jusqu’à un lieu d’exécution éloigné situé entre la ferme d’Ovcara et Grabovo où ils les ont abattus. Environ 255 croates de l’hôpital de Vukovar ont ainsi péri, leurs corps ont été jetés dans un charnier. » 12 . Sur la question des langues et du lien au nationalisme en Yougoslavie, voir Paul GARDE, Denis LACORNE et Tony JUDT (dir.), La politique de Babel. Du monolinguisme d’État au plurilinguisme des peuples, Paris : Kartha-la, CERI, 2003. 13 . Cette appellation est née en 2002.
E. CLAVERIE
10 Droit et Société 73/2009
« bosno-serbo-croate 14 », considérant qu’il s’agit, linguistiquement, d’une seule et même langue. Qu’en tout cas, l’ayant pratiquée pendant l’essentiel de leur vie, les ressor-tissants de l’ex-Yougoslavie la comprennent tous, malgré l’existence de certaines varian-tes locales, exacerbées désormais dans une logique de production des différences par les différents États issus de l’ex-Yougoslavie. Mais cette question, liée désormais aux conséquences de l’épuration ethnique, révèle la question linguistique sous un nouveau jour, au grand dam des nationalistes. En effet, comme il apparaît sans cesse avec la langue des témoins, les locuteurs musulmans par exemple, il est démontré qu’ils ne parlent en aucun cas un dialecte partagé sous le rapport de « l’ethnie », mais que, s’ils sont nés dans la même région que Seselj, ils parlent le dialecte ékavien, le même que lui, et que la différence de dialecte, pour les personnes nées avant les recompositions nationalistes, ne dépendaient que de la localisation, non de la communauté d’appartenance ethno-religieuse, quelques rares termes exceptés.
Reprenons la séquence de la réponse de Seselj, manifestant sa vive contrariété de ne pas comprendre tous les mots de l’acte d’accusation, au risque de sa nullité, parce que certains d’entre eux étaient « croates ». Ici, une première confrontation eut lieu entre le juge et l’accusé. Le juge demanda à Seselj d’envoyer une note au service de traduction, puisque ce genre de tâche, du ressort de l’avocat, devait, puisqu’il n’en souhaitait pas, être assumé par lui. Seselj déclara alors qu’il savait bien que la Cour « voulait le condamner d’ores et déjà ». Cette phrase vint certifier la position dite « de rupture » : tout est joué à l’avance, moi, l’accusé, je suis en réalité la victime d’un système injuste et partial. Réponse immédiate du président :
Bien entendu, nous rejetons ces insinuations. Il appartient à la Chambre de première ins-tance, d’après vous, de vous condamner, alors que le seul objectif poursuivi par la Chambre de première instance consiste à s’approcher le plus près possible de la vérité. Nous savons tous que la vérité n’existe pas sur terre, mais nous entendons les deux parties et c’est seulement après les avoir entendues que nous nous déterminerons sur la base de faits, et de faits destinés à nous permettre de nous approcher le plus près possible de la vérité. Nous nous prononcerons donc dans notre activité qui consiste à administrer la justice. Il vous sera permis, comme cela est le cas de façon générale, de réfuter si vous le souhaitez les allégations contenues dans l’acte d’accusation.
Face à l’accusation de « faux procès », déjà noué et joué, le juge oppose, dans un rapport d’interlocution directe, l’argument dont nous avons parlé plus haut de la garan-tie offerte par la visée processuelle de la formation judiciaire de la vérité, au moins « autant qu’il est humainement possible ». Cette garantie s’appuie ici, répète le juge à l’audience, sur la formule accusatoire du procès, et son corollaire, son caractère contradic-toire qui voit se confronter directement les parties, procès où l’accusation et la défense sont à « armes égales » et développent leurs moyens de preuves (témoins, experts, docu-ments) devant un juge-arbitre, selon la procédure anglo-saxonne. Ce caractère contradic-toire est renforcé par le contre-interrogatoire mutuel des parties. L’impartialité est alors
14 . « La Chambre de première instance est donc convaincue que l’accusé comprend la langue dénommée BCS. En outre, la Chambre de première instance fait observer que, dans toutes les traductions fournies à l’accusé, la variante serbe est utilisée. Sa plainte injustifiée ne portait que sur des mots figurant dans l’annexe, dont une variante différente avait été employée durant l’interprétation » (Décision de la Chambre de première instance, 9 mai 2003, paragraphe 23).
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 11
réputée garantie, tente-t-il de démontrer, par les principes mêmes de cette procédure. En quelque sorte, le droit, en la personne du juge-arbitre, vient définir et garantir le cadre de l’impartialité. Bien entendu, cette définition sera aisée à démonter. Le président rappelle enfin que, quoique Seselj soit juriste, il a peut être intérêt à demander un avocat :
Néanmoins, il est de mon devoir de souligner, en conclusion, que vous êtes toujours habilité à bénéficier de l’aide d’un conseil choisi par vous qui, sans aucun doute, vous facilitera votre défense, compte tenu notamment de l’extrême complexité des questions juridiques qui se pose-ront. Vous connaissez bien le droit, évidemment. Mais, comme vous le savez aussi, il vous faut vous plier aux règles d’une procédure et d’un exposé de preuves qui est une série de règles hy-brides, issues en majorité du système de common law. Et moi-même, provenant d’un système de civil law, je connais les problèmes supplémentaires que toutes ces questions juridiques posent. Il ne fait aucun doute – et je n’ai aucun doute à ce sujet – que vous avez toute l’éloquence néces-saire et toutes les capacités rhétoriques pour vous exprimer sur les faits. Mais dès lors qu’il est question de droit, il peut être dans votre intérêt de bénéficier de l’aide d’un conseil de la dé-fense.
Le président indiqua ensuite à Seselj qu’il devait, maintenant ou dans un délai de trente jours 15 , déclarer son intention de plaider coupable ou non coupable. Si un accusé plaide non coupable, un procès a lieu ; s’il choisit de plaider coupable il est réputé tel et il n’y a pas de procès, simplement des audiences pour fixer la peine. Seselj choisit de se prononcer dans trente jours 16 , mais posa une condition : il ne se prononcerait que si, sous trente jours, le procureur lui expliquait certains termes croates de l’acte d’accusation, ne pouvant se régler sur un acte d’accusation dont tous les termes n’étaient pas clairs.
On voit poindre ici la technique de la symétrisation, grande arme de la défense de rup-ture. Non pas la symétrie accordée par la procédure, mais une symétrie maitrisée par l’accusé, qui réclame le pouvoir, pour lui aussi, au nom de la symétrie, d’édicter ses rè-gles et son système de normes. Le juge, calmement, répète les règles, en insistant sur leur inchangeabilité institutionnelle appuyée sur des lois : il y a deux parties, répète-t-il, les juges n’appartiennent pas aux parties : ils sont là pour garantir l’égalité des armes entre l’Accusation (le procureur) et la Défense (les avocats qui représentent l’accusé). Le juge, reprend-il, comme il le fera des centaines de fois, dit la règle de droit et discernera, à la fin du procès, la vérité, après avoir entendu les deux parties, leurs discours, leurs témoins, et examiné les documents qu’ils produisent. Si, s’agissant de son mode de plaidoirie, l’accusé ne dit rien, la règle parlera à sa place et la Chambre prononcera pour lui un plai-doyer de non-culpabilité. Car, dans ce système, comme dans tout système juridique, mar-tèle le juge, c’est la loi et non les hommes qui disent la règle, et en tout cas, ce n’est pas l’accusé, même s’il est juriste :
Pour que tout soit clair dans ce prétoire, des limites de temps sont imposées par la Chambre de première instance, et pas par l’une ou l’autre des parties. Donc si vous avez le moindre pro-blème, il vous appartient de décrire ces problèmes liés à la traduction. Vous pourrez le faire par écrit, comme cela est prévu dans le Règlement. Si vous ne le faites pas, nous nous retrouverons
15 . Articles 62 et 66 du Règlement de procédure et de preuve. 16 . Dans la plupart des cas, les accusés plaident non coupable ; cependant, en janvier 2009, 19 d’entre eux ont plaidé coupable, soit au début de leur procès, soit en cours de procès, sur 116 personnes jugées (dont 10 acquittements). Lorsque les accusés plaident coupable, le procès s’arrête, les opérations de transactions du plaider coupable commencent.
E. CLAVERIE
12 Droit et Société 73/2009
exactement dans la situation d’aujourd’hui dans 30 jours. Et dans ce cas, comme je l’ai déjà dit, il vous appartiendra de vous prononcer sur votre façon de plaider. Si vous ne dites pas de quelle façon vous allez plaider, ce seront les juges qui détermineront à votre place et pour chacun des chefs d’accusation 17 .
Seselj rétorque alors qu’il n’est pas pressé, qu’il est maître du temps, jouant, pour provoquer le juge, du fait que, que dans la notion de « procès équitable », il y a la notion de procès réglé « sans traîner », stipulant que l’inculpé ne doit pas rester « trop long-temps » en détention préalable, et que les moyens du Tribunal ne sont pas éternellement extensibles.
Viennent ensuite les questions du juge concernant la procédure d’arrestation. Seselj a-t-il des remarques à faire ? Réponse : je n’ai pas été arrêté, je suis venu de mon plein gré 18 . Stratégie de mise en égalité entre sa personne et le corps professionnel des juges, et entre sa cause et la leur. Il continue : « Je ne souhaite pas que mon ambassade (Serbie-Monténégro) soit prévenue. J’estime, pour ma part, qu’en Serbie et au Monténégro il y a au pouvoir des mafieux et des criminels, et je ne veux pas de contacts, quels qu’ils soient, avec eux. » Il ajoute ensuite, dans la même veine de dérision et de symétrisation des actes qui lui sont reprochés avec ceux du tribunal :
J’ai été exposé à une torture physique et à de mauvais traitements parce que, suite à la sor-tie de la prison, on m’a mis un gilet pare-balles qui pèse 20 kilos. Je crois que c’est là une me-sure de torture interdite par le droit international. Je n’ai pas besoin d’un gilet pare-balles. Per-sonne n’a besoin de protéger ma vie. Et j’ai dû entrer à quatre pattes dans un véhicule pour ar-river ici. Dans un monde civilisé, s’il y a un danger quelconque, on se procure un véhicule blin-dé. Je ne suis pas arrivé ici pour trimbaler dans La Haye des gilets pare-balles ! Je suis venu ici pour être jugé. Je ne puis donc supporter ce type de mesure et je vous demande de la supprimer. Personne ne m’a menacé et il n’y aucun danger, pour ce qui me concerne, à mon égard.
Puis Seselj continue ses contestations par la dénonciation du caractère fallacieux de la prétention d’extra-territorialité du tribunal. L’attaque vise ici la revendication d’indépendance du tribunal, de détachement de toute dépendance politique. Il vise, plus profondément, un des credo de l’internationalisme juridique libéral selon lequel le droit, objectif, devrait fonder, plutôt que le politique, subjectif, le fonds de la relation entre États 19 . Il s’agira donc pour Seselj, à travers mille et une attaques diverses, de démonter les affirmations de connexions entre impartialité et neutralité, en montrant toutes les occurrences empiriques, factuelles qui démontrent les liens politiques, l’environnement politique du Tribunal, sous-entendant alors sa dépendance
Ce que je ne puis supporter, c’est l’idée de voir le gouvernement néerlandais approuver quoi que ce soit. Ce Tribunal est ex-territorial, la loi est ex-territoriale. Donc ce que je ne sup-porte pas, c’est que l’on demande au gouvernement néerlandais quelque visa que ce soit. Dans ce cas-là, je devrais renoncer aux visites de certains membres de la famille ou de certains amis, mais je ne veux pas permettre que le gouvernement néerlandais soit à même de décider de la chose.
17 . Intervention du juge Schomburg, audience du 26 février 2003. 18 . Il ajoutera lors de l’audience suivante : « J’ai déposé une demande au Greffe pour que 438 dollars me soient versés, soit le prix d’un billet d’avion. Une fois que j’ai reçu l’acte d’accusation, je me suis rendu à La Haye. Je crois que c’est le Tribunal de La Haye qui doit prendre en charge ces frais. En tout cas, c’était certainement meilleur marché que de me voir transférer sous contrainte » (Seselj, 25 mars 2003, audience de l’après-midi). 19 . Martti KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations : The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 13
À l’audience suivante, montant en généralité et amorçant le second moment de sa stra-tégie (à génocidaire, génocidaire et demi), Seselj ajoutera :
Ma famille à moi, mes amis à moi ne demanderont jamais un visa néerlandais, notamment au moment où le gouvernement néerlandais soutient l’agression et le génocide contre le peuple irakien. Le Conseil de sécurité des Nations unies est tenu d’assurer la délivrance de visas, s’il s’agit d’assurer l’extraterritorialité du Tribunal, les timbres-poste, etc. 20 .
Enfin, toujours lors de cette audience préliminaire, Seselj accuse le Tribunal de ridi-cule, et de liens au moins analogiques avec l’expression même de la tyrannie : l’Inquisition. Il accuse la Cour de coller à une appartenance en dépit de son affirmation de neutralité, d’être soumise à l’Église catholique, l’ennemie des Orthodoxes (dans la grammaire de Seselj).
Dans mon pays, il est coutumier que les juges, les procureurs et les employés d’un tribunal portent des vêtements civils, normaux, décents. Je suis très frustré quand je vois que les juges sont vêtus de vêtements bizarres, en noir et rouge, et les procureurs en noir et en blanc. Cela me fait penser à l’inquisition de l’Église catholique. Je puis difficilement supporter la chose sur le plan psychologique. Je crois pouvoir exiger que vous soyez vêtus de façon décente, parce que je crois savoir qu’il n’y a aucune règle prescrivant que vous soyez vêtus de la sorte ; du moins, je n’ai pas connaissance d’une règle de cette nature, quelle qu’elle soit.
Il reviendra sans cesse sur ce point. Enfin, cette première audience fut conclue par un retour au point clé : le mode de défense. Ce fut le dernier dialogue de cette audience entre Seselj et le juge.
J’en arrive maintenant au dernier point que nous aborderons lors de la présente audience. Vous connaissez la signification de l’expression « le droit d’être entendu ». Il est fort possible que la Chambre de première instance, ex officio, soulève la question de savoir si, dans l’intérêt de la justice, un conseil de la défense vous sera assigné ou pas. Souhaitez-vous commenter, formuler un commentaire, sur ce point ?
Réponse de Seselj, dont c’est le tour de s’adosser à la règle : Sous aucune condition, je n’accepterai que vous m’attribuiez, ex officio, un conseil de la dé-
fense. J’estime que cela limiterait ma possibilité de me défendre. Dans ce prétoire, personne en mon nom ne saurait prendre la parole et me défendre de ce qui constitue la teneur de l’acte d’accusation. Ce serait une mise en scène de procès et cela n’aurait aucune signification que de faire un procès. Si l’on m’assure des conditions normales, j’aurai un conseiller juridique, j’aurai un assistant, mais je ne veux pas qu’il y ait de simulacre de procès et je veux me défendre moi-même. J’estime avoir le droit pour ce faire, et je me réfère à l’article 21.
Le juge conclut, tentant de garder la main : « La Chambre de première instance délibè-rera à ce sujet ». Fin de la première audience.
I.2. Premières requêtes
Dans les trente jours qui suivirent, Seselj envoya au juge une lettre en langue serbe de cent pages, écrite à la main et illisible. C’était utiliser une des ressources classiques de la défense d’obstruction. Elle empruntait ses méthodes à la grève du zèle, en poussant à l’extrême ses possibilités légales, ce qui avait pour résultat de gripper le fonctionnement du système. Seselj refusait d’employer la machine à écrire ou l’ordinateur mis à sa dispo-sition, arguant qu’il avait peur du courant électrique, tandis que les traducteurs ne par-
20 . Intervention de Vojislav Seselj, audience du 25 mars 2003.
E. CLAVERIE
14 Droit et Société 73/2009
venaient pas à déchiffrer son écriture. Le juge lui signifia alors que ses lettres et requêtes ne devaient pas dépasser une certaine taille. Par ailleurs, voyant venir le style de défense, le bureau du procureur demanda, par requête à la Chambre, la commission d’office d’un conseil de défense « dans l’intérêt de la justice ». Il arguait du fait que « l ’accusé Seselj vit pour soulever des scandales, des complots et publicités ». Réponse de Seselj à l’audience suivante : « Jusqu’à maintenant, au moins une cinquantaine de fois j’ai été jugé dans mon propre pays, en Serbie, et cela toujours pour cause politique. Jamais il est arrivé de me voir insulter de façon si grossière par le procureur moyennant un acte pu-blic. » Restait au juge à statuer. Il avait devant les yeux, déjà, de nombreuses requêtes écrites déposées par les parties devant la Chambre, des lettres, et le premier compte rendu d’audience.
I.3. Deuxième audience : coupable ou non coupable
Trente jours plus tard, en présence de Carla del Ponte, procureure, lors de la seconde audience – au cours de laquelle Seselj devait annoncer son choix de plaidoirie (coupable ou non coupable) –, la polémique sur la langue recommença, Seselj ayant fait de la retra-duction « en serbe » de termes « qu’il ne comprenait pas » la condition de sa compré-hension de l’acte d’accusation. Le juge commença l’audience en indiquant que ses re-cherches et la consultation de linguistes l’avait renforcé dans l’ idée, puisqu ’il s’agissait d’une même langue, que Seselj comprenait bien son acte d’accusation. Seselj en profita pour jouer avec les mots et les transformer, s’amusant à utiliser en plein prétoire, à travers l’emploi déformé du mot « hoticine », « délibéré », une série d’ insultes contre les Alba-nais, en reprenant le vocabulaire même de l’épuration ethnique :
Pour dire « hotimice » encore, je ne comprends pas encore ce que cela veut dire. Il m’a été dit qu’il y avait une tribu albanaise de « Hot » ; cela veut dire aussi quelqu’un qui bouge, qui grouille, qui rampe. Donc les « Hots » qui rampent, qui grouillent ou quelqu’un qui le fait à la façon des « Hots » 21 .
Les termes « croates » furent donc remplacés. Un peu plus tard dans l’audience, une nouvelle remarque de Seselj déclenchera une leçon de politique libérale (à un accusé d’épuration ethnique) :
Monsieur Seselj, nous sommes dans un Tribunal où l’on emploie les trois variantes de la lan-gue serbo-croate. Tout le monde est traité de manière égale. […] Il faut donc que vous fassiez preuve de tolérance. Les langues sont des outils qui permettent de rapprocher les hommes et leur permettent de se comprendre, mais on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde parle la même langue, la même variante de la même langue, voire même le même dialecte au Tribu-nal ; ainsi l’anglais est une de nos langues officielles. Mais parfois, il nous est difficile de com-prendre quelqu’un qui parle la variante irlandaise de l’anglais, la variante française de l’anglais, la variante allemande de l’anglais, etc., mais nous devons nous y faire. Il faut donc faire preuve de tolérance et essayer de comprendre autrui. Vous ne bénéficierez pas d’un trai-tement particulier s’agissant des traductions ou de l’interprétation. Il faut que vous sachiez que peu nous importe d’où viennent les gens : Zagreb, Novi Sad, Belgrade ou ailleurs, l’essentiel c’est que les propos soient traduits dans une langue que vous comprenez et cela ne devrait poser aucune difficulté.
21 . Audience du 25 mars 2003.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 15
Seselj répond qu’il ne peut tolérer l’écoute d’un mot croate, et qu’il n’est pas venu ici pour être tolérant « avec eux ».
Attaché à mettre lui-même en scène le « grand moment » de cette audience, le pronon-cé de culpabilité ou de non-culpabilité, il demande que l’ensemble de la Chambre soit présente et ajoute, provocant :
L’ensemble de la Chambre de première instance doit être représenté ici au moment où je plaide. Je considère cet acte comme un des plus importants, pour moi et pour vous tous. Je vou-drais regarder droit dans les yeux tous les membres de la Chambre de première instance, je voudrais voir comment ils réagissent lorsque je plaide coupable ou non coupable. Voilà pourquoi je vous demande de convoquer l’ensemble de la Chambre de première instance.
Il demande ensuite que tous les chefs d’accusation soient lus, non par la greffière, mais par chacun des trois juges, en procédant à un roulement. À chaque chef, la question lui est posée : coupable ou non-coupable ? Pour les quatorze chefs, Seselj répondra « non-coupable ». Cette première audience ayant donné le ton, nous voudrions mainte-nant présenter les grandes lignes de la conduite de Seselj lors des six années de son procès, non encore conclu à ce jour (mars 2009).
II. La défense de Seselj, théâtre de la rupture II.1. « Et au nom de l’accusé, l’accusé en personne ! »
C’est ainsi que se présente Seselj devant la Cour. Au sein même du prétoire, en effet, il parvint à imposer un espace propre, un dispositif depuis lequel il pouvait diligenter sa cause et imposer son mode de présence : son corps, sa voix tonitruante, ses invectives. Il se dégagea ainsi de toute posture de passivité dans laquelle la procédure aurait pu le pré-placer comme partie d’une mécanique procédurale séquentielle instituée, fonctionnant sans lui. Il entendait en effet donner au mot lui son extension maximale, comme on voit dans ses multiples affirmations du type : « moi, le plus grand juriste du monde », « je vous aurai tous », « je serai le vainqueur et je vous abattrai », sorte de Cassius Clay d’une audience qu’il assimilait volontiers à un ring. Se défendre seul, ne s’entourer que de conseils choisis par lui, selon ses normes de recrutement – fidélité personnelle et liens du sang forgés dans la guerre – et non selon les normes du greffe – appartenir à un Barreau national comme garantie, notamment, de connaissance et de respect des mesures de confi-dentialité -. À défaut de quoi, annonçait-il, pas de procès. C’est lui seul qui décidait des conditions de son apparition. C’était cela ou la grève de la faim, la menace de suicide. Son procès, sa défense, déclara-t-il, étaient la continuation de la guerre. Il abattrait le tribunal, même au prix de sa propre condamnation. Se battre pour sa cause et non pour soi (pour la personne de l’accusé), voilà encore un trait classique de la défense de rupture. Mais ici, avocat, cause et défenseur sont une seule et même personne.
L’attitude de Seselj, son comportement « perturbateur, obstructionniste ou cho-quant », contraignit l’accusation à une réponse. Dans l’intérêt de la justice 22 , elle de- 22 . L’article 21 du Statut, la jurisprudence du Tribunal et celle du Tribunal pour le Rwanda n’excluent pas la possibilité de commettre d’office un conseil à un accusé au cas par cas, quand l’intérêt de la justice le commande. L’expression « dans l’intérêt de la justice » est employée comme suit dans le texte de la décision de la Chambre de première instance du 9 mai 2003, décision rendue pour répondre à la demande de l’accusation d’affecter un avocat à Seselj : « La formule "dans l’intérêt de la justice" peut être entendue au sens large. Elle englobe la tenue d’un procès équitable qui non seulement constitue un droit fondamental de l’accusé, mais présente aussi un intérêt
E. CLAVERIE
16 Droit et Société 73/2009
manda par requête à la Chambre qu’un avocat soit désigné. La chambre ne désigna pas un avocat proprement dit, mais elle demanda un conseil d’appoint maîtrisant le bosnia-que/croate/serbe et l’une des langues officielles du Tribunal. Elle ordonna au greffier de désigner ce conseil parmi ceux figurant sur la liste tenue en application de l’article 45 B) du Règlement 23 . Seselj récusa ce conseil imposé, Toma Fila, ne lui adressa jamais la pa-role, si ce n’est pour l’injurier.
Lorsqu’on s’aperçut, dès les premières semaines de détention, en novembre 2003, que Seselj, patron du Parti radical serbe, menait une campagne électorale depuis sa pri-son, avec les moyens matériels du Tribunal, que les fonds de l’ONU et ceux de la coopéra-tion des États signataires servaient à financer la campagne électorale ultranationaliste d’un criminel de guerre, campagne au terme de laquelle son parti obtint un score impor-tant, la question de ses assistants juridiques devint vraiment pressante. Le procureur et certains des juges de la Chambre insistaient toujours pour qu’il accepte malgré tout un conseiller « stand by » qui pourrait rester muet dans le prétoire, n’intervenant qu’à la requête expresse de l’accusé pour l’aider à préparer des dossiers 24 . Ceci lui fut imposé au fondamental pour le Tribunal, lié à sa légitimité. S’agissant du droit à un procès équitable, il convient de prendre en compte la longueur du procès, l’importance de l’affaire et sa complexité. » La requête de l’accusation, pour sa part, spécifiait ainsi l’expression « dans l’intérêt de la justice » : « L’accusation a avancé que l’intérêt de la justice exigeait de désigner un conseil chargé d’aider l’accusé à se défendre, compte tenu de la complexité de l’affaire, des intentions déclarées de l’accusé de nuire au Tribunal et d’utiliser ce procès comme une tribune au service des intérêts nationaux serbes. » 23 . Décision de la Chambre du 9 mai 2003. 24 . Vu le comportement immédiat de Seselj, répété lors des cinq premières audiences de mises en état qui eurent lieu en 2003, tous les trois mois, l’accusation déposa sa première demande de commission d’office d’un conseil à la Chambre de première instance par voie de requête le 28 février 2003, soit deux jours après l’audience de compa-rution initiale du 26 février. La réponse de la Chambre de première instance parvint le 9 mai 2003. Dite « première décision », elle décidait d’accepter que Seselj se défende lui-même, mais décidait aussi de lui adjoindre un « conseil d’appoint » nommé par elle et devant répondre aux exigences de conformité exigées par le greffe. Cet assistant juridique aiderait l’accusé à constituer ses dossiers, pourrait rester muet à l’audience si Seselj le désirait, mais serait présent dans le prétoire au cas où Seselj aurait besoin de lui, ou au cas où le comportement de l’accusé exigerait qu’il soit interpellé par l’accusation ou par la Chambre. Un conseil fut donc nommé, maître Toma Fila. Il fut récusé violemment par Seselj qui, à l’audience, dénonça « ses affiliations mafieuses », « la mafia du tribunal », en réponse au fait que ses propres suggestions de recrutements d’assistants juridiques, qu’il voulait choisir lui-même, et ne voulait pas voir dans le prétoire, avaient été qualifiées de ce terme. Devant les violentes attaques publiques de Seselj à l’audience, T. Fila refusa d’être le conseil d’appoint de Seselj et porta plainte pour calomnie. Un deuxième conseil fut alors nommé, maître Van der Spoel, qui avait été l’avocat, à Arusha, d’accusés rwandais. Seselj refusa de lui adresser la parole. Le 3 janvier 2006, l’accusé pria à nouveau la Chambre de première instance d’examiner et d’annuler la décision de commettre un conseil d’appoint à sa défense en alléguant le droit à se défendre seul. Il ajoutait que si maître Van der Spoel parlait l’anglais, il ne parlait pas serbo-croate. Il invoqua le règlement de procédure et de preuve, le statut, et son droit à se défendre lui-même, consacré par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Quatre mois plus tard, le 22 mai 2006, l’accusation déposa à son tour une seconde requête aux fins de commettre un conseil à la défense, c’est-à-dire, cette fois, un avocat pour représenter Seselj à l’audience. La Chambre de première instance, présidée par le juge Orie, fit droit à cette requête, et rendit une décision ordonnant que Seselj soit assisté d’un avocat, estimant que son attitude pourrait faire obstacle à la conduite d’un procès rapide et équitable « du fait de son comportement obstructionniste et de sa conduite abusive ». Seselj s’opposa violemment à cette décision, tout au long des audiences de mises en état, préalables au procès. En août 2006, le procureur exigea la suspension du procès. Deux mois plus tard, à la fin d’octobre 2006, coup de tonnerre, la chambre d’appel renversa la décision de la Chambre, déclarant que Seselj n’avait pas été suffisamment informé de la possibilité de refus du droit de se défendre seul, mais le « conseil d’appoint » fut maintenu. Malgré cette nouvelle décision, et alors que le procès devait commencer le 2 novembre 2006, Seselj refusa de se présenter à l’audience, refusant le principe de l’imposition d’un conseil d’appoint nommé, et entama le 10 novembre 2006 une grève de la faim. Il ne voulait ni avocat commis d’office ni conseil d’appoint nommé. Le
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 17
long de péripéties qui durèrent pendant toute la phase préalable au procès proprement dit. Une guerre des requêtes eut alors lieu entre Seselj, la Cour et l’Accusation, jusqu’à ce que la Chambre d’appel casse les décisions de la Chambre d’instance. Elle acceptait qu’il n’y ait pas d’avocat, mais voulut imposer un conseiller juridique. Nouveau point de litige 25 .
Il était alors crucial, du point de vue du tribunal, d’exiger de ses conseillers juridi-ques quelques garanties : qu’ils appartiennent à un Barreau d’avocat par exemple. Plu-sieurs furent imposés à Seselj, dont maître Lazarevic, qu’il récusa violemment, leur repro-chant leurs affiliations en utilisant pour exiger leur récusation la même analogie de logi-que mafieuse qu’il était suspecté d’employer lui-même pour le recrutement de ses conseil-lers :
Me Toma Fila, par l’intermédiaire de Mme Holthuis [épouse du greffier en chef], a des rap-ports directs avec un représentant de la Cour pénale internationale. Et c’est dans cette maison, sur le lac Ohrid, qu’il a été décidé de nommer l’avocat Lazarevic pour me défendre ou pour m’aider. Pourquoi est-ce que Me Lazarevic ne peut absolument rien faire pour moi ? Parce que Me Fila, en 1993 et 1994, est intervenu en faveur d’Arkan, dans des procédures juridiques in-tentées à l’époque. À cette époque, Aleksandar Lazarevic était un stagiaire dans le bureau de l’étude de Me Toma Fila. J’ai préparé ici un document que vous voyez, je l’ai entre mes mains. Il est très volumineux. C’est un document qui contient tous les documents juridiques de ces pro-cédures judiciaires intentées contre Arkan, et Me Fila était le conseil de Arkan. Deuxièmement, j’ai également découvert un certain nombre d’actes criminels auxquels a participé M. Hans Holthuis [le greffier en chef du Tribunal], qui a distribué de l’argent, des fonds, sans que le Tri-bunal soit au courant 26 .
Longtemps, jusqu’à ce que des avocats internationaux se proposent, les accusés au TPIY ont été défendus par les avocats locaux des partis nationalistes. Les hommes et femmes qui défendaient Seselj font aussi partie de ces mêmes instances ultranationalistes, souvent en guerre entre elles (dans un même « camp ethnique »). La publication par Seselj de livres, d’articles, d’injures sur les témoins, y compris les témoins protégés, mais aussi sur des membres du bureau du procureur obligea le tribunal à limiter le choix de certains défenseurs. Ce dont Seselj se plaignit :
Vingt et un avocats du bureau de Me Toma Fila sont également impliqués dans quinze pro-cédures engagées devant ce Tribunal. Je m’affronte avec Me Toma Fila et tous les membres de son bureau depuis plus de dix ans. Toma Fila est l’un des fondateurs du Parti de l’unité serbe d’Arkan et le procureur ne peut pas se satisfaire du fait que Maja Gojkovic soit conseil dans ma défense parce qu’elle est un des fondateurs de [mon] parti politique. Mais ils n’ont rien à faire du fait que Toma Fila était également un fondateur de parti politique. Donc, d’une part, cela empêche mon avocat de travailler, d’autre part, on n’a rien contre Toma Fila pour le même mo-tif.
procès commença donc le 27 novembre sans Seselj. En son absence, la cour désigna un avocat pour le représenter, lequel fut présent lors de la déclaration liminaire du procureur, et ils firent part de leur inquiétude devant l’état de santé de l’accusé. Le 29 novembre 2006, Seselj était hospitalisé. Le 1er décembre 2006, le procès était suspendu ; le 8 décembre, Seselj arrêtait sa grève de la faim. En février, une nouvelle chambre était nommée, avec le juge Antonetti pour président. L’instruction reprit. La première audience du nouveau procès eut lieu le 13 mars 2007. 25 . Trois juges ont à ce jour présidé ce procès : le juge Schomburg pendant les premières audiences de la première phase de mise en état ; puis, celui-ci entrant à la Chambre d’appel, le juge Agius ; enfin, lors du second procès, le juge Antonetti. 26 . Audience du 29 octobre 2003.
E. CLAVERIE
18 Droit et Société 73/2009
Autre grief dénoncé par Seselj, les liens personnels : Le père d’Aleksandar Lazarevic est un professeur bien connu qui falsifie les résultats des
étudiants aux examens et il partage son bureau avec Ilija Drazic, qui est avocat. Il s’agit donc de mettre Ilija Drazic, qui est conseiller de la mafia, d’un membre de la mafia, Goran Pipic. Et par ailleurs, l’épouse d’Aleksandar Lazarevic est une responsable bien connue du régime ma-fieux de Serbie. Actuellement elle est dans la galerie du public, ici. J’aimerais beaucoup infor-mer la Chambre de première instance de ce tribunal du fait qu’en aucun cas je n’accepterais le moindre contact avec l’avocat Aleksandar Lazarevic. J’ai moi-même mes conseillers juridiques qui jouissent d’une confiance totale et entière de ma part, sans limites de ma part. Et même si Hans Holthuis [greffier en chef du tribunal] essaye de ne pas les rencontrer, si la Chambre de première instance a peur de Maja Gojkovic, qui est mon conseil, Maja Gojkovic en tout cas remplit toutes les conditions nécessaires pour être mon conseiller juridique. Les avocats qui tra-vaillent ici n’ont pas besoin de connaître la langue anglaise pour travailler puisqu’en tout cas, dans le cas qui m’intéresse, ces avocats ne s’exprimeront pas dans le prétoire. Ils sont censés simplement être assis à côté de moi et communiquer avec moi par écrit ou par oral, le cas échéant. Donc voilà, Monsieur le Juge, ce que je voulais dire jusqu’à présent. Je demande que ce que je viens de dire soit bien consigné au compte rendu d’audience et, dans ce compte rendu d’audience, je veux que l’on cite le titre de l’ouvrage que j’ai entre les mains qui contient une synthèse de la plupart des procès engagés contre moi par le régime en Serbie, et entre autres les comptes rendus d’audience du procès qui a eu lieu, auquel a participé Zeljko Raznjatovic, dit Arkan, procès au cours duquel, je l’ai déjà dit, Zeljko Raznjatovic, dit Arkan, a eu pour défen-seurs Me Toma Fila et Aleksandar Lazarevic qui travaillait dans son cabinet.
II.2. Revendiquer « l’égalité des armes »
L’émergence, depuis Nuremberg 27 , d’une justice internationale décidée à poursuivre les criminels de guerre et à les juger plutôt qu’à « châtier les coupables » posa à nouveau la question de la forme que devait prendre la défense. Dès lors qu’au terme de longues péripéties, la solution de Staline ni celle de Churchill n’avaient été retenues (« les coller au mur » 28), dès lors que la solution judiciaire prévalait (à côté, ici et là, de pratiques nationales d’épurations ou d’amnistie 29), il fallut donner à la défense une mission, à la culpabilité une définition technique. À côté du coupable de l’épuration et de ses caracté-ristiques, il fallait constituer un coupable judiciaire de cette forme de crimes les plus graves, définir un type de responsabilité, c’est-à-dire mettre en place une procédure et des preuves à la hauteur de cette tâche. Ce qui signifiait aussi donner un sens général à l’objet de ces procès. Dans les années 1990, le Tribunal pénal international de La Haye, puis celui d’Arusha, le TPIR, se placèrent dans le sillage ouvert par le Tribunal militaire de Nuremberg, mais avec d’autres incriminations. Ces deux tribunaux civils eurent à mettre en œuvre un tribunal jugeant au nom des droits de l’homme, sans les assises habi-tuelles de la souveraineté, par exemple sans forces de police propres et sans un corps de lois rassemblées « de longue date » dans des textes tangibles, des codes, selon les usages du droit anglo-saxon et des précédents. Mais ici, les traités, les conventions, les coutu-mes éparses, la jurisprudence produisaient des références vraiment dispersées. De plus,
27 . Jean-Marc VARAUT, Le procès de Nuremberg , Paris : Perrin, 2002. 28 . Sur les débats entre Churchill, Staline et Roosevelt, puis Truman, sur le sort des criminels de guerre, voir Annette WIEVIORKA, Le procès de Nuremberg , Paris : Liana Lévi, 2006. 29 . Voir, notamment, Anne SIMONIN, Le déshonneur dans la République : une histoire de l’indignité, 1791-1958, Paris : Grasset, 2008.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 19
mais c’est sans doute aussi un signe de sa vitalité, un statut et un règlement de procédure et de preuve pour partie en cours, avec des articles souvent remaniés dans le cours même du procès.
Laboratoire de la mise en œuvre d’une « Justice des droits de l’homme », on l’a dit, le Tribunal était désireux de mettre à l’épreuve une théorie du droit porteuse de valeurs objectives universelles. Cette théorie d’un droit (objectif) capable de contrebalancer dans le jeu international, voire de contrer ou d’équilibrer l’ influence des politiques nationales (subjectives) était un enjeu de taille. Elle voulait dessiner un univers dans lequel l’impunité devant le crime, le crime de masse, y compris celle des chefs d’État, des chefs militaires, était proscrite. Ceux-ci répondraient, un jour ou l’autre, au nom de leur responsabilité individuelle, devant une Cour pénale internationale. Principes hautement revendiqués, l’impartialité et l’objectivité furent en charge de supporter ensemble l’assise du Tribunal pénal international. Insérée dans cette procédure, l’égalité des armes entre défense et accusation, principe des juridictions anglo-saxonnes, est spécialement soulignée dans son rôle de garant de symétrie entre les parties. Ainsi, la défense et l’accusation présentent à l’audience leurs moyens réciproques de preuves (témoins et dossiers), chacun contre-interroge ensuite les preuves de l’autre, le tout devant trois juges placés en position d’arbitres, et qui, à l’issue du procès, jugeront de la culpabilité et de son degré au vu de ce qu’ils ont entendu et des preuves qu’ils ont admises au dos-sier. Réglées par un Statut et un Règlement de procédure et de preuve, la procédure et ses diverses séquences contradictoires sont revendiquées comme la mise en œuvre de cette volonté d’impeccabilité. Cette procédure était réputée la mieux à même d’organiser des débats contradictoires au terme desquels un arbitre, le juge, établirait une vérité judi-ciaire, déclarerait une culpabilité et prononcerait une sanction. C’est donc contre cette vision que Vojislav Seselj, à la suite de Slobodan Milosevic, lança ses attaques.
D’emblée, Seselj refusa d’entrer dans le cadre régulé de la procédure. D’emblée, il la fit apparaître comme purement relative, une norme parmi d’autres, et non le lieu même de l’objectivité et de l’impartialité au sommet d’une hiérarchie juridictionnelle remarquable par son impeccabilité. Se plaçant en position d’autorité et d’égalité (comme professeur de droit, condescendant à visiter des locaux judiciaires), dès sa première comparution il força le juge 30 à faire savoir qu’il était, lui, le juge, et Seselj, l’accusé. Qu’entre impartialité, symétrie des débats et symétrie des positions, il y avait une différence ; que c’était lui, le juge, qui menait les débats et maîtrisait les séquences procédurales, que Seselj devait prendre la parole selon un ordre du jour. Bref, il dut sans cesse contenir Seselj pour que celui-ci accepte d’ajuster ses réponses aux questions posées. On voit bien ici la tactique de Seselj se mettre en place : prendre à la lettre les propositions de symétrie du tribunal, en commençant par la proposition « à armes égales ».
II.3. Seselj en accusateur
C’est à partir de cette position d’égalité des armes avec le procureur que Seselj se fait lui aussi accusateur. Cette technique de plaidoirie, le retournement des accusations, fut employée par Göring devant le Tribunal de Nuremberg, comme elle fut employée par les 30 . Le juge Schomburg était le juge de la comparution initiale et des premières audiences de la mise en état, avant d’être envoyé à la chambre d’appel du Tribunal et remplacé par le juge Agius.
E. CLAVERIE
20 Droit et Société 73/2009
communistes dans les années 1950 en France, par exemple 31 . Seselj semble ainsi s’inscrire dans la tradition de la « défense de rupture », qui fut remise sur le devant de la scène par l’avocat Jacques Vergès lors du procès de Klaus Barbie, notamment. Dans tous les procès où il intervient, Vergès s’attache à mettre en lumière les relations existant entre jugements et situations de domination individuelle et collective, privées et politiques. Dans cette vision, qui prend pour exemplum la relation du colonisateur au colonisé, est décrite à la fois la symétrie des comportements de violence des groupes nationaux ou des États opposée à l’asymétrie de la façon dont ils sont évalués. Les uns étant jugés ; les autres, non. Une théorie de l’injustice sous-tend l’écart pointé par Vergès, comme aussi une théorie de la violence 32 . Le schème de la mise en évidence de chaînages, souvent via la vente d’armes et la formation militaire, liant l’ « Occident » – appelé dans ce cadre « OTAN » 33 – aux dits dictateurs, lesquels sont pourtant les seuls accusés 34 , est au centre du travail de dévoilement de plusieurs avocats pro-nationalistes serbes, dont Jacques Vergès, de Milosevic comme de Seselj. Tous émaillent leurs discours au procès de phrases visant à attacher leur cause (illégitime) à la forme « défense de rupture » (légi-time) :
Les puissances occidentales ont décidé que je ne sorte jamais d’ici vivant, et pour moi il n’y a pas de changement de situation. Quant à l’impression que vous allez laisser sur le caractère ethnique de la procédure menée par vous, c’est à vous de décider 35 .
Réponse d’une des trois juges : Je ne peux pas admettre que vous supposiez que les juges sont ici sous les ordres des puis-
sances occidentales. On ne peut pas admettre cela.
suivie par celle du juge président la Chambre, le juge Antonetti : Monsieur Seselj, je tiens à vous dire pour ma part, mais je pense que pour mes collègues
c’est pareil, nous, on n’est sous les ordres de personne, et moi-même, je ne suis sous l’ordre de quiconque, et encore moins de mes collègues. Donc, sachez que vous avez des juges totalement indépendants qui, s’ils doivent vous acquitter, ils vous acquitteront ; s’ils doivent vous condam-ner, ils vous condamneront ; et que maintenant les puissances occidentales n’ont strictement rien à voir là-dedans. Je suis totalement imperméable à toutes formes de pressions, d’interventions. D’ailleurs, depuis que je suis ici, vous concernant, je n’en ai eu aucune, et je défie quiconque de venir m’approcher pour quoi que ce soit. Donc, voilà, je vous l’ai dit, Monsieur Seselj, vous avez un dossier où le procureur estime qu’il y a des allégations vous concernant. Défendez-vous à partir de ce dossier. Laissez tomber toutes les connotations politiques, qui n’ont stricte-ment rien à voir. Vous avez des juges qui apprécient les éléments de preuve au travers d’un prisme qui est celui du droit pénal international, et à partir de là, vous avez les meilleures garan-ties. Voilà. Ce n’est pas un tribunal militaire. Ce n’est pas un tribunal politique, comme vous le dites. C’est un tribunal constitué par des juges qui, eux, sont indépendants, et croyez-moi, moi, je
31 . Sharon ELBAZ et Liora ISRAËL, « L’invention du droit comme arme politique dans le communisme français. L’association juridique internationale (1929- 1939) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 85 (1), 2005, p. 31-43. 32 . Sur la question de la relation de la violence à la justice, voir par exemple Walter BENJAMIN, « Critique de la violence », in ID., Œuvres, tome I, , Paris : Gallimard, coll. « Folio. Essais », 2000. 33 . Ainsi, le « groupe de surveillance de l’Otan » est un site internet rassemblant des plaidoiries montrant les infamies unilatérales (et secrètes) de « l’OTAN ». L’un de ces avocats, Christopher Black, fut un des conseillers juridiques de Milosevic. 34 . Jacques Vergès déclare souvent qu’il voudrait voir ceux qui leur ont vendu leurs armes à leurs côtés sur le banc des accusés. 35 . Audience du 25 février 2009.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 21
le suis. Je l’ai toujours été, et ce n’est pas parce que je suis ici que je vais changer. Donc, c’est ça votre meilleure garantie.
Nier la légalité du tribunal, sa légitimité, son impartialité, son impeccabilité, l’universalité de ses valeurs, mettre en doute l’innocence et la transparence de ses buts, révéler au contraire ses liens de dépendance, ses abus de pouvoir, la relativité de ses fondements politiques et moraux, et surtout sa « non accountability », autant de thèmes dont Seselj encadra ses plaidoiries. Chacun des chefs d’accusation en retour de cette offensive était appuyé sur un ensemble de techniques rhétoriques, d’actes de langage, comme son constant « j’exige que… », de provocations langagières et gestuelles. C’est ainsi que son attitude contraignit le tribunal à modifier le cérémonial des entrées. Le juge Antonetti :
Vous avez noté que j’ai mis en place une procédure pour l’audience qui est la suivante : j’entre en premier, et puis vous entrez après. Pourquoi j’ai fait ça ? Pour éviter le problème que vous posez quand vous ne vous levez pas quand le juge ou les juges rentrent ou quand le juge part. Alors, j’ai réglé à 50 % le problème. Mais les 50 %, je ne les ai pas réglés parce que, quand moi je m’en vais ou quand la Chambre partira, vous n’allez pas vous lever. Alors, je me suis interrogé sur les raisons qui vous motivent. […]
Je pense que vous faites cela parce que, vous l’avez dit, vous contestez l’existence du Tri-bunal, et par cela vous manifestez votre opposition au Tribunal. Très bien, ceci vous appartient. Et moi, je peux comprendre votre position, mais je ne suis pas seul. Pourquoi je ne suis pas seul ? Parce qu’on est dans une enceinte judiciaire ; par ailleurs, il y a des spectateurs. Vous le savez, les audiences sont également télévisées via internet. Il y a donc des gens qui regardent. Il y aura des témoins qui viendront qui auront pu être victimes également de certains faits, et à l’égard de ces personnes, de ces victimes, à l’égard des spectateurs, à l’égard de toutes les personnes, le fait de ne pas se lever pourrait être perçu par ces personnes comme un refus de tout, comme une marque d’impolitesse ou comme un comportement portant atteinte à la justice 36 .
Le thème du public et de son usage par Seselj commence ici d’apparaître. Or, c’était là un des points sur lesquels le tribunal montrait ses garanties libérales. Commençons par les attaques de Seselj contre « la prétention d’impartialité » du tribunal. Comme tou-jours, Seselj introduit ses actions par des jeux de déplacements triviaux. Dans la phase préparatoire au procès, il s’attaqua, comme on l’a vu, à la façon de se vêtir des juges, revenant à chaque audience sur ce point :
L’électrocardiogramme montre une certaine nervosité cardiaque due à mon sentiment de frustration et aux souffrances psychologiques que je subis lorsque je vois vos toges, Monsieur le Juge. J’insiste sur le fait que le juge devrait, au moins dans les procédures qui me concernent, porter des vêtements civils parce que cette espèce de travestissement catholique romain me porte sur les nerfs. J’ai perdu 18 kilos déjà en raison des frustrations psychologiques que je res-sens à cause de l’aspect de vos toges 37 .
[…] Vous devez comprendre que, quand je vois arriver les juges, le greffe, les conseils, je m’attends à être cuit dans un chaudron, à être tourné à la broche, à devoir subir toutes sortes de tortures de l’inquisition. Ces habits que vous portez, cela évoque chez moi des associations aux unités SS ou à la Gestapo. C’était la tenue de l’inquisition des SS et des membres de la Gestapo et de l’Église catholique. Je vous en prie, prenez une décision 38 .
36 . Audience du 27 septembre 2007. 37 . Audience du 29 octobre 2003. 38 . Audience du 17 février 2004.
E. CLAVERIE
22 Droit et Société 73/2009
Quelques jours après avoir plaidé non coupable, Seselj présenta une requête 39 de-mandant le dessaisissement des juges, arguant de leurs appartenances nationales : Schomburg parce qu’il était Allemand, et que les Allemands étaient des « ennemis héré-ditaires » des Serbes ; les juges Florence Mumba et Agius « parce qu’ils étaient catholi-ques », et que les catholiques étaient les ennemis invétérés des orthodoxes, lui Seselj étant un Serbe orthodoxe. Il insistait sur le fait qu’il considérait l’Église catholique coupable d’avoir « participé à la destruction de la Yougoslavie ». Seselj ajoutait que, l’Allemagne étant membre de l’Otan et le juge Schomburg Allemand, celui-ci ne pouvait être admis à entendre son affaire. La décision rendue par le « bureau » du Tribunal portait que « la nationalité ou la religion des juges ne sauraient avoir la moindre incidence sur leur capacité de connaître de manière impartiale des affaires dont ils sont saisis. Les poli-tiques menées par les autorités des États dont les juges du Tribunal sont ressortissants ne sauraient influer sur l’exercice de leurs fonctions judiciaires ». Cette affirmation se fondait sur « l ’engagement que les juges prennent, lors de leur prestation de serment, de remplir leurs devoirs en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience ». De même, continue la décision, « ils doivent faire abstraction de tous ces éléments d’identification vis-à-vis d’un accusé qui comparaîtrait devant eux. Leur capacité de le faire et de ne s’intéresser qu’aux éléments de preuve qui leur sont présentés lorsqu’ils sont amenés à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne accusée est un aspect fondamental du rôle qu’ils ont à jouer en leur qualité de juges. Telle est la règle au Tribunal pénal international pour la Yougoslavie ». La Cham-bre rejeta donc la demande pour abus de procédure 40 .
Il s’agissait donc pour Seselj de dénoncer, contre les justifications de « détachement libéral », les affiliations de facto en faisant apparaître un point d’asymétrie et les perspec-tives qu’il dévoile par le seul fait de se placer, lui, en position symétrique à celle de la Cour. Pour ce faire, il doit se placer en position symétrique à celle du juge : contrôler le rituel. Il ne cessera d’interrompre l’ordre procédural pour intervenir et déclarer sa loi. Sans cesse, le juge doit le contenir, le rabattre sur la procédure dont il a, lui, le contrôle et, pour cela, faire reconnaître sa position d’arbitre (accusation et défense sont les parties, je suis l’arbitre). Seselj aussitôt montre que le juge est partie, qu’il n’y a là qu’un tribu-nal solidaire et qu’il est seul face à lui, mais qu’il se battra, non pour lui-même mais pour défendre la cause du peuple serbe, injustement traité par ses ennemis, dont le tribunal.
III. « Outrage au Tribunal » Les crimes reprochés à l’accusé, nous l’avons dit, sont de notoriété publique. Toute-
fois, comme l’a rappelé le juge Antonetti, président de la Chambre, lors de l’audience de « reprise » du procès dont il avait désormais la charge après l’interruption de plusieurs mois due à la grève de la faim de Seselj 41 :
39 . Requête aux fins de dessaisissement du 21 mai 2003. 40 . Décision relative à la requête aux fins de dessaisissement du 10 juin 2003. 41 . Le procès de Seselj, le juge Agius étant président de la Chambre, commença le 27 novembre 2006, en l’absence de l’accusé qui, le 10 novembre, avait entamé une grève de la faim qui dura 28 jours, jusqu’au 8 décembre lorsque la chambre d’appel annula l’ouverture de la procédure et ordonna qu’un nouveau procès commence quand Seselj serait capable d’y participer en se représentant lui-même.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 23
M. Seselj a plaidé non coupable. Donc M. Seselj, à mes yeux, est présumé innocent et il in-combera à l’Accusation de prouver sa culpabilité. En tant que présumé innocent, l’accusé a des droits 42 .
Il donna alors son point de vue. L’essentiel de la responsabilité des retards accumu-lés dans cette affaire revenait à la Cour précédente et aux procureurs qui voulaient imposer à l’accusé soit un avocat sans restrictions, soit un avocat d’appoint (« stand by ») se contentant d’assister Seselj dans ses seules demandes ponctuelles. Comme juge de la chambre de première instance II, il avait déjà donné son opinion à cet égard :
Sur cette question fondamentale, j’avais été amené à émettre une opinion dissidente au terme de laquelle je reconnaissais à M. Seselj le droit de se défendre seul bien entendu, aidé par ses conseillers. J’y reviendrai par la suite. De ce fait, en ce qui le concerne, il ne sera jamais question pour moi d’imposer à M. Seselj un avocat et encore moins de nommer un ami de la Cour.
Décidant de prendre en considération, une fois pour toutes, le droit de l’accusé à se défendre seul, uniquement entouré d’assistants et de conseillers juridiques de son choix, Antonetti demanda dès l’audience de reprise du procès que des aménagements pratiques conséquents permettent à ce dispositif de défense de fonctionner. Il demanda que ces aménagements, d’ailleurs en cours de réalisation, soient définitivement mis en place sans interférence des mesures de restriction du greffe. Il précisa de quoi devait être fait ce dis-positif hors les murs. Sachant que le système de common law, qu’il déplore, demande que les enquêtes soient effectuées par chacune des parties 43 , il déclare que les assistants des accusés feront pour lui des enquêtes sur place auprès de témoins, en Bosnie, Croatie, et Serbie. Seselj devra donc disposer de certains moyens matériels imputables sur les finan-ces du tribunal. Il devra disposer, à côté de sa cellule, d’un bureau aménagé pour recevoir les milliers de pages de documents. Parmi ses quatre conseillers, tous membres de son parti et siégeant au Parlement à Belgrade, certains devront disposer d’un appartement permanent à La Haye, mis à leur disposition par le Tribunal. Vivant pour l’instant de leurs rémunérations de députés, une rémunération au moins égale devra leur être allouée pour qu’ils puissent s’établir à La Haye. Dans ce dispositif dessiné par le juge Antonet-ti, l’espace de déploiement des enquêtes (la Bosnie, la Serbie) est représenté comme neu-tre et accessible. Il n’est pas un lieu politique déchiré, en crise profonde, en proie à la violence de groupes de pressions divers, de mafias. L’accent est mis sur l’égalité des armes, au sens procédural, le lieu des enquêtes est une simple extension du tribunal. En ne jugeant pas, contrairement à l’ensemble de ses collègues, que Seselj adoptait un com-portement d’obstruction (défense abusive) mais « combattait pour ses droits » (défense légitime), le juge Antonetti se déterminait fortement au sein du Tribunal, et signifiait une position qui, dans les débats internes, prenait position pour un élargissement des droits à la défense dans la justice internationale :
42 . Audience du 13 mars 2007. C’est cette audience qui rouvre le « second procès ». Le juge Antonetti devient le président de la chambre qui devra juger l’affaire. Il a à ses côtés les juges Harhoff et Lattanzi. Le bureau du procureur est représenté par Dan Saxon et Ulrich Mussemeyer. 43 . Selon cette procédure, dite anglo-saxonne, de common law, il n’y a pas d’instruction centralisée menée à charge et à décharge par un juge d’instruction ; chacune des parties construit sa cause, mène ses enquêtes. La charge de la preuve, cependant, revient à l’Accusation.
E. CLAVERIE
24 Droit et Société 73/2009
J’estime que si on avait, dans le temps, résolu ces problèmes, nous n’en serions pas là, car nous sommes, dans toute l’histoire de la justice internationale, à un stade où, pour la première fois, un procès recommence quasiment à son début par la mise en état en raison de problèmes qui n’ont pas ou qui n’ont pu être réglés. La grève de la faim de l’accusé, qui heureusement s’est terminée courant décembre, va permettre de renouer le dialogue avec l’accusé entre les instances de ce Tribunal : Accusation, accusé ; Greffe, accusé, afin de permettre à l’accusé de se défendre le mieux possible, étant précisé qu’en droit, l’accusé est présumé innocent. Il y a quelque temps, le Président m’a demandé de prendre en charge cette affaire au niveau de la mise en état. Moi-même, je suis actuellement dans un procès en cours. Je siégeais ce matin. Je siège tous les jours, mais j’ai accepté dans l’intérêt général de prendre en charge ce dossier, es-timant que je peux renouer le dialogue et permettre le redémarrage de cette procédure qui, bien entendu, actuellement, recèle en elle-même toute une série de problèmes non résolus. La mise en état va nous permettre d’avancer et de permettre, tant à l’Accusation et à l’accusé, de se préparer le mieux possible. J’ai particulièrement présent à l’esprit le fait que l’accusé est à La Haye depuis plus de quatre ans. Depuis plus de quatre ans, l’accusé attend son procès.
Il marquait même une désapprobation publique contre l’accusation, décidant de prendre au sérieux ce qui, pour l’Accusation, n’était que comédie, chantage et abus :
Je compte également demander à l’Accusation de revoir un nombre de requêtes qu’ils ont adressées alors même que vous [Vojislav Seselj] étiez sur votre lit de douleur [grève de la faim], et nonobstant cela, ils ont continué à inonder la Chambre de requêtes.
Puis, s’adressant directement à Seselj : J’ai la nette impression, M. Seselj, que vous vous êtes trouvé face à un mur et que vous,
ayant l’impression de ne pas être entendu, la seule solution que vous aviez, c’était d’entamer une grève de la faim.
Et, revenant sur les demandes de récusation des juges, alors au nombre de douze : Je tiens à vous rappeler, Monsieur Seselj, qu’il faut faire confiance à ce Tribunal. Ce Tri-
bunal a rendu beaucoup de décisions. Quand vous regardez les décisions, vous vous apercevez qu’un certain nombre d’acquittements ont été rendus, et que même quand il y a eu des déclara-tions de culpabilité, dans un grand nombre de dossiers il y a eu des acquittements partiels. Ceci, c’est pour vous dire qu’il faut que vous soyez convaincu que le Tribunal est impartial, que je suis totalement indépendant, que je n’ai aucun parti pris à votre encontre et que j’examinerai tous les éléments du dossier. Bien entendu, vous pouvez toujours me récuser, mais à ce moment-là, ce sera à mon vif étonnement, car je ne comprendrai pas pourquoi vous entamez la récusa-tion d’un treizième juge, etc.
Un Seselj victime du procureur et du greffier (plutôt que des complots de l’Otan) commençait à se dessiner. Désormais, la qualification de défense d’obstruction avancée par l’Accusation tout au long de ses multiples requêtes demandant que l’on impose un avocat à l’accusé, et souvent soutenue par ses co-juges, ne sera plus retenue par le juge Antonetti, président de l’affaire. Celui-ci défendra au contraire, au nom des idéaux de la Justice internationale et de ses critères élevés d’objectivité, la nécessité d’un procès « defendant-oriented » 44 . Deux camps allaient désormais s’opposer : l’un, composé des membres du bureau du procureur, l’accusation, mais souvent aussi des propres co-juges du juge-président ; dans l’autre, le juge-président Antonetti. Au milieu, les témoins, souvent des témoins-victimes, dont on constate à la lecture des verbatim d’audience, qu’ils ont souvent fait les frais de cet affrontement. Au TPIY, à défaut de pouvoir se porter
44 . Larry MAY, Crimes Against Humanity : A Normative Account, Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 25
partie civile, les témoins, en général, et les témoins-victimes en particulier, sont considé-rés comme ceux qui, grâce à leurs dépositions, contribuent en première ligne à énoncer la vérité des faits 45 . Ceci au terme d’une épreuve : leur interrogatoire par l’Accusation suivi de leur contre-interrogatoire par la Défense (dans le cas des témoins à charge), ici l’accusé – c’est-à-dire, un des responsables de ce qu’ils ont subi. Dans le cas de ce pro-cès, les victimes sont alors (à nouveau) confrontés à leur persécuteur, sans intermédiaires. Ils sont confrontés à sa violence, contraints de se plier à ses façons de contre-interroger. Les questions de Seselj aux témoins, en effet, sont souvent très agressives, émaillées de détails de police, vrais ou faux, jetés à la face des témoins, détails obtenus par les enquê-teurs locaux de Seselj. Il devient d’ailleurs impossible de trouver encore des témoins qui acceptent de témoigner dans ce procès, d’ailleurs suspendu, on l’a dit. Plusieurs té-moins-experts se plaignirent, comme ici Yves Tomic 46 , sociologue politique, membre d’une société savante, l’Association française d’études sur les Balkans :
J’ai été sollicité en mai 2004 par le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie afin de rédiger un rapport sur l’idéologie de la Grande Serbie, ainsi que sur les idées politiques de Vojislav Seselj, président du Parti radical serbe (SRS). […] Avant mon apparition devant la Cour du TPIY le 29 janvier 2008, Vojislav Seselj aura tout fait pour que mon rapport ne soit pas validé et que je ne témoigne pas en qualité d’expert témoin. […] Bien entendu, « l’Association française d’études sur les Balkans » n’est pas un parti politique menant des « activités politiques destructrices ». Elle n’est pas non plus un think-tank et ne formule pas, par conséquent, de recommandations à destination des décideurs 47 .
On a aussi cet échange entre l’accusé, un témoin à charge, le juge Antonetti et un membre du bureau du procureur (Mme Biersay). Cette scène d’audience permettra de mieux sentir l’ambiance et le type de propos échangés. La scène se situe dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Lors de l’audience précédente, le témoin avait expliqué comment, alors qu’il s’apprêtait à jeter une grenade dans le bar où des « hommes de Seselj » s’étaient réunis pour préparer l’attaque de Bijeljina, leur chef, Blagojevic, lui avait tiré dessus, le blessant à la jambe. Il est maintenant contre-interrogé sur ces faits par Seselj qui conteste la véracité de la scène en employant ses arguments habituels. On observera que le témoin, quant à lui, tutoie Seselj pour indiquer qu’il est ici, enfin, à égalité avec lui, qu’ils sont « entre hommes », qu’il peut enfin lui dire son fait, l’interpeller sans (trop) de danger :
– L’accusé [s’adressant au témoin] : Est-ce que vous connaissez Marko Blagojevic ? Tous les [imperceptible] savent très bien manier les pistolets, tout ça. Moi aussi, je suis un excellent ti-reur. Vous trouvez peut-être ça drôle étant donné que je porte des lunettes mais je suis très bon, moi aussi. Mais est-ce que vous saviez que Mirko Blagojevic était un excellent tireur en ex-Yougoslavie, l’un des meilleurs tireurs en ex-Yougoslavie ? – Le témoin : Non, je ne le sais pas. – L’accusé : Est-ce que vous saviez que… – Le témoin : C’était le meilleur parce que c’est le tien, c’est ton homme à toi, c’est pour ça que tu le dis.
45 . Sur ce point, voir Elisabeth CLAVERIE, « Les victimes saisies par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », in Sandrine LEFRANC (dir.), Après le conflit, la réconciliation ?, Paris : Michel Houdiard, 2006. 46 . Voir, par exemple, Yves TOMIC, « La Ligue des communistes de Serbie et l’ouverture de la question nationale serbe : 1977-1987 » , Balkanologie, III (1), juillet 1999. 47 . http://ytomic.blogspot.com/2008/02/lassistant-tomic-et-le-docteur-seselj.html (consulté le 10 mars 2009).
E. CLAVERIE
26 Droit et Société 73/2009
– L’accusé : Oui, oui, c’est un de mes meilleurs hommes à Bijeljina, voilà. Est-ce que vous savez que, quelques mois plus tard, après avoir appris cet événement, j’ai critiqué Mirko Blagojevic car, lorsqu’il vous a vu galoper sur ce cheval, qu’il vous a tiré dans la jambe, parce qu’il aurait pu risquer de blesser le cheval aussi, je lui ai dit qu’il aurait dû vous tirer à la tête. – Le témoin : [aucune interprétation] – Mme Biersay [bureau du procureur] : Objection, Monsieur le Président. M. Seselj, je dirais ceci n’a pas sa place dans ce prétoire. – L’accusé : C’est un fait. Ce n’est pas du tout inapproprié. S’il est nécessaire, j’appellerai Mir-ko Blagojevic en tant que témoin dans ce procès. Il viendra dire tout ce qu’il faut dire. Mais c’est un fait, je l’avais critiqué. – Le témoin : [aucune interprétation] – Mme Biersay [bureau du procureur] : Nous considérons que c’est un peu comme une menace, et ce n’est pas approprié ici dans ce prétoire. Cela ne devra pas être toléré. – M. le juge Antonetti : Madame Biersay, je ne comprends pas très bien votre objection. M. Se-selj reconnaît qu’il avait un rapport avec M. Blagojevic, un. Deuxièmement, il nous dit que, deux mois après, il a critiqué Blagojevic, lui reprochant de ne pas l’avoir tué, lui. Voilà, qu’est-ce que vous voulez dire ? – L’accusé : Voilà, c’est un aveu. C’est un aveu de ma part, Monsieur le Président. Mais je crois qu’il aurait dû tuer l’homme qui se lance sur lui avec une grenade à main, non pas tirer à la jambe et risquer de tuer le cheval. C’est une réaction tout à fait normale. Ça aurait été une dé-fense, autodéfense 48 .
Le 11 février 2009, le procès était ajourné à nouveau sur décision de la Chambre de première instance III, l’Accusation ayant fait une requête orale en ce sens, lors de l’audience du 15 janvier 2009. Il s’avérait, en effet, que nombre de témoins à charge ne voulaient plus se présenter à la barre, se plaignant d’avoir été menacés et intimidés par « les enquêteurs » de Seselj. Le juge Antonetti prononça, là encore, une opinion dissi-dente en faveur des arguments de Seselj. Il avait déjà déclaré les semaines précédentes qu’il ne voulait pas, pour conserver son impartialité, être partie dans le procès intenté à l’accusé pour outrage à la Cour, arguant que s’il s’avérait que Seselj faisait intimider les témoins, il ne pourrait plus être impartial dans la conduite du procès principal.
Il m’apparaît que je ne pourrais juger sereinement l’accusé Seselj dans le dossier principal si j’ai la conviction qu’il a participé à une entreprise de menace et d’intimidation de témoins, et qu’ainsi je pourrais avoir un préjugé sur sa responsabilité pénale dans le dossier principal. Ce lien potentiel entre le dossier principal et les dossiers annexes d’outrage à la cour concernant le même accusé Seselj m’empêchent donc de traiter en toute impartialité les dossiers d’outrage à la cour reprochés à l’accusé. Pour cette raison, j’ai informé dernièrement le président du Tribu-nal de ma décision personnelle de me récuser des dossiers d’outrage à la cour et je lui ai de-mandé de désigner un autre juge pour siéger à ma place. Je tiens à préciser qu’à ce jour mes collègues, les juges Harhoff et Lattanzi, n’ont pas fait, en ce qui les concerne, la même démar-che.
Le juge Antonetti continua de lutter pour établir ce qu’il considérait être un meilleur équilibre entre Accusation et Défense. Ceci jusqu’à ce que le procès soit entièrement bloqué, ajourné sine die. Il exigea que soit donné à Seselj la traduction en serbe du moin-dre élément (existant déjà en croate par exemple - la même langue-), tenta d’obtenir d’autres méthodes de travail du bureau du procureur afin d’aider Seselj dans sa possibili-té de se défendre : il exigea du procureur qu’il rationalise les méthodes de présentation
48 . Audience du 4 mars 2009.
Bonne foi et bon droit d’un génocidaire
Droit et Société 73/2009 27
des preuves à charge. Il admonesta celui-ci aux fins d’obtenir une meilleure communica-tion des pièces de l’Accusation à la Défense, notamment les dépositions, un meilleur classement de l’ordre de passage des témoins à l’audience, demandant que les témoigna-ges apparaissent au procès selon leurs types (témoins victimes, témoins experts), mais aussi selon leur mode d’expression, orale ou écrite 49 , selon les lieux du crime (par muni-cipalités), de façon à ce que l’accusé puisse mieux structurer sa défense, enquêter plus facilement sur les témoins et les contrecarrer. Antonetti tenait en effet que si Seselj mani-festait un comportement d’obstruction, c’était pour protester contre le déni de ses droits. Seselj parvint donc à diviser la Cour et à l’obliger à se poser la question de la relation entre défense légitime et défense d’obstruction.
Après deux suspensions, un ajournement, la récusation de plusieurs juges, le départ de plusieurs membres du bureau du procureur, les plaintes pour « menaces » de plusieurs témoins, une procédure d’outrage, une grève de la faim, le procès, apprend-on fin novem-bre 2009, devrait reprendre le 12 janvier 2010. On apprend aussi, par ce même communi-qué de la Chambre, que l’ajournement de l’audition des témoins étant levé, les six der-niers témoins qui doivent encore être entendus « ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient plus témoigner en faveur de l’Accusation, mais de la Défense ». Devant cet étrange revi-rement, une décision a été prise : ces témoins ne seront pas interrogés par les parties, mais par la Chambre (les juges). Par ailleurs, et bien que la procédure d’outrage ait montré que Seselj avait divulgué le nom de témoins protégés, il ne lui sera pas, malgré les demandes insistantes du procureur, imposé un avocat. On lui demandera cependant de livrer désor-mais copie de ses œuvres pour vérifier qu’elles ne contiennent plus les noms des témoins protégés.
Conclusion Nous avons essayé de montrer ici quelques-unes des tensions qui parcourent, au-
jourd’hui, une institution pénale internationale comme le TPIY, mais sans doute aussi d’autres Cours qui prennent sa suite. Malgré l’immense travail accompli dans ce véritable laboratoire du droit, la jurisprudence accumulée dans un nombre considérable de domai-nes, on le voit, la mission du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie est parfois mise à rude épreuve et très près de ne pouvoir être conclue. A travers la question immédiate de la défense de Seselj par lui-même, il semble qu’on peut pointer quelques-unes des difficultés rencontrées par ce tribunal. Car, au fond, que juge-t-il ? Que veut-il pointer quand il désigne le responsable individuel, à tel ou tel titre, de massacres et de crimes de masse ? Comment parvient-il à désigner et qualifier les aspects politiques et collectifs du crime ? Comment assure-t-il le lien entre responsabilité individuelle et responsabilité collective (au pénal) ? A quoi renvoie l’expression « responsabilité collective » ? à une organisation ? à un régime politique ? à un Etat ? au travail de pro-pagande suivi d’acquiescements « actifs » d’une partie de la population ? Comment enquêter dans des Etats où les criminels de guerre sont des héros ? Que rétorquer à Seselj quand il déclare qu’il n’y a pas d’acquittements de Serbes si la politique des poursuites
49 . Les témoins peuvent témoigner viva voce, ou selon l’article 92ter : ils sont alors interrogés d’après leur décla-ration écrite antérieure. Seselj refusa toujours de contre-interroger ces derniers.
E. CLAVERIE
28 Droit et Société 73/2009
du tribunal ne vise pas délibérément à désigner des responsabilités politiques hiérarchi-sées dans cette guerre, et à désigner, en effet, un agresseur principal et l’organisation mise à son service ? Cela sans omettre les autres responsabilités politiques, ni les penser seulement en termes d’arbitrages diplomatiques d’un quota entre ethnies, quota qui implique une équivalence entre les parties au conflit ? Sans doute manque-t-il à ce tribu-nal quelques supports juridiques (comme le crime contre la paix et/ou le crime d’agression). Enfin, comment juger quand la place de l’accusé est vide, comme ce fut le cas dans le procès Seselj ? Comment comprendre que les agissements de Seselj dans le prétoire, qui ne pourraient avoir lieu dans aucune autre arène sociale, soient ici possi-bles ? Au nom de quelle politique des rapports symétrie/asymétrie ? Comment expliciter cette relation politico-judiciaire ? Comment et sur quoi est-elle fondée ? Sur ce point, au plan le plus pratique, une leçon semble avoir été retenue dans ce tribunal en constante capacité d’autocritique : Radovan Karadic, dont le procès vient de commencer (octo-bre 2009), mais qui ne s’est pas présenté à ses premières audiences, vient de se voir impo-ser un avocat. Cette fois, le même n’est plus à la fois l’accusé et le défenseur.
L’auteur
Anthropologue, Élisabeth Claverie est directrice de recherche au CNRS (Groupe de sociologie politique et morale, EHESS, Paris). Outre plusieurs recherches sur la « forme affaire » inventée par Voltaire, elle a travaillé sur un site politico-religieux en Yougoslavie. Ses travaux actuels portent sur la violence de guerre dans ce même pays et sur le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Parmi ses publications récentes : – « Religion et politique », Terrain, 51, 2008 ; – « Les victimes saisies par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie », in Sandrine LEFRANC (dir.), Après le conflit, la réconciliation ?, Paris : Michel Houdiard, 2006, p. 152-172 ; – « Techniques de la menace », Terrain, 45, 2004, p. 15-30 ; – Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions, Paris : Gallimard, 2003.






























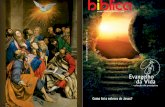













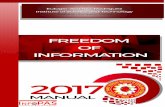
![“Bon pour l’Orient”: Fuat Dündar’ın Kitabını Deşifre Ederken [Bon pour l’Orient: Desciphering Fuat Dündar's book], Tarih ve Toplum - Yeni Yaklaşımlar. Bahar 2009](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315106bfc260b71020fd545/bon-pour-lorient-fuat-duendarin-kitabini-desifre-ederken-bon-pour.jpg)



