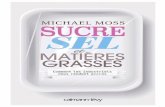Thèse_table des matières
Transcript of Thèse_table des matières
1
AUTOUR DE L’ÎLE D’EZO
EVOLUTION DES RAPPORTS DE DOMINATION SEPTENTRIONALE
ET DES RELATIONS AVEC L’ÉTRANGER DES ORIGINES AU 19ème
SIÉCLE
2
I. UNE LOGIQUE ANCIENNE DE RAPPORTS DE DOMINATION
PLURISÉCULAIRES DANS LE SEPTENTRION JAPONAIS, DÉFINIS PAR UNE
VISION PARADIGMATIQUE D’OPPOSITION ENTRE BARBARES ET
CIVILISÉS
1. Le septentrion japonais depuis la préhistoire
a. Une unité culturelle à l’époque Jômon
b. Une première rupture culturelle : les cultures Yayoi et du Jômon prolongé
c. Les cultures de Satsumon et d’Okhotsk : des cultures septentrionales intégrées à un
dense réseau d’échanges
d. Des cultures proto-aïnoues
2. La naissance de la frontière et l’émergence de la vision paradigmatique d’une
opposition entre barbares et civilisés
a. La « frontière » : une expérience vécue plus qu’une délimitation territoriale ou
topographique
b. L’opposition entre centre et périphérie : la mise en place d’une vision dichotomique
entre barbare et civilisé
c. Barbares et civilisés au Japon
d. Les « barbares de l’Est » du Japon : les Emishi
i. L’hypothèse des « Emishi-Aïnou »
ii. L’hypothèse des « peuples périphériques »
iii. L’hypothèse « de la triple vague »
iv. L’hypothèse « créole »
e. Des barbares à soumettre
3. Un antagonisme grandissant entre l’État central japonais et les Emishi : la soumission
des « confins des terres »
a. Des places fortes et des colons
b. Des gouverneurs et des tributs
c. Les campagnes de soumission et de représailles
d. L’intégration du Mutsu et du Dewa au territoire japonais
4. Asseoir la domination japonaise du septentrion : nouveaux enjeux, nouveaux acteurs,
nouvelles altérités régionales
a. De nouveaux enjeux dans le contrôle du nord
i. Se protéger de l’impur
ii. Les enjeux commerciaux
iii. Les enjeux politiques : les guerres des clans sur fond de guerre civile
b. L’avènement de la culture aïnoue
i. La fin des cultures d’Okhotsk et de Tobinitai au profit des hommes de Satsumon
ii. Les hommes de Satsumon deviennent les Aïnous
iii. Une première transition nominative : les Emishi deviennent des Ezo
3
iv. Watarishima devient Ezogashima
v. Une transition technique : le métissage culturel entre Okhotsk et Satsumon, et
technique avec le Japon
vi. Une transition identitaire face aux altérités régionales
vii. Une transition culturelle liée au commerce avec le Japon
c. La culture et la société aïnoues
i. Les kamui
ii. Le kotan
iii. La hiérarchie
d. Des partenaires commerciaux
i. Le Texte du rouleau peint de la divinité de Suwa de 1356
ii. Les produits du commerce septentrional
iii. Un commerce qui attise les convoitises
e. Les guerres aïnoues : de la nécessité de définir les rapports entre Japon et Ezo, et
d’établir un type d’autorité nouveau dans le nord
i. Un embryon de découpage administratif japonais à l’extrême sud de l’île
ii. La guerre de Kosham’ain (1457-1458)
iii. La guerre de Shoya et Kôji (1512-1515)
iv. Les conflits de Tanasakashi (1528-1529) et Tarikona (1536)
v. Les conséquences des conflits : vers l’établissement du fief de Matsumae
II. LE TEMPS DES SYSTÈMES : L’ÉCLATEMENT DES CENTRES ET LA MISE
EN PLACE DE DÉPENDANCES CROISÉES : COMMERCE ET SOUMISSION
DANS LE MINI-SYSTÈME MATSUMAE-EZO-PACIFIQUE
1. Un nouvel ordre japonais dans un nouvel ordre mondial : le système bicéphale
shogunal-domanial et sa politique d’isolement partiel dans un contexte de mondialisation
archaïque et d’émergence du système-monde moderne
a. Les institutions du shogunat Tokugawa
i. L’influence du néoconfucianisme – une économie physiocratique, une hiérarchie
sociale fixe
ii. Une autorité bicéphale – un shogunat suzerain, mais aussi « super-daimyô »
iii. Une autorité bicéphale – des fiefs vassaux, mais souverains
b. Un monde qui rétrécit – la nécessité de mettre en place un référentiel paradigmatique
nippo-centré
i. A la recherche de nouveaux eldorados - la naissance de l’économie-monde et de la
mondialisation archaïque
ii. Trouver l’Eldorado – à la recherche d’Ezo
iii. Le tournant de la mission de Vries et Schaep (1643)
iv. Cartographier l’humanité – l’essor des mappa mundi
v. Ezo – une énigme cartographique
vi. Trouver et marquer sa place en Asie, dans le monde et dans le cosmos
c. La mise en place d’un cadre de régulations des relations avec l’Asie et l’Europe : les
interdictions maritimes et la politique du sakoku
4
i. Les origines de la fermeture du Japon : préférer la physiocratie, le bullionisme et
la substitution à l’importation au mercantilisme face à une nouvelle réalité
économique
ii. Les origines de la fermeture du Japon : une restructuration des relations étrangères
en Asie
iii. Le verrouillage partiel du pays : la mise en place politique du nihongata
ka.ichitsujo
iv. Le Japon vu de l’Europe : la naissance du mythe du « sakoku »
2. L’éclatement des centres : le fief de Matsumae dans le système shogunal-domanial
a. La mise en place du fief de Matsumae– l’officialisation de la domination septentrionale
i. L’émancipation du clan Kakizaki (Matsumae) vis-à-vis de la suzeraineté des
Andô
ii. Diplomatie, stratégie et expansion territoriale : la reconnaissance de l’autorité
Kakizaki sur l’île
iii. L’avènement des Matsumae et de la relation triangulaire shogunat-Matsumae-
Aïnous
b. Un « invité vêtu de brocart » – les entorses de Matsumae au système shogunal-domanial
i. Une structure domaniale conventionnelle
ii. Une entorse au « système de résidence alternée »
iii. Des pratiques diplomatiques bien rodées
iv. Une relative facilité de mouvement
v. Une autorisation à déployer ses troupes
vi. L’absence de riziculture et la non-application du kokudaka
vii. « Matsumae n’est pas le Japon »
3. Les relations nippo-aïnoues – un système complexe de dépendances croisées
shogunat-fief de Matsumae-Aïnous
a. Un héritage médiéval : le « commerce sous le château »
i. Les origines du développement commercial
ii. Commerce et politique : l’origine des uimam
iii. Un commerce de luxe – la prépondérance des karumono
b. Une évolution mercantiliste : l’avènement des « guerriers marchands »
i. Les modalités commerciales – le « système des comptoirs de commerce alloués »
ii. Une évolution vers le commerce de masse - Vers une prépondérance des
tawaramono
c. L’ambivalence des rapports nippo-aïnous et des dépendances croisées à la lumière des
sources aïnoues, les yukar
i. Retour sur le concept et l’historiographie
ii. Structure et types de yukar
iii. La présence japonaise dans les yukar – indirecte via les objets de commerce
iv. Les Japonais, acteurs des yukar
v. Une exception : un Japonais narrateur des yukar
vi. La présence étrangère dans les yukar
5
4. Les conséquences des dépendances croisées : déséquilibres inter- et intra-ethniques
a. L’intrusion grandissante des Japonais en territoire aïnou et ses conséquences
écologiques et environnementales
i. Des frontières domaniales fluctuantes et changeantes
ii. Chercher de l’or à Ezo
iii. Chasser le faucon à Ezo
iv. Pêcher à Ezo
b. Une balance commerciale déséquilibrée : la détérioration des rapports commerciaux
nippo-aïnous
c. Les changements dans la société aïnoue :
i. L’évolution du rapport à l’animal – la dé-ritualisation de la chasse et de la pêche
et la recherche d’ « animaux d’entreprise »
ii. Les conséquences sur les modes de subsistance aïnous
d. Des conflits intra-ethniques, dus à la concurrence pour les ressources rendue nécessaire
par la présence japonaise
5. Le tournant de la guerre de Shakush’ain : la sakoku-isation de Hokkaidô, la
détérioration des rapports nippo-aïnous et le tournant mercantiliste, proto-industriel et
proto-capitaliste de Hokkaidô
a. Le conflit
i. Les prémisses : les conflits intra-ethniques
ii. Les prémisses : les conflits intra-ethniques
iii. Le conflit intra-ethnique se mue en conflit interethnique
iv. Les partis non-interventionnistes
v. L’intervention extra-domaniale
vi. La mort de Shakush’ain et la fin du conflit
b. De nouveaux moyens de domination septentrionale : séparer pour mieux surveiller et
soumettre
i. La mise en place de frontières tangibles : la sakoku-isation de Hokkaidô et du
territoire aïnou
ii. Une soumission officielle : le Serment en sept points
iii. Les uimam : la mise en scène de l’altérité aïnoue comme justification de la
domination
6
III. LE TEMPS DES ENJEUX ÉCONOMIQUES (FIN 17EME
– MI 18EME
SIECLE) :
DOMINATION, EXPANSION, MULTIPLICATION DES ACTEURS RÉGIONAUX
ET DÉVELOPPEMENT
1. Pallier les difficultés financières shogunales : l’émergence des « traités d’ouverture »
- Le septentrion comme territoire à défricher, solution à des problématiques économiques
nationales
a. Les finances shogunales jusqu’au milieu du 18ème
siècle :
b. L’apparition du septentrion dans les réflexions économiques
c. Les richesses potentielles de l’île d’Ezo : riz, territoire et or
i. Satô Nobukage 佐藤信景 (1674-1732) : les traités pour l’ouverture, une histoire de
famille ?
ii. Namikawa Tenmin並河天民– La recherche du profit économique, inspirée par le
modèle chinois
iii. Ara.i Hakuseki 新井白石 – le compilateur érudit
iv. Sakakura Genjirô 坂倉源次郎 – le premier envoyé spécial shogunal pour
l’exploitation aurifère
2. Une reconversion rendue nécessaire par la guerre de Shakush’ain : une nécessité de
diversifier ses activités et d’augmenter ses liquidités
a. Les origines du système des basho : conséquence d’une transition économique,
démographique, technique et agricole
i. Une reconversion rendue nécessaire par la guerre de Shakush’ain : une nécessité
de diversifier ses activités et d’augmenter ses liquidités
ii. La mise en place de la sylviculture en territoire japonais
iii. Les conséquences d’une évolution économique shogunale : la priorité aux
tawaramono pour faire face à une demande quasi-industrielle
iv. Les conséquences d’une évolution technique et démographique au Japon : une
demande accrue en farine de hareng
v. La transition entre « système de comptoirs de commerce alloués » et « système de
lieux d’entreprise contractuels »
b. Le fonctionnement effectif et logistique d’un basho
i. Les contrats
ii. Le fonctionnement
iii. Les marchandises
c. Conséquences
i. L’insignifiance grandissante du fief dans le système des basho
ii. Les conséquences sur la population aïnoue : une double soumission domaniale et
vis-à-vis des basho
iii. La cérémonie d’umsa – la matérialisation de la transition entre barbares et main
d’œuvre
d. Les basho : éléments de transition proto-industrielle, proto-capitaliste et proto-
colonialiste ?
7
3. Les origines économiques de la présence russe en Extrême-Orient
a. Réseaux et tensions commerciaux
i. Le commerce de Santan
ii. A la recherche de l’ « or doux » : l’expansion russe en Extrême-Orient
iii. Les conflits territoriaux sino-russes
b. La volonté russe d’instaurer un commerce avec le Japon
i. Les conséquences du Traité de Nertchinsk
ii. L’expansion russe dans le Kamtchatka
iii. Ambassadeur malgré lui, le naufragé Dembei à la Cour du tsar
iv. L’exploration des Kouriles par les Russes
v. L’intérêt russe pour leur nouveau voisin japonais
vi. Les naufragés Sôza et Gonza
c. La rencontre entre la Moscovie et le Japon
i. L’expédition Spanberg et Walton
ii. Des colonies russes dans les Kouriles
iii. Les naufragés du Taga-maru
iv. Les origines des tensions russo-aïnoues et l’absence de réaction shogunale
v. Incursions et tensions
IV. LE TEMPS DES ENJEUX STRATÉGIQUES (DES MENACES ?) :
L’ÉMERGENCE DE LA MENACE RUSSE ET DES TRAITÉS D’OUVERTURE ET
DE DÉFENSE MARITIME (KAIBÔRON海防論)
1. Le tournant de 1771 : le coup de semonce de Beniowski
a. Point historiographique
b. Beniowski, le comte qui criait aux Russes
c. Les Mémoires de Beniowski
d. Le périple de Beniowski
e. Les Kouriles de Beniowski
f. Beniowski au Japon
g. L’avertissement de Beniowski
2. Les conséquences du passage de Beniowski : le début des rivalités européennes dans
le Pacifique nord
a. Une absence de réaction shogunale
b. La réaction russe : la mission Shabalin
c. Le regard russe se tourne vers les Aléoutiennes
d. Les autres réactions européennes : « D’incalculables avantages à l’initiative d’un
gouvernement audacieux »
e. Le Voyage de La Pérouse
3. Le contexte d’émergence des traités d’ouverture et de défense : l’époque de Tanuma
8
a. Contexte économique de l’arrivée au pouvoir de Tanuma Okitsugu
i. Tanuma Okitsugu, personnage controversé de l’histoire japonaise
ii. L’ascension au pouvoir de Tanuma
iii. Des difficultés financières et des catastrophes naturelles
iv. Les mesures innovantes de Tanuma
v. Une politique controversée
b. Un contexte d’essor intellectuel et de remise en cause des piliers du confucianisme
i. Une goutte d’huile dans un étang : la transition des « études barbares » (bangaku
蛮学) aux « études hollandaises » (rangaku 蘭学) et le rôle grandissant des
« spécialistes des études hollandaises » dans les réflexions menées sur les
relations avec l’étranger
ii. Une réaction immédiate de la part des traducteurs et des lettrés : Hirasawa
Kyokuzan平沢旭山 et Yoshio Kôgyû吉雄耕牛
iii. Au nord, rien de nouveau : l’état d’Ezo en 1781 vu par Matsumae Hironaga
4. La naissance des traités de géographie : les partisans de l’ouverture (積極論者) et les
hommes qui « brisèrent le rêve du sakoku »
a. Hayashi Shihei 林子平, le « consultant free-lance » : « Un pays prospère, une armée
forte » par la préparation et l’anticipation
i. Une loyauté indéfectible vis-à-vis du fief de Sendai
ii. La Première Opinion écrite (Dai.ichi jôsho第一上書) de 1765
iii. De multiples rencontres
iv. Les Réflexions sur la stèle des distances (坪碑考 Tsubo no ishibumi kô)
v. La Deuxième Opinion écrite (Daini jôsho 第二上書)
vi. Le Panorama illustré des Trois Royaumes (Sangoku tsûran zusetsu三国通覧図説)
de 1785
b. Kudô Heisuke : celui qui fit bouger le shogunat (幕府を動かした人物1)
i. Les réseaux de la « famille des médecins du fief de Sendai » et des « spécialistes
en études hollandaises »
ii. Les Réflexions sur les rumeurs concernant la Russie (Akaezo fûsetsu kô 赤蝦夷風
説考)
V. LE TEMPS DE LA RÉFLEXION : LES MISSIONS D’EXPLORATION 1783-
1786
1. Le temps de l’investigation : les missions d’exploration 1783-1786
a. La mission de Hezutsu Tôsaku平秩東作
b. L’expédition de l’ère Tenmei
i. L’équipe orientale
ii. L’équipe occidentale
iii. Le rapport de Satô Genrokurô 佐藤玄六郎
iv. Conséquences de l’expédition
1 KÔNO Tsunekichi, « Aka-ezo fûsetsu kô no chosha Kudô Heisuke » (L’auteur des Réflexions à propos des
rumeurs concernant la Russie), Shigaku zasshi, volume 26, n°5, p.607
9
c. Un changement de contexte politique : la chute de Tanuma et l’arrivée au pouvoir de
Matsudaira Sadanobu
i. La chute de Tanuma
ii. Matsudaira Sadanobu et les Réformes de l’ère Kansei
iii. Une mission shogunale sous Matsudaira : Furukawa Koshoken « cent paroles ne
valent pas un regard » (百聞は一見に及ばず)
2. Le soulèvement de Kunashiri-Menashi
a. Le contexte régional
b. Le contexte local : la mainmise des Hidaya sur le nord-est de l’île
c. Tensions et famines
d. Les évènements
e. Les réactions shogunale et domaniale
f. Les conséquences concrètes
3. Le temps de la réflexion : immobilisme ou changement ?
a. Deux politiques shogunales possibles :
i. Une possible prise en charge shogunale partielle
ii. Une politique de maintien du statu quo – « Combattre le barbare par le barbare »
iii. Une surveillance et une bienveillance accrues
b. Le pragmatisme marchand de Naka.i Chikuzan
i. Préserver l’utile, se débarrasser du superflu : tout l’or du monde ne vaut pas du riz
ii. La gestion septentrionale : assainissement des relations nippo-aïnoues et mise en
valeur des ressources utiles au peuple
iii. Une histoire de famille : les origines d’une théorie du pare-feu, développée par
Naka.i Riken
c. Le changement radical : Honda Toshiaki et Mogami Tokunai
i. Le professeur barbare du nord » (北夷先生 hoku-i sensei)
ii. Une argumentation logique et mathématique imparable, mâtinée d’une admiration
pour l’Occident
iii. Des inspirations croisées : les Notes sur Ezo (Ezo sôshi 蝦夷草紙) de Mogami
Tokunai
iv. La Situation actuelle chez les barbares rouges (赤夷動静 Seki.i dôsei)
4. Le temps de l’action : le tournant de 1791-1792
a. Le Traité de Défense d’un pays maritime 海国兵談 (Kaikoku heidan) (1785)
i. Un contenu novateur
ii. Un contenu explosif
iii. Un très mauvais timing : les mesures défensives de Matsudaira et la réception du
Traité
b. L’Opinion écrite relative au développement d’Ezo (Ezo kaihatsu ni kansuru jôsho 蝦夷
開發に關する上書)
10
VI. LE TEMPS DE L’ACTION : L’OUVERTURE
1. La rencontre avec Laxman
a. La fabuleuse histoire de Daikokuya Kôdayû et d’Isokichi, ambassadeurs malgré eux :
b. La réaction shogunale
c. Le face-à-face
d. Les conséquences du côté russe
2. Le durcissement des positions : l’émergence d’une volonté de rejeter les barbares
a. Un envoyé spécial malgré lui : le parcours atypique d’Ôhara Sakingo
b. Les Humbles paroles concernant les terres du nord (Chihoku gûdan 地北寓談) – la
sérénité à travers « un pays prospère et une armée forte » (富国強兵)
c. De nouvelles menaces : le premier passage de Broughton
d. L’Avertissement concernant les terres du nord (北地危言 Hokuchi kigen)
e. Vers les concepts de fukoku kyôhei, jô.i et le rôle grandissant de l’Ecole de Mito
f. Le retour de Broughton
3. L’émergence du courant d’abandon du modèle asiatique au profit du modèle européen,
la création de la figure paternelle du souverain et la proposition de mesures coloniales dans
les écrits de Honda Toshiaki
a. Les Contes d’Occident (Sei.iki monogatari 西域物語) – l’expansionnisme septentrional
selon Honda
b. Les Mesures secrètes pour gouverner (Keisei hisaku 経世秘策)
4. Intégrer Ezo
a. « Itouroup, grand empire japonais » (Dai Nippon Etorofu 大日本恵土呂府 ) -
l’expédition de 1798
b. Une décision pour contrer la bienveillance russe à l’égard des Aïnous
c. Gommer le barbare, respecter l’autochtone - les mesures concrètes envers les Aïnous