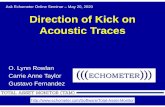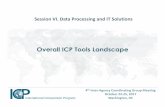Sur les traces de l'or monnayé ; recherche de provenance par LA-ICP-MS
Transcript of Sur les traces de l'or monnayé ; recherche de provenance par LA-ICP-MS
Revue d'Archéomètrie, 20, 1996, p. 23-32.
SUR LES TRACES DE L'OR MONNAYE: RECHERCHE DE PROVENANCES PAR LA-ICP-MS
Alexandra GONDONNEA U* Maria Filoména GUERRA * et Jean-Noël BARRANDON*
Résumé: Les problématiques concernant l'étude de provenance de l'or monnayé sont abordées au moyen des techniques classiques ainsi que par la méthode de spectrométrie de masse à plasma inductif couplée à une ablation laser. Après la mise au point des paramètres d'analyse pour un nouveau laser de type UV, nous abordons les questions telles la reproductibilité de l'analyse et les limites de détection. Puis, nous exposons les avantages de cette méthode par rapport à 1' activation protonique pour la caractérisation de l'or.
Pour estimer les possibilités de la technique LA-ICP-MS permettant de différencier des ors d'origines diverses, nous présentons les premiers résultats de son application à l'étude de l'or monnayé au XVHIème siècle en Europe ainsi qu'aux imitations gauloises du statère à l'effigie de Philippe II de Macédoine. Abstract: The problems concerning the study of the provenance of minted gold using classical analytical
as well as the inductively coupled plasma mass spectrometry technique associated to a laser ablation are discussed. After the choice of the parameters for a new laser of UV type, we consider questions like the reproducibility of the analysis and the limits of detection as well as the advantages of this technique compared to proton activation analysis.
The first results on the application of the LA-ICP-MS to the study of the 1 8th century minted gold in Europe and to the Phillips II stater copies in Gaul, estimate the possibilities of the technique to differentiate gold from different origins. Mots-clés: LA-ICP-MS, spectrométrie de masse, ablation laser, analyse par activation, or, numismatique,
de fabrication, provenance. Key-words: LA-ICP-MS, mass spectrometry, laser ablation, activation analysis, gold, numismatics, manufacture technology, provenance.
INTRODUCTION
L'étude des métaux archéologiques porte sur l'évolution de l'utilisation du métal par l'Homme. Pour cette étude, des techniques métallographiques et chimiques ont été développées et utilisées de façon à mettre en évidence l'évolution de l'habilité de l'Homme à fabriquer des armes, outils, ornements, vaisselles, monnaies...
Si, pour les céramiques, il a été possible de déterminer la provenance de la matière première et ainsi établir des routes de commerce, en revanche pour les métaux les problèmes de provenance ont eu un succès bien plus limité (voir Guerra et Barrandon, 1996). En effet, diverses difficultés apparaissent, parmi lesquelles les plus importantes sont la rareté de certains gisements ainsi que leur localisation, la haute température à laquelle le minerai est soumis pendant le raffinement, et surtout la refonte et la réutilisation des métaux.
Parmi les métaux utilisés de la préhistoire à nos jours, l'or reste sans doute le métal le plus convoité, de par sa rareté et de par la puissance qu'il représente (Clark, 1986).
Ceci explique l'intérêt que portent les archéologues et les numismates à ce métal précieux. Diverses techniques d'analyse ont été appliquées à l'étude de l'or. Cependant, comme pour les autres métaux, la détermination de la provenance du métal utilisé s'avère difficile.
La technique de spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) est actuellement une des plus puissantes pour la caractérisation multi-élémentaire de matériaux, du fait des très basses limites de détection qu'elle peut atteindre et de la réponse linéaire sur un grand nombre d'éléments. Associée à l'ablation laser (LA-ICP-MS), cette technique devient quasi non-destructive. Les possibilités analytiques liées à l'utilisation d'un nouveau laser de type UV nous ont amenés à développer cette technique pour l'étude de l'or et à l'appliquer à la recherche de provenances de l'or au moyen des éléments traces caractéristiques.
1-LES TECHNOLOGIES DE FABRICATION
La monnaie est un des objets les plus étudiés. Elle est frappée avec un alliage contrôlé par un atelier d'état et
* C.N.R.S., Centre de Recherches Ernest-Babelon, U.P.R 7548, 3D rue de la Férollerie, 45071 ORLÉANS Cedex.
24
présente parfois la date d'émission; il existe des références documentaires sur les monnayages; la typologie et la métrologie sont bien étudiées. Tous ces faits conduisent à une plus grande richesse de résultats (Guerra, 1995).
Plusieurs questions peuvent être posées sur l'or monétaire. La provenance du minerai utilisé nous permet de connaître les sources d'approvisionnement en or et l 'étude des technologies de fabrication de la monnaie nous permet d'aborder des problématiques historiques et économiques. La connaissance des techniques de fabrication permet en effet de connaître les méthodes employées par les autorités monétaires et les besoins ou contraintes de la politique monétaire.
Du point de vue de l 'archéomètre, les questions les plus simples sont celles qui concernent l'étude de l'altération du titre (quantité d'or utilisée pour la fabrication du flan monétaire) et donc l'étude de la dévaluation monétaire, indice de l'évolution économique.
La détermination de la quantité d'or présente dans la monnaie peut être faite au moyen d'un grand nombre de techniques d'analyse (voir, par exemple, Bird etal, 1983). En effet, l'or (ainsi que l'argent et l'alliage de ces deux métaux) ne présente pas d'hétérogénéité ni de corrosion, et donc même les méthodes de surface peuvent donner des résultats fiables. Néanmoins, il faudra tenir compte du léger enrichissement de surface en or dû au départ sélectif du cuivre dans la première couche. Ce phénomène peut influencer les résultats obtenus par des méthodes qui analysent les premiers microns, telles le PIXE et le XRF, méthodes qui souffrent de l'énorme absorption des rayons X dans la matrice (1).
L'évolution de la teneur en or de la monnaie associée à l'évolution métrologique et typologique, permet d'établir une chronologie relative (2). Pour cela des techniques très simples, comme le poids spécifique (3), qui a en plus l'avantage de pouvoir effectuer des mesures dans un musée, présentent des résultats très satisfaisants (Hughes et Oddy, 1970). Un bon exemple de ce type d'étude concerne l'établissement de la chronologie relative du monnayage axoumite (Oddy et Munro-Hay, 1980) par association de l'analyse du titre par la méthode du poids spécifique et de l'étude typologique et métrologique. La
En*** ApMM OilunM Ènn» Eon Anonymous AVI Efb.M Anonymous AV. 3 OttlM Ousmi MamyimnAV.] «tuna Ntaol Ettijrtu loM
a
jj^ i i i
a a q Btc od Q Bo a a □ OD c=i 1 1 1 rn cx3 B a a i n i i fit *^ a a □ ° a ■ a
° a %Au __i j i ■ ■ ' ' • 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Fig. 1: Évolution de la teneur en or dans le monnayage axoumite montrant la dévaluation pour chaque souverain (Oddy et Munro- Hay, 1980).
fig. 1 montre la dévaluation de la valeur moyenne du titre pour chaque règne et traduit une chronologie relative qui permet de connaître la succession d'un grand nombre de rois axoumites (très peu connue par les sources historiques).
Un des problèmes les plus importants à traiter du point de vue analytique est celui qui concerne la refonte de l'or monnayé. Un exemple très clair de l'apport des méthodes analytiques à l'étude de la technologie de fabrication de la monnaie, concerne le monnayage en or byzantin frappé à Constantinople entre le Vème et le Xlème siècle (Morrisson et al. , 1 985). L'étude de la variation du titre au moyen de la technique de fluorescence X montre une dévaluation à partir du milieu du Xème siècle qui se traduit par l'augmentation de la teneur d'argent accompagnée d'une légère augmentation du cuivre, c'est-à-dire soit par la non purification de l'or natif (qui peut contenir jusqu'à environ 36% d'argent) soit par l'ajout volontaire d'argent.
Dans l'Antiquité, l'argent est issu de la galène argentifère, contenant donc toujours du plomb résiduel à des teneurs de 0, 1 à 1 %. Comme le plomb est présent dans l'or natif seulement à l'état de trace, sa concentration est toujours inférieure à 100 ppm. Ainsi, le plomb est un élément qui permet de différencier le type de procédé utilisé.
La technique d'activation aux protons de 12 MeV issus d'un cyclotron (PAA), dont la limite de détection est de l'ordre de 1 ppm pour le plomb dans l'or, est utilisée pour la mesure du plomb et de l'argent dans le monnayage byzantin. Cette technique permet une analyse d'environ 300 urn, est multi-élémentaire, et surtout permet le dosage des éléments majeurs ainsi que de quelques éléments à l'état de traces (Barrandon, 1986). Elle permet donc de mettre en évidence, comme nous pouvons observer sur la fig. 2, les deux phases de l'altération: la première correspondant à l'ajout d'or natif ou à la non purification de l'or et la deuxième par refonte de monnaies d'argent ou par adjonction d'argent pur.
2-LAPROVENANCEDES MINERAIS
La question la plus difficile posée par le numismate est certainement l'attribution d'une provenance au métal utilisé pour la fabrication des flans monétaires, qui engage des
À i. ppm Pb 1000
500
% Ag 10 20 30 40
Fig. 2: Variation de la teneur en plomb dans les monnaies en or byzantines (491-1081) (Morrisson et al, 1982).
(1) II faut remarquer qu'il y a eu plusieurs travaux effectués avec ces techniques sur l'or monnayé depuis la fin des années 70 (voir, par exemple, Ferreira et Gil, 1981). Citons un travail récent sur le titre et dévaluation de la monnaie en or frappée par les Wisigoths et qui fait intervenir ces deux techniques (Marques et al., 199S). (2) L'évolution du titre des monnaies permet aussi de dater les objets qui sont trouvés dans un même ensemble. Un exemple de cette situation est la datation de l'enfouissement du gabeau de Sutton Hoo au moyen du titre des monnaies mérovingiennes qui y ont été trouvées (Cowell et La Niece, 1991). (3) La technique du poids spécifique permet la détermination du titre de la monnaie d'or en alliage binaire. Pour des alliages ternaires, avec une teneur en cuivre supérieur à 5 %, l'erreur introduite fausse le calcul de la teneur en or (Oddy et Blackshaw, 1974).
25
q. Cl
10000 T
1000 ■
100
10 <
▲ Angleterre + Portugal ♦ Brésil
-1- 1
+ ▲
+
1400 1500 1600 1700 1800 date
Fig. 3: Teneurs en palladium des monnaies portugaises, brésiliennes et anglaises (Barrandon, 1994).
problèmes politiques et économiques. S'il a été possible de répondre à un grand nombre de
questions qui portent sur les technologies de fabrication de la monnaie en or - telles le titre, la refonte, le changement d'approvisionnements de métal... - en utilisant un vaste éventail de techniques physico-chimiques, la détermination de l'origine du métal reste très difficile, même dans le cas du métal natif qui est soumis à moins de traitements. Cette difficulté est due essentiellement à:
- l'utilisation de petits gisements actuellement épuisés, rendant le tracé des routes difficile à rétablir;
- la haute température à laquelle le minerai et le métal sont soumis pendant le raffinement et la manufacture, ce qui induit la perte par oxydation d'un certain nombre d'éléments traces;
- la corrosion pendant l'enfouissement, qui est à l'origine de la migration de certains éléments;
- le fait que les métaux sont facilement refondus pour être réutilisés pour la fabrication d'autres objets, ce qui nous fait perdre des informations sur les minerais d'origine.
Dans l'étude des provenances nous pouvons distinguer deux cas. Dans le premier cas la mine n'est pas connue et la réponse reste alors difficile. Dans le second, on connaît la mine et l'on veut savoir si l'objet a bien été réalisé à l'aide du minerai extrait de celle-ci. Un seul élément trace caractéristique du minerai exploité (dit élément "traceur") peut être suffisant pour le suivre dans les monnayages étudiés. Remarquons que ce type d'hypothèse ne peut être appliquée que dans le cas d'une dilution d'un métal caractérisé soit par un traceur non existant dans les autres minerais, soit par des valeurs bien supérieures à celles trouvées dans les autres.
Suite à un travail effectué sur l'impact de l'arrivée de l'argent du Potosi en Europe au XVIème siècle (Guerra et Barrandon, 1988 et Guerra et al, 1991), une étude a été réalisée sur l'arrivée et la diffusion de l'or du Brésil en Europe au XVIIIème siècle (Barrandon étal, 1993). Des études géochimiques préalables montrent que l'or de Mato Grosso et de Minas Gérais, exploité à partir de 1696, contient de l'argent et du palladium, ou seulement du palladium (qui peut atteindre 9,85% pour certaines pépites). L'atelier de Rio de Janeiro, suivi par Baia et Minas Gérais, commence
à frapper l'or en 1703 . Pour vérifier si l'or brésilien arrive au Portugal pendant
le XVmème siècle, il suffit de mesurer la quantité de palladium dans le monnayage en or portugais avant et après 1700, ainsi que dans le monnayage en or brésilien. La méthode PAA présente une limite de détection d'environ lppm pour le palladium dans l'or. Si l'on mesure sa concentration au moyen de cette technique et si l'on trace la teneur en palladium (voir fig. 3) en fonction de la date d'émission des monnaies frappées au Brésil et au Portugal, nous pouvons observer que la teneur en palladium augmente au Portugal d'un facteur proche de 100 à partir de 1702, atteignant ainsi des teneurs qui égalent celles de l'or brésilien pur. Cette date correspond à l'arrivée de l'or du Brésil à l'atelier de Lisbonne. La même étude a pu être effectuée pour le monnayage
français et anglais. Cette étude a montré que l'or brésilien arrive en Angleterre, comme l'illustre la fig. 3, entre 1703 et 1713 (pas de monnaies analysées entre les deux dates) et en France à partir de 1705. A partir des valeurs obtenues il a été possible d'estimer la contribution de l'or brésilien au monnayage en or anglais et français.
S'il a été possible de montrer que l'or du Brésil a été utilisé pour la frappe de la monnaie au Portugal, en Angleterre et en France, il a aussi été possible de montrer que la teneur élevée en platine dans les monnayages anglais et français contrastait avec la faible teneur trouvée dans l'or brésilien. En effet, il y a eu mélange, ou dilution par refonte, d'or du Brésil avec un autre or. Mais lequel? Nous sommes ici dans le cas où la mine n'est pas connue. Lorsque l'on cherche à identifier la mine à partir de l'objet, il faut alors réussir à identifier plusieurs éléments traceurs du minerai et/ou déterminer les rapports isotopiques du plomb qui sont caractéristiques d'un gisement.
Si la détermination des rapports isotopiques du plomb a pu montrer de très bons résultats en ce qui concerne l'attribution de minerais de cuivre et d'argent, il n'en n'a pas été de même pour l'or. En effet, comme nous l'avons déjà dit, l'or à l'état natif ne possède que des traces de plomb, c'est-à-dire, à des teneurs inférieures à 100 ppm. Or, en ce qui concerne la méthode TIMS (4), la limite théorique de plomb nécessaire pour la mesure des rapports
(4) La spectrométrie de masse avec thermo-ionisation permet une mesure simultanée des 4 isotopes du plomb. Les rapports de ces isotopes sont caractéristiques d'un gisement et permettent de s'affranchir d'une éventuelle hétérogénéité de la composition chimique des filons d'un même gisement. Néanmoins, le problème de refonte et réutilisation des métaux se pose de la même façon pour cette technique.
26
isotopiques est de 100 nanogrammes de plomb qui doivent être extraits de l'objet au moyen d'un échantillon assez conséquent (Gale et Stos-Gale, 1992), c'est-à-dire qui peut atteindre facilement environ 10 miUigrammes. Comme il est impossible d'obtenir des échantillons de grande taille, surtout quand on analyse des pièces de monnaies, la détermination des éléments à l'état de trace de façon à différencier les minerais présente un grand intérêt.
3-DÉTERMINATION D'ÉLÉMENTS TRACES: LATECHNIQUELA-ICP-MS
Après tous les traitements chimiques et les hautes températures subis par l'or de la mine à l'objet - extraction, raffinement, manufacture, etc. - beaucoup d'éléments caractéristiques du minerai original ne sont plus présents dans les flans monétaires. Parmi les éléments qui peuvent être pris comme traceurs de certains minerais, il faut mettre en évidence ceux qui appartiennent au groupe du platine. En effet, ces éléments ont des affinités chimiques voisines de celles de l'or et donc ne sont pas affectés par les traitements métallurgiques.
La détermination d'éléments traces dans l'or a toujours été assez difficile. En effet, certaines méthodes ne sont pas d'utilisation aisée pour la détermination d'éléments à des teneurs de l'ordre de la ppm. Parmi celles-ci, citons le PDŒ, qui souffre d'une énorme absorption des rayons X dans la matrice, et l'irradiation aux neutrons de réacteur (5) qui nécessite des séparations chimiques longues et coûteuses vue la grande activité induite sur l'or. Par contre la technique PAA permet de doser certains éléments présents à l'état de trace, parmi lesquels certains appartiennent au groupe du platine, avec de très bonnes limites de détection. Néanmoins, nous pouvons observer sur le tab. 1 que certains éléments, tels le rhodium ou l'iridium, ne peuvent pas être mesurés à l'état de trace.
Le manque de sensibilité peut expliquer l'absence d'attribution de provenance faite au moyen des techniques classiques d'analyse. La technique de spectrométrie de masse à plasma inductif, ICP-MS, est en train de devenir une des plus utilisées pour l'analyse de matériaux. Ceci est dû à ses très bonnes limites de détection pour un grand éventail d'éléments. En plus, associée à l'ablation laser cette méthode devient quasi non destructive, ce qui est d'importance primordial pour l'étude des métaux archéologiques.
L'application de la technique ICP-MS à l'étude de l'or archéologique peut être faite par l'introduction de l'échantillon soit sous forme liquide, soit sous forme solide. Bien évidemment, dans le premier cas une dilution chimique de l'échantillon prélevé sur l'objet doit être faite; cette dilution n'est pas aisée, augmente considérablement le temps d'analyse et peut diminuer la sensibilité.
Pour l'or, nous pouvons citer une étude effectuée par LA-ICP-MS avec un laser du type IR pour la différenciation de minerais d'Australie, chacun étant caractérisé par un ou des éléments traces (Watling et al, 1 994). En effet, dans ce pays la proportion d'or volé ou détourné devenait tellement importante que s'imposait l'identification des lingots fabriqués avec de l'or volé. Cette étude montre bien les perspectives que peut atteindre cette technique. Remarquons toutefois que, contrairement aux géologues qui travaillent sur le minerai, les archéomètres doivent
Elément Ti Fe Zn Ga As Ru Rh Pd Cd Sn Sb Te Os Ir Pt Hg Pb
PAA (ppm) 1 1 5 10 1 2
1000 2 5
1,5 1 1 20 20
1 3 1
LA-ICP-MS (ppm) 0,20 0,50 0,03 0,02 0,06 0,04 0,09 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 0,05
Tab. 1: Limites de détection pour les méthodes PAA et LA-ICP-MS pour les éléments dosés par PAA.
analyser le minerai transformé en métal. Les difficultés supplémentaires auxquelles nous devons
faire face, sont relatives à la différence qui peut exister entre un minerai et un flan monétaire. Dans ce dernier cas, les éléments traces, en plus petit nombre, doivent pouvoir être dosés à des teneurs très faibles ce qui implique le besoin d'une meilleure sensibilité de mesure. Ceci justifie tout l'intérêt d'une première étude utilisant un laser de typeUV.
4-MKEAUPOENTDEIA TECHNIQUE LA-ICP-MSPOURUÉTDDE DEL'OR
Nous avons utilisé un Plasma Quad 2-Plus de VG Instruments associé à un laser du type Nd:YAG dont la fréquence a été quadruplé de façon à travailler à une longueur d'onde de 266 nm (région UV), d'énergie 2 mJ et de 10 Hz de fréquence maximale de répétition de tir, opérant en émission déclenchée. Les échantillons sont disposés dans une cellule en quartz dont les dimensions sont de 5,5 cm de diamètre et de 2,5 cm de hauteur. La cellule est montée sur une table xyz ayant un pas de déplacement de 2,5 um, un système vidéo permet de visualiser l'échantillon.
Un courant d'argon balaye l'intérieur de la cellule et entraîne les particules ablatées vers la torche à plasma. Le plasma est obtenu par le couplage de l'énergie d'un générateur radie-fréquence de type Henry à 27, 12 MHz avec l'argon. Le principal intérêt de ce gaz réside dans son énergie d'ionisation élevée (15,8 eV) qui lui permet d'ioniser plus de 50 éléments à plus de 90%.
Les paramètres d'analyse sont déterminés en tenant compte du fait que nous travaillons sur des objets archéologiques. De ce fait, la taille des cratères effectués par le laser doit être la plus petite possible tout en nous permettant de conserver une bonne reproductibilité des résultats et de bonnes limites de détection pour la plupart
(5) L'irradiation aux neutrons de réacteur est une technique très utilisée pour l'étude des monnayages en or par A. Gordus pour l'analyse des éléments majeurs Au, Ag et Cu (voir par exemple Messier, 1973). La technique de cet auteur nécessite un faible prélèvement sur la monnaie (Gordus, 1967).
27
40000 7
30000 4 CO Q. g 20000 CD T3 °- 10000 ■ f
30 Temps (s)
60
Fig. 4: Spectre en mode S.I.M. pour l'or (conditions: 10 ms de dwell-time et 6 Hz de fréquence de laser).
des éléments traces. Le choix de ces paramètres est fixé à l'aide de spectres réalisés en mode S.I.M. Le mode d'acquisition S.I.M. (de single ion monitoring) est utilisé lorsque l'on souhaite visualiser l'évolution du signal dans le temps d'un ion bien défini. Deux types de paramètres doivent être optimisés: ceux d'acquisition et ceux du laser. Les premiers regroupent le temps passé sur chaque masse balayée (dwell-time), le temps d'acquisition et le temps de pré-analyse (uptake), tandis que pour les seconds seule la fréquence du laser est optimisée, son énergie étant maintenue constante, à sa valeur optimale.
Pour la plupart des masses on observe une même allure générale du signal (voir fig. 4): un pic de forte intensité durant les 5 à 7 premières secondes d'acquisition, puis une réponse stable d'intensité souvent inférieure à celle du pic. Ce plateau étant maintenu pendant un temps assez long, nous avons fixé un temps d'acquisition de 60 s avec un temps de pré-analyse de 10 s, afin d'éviter la saturation du détecteur par le pic initial. Pour les diverses valeurs choisies de dwell-time nous avons obtenu des réponses similaires. Nous avons alors fixé le dwell-time à sa valeur
maximale: 10 ms. Pour ces conditions d'analyse, nous avons fait varier la
fréquence de 1 à 10 Hz. A partir de la stabilité du signal et de sa durée ainsi que de la sensibilité de la mesure, qui peuvent être observées dans la fig. 5, nous avons fixé la fréquence optimale du laser à 6 Hz. La recherche des paramètres a été faite au moyen du plus large diaphragme qui crée des cratères d' approximativement 40 um de diamètre et de 130 um de profondeur. Pour contrôler la reproductibilité des analyses, nous avons effectué 30 ablations pour tous les éléments mesurés et ceci sur un étalon en or. La plupart des éléments présentent une reproductibilité très satisfaisante. Nous montrons ici à titre d'exemple la réponse du platine sur la fig. 6, les autres éléments présentant une réponse similaire. On doit signaler cependant la répartition hétérogène de l'osmium et du ruthénium ainsi que de l'iridium quand ils sont présents en teneurs importantes (6). Pour tenir compte des quelques hétérogénéités de l'échantillon et des fluctuations de la machine, nous effectuons trois analyses pour chaque groupe d'éléments.
Les calculs de teneur sont effectués par rapport à des étalons en or de matrice similaire aux échantillons et, pour résoudre le problème de fluctuation du processus d'ablation et du transfert de la quantité de matière vers le plasma, nous utilisons la méthode de l'étalon interne. Celui- ci doit être présent en quantité suffisante dans les échantillons et avoir une distribution homogène. Comme nous étudions des monnaies très pures, l'or nous semble être le meilleur étalon interne possible. Néanmoins cet élément est mono-isotopique. Afin de pouvoir le détecter dans les deux modes d'acquisition (7) nous avons eu recours à l'ion AuAr+ généré par le plasma (8).
Les calculs de concentration sont faits en normalisant à 100% la teneur des majeurs (Gratuze et al., 1993), en l'occurrence l'or, l'argent et le cuivre, et en tenant compte des interférences isobariques. Pour les éléments non certifiés, nous considérons l'hypothèse d'un comportement
"...2+...4X...6 -...8X-10
30000
100 200 Temps (s)
Fig. 5: Spectre en mode S.I.M. pour le cuivre à 4, 6, 8 et 10 Hz de fréquence de laser et 10 ms de dwell-time.
(6) Ces problèmes ont déjà été abordés par divers auteurs (voir, par exemple, Meeks et Tite, 1980 et Lehrberger et Raub, 1995). La formation de précipités d'alliages binaires et ternaires de ces éléments est visible sur certaines monnaies. La différence de densité entre ces alliages et l'or mène à une migration en surface. Ce phénomène n'est observé que pour peu de monnaies. (7) II existe deux modes de détection: un mode peu sensible (dénommé « analog ») pour l'analyse des éléments majeurs et un plus sensible (dénommé « pulse counting ») pour l'analyse des éléments trace. (8) D'autres auteurs ont déjà eu recours à cette technique pour l'analyse de l'or industriel au moyen d'un laser IR avec des résultats très satisfaisants (Kogan et al, 1994).
28
c/} Q. 13 O O CD ■o
50 40 30 ■ 20 ■ 10 ■ 0
0 10 20 n° analyse
30
Fig. 6: Nombre de coups mesurés pour le platine dans un étalon en or pour 30 analyses consécutives.
similaire pour des masses proches. Nous introduisons dans le calcul le coefficient de sensibilité relative de l'élément le plus proche de celui que nous voulons doser.
Si nous comparons les valeurs obtenues par PAA avec celles obtenues par LA-ICP-MS, nous observons une bonne concordance générale comme, par exemple, pour le palladium qui se trouve sur la fig. 7. Néanmoins, pour quelques rares éléments tels le Zn (fig. 8), certaines valeurs peuvent s'éloigner des valeurs certifiées mais l'ordre de grandeur reste le même. Remarquons que le zinc ayant un point de fusion assez bas, il peut s'évaporer suite à l'élévation de température induite par le laser. D'autres éléments avec un bas point de fusion ne présentant pas le même comportement, nous ne pouvons pas généraliser.
Les limites de détection sont calculées en utilisant comme critère trois fois l'écart-type de 10 analyses de bruits de fond consécutives. Il est possible de mesurer environ 40 éléments avec des limites de détection entre 10 et 500 ppb. Si nous comparons les limites de détection obtenues par la méthodes LA-ICP-MS avec celles obtenues pour les éléments dosés par activation aux protons de 12 MeV, nous pouvons constater qu'elles sont meilleures d'un facteur 5 à 1000 (fig. 9 et tab. 1). Il faut aussi prendre en considération le gain de temps permis pour les analyses de l'or par la méthode LA-ICP-MS par rapport aux méthodes nucléaires.
5-APPUCATïONÀL'ORMONNAYÉ
Nous avons montré l'intérêt de la technique LA-ICP- MS pour la caractérisation de l'or archéologique. Afin d'entrevoir les possibilités offertes par cette méthode sur des ors d'origines diverses, nous présentons à titre d'exemple les premiers résultats obtenus sur deux problèmes numismatiques. En premier lieu, suite à une étude menée sur l'or monnayé du XVIIIème siècle, nous
présentons les premiers résultats obtenus pour les monnayages russe et ottoman; une seconde application concerne les imitations gauloises des statères à l'effigie de Philippe n de Macédoine en vue de les différencier de ceux frappés en Grèce.
5.1-L'ORDUXVmëme SIÈCLE ENEUROPE
Nous avons vu dans le §3 qu'il a été possible de dater rarrivée de l'or du Brésil en Europe au moyen de la méthode PAA, mais qu'il a été impossible d'identifier l'or, plus riche en platine, dans lequel il a été dilué.
D'après les textes (Laurent, 1980), les mines d'or de l'Oural ont commencé à être exploitées à partir de 1737. La production d'or dans cette région est alors
importante, puisque plus de mille tonnes de ce métal ont été extraites par an. Des données géochimiques montrent que cet or contient une forte teneur en platine, qui peut atteindre environ 1%. De ce fait, nous avons analysé neuf monnaies russes couvrant les règnes d'Alexis jusqu'à Catherine II, c'est-à-dire de 1645 à 1777.
Si nous considérons, par exemple, le cas des monnaies françaises, russes et brésiliennes, nous pouvons observer dans la fig. 10 que la teneur du platine est similaire pour l'or russe et pour l'or brésilien à l'exception d'une monnaie, frappée sous Pierre I en 1723, qui dépasse les 2000 ppm de platine. Curieusement cette monnaie a donc été frappée avant l'exploitation des mines de l'Oural tandis que celles frappées sous Catherine II (en 1763 et 1777) présentent une teneur en platine inférieure à 1000 ppm.
Deux problèmes se posent: premièrement la teneur en platine est inférieure à celle indiquée par les données géochimiques et deuxièmement un or qui a été dilué présente une concentration de ces éléments traces qui doit être bien inférieure à celle observée pour le minerai.
Pour vérifier s'il n'y a pas eu de problème analytique lors de l'analyse par LA-ICP-MS, quelques monnaies russes ont été analysées par activation protonique. Les teneurs en platine obtenues par les deux méthodes sont comparées dans la fig. 11. Cette figure nous montre que les résultats concordent. Ainsi, nous concluons que l'or de l'Oural ne peut nullement justifier les teneurs en platine observées dans les monnayages français et anglais frappés au XVIIIème siècle. Néanmoins, en raison du faible nombre d'échantillons analysés, d'autres analyses s'imposent pour vérifier si la discordance avec les données géochimiques se confirment.
Afin de nous assurer que la méthode LA-ICP-MS permet de bien différencier des ors de différentes origines utilisés pour la frappe de monnaies de la même période, nous avons comparé les résultats obtenus sur six monnaies ottomanes
< < CL
1000 t
100 ■
10
] 4
0 0 10
LA-ICP-MS 100 1000
Fig. 7: Comparaison entre les teneurs obtenues par LA-ICP-MS et par PAA pour le palladium, en ppm.
200 400 LA-ICP-MS
600
Fig. 8: Comparaison entre les teneurs obtenues par LA-ICP-MS et par PAA pour le zinc, en ppm.
29
Fig. 9: Comparaison entre les limites de détection de PAA (obtenus sur une monnaie en or pur) et de LA-ICP-MS pour les éléments dosés aux protons.
frappées entre les règnes de Ahmed II et Mustafa in, c'est- à-dire entre 1691 et 1774.
Parmi les éléments dosés, nous avons considéré le platine, le rhodium et le palladium pour représenter sur un graphique ternaire (fig. 12) les monnayages russe et ottoman. Nous constatons que deux groupes se distinguent: le premier constitué par les monnaies russes, plus riches en platine, et le second par les ottomanes. La monnaie russe qui se trouve en dehors du groupe a été frappée sous Pierre I en 1723. Nous arrivons donc à bien différencier l'or russe de l'or ottoman. Ces résultats justifient les recherches en cours sur l'or monnayé au XVIIIème siècle en Europe au moyen de l'analyse d'ors d'autres origines.
5.2 - LES IMITATIONS GAULOISES DUSTATÈRE
D'après Simone Scheers (1976), la notion d'imitation du statère à l'effigie de Philippe n de Macédoine se rapporte à une multitude de numéraires dont les types sont parfois
très éloignés du prototype grec. Par conséquent, on distingue deux générations d'imitations. D'une part, les copies caractérisées par une imitation métrologique et typologique parfaite du prototype grec, où même le nom de Philippe est copié; d'autre part, les imitations dont le type ainsi que la métrologie s'éloignent avec le temps du prototype grec.
Les questions qui se posent sont les suivantes: les gaulois ont-ils refondu l'or grec pour frapper leurs premières monnaies? Peut-on différencier les statères des imitations gauloises? (9)
Pour répondre à ces questions il faudrait analyser un certain nombre de monnaies gauloises appartenant à la première génération d'imitations. Malheureusement, seuls cinq exemplaires sont connus, dont un a été volé. Toutefois, nous avons analysé une monnaie appartenant à la première génération (CH1937) et trois autres qui font partie de la seconde. A ces monnaies viennent s'ajouter trois statères à l'effigie de Philippe II frappés en Grèce (Le Rider, 1977).
Si l'on trace la teneur en palladium en fonction de celle
Q. Q.
30000 ■]
10000 ■
1000 ■
100 ■ i
10 ■
1 ■
+ + , 4
► ♦
+ + % +♦ A+
il
+France A Brésil ♦ Russie
A
1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 date
Fig. 10: Teneurs en platine des monnaies françaises, brésiliennes et russes.
(9) Certains numismates se sont posé le problème de l'origine du statère de Pons et d'Avènes (voir Scheers, 1976 et Nony, 1976).
30
10 100 1000 10000 LA-ICP-MS
Fig. 11: Comparaison entre les teneurs obtenues par LA-ICP-MS et par PAA pour le platine en ppm.
50
Pd
20 /
/ • 10 / /% / % / *
/ V
40
30 /
% ;
A
/
y
i — . a — . *
7\ -- — , m \ s
« ■
m
\ : i *
>
• Russe 10 A Ottoman
\ 20
À Rh
» / \ .„*,: .\40
> v \
50 100 90 Pt Fig. 12: Représentation des teneurs en platine, palladium et pour les monnaies russes et ottomanes.
du platine dans la fig. 13 , on constate une corrélation entre ces deux éléments pour les deux ors. Comme leurs teneurs sont plus fortes pour les monnaies grecques que pour les gauloises, nous pouvons avancer l'hypothèse qu'il y a eu dilution dans un or contenant moins de platine et de palladium.
Si l'on trace la teneur en iridium en fonction de la teneur en rhodium dans la fig. 14, on distingue alors deux groupes: l'un comprenant les monnaies grecques et l'autre les gauloises. Cette distinction étant confirmée par les teneurs d'autres éléments, comme l'antimoine (fig. 15). Bien que le nombre d'exemplaires analysés soit très faible et que l'on ne peut à l'heure actuelle trancher de façon indiscutable
40 -
500 1000 Ptppm
1500
Fig. 13: Teneurs en platine et palladium pour les statères et les imitations gauloises.
100 ■
75 ■
|50. Q. 0C 25 ■
♦ Grèce ▲ Gaule
0 10 20 Ir ppm
30
Fig. 14: Teneurs en rhodium et iridium pour les statères et les gauloises.
10 T
♦ Grèce ▲ Gaule
500 1000 1500 Ptppm
Fig. IS: Teneurs en antimoine en fonction du platine pour les statères et les imitations gauloises. entre dilution et or de nature complètement différente, les premières imitations de statère de Philippe II sembleraient être au moins frappées avec de l'or dilué. Ceci implique qu'elles ne peuvent être en tout état de cause de vrais statères de Philippe II, ce qui répond en partie au problème posé par le statère de Buzançais (Dupoux, 1 976) et devrait éclairer d'un jour nouveau l'origine du statère de Pons et d'Avène.
6 -CONCLUSION
Parmi les diverses questions posées par le numismate, celles qui concernent la provenance du minerai utilisé dans la fabrication des flans monétaires restent les plus difficiles à résoudre. Si les questions en rapport avec la relation mine -> objet peuvent être résolues pour des cas particuliers, celles qui traitent la relation objet -> mine se montrent bien plus complexes.
Dans le cas particulier de l'or monnayé, les méthodes classiques restent impuissantes face à ce type de question, vue la difficulté de la détermination des rapports isotopiques du plomb caractéristiques des gisements, ainsi que de la plupart des éléments traces caractéristiques des minerais.
La technique ICP-MS couplée à l'ablation laser présente plusieurs avantages parmi lesquels nous pouvons citer son caractère quasi non-destructif, ses basses limites de détection pour un grand nombre d'éléments et la rapidité de l'analyse. Nous avons prouvé que l'utilisation d'un nouveau laser de type UV permet une analyse multi- élémentaire avec une très bonne reproductibilité des résultats.
Avec cette technique, utilisant le laser de type UV, offrant
31
Monnaies Russe BN632 BN673
BN764 BN803 BN840 BN865 BN958 BN1013 BN1070 Ottoman BN920 BNV1616 BN830 BNs.n° BN2361 BN1075
Grec BNI592
BN1593 BN131 Gaulois N1844 CH21n B959-29-1 CH193712
Règne
Alexis Ivan Pierre et Sophie Pierre I Pierre I Pierre I Anne Elisabeth I Catherine II Catherine II
Mohamed I Abdulhimal I Suleyman Ahmed II Mustafa III Selim III
Atelier^ Amphipolis D:211 Pella C:416 Pella C:87
Rh
13
29 20 17 595 18 132 157 0
36 15 0 1 0 31
65 94 90
32 6 17 1
Pd
8
4 18 15 175 18 107 0 7
53 61 2 3 6 33
18 32 12
5 1 9 3
lr
4
3 5 6 32 4 10 0 4
11 4 0 0 6 16
19 20 18
5 1 6 10
Pt
63
73 119 130 2088 123 315 2 687
212 194 11 13 17 70
552 1043 423
87 25 198 100
Au%
98
98 93 97 81 93 93 92 99
99 93 96 95 98 96
99,6 99 99
95 99 98 99,8
Table: Teneurs des éléments traces les plus caractéristiques des analysées (en ppm). BN- Bibliothèque nationale, CH (13) -
Musée de Châteauroux, B- Musée de Bourges, N- Musée de Nantes.
les possibilités de dosage d'un plus grand nombre d'éléments traceurs des minerais, il nous a été possible d'aborder le difficile problème des provenances de l'or monnayé.
Pour estimer les possibilités de cette technique, nous l'avons appliquée à l'étude de plusieurs ors monnayés. Les premiers résultats montrent une voie pleine d'avenir pour résoudre des problèmes de provenance soulevés par l'or (ainsi que pour l'argent). La détermination des éléments traces dans cette matrice et la différenciation des ors d'origines et d'époques diverses, permet d'entrevoir de vastes possibilités de recherche dans le domaine de la caractérisation de l'or, qui englobent le délicat problème d'identification des imitations. Il reste néanmoins une difficulté: l'obtention d'étalons certifiés de composition similaire aux objets analysés et contenant les éléments traces que l'on souhaite doser. Seule l'utilisation d'étalons bien connus par des laboratoires utilisant le même type de technique ou d'autres permettant de doser les éléments traceurs de l'or, permettra dans l'avenir de construire une véritable base de données pour l'or archéologique.
BIBLIOGRAPHIE BARRANDON, J.N., 1986 - Metals analysis by charged particles:
evaluation and prospects. NIM, B 14, 133-141. BARRANDON, J.N., LE ROY-LADURIE, E., MORRISSON,
C. et MORRISSON, C., 1993 - L'or du Brésil et son influence sur les frappes françaises au XVIIIème siècle: première étape d'une enquête, Actes du Xlème Congrès International de Numismati-que, éd. Séminaire de Numismatique Marcel Hoc, 135-140.
BARRANDON, J.N., 1994 - The nuclear analytical methods in historical science: the case of precious metals from the New World, Russian J. Anal Chem., 49, (1), 89-93.
BIRD, Ch., J.R., DUERDEN, P. et WILSON, D.J., 1983 - Ion beam techniques in Archeology and the Arts, Nucl. Scien. Appli., 1, 357-516.
CLARK, G., 1986 - Symbols of Excellence: Precious materials as expressions of status, Cambridge University Press, 1986.
COWELL, M. et LA NIECE, S., 1991 - Metalwork: Artifice and artistry, Science and the Past, S. Bowman éd., British Museum Press, 74-98.
DUPOUX, J, 1976 - Le statère d'or de Buzançais (Indre), RACF, XV, (3/4), 241-245.
FERREIRA, G. P. et GIL, F. B., 1981 - Elemental analysis of gold coins by PIXE, Archaeometry, 23, (2), 189-199.
FISCHER, B., - Monnaies gauloises du Musée Bertrand à éd. Académie du Centre, Châteauroux.
GALE, N. H. et STOS-GALE, Z. A., 1992 - Lead Isotope Studies in the Aegean, New Developments in Archaeological Science, M. Pollard éd., Oxford University Press, 63-108.
GORDUS, A.A., 1967 - Quantitative non-destructive neutron activation analysis of silver in coins, Archaeometry, 10, 78-86.
GRATUZE, B., GIOVAGNOLI, A., BARRANDON, J.N., TELOUK, Ph. et IMBERT, J.L., 1993 - Apport de la méthode ICP-MS couplée à l'ablation laser pour la caractérisation des archéomatériaux. Rev. d'Archéomètrie, 17, 89-104.
GUERRA, M.F. et BARRANDON, J.N., 1988 - Thermal neutron activation analysis of archaeological artifacts using a cyclotron. Proceedings of Archaeometry, 88, Univ. of Toronto éd., 262- 268.
GUERRA, M. F., BARRANDON, J.N., LE ROY LADURIE, E., MORRISSON, C. et COLIN, B., 1991 - The diffusion of the silver from Potosi in the XVI century European coinage, Archaeometry, 90, Birkhâuser Verlag Basel éd., 11-18.
GUERRA, M. F., 1995 - Elemental analysis of coins and glasses, Appl. Radiât, hot, 46, (6/7), 583-8.
GUERRA, M.F. et BARRANDON, J.N., 1996 - Ion beam analysis with a cyclotron, Proceedings of the Symposium
The application of scientific methods for investigating coins and coinage, Londres 1994, sous presse.
HUGHES, M. J. et ODDY, W. A., 1970 - A reappraisal of the specific gravity method for the analysis of gold alloys, Archaeometry, 12, 1-11.
KOGAN, V.V., HINDS, M. W., et RA-MENDIK, G. I., 1994 - The direct determination of trace metals in gold and silver materials by laser ablation inductevely coupled plasma mass spectrometry without matrix matched standards, Spectrochimica Acta, 49B, (4), 333-343
LAURENT, L., 1890 - Sur l'industrie de l'or dans l'Oural, Annales des Mines.
LEHRBERGER, G. et RAUB, Ch., 1995 - A look into the interior of cehic gold coins, Prehistoric Gold in Europe. Mines, Metallurgy and Manufacture, ed. G. Morteani and J. P. Northover, Kluwer Academic Publishers/NATO series E 280, 341-356.
LE RIDER, G., 1977 - Monnayage d'argent et d'or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294, E. Bourgey éd., Paris.
(10) Références de Le Rider, 1977. (11) Statère au type BN3429, Muret et Chabouillet, 1889. (12) Statère d'or de Buzançais, Dupoux, 1976. (13) Références de B. Ficher.
32 MARQUES, M.G., CABRAL, J.M.P., et MARINHO, J.R., 1995 -
Ensaios sobre histôria monetària da monarquia visigoda, Sociedade Portuguesa de Numismatica, Porto.
MEEKS, N. D. et TITE, M. S., 1980 - The analysis of platinum- group element inclusions in gold antiquities, J. Archaeol. Science, 7, (3), 267-275.
MESSIER, R. A., 1973 - The Almoravids: West Africain gold and the gold currency of the Mediterranean basin, J. Econom. Soc. Hist. Orient, XVII, part 1, 31-47.
MORRISSON, C, BARRANDON, J.N., BRENOT, C, CALLU, J.P., HALLEUX, R. et POIRIER, J., 1982 - Numismatique et histoire. L'or monnayé de Rome à Byzance: purification et
Comptes Rendus de L 'Acacémie des Inscript. & Belles- Lettres, avril-juin, 203-223.
MORRISSON, CM BRENOT, C, CALLU, J., BARRANDON, J.-N., POIRIER, J. et HALLEUX, R., 1985 -L'or monnayé I. Cahiers Ernest-Babelon 2, Ed. du CNRS.
MURET, E. et CHABOUILLET, A., 1889 - Catalogue des gauloises de la bibliothèque nationale, Paris.
NONY, D., 1976 - Réhabilitation du statère macédonien de Pons (Charente-Maritime), BSFN. 31, (7), 82-83.
ODDY, W.A. et BLACKSHAW, S.M., 1974 - The accuracy of the specific gravity method for the analysis of gold, Archaeometry, 16, (1), 81-90.
ODDY, W.A. et MUNRO-HAY, S.C., 1980 - The gold coins of Aksum, Metallurgy in numismatics, Royal Numismatic Society éd., 71-82.
SCHEERS, S., 1976 - Les imitations en Gaule du statère de II de Macédoine, Proceedings of the International
Numismatic Symposium, Akadémiai Kiadô, Budapest, 41-53. WATLING, R.J., HERBERT, H.K., DELEV, D. et ABELL, LA.,
1994 - Gold fingerprinting by laser ablation- inductevely coupled plasma-mass spectrometry, Spectrochimica Acta, 49B, (2), 205- 219.