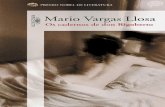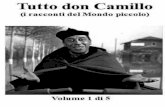«Stratégies du paratexte dans les œuvres de Don Juan Manuel»
Transcript of «Stratégies du paratexte dans les œuvres de Don Juan Manuel»
CAHIERS D’étUDES HISPANIQUES MéDIéVALES, no 35, 2012, p. 195-232
Stratégies du paratexte dans les œuvres de don Juan Manuel
Olivier biaggini
Université Sorbonne-Nouvelle – Paris III LECEMO / CREM
résumé
Cet article considère les stratégies du paratexte dans les œuvres de don Juan Manuel selon deux perspectives complémentaires. D’une part, il tente d’examiner l’évolution formelle des prologues manuélins afin de montrer qu’ils élaborent une figure de l’auteur qui occupe une place de plus en plus centrale dans l’énonciation et dans la rhétorique de justification du projet littéraire. Au sein de cette évolution, il semble qu’un pas décisif soit franchi lorsque l’auteur, s’émancipant du modèle d’écriture alphonsin, adopte la fiction comme principe de composition de ses œuvres (du Libro del cavallero et del escudero au Conde Lucanor), comme si ce principe de distanciation favorisait l’émergence d’une voix propre. D’autre part, l’article suggère que l’affir-mation énonciative et rhétorique de l’auteur va de pair avec un transfert – d’abord ponctuel, ensuite plus massif – des fonctions du paratexte au texte proprement dit : de façon de plus en plus nette, le corps du texte intègre des discours réflexifs et accueille en son sein la figure semi-fictionnelle de don Johán, vers laquelle convergent diverses stratégies d’autolégitimation de l’acte d’écriture. Dans les œuvres les plus tardives (Libro infinido, Libro de las armas) qui, loin des œuvres fictionnelles précédentes, se dotent d’une véracité testimoniale, tout l’effort rhétorique se concentre sur cette figure du moi, dont le pouvoir énonciatif se fonde sur une expérience personnelle et une continuité lignagère providentielles.
resumen
Este artículo contempla las estrategias del paratexto en las obras de don Juan Manuel desde dos perspectivas complementarias. Por una parte, intenta examinar la evolución formal de los prólogos manuelinos con el fin de mostrar que elaboran una figura autorial que va ocupando un lugar cada vez más central en la enunciación y en la retórica de
196 OLIVIER BIAGGINI
justificación del proyecto literario. Dentro de esta evolución parece que se da un paso decisivo cuando el autor, librándose del modelo de escritura alfonsí, adopta la ficción como principio compositivo de sus obras (del Libro del cavallero et del escudero al Conde Lucanor), como si este principio de distanciamiento favoreciese la emergencia de una voz propia. Por otra parte, el artículo sugiere que la afirmación enunciativa y retórica del autor corre parejas con un traslado –puntual al principio, y luego más intenso – de las funciones del paratexto hacia el texto propiamente dicho: de forma cada vez más nítida, el cuerpo textual va integrando discursos reflexivos y va acogiendo en su seno la figura semificcional de don Johán, hacia la cual convergen diversas estrategias de autolegitimación del acto de escritura. En las obras más tardías (Libro infinido, Libro de las armas) que, alejándose de las obras ficcionales precedentes, ostentan una veracidad testimonial, todo el esfuerzo retórico se concentra en esa figura del yo cuyo poder enunciativo estriba en una experiencia personal y una continuidad linajística providenciales.
Si le paratexte configure un espace qui, de façon à la fois concrète et sym-bolique, entoure le texte, on pourrait dire aussi que cet espace le surplombe, car c’est depuis le paratexte, notamment depuis les seuils du texte que sont les prologues ou les épilogues, que le lecteur est invité – parfois directement par la voix de l’auteur – à contempler le texte, à observer sa construction ou à comprendre ses fonctions. Toutefois, ce point de vue sur le texte n’est jamais neutre et, comme tout point de vue, il sélectionne, oriente et, dans une certaine mesure, fait exister ce qu’il y a à voir. L’adjonction d’un para-texte est toujours stratégique. Une de ses fonctions, au-delà de ses aspects pratiques de mise en contexte, de présentation de la matière ou d’attri-bution à un auteur, est de faire exister le texte d’une certaine façon plutôt que d’une autre. Les paratextes ne déterminent pas seulement un espace, mais déploient aussi une généalogie du texte, le dotant d’un avant (relatif à son origine, à sa composition, à son auteur) et d’un après (en offrant des représentations de sa cible, de sa réception, de son interprétation).
Dans le cas de l’œuvre foisonnante de don Juan Manuel, il n’est pas difficile de se rendre compte que le paratexte sert autant à garantir le texte qu’à promouvoir la figure de son auteur et les partis pris qui sont les siens. Ses prologues sont le lieu d’une affirmation de soi toujours plus impérieuse. Quant au célèbre prologue général, écrit au terme de cette production, il fixe la liste des œuvres complètes de l’auteur et, par ailleurs, on sait quel procédé il préconise pour remédier à la corruption à laquelle les copistes ne manqueront pas de les soumettre : dans ce prologue, don Juan Manuel affirme avoir préparé un volume approuvé par lui qui pourra servir de version de référence en cas de doute dans la lecture de tel ou tel passage d’un manuscrit de ses œuvres. Si, dans les prologues de ses pre-mières œuvres, don Juan Manuel ne se considère pas pleinement comme un auteur, le prologue général témoigne au contraire d’un souci de garder un contrôle sur la postérité du texte et d’en fixer la lettre comme s’il était un texte canonique.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 197
La critique a souvent souligné que cette mise en scène de l’auteur est liée à un rapport atypique de don Juan Manuel à l’auctoritas. Alors que la plupart des écrivains médiévaux affirment leur propre discours et leur propre figure en s’appuyant sur les auctoritates, dont ils peuvent utiliser ou détourner le prestige à leur profit, l’originalité littéraire de don Juan Manuel serait liée à une valorisation de son expérience individuelle, ce qui invite à rechercher dans ses textes les traces d’une « subjectivité litté-raire », notion mal définie qui risque de limiter l’analyse à l’approche bio-graphique1. Pour ma part, je préfère une approche qui procède à l’inverse : je ne tiens pas la subjectivité ou l’autorité comme une donnée première qui laisserait ses traces dans le texte ou le paratexte, mais je crois plutôt que ce sont texte et paratexte qui construisent de toutes pièces leur auteur – en l’occurrence ce don Johán qu’il ne faut certainement pas confondre avec le don Juan Manuel de chair et d’os. Par là, je ne nie pas la dimension auto-biographique des œuvres de don Juan Manuel (quoique la notion d’au-tobiographie reste alors à définir) et n’entends pas minimiser la part de l’expérience individuelle dans leur élaboration (quoique celle-ci ne soit pas toujours vérifiable). Je ne refuse pas non plus la part d’autorité politique du grand seigneur qui peut entrer dans l’élaboration de l’autorité d’écri-ture, bien au contraire. Je veux seulement suggérer que la mise en avant de l’expérience de don Juan Manuel ou de sa qualité de grand noble fait partie des stratégies de ses paratextes et que, tout autant que le recours aux autorités, elle relève de la construction rhétorique.
Mon approche sera donc essentiellement formelle. Elle tentera un examen chronologique et nécessairement panoramique des pratiques du paratexte chez don Juan Manuel. À cette fin, je reprendrai à mon compte les trois périodes que l’on distingue traditionnellement dans la production manuéline2. Les œuvres d’une première époque (jusque vers 1325-1326) s’inscrivent dans le sillage direct de celles d’Alphonse X et l’autorité d’écri-ture de don Juan Manuel, affirmée de façon indirecte, se définit par rap-port à celle du Roi Sage. Une deuxième étape (1326-1335) correspond à des œuvres qui se caractérisent par le recours à la fiction, qui est clairement utilisée comme une voie nouvelle de constitution de l’autorité. Enfin, une dernière période (après 1335) comprend des œuvres qui abandonnent la fiction et se recentrent sur des préoccupations familiales et lignagères qui mettent plus que jamais le moi de l’auteur au centre de la matière littéraire.
1. À ce sujet, voir les réflexions de Leonardo funes, « Las paradojas de la voluntad de autoría en la obra de don Juan Manuel », in : Florencio sevilla arroyo et Carlos alvar (dir.), Actas del XIII congreso de la Asociación internacional de hispanistas, Madrid, 6-11 de julio de 1998, 4 vol., Madrid : Castalia, 1, 2000, p. 126-133.
2. Voir la présentation synthétique qu’en donne Guillermo serés, dans son introduction à don juan manuel, El conde Lucanor, Barcelone : Crítica, 1994, p. xxxvii-xlvii.
198 OLIVIER BIAGGINI
En premier lieu, j’examinerai l’évolution des prologues de don Juan Manuel dans le passage de la première à la deuxième période : il s’agira notamment de pointer une rupture très nette dans la stratégie du para-texte. En second lieu, je m’intéresserai au passage de la deuxième à la troi-sième période pour voir comment le paratexte tend à contaminer le texte : le corps même du texte se trouve ponctuellement ou parfois plus massive-ment investi de certaines fonctions qui, en principe, relèvent du paratexte, jusqu’à aboutir à une indistinction des deux ensembles.
L’évolution des prologues
Première période : face à l’héritage alphonsin
En jetant un regard panoramique sur les prologues que don Juan Manuel a écrits au cours du temps, il est possible d’observer les étapes de la construc-tion d’une autorité d’écriture selon une évolution relativement simple, qui va toujours vers une affirmation plus forte de cette autorité et qui est loin d’être proportionnelle au pouvoir réel que don Juan Manuel a pu exercer dans le champ politique. Au contraire, cette autorité construite par le texte semble parfois tenter de compenser les difficultés ou les échecs que don Juan Manuel a rencontrés au cours de sa vie pour exercer pleinement l’au-torité politique dont il se croyait investi. Toutefois, il convient de se garder des simplifications abusives. D’abord, il faut veiller à ne pas accorder rétrospectivement à cette évolution un caractère nécessaire qu’elle n’a pas. Ensuite, il importe d’être conscient du filtre des manuscrits : au fil de la tradition, le texte médiéval se transforme, mais le paratexte est sans doute encore plus altéré que le texte : dans le cas des manuscrits des œuvres de don Juan Manuel, il est parfois particulièrement difficile de faire le départ entre ce qui revient à l’auteur et ce qui revient aux copistes3.
Lors de la première période de production (jusque vers 1326), les para-textes s’inscrivent nettement dans le sillage d’œuvres d’Alphonse X. Outre le prestige attaché au Roi Sage, sa figure présente pour don Juan Manuel le double avantage du lien familial – Alphonse X est son oncle – et de la condi-tion laïque, qui lui permet de ne pas se mesurer directement aux modèles
3. Au-delà de l’élaboration propre à l’auteur, les modifications des copistes ont sans doute beaucoup pesé sur la configuration et la réception des œuvres. Pour le Libro de los estados, voir L. funes, « La capitulación del Libro de los estados. Consecuencias de un problema tex-tual », Incipit, 4, 1984, p. 71-91, et, du même auteur, « Sobre la partición original del Libro de los estados », Incipit, 6, 1986, p. 3-26. Pour le cas particulier du Conde Lucanor, voir Laurence De looze, Manuscript diversity, meaning and variance in Juan Manuel’s Conde Lucanor, Toronto : Uni-versity of Toronto Press, 2006, notamment p. 26-63, et Jonathan burgoyne, Reading the exem-plum right. Fixing the meaning of El conde Lucanor, Chapell Hill : University of North Carolina Press, 2007, notamment p. 124-168.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 199
de l’écriture cléricale. Cette période correspond à au moins trois œuvres : la Crónica abreviada (avant 1325), le Libro de la caza (rédigé vers 1325-1326, mais peut-être profondément remanié des années plus tard lors d’une nouvelle rédaction) et le Libro de la cavallería (œuvre perdue, dont on sait qu’elle a été composée avant le Libro de la caza, qui la cite dans son prologue).
Les paratextes de la Crónica abreviada et du Libro de la caza présentent trois points communs. En premier lieu, dans leurs prologues, les œuvres se définissent explicitement comme des textes dérivés d’œuvres alphonsines, dont ils reprennent la matière (et le prologue du Libro de la caza semble indiquer la même chose pour le Libro de la cavallería4). En second lieu, ces prologues s’énoncent à la troisième personne : ils déclarent que don Johán est à l’origine de l’entreprise littéraire, mais ne lui attribuent jamais un discours à la première personne. En troisième lieu, ce don Johán n’appa-raît pas comme le responsable de la facture du livre : des verbes tels que fazer ou conponer, fréquents pour désigner l’opération de composition litté-raire, ne sont pas employés pour désigner son intervention. À mon sens, ces trois caractéristiques formelles configurent une autorité qui ne s’as-sume pas encore pleinement comme telle et qui doit donc trouver des voies détournées pour se construire.
La Crónica abreviada, dont le titre provient d’une désignation postérieure5, est une abréviation, à peine plus développée qu’un sommaire, que don Juan Manuel établit à partir d’une version de la Estoria de España que Diego Catalán a appelée Crónica manuelina et qu’il a essayé de reconstruire6. Chacun des chapitres se limite à un résumé lapidaire de quelques lignes, dont la sécheresse ne permet guère l’affirmation d’une autorité propre, bien que celle-ci affleure à quelques occasions particulières7. C’est donc essentiellement dans le prologue que la figure de don Juan Manuel peut trouver un certain développement. Don Juan Manuel y apparaît doté de la titulature éclatante de « don Iohan, fijo del muy noble ynfante don Manuel, tutor del muy alto e muy noble señor rey don Alfonso, su sobrino, e guarda de los regnos e fue adelantado mayor del regno de Murçia » – et c’est en effet l’époque, avant la
4. Voir don juan manuel, Libro de la caza, in : José Manuel fraDejas rueDa (éd. et dir.), Don Juan Manuel y el Libro de la caza, Tordesillas : Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal, 2001, p. 130, où il est question de « otro libro que fabla de lo que perte-nesçe a[l] estado de caballería ».
5. Ce titre figure dans la liste des œuvres établie par le prologue général ainsi que dans l’avant-prologue du Conde Lucanor.
6. Diego catalán, « Don Juan Manuel ante el modelo alfonsí: el testimonio de la Crónica abreviada », in : Ian macPherson (dir.), Juan Manuel Studies, Londres : Tamesis, 1977, p. 17-51.
7. Voir Marta lacomba, « Trois miracles cidiens et un motif hagiographique. La mise en place d’un système narratif dans la Crónica abreviada de l’infant don Juan Manuel », in : Olivier biaggini et Bénédicte millanD-bove (dir.), Miracles d’un autre genre. Réécritures médiévales en dehors de l’hagiographie, Madrid : Publications de la Casa de Velázquez, 2012, p. 171-189.
200 OLIVIER BIAGGINI
majorité d’Alphonse XI, où don Juan Manuel est corégent du royaume –, mais son autorité d’écriture est loin d’être affirmée de façon aussi directe. À partir d’une citation de Jean Damascène – et donc un recours à l’aucto-ritas –, le prologue présente le projet littéraire de l’œuvre :
[…] los que fazen o mandan fazer algunos libros, mayor mente en romançe, que es sennal que los fazen para los legos que non son muy letrados, non los deuen fazer de razones tan sso-tiles que los que los oyeren non las entiendan o por que tomen dubda en lo que oyen. E por ende, en el prólogo deste libro que don Iohan […] mandó fazer non quiso poner i palabras nin razones muy sotiles8.
La première proposition générale s’intéresse à ceux qui font ou ordon-nent de faire des livres (« fazen o mandan fazer ») mais l’application de cette proposition à don Juan Manuel se réduit à « mandó fazer » : le prologue lui accorde une autorité de commande, en accord avec son autorité politique prééminente, mais aucune autorité dans la réalisation du livre9. En outre, l’expression « el prólogo deste libro que don Iohan […] mandó fazer » laisse planer un doute sur l’antécédent de la proposition relative : don Juan Manuel est-il déclaré responsable de la production du livre ou seulement de son prologue ? Cette ambiguïté grammaticale ponctuelle résume à elle seule celle de l’autorité d’écriture de la Crónica abreviada : il est difficile de dire si ce texte doit être considéré comme une œuvre de don Juan Manuel tirée d’un antécédent alphonsin ou comme une nouvelle version de l’œuvre d’Alphonse X dont l’autorité incomberait encore tout entière à ce dernier. La part d’autorité qui revient à don Juan Manuel ne peut émerger qu’à travers une figure de lecteur, qui écrirait le texte pour son propre usage : « saco de su obra conplida vna obra menor, et non la fizo sinon para ssi en que leyese »10.
Parallèlement, le prologue s’ingénie à donner d’Alphonse X l’image d’un auteur pleinement responsable des livres qu’il a produits, comme l’indiquent, entre autres, les multiples occurrences du verbe fazer :
[…] fizo ayuntar los [grandes fechos] que fallo que cumplian para los contar. E tan complida mente e tan bien los pone en el prologo que fizo de la dicha Cronica donde lo sopo, que nin-guno non podria y mas dezir nin avn tanto nin tan bien commo el (Crónica abreviada, p. 175).
[…] ca fallamos que en todas las ciencias fizo muchos libros e todos muy buenos. E lo al, por que auia muy grant espacio para estudiar en las materias que queria conponer algunos libros (loc. cit.).
8. Crónica abreviada, in : don juan manuel, Obras completas, José Manuel blecua (éd.), 2 vol., Madrid, Gredos, 1981, 1, p. 573.
9. Pour ces notions d’autorités de commande et de réalisation telles qu’elles se manifestent dans les prologues alphonsins, voir Georges martin, « Alphonse X ou la science politique (Sep-ténaire, 1-11) » (première partie), Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 18-19, 1993, p. 79-100.
10. Crónica abreviada, éd. citée, p. 576.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 201
[…] ordeno muy conplida mente la Cronica d’Espanna, e puso lo todo conplido e por muy apuestas razones e en las menos palabras que se podia poner (ibid., p. 576).
Le verbe apparaît dans un emploi factitif mais aussi dans son sens plein, à mettre sur le même plan que celui des verbes conponer, poner ou ordenar qui, tous, impliquent une intervention directe dans la facture du livre. Rap-pelant l’ampleur de l’entreprise culturelle d’Alphonse, le prologue loue les nombreux livres dont le roi est l’auteur et, parmi eux, la chronique, dont la perfection rhétorique se manifeste tout particulièrement dans son propre prologue. Cet éloge du prologue alphonsin suggère que don Juan Manuel ne pourra l’égaler. Face à Alphonse X comme autorité, la place qu’il s’attribue est bien plus modeste : « [Don Iohan] [por] muchas razones non podria fazer tal obra commo el rey fizo […], por ende fizo poner en este libro todos los grandes fechos que se y contienen » (ibid., p. 576). Le verbe fazer est aussi associé à don Juan Manuel, mais seulement dans sa fonction factitive (« fizo poner »), alors que, dans son sens plein, il lui est refusé (« non podría fazer »). En outre, le prologue renvoie le lecteur à la chronique complète du roi au cas où la version abrégée ne lui donnerait pas satisfaction : « cate el logar onde fue sacado en la Cronica » (ibid., p. 577).
Le prologue construit donc une figure d’Alphonse face à laquelle celle de don Juan Manuel ne saurait rivaliser en termes d’autorité d’écriture. D’une part, cette dissymétrie permet de suggérer un héritage : en magni-fiant l’œuvre de son oncle, don Juan Manuel valorise indirectement la sienne, qu’il place dans son sillage, y compris en imitant certains prolo-gues alphonsins11. D’autre part, toutefois, cette construction qui consiste à louer l’autorité d’Alphonse X tout en minimisant la responsabilité d’écri-ture de don Juan Manuel produit au moins trois contradictions profondes qui, loin d’être des maladresses, sont dotées d’une remarquable portée stratégique. Si don Juan Manuel n’avait écrit l’abréviation de la chro-nique que pour son usage personnel, à quoi bon écrire un prologue pour guider le lecteur ? L’existence même de ce prologue et les recommanda-tions de lectures qu’il donne indiquent clairement que la Crónica abreviada a été écrite pour autrui. Si le prologue alphonsin qui figure dans la chro-nique complète était inégalable, pourquoi don Juan Manuel le remplace-t-il par un prologue de son cru ? Cette substitution indique que la Crónica abreviada doit être considérée comme une œuvre autonome, même si elle dérive d’une œuvre antérieure. Si la qualité de la chronique alphonsine
11. Voir Germán orDuna, « Los prólogos a la Crónica abreviada y al Libro de la caza: la tradi-ción alfonsí y la primera época en la obra literaria de don Juan Manuel », in : J. M. fraDejas rueDa (dir. et éd.), op. cit., p. 105-119 : « La alusión a la actividad de Alfonso es extensa y demorada, y a veces recuerda el tono de algunos prólogos puestos por los colaboradores de Alfonso en alabanza de la sabi-duría y magnificencia del rey. » (p. 113).
202 OLIVIER BIAGGINI
tient à son expression condensée (« en las menos palabras que se podia poner »), la version qu’en donne don Juan Manuel ne doit-elle pas être tenue pour supérieure, elle qui l’abrège encore ? Le critère de la brevitas, lieu commun de la rhétorique médiévale, rend ici possible une autorité propre, même si celle-ci ne s’énonce pas littéralement. Ainsi, à maintes reprises, ce que dit le prologue est démenti par ce qu’il fait.
Tandis que l’autorité d’écriture de don Juan Manuel est affirmée en creux face à celle d’Alphonse, son autorité politique est mise en avant de façon beaucoup plus nette. Alors que le prologue a pris soin de souligner que l’infant est tuteur du jeune Alphonse XI, il ne manque pas de faire allusion aux troubles qui ont marqué la fin du règne d’Alphonse X, en indiquant que leurs conséquences pèsent sur le présent :
Mas por los pecados de Espanna et por la su ocasion e sennalada mente de los que entonces eran, e avn agora son, del su linaje, ovo tal postrimeria que es quebranto de lo dezir e de lo contar. E siguiosse ende tan danno que dura agora e durara quanto fuere voluntad de Dios12.
Alphonse X a certes été un auctor, promoteur d’une œuvre culturelle sans égale, mais, dans le champ politique, l’exercice de son autorité de roi l’a conduit au désastre13. Don Juan Manuel laisse peut-être entendre ici que l’Espagne pourrait, grâce à lui, qui est tuteur du roi de Castille et gar-dien du royaume, retrouver la faveur divine qu’elle a perdue. C’est fort de cette prééminence politique qu’il peut à son tour commencer à bri-guer un statut d’auteur.
Ce statut d’auteur, qui ne lui est pas explicitement accordé dans le prologue, l’est en revanche dans la table placée au seuil de l’œuvre dans l’unique manuscrit conservé et qui est introduite par la formule : « [E ]sta es la tabla deste libro que don Iohan […] fizo que es dicho Sumario de la Cronica de Espanna, que va repartido en tres libros »14. Alphonse X, auteur premier de la chronique, n’est pas mentionné et c’est à don Juan Manuel qu’est attri-buée la facture du texte. Cette table, qui peut être considérée comme une abréviation de l’abréviation, occupe face à la chronique abrégée une posi-tion similaire à celle qu’occupait celle-ci face à la chronique complète.
12. Crónica abreviada, éd. citée, p. 576.13. Le terme postrimería me semble renvoyer aux dernières années du règne d’Alphonse X,
marquées par la révolte nobiliaire conduite par l’infant Sanche, futur Sanche IV, plutôt qu’au règne de ce dernier ou de Ferdinand IV. Ainsi, je comprends mal l’explication de Germán Orduna : « La alusión a la postrimería de Alfonso muestra la llaga abierta de los sucesos que don Juan vivió » (G. orDuna, « Los prólogos… », p. 115), car Juan Manuel avait deux ans à la mort de son oncle. Au-delà d’une possible explication biographique, le lieu commun de la difficulté à dire (« que es quebranto de lo dezir e de lo contar ») permet surtout de ne pas résoudre le conflit, au cœur de l’argumentation du prologue, entre l’éloge d’Alphonse X et le rappel de la fin catas-trophique de son règne.
14. Crónica abreviada, éd. citée, p. 511.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 203
Cet effet de miroir permet de promouvoir implicitement la figure de don Johán au rang d’auteur, opération que le prologue avait laissée en suspens. Toutefois, il semble très peu probable que cette table ait été composée par don Juan Manuel lui-même, si l’on se fie à certaines formulations qu’elle contient15. C’est plutôt ce manuscrit du xve siècle, ou un de ses antécédents, qui achève le processus de construction de l’autorité en adjoignant une pièce paratextuelle supplémentaire. C’est par le paratexte – le prologue d’abord et la table des matières ensuite – que don Juan Manuel devient l’auteur d’un texte dont, au premier abord, toute la responsabilité sem-blait revenir à Alphonse.
Comme le prologue de la Crónica abreviada, celui du Libro de la caza conjugue un éloge d’Alphonse X comme auctor et une allusion à la fin calamiteuse de son règne. L’éloge est encore plus appuyé que dans la Cró-nica abreviada, faisant du roi de Castille un promoteur du savoir inégalé depuis l’Antiquité :
[…] puso en el su talante de acresçentar el saber quanto pudo, et fizo por ello mucho; así que non se falla que, del rey tolomeo acá, ningún rey non otro omne tanto fiziesse por ello como él16.
Quant à l’allusion, elle est plus discrète que dans le prologue de la Crónica abreviada mais, parce qu’elle suit immédiatement le panégyrique, elle n’en est que plus déroutante :
¿Qué vos diré? Non podría decir ningún omne quánto bien este noble rey fizo señaladamente en acresçentar et alunbrar el saber. ¡O Dios padre, et criador et poderoso et sabidor sobre todas las cosas: […] marabillosos et derechureros son los tus juyzios et marabillosso fue el que vino contra este tan noble rey! tú, Sennor, sabes lo que feziste; bendito seas por quanto feziste et quanto fazes et quanto faras17.
La figure d’Alphonse X est donc en même temps encensée et relativisée, sans qu’aucune synthèse ne soit proposée. Cette indétermination est en soi-même stratégique : elle favorise l’émergence d’une autre figure d’au-torité. L’écriture de don Juan Manuel, s’inspirant de l’œuvre de son oncle, pourra à la fois capter une part de son prestige et s’en démarquer. Ainsi, dans un premier temps, le prologue déclare que don Juan Manuel a grand
15. La formule qui, dans la table, annonce le prologue est : « Primera mente comiença el pro-logo la horden que han de tener los discretos que lo ley[e]ren » (loc. cit.). Non seulement cette formule ne reprend pas une expression du prologue, mais la notion de lecteur discreto est étrangère à la phraséologie manuéline et semble correspondre à un usage postérieur.
16. Libro de la caza, in : J. M. fraDejas rueDa (dir. et éd.), op. cit., p. 129.17. Ibid., p. 129-130. Là encore, le lieu commun de l’indicible sert à entretenir une tension
dans le prologue plutôt qu’à la résoudre. En l’occurrence, deux appréciations indicibles sont renvoyées dos à dos : celle qui fait d’Alphonse un auctor exceptionnel (on retrouve d’ailleurs l’expression « acresçentar […] el saber », déjà présente dans le prologue de la Crónica abreviada) et celle qui relève du dessein impénétrable de Dieu (« tú, Sennor, sabes lo que feziste »).
204 OLIVIER BIAGGINI
plaisir à lire les livres de son oncle et qu’il en a fait copier certains passages pour son usage personnel :
Et porque don Johan, su sobrino, fijo del infante Manuel, hermano del rey don Alfonso, se paga mucho de leer en los libros que falla que conpuso el dicho rey, fizo escrivir algunas cosas que entendía que cunplía para él de los libros que falló que el dicho rey abía conpuesto […]18.
Toutefois, dans un second temps, il apparaît que le degré d’intervention accordé à don Juan Manuel par le prologue du Libro de la caza est beau-coup plus élevé que celui que lui attribuait le prologue de la Crónica abre-viada. Non seulement il est érigé en expert de la chasse, capable de juger de la valeur des livres de son oncle en cette matière, mais, dans son propre traité, il ne se contentera pas de résumer ce qu’il a trouvé dans les sources alphonsines :
[Et por] lo que non usa en esta arte, et [ por] lo que oyó decir al infante don Johan, que fue muy grant caçador, et a falconeros que fueron del rey don Alfonso et del infante don Manuel, su padre, como se usava quando ellos eran bivos, que eran muy grandes caçadores, tovo que él vio cómo se mudó la manera de la caça de aquel tienpo fasta aqueste que agora está. E lo que él entendió et acordó con los mejores caçadores con quien él departió muchas vegadas sobre sobre esto, et otrosí lo que falló en la arte del venar […] escriviólo en este libro […]19.
Et le prologue donne ensuite le nom de ces fauconniers qui ont été consultés avant que ne soit élaboré le livre. Alphonse X qui, quelques lignes plus haut, était défini comme un auctor à l’échelle de l’histoire de l’humanité est ici ramené au cercle familial de don Juan Manuel et c’est à travers ses fau-conniers qu’il est mentionné, au même titre que l’infant Manuel. En outre, face aux sources écrites que constituent ses livres, c’est ici la parole des chas-seurs qui est valorisée, notamment celle de l’infant Jean20, figure qui, dans le registre de l’oralité, fait pendant au savoir attribué à Alphonse X dans celui de l’écriture. Ce parallélisme est renforcé par le recours à l’image, très présente dans les prologues alphonsins, de la collecte des savoirs et de la compilation des sources, qui est ici appliquée aux discours oraux des chas-seurs (« él entendió et acordó con los mejores caçadores con quien él departió muchas
18. Ibid., p. 130.19. Ibid., p. 131.20. J. M. Fradejas Rueda (ibid., p. 131, n. 10) fait de lui un fils de Sanche IV, alors qu’il s’agit
d’un de ses frères et, donc, d’un cousin germain de don Juan Manuel. Cet infant Jean, né en 1262, surnommé « el de tarifa », fut un ami proche de don Juan Manuel. C’est ensemble, en 1309, qu’ils firent désertion lors du siège d’Algésiras, au grand dam de Ferdinand IV. Il mourut lors du désastre militaire de la Vega de Granada, de même que son neveu, l’infant Pierre, en 1319. Le Libro de los estados évoque les circonstances de sa mort (don juan manuel, Libro de los estados, Ian R. macPherson et Robert Brian tate [éd.], Madrid : Castalia, 1991, p. 229) et relate un épisode où, alors qu’il est brouillé avec le roi, c’est don Juan Manuel qui, aux côtés de l’arche-vêque de Saint-Jacques, joue le rôle de médiateur (ibid., p. 252-253). À cette occasion, il est dit que les deux cousins « se amavan más que omnes en el mundo » (ibid., p. 252).
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 205
vegadas sobre esto »). Enfin, la matière du livre n’est pas perçue comme un objet immémorial et figé, mais avant tout comme une pratique qui évolue au cours du temps : c’est parce que la chasse n’est plus pratiquée du temps de don Juan Manuel comme elle l’était du temps de son oncle que se jus-tifie le recours direct à la parole experte des fauconniers.
Grâce à ce double déplacement – vers l’oralité et vers l’expérience –, ce prologue s’écarte des paratextes alphonsins21, mais il revendique aussi une rénovation de la matière textuelle elle-même qui, par conséquent, ne se limitera pas à translater celle que fournissent les sources écrites. Cette intervention actualisatrice de don Juan Manuel ne le rend pas explicite-ment responsable de la facture de l’œuvre (l’expression « escriviólo » ne dit pas la composition littéraire mais la simple mise par écrit) et ne passe pas non plus par une énonciation à la première personne. Toutefois, en poin-tant l’insuffisance de l’héritage alphonsin en ce qui concerne la chasse, le prologue annonce d’emblée que le traité suivra ce modèle pour mieux s’en écarter, ce qui, nous le verrons, est également souligné à maintes reprises dans le corps du texte.
Deuxième période : usages de la fiction
Les œuvres que don Juan Manuel a écrites après le Libro de la caza ont sou-vent été qualifiées de plus « personnelles », ce qui, à mon sens, n’est pas un critère de distinction très net22. Si un point de rupture est repérable dans cette deuxième époque, c’est plutôt l’usage systématique de la fic-tion dans le cadre d’énonciation du texte : le Libro del cavallero et del escudero (entre 1326 et 1328), le Libro de los estados (entre 1327 et 1332) et El conde Lucanor (achevé en 1335) présentent tous trois des discours insérés dans un cadre dialogué fictionnel. Pour le premier d’entre eux, don Juan Manuel, dans la lettre-prologue qui l’introduit, met en avant ce statut en assignant à son œuvre une étiquette générique, celle de la fabliella. S’adressant à son
21. Pour une analyse du prologue du Libro de la caza face au prologue du Libro de las anima-lias que cazan, voir Juan Héctor fuentes, « Continuidad y ruptura en el Libro de la caza de don Juan Manuel », Memorabilia, 10, 2007 [en ligne] [URL : http://parnaseo.uv.es/Memorabilia/Memorabilia10/Fuentes/Texto.htm], consulté le 15 novembre 2012.
22. Voir, par exemple, G. orDuna, « Los prólogos… », p. 113 : « Son los años del Libro del caballero y del escudero y, sobre todo, del Libro de los estados, obras que marcan un vuelco en la crea-ción literaria y una búsqueda deliberada del tono personal. » Or, dans le Libro de la caza, certains discours sont directement attribués à don Johán, en vertu de son expérience personnelle de la chasse, ce qui les oppose aux autres discours, censés venir d’autrui. Le « ton personnel » y est donc constamment présent (et recherché comme tel), alors que les œuvres suivantes choisissent une voie d’affirmation beaucoup plus indirecte, qui passe par la fiction.
206 OlivierBiaggini
dédicataire,quiestsonbeau-frèreJeand’aragon23,archevêquedeTolède,donJuanManuelprésentesonœuvreainsi:
[…] començe este libro que vos envio, et acabelo depues que me parti dende, et non lo fiz po que yo cuydo que sopiesse conponer ninguna obra muy sotil nin de grant recado, mas fiz lo en vna manera que llaman en esta [tierra] ‘fabiella24.
Cettedéclarationpourraitsuffireàprésenterlesnouvellescaractéristiquesdesparatextesdanslestroisœuvres,car,outrelarevendicationd’unefic-tion,elleexhibedeuxautresinnovationsessentiellesqui,jecrois,sontintimementliéesàlapremière.D’abord,lavoixdedonJuanManuels’yénonceàprésentàlapremièrepersonne.ensuite,faisantusagedecettevoixpropre,donJuanManuelseprésentedorénavantcommeceluiquiafaitlelivre(ilassumeleverbefazerendehorsdesexpressionsfactitives).
ilsemblequedonJuanManuelnepuisseassumerdirectementsontextecommeuneœuvreproprequeparlebiaisdelafiction.Considéréecommemoinssérieuseetimposantequ’unechroniqueouqu’untraitérelevantdetelleoutellescience,l’œuvredefictionpeutplusfacilementêtrerevendiquéecommeuneproductionpersonnelledelapartd’unlaïcenmanquedelégitimitélittéraire25.Parailleurs,ilsepeutquelafictionaitrevêtupourl’auteurunefonctioncompensatoire.eneffet,cettedeu-xièmepériodedelaproductiondedonJuanManuelcoïncidepourunebonnepartaveccelledesaffrontementsquil’ontopposéàalphonseXidèslorsquecelui-ci,en1327,arépudiéConstance,lafillededonJuanManuelqu’ils’étaitengagéàépouser,laretenantenoutreprisonnière.lesrupturesetlesconflitssuccessifsavecleroiontmisendangerlesinté-rêtséconomiquesetpolitiquesdedonJuanManueletcelui-cis’estàplu-sieursreprisessentimenacédanssonhonneuretdanssonpouvoir,maisilsemblequ’ilaitaussicraintqu’alphonsenelefasseassassiner.lafra-gilisationdel’autoritépolitiquededonJuanManueliraitdoncdepairavecledéveloppementd’uneautoritéd’écriture,conçuecommeunsubs-titutdelapremière.Cependant,devantcetteexplicationminimaliste,onpeutaussitenteruneexplicationmaximaliste:lafictionestsurtoutleter-ritoired’unepossibleredéfinitiondesoietd’unereconfigurationradicaledel’autoritépersonnelle.lepassageàuneconventionfictionnelleoffreàl’auteurlapossibilité,enseprojetantdansdifférentspersonnagesdéposi-
23. Surcepersonnage,voirrobertB.TaTe,«laobraliterariadedonJuanManuelyelinfantedonJuandearagón»,in:MaximeChevalieret al.(dir.),Actas del quinto congreso de la Aso-ciación internacional de hispanistas,2vol.,Bordeaux:universitédeBordeauxiii,1977,2,p.819-828.
24. Libro del cavallero et del escudero,in:donJuan Manuel,Obras completas,éd.citée,p.39-40.25. SurcedéficitdelégitimitéquedonJuanManueltransformeenatout,voirCarlos
heusCh,«lafableducorbeauetdurenard,selonJuanManuel:dudiscoursmoralausavoirpratique»,in:nicoleChareyron(dir.),« Clere Espaigne »,Bulletin du CRISIMA,3,2009,Mont-pellier:PressesuniversitairesdeMontpellier,p.87-122.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 207
taires d’un savoir ou d’un pouvoir et en adoptant un regard à la fois réflexif et distancié, de construire de l’intérieur les soubassements d’une autorité. La fiction est certes une compensation mais aussi, et surtout, la base dis-cursive susceptible de légitimer et de contribuer à restaurer le plein exer-cice d’un pouvoir menacé.
Ainsi, dans la forme énonciative adoptée, don Juan Manuel assume à présent la production d’une œuvre propre à la première personne. Pour-tant, même s’il se déclare entièrement responsable du statut fictionnel de ses œuvres, on sait qu’il hérite une part de cette convention : le Llibre de l’ordre de cavalleria de Ramón Llull qui est le principal modèle du Libro del cavallero et del escudero, ainsi que le Barlaam et Josaphat, qui sert de base au cadre narratif du Libro de los estados, lui fournissent des schémas narra-tifs et une formule d’écriture fictionnelle, mais il se garde bien de les citer comme il citait les modèles alphonsins dans les prologues de la première période. D’autres traités structurés à partir d’un dialogue, comme le Luci-dario de Sanche IV, ont pu servir de modèles pour ces dialogues qui struc-turent ces trois œuvres. Pour le Conde Lucanor, le statut fictionnel est plus complexe, parce que le dialogue accueille des récits dont le statut est assez flottant (fables, mais aussi anecdotes historiques et beaucoup d’exempla dont la véridicité littérale reste indéterminée), mais il est lui aussi tributaire des mêmes formules préalables, que l’auteur a su s’approprier. Tout cela est passé sous silence, comme si l’adoption de la fiction comme cadre d’expo-sition de la matière du livre autorisait don Juan Manuel à l’assumer hors de tout antécédent textuel26.
L’autorité d’une éventuelle source, comme celle d’Alphonse X dans les œuvres précédentes, tend à disparaître. À sa place, émerge une autre figure, qui va également entrer dans l’économie de la production du texte et être exploitée dans son paratexte : celle du dédicataire de l’œuvre. Jean d’Aragon apparaît revêtu de cette fonction dans le Libro del cavallero et dans
26. Dans les prologues de ces trois œuvres, on trouve toujours une déclaration volontariste du choix de la fiction, qui n’incombe qu’à l’auteur. C’est bien l’auteur qui assume le choix de la fabliella dans le Libro del cavallero. Dans les deux œuvres suivantes, le paratexte précise le statut des personnages en le présentant également comme une convention choisie par l’auteur. Ainsi, dans le prologue du Libro de los estados, don Juan Manuel affirme que le recours à la simi-litudo permet de rendre le discours plus intelligible et qu’il a donc composé le livre « en manera de preguntas e respuestas que fazían entre sí un rey et un infante su fijo, e un cavallero que crió al infante et un philósofo. Et pus nonbre al rey, Morabán, et al infante Johas, et al cavallero, turín, et [al] philósofo Julio » (Libro de los estados, éd. citée, p. 73). Dans le prologue du Conde Lucanor, on trouve une formule analogue : « Et pues el prólogo es acabado, de aquí en adelante començaré la materia del libro en manera de un grand señor que fablava con un su consegero. Et dizían al señor, conde Lucanor, et al consegero, Patronio » (don juan manuel, El conde Lucanor, Guillermo serés [éd.], Barcelone : Crítica, 1994, p. 14). Dans ce dernier cas, cependant, la fiction est annoncée de façon plus subtile, à la jonction du paratexte et du texte, par une formule qui donne l’illusion que l’énonciation s’abandonne déjà à la fiction (ce « dizían » évoque déjà les personnages comme s’ils avaient existé).
208 OLIVIER BIAGGINI
le Libro de los estados. Don Jaime de Jérica, ami de l’auteur, joue un rôle important dans les parties II à V du Conde Lucanor : il n’est pas exactement un dédicataire de l’œuvre (son nom n’apparaît pas dans le prologue prin-cipal), mais à partir du prologue de la deuxième partie, don Juan Manuel affirme que c’est à sa demande qu’il a entrepris de prolonger le livre. Ces mentions révèlent que don Juan Manuel envoie ses œuvres à ses proches pour qu’ils les lisent, mais, au-delà du reflet d’une pratique, leur interven-tion dans le paratexte permet surtout l’élaboration d’une figure de destina-taire. Dans les deux premiers cas, soumettre son œuvre à l’archevêque de Tolède permet aussi de situer son écriture, vernaculaire et imprégnée de valeurs nobiliaires, vis-à-vis des modèles dominants d’une écriture latine emblématique du monde clérical.
Le Libro del cavallero et del escudero est introduit par deux pièces liminaires : un court exorde qui, dans la configuration actuelle du manuscrit, n’est pas formellement séparé du début de la narration, et, placée avant lui, une lettre-prologue adressée à Jean d’Aragon. La première pièce mentionnée imite les prologues alphonsins en reprenant le topos de l’éloge du savoir comme la meilleure chose au monde et en insistant sur la nécessité d’ac-croître (acresçentar) ce savoir. En outre, pour les sages soucieux de la pro-motion du savoir,
[…] vna de las cosas que lo mas acresçenta es meter en scripto las cosa que fallan […] [Et] por ende yo, don Iohan, fijo del infante Manuel, fiz este libro en que puse algunas cosas que falle en vn libro. […] Et otrosi puse y algunas otras razones que falle scriptas et otras algunas que yo puse que perteneçian para seer y puestas27.
Par cette mise en avant de sa propre personne comme promoteur du savoir, don Juan Manuel a symboliquement remplacé Alphonse X, à qui reve-nait, dans les prologues des œuvres précédentes, la fonction d’accroître le savoir. Le savoir qui sera exposé a été trouvé dans un livre (allusion pro-bable au Llibre de l’ordre de cavalleria de Raymond Lulle, mais cette source reste non identifiée) et, cependant, don Juan Manuel ne s’est pas contenté de reproduire sa matière, ajoutant des éléments trouvés dans d’autres sources (« algunas otras razones que falle scriptas ») et même des éléments de son cru (« otras algunas que yo puse »). Cet exorde dresse donc un portrait de don Juan Manuel en compilateur, mais n’exclut pas non plus de faire de lui un auctor si l’on pense à la célèbre définition qu’en donne Bonaven-ture dans le prologue à son commentaire des Sentences de Pierre Lombard28.
27. Libro del cavallero et del escudero, éd. citée, p. 41.28. Selon Bonaventure, l’auctor (au-delà du scriptor, du compilator et du commentator) est celui
qui écrit à partir d’une matière appartenant en partie à autrui et en partie à lui-même, sa matière propre étant la principale et la matière d’autrui servant seulement à confirmer la sienne. Voir Alistair J. minnis, Medieval theory of Authorship, Aldershot : Wildwood House, 1988, p. 94.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 209
À première vue, cette définition de soi contraste avec celle que construit la lettre-prologue adressée à Jean d’Aragon. L’activité littéraire n’y est plus présentée comme une contribution au savoir universel, mais, bien plus modestement, comme un possible remède aux insomnies. Don Juan Manuel y déclare qu’il se fait lire des livres lorsque ses soucis l’empêchent de dormir et qu’il a commencé celui-ci à Séville, une nuit sans sommeil. S’il envoie cette œuvre, qualifiée de fabliella, à son beau-frère, c’est parce qu’il sait qu’il est lui aussi sujet aux insomnies et qu’il pourra peut-être y trouver quelque distraction. Outre cette réduction de l’œuvre littéraire à sa fonction récréative et prophylactique, don Juan Manuel sacrifie au topos de modestie en soulignant qu’il ne peut, en tant que laïc (« yo que so lego, que nunca aprendi nin ley ninguna sciencia »29), rivaliser dans le champ de l’écriture avec le prélat érudit (« uos, que sodes clérigo et muy letrado »30). Il ne peut pas non plus fonder son autorité d’écriture sur son autorité politique, car les tracas nocturnes qui sont à l’origine de la production de l’œuvre concer-nent précisément sa situation politique : les grands desseins qu’il croyait que Dieu avait pour lui et qui avaient commencé à se réaliser n’ont fina-lement pas abouti. On peut lire dans cet aveu la déception de don Juan Manuel de se voir écarté des affaires du gouvernement après la majorité d’Alphonse XI et, remède aux soucis politiques, l’œuvre littéraire est donc investie d’une vertu consolatrice et compensatoire.
Toutefois, d’autres éléments de la lettre-prologue dépassent la posture conventionnelle de la modestia auctoris et paraissent plus compatibles avec l’ambition exprimée dans l’exorde. Auteur de cette fabliella, don Juan Manuel a conscience de l’écart qui le sépare d’un grand lettré comme l’archevêque, à qui il envoie son œuvre pour qu’il la juge et, éventuelle-ment, la corrige, mais, d’une part, la familiarité de la lettre relativise cet écart et, tout en jouant avec une hiérarchie supposée entre clerc et laïc, l’auteur souligne les points communs qu’il a avec son destinataire (chacun d’eux est un « mal dormidor » en quête de remèdes littéraires). Ce jeu est tout entier contenu dans la formule de politesse « hermano señor » par laquelle don Juan Manuel s’adresse à son beau-frère et qui dit une relation à la fois verticale et horizontale. D’autre part, la lettre se termine par une boutade, révélatrice de desseins bien immodestes : de même que l’archevêque lui a envoyé une de ses œuvres en latin consacrée au Pater Noster pour qu’il la traduise en roman, don Juan Manuel lui envoie à présent sa fabliella pour qu’il la traduise en latin. À force d’abuser de la symétrie entre le laïc et le clerc, don Juan Manuel en arrive à une proposition clairement ironique : comment imaginer que l’archevêque de Tolède, versé dans la théologie
29. Libro del cavallero et del escudero, éd. citée, p. 39.30. Ibid., p. 40.
210 OLIVIER BIAGGINI
et la scolastique, puisse traduire en latin une œuvre de fiction ? Cepen-dant, le caractère incommensurable des deux types de production, loin de miner la légitimité du Libro del cavallero et del escudero, permet de bâtir autour d’elle un rempart d’indétermination qui la protège. Si don Juan Manuel se mesurait à l’archevêque dans le champ de l’écriture proprement cléricale, son œuvre n’aurait sans doute aucune valeur et, par conséquent, elle doit se construire un domaine propre qui invalide la comparaison et neutra-lise la hiérarchie. Ce domaine reste peu défini, si ce n’est par son choix de la fiction. Don Juan Manuel finit sa lettre-prologue en disant que le livre qu’il envoie est rédigé dans une graphie et sur un parchemin médiocres, mais qu’il lui donnera une meilleure facture matérielle s’il plaît à l’ar-chevêque : l’œuvre, jusque dans sa dimension matérielle, reste en attente de reconnaissance, en souffrance, mais elle peut ainsi pointer un régime d’autorité qui est lui-même en construction hors des conventions admises.
Dans une large mesure le paratexte du Libro de los estados reprend et ren-force le dispositif posé par celui du Libro del cavallero et del escudero. Toute-fois, la configuration actuelle de l’œuvre dans le seul manuscrit conservé résulte, comme l’a démontré Leonardo Funes31, d’une recomposition de copiste. Le découpage des deux parties de l’œuvre en, respectivement, cent et cinquante chapitres n’incombe pas à don Juan Manuel et il a été motivé après coup en raison de la perfection numérologique qu’il appor-tait. Il s’est accompagné d’une intégration des prologues de l’auteur dans le corps du texte (le prologue de la première partie, scindé, en occupe les chapitres I et II ; celui de la seconde occupe le chapitre I de celle-ci) et de l’ajout de nouvelles pièces paratextuelles, avant le texte (un incipit annon-çant l’insertion de l’œuvre dans le volume ; une table des chapitres soli-daire de la pièce précédente ; un nouvel incipit qui répète le premier et l’annonce du premier chapitre) et à l’intérieur du texte (les mentions de chapitre, assorties d’épigraphes). Ces éléments ajoutés, importants pour étudier la réception de l’œuvre manuéline au xve siècle et la construction de sa postérité32, ne peuvent rien nous dire du projet de don Juan Manuel lui-même, qui ne peut être appréhendé qu’à partir des deux prologues qui constituent les chapitres initiaux des deux parties.
Le premier est une lettre-prologue qui, comme dans le Libro del caval-lero et del escudero, est adressée à Jean d’Aragon, pour soumettre le livre à sa lecture attentive. D’ailleurs, à la fin de cette pièce, don Juan Manuel indique qu’il a commencé à rédiger son œuvre immédiatement après avoir achevé la précédente, soit sans doute en 1327-1328, renforçant ainsi l’effet
31. Voir L. funes, « La capitulación del Libro de los estados… ».32. Par exemple, l’incipit attribue, à la troisième personne, la production de l’œuvre à
don Johán en employant le verbe componer : « Este libro compuso don Johan… » (Libro de los estados, éd. citée, p. 69).
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 211
de continuité formelle. La continuité est aussi thématique puisque la men-tion des soucis personnels qui apparaissait dans la première lettre-prologue se prolonge ici par l’évocation d’un « doloroso e triste tiempo » qui serait le contexte d’écriture de cette nouvelle œuvre. Le point de départ du pro-logue, corroboré par une citation de Boèce qui est l’incipit de la Consola-tion de la Philosophie, est que les œuvres et les paroles dépendent du temps où elles s’inscrivent et des circonstances qui entourent leur production :
[…] los tienpos et las cosas que en ellos acaesçen mudan los fechos, et todos los philósofos et los prophetas et después los sanctos, segunt las cosas que les acaesçieron en cada tienpo, así dizían et fazían sus dichos et sus fechos33.
Toute parole, même la parole d’autorité des philosophes, des prophètes et des saints (qui représentent respectivement les régimes d’écriture du monde païen, de la Loi ancienne et de la Loi nouvelle), est contingente et dépend des circonstances de son énonciation. Cette façon de « recontex-tualiser » une auctoritas qui, dans les usages communs, est faite pour s’appli-quer indifféremment à tout contexte permet à don Juan Manuel d’établir un parallélisme avec sa propre parole : « Por ende, segu[n]d el doloroso et triste tienpo en que yo lo fiz, cuidando cómmo podría acertar en lo mejor et más seguro, fiz este libro que vos envío »34. Comme ces prestigieux auteurs, il a fait un livre (en étant pleinement responsable de sa facture : « fiz ») qui est aussi le produit des circonstances qui l’ont vu naître. Don Juan Manuel présente donc son œuvre comme l’émanation de cette période de sa vie, sans en préciser d’emblée le contenu. Il justifie ensuite la forme fictionnelle qu’il lui a donnée au livre et ce n’est qu’en dernier lieu, presque incidemment, qu’il évoque sa matière : « Et porque entiendo que la salvación de las almas a de ser en ley et en estado, por ende convino, et non [se] puede escusar de fablar algu[n]a cosa en las leys e en los estados »35. La thèse principale du Libro de los estados est énoncée comme s’il s’agissait d’un à-côté du livre, d’un thème mineur devant être abordé en lien avec un thème principal qui, lui, resterait dans l’ombre. Ensuite, le prologue s’en remet à une rhétorique de la modestie et de la captatio benevolentiae pour que l’archevêque accueille le livre avec indulgence, assuré de la bonne intention de son auteur au service de Dieu.
Ce qui est frappant ici, c’est la préséance, dans le prologue, de la moti-vation circonstancielle ou existentielle, dictée par le tienpo individuel, par rapport à l’utilité universelle que l’œuvre doit pourtant viser. J’y vois une justification d’un élément essentiel de la fiction : le fait que Julio, le pré-dicateur castillan qui convertit au christianisme l’infant païen, le roi son
33. Ibid., p. 71-72.34. Ibid., p. 72.35. Ibid., p. 73.
212 OLIVIER BIAGGINI
père et tout son royaume, soit présenté comme l’ancien précepteur de don Johán et rapporte des anecdotes personnelles qui le concernent ou font allusion, précisément, à son conflit avec le roi Alphonse. Si on lit le texte à la lumière de cette logique énoncée dans le paratexte, cela signifierait que don Juan Manuel ne considère pas ces passages pseudo-autobiographiques comme des digressions par rapport à la doctrine enseignée (qui conjugue des discours de théologie, de morale chrétienne et de théorie politique), mais au contraire comme leur point de départ : c’est la revendication d’un point de vue individuel qui détermine l’orientation de tous les autres discours.
Cette revendication est également présente dans le prologue de la deu-xième partie, postérieur à 1330, qui se présente lui aussi comme une lettre adressée à Jean d’Aragon (qui n’est plus alors archevêque de Tolède, mais archevêque de Tarragone et patriarche d’Alexandrie). Don Juan Manuel y reprend l’idée de tienpo comme facteur déterminant de l’écriture. Pourtant, cette fois, le temps en question ne renvoie pas à une époque de sa vie per-sonnelle, mais à un moment du calendrier liturgique : don Juan Manuel entreprend son second livre à la Pentecôte et donc, malgré la difficulté de la tâche – d’autant plus ardue qu’il s’intéresse maintenant à l’estado des clercs après avoir traité celui des laïcs –, il peut espérer bénéficier d’une illumination divine. Tout en soumettant son livre à l’appréciation d’un prélat, don Juan Manuel mise sur l’inspiration divine qui, idéalement, lui permettrait de soustraire l’écriture à la médiation du savoir clérical. En outre, le prologue s’achève sur une image fort éloignée du monde clérical et propre au monde nobiliaire : de même qu’on emploie des carreaux d’arbalètes de faible valeur pour tuer une bête lorsqu’on a peu de chances de l’atteindre et qu’on se réjouit alors d’autant plus si l’on touche la cible, de même don Juan Manuel parie sur les chances de succès de sa modeste écriture. Par cette comparaison quelque peu forcée, l’auteur du Libro de la caza ramène « sur son terrain » les enjeux de l’écriture. Si une individua-lité est ici posée comme justification du livre, elle est, plus clairement que dans le premier prologue, associée à une catégorie sociale, à un estado. Le Libro de los estados, au-delà de toutes les règles de conduite qu’il prescrit aux bellatores dans sa première partie, cherche avant tout à imposer une parole et une écriture qui leur seraient propres et c’est à ce titre que le livre peut à présent aborder la condition des clercs : si la matière varie, le point de vue reste identique, assigné à l’estado, ce qui justifie qu’un laïc ose produire un discours sur les clercs. On comprend alors rétrospectivement pourquoi le prologue de la première partie semblait reléguer au second plan l’an-nonce de la matière de l’œuvre : pour conjurer par avance les éventuelles objections à son entreprise hardie, don Juan Manuel fait porter son effort rhétorique non sur l’exposition d’une doctrine, mais sur sa légitimité à en
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 213
exposer une. Le paratexte étant le lieu où s’élabore un point de vue sur le texte, il peut devenir aussi le lieu d’émergence d’une figure d’auteur qui s’arroge ce point de vue en le rapportant à des circonstances personnelles.
C’est aussi de points de vue qu’il est essentiellement question dans le prologue du Conde Lucanor. Ce prologue n’est pas la seule pièce paratex-tuelle de l’œuvre : il faut tenir compte aussi d’un deuxième prologue, situé après la première partie et conçu après coup pour introduire et justifier l’adjonction des parties II à V, achevées en 1335. Plusieurs années plus tard, après la rédaction du prologue général, s’ajoute un avant-prologue qui en reprend le contenu (mais à la troisième personne) et dont la plu-part des critiques pensent qu’il n’est pas de don Juan Manuel36. Le pre-mier prologue du Conde Lucanor, d’un point de vue formel, s’inscrit dans la droite ligne de ceux des œuvres précédentes. L’usage d’une première per-sonne du singulier et la revendication personnelle de la facture de l’œuvre sont maintenant acquis : « Por ende yo, don Johán, fijo del infante Manuel, ade-lantado mayor de la frontera et del regno de Murcia, fiz este libro […] »37. Comme dans le Libro de los estados, on note l’absence de mention d’une source ou d’un antécédent, ainsi que le choix volontariste de la fiction. Cependant, l’enjeu rhétorique du prologue s’est considérablement déplacé par rap-port à ceux du Libro de los estados, car, pour la première fois, l’effort de jus-tification porte sur la formule de composition de l’œuvre : « […] fiz este libro conpuesto de las más apuestas palabras que yo pude, e entre las palabras entre-metí algunos exienplos de que se podrían aprovechar los que los oyeren »38. Don Juan Manuel s’efforce moins de justifier l’existence de son livre que sa manera, c’est-à-dire les choix formels qu’il a faits pour le composer et, en l’occur-rence, il revendique une écriture hétérogène, qui mêle les mots séduisants aux exemples profitables39, « segund la manera de los físicos » qui, pour soigner le foie, mélangent le médicament à du sucre ou à du miel afin de favoriser son assimilation. La revendication de cette écriture mixte, qui associe docere et delectare, faisant dépendre le premier du second, n’a rien d’original, pas plus que la comparaison entre cette écriture et le remède utilisé par les
36. C’est l’opinion d’Alberto blecua, La transmisión textual de « El conde Lucanor », Barcelone : Universidad Autónoma de Barcelona, 1980, p. 103-104, et de Francisco rico, « Crítica del texto y modelo de cultura en el Prólogo general de don Juan Manuel », in : Studia in honorem pro-fesor Martín de Riquer, 4 t., Barcelone : Quaderns Crema, 1986-1991, 1, p. 409-423. Il n’en reste pas moins que cet avant-prologue prolonge de façon complexe la problématique de l’analogie qui se trouve au centre du projet du Conde Lucanor, comme le montre, à partir d’une analyse de détail, L. De looze, op. cit., p. 105-107.
37. El conde Lucanor, éd. citée, p. 12.38. Loc. cit.39. Comme l’indique L. De looze, op. cit., p. 102, les deux éléments associés ne renvoient
pas à la distinction entre récit et sentence versifiée, deux éléments constitutifs des exempla de l’œuvre, mais désignent plutôt le contenu exemplaire, d’une part, et son habillage rhétorique, d’autre part.
214 OLIVIER BIAGGINI
médecins40. Cependant, il convient de replacer ces lieux communs dans le contexte de l’argumentation globale du prologue.
Le point de départ de cette argumentation est que les visages des hommes, bien qu’ils aient des points communs qui, précisément, en font des visages, sont tous différents par le détail de leurs traits. Plus encore que leurs visages, les intentions ou les volontés des hommes diffèrent elles aussi, si bien qu’il y a autant d’intentions et de volontés différentes qu’il y a d’in-dividus. Don Juan Manuel trouve peut-être ce motif chez Augustin41 et Laurence De Looze le replace dans la réflexion plus globale que El conde Lucanor propose sur la ressemblance et la dissemblance, également carac-téristique de la pensée néo-augustinienne : cette question est à la fois de nature ontologique (le processus de signification ne peut prétendre se fonder sur une adéquation parfaite des signes aux choses) et de nature rhé-torique (l’exemplum est lui-même fondé sur le principe d’analogie et, donc, sur une combinaison d’identité et de différence)42. Elle s’applique plus précisément ici à l’interprétation de l’œuvre à venir, susceptible de dif-férer profondément d’un lecteur ou d’un auditeur à l’autre. Cette diver-sité des interprétations est implicitement présentée comme un danger pour l’œuvre littéraire qui, une fois sortie des mains de son auteur, risque de ne pas jouer le rôle que celui-ci lui assigne. Or, le postulat central du prologue est qu’un seul point commun permet de dépasser cette diver-sité et d’assurer donc une certaine maîtrise de l’auteur sur la réception de son texte : tous les hommes apprennent mieux lorsque cet apprentissage se fait avec plaisir. Il s’agit donc de neutraliser la diversité des récepteurs en axant le livre sur le delectare, capable de suppléer le manque d’entende-ment de certains d’entre eux :
Et aun los que lo tan bien non entendieren non prodrán escusar que, en leyendo el libro, por las palabras falagueras e apuestas que el él fallarán, que non ayan a leer las cosas aprove-chosas que son ý mezcladas43.
Ainsi, dès le prologue, le livre assume, dans l’écriture exemplaire qu’il pro-pose, une nécessaire part de manipulation du destinataire, qui permet idéa-lement une stabilité du sens au prix d’un abus rhétorique44. La prise en
40. Voir à ce sujet la note de G. Serés dans son édition, El conde Lucanor, éd. citée, note 13.19, p. 331-332.
41. Ibid., note 11.12, p. 329-330.42. L. De looze, op. cit., notamment p. 117-121.43. El conde Lucanor, éd. citée, p. 13.44. Les ornements rhétoriques du discours exemplaire, ces « palabras falagueras e apuestas »,
apparaissent également, au sein des exempla de la première partie, pour désigner des mensonges utilisés par des personnages à des fins pédagogiques (Patronio préconise, dans l’exemple XXI, que Lucanor imite le philosophe du récit et emploie à son tour des « palabras maestradas et fala-gueras » pour éduquer son jeune protégé, ibid., p. 89) ou à des fins purement égoïstes (dans
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 215
compte du point de vue du destinataire permet ensuite l’affirmation de l’auteur en tant que dépositaire d’un sens déterminé, scellé par son enten-ción, même si le fonctionnement effectif des exempla et des sentences de l’œuvre, ainsi que les fluctuations de leur tradition manuscrite, nous mon-trent que cette volonté de contrôle n’est qu’un fantasme.
Du même coup, El conde Lucanor, dans un premier temps, se passe de l’artifice d’un dédicataire et ce n’est que dans sa continuation, à partir de la deuxième partie, que don Juan Manuel fait intervenir la figure de son ami Jaime de Jérica. Dans le second prologue, il justifie le passage des exemples, langage clair et accessible, aux sentences, langage plus obscur et subtil – soit le passage à une autre manera d’écriture –, par la requête supposée de Don Jaime « que querría que los mis libros fablassen más oscuro et me rogó que si algund libro feziesse, que non fuesse tan declarado »45. Le changement introduit ici par rapport aux prologues des œuvres précédentes est que le destinataire est présenté aussi comme commanditaire : c’est à sa demande que don Juan Manuel reprend la plume comme s’il était devenu un écri-vain reconnu, du moins dans le cercle restreint de ses relations nobiliaires, sollicité par autrui pour produire ses livres. Or, nous le verrons, cette convention est celle qui domine dans les œuvres de la dernière période de production de don Juan Manuel.
Extension au texte des fonctions du paratexte
Une des stratégies à l’œuvre dans l’écriture de don Juan Manuel consiste à brouiller, voire à dissoudre, la frontière entre texte et paratexte. Une exten-sion des fonctions du paratexte à certains passages du texte lui-même pour-rait être mise en évidence, déjà, dans le Libro de la caza, car des opinions, des précisions, des anecdotes personnelles attribuées à don Johán apparaissent abondamment citées dans un texte qui, d’après le prologue, était principa-lement issu de traités alphonsins. L’expression de don Juan Manuel sur le texte n’est donc pas simplement cantonnée aux zones périphériques, mais elle se manifeste de l’intérieur, à la troisième personne, comme si le scribe truffait le texte qu’on lui dicte des commentaires ponctuels ajoutés par son dictator. En outre, ces interventions ont, pour une bonne part, une visée critique : souvent introduites par la formule « Pero dize don Iohan… », elles relativisent et parfois désavouent la matière principale du livre au point de déclarer, au nom de l’expérience, que le savoir livresque sur la chasse
l’exemple V, Patronio détecte la tromperie sous les « palabras fremosas » d’un adulateur de Lucanor et montre à ce dernier que le renard de la fable parvient à tromper le corbeau par des « falagos », ibid., p. 38 et 39).
45. El conde Lucanor, éd. citée, p. 226.
216 OLIVIER BIAGGINI
ne saurait prévaloir sur le jugement pratique du chasseur. Ainsi, non seu-lement de nombreux points techniques, contre les préconisations d’abord exposées, sont finalement laissés à l’appréciation du fauconnier, mais l’uti-lité même du livre est déclarée relative, ce que montre en particulier une évocation des plus comiques : si un fauconnier essayait de lire le livre sous la pluie ou en chassant une grue dans une rivière, il le mouillerait et le livre serait perdu46. Non seulement la théorie doit céder le pas à la pra-tique, mais le livre doit être lu à un double niveau. Il transmet un savoir admis mais, surtout, fait émerger la figure de son auteur en marge de ce savoir – et même contre celui-ci – en transférant les fonctions du paratexte à certains passages du texte lui-même. Il faut néanmoins se garder de trop exploiter le Libro de la caza pour mesurer une évolution car, si l’on accepte l’hypothèse de la double rédaction proposée par Germán Orduna47, ces remarques personnelles de don Juan Manuel pourraient aussi être des ajouts tardifs. Sans remettre en cause cette hypothèse, il me semble néan-moins que cette tendance à l’inclusion, dans un discours premier, d’un discours second adoptant face à lui une posture critique est une caracté-ristique de l’ensemble des œuvres de don Juan Manuel.
Le paratexte dans la fiction : du Libro del cavallero et del escudero au Conde Lucanor
Malgré le caractère incomplet de la version du Libro del cavallero et del escu-dero qui nous est parvenue, la structure d’ensemble du traité a pu être reconstituée48. Avant que l’écuyer ne soit armé chevalier, il reçoit du che-valier ermite un enseignement qui répond à la série de questions qu’il lui a posées. Même si cette première partie du récit reste très lacunaire, on lit ensuite que le maître n’a répondu qu’à une partie des questions posées par son élève :
[…] vos he respondido lo mejor que yo pude a las preguntas que yo entendi que vos cunplian para el vuestro estado, de las que me fizistes, et a las otras que vos non respondi, dexolo porque cuydo que vos non fazen tan grant mengua de las saber49.
Le texte a donc affiché un programme et, en même temps, refuse d’en
46. Libro de la caza, in : J. M. fraDejas rueDa (dir. et éd.), op. cit., p. 157.47. Voir G. orDuna, « Los prólogos… », p. 119.48. Dans l’unique manuscrit conservé, il manque la quasi-totalité des seize premiers cha-
pitres. Barry Taylor a tenté une reconstruction des passages manquants, en tenant compte des renvois d’un chapitre à l’autre, mais aussi de la table des matières de l’œuvre qui apparaît dans le Libro de los estados et qui s’énonce depuis la fiction, puisque c’est Julio, un des person-nages du dialogue, qui se réfère au Libro du cavallero et en dresse pour l’infant la liste des cha-pitres. Voir Barry taylor, « Los capítulos perdidos del Libro del cavallero et del escudero y el Libro de la caballería », Incipit, 4, 1984, p. 51-69.
49. Libro del cavallero et del escudero, éd. citée, p. 52.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 217
traiter une partie, établissant ainsi une sélection critique, une discrimina-tion entre les questions qui sont utiles et celles qui ne le sont pas pour un homme dont l’estado est celui d’un futur chevalier. Une fois que l’écuyer a été armé chevalier, il revient voir l’ermite pour que celui-ci apporte une réponse à ces questions qui avaient été ostensiblement écartées. Le texte met alors en scène l’insistance du cavallero novel, qui se heurte à la réti-cence du chevalier ermite. La curiosité sans bornes et parfois importune de l’élève est un topos des dialogues didactiques médiévaux, très présent, par exemple, dans le Lucidario de Sanche IV50 : en acceptant toujours de répondre à de nouvelles questions, le maître réaffirme sans cesse le lien pri-vilégié qui sous-tend le processus pédagogique. Cependant, dans le traité de don Juan Manuel, ce topos acquiert des proportions inouïes. Non seule-ment l’ermite se fait prier avant de répondre, mais ses réponses contour-nent et détournent ouvertement certaines questions comme s’il s’agissait d’en interroger systématiquement le bien-fondé51, ce qui revient parfois à en saper la pertinence. Cette approche critique, dans quelques cas, est simplement formelle : le chevalier ermite remarque ainsi que son élève lui pose plusieurs questions en une, ce qui l’oblige à segmenter sa réponse pour éviter toute confusion. Mieux, le chapitre 39 est tout entier consacré à un reproche que le chevalier adresse à son élève pour avoir posé tantôt une question unique, tantôt plusieurs questions regroupées en une seule :
Fijo, vos deuedes saber que vna de las cosas que omne deue guardar en lo que faze, et avn en lo que dize, es que non mude la manera de commo lo ha començado […]. E uos en quanto mudastes la manera de non fazer estas preguntas como las otras, tengo que vos puedo reprehender; mas la mi reprehension uos deue ser tal commo el castigo del padre o del buen amigo leal 52.
En critiquant le mode de questionnement qu’adopte le cavallero novel, le texte critique aussi sa propre dispositio. Sans constituer stricto sensu un élé-ment de paratexte, cette critique interne du dialogue est un jugement porté sur l’organisation même du texte et hérite donc d’une des fonctions nor-malement dévolues au paratexte.
Or, il est fréquent que le détournement s’applique au contenu même de la question, ce qui constitue une remise en cause beaucoup plus radi-cale du propos affiché du livre. Lorsque c’est l’opportunité même de la
50. Outre de nombreuses formules placées à l’articulation des questions et des réponses, un chapitre entier du Lucidario, intitulé « Como el diçipulo preguntaua al maestro si querria que le preguntase mas » (Richard P. kinkaDe [éd.], Los “Lucidarios” españoles, Madrid : Gredos, 1968, chapitre XXVII, p. 144-145), sert à confirmer le bien-fondé du processus d’apprentis-sage et à relancer le dialogue.
51. Voir Fernando gómez reDonDo, Historia de la prosa medieval castellana, 4 t., Madrid : Cátedra, 1998-2007, 1, p. 1113 : « […] el caballero anciano enseña y, a la vez, reflexiona sobre los meca-nismos lógicos con que dispone su enseñanza ».
52. Libro del cavallero et del escudero, éd. citée, p. 86.
218 OLIVIER BIAGGINI
question qui est ainsi discutée, les commentaires qui en résultent occu-pent beaucoup plus d’espace textuel que les réponses proprement dites, souvent très laconiques. Par exemple, au chapitre 35, le vieux chevalier répond à son élève qui voulait savoir ce que sont les cieux et pourquoi ils ont été faits. Après avoir signalé qu’il y avait là deux questions en une, c’est la pertinence même de ces questions qu’il remet en cause : « En verdat vos digo, fijo, que a mi paresçe que estas preguntas atales non fazen a vos mengua de me las preguntar, nin pertenesçen a mi de vos responder a ellas »53. D’autres questions du cavallero novel sont ainsi déclarées peu pertinentes, voire nulles et non avenues parce qu’elles ne relèvent pas du savoir propre aux chevaliers54. Dans la plupart des cas où la question posée est ainsi désavouée, la réponse du chevalier ermite s’offre ouvertement comme une digression, au point, parfois, de traiter méticuleusement un problème qui n’a rien à voir avec le thème du chapitre. Cette digression peut même trouver sa justification dans l’arbitraire d’une simple comparaison : par exemple, là où l’élève demande des précisions sur les pierres précieuses (chapitre 45), le maître répond que, de même qu’il y a deux types de pierres, il y a deux façons de vivre, au jour le jour ou bien en prévoyant l’avenir ; là où l’élève s’inter-roge sur la nature de la mer (chapitre 47), le maître répond qu’à l’instar de la mer, les grands seigneurs peuvent être cléments ou montrer leur colère. Dans ce cas, c’est au nom de son expérience personnelle que le chevalier ermite assume l’inadéquation de sa réponse : « Et por que vi yo que muchas vegadas acaeçio esto, et passe por ello, vos puedo fablar en esto mas verdadera mente que en la pregunta que me fiziestes que cosa es la mar »55. Parfois, il déclare que la question conviendrait si elle s’adressait un clerc lettré, selon une opposi-tion qui reprend clairement le face à face entre don Johán et l’archevêque de Tolède tel que le prologue le mettait en scène56.
Tout se passe comme si le texte, par le biais du dialogue de fiction, cherchait à délimiter le savoir qui correspond au chevalier et à son estado : l’objet du traité de don Juan Manuel est moins de transmettre le contenu de ce savoir que de définir son champ. Ainsi, le texte critique de l’inté-
53. Ibid., p. 66.54. C’est le cas des questions du chapitre 34 (sur l’Enfer) ; 36 (sur les aliments), p. 71 ; 37
(sur les planètes), p. 74 ; 43 (sur les plantes), p. 98-99 ; 46 (sur les métaux), p. 105 ; 47 (sur la mer), p. 109, etc.
55. Ibid., p. 110.56. C’est le cas dans le chapitre 34, consacré à l’Enfer : « Fijo, estas preguntas que me fazedes,
muchas de ellas tanen [en] cosas que pertenesçen a la fe, et los legos non son tenidos a saber dellas, si non crer simple mente lo que sancta Eglesia manda. Que los fechos de Dios, que son muy maravillosos et muy escondidos, non deue ninguno ascodriñar en ellos mucho, mayormente los caualleros, que an tanto de fazer en mantener el estado en que están, que es de muy grant periglo et de muy grant trabajo, que non an tiempo nin letradura para lo poder saber conplida mente » (ibid., p. 65). De façon assez subtile, cette distinction met en cause la tendance des clercs à aborder des questions que Dieu a voulu dérober au savoir des hommes, reprenant peut-être sur ce point le prologue du Lucidario.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 219
rieur à la fois sa propre dispositio et sa propre inventio, donnant l’impression de passer au crible de son propre projet : il s’agit avant tout de pointer le savoir utile au chevalier et d’écarter tout ce qui ne correspond pas à son estado. La démarche qui, si l’on s’en tient aux questions posées par le caval-lero novel, semble servir une visée encyclopédique, aboutit dans les faits à un texte qui est le contraire d’une encyclopédie. En outre, non seulement le texte s’arroge une partie des fonctions du paratexte, mais il invalide en retour l’utilité du paratexte proprement dit : les titres de chapitre, dans le Libro del cavallero et del escudero, ne correspondent pas, la plupart du temps, à l’essentiel du contenu développé dans les chapitres correspondants. On voit donc se mettre en place dans cette œuvre ce que nous appellerons un paratexte à deux niveaux. Face à un paratexte formel, sur lequel est jeté le soupçon (à l’ironie de la lettre-prologue s’ajoute l’inadéquation des titres de chapitre), s’impose un paratexte interne au texte (si on veut bien le définir par cette contradiction dans les termes) qui ne peut se construire que par la fiction : c’est à partir du cœur de la fiction, celle des personnages qui parlent, que le texte construit sa réflexivité, discute sa propre facture et pointe sa propre origine. Selon ce dispositif, le personnage du chevalier ermite est un substitut fictionnel de l’auteur non seulement par son statut et son savoir nobiliaires, mais aussi et surtout parce qu’il ordonne, sélec-tionne et réoriente, à l’intérieur même du dialogue, la matière du livre.
Or, dans le Libro de los estados et dans El conde Lucanor, cette analogie ou lien métaphorique entre le monde de l’auteur et celui des personnages se double d’un lien généalogique ou métonymique, à savoir une conti-guïté supposée, à l’intérieur de la fiction, entre les personnages et un cer-tain don Johán. Dans le Libro de los estados, Julio évoque souvent la relation avec un certain don Johán, dont il aurait été le précepteur, dont il rapporte de nombreux éléments biographiques, souvent conformes à ce que nous savons de la vie de don Juan Manuel, et qu’il cite même comme auteur du Libro de la cavallería et du Libro del cavallero et del escudero. Dans la première partie du Conde Lucanor, le nom de don Johán apparaît à la fin de chaque exemplum, dont il est dit qu’il l’a ratifié et qu’il a décidé de l’inclure dans le livre. Ensuite, au fil des parties II à V de l’œuvre, Patronio se réfère de plus en plus fréquemment à ce don Johán, auteur du Libro de los estados et même auteur du livre en cours57.
Dans les deux cas, ce don Johán est posé comme un double de don Juan Manuel dans son texte et trouve sa place au sein de la fiction, comme s’il en était lui-même un personnage. Le rapport qu’entretiennent avec lui
57. Sur ces transgressions narratives, je me permets de renvoyer à Olivier biaggini, « Stra-tégies du texte hétérogène dans le Conde Lucanor de don Juan Manuel », Atalaya, 11, 2009 [en ligne] [URL : http://atalaya.revues.org/377], consulté le 15 novembre 2012.
220 OLIVIER BIAGGINI
les personnages lui confère un rôle stratégique face au savoir et au livre qui contribuent à construire son autorité. Dans le Libro de los estados, Julio est un clerc, qui a tout d’un prédicateur et qui, auprès de l’infant païen, se substitue à un premier maître, nommé Turín, qui était un chevalier mandaté par le roi. On a ici un dépassement du schéma pédagogique mis en place par le Libro del cavallero et del escudero, dans lequel il s’agissait de réduire le champ du savoir aux préoccupations propres au chevalier et, donc, d’écarter le savoir clérical. Dans ce nouveau livre qu’il envoie aussi à son beau-frère l’archevêque de Tolède, don Juan Manuel ose faire parler un clerc et, en toute logique, lui fait endosser un discours qui traduit sa propre doctrine. Pourtant, il ne s’agit pas de renoncer à la primauté de l’estado dans la recherche pragmatique du salut, bien au contraire, car la parole de Julio est intimement liée à son ami don Johán, double de l’auteur. Dès la première mention que Julio fait de cet ami, il souligne que l’ensei-gnement s’est fait dans les deux sens. Julio a été son précepteur, mais il dit aussi de lui :
E por las grandes guerras quel acaesçieron et por muchas cosas que vio et que pasó, despar-tiendo entre él et mí, sope yo por él muchas cosas que pertenesçen a la cavallería de que yo non sabía tanto, porque só clérigo, e el mi ofiçio es más de pedricar que de usar de cavallería58.
La généalogie du savoir en est inversée : c’est le clerc qui a appris du chevalier et qui va enseigner grâce à lui à l’infant une pratique du salut encadrée par les contraintes sociopolitiques de son estado. Ce dispositif est un relais du paratexte, puisqu’il met en scène un personnage nommé don Johán, double de l’auteur à l’intérieur de la fiction, comme origine autorisée du discours. Autorisé, il l’est, car Julio ne se réfère pas seule-ment à lui comme à un ami, mais aussi comme à un auteur, notamment lorsqu’il renvoie au Libro de la cavallería ou au Libro del cavallero et del escu-dero, ou encore lorsqu’il cite un autre de ses discours parmi les autorités les plus prestigieuses59.
Dans le Conde Lucanor, il en va de même, puisque Patronio se réfère explicitement à des œuvres antérieures de don Johán, notamment le Libro de los estados, qui est présenté en outre comme une œuvre exceptionnelle60. La construction d’une autorité, de la part de don Juan Manuel, passe ici par la construction fictionnelle d’une altérité : posé comme un proche et un lecteur de don Juan Manuel, Julio peut le citer comme une auto-rité. Il s’agit bien d’une autocitation déguisée, mais le dispositif choisi, outre qu’il permet de ne pas déroger trop ouvertement à la modestia auc-
58. Libro de los estados, éd. citée, p. 100.59. Ibid., respectivement p. 200 et p. 187.60. Ces références apparaissent dans la cinquième partie de l’œuvre. Don juan manuel,
El conde Lucanor, éd. citée, p. 263 et 275.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 221
toris, ouvre des perspectives littéraires beaucoup plus riches : la multipli-cation des voix permet que les discours puissent toujours être assumés à plusieurs niveaux, l’énonciation de don Juan Manuel étant tour à tour mise en retrait et mise en avant.
Cependant, don Johán est plus qu’un double de don Juan Manuel inscrit dans la fiction. En effet, le rapport des personnages à don Johán leur permet aussi de transgresser ouvertement les frontières du monde fictionnel. Dans le Libro de los estados, Julio renvoie fréquemment au dialogue qui le lie à l’in-fant Joas comme à un texte écrit et il peut même se référer au livre que le lecteur a sous les yeux : il dit en particulier que, pour ne pas déroger à l’impératif de brevitas, il serait pour lui trop long d’écrire dans ce livre telle ou telle chose61. Ces références transgressives de Julio au livre dont il est lui-même le personnage ne sont pas de simples erreurs énonciatives ou raccords maladroits de la part de don Juan Manuel. Il s’agit bien là d’une stratégie pensée et assumée lorsqu’à la fin de la première partie du Libro de los estados, Julio et don Johán apparaissent comme coproducteurs et donc, en quelque sorte, co-auteurs du texte écrit :
Al infante plogo mucho desto que Julio le dizía, e pues non cunplía nin fazía mengua de poner ý más, dexólo por acabado et rogó a don Johan, su criado et su amigo, que lo cunpliese. Et por su consejo et por su ruego, acabó don Johan esta primera parte deste libro en Pozancos, lugar del obispo de Çigüenza, martes veinte e dos días de mayo, era de mill et trezientos et sesenta et ocho. Et en este mes de mayo, cinco días andados dél, conplió don Johan quarenta e ocho años 62.
Le procédé consiste avant tout à créer l’illusion d’une continuité sans faille entre le discours de Julio63 et celui de don Johán qui, de personnage posé par la fiction, en arrive in fine à coïncider avec le don Juan Manuel de chair et d’os, parfaitement situé dans un espace et dans un temps qui sont ceux de la rédaction de l’œuvre.
Dans le Conde Lucanor, les transgressions de ce type sont également pré-sentes et prennent même une forme plus radicale. Patronio, contraire-ment à Julio, n’a aucun lien personnel affiché avec don Johán. Il se réfère à lui comme auteur du Libro de los estados, mais aussi du livre que le lecteur a sous les yeux. Au début de la cinquième partie, assumant un paratexte à l’intérieur du texte (et de la fiction), Patronio précise que les parties pré-cédentes du livre ont consigné des propos subtils, obscurs et abrégés « por talante que don Johán ovo de conplir talante de don Jayme »64. Patronio fait non
61. Les termes escriptura ou escripto désignent le discours en cours d’énonciation à de nom-breuses reprises. Voir Libro de los estados, éd. citée, p. 185, 191, 193-194, 213, 243, 244, etc.
62. Ibid., p. 294-295.63. Je n’adhère pas à l’interprétation de G. orDuna, « …Yo, don Johán, fijo del infante
Manuel… », Estudio preliminar, in : El conde Lucanor, éd. citée, p. XXVIII, selon laquelle ce serait l’infant Joás, plutôt que Julio, qui s’adresserait à don Johán pour qu’il achève le livre.
64. El conde Lucanor, éd. citée, p. 294-295.
222 OLIVIER BIAGGINI
seulement référence à son créateur, mais aussi au commanditaire des livres de sentences et aux circonstances qui sont censées avoir produit le texte dont il est lui-même un personnage. La transgression des conventions nar-ratives est ici frontale et aucun artifice de vraisemblance ne tente de l’atté-nuer. Il s’agit bien d’imaginer un paratexte qui viendrait de l’intérieur du texte, qui serait produit par lui. Le procédé, d’une part, donne l’illusion d’une œuvre autonome, dégagée de toute contingence, et, d’autre part, produit une autolégitimation : plus qu’une figure de l’auteur produisant et validant un discours, don Juan Manuel imagine un discours qui pro-duit et valide son auteur.
L’émergence de la figure de don Johán est progressive dans El conde Lucanor, puisqu’elle apparaît d’abord à la fin de chaque exemplum dans la première partie. On a ici un cas indéniable de pénétration du paratexte dans le corps du texte puisque, de façon systématique, chaque exemple s’achève en pointant l’origine de son inscription dans le livre. Une fois que Patronio a achevé le récit qu’il adresse au comte Lucanor et qu’il en a tiré son conseil, le narrateur premier déclare que le comte a apprécié cet exemple et qu’il s’en est bien porté (« e fallose ende bien »), ce qui constitue une première validation de l’exemple, interne à la fiction. Puis ce même narrateur, sans rupture apparente de l’énonciation, indique ensuite que don Johán a lui-même jugé l’exemple fort bon et qu’il a décidé de l’in-clure dans le livre en lui adjoignant des vers conclusifs de son cru. Dans le manuscrit S, ce même narrateur annonce enfin l’inclusion d’une image (une estoria) censée synthétiser l’exemple, sans que l’on sache si ces images ont existé ou non dans la version originale de l’œuvre ou dans une ver-sion intermédiaire de sa tradition textuelle. Le paratexte ressurgit donc en force cinquante et une fois au sein de la première partie du Conde Lucanor et chaque occurrence rappelle que, plus que l’auteur de l’exemple, don Johán, après avoir jugé sa teneur, est le responsable de son inclusion dans le livre. Le narrateur serait alors figuré comme un exécutant, un scribe aux ordres de don Jóhan, ce qui peut éventuellement refléter une pratique réelle du scriptorium manuélin, mais offre surtout un portrait de don Juan Manuel en compilateur tout-puissant qui fait rédiger une œuvre d’abord en vertu d’une fonction sociale et politique, à la manière d’un Alphonse X.
Paratexte testimonial : du Libro infinido au Libro de las armas
On peut considérer qu’une troisième période dans la production litté-raire de don Juan Manuel commence un peu avant 1337, date de la paix à peu près définitive qu’il conclut avec Alphonse XI et qui met fin à sa tumultueuse vie politique. Elle donne lieu notamment à des œuvres qui se recentrent sur une problématique familiale, tels le Libro infinido (vers
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 223
1336-1337)65, qui se présente comme un legs de don Juan Manuel à son fils Fernando, et le Libro de las armas (postérieur à 1337), qui entend, à partir d’anecdotes familiales, exalter le lignage des Manuel, en l’opposant clai-rement au lignage d’Alphonse XI, dont le livre montre que, avant même la naissance d’Alphonse X, il était entaché de sinistres présages. Toute-fois, cette thématique familiale n’est pas suffisante pour rendre compte de cette troisième période, ne serait-ce que parce que l’on conserve aussi un tratado de la Asunción de la Virgen (postérieur à 1335 et peut-être bien plus tardif car il n’est pas mentionné dans la liste des œuvres que don Juan Manuel établit dans son prologue général). De même, c’est sans doute de cette époque que date une œuvre perdue, le Libro de las reglas de cómmo se deue trouar, un art poétique dont la thématique ne devait pas être familiale.
Plutôt que le critère thématique, donc, c’est un critère formel qui peut permettre de saisir la cohérence de cette production : le point commun des trois œuvres conservées est l’intervention directe de don Juan Manuel à la première personne non seulement dans l’espace paratextuel, comme c’était déjà systématiquement le cas depuis le Libro del cavallero et del escudero, mais aussi, pour la première fois, dans le corps du texte. Ainsi, la frontière entre le paratexte et le texte devient de plus en plus diffuse du point de vue énonciatif : le yo de don Juan Manuel tend à occuper indistinctement tout l’espace de l’œuvre. Cette façon de centrer l’œuvre sur soi, sans passer cette fois par des relais fictionnels, consacre une modalité d’écriture que l’on peut nommer autobiographique66, mais qui possède ses propres filtres et engage ses propres stratégies énonciatives. Pour cette raison, je préfère l’appeler testimoniale, car, au détriment parfois de la vraisemblance auto-biographique, le critère de vérité revient à l’expérience personnelle que l’auteur affirme avoir faite des choses qu’il rapporte.
Le prologue du Libro infinido réunit trois caractéristiques présentes dans les paratextes antérieurs (les deux premières, dès le prologue du Libro del cavallero et del escudero et la troisième, dans le prologue de la deuxième partie du Conde Lucanor) : don Juan Manuel y parle à la première personne ; il y
65. Cette datation reste hypothétique. Carlos Mota, dans son édition de l’œuvre, envisage un intervalle plus ample : « […] la redacción puede datarse entre 1334 y 1337, siendo posible extender esta fecha hasta los aledaños de 1340 » (don juan manuel, Libro infinido, Carlos mota (éd.), Madrid : Cátedra, 2003, p. 60). Au moins la partie finale du livre, correspondant au chapitre 25, a dû être rédigée après 1335, puisque l’auteur s’y réfère au « libro que yo fiz de Patronio » (ibid., p. 177), quoiqu’il puisse très bien se référer à une première version de El conde Lucanor constituée seule-ment du livre d’exempla. Même dans le cas où la rédaction du Libro infinido chevaucherait celle du Conde Lucanor, la façon que don Juan Manuel a de s’inscrire dans son livre inaugure bien une nouvelle période de sa production littéraire.
66. Sur la notion d’autobiographie chez don Juan Manuel, voir G. orDuna, « La auto-biografía literaria de don Juan Manuel », in : Don Juan Manuel. VII centenario, Murcie : Univer-sidad de Murcia-Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 245-258, et L. funes, « Las paradojas de la voluntad de autoría… ».
224 OLIVIER BIAGGINI
revendique la facture de l’œuvre ; et il déclare qu’il a entrepris la rédaction du livre à la demande de quelqu’un d’autre. En l’occurrence, ce comman-ditaire de l’œuvre est aussi son principal destinataire et il s’agit du jeune fils de l’auteur, Fernando : « Et fizlo para don Ferrando, mío fijo, que me rogó quel fiziese un libro, et yo fiz este para él et para los que non saben más que yo et él, que es agora, quando lo comencé, de dos años »67. Fernando est déclaré commandi-taire de l’œuvre au détriment de toute vraisemblance, puisqu’il est âgé de deux ans. Cette contradiction peut laisser perplexe, mais elle renvoie à des modèles identifiables68 et dit bien à quel point, pour don Juan Manuel, l’adéquation de son prologue à certains critères formels prime sur toute expression strictement autobiographique : il s’agit d’observer un impératif stratégique selon lequel l’œuvre doit être issue d’une commande et non d’une décision spontanée de l’auteur. Cette idée est par ailleurs réactivée à la fin du traité puisque l’argumentation finale consacrée à « las maneras de amor » qui classe l’amour en quinze catégories est présentée comme un ajout rédigé à la demande de fray Johán Alfonso69 : « […] después que fiz este libro me rogó Fray Johan Alfonso, vuestro amigo, quel scribiese lo que yo entendía en la manera del amor […] »70.
Par bien des aspects, le prologue du Libro infinido permet de mesurer la distance qui le sépare des productions précédentes. Deux valeurs, impli-citement présentes dans d’autres prologues, sont ici exacerbées : le savoir vu comme un instrument du pouvoir ; l’expérience personnelle comme critère de vérité du texte.
Le point de départ de l’argumentation ressemble fort à celui de l’exorde du Libro del cavallero et del escudero, puisqu’il consiste en un éloge du savoir. Cependant, là où le Libro del cavallero disait : « la mejor cosa del mundo es el saber »71, le Libro infinido reprend le lieu commun de façon légèrement dif-férente : « la mejor cosa que omne puede aver es el saber »72. Cette nouvelle for-mulation, qui fait du savoir un bien à acquérir et à conserver, s’avère immé-diatement très orientée, puisque ce savoir, outre qu’il permet à l’homme de connaître Dieu et de se distinguer des animaux, est aussi essentielle-ment un instrument d’autorité et de pouvoir : « Et por el saber se onran et se apoderan et se enseñorean los unos omnes de los otros » (loc. cit.). Alors que c’était
67. Libro infinido, éd. citée, p. 118.68. C. Mota, sans exclure un trait d’humour de la part de l’auteur, met en relation son
choix rhétorique et le lieu commun du puer senex (ibid., p. 54-55), tout en le rapprochant du modèle énonciatif du livre biblique des Proverbes (ibid., p. 69).
69. María Rosa liDa De malkiel, « Tres notas sobre don Juan Manuel », Romance philo-logy, 4, 1950-1951, p. 155-194, note 5, p. 185, considère ce personnage comme un frère domi-nicain chargé du couvent féminin de Madrid.
70. Libro infinido, éd. citée, p. 176.71. Libro del cavallero et del escudero, éd. citée, p. 41.72. Libro infinido, éd. citée, p. 113.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 225
un but en soi d’accroître (acresçentar) le savoir dans le Libro del cavallero, le savoir devient ici un moyen d’accroître les chances de succès de l’homme dans un monde inconstant et imprévisible : « Et por el saber se acresçientan las buenas venturas, et por el saber se contrallan las fuertes ocasiones » (loc. cit.). Vient ensuite un développement sur le savoir divin qui montre que, dans la Tri-nité, savoir, vouloir et pouvoir sont indissociablement liés. Même si le savoir de l’homme ne peut jamais être complet, comme l’est celui de Dieu, il lui permet de trouver une stabilité qui conjure l’instabilité du monde. Chaque homme, au cours de sa vie limitée, doit s’efforcer d’acquérir la part de savoir qui lui convient et, en ce qui le concerne, don Juan Manuel déclare que son savoir, contenu dans le livre, se fonde sur son expérience, ce qui l’apparente à un témoignage : « por ende, asmé de conponer este tractado que tracta de cosas que yo mismo prové en mi mismo et en mi fazienda et vi que conteció a otros » (ibid., p. 117).
Plus loin, quand il évoque son fils, il répète qu’il lui adresse son texte « por que sepa por este libro quáles son las cosas que yo prové e vi » et ajoute, s’adressant apparemment à un groupe de destinataires plus ample, que la modalité testimoniale va de pair avec une vérité indubitable : « Et cred por çierto que son cosas probadas e sin ninguna dubda » (ibid., p. 118). Le texte adopte le critère de l’expérience comme le principe de son inventio, mais aussi comme celui de sa dispositio : à la fin du prologue, don Juan Manuel déclare que le livre reste ouvert (d’où son nom d’« enfinido », soit « sin acabamiento ») parce qu’il se réserve le droit d’y ajouter de nouveaux chapitres au fur et à mesure que de nouvelles expériences personnelles le justifieront. Cette idée est égale-ment reprise dans la partie finale de l’œuvre pour justifier l’insertion de la pièce intitulée « De las maneras de amor » : « et porque prové algunas cosas más de las que avía provado, quiérovos fablar en lo que después prové. Et aún segund lo que adelante provare, con la merçed de Dios, porné en este libro » (ibid., p. 176).
Selon don Juan Manuel, le critère de la vérité de l’écriture est l’expé-rience individuelle alors que dans la plupart des textes contemporains prime la conformité à l’auctoritas, sacrée ou profane. Cependant, déclarer la primauté de l’expérience sur tout autre critère est un choix éminemment rhétorique, tout aussi rhétorique que l’allégeance aux autorités. De fait, un examen de détail du Libro infinido ne permet pas de montrer qu’il se réfé-rerait davantage que les œuvres précédentes à des expériences concrètes de son auteur : le contenu varie peu (de nombreux passages rappellent le Libro de los estados, auquel ils renvoient parfois littéralement) et c’est seu-lement le mode de justification du discours qui a changé. Don Johán n’est plus un double fictionnel de don Juan Manuel cité comme une autorité par les personnages, mais l’instance énonciative principale qui parle au nom de ce qu’il a expérimenté en lui et chez autrui, témoin direct de lui-même et du monde. Il s’agit de s’appuyer sur une autorité de l’expérience,
226 OLIVIER BIAGGINI
comme il existe – si j’ose dire – une autorité de l’auctoritas. Ce don Johán déclare que les choses qui constituent la matière du Libro infinido sont « de las que fiz e vi fazer e me fallé dellas bien, e yo e los otros. Et en diziendo de las que me fallé bien, se entiende que, si de algunas fiz en contrario, que me fallé dellas mal » (ibid., p. 117-118). Cette idée de « fallarse ende bien » reprend littéralement la formule qui clôturait invariablement chacun des récits-cadres dans la première partie du Conde Lucanor73. Là où l’on attendrait l’adoption d’un nouveau dispositif de légitimation du discours, on doit constater une conti-nuité révélatrice : la façon de recourir à l’expérience prétendument vécue dans le Libro infinido répète littéralement la validation finale de l’exemple de fiction dans El conde Lucanor.
Or, c’est sur cette seule formule qu’est construite toute la véracité du Libro infinido. De façon systématique, l’enseignement contenu dans chacun des chapitres se trouve justifié par une ou deux phrases du type : « Et la prueva desto es que los que esto fizieron se fallaron ende bien. Et el contrario »74. Le livre se fonde sur la constatation empirique des conséquences d’un com-portement pour ériger celui-ci en modèle de conduite à suivre ou à éviter. De fait, le raisonnement est circulaire car, indépendamment de l’expé-rience réelle de don Juan Manuel, qui reste inaccessible, la règle préexiste aux faits dont elle est censée être tirée. Cette prueva est un pur artifice rhé-torique qui donne l’illusion que le savoir contenu dans le livre est ancré dans le vécu personnel de son auteur. La circularité du raisonnement devient patente lorsque, ponctuellement, est en outre prise en compte l’expérience virtuelle de Fernando, que don Johán se croit capable de pré-dire sans erreur possible : « Et para esto non ha menester otra prueva sinon que es cierto que, si lo así fiziéredes, que vos fallaredes ende bien »75. S’il n’y a pas besoin de preuve, c’est littéralement parce que la preuve viendra après la chose à prouver, mais cette preuve est pourtant établie ici et maintenant par l’énonciation de don Johán.
Bien au-delà de la naïve mise en forme d’une expérience effectivement vécue, le livre apparaît régi par un parti pris théorique qui fait du moi, doté d’une expérience et d’un statut de témoin, la principale source de véridi-cité. Formellement, cette primauté du moi se traduit par une unification du prologue et du corps du traité en un seul discours à la première per-sonne, la seule différence entre le paratexte et le texte tenant à la conven-
73. C. Mota signale cette reprise littérale, mais seulement pour comparer l’usage de l’ana-phore que font les deux œuvres (ibid., p. 69).
74. Ibid., p. 160. Ces formules apparaissent, notamment pour clore un chapitre, avec une régularité inlassable qui rythme le livre tout entier : p. 122, 123, 125, 126, 128, 134, 137, 143 (deux fois), 146, 149, 150, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 168, 169, 171, 172 (deux fois), 173, 174, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 (deux fois).
75. Ibid., p. 149.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 227
tion d’un interlocuteur différent : cet interlocuteur, indéterminé dans le prologue, devient Fernando dans le reste du traité.
Le Libro de las armas et le tractado de la Asunción de la Virgen María ne ména-gent même plus cette frontière ténue entre un éventuel prologue et le corps du texte. On ne peut pas dire pour autant que ces œuvres soient dénuées de paratexte. Celui-ci a simplement investi les articulations mêmes du texte, à moins qu’il ne soit plus juste de décrire la contamination en sens inverse : le mode d’écriture se rapproche davantage des prologues des œuvres anté-rieures que de ces œuvres elles-mêmes et on pourrait donc les lire comme des paratextes sans texte, ou dont le texte s’identifierait avec un en deçà du livre, à savoir l’expérience que le moi a vécue et sur laquelle il compte appuyer son discours. Ainsi, dans les deux cas, le livre déroule un discours adressé à un destinataire identifié qui, pour le Libro de las armas, est aussi présenté comme un commanditaire, car l’œuvre répond à trois questions qu’il est censé avoir posées à don Johán. Dans les deux cas, ce destinataire est un dominicain. Pour le tractado de la Asunción, c’est Ramón Masquefa, prieur du couvent des prêcheurs de Peñafiel que don Juan Manuel a lui-même fondé76 : dans ce traité, don Johán mesure directement son savoir à celui des clercs lettrés, non seulement parce qu’il donne son avis à un ecclésiastique sur un point de théologie (le fait de savoir si la Vierge se trouve corps et âme au Ciel), mais aussi parce qu’il prend position contre ce qu’il a entendu dire « a algunas personas onradas et muy letradas »77. Pour le Libro de las armas, le destinataire est fray Johán Alfonso qui, comme dans la partie finale du Libro infinido, apparaît comme commanditaire de l’œuvre. Les premiers mots du Libro de las armas sont :
Frey Iohan Alfonso, yo don Iohan pare mientes al ruego et afincamiento que me vos diesse por scripto tres cosas que me aviades oido, por tal que se vos non oluidassen et las pudiesedes retraer quando cumpliese78.
Le libro de las armas ou Libro de las tres razones peut être considéré à bien des égards comme un point d’aboutissement dans la revendication d’une auto-rité sociopolitique. Don Juan Manuel entend y montrer que son lignage a été élu par Dieu, contrairement à celui d’Alphonse XI qui, dès l’époque de son bisaïeul Alphonse X, est entaché par des signes qui dégradent sa dignité familiale et sa légitimité politique79. Ces signes sont le rêve néfaste
76. Sur ce personnage, voir Francisco garcía serrano, Preachers of the City: the Expan-sion of the Dominican Order in Castile (1217-1348), La Nouvelle-Orléans : University Press of the South, 1997.
77. Don juan manuel, tractado de la Asunción de la Virgen, in : Obras completas, éd. citée, 1, p. 509.78. Don juan manuel, Libro de las armas, in : Obras completas, éd. citée, 1, p. 121.79. Pour une étude d’ensemble de ce traité, sous l’angle de ses enjeux politiques, voir María
Cecilia ruiz, Literatura y política: el Libro de los estados y el Libro de las armas de don Juan Manuel, Potomac : Scripta humanistica, 1989, p. 58-131.
228 OLIVIER BIAGGINI
de la reine Béatrice lorsqu’elle était enceinte d’Alphonse X, le compor-tement injuste d’Alphonse X et de la reine Yolande vis-à-vis de l’infant Manuel et de sa femme Constance, qui a peut-être été assassinée par la reine, l’allusion à la malédiction de Sanche IV par Alphonse X, qui se transmet à toute sa descendance, etc. Face à la lignée maudite, celle des Manuel est investie d’une mission providentielle au service de Dieu et d’une dignité supérieure à tous les autres lignages qui se traduit notam-ment par la capacité des Manuel à faire des chevaliers sans être nécessai-rement chevaliers eux-mêmes. Or, cette revendication maximale d’une autorité lignagère et sociopolitique, à une époque où don Juan Manuel a perdu tout pouvoir effectif en Castille, va aussi de pair avec l’aboutisse-ment d’une autre évolution, essentiellement discursive. Le Libro de las armas offre le résultat du travail continu de don Juan Manuel sur les formes du paratexte qui ont été pour lui un espace d’expérimentation d’écriture. Ici, le paratexte ne peut plus être distingué du texte, puisque tout le traité se présente comme une lettre à fray Johán Alfonso, sans aucune rupture énon-ciative, tout imprégnée de fonctions paratextuelles.
Ainsi, à des moments clefs de son exposition en trois razones, le texte définit son propre statut en prétendant énoncer son rapport à la vérité. Don Juan Manuel affirme que les trois razones sont issues de propos tenus oralement dans son entourage par des personnes dignes de foi, qu’il a réunis pour en faire un discours unitaire :
[…] cred que todo passo assi verdaderamente. Pero deuedes entender que todas estas cosas non las alcançe yo, nin vos puedo dar testimonio que las yo bi. Ca si quiera, bien podedes entender que non pude yo ver lo que acaesçio quando nascio mio padre; […] mas oylas a per-sonas que eran de crer. Et non lo oy todo a vna persona, mas oy vnas cosas a vna persona, et otras, a otras; et ayuntando lo que oy a los vnos et a los otros, con razón ayunte estos dichos (et por mi entendimiento entendi que passara todo el fecho en esta manera que vos yo porne aqui por escripto) que fablan de las cosas que passaran; et asi contesçe en los que fablan [de] las Scripturas: que toman de lo que fallan en vn lugar et acuerdan en lo que fallan en otros lugares et de todo fazen vna razón; […] Et vos, et los que este scripto leyeren, si lo quisie-redes crer, placernos [a]; et si fallaredes otra razón mejor que esta, a mi me plazera mas que la falledes et la creades80.
Comme on l’a souvent remarqué, la principale innovation consiste ici à appli-
80. Libro de las armas, éd. citée, p. 121-122. Dans le sillage de cette déclaration initiale, d’autres déclarations convergentes apparaissent dans le traité. Le souci de véracité a été analysé par Alan DeyermonD, « Cuentos orales y estructura formal en el Libro de las tres razones (Libro de las armas) », in : Don Juan Manuel, VII centenario, Murcie : Universidad de Murcia-Academia Alfonso X el Sabio, 1982, p. 75-87, et surtout par Dennis P. seniff, « “Así fiz yo de lo que oý”: orality, authority, and experience in Juan Manuel’s Libro de la caza, Libro infinido, and Libro de las armas », in : Antonio torres alcalá et al., Josep Maria Solà-Solé: homage, homenaje, homenatge (mis-celánea de esudios de amigos y discípulos), 2 vol., Barcelone : Puvill, 1984, 1, p. 91-109.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 229
quer à des sources orales un traitement normalement réservé aux sources écrites : don Juan Manuel soumet les discours oraux qu’il a recueillis à une opération de compilation. Il devient, en quelque sorte, témoin des décla-rations de tous les témoins, le témoignage direct n’étant pas pour autant exclu puisque la troisième razón relate l’entretien que don Juan Manuel a eu personnellement avec le roi Sanche alors que celui-ci était sur son lit de mort. Toutefois, le transfert le plus hardi consiste certainement à com-parer cette opération à l’activité de l’exégèse sacrée qui s’efforce de faire concorder différents passages bibliques. Le Libro de las armas applique donc aux anecdotes historico-familiales des Manuel un traitement textuel qui érige don Johán à la fois en compilator et commentator, rehaussant par là même la dignité de la matière abordée. L’activité d’exploration de la mémoire familiale, qui est en fait une activité de création de cette mémoire, est assi-milée à un exercice scolastique dans lequel don Juan Manuel serait passé maître. Au cœur de ce processus de surgissement de la vérité, en effet, c’est l’entendement personnel de don Juan Manuel qui sert de critère ultime (« et por mi entendimiento entendi… »).
Cependant, le point le plus troublant dans le passage cité est peut-être le décalage établi entre l’injonction initiale – qui exhorte à croire que tout s’est vraiment passé tel que le livre le dit – et l’injonction finale – qui sou-ligne, au contraire, que ce qui est écrit n’est qu’une interprétation et que d’autres versions de l’histoire sont donc possibles. D’une part, la deuxième injonction fait sourire par son caractère purement théorique : qui d’autre que don Juan Manuel pourrait être en mesure de proposer une meilleure version de ces histoires issues des sources orales qui, précisément, sont inaccessibles à quiconque n’appartient pas à son cercle ? D’autre part, la contradiction entre les deux injonctions crée une autre similitude entre le texte de don Juan Manuel et le texte sacré. Même si la ratio scolastique est là pour rendre compte des apparentes contradictions de la lettre et en aplanir les conflits, tout ce qui est dit dans le texte sacré ne peut être prouvé par cette voie et il reste toujours une part de la vérité du texte qui n’est accessible que par la foi. De la même façon, au-delà de tous les cri-tères de véracité qu’il expose, don Juan Manuel se sent autorisé à exhorter son lecteur à simplement ajouter foi à son récit comme on doit le faire en étant confronté à certains points de la doctrine sacrée. C’est dans ce sens que l’on pourra lire la phrase finale du livre :
Et por que las palabras son muchas [et] oylas a muchas personas, non podría ser que non oviese y algunas palabras mas o menos, o mudadas en alguna manera; mas cred por cierto que la iustiçia et la sentencia et la entençion et la verdat asi passo commo es aqui scripto81.
81. Ibid., p. 140.
230 OLIVIER BIAGGINI
On retrouve là une problématique propre au texte sacré : au-delà des éven-tuelles erreurs de transmission du texte, mais aussi des limitations propres à la lettre (sens littéral), il s’agit de trouver la sententia qui coïncide avec l’intention et la vérité, mais aussi avec cette iustiçia, que l’on comprendra à la fois comme justesse (dans la forme du discours) et justice (de la cause que sert ce discours).
Pour conclure cette approche panoramique des paratextes manuélins, je proposerai un rapprochement qui me paraît saisissant. Pour résumer l’évo-lution de la conception que don Juan se fait de sa propre autorité, il suffit d’examiner ensemble deux passages, issus de ses paratextes, qui envisa-gent tous deux l’insatisfaction du lecteur face au texte qu’il s’apprête à trouver dans le livre. Dans les deux cas, le lecteur est alors renvoyé à un autre texte, extérieur au volume qu’il a sous les yeux. Le premier pas-sage apparaît dans le prologue de la Crónica abreviada. Il invite le lecteur de l’œuvre abrégée à aller consulter la chronique alphonsine s’il a besoin d’une information plus complète :
Pero ssi alguno otro leyere en este libro e non lo fallare por tan conplido, cate el logar onde fue sacado en la Cronica, en el capitulo de que fara mencion en este libro, e non tenga por mara-villa de lo non poder fazer tan conplida mente commo conviene para este fecho82.
Par cette indication du paratexte, le texte de don Juan Manuel se trouve explicitement assujetti au texte premier dont il dérive, qui est le seul à être explicitement investi d’une autorité et qui, par conséquent, reste le texte de référence. La valeur propre de la Crónica abreviada dépend simplement de sa conformité à la chronique alphonsine qui le précède.
Le second passage, issu du prologue général, et donc d’une des toutes dernières compositions que don Juan Manuel ait produites, offre un point de comparaison qui permet de mesurer le chemin accompli depuis l’époque de la Crónica abreviada. L’auteur a évoqué le volume de ses œuvres com-plètes qu’il a fait faire afin de remédier à la négligence des copistes et il invite le lecteur qui y trouverait une erreur à aller consulter ce volume avant de juger son auteur :
Et ruego a todos los que leyeren cualquier de los libros que yo fiz que si fallaren alguna razón mal dicha, que non pongan a mí la culpa fasta que vean este volumen que yo mesmo concerté. E desque lo vieren, lo que fallaren que es ý menguado non pongan la culpa a la mi entención, ca Dios sabe buen la ove, mas póngala a la mengua de mi entendimiento […]83.
Dans sa forme, la démarche est identique : s’il est confronté à un passage
82. Crónica abreviada, éd. citée, p. 577.83. El conde Lucanor, éd. citée, p. 6.
STRATÉGIES DU PARATEXTE CHEZ DON JUAN MANUEL 231
qu’il juge défectueux, le lecteur devra se reporter à un autre texte, consi-déré comme fiable, qui permettra de trancher la question. Pourtant, dans ce cas, le texte autorisé n’est pas le texte d’un autre : c’est non seulement le texte même des œuvres complètes de don Juan Manuel, mais celui qu’il a révisé lui-même, un manuscrit d’auteur qui, dans l’idéal, serait exempt de toute intervention extérieure. Francisco Rico84 a montré le lien que pour-rait avoir ce dispositif avec le système universitaire de la pecia, qui prévoit qu’un exemplar, approuvé par les maîtres, serve de modèle et de référence à toutes les copies qui en seront tirées à l’intention des étudiants. En imi-tant, pour ses propres textes, le système de validation appliqué aux textes prestigieux que commentent les maîtres universitaires, don Juan Manuel semble renouer, de façon très sérieuse cette fois, avec la boutade de la fin du prologue du Libro del cavallero et del escudero. En outre, si ce volume de référence est censé avoir été confié au monastère dominicain de Peñafiel85, que don Juan Manuel a fondé et où il a décidé de reposer après sa mort, il s’agirait de suggérer l’union intime du corps de l’auteur et du corpus authentique de ses textes. Toutefois, comme Laurence De Looze86, on est en droit d’émettre des doutes au sujet de l’effectivité d’un tel dispositif. D’une part, un livre sans « erreur » est sans doute un objet irréalisable au Moyen Âge : bien plus qu’il se réfère à un possible objet concret, le pro-logue général fait miroiter à son lecteur la possibilité de combler un désir, celui d’accéder en toute transparence à l’intention de l’auteur. D’autre part, même si un tel livre était réalisable, son efficacité pratique serait à peu près nulle : peut-on imaginer que le lecteur, pris de doute devant la copie qu’il consulte, se rende effectivement à Peñafiel ou ailleurs pour véri-fier le détail dans le volume autorisé ? Loin de toute utilité pratique, ce que construit don Juan Manuel est avant tout un modèle théorique et qui, pour être théorique, n’en est pas moins efficient et fondateur d’un pou-voir. Posé hors de lui-même, ce substitut de l’auteur est doté d’une auto-rité qui découle de son « objectivité » offerte à la vérification. En posant en dehors de lui-même ce texte authentique, écrin idéal de son intention, don Juan Manuel se réserve la possibilité de s’y référer comme à une auto-rité et invite ses lecteurs à en faire autant. Le processus de comparaison et de validation auquel est invité le lecteur s’apparente d’ailleurs au méca-nisme qui sous-tend tout argument d’autorité : un discours est doté d’au-torité non en vertu de sa capacité intrinsèque à dire le vrai, propre à son
84. Francisco rico, « Crítica del texto y modelo de cultura… ».85. Cette information n’est pas donnée par le prologue général, mais par l’avant-prologue
du Conde Lucanor qui, d’après la majorité des critiques, n’est pas de don Juan Manuel. C’est donc de façon quelque peu abusive que l’on dit souvent du prologue général qu’il évoque le dépôt du volume des œuvres complètes de don Juan Manuel à Peñafiel.
86. L. De looze, op. cit., p. 31-33 et p. 105-107.
232 OLIVIER BIAGGINI
énoncé, mais parce qu’il est porteur d’une validité déjà posée – que lui confère par exemple le nom prestigieux de son auteur –, liée à son énon-ciation. Le discours d’autorité déplace la question de la vérité interne de l’énoncé vers celle de sa conformité à un modèle. Le dispositif textuel de don Juan Manuel exploite avantageusement cette logique : il pose une norme construite de toutes pièces et qui reste hors de portée afin que le texte se valide par lui-même. Dans le mouvement même qui consiste à se déclarer dépendant d’un modèle matériel, le texte s’affranchit ainsi par avance de toute critique qu’on pourrait lui adresser. En ce sens, le texte absent qui valide le texte présent, par l’intermédiaire du prologue, joue aussi un rôle paratextuel. Ce serait peut-être là une définition – restreinte mais dynamique – du paratexte : un espace que le texte crée au-delà de lui-même pour s’y reconnaître comme tel.